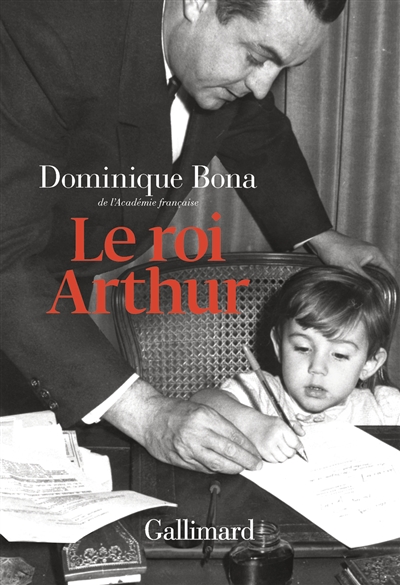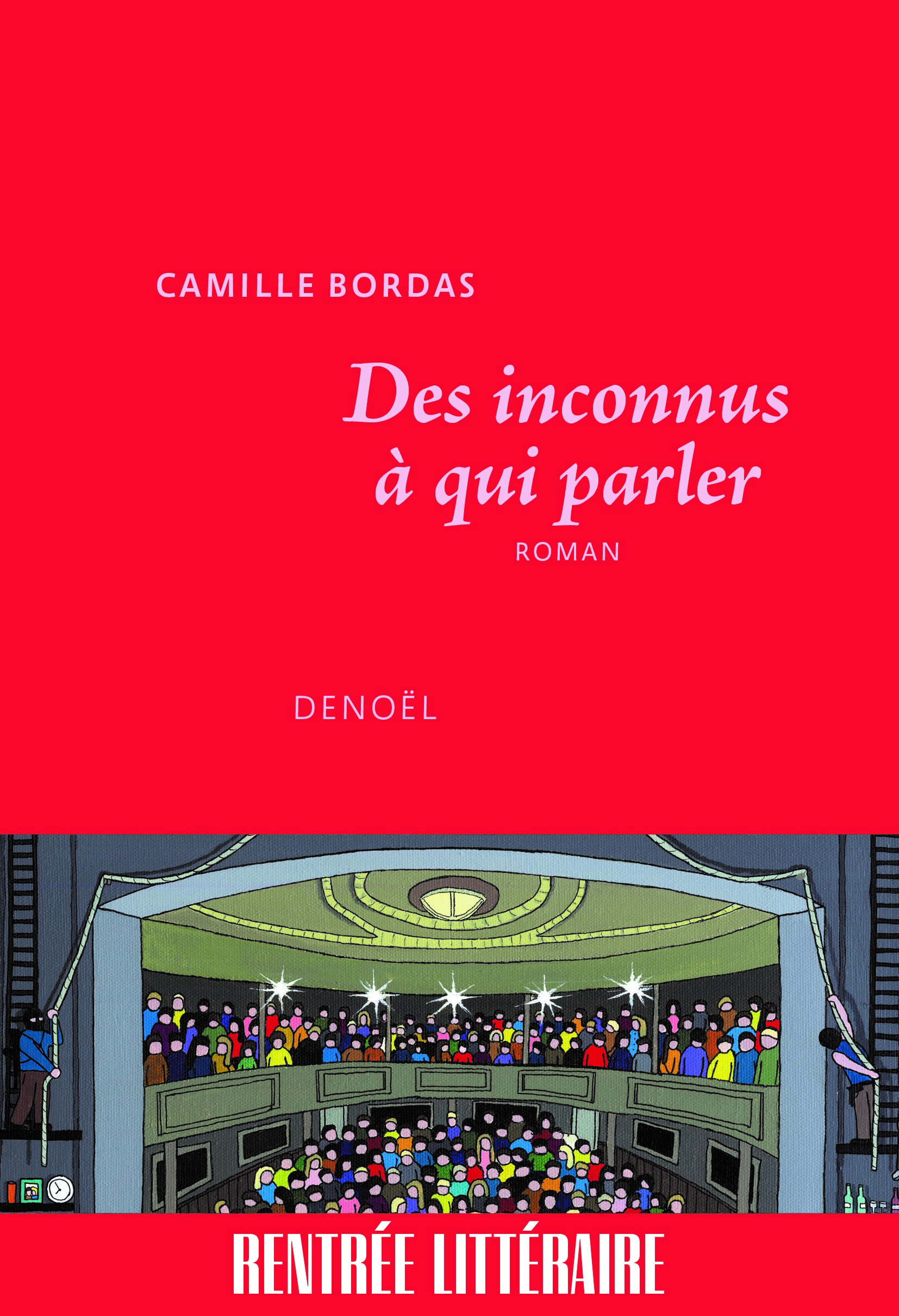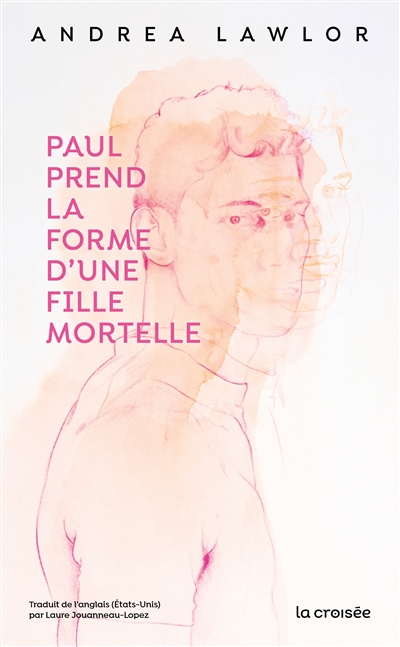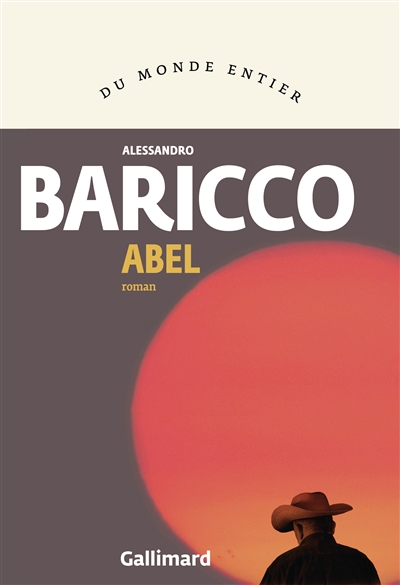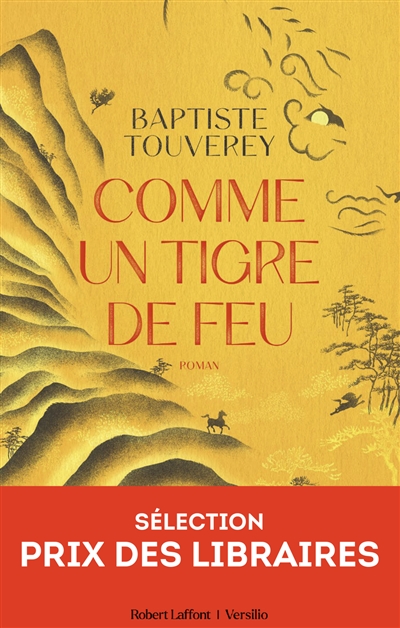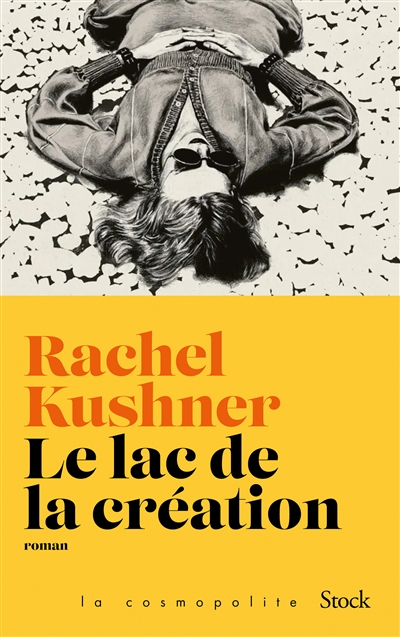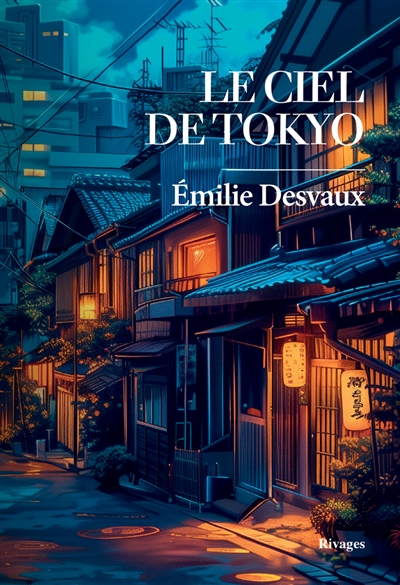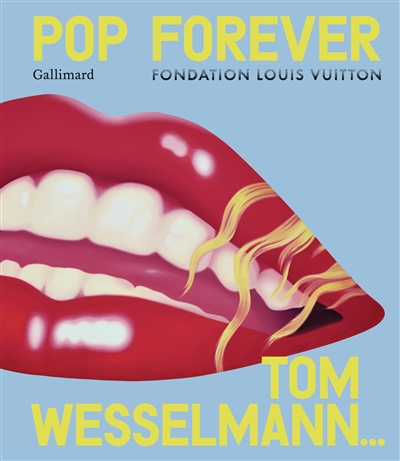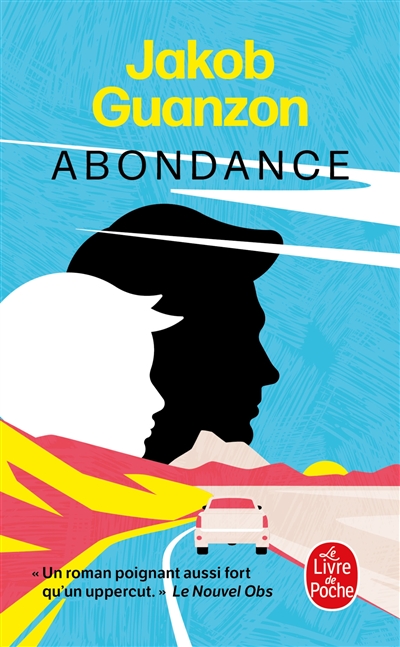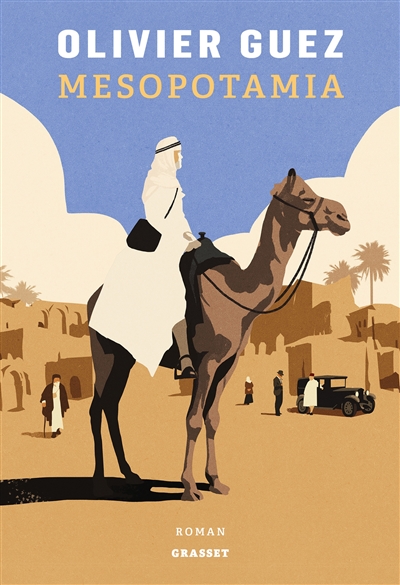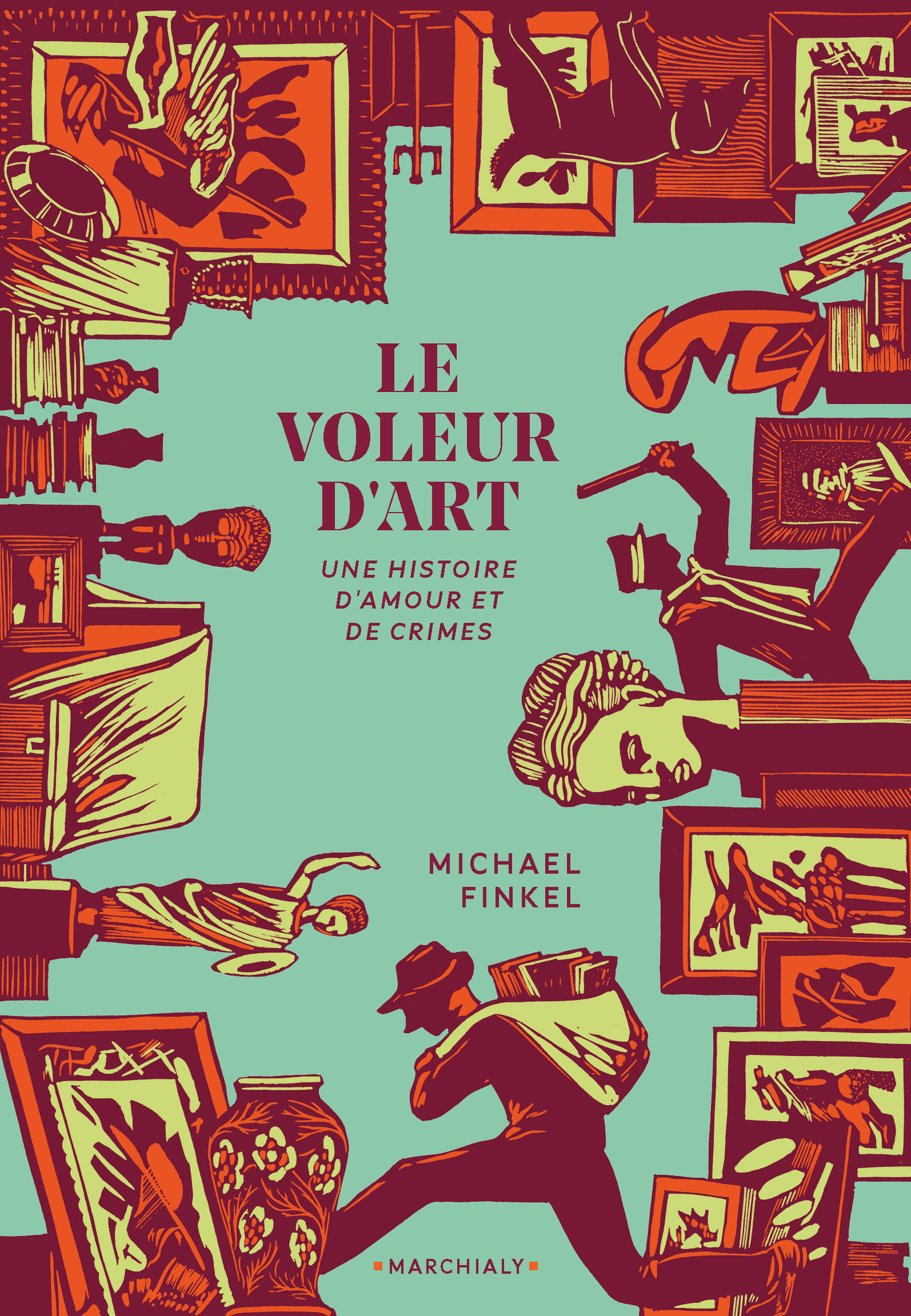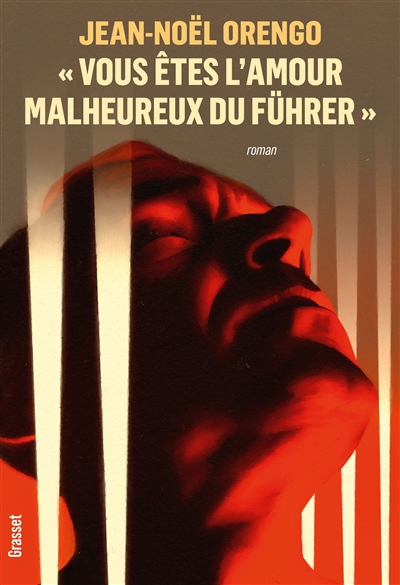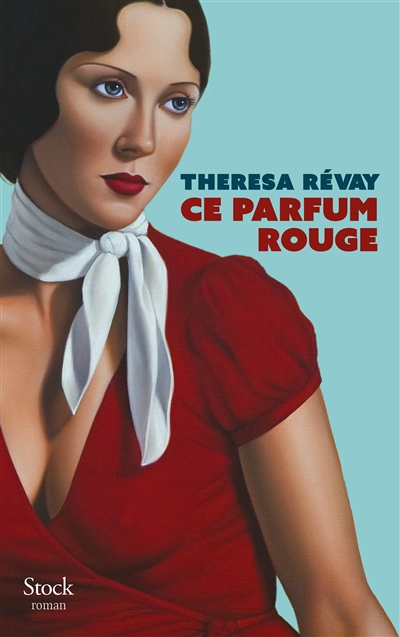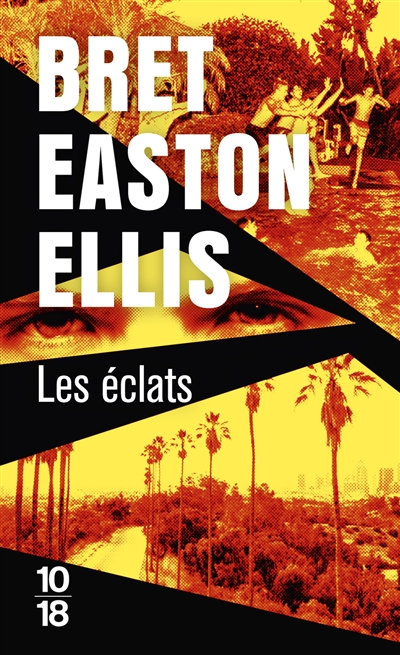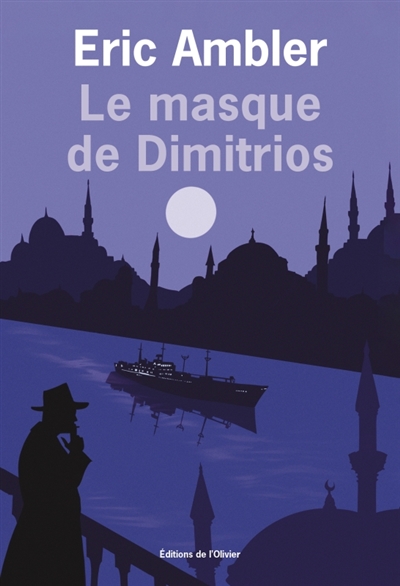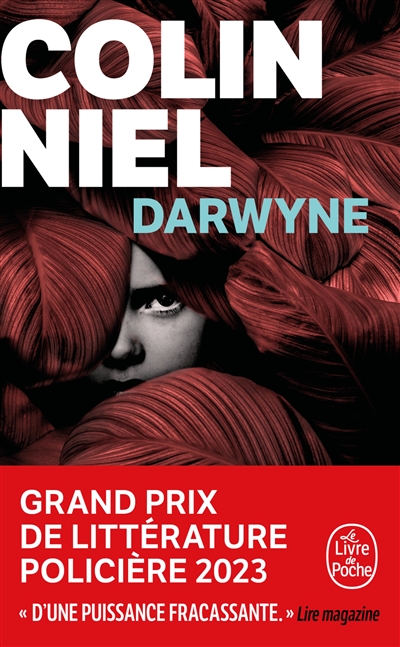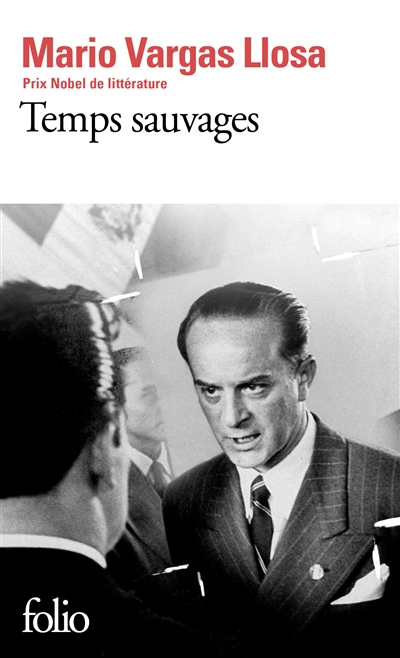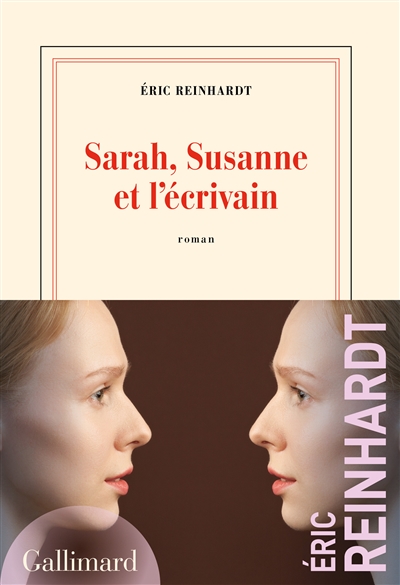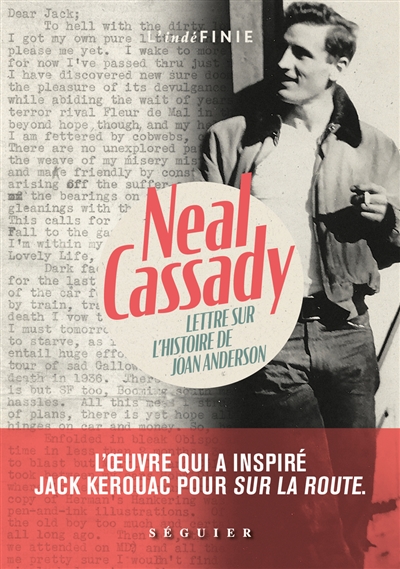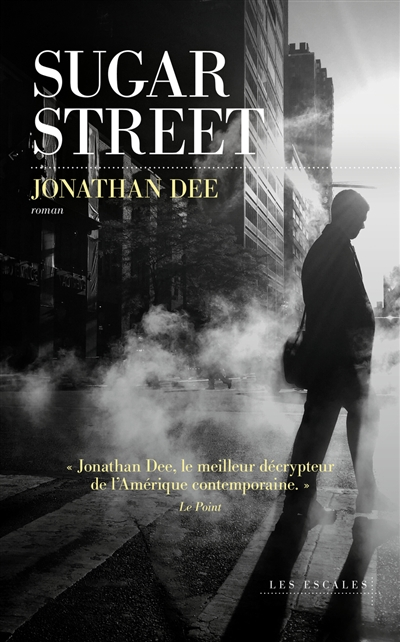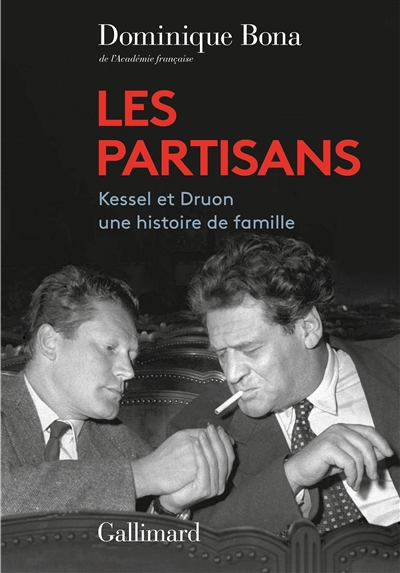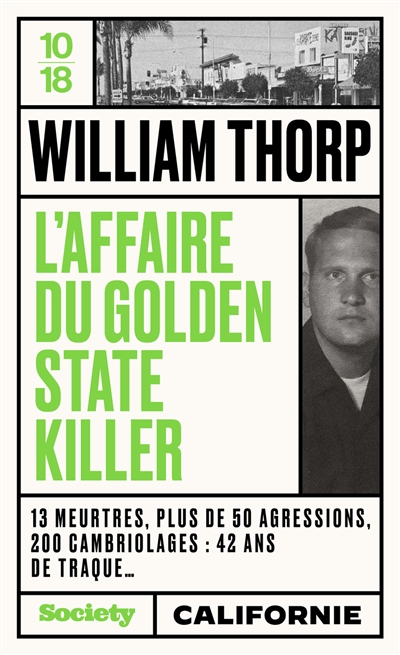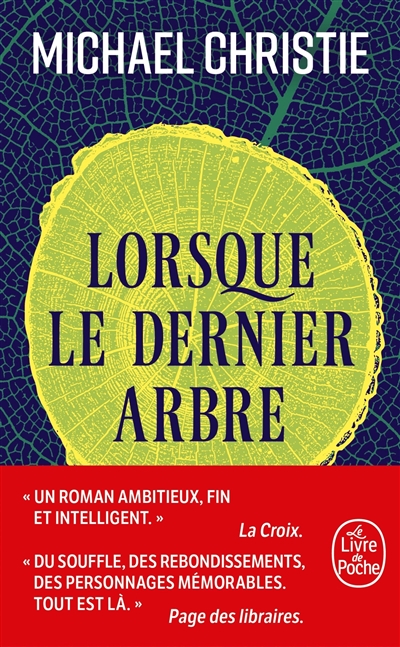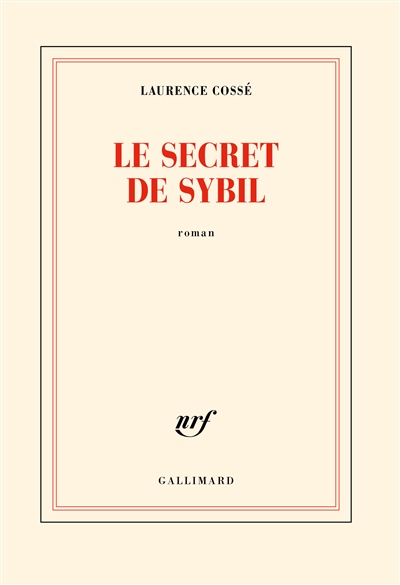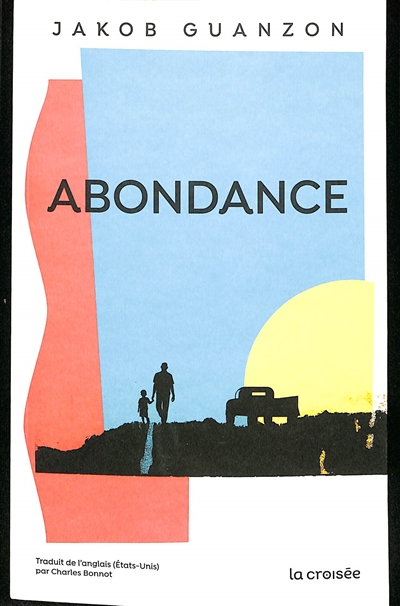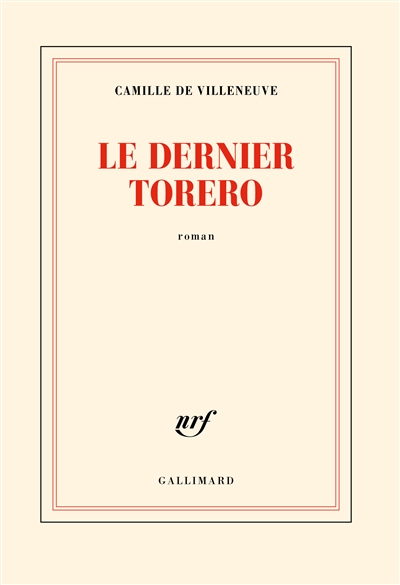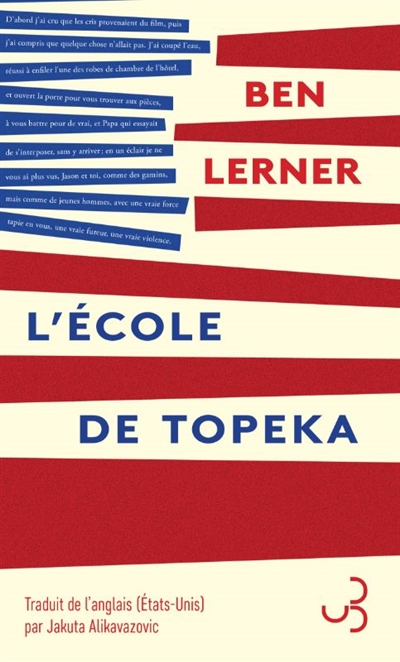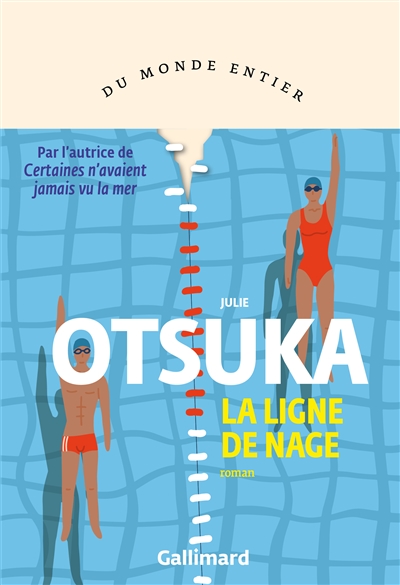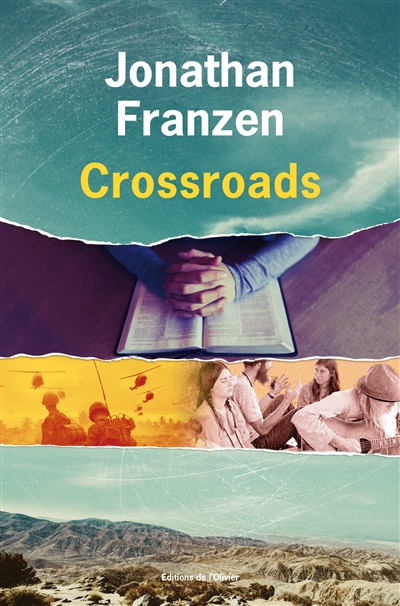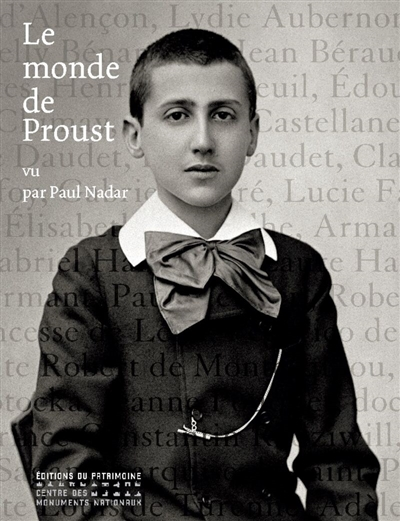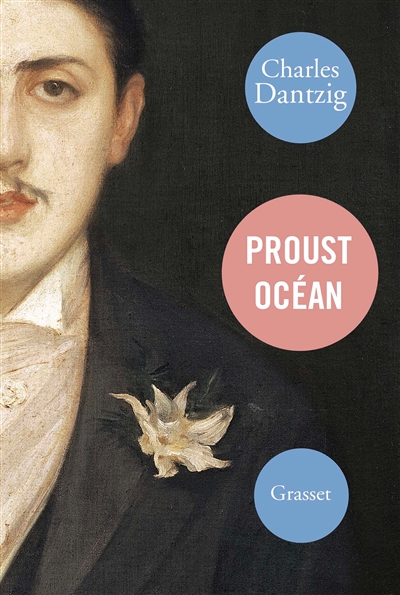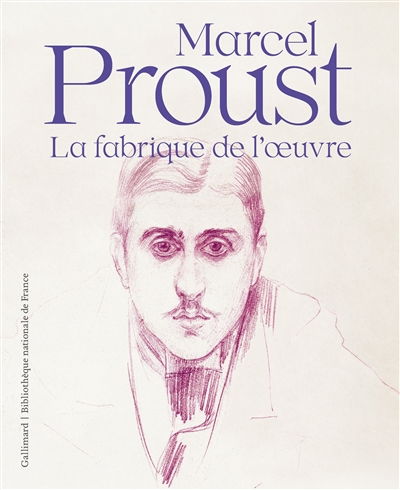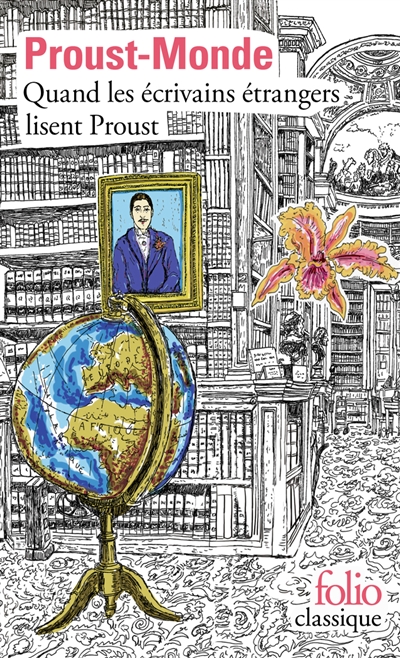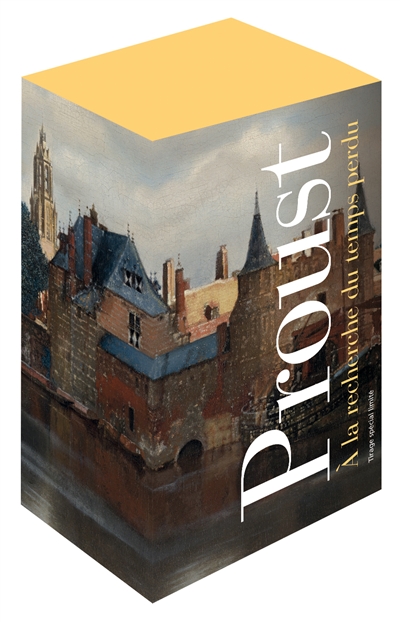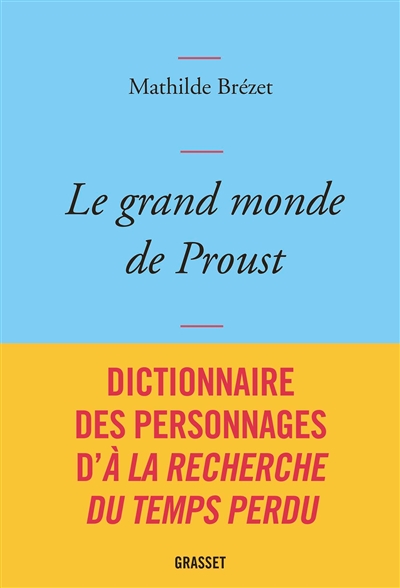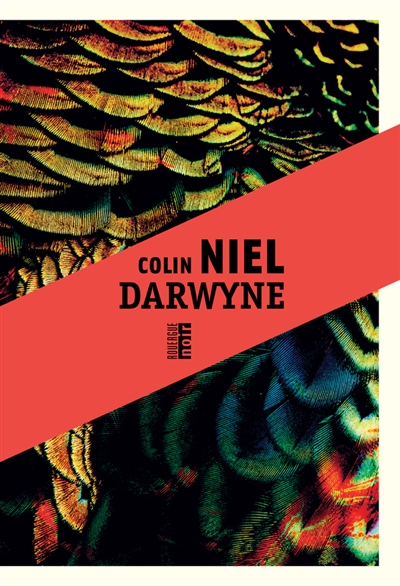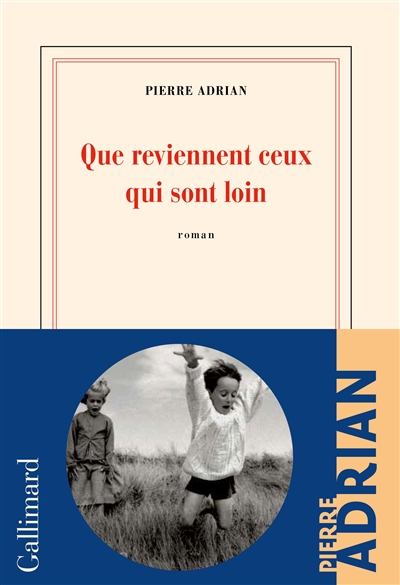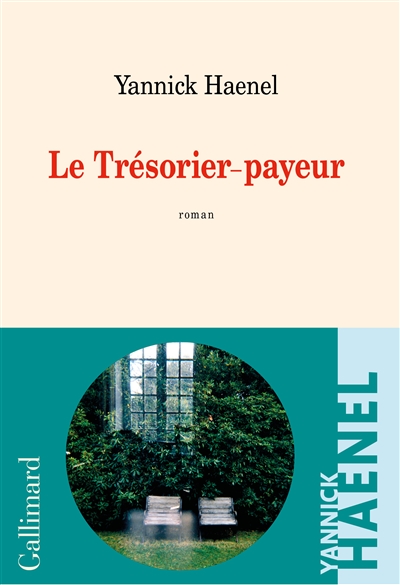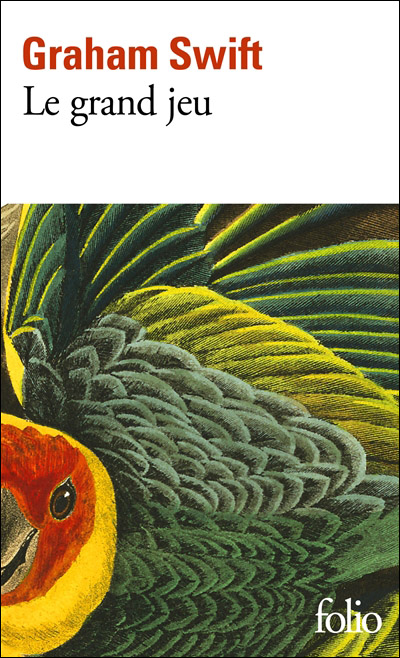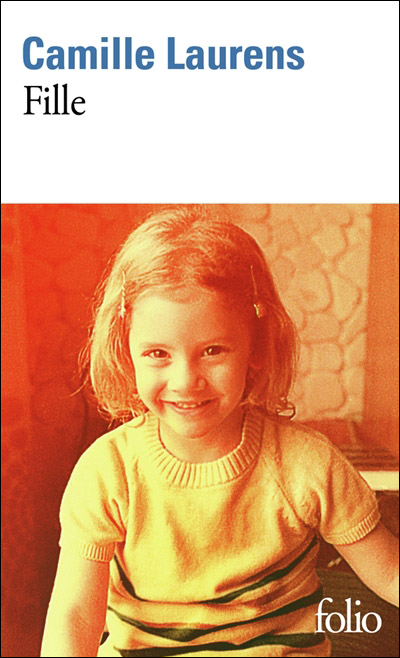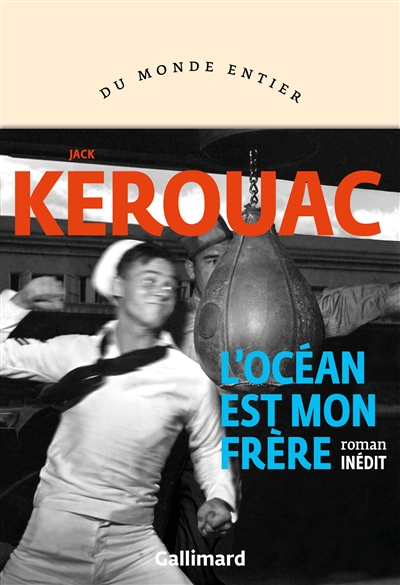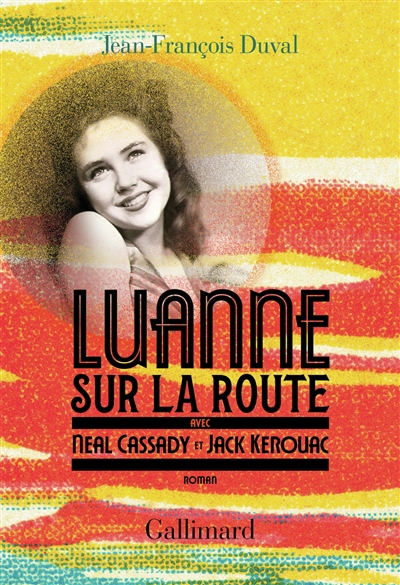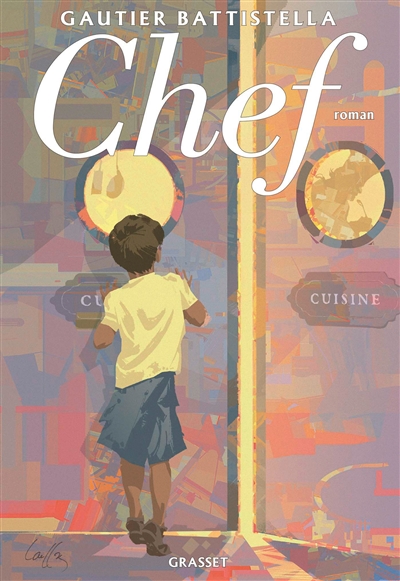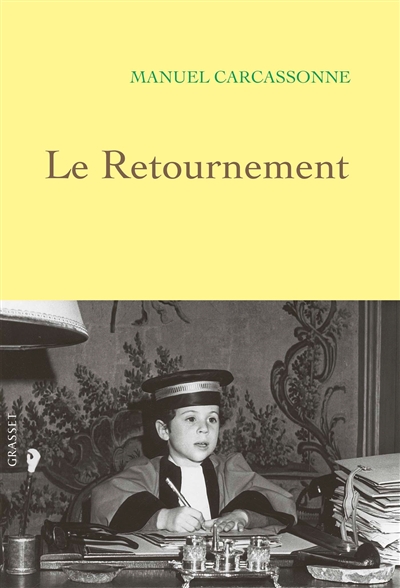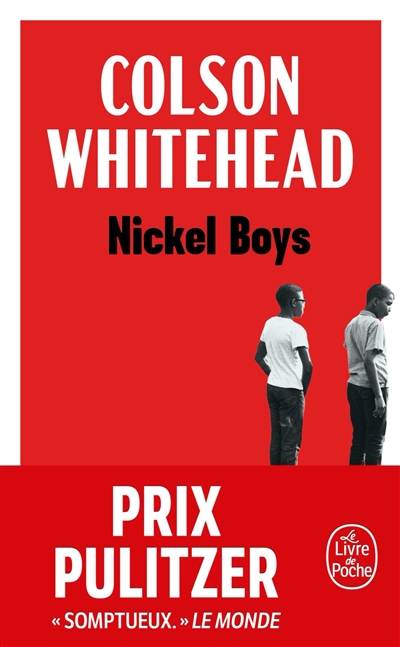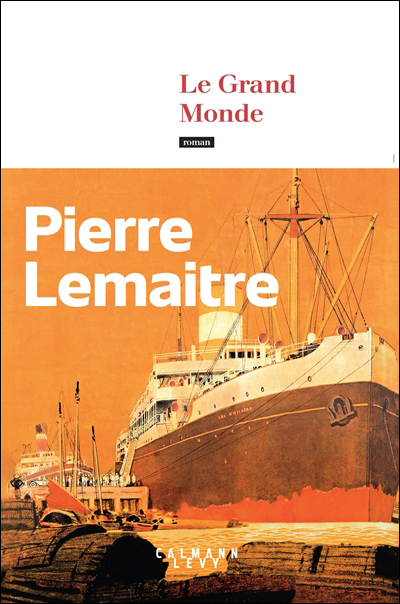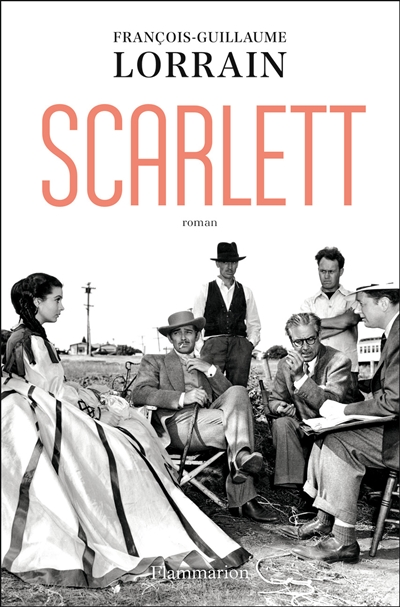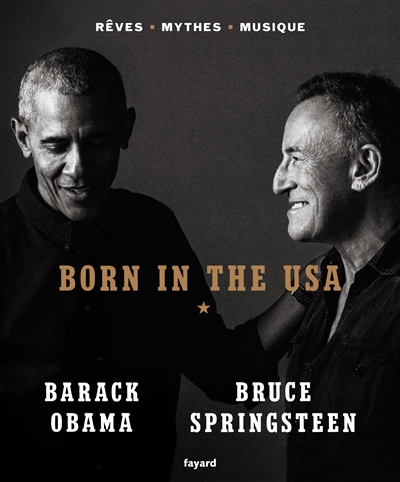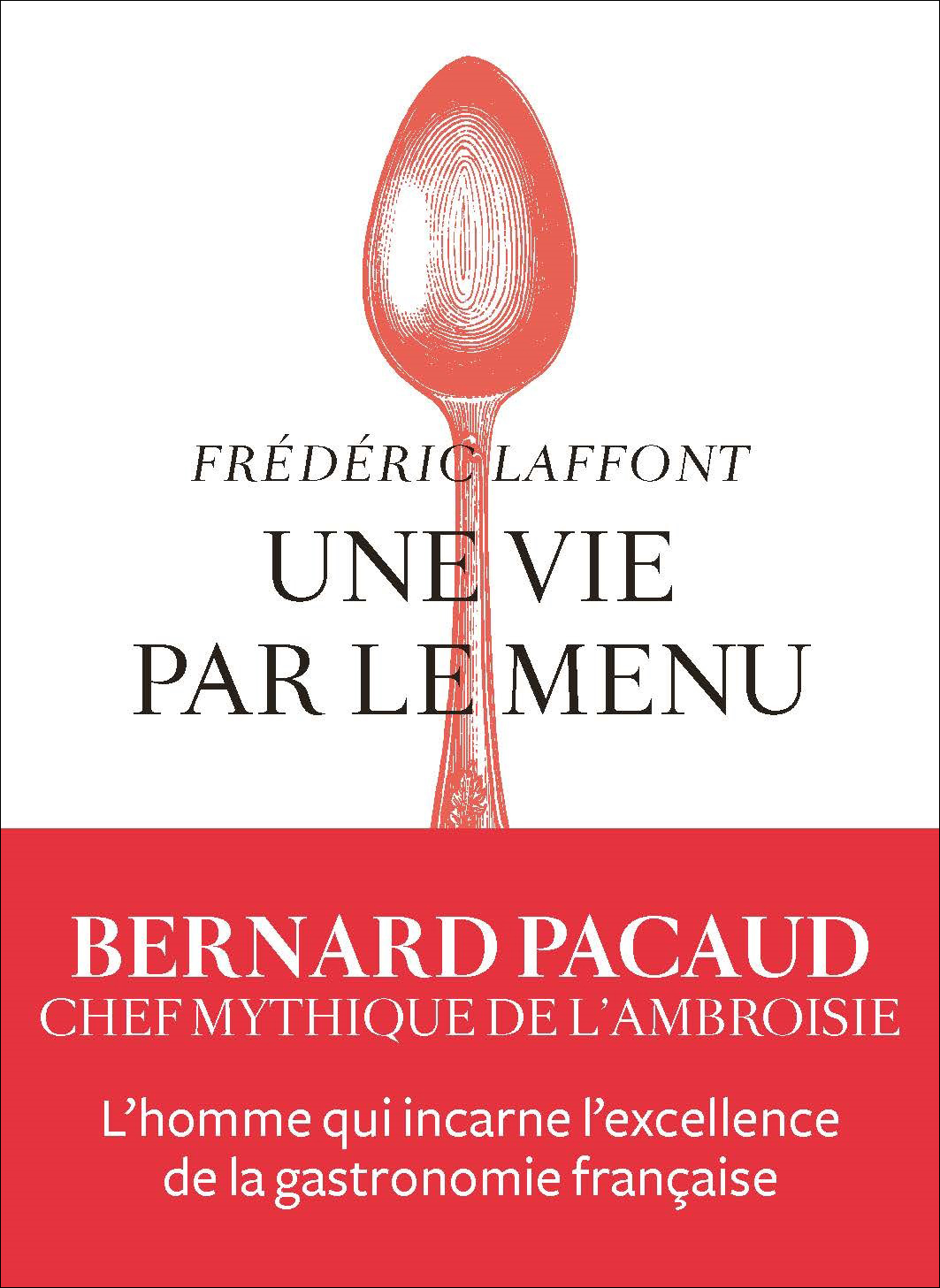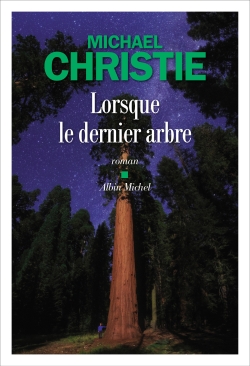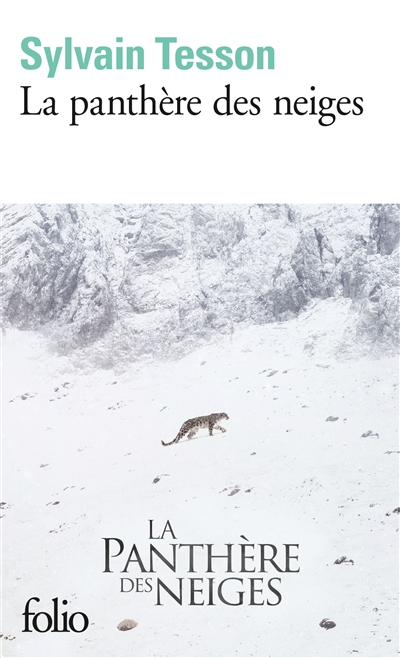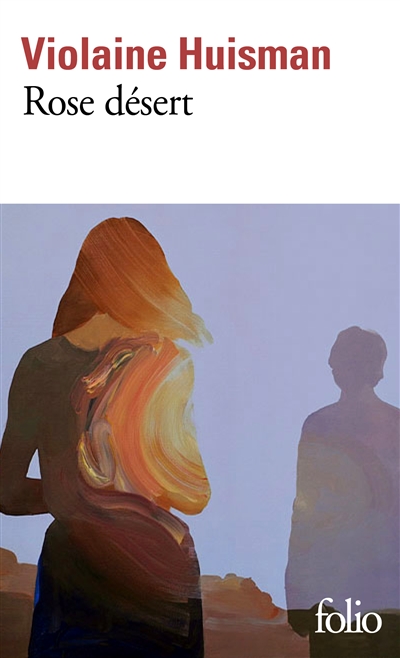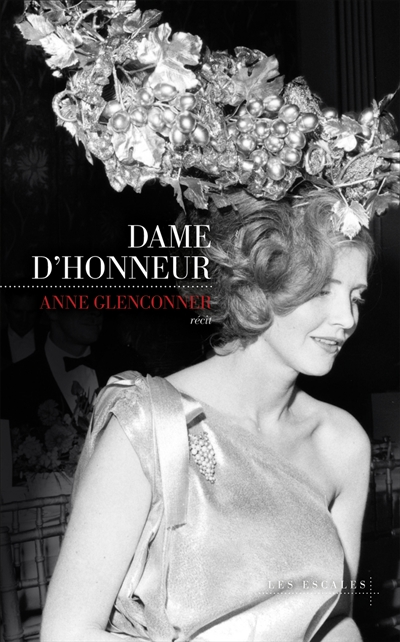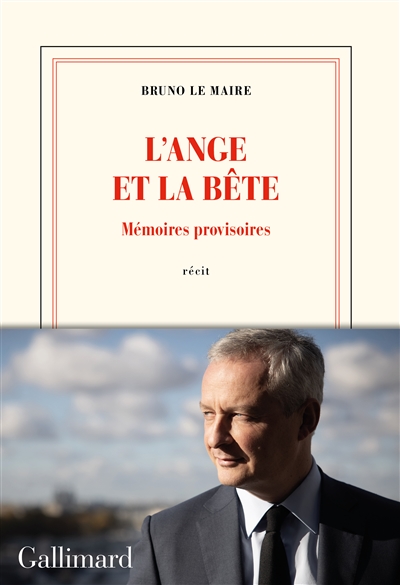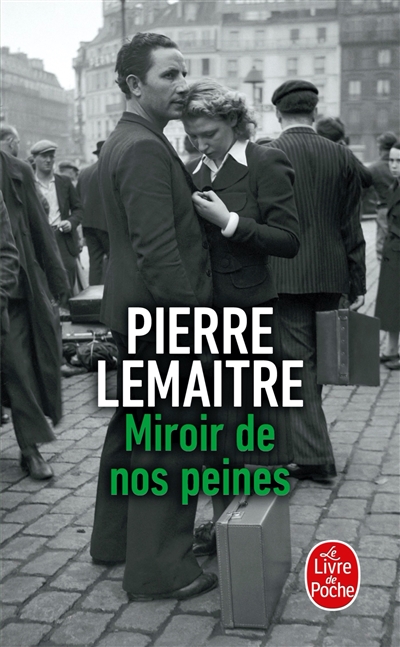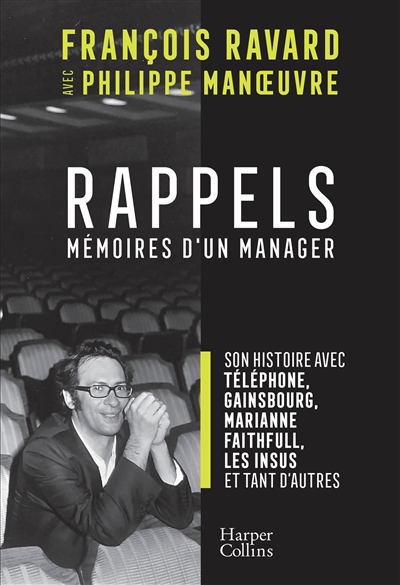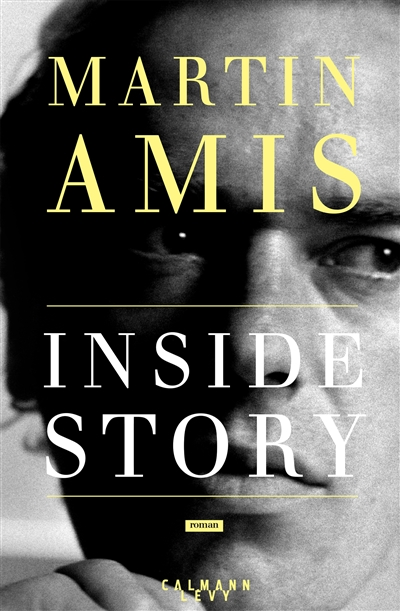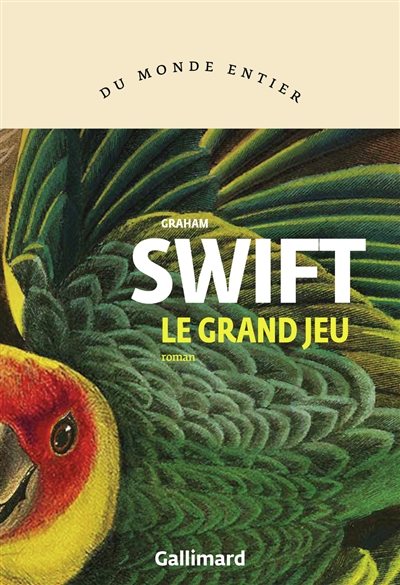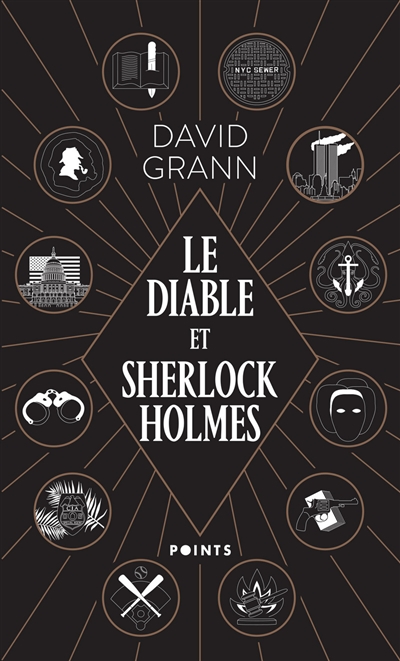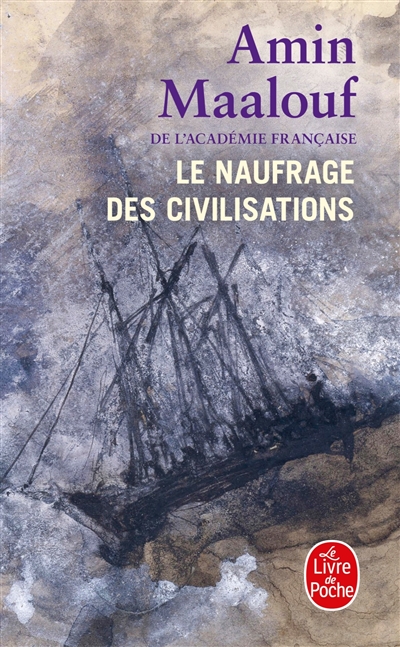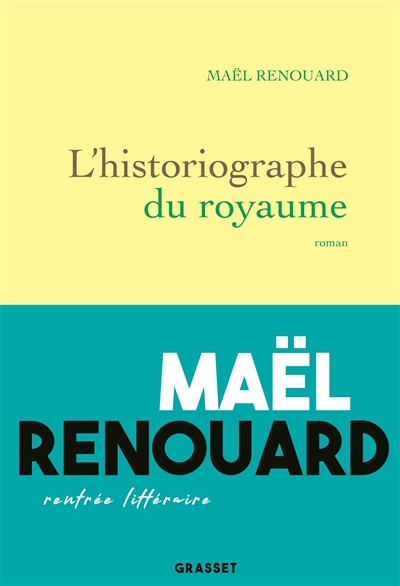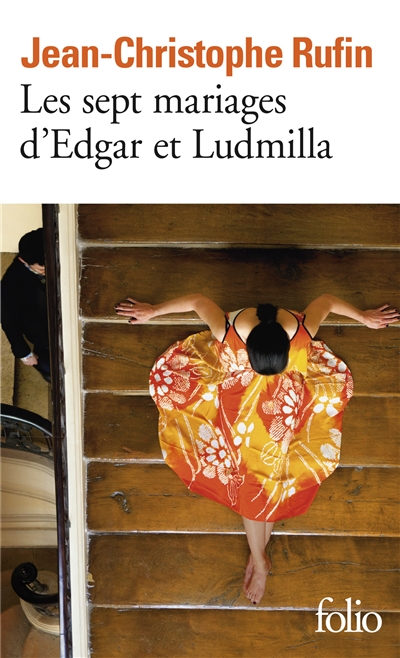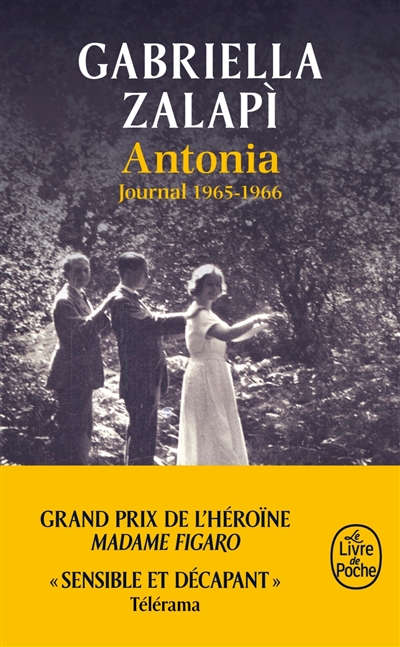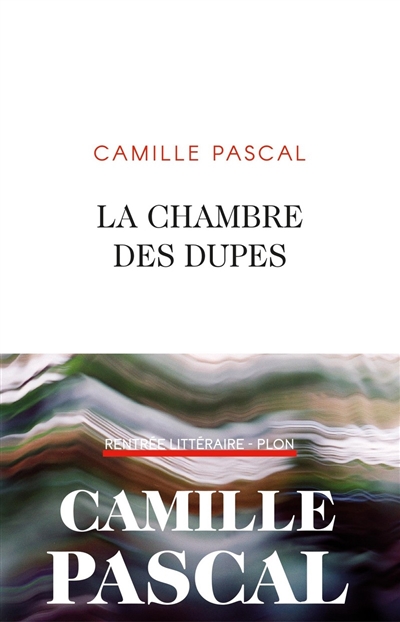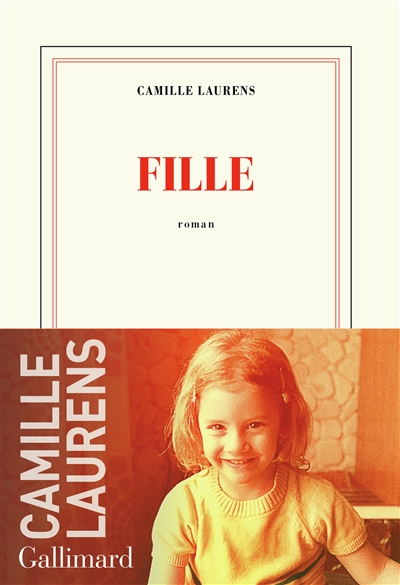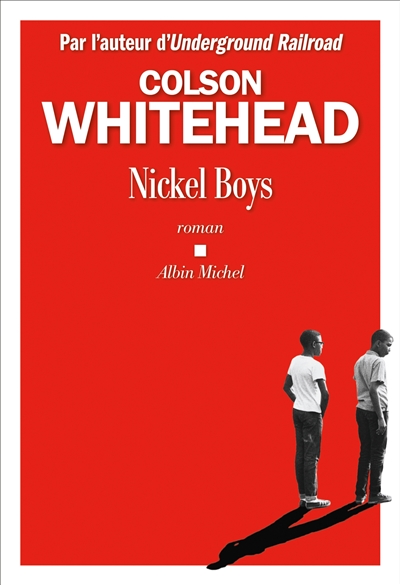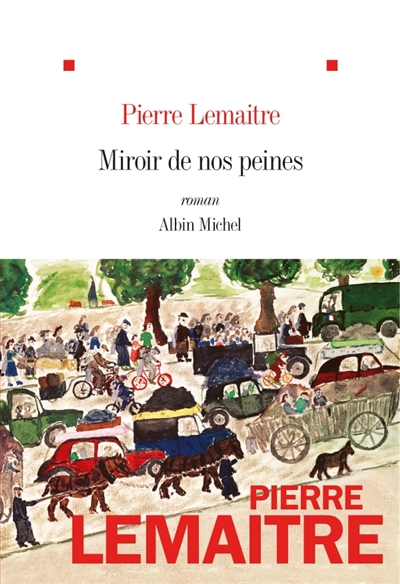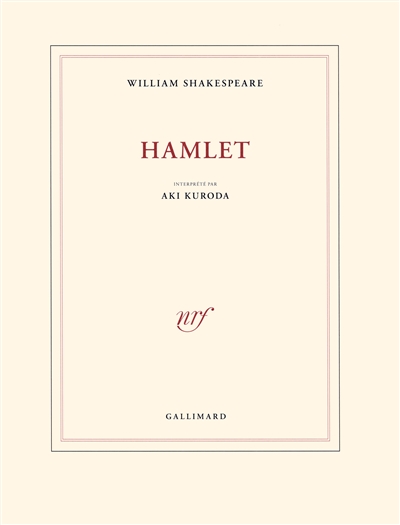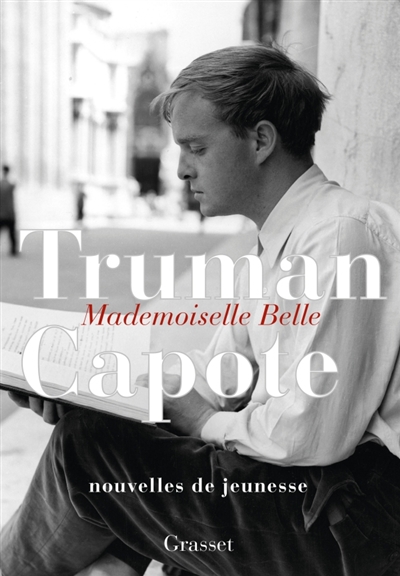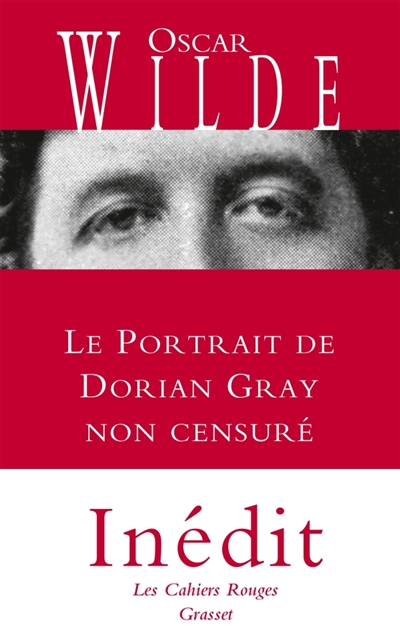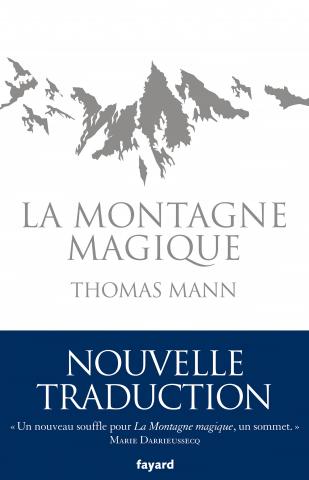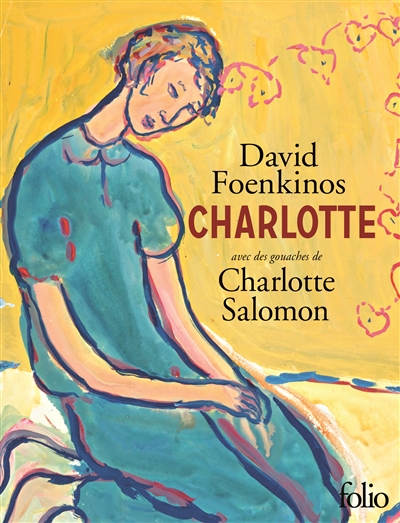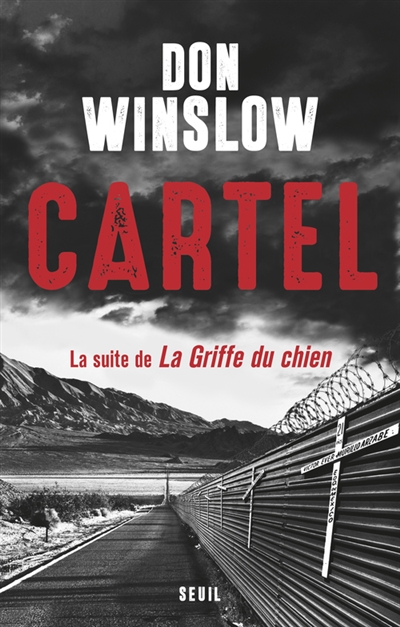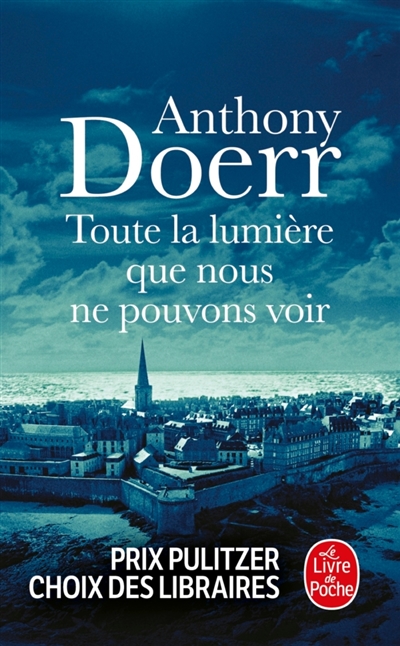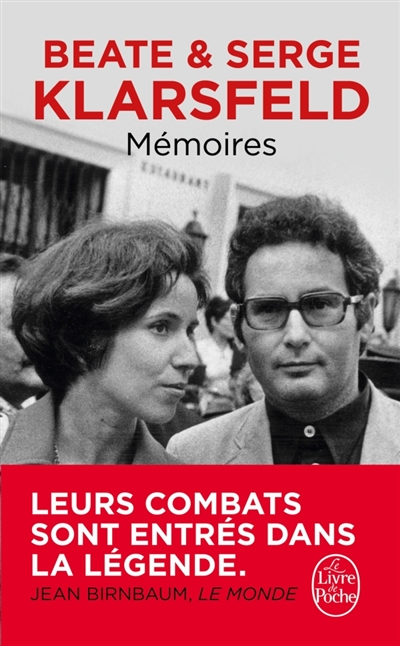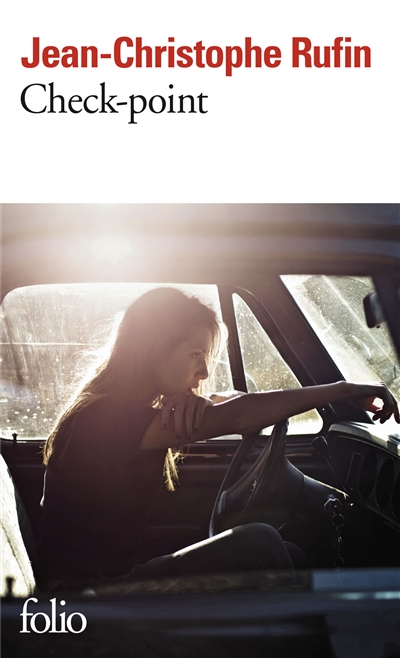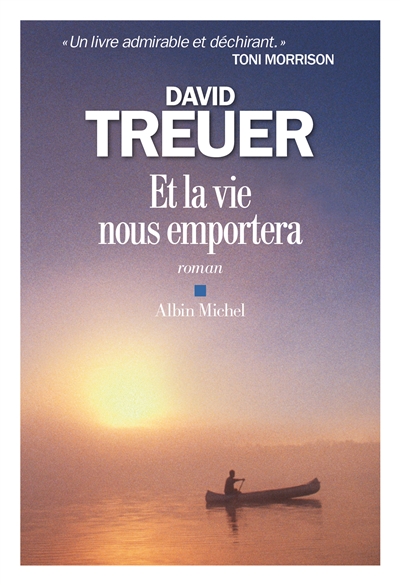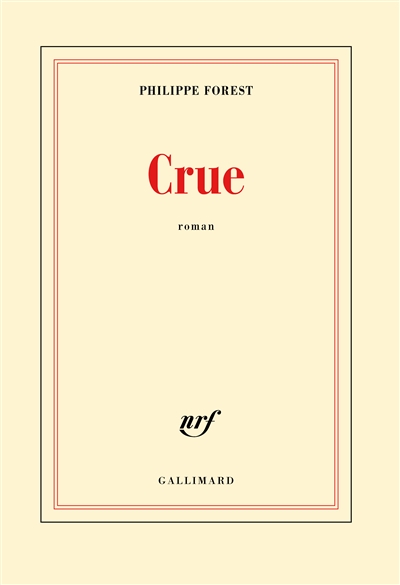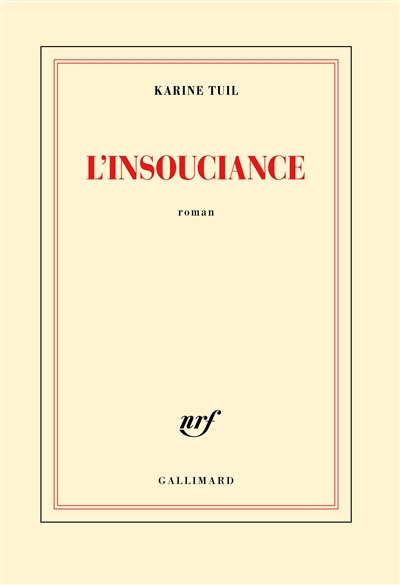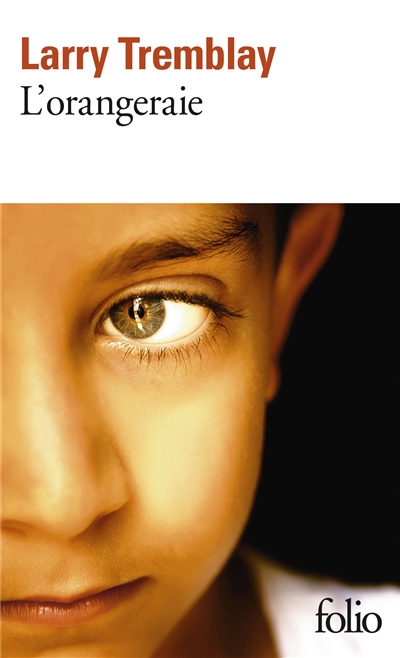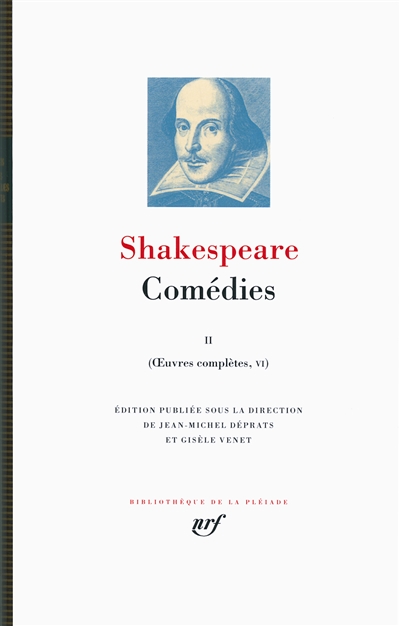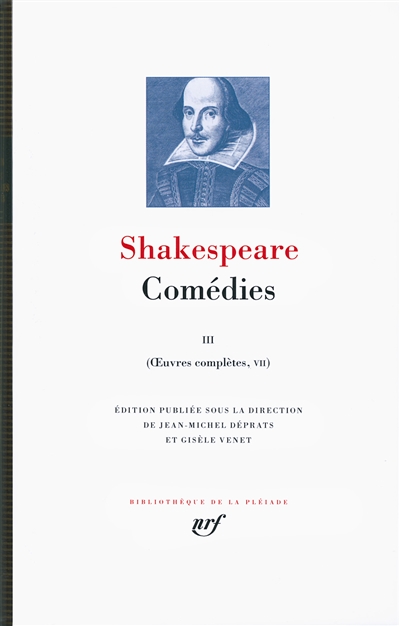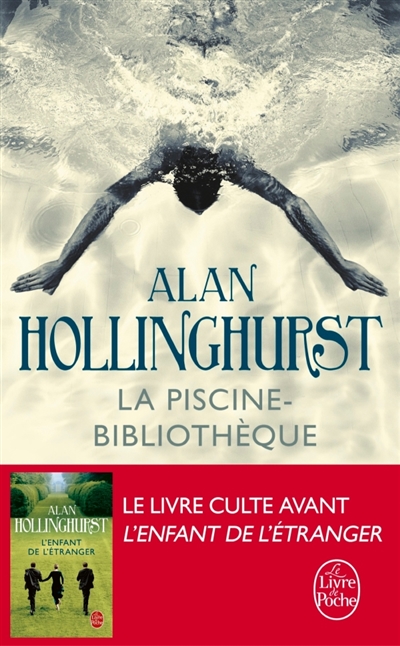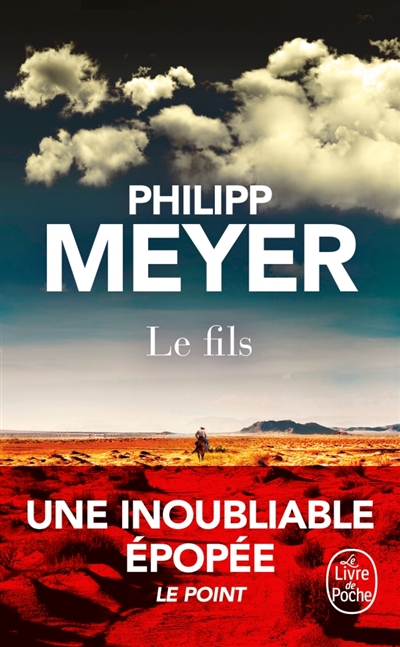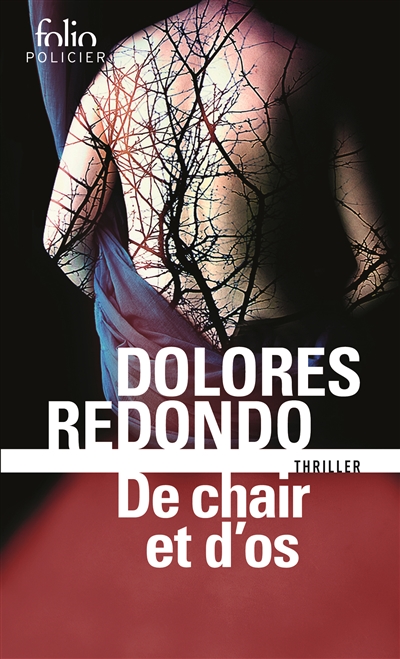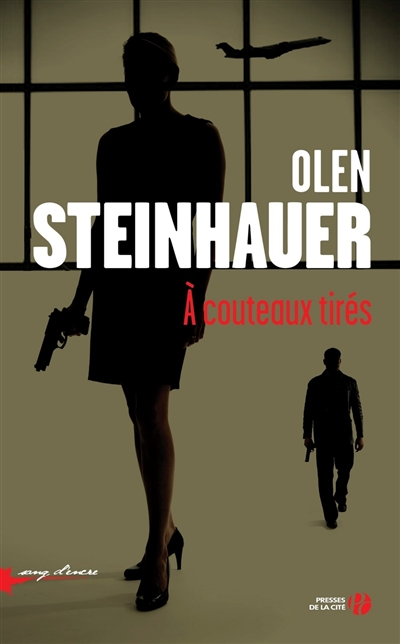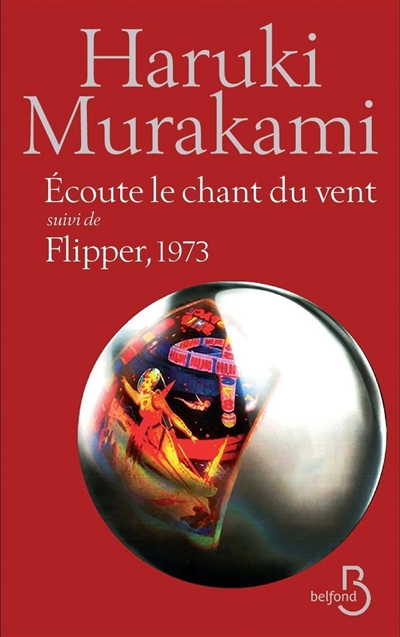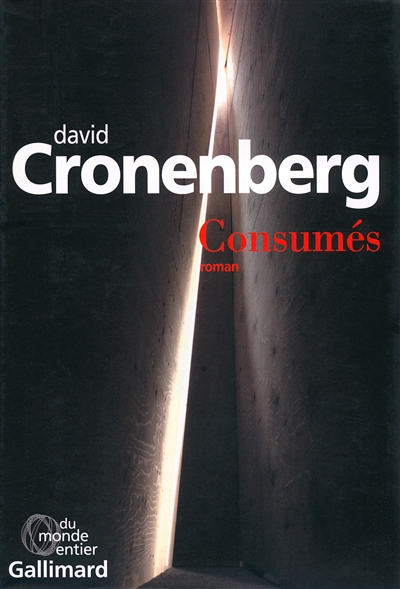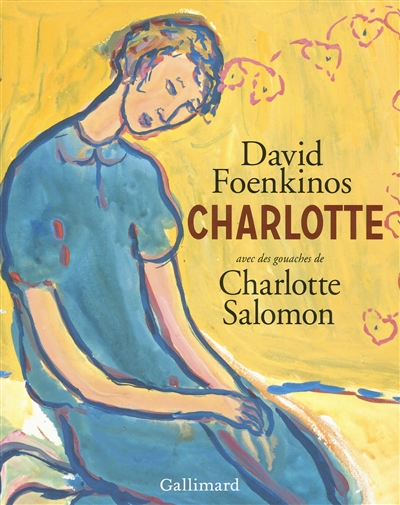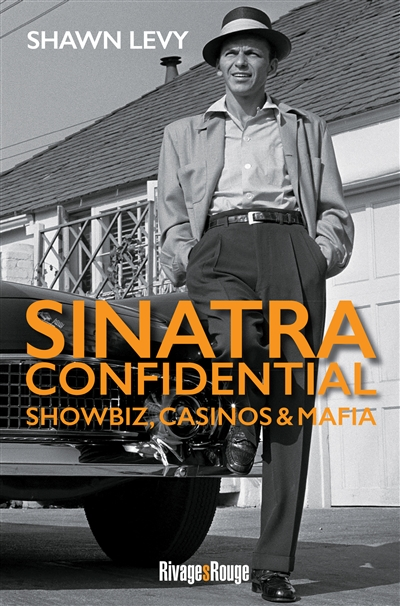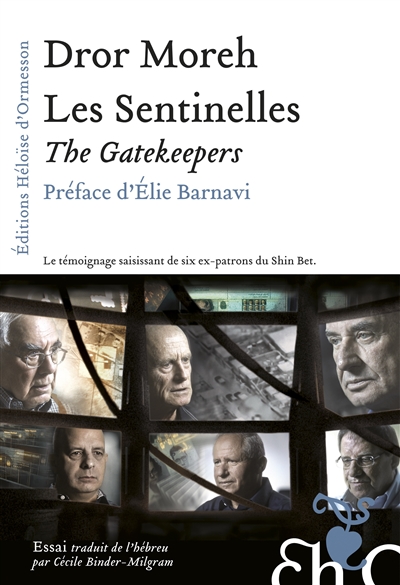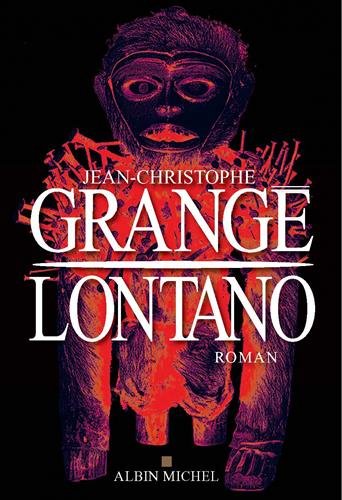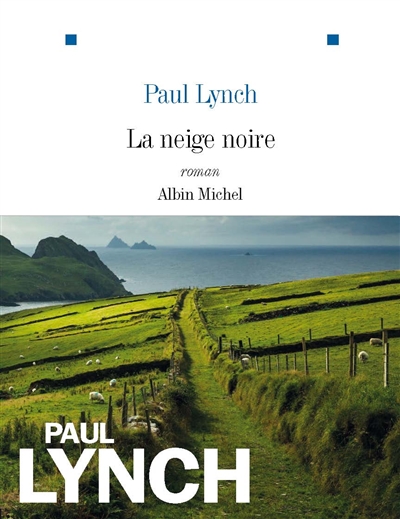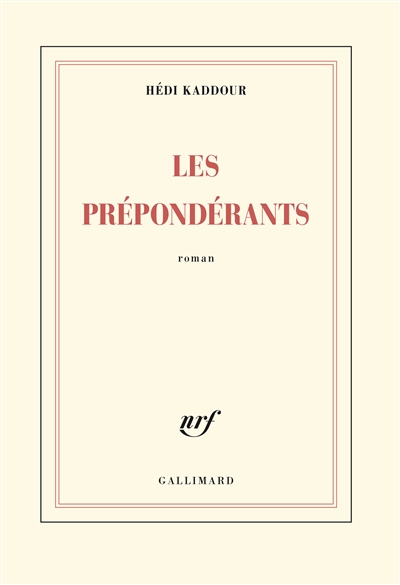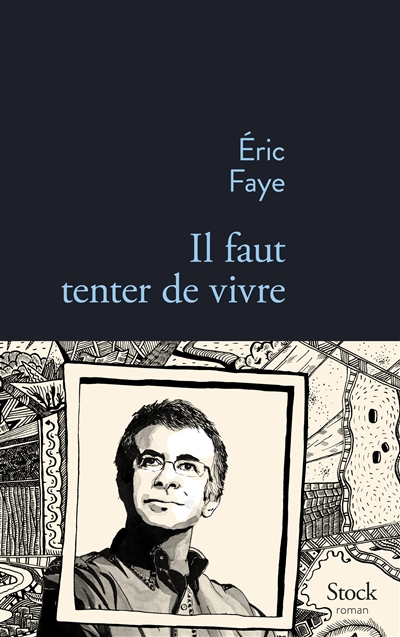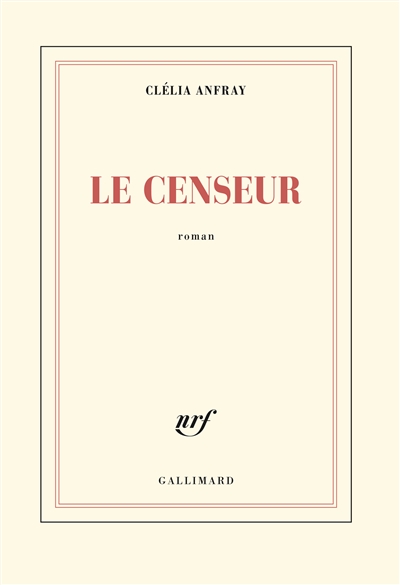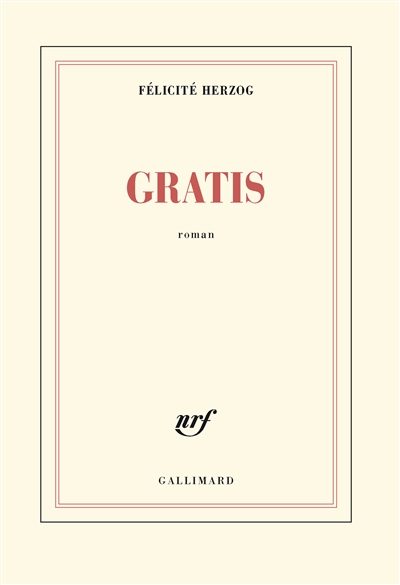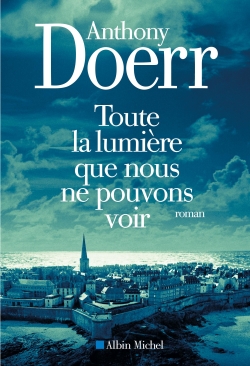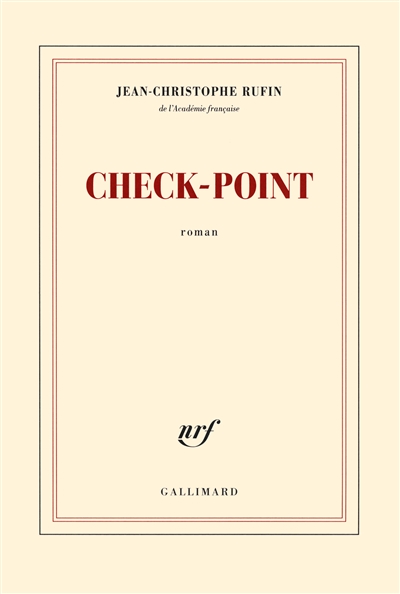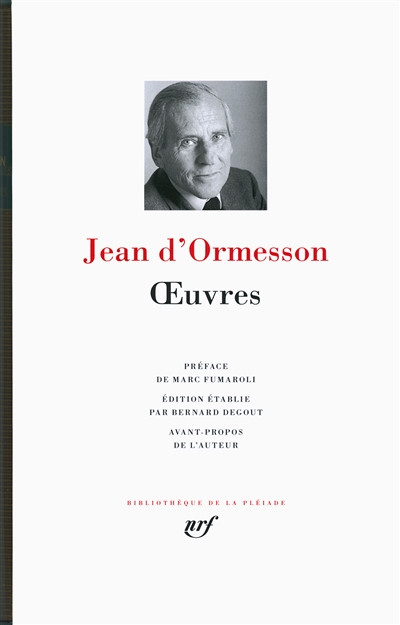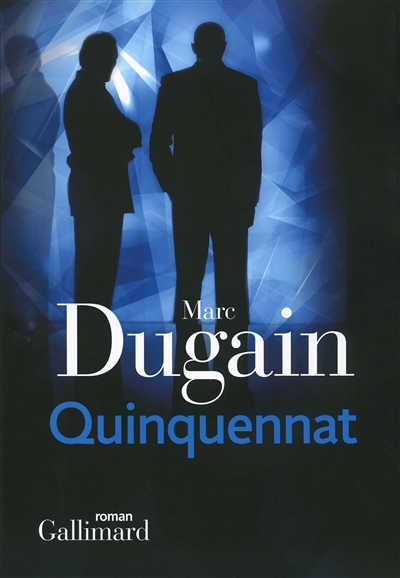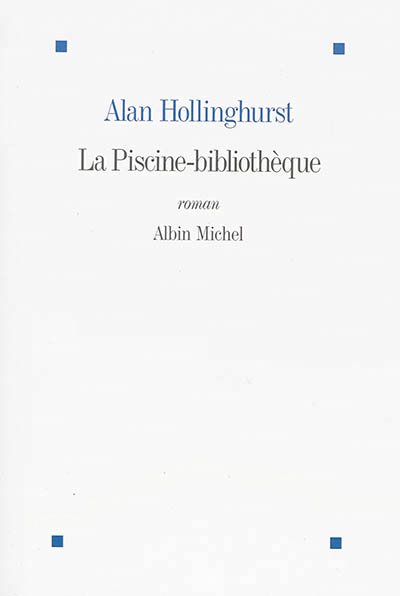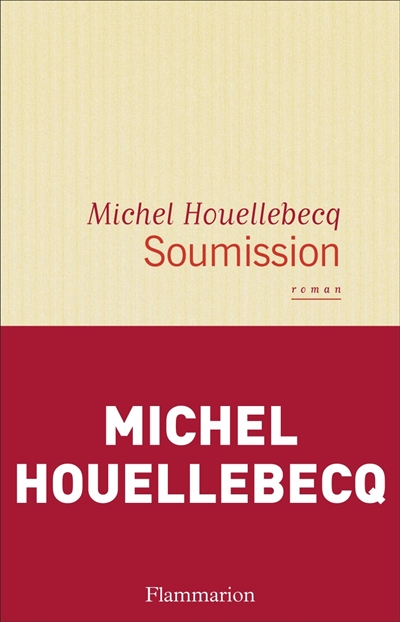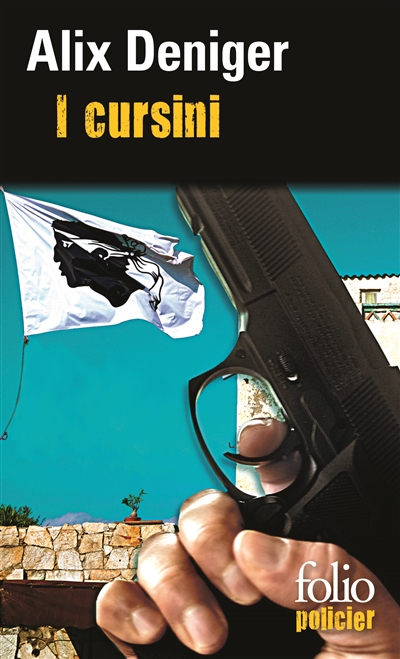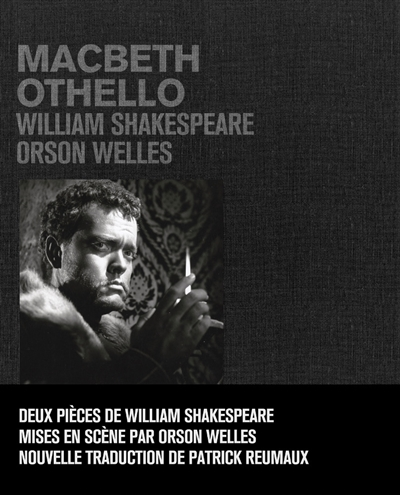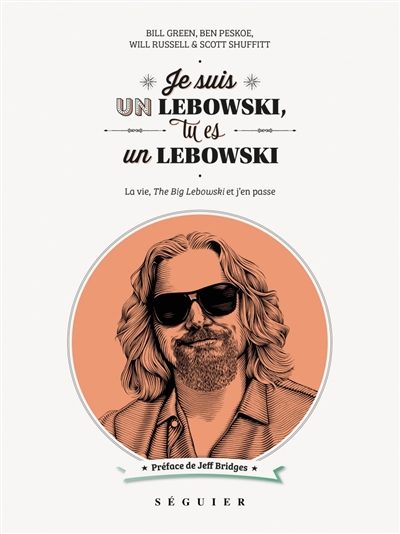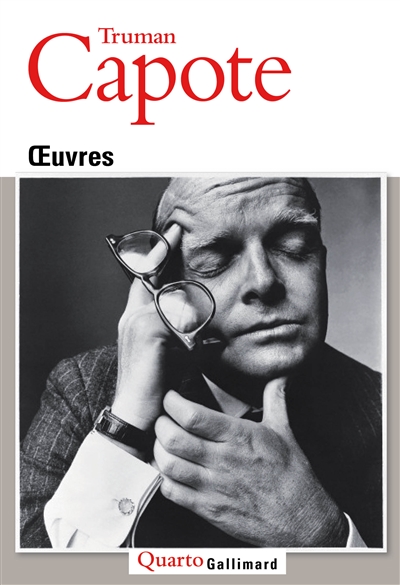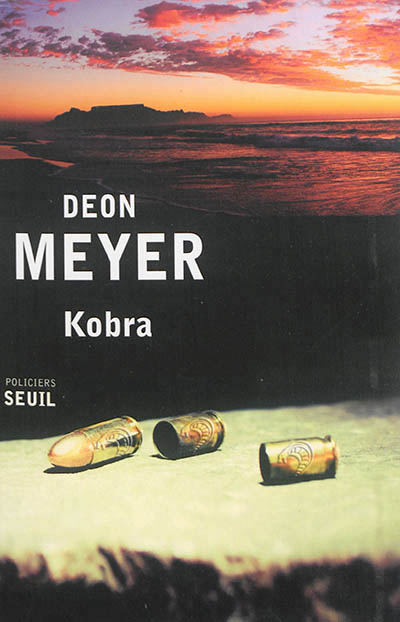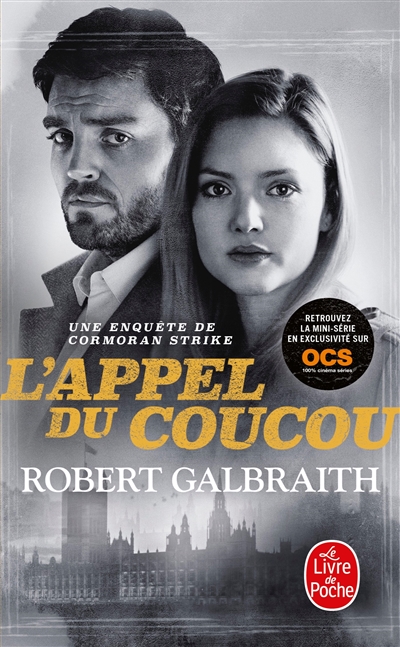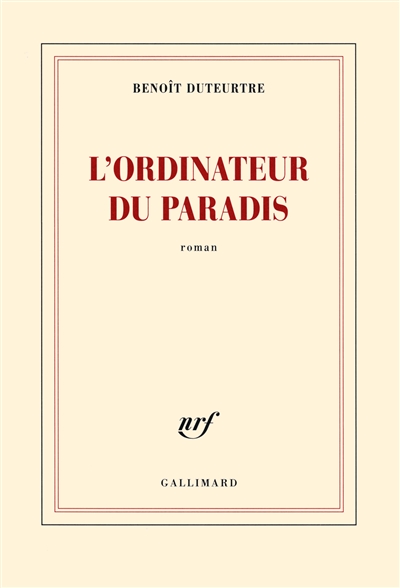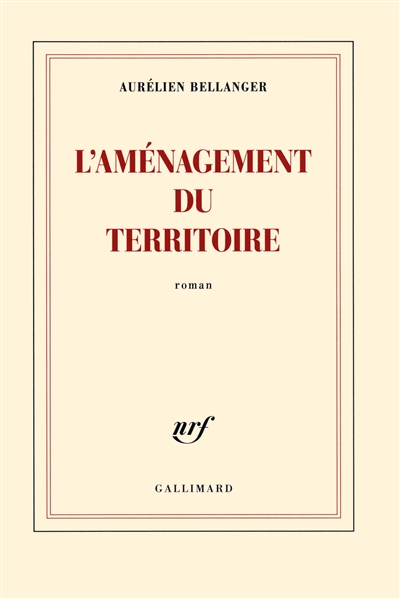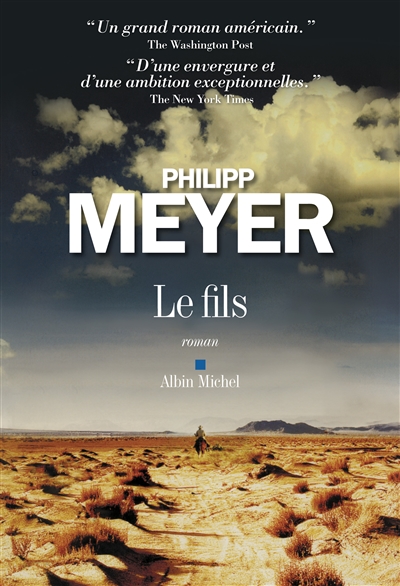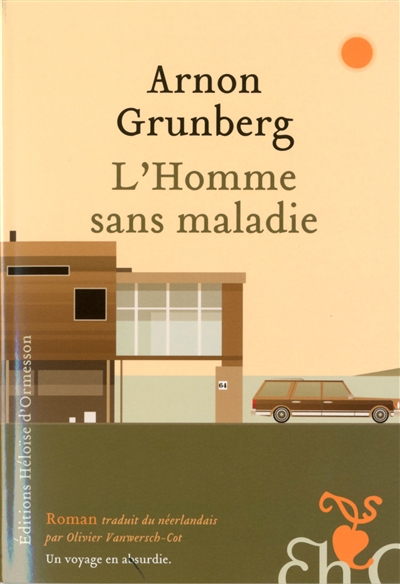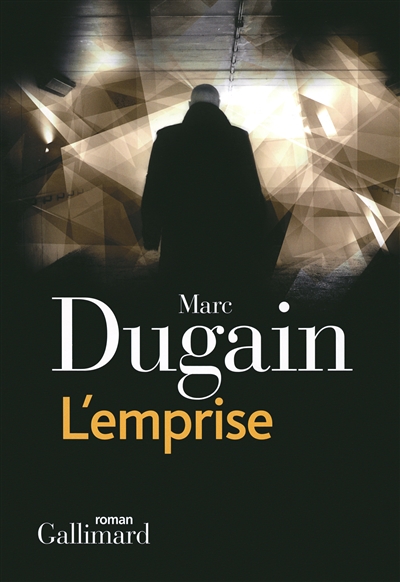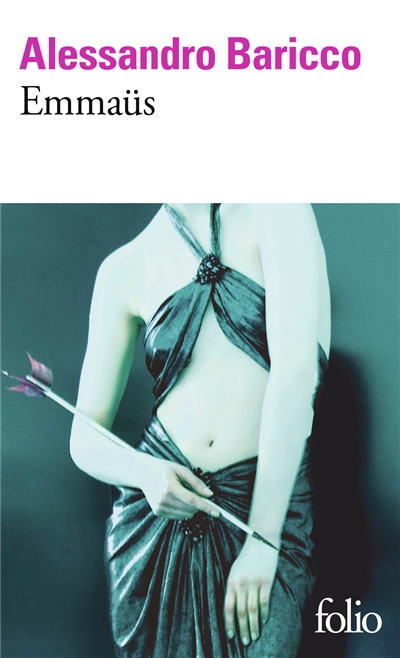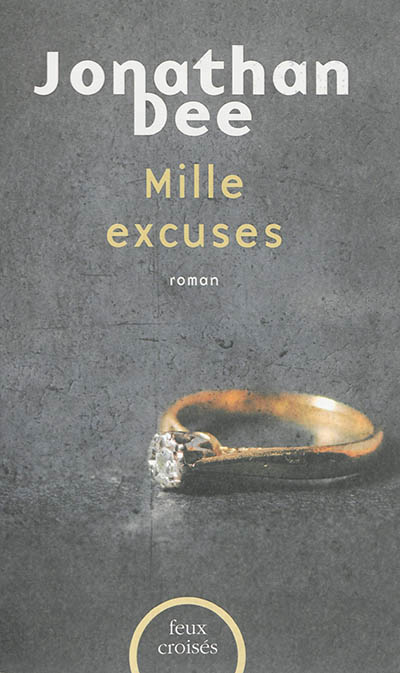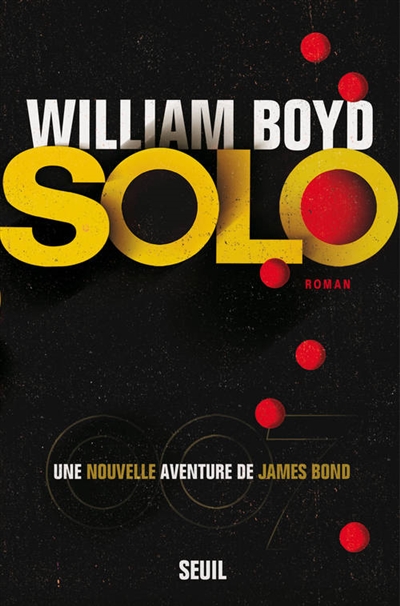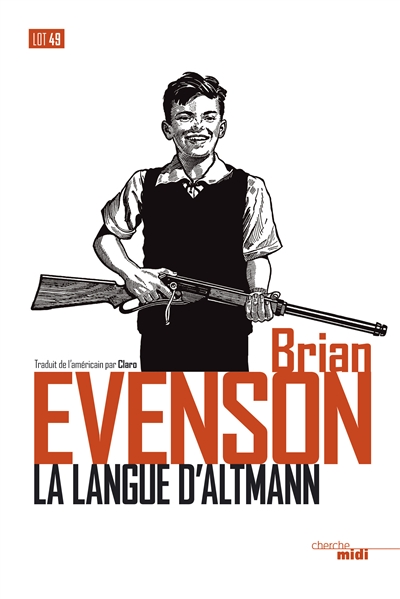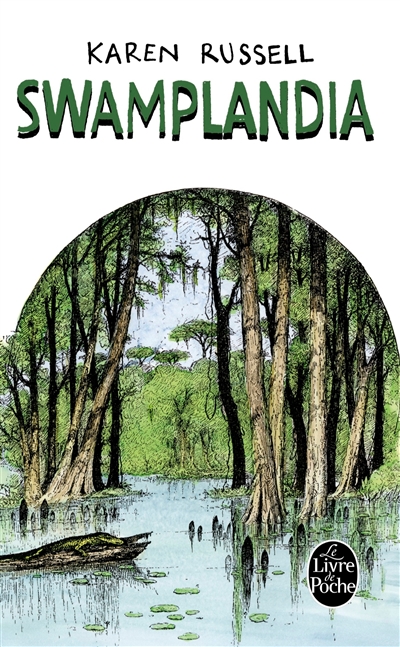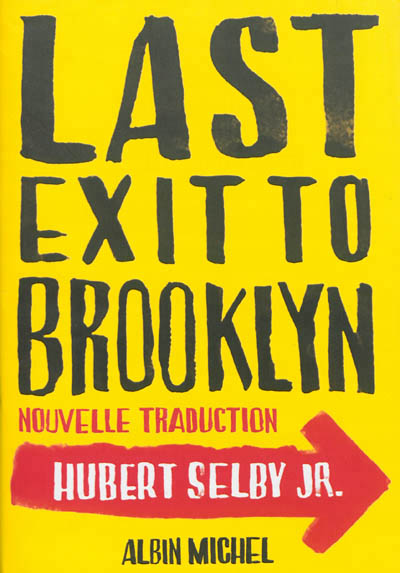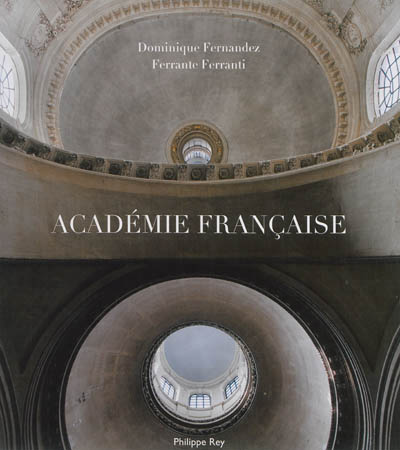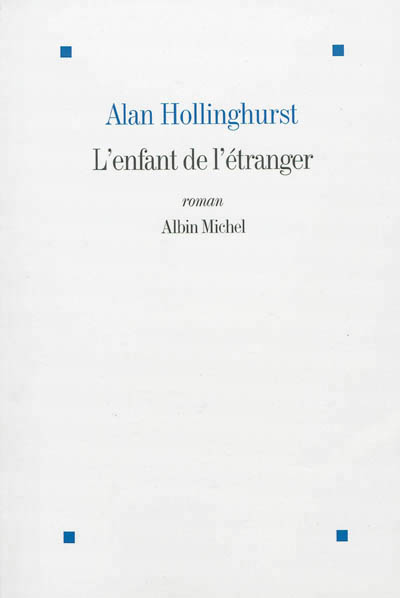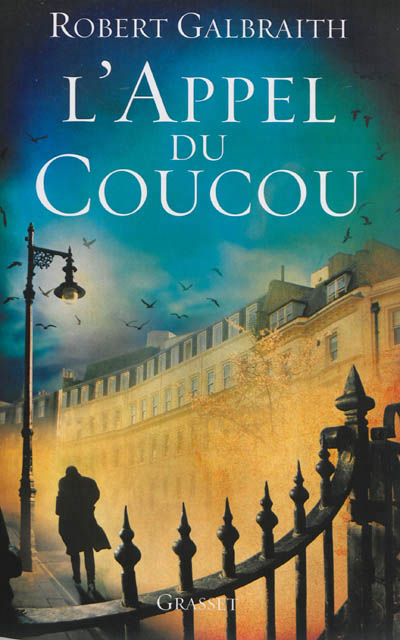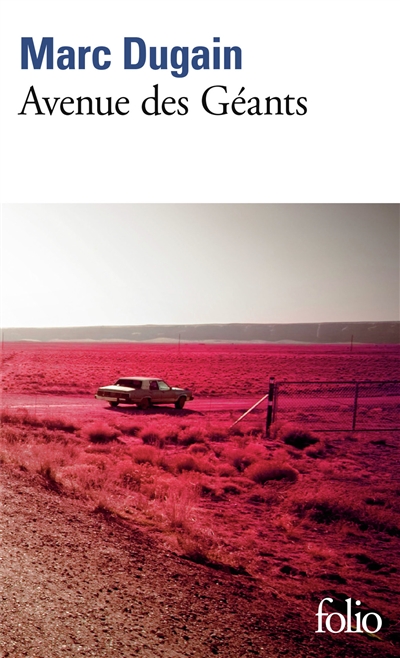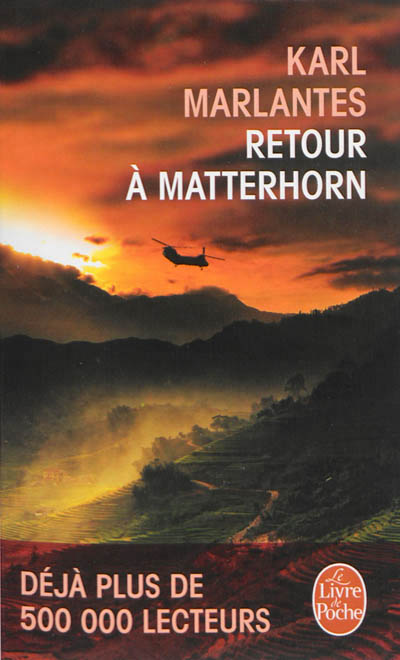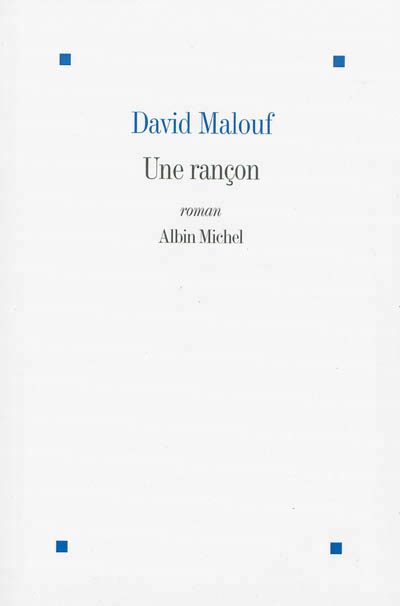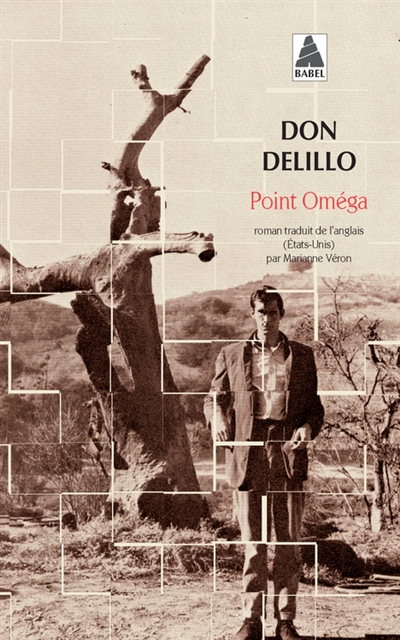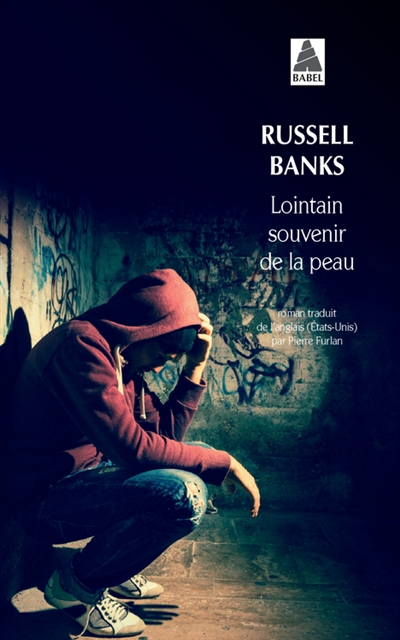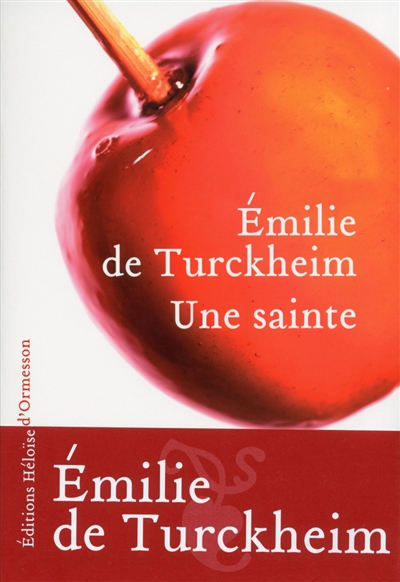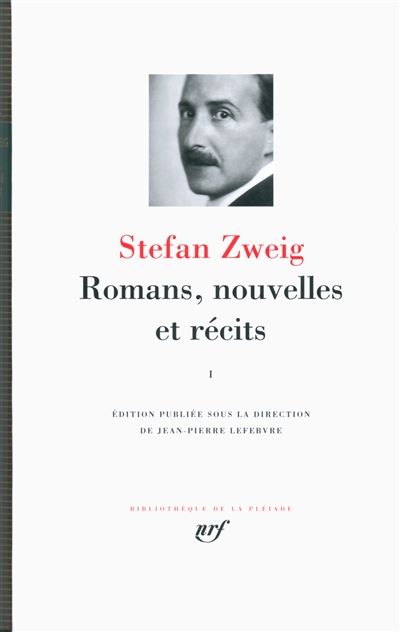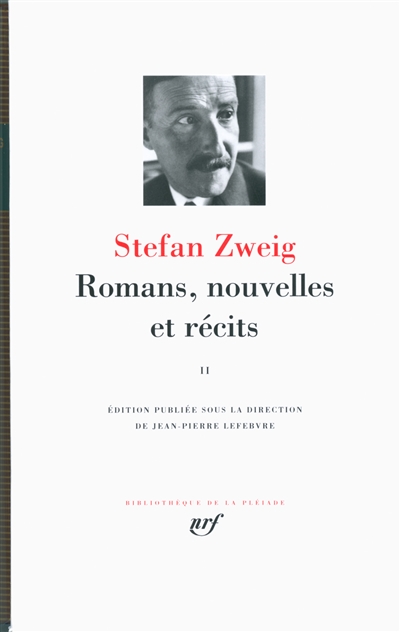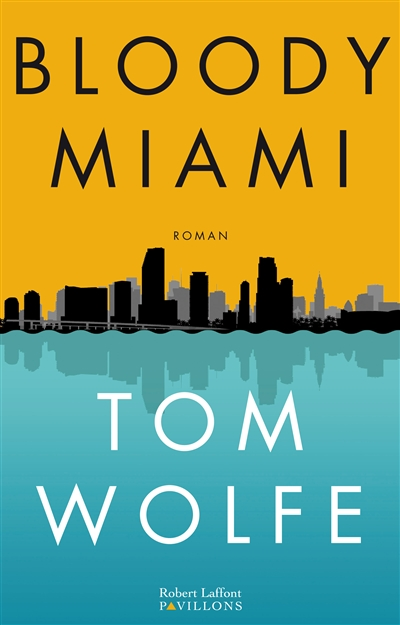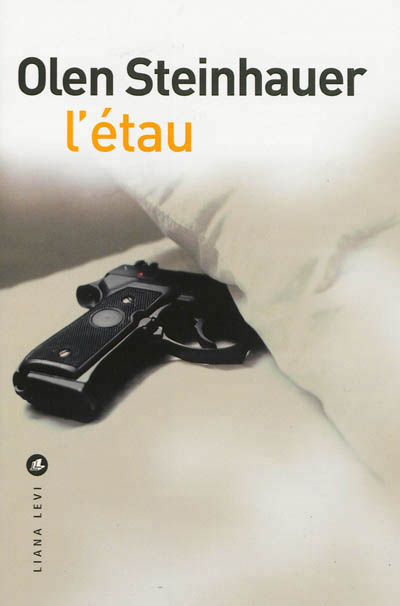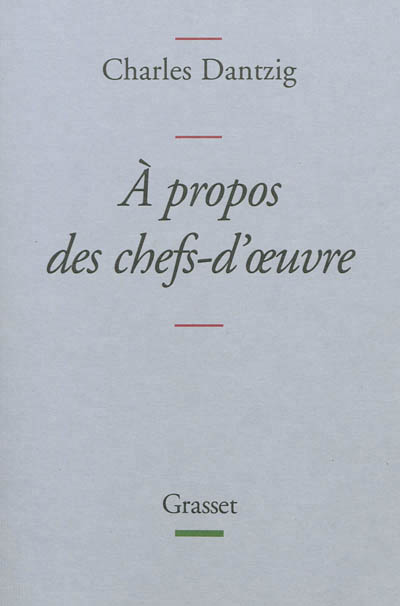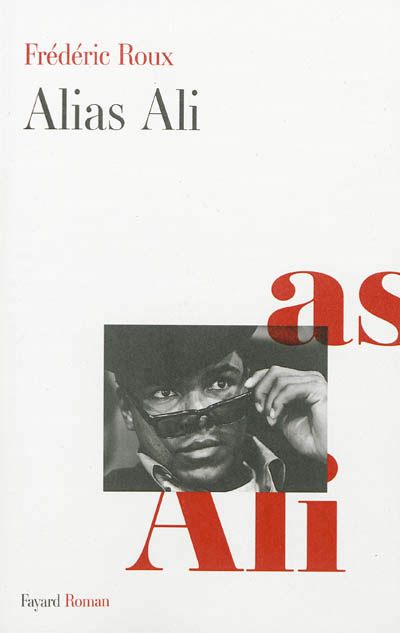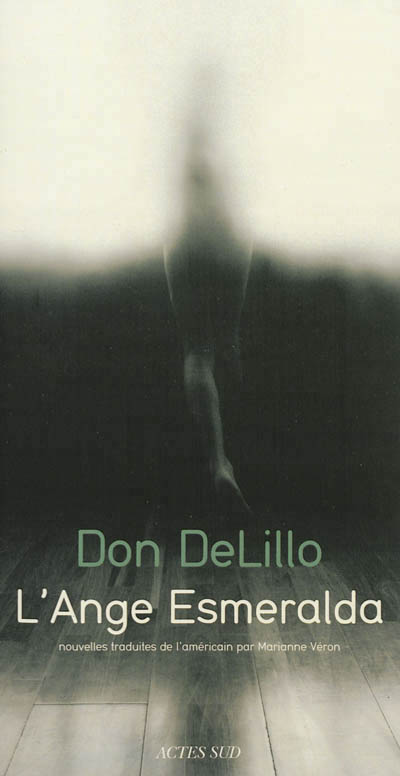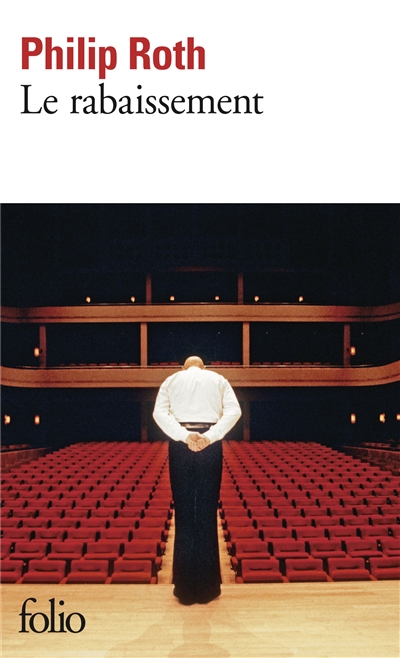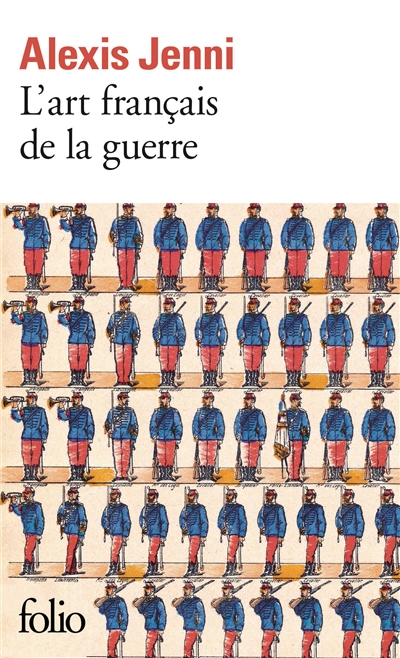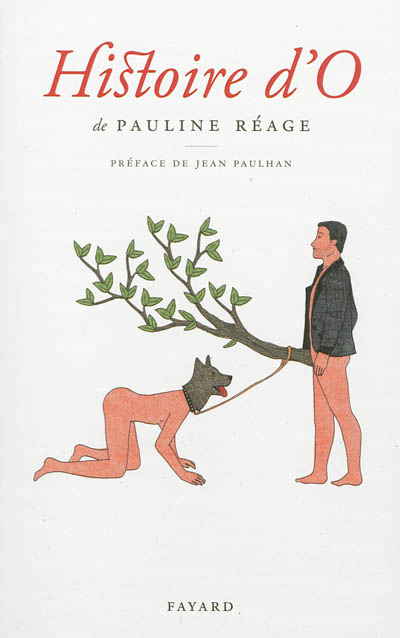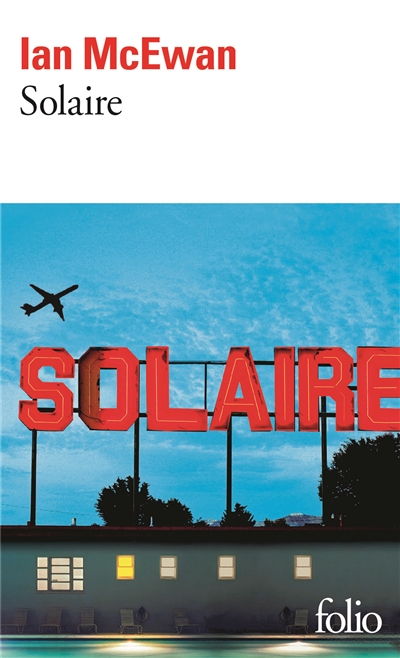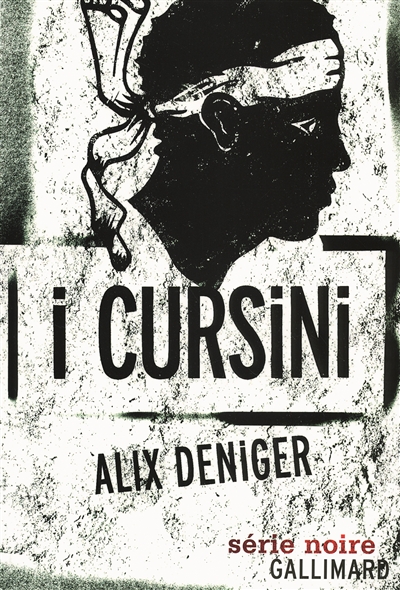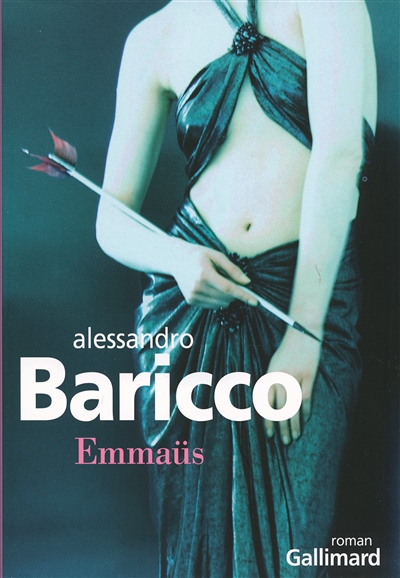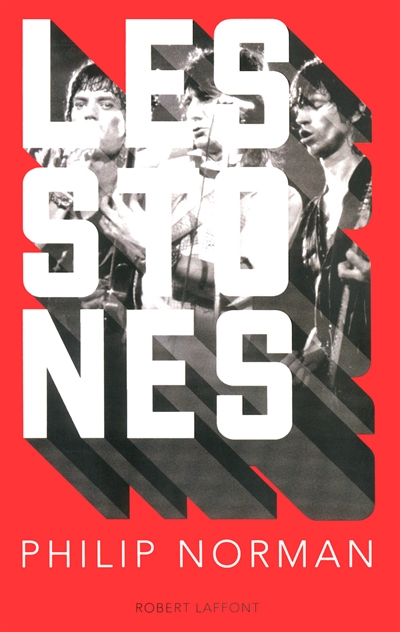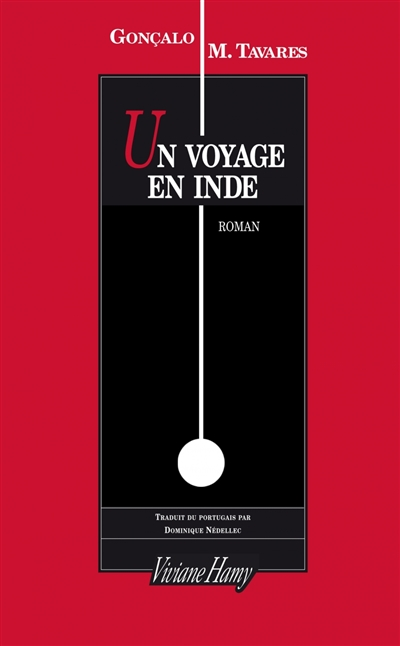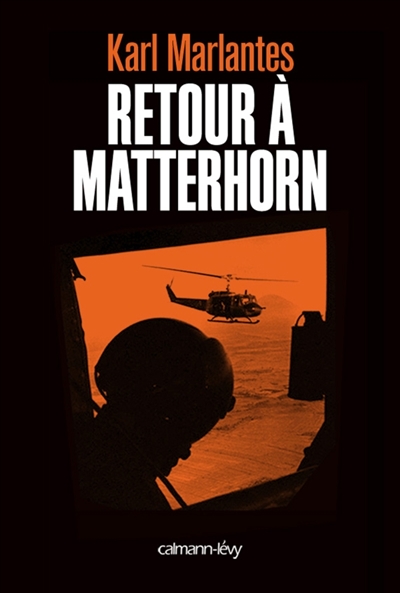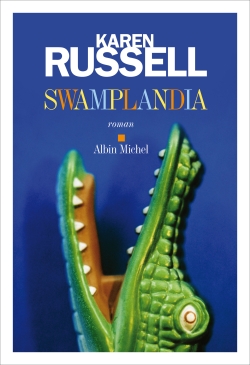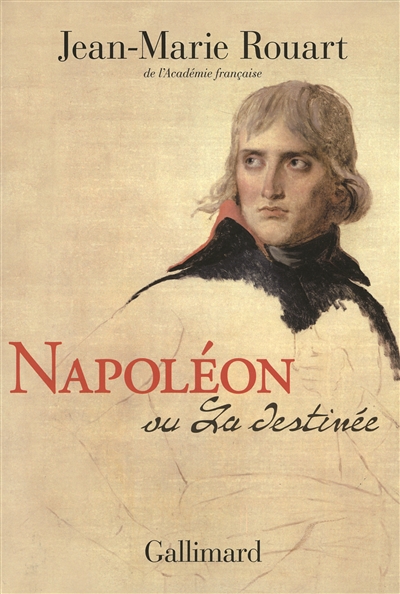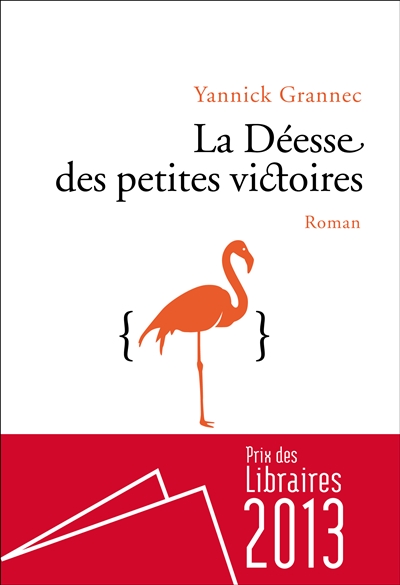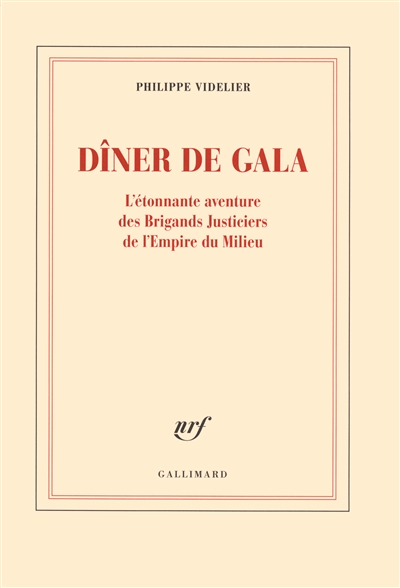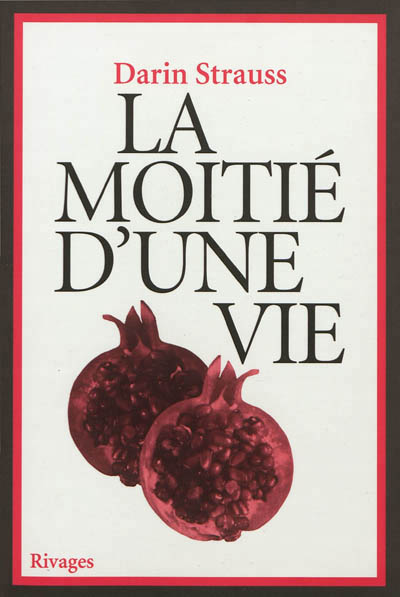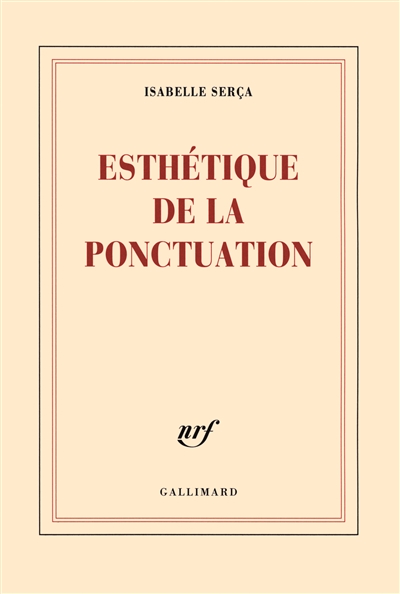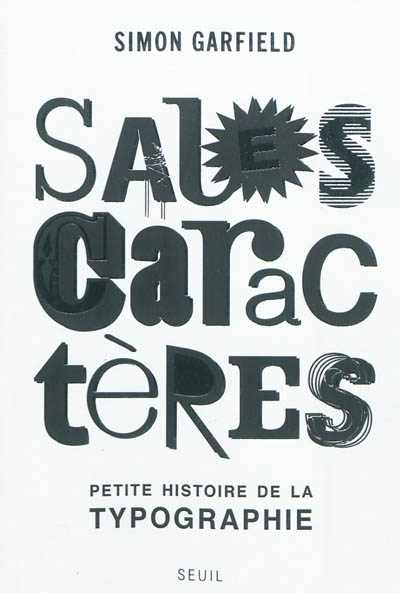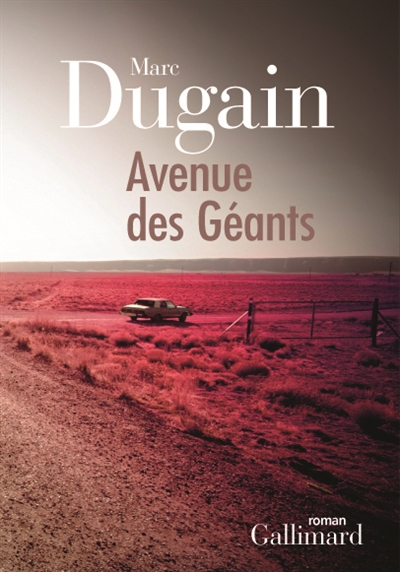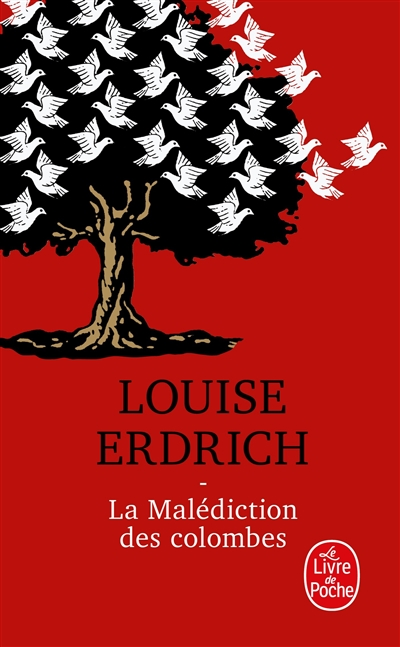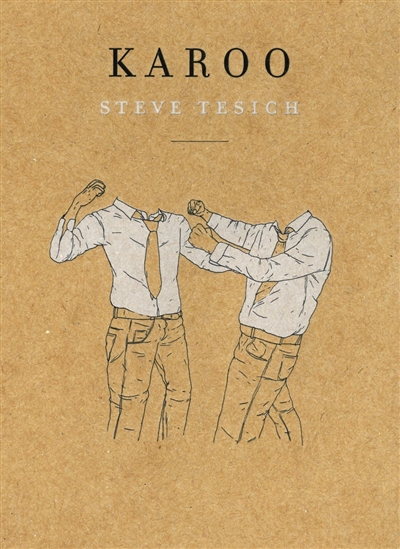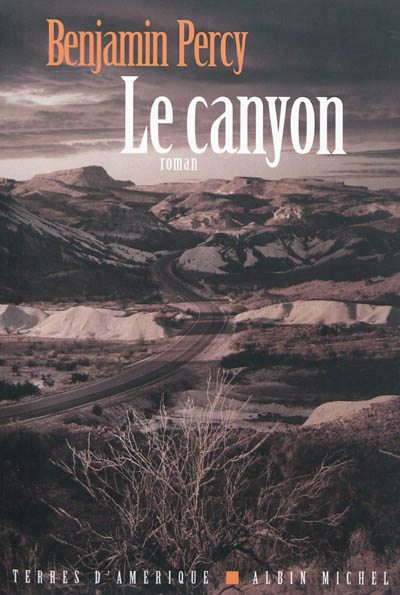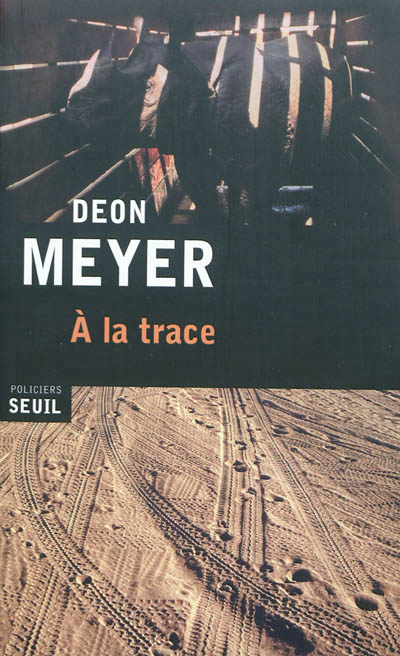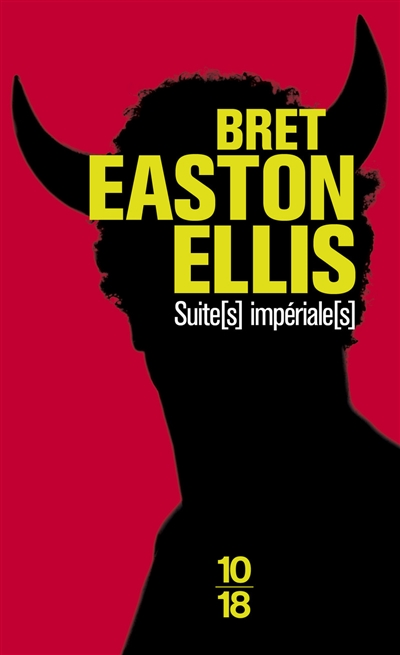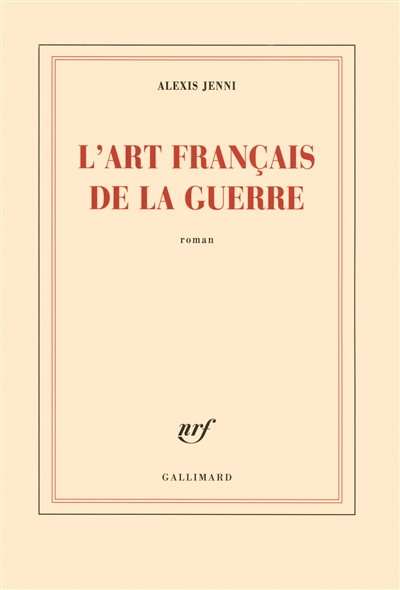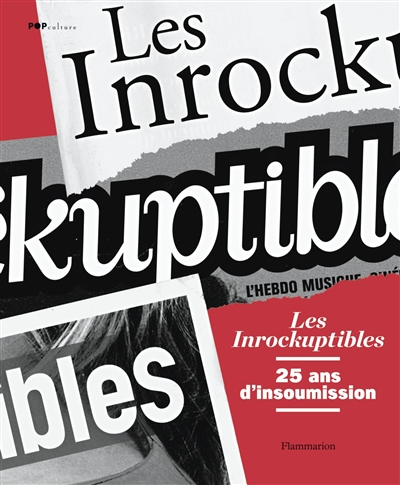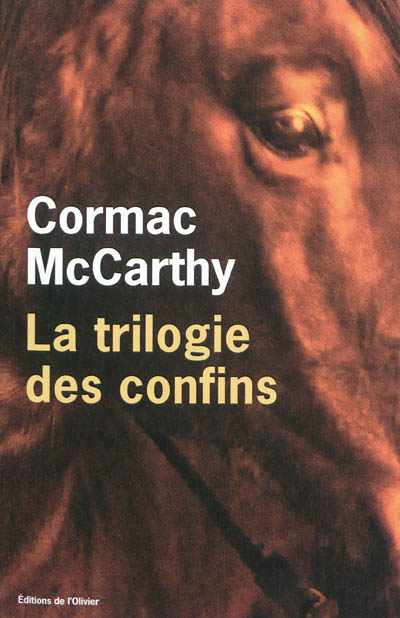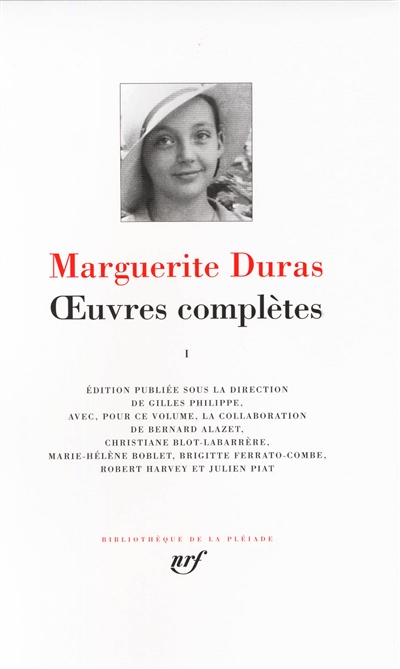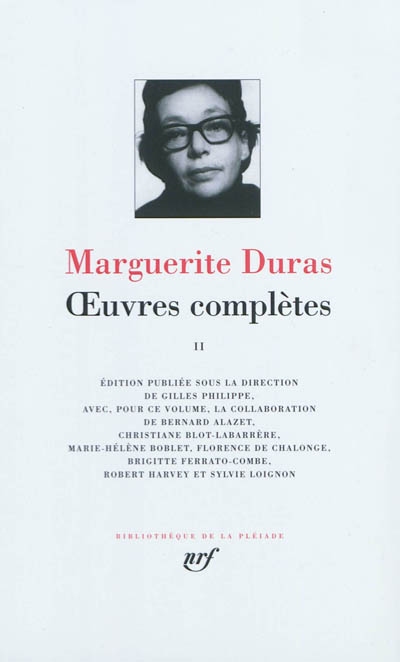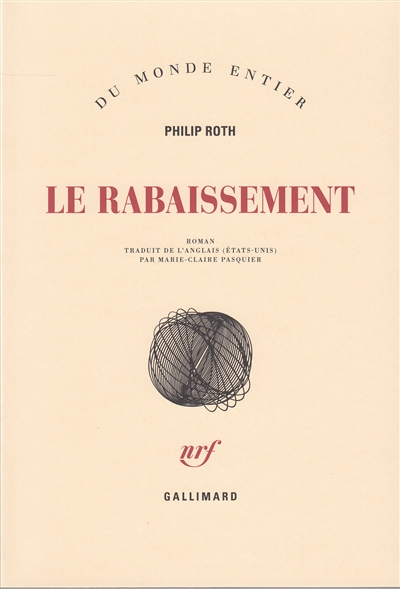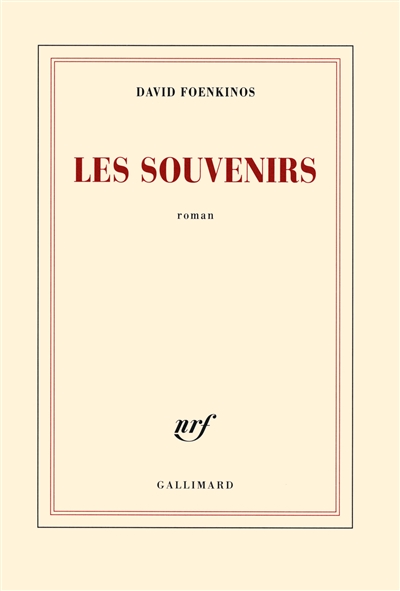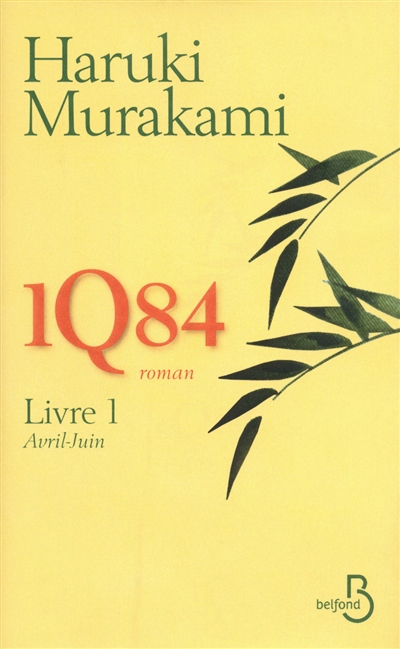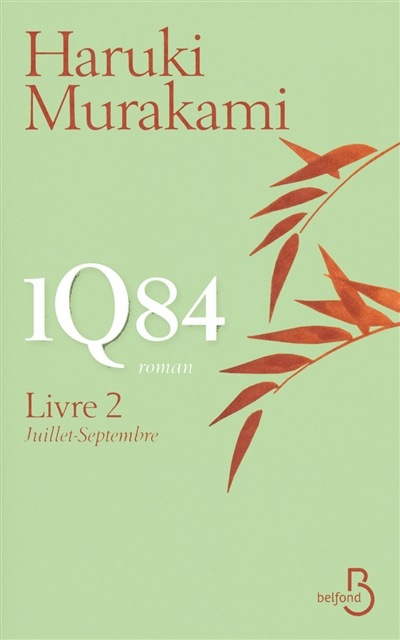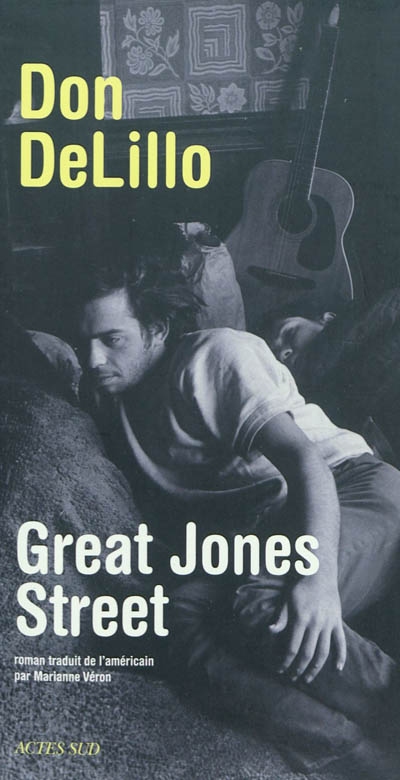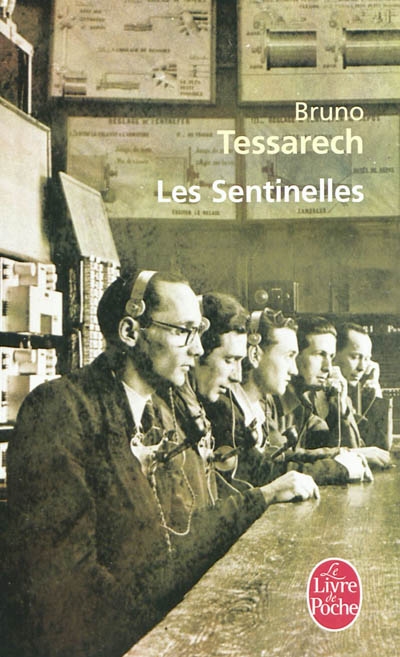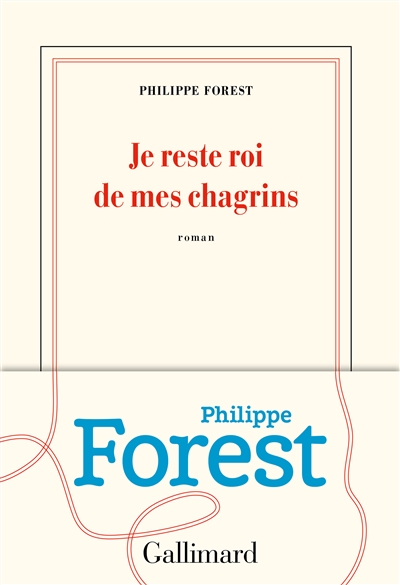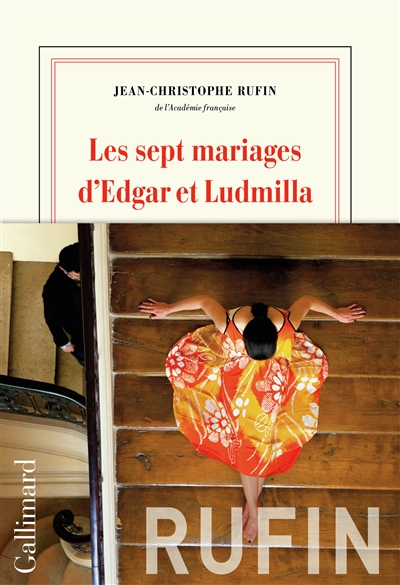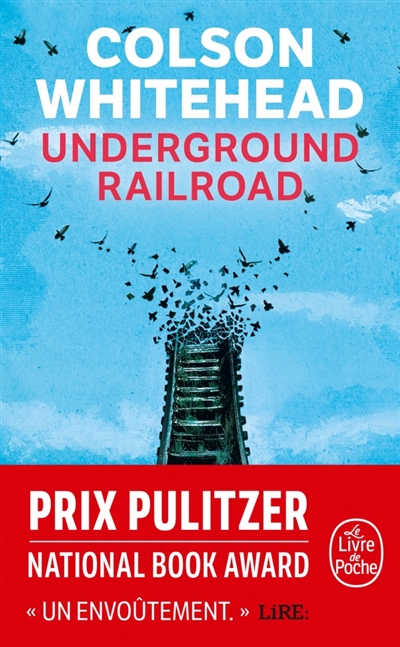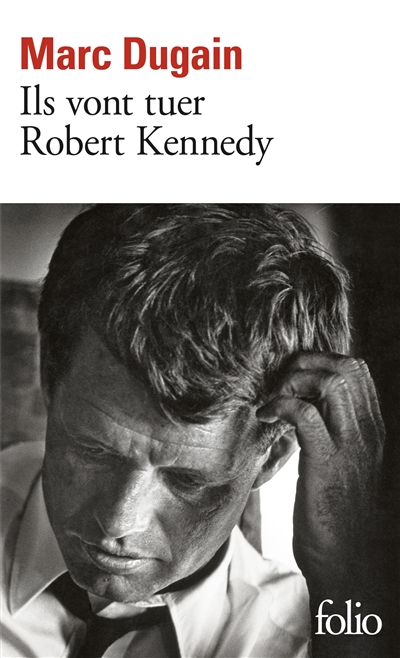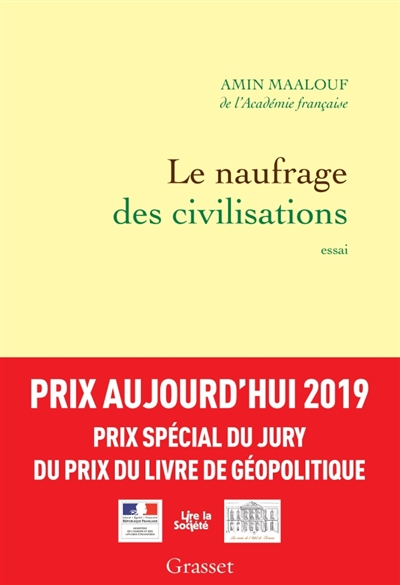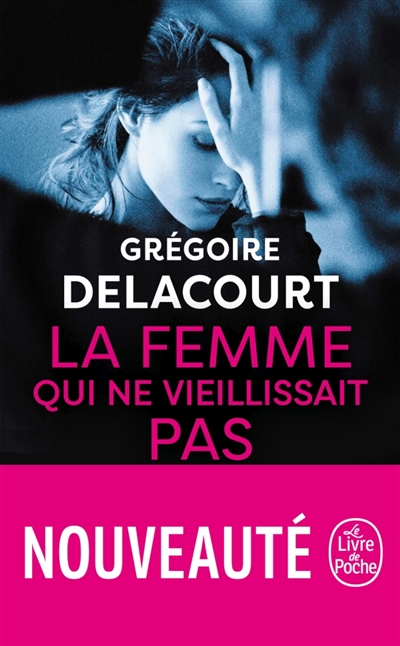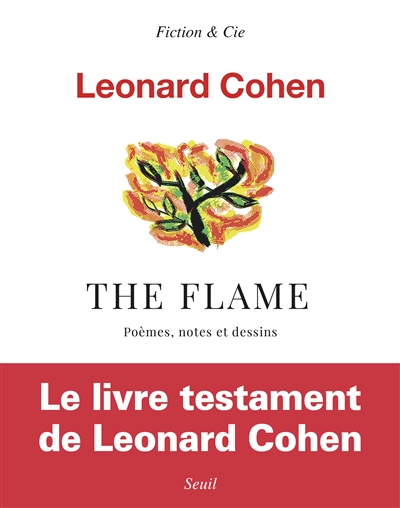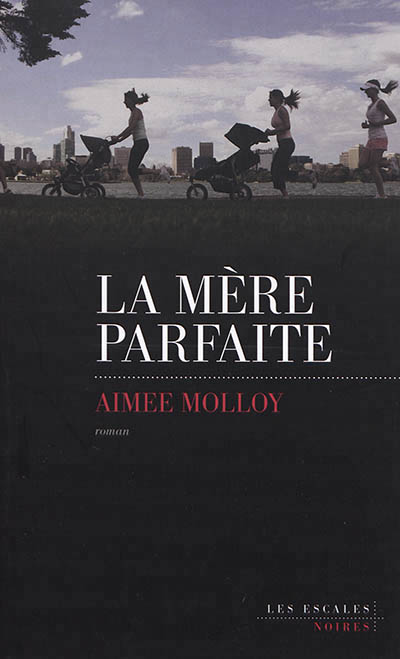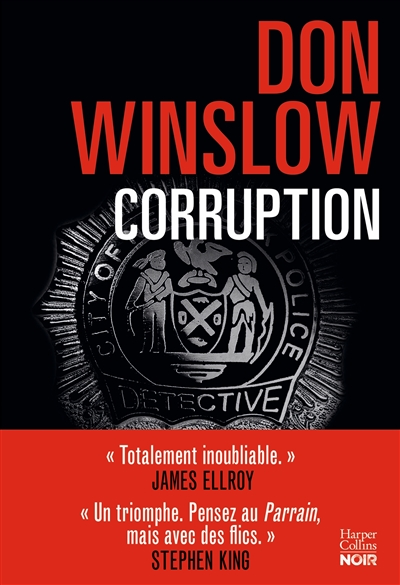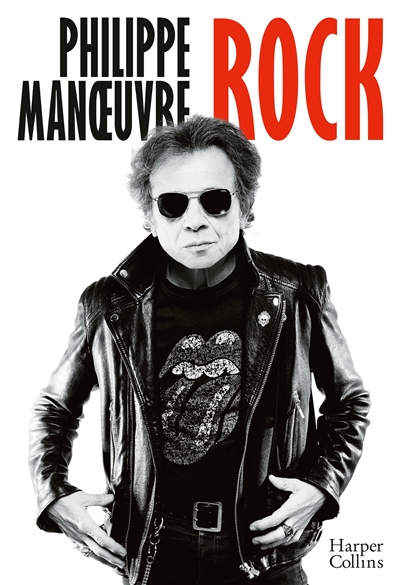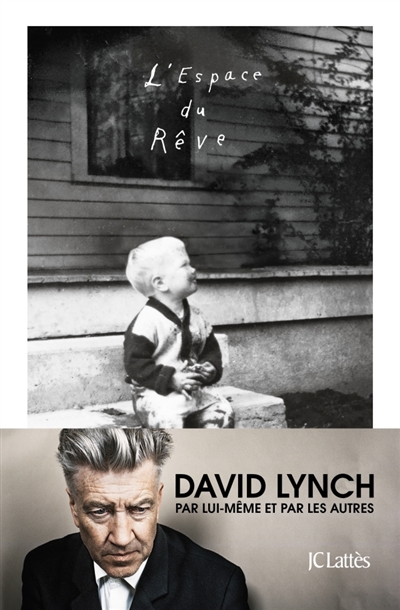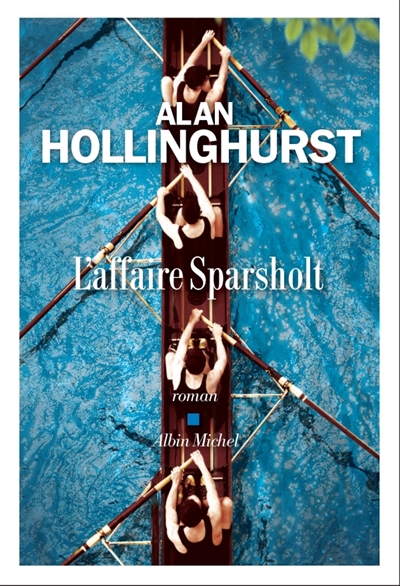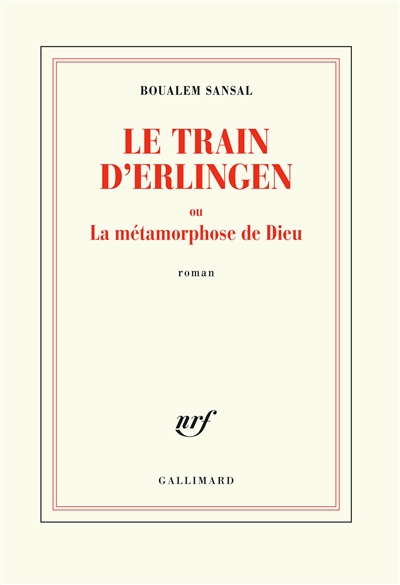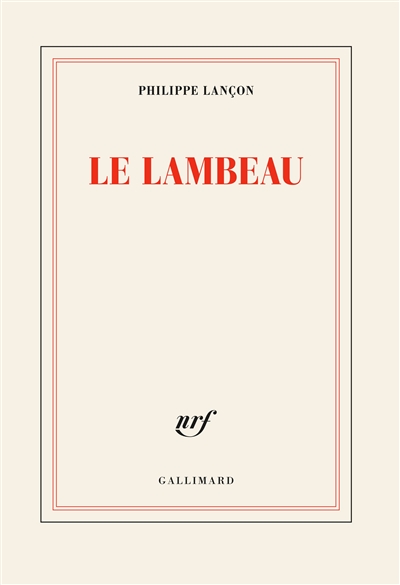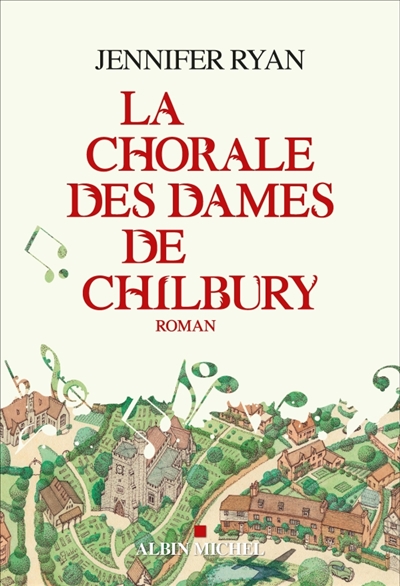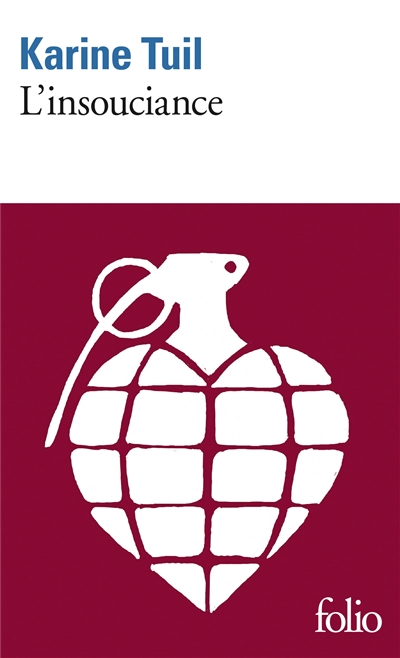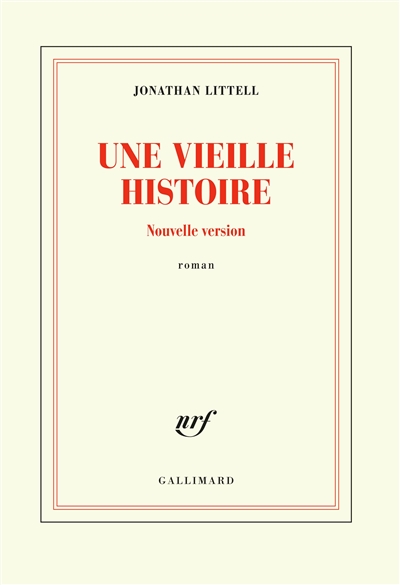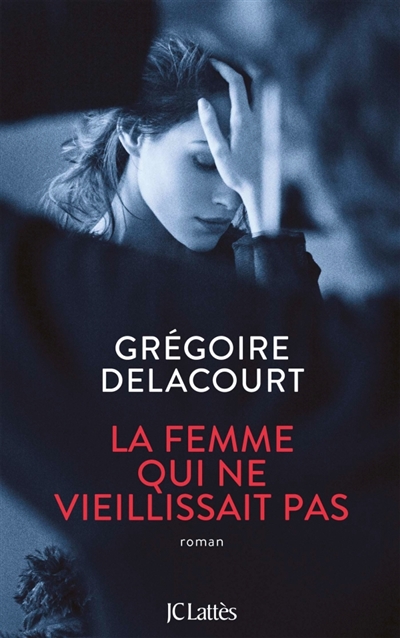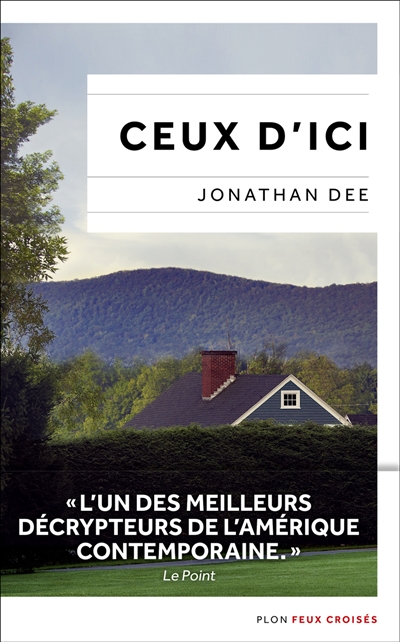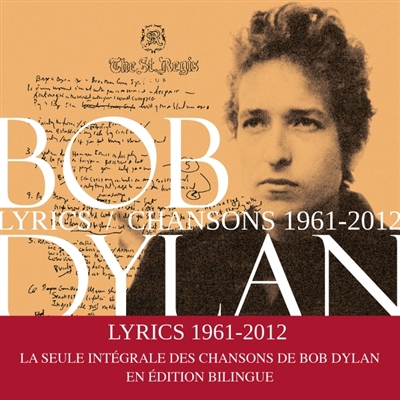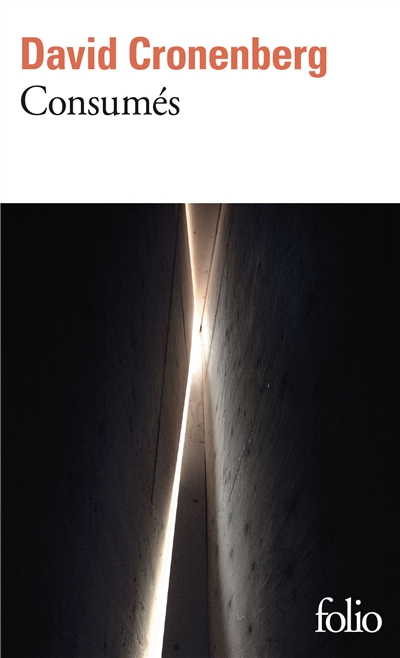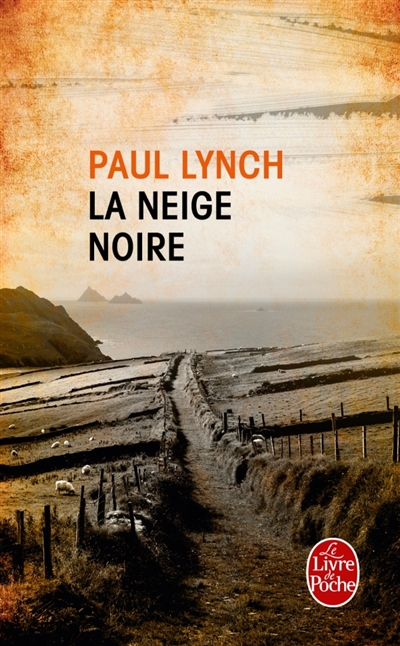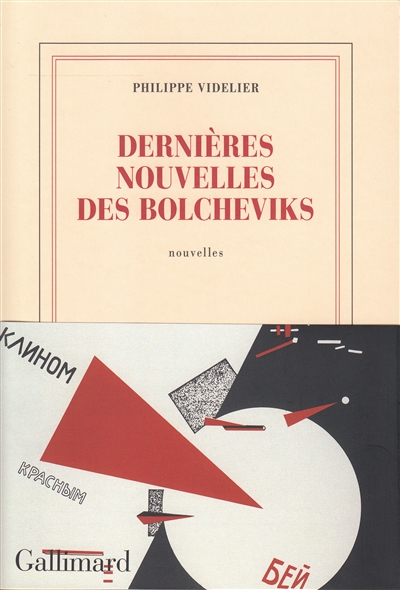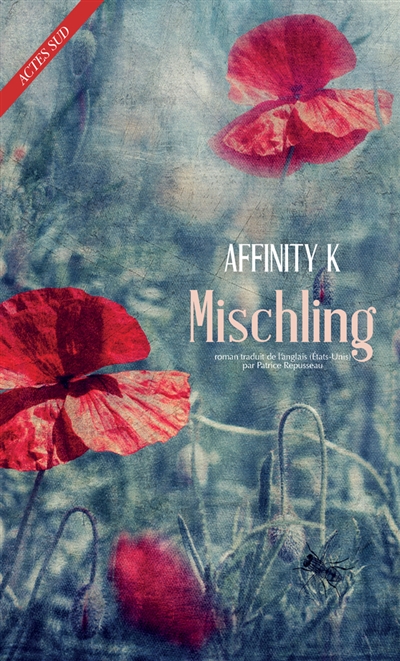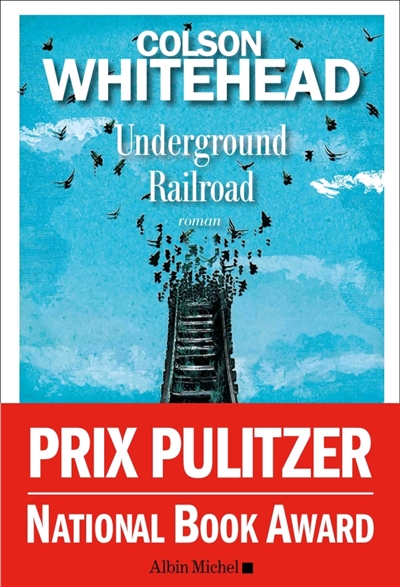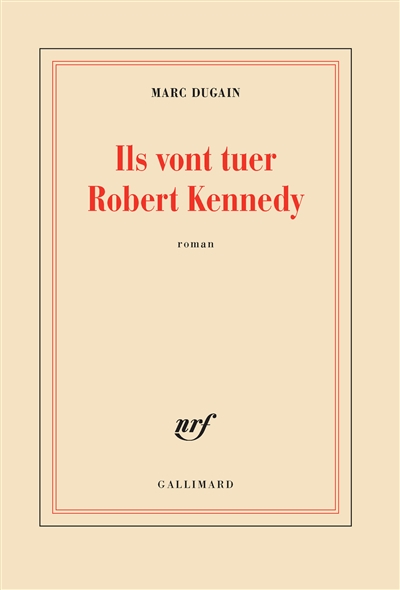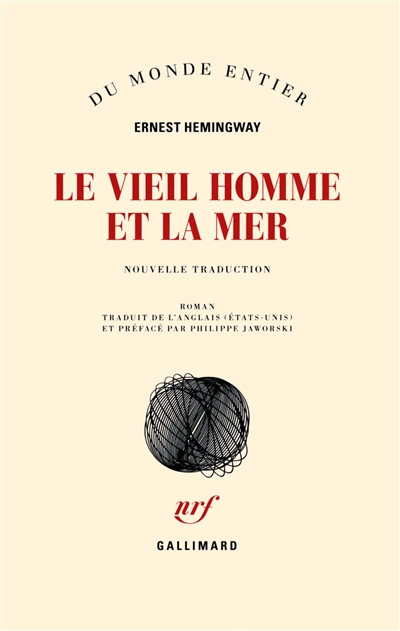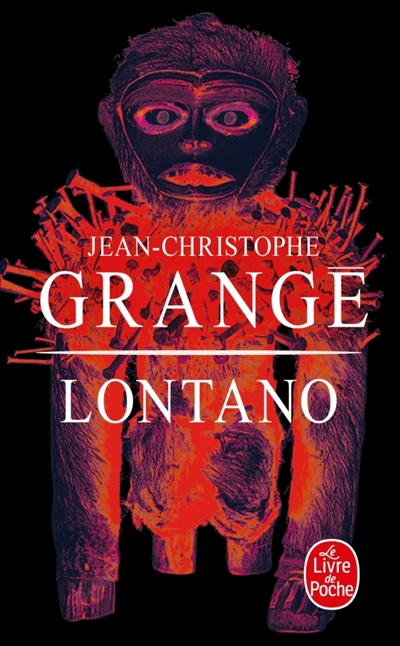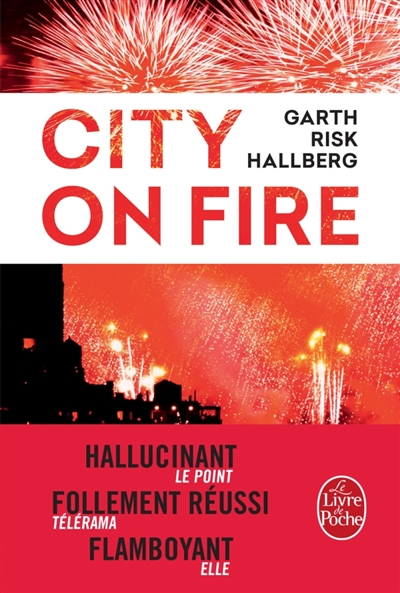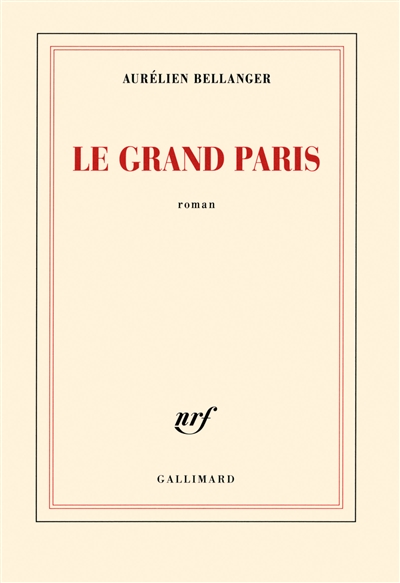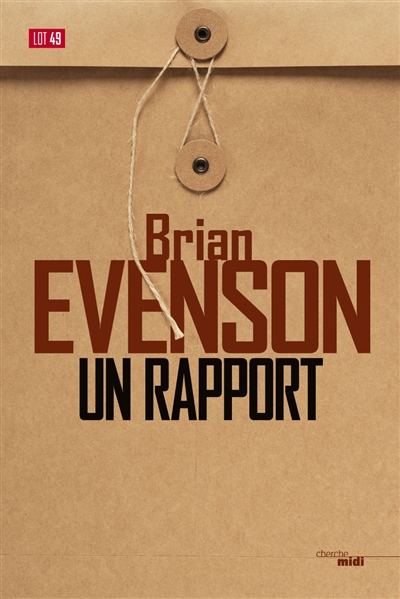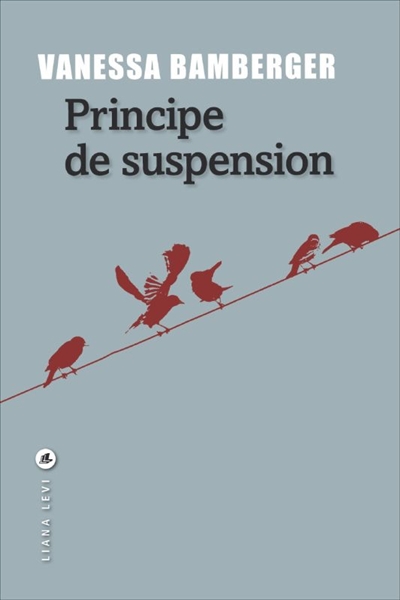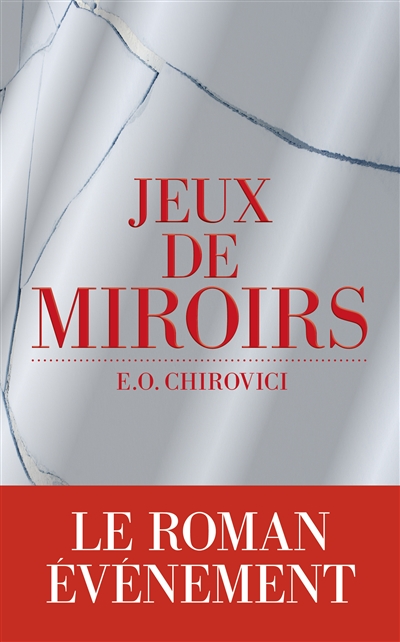Littérature étrangère
Ian McEwan
Dans une coque de noix

-
Ian McEwan
Dans une coque de noix
Traduit de l'anglais par France Camus-Pichon
Gallimard
13/04/2017
224 pages, 20 €
-
Chronique de
Stanislas Rigot
Librairie Lamartine (Paris) - ❤ Lu et conseillé par 25 libraire(s)

✒ Stanislas Rigot
(Librairie Lamartine, Paris)
Après le bouleversant L’Intérêt de l’enfant (Folio), Ian McEwan prend une fois encore ses lecteurs à contre-pied avec le corrosif Dans une coque de noix, dans lequel un fœtus bavard se confronte à sa famille pour le moins perturbée et à un monde qui ne l’est pas moins. Le tout à l’ombre de Shakespeare.
Le narrateur : un enfant sur le point de naître, aux sens particulièrement développés malgré une capacité de mouvement des plus restreintes. La situation familiale, disons particulière : Trudy sa jeune mère, (adorée et détestée par notre narrateur) a mis son père (John le poète) à la porte du domicile conjugal (accessoirement, notons que la maison appartient pourtant à John) pour y vivre une relation adultérine avec Claude qui n’est autre que, comme le découvre avec horreur notre narrateur, le frère de John. Et s’il subit l’horreur de la situation par la pensée (comment intervenir ?), il la subit aussi physiquement car Claude, incroyablement ennuyeux au quotidien, est capable de faire monter Trudy au rideau en quelques minutes, ce dont il ne se prive pas. Relecture iconoclaste d’un Hamlet ne questionnant plus la mort mais la vie (naître ou ne pas naître), Dans une coque de noix est un feu d’artifice d’intelligence, de drôlerie, tiré par l’un des plus remarquables artificiers du monde littéraire.
PAGE — Comment vous sentez-vous alors que vous attaquez un an après la première parution de votre dernier roman une nouvelle tournée promotionnelle ?
Ian McEwan — Un livre doit mourir afin que vous puissiez attaquer l’écriture d’un autre livre et, à mon avis, la méthode la plus rapide pour le tuer, c’est d’en parler encore et encore !
P. — Et l’avez-vous tué aujourd’hui ?
I. McE. — Oui (rires). Une mort sans douleur.
P. — Après tant d’évocations, vous arrive-t-il de voir votre texte différemment ?
I. McE. — Je me sens différent mais je ne le vois pas différemment. Lorsque je finis d’écrire, je suis totalement rempli de mon texte puis je commence à en parler. Je vivais dans mon projet et dorénavant, je vis en dehors et je le décris. C’est comme si je finissais par inventer un nouveau langage pour en parler et que ce langage finisse par se solidifier. C’est un vrai problème : vous avez un bon éditeur, vous voulez l’aider, vous voulez que les gens lisent le livre et, de nos jours, la pression sur le livre n’a sans doute jamais été aussi forte avec Internet et le reste. En même temps, vous devez faire attention à ne pas vous dissoudre là-dedans. Mais bon, c’est un problème de riche, la rançon d’un certain succès !
P. — Comment voyagez-vous d’une histoire à l’autre ?
I. McE. — J’aime laisser du temps entre deux livres. Je dis souvent que je suis bon à ne pas écrire et donc, dans ces moments-là, je n’écris pas. Je lis, fais des recherches, d’autres choses, j’ai de nombreux centres d’intérêt. Et à un moment cela vient. Je ne suis pas un écrivain qui attaque la première ligne de son nouveau livre juste après avoir mis un point final au précédent, le jour même. Je pense que poser les choses, hésiter, voyager est essentiel. Vous devez laisser une chance au hasard.
P. — Un certain nombre d’écrivains creusent, au fil de leurs livres, le même sillon. Avec vous, on ne sait jamais ce que l’on va lire. Cette manière de changer à chaque fois d’univers, de registre, de genre, est-ce conscient ?
I. McE. — Cela revient à la question de l’hésitation. L’hésitation est un élément essentiel, vital de l’acte de création. Se laisser du temps et de l’espace. Curiosité, ouverture, hésitation, ce que ça me donne, ce que ça me dit, où tout cela me conduit. Je laisse au loin le précédent livre, je m’enfuis et il meurt. Je ne l’oublie pas mais j’en profite pour élargir mes domaines de prédilection. En même temps, vous ne vous enfuyez jamais vraiment totalement et vous n’êtes pas censé vous en échapper car le roman, bien plus que n’importe quelle autre forme d’art, est personnel : le roman porte la trace de vos doigts sur chaque mot ! Et je sais qu’on ne peut être une autre personne que celle que l’on est.
P. — Comment avez-vous trouvé la voix de votre héros ?
I. McE. — Cela a été difficile. J’avais l’idée du livre : le fœtus devait parler mais de quelle manière ? Il m’a fallu presque trois mois pour capter cette voix et une fois que je l’ai eue, j’ai écrit quelques pages d’un monologue qu’il tenait et j’ai su alors que le roman s’écrirait tout seul. Je voulais aussi une voix qui fasse écho à Shakespeare, à sa prose qui m’a toujours fasciné, je voulais quelque chose de son rythme.
P. — Lisez-vous en français ?
I. McE. — Oui, c’est la seule langue que je parle assez pour lire les traductions qui sont faites de mes livres. Je parle un peu allemand mais pas suffisamment. Je suis admiratif de la traduction française même s’il y a toujours quelque chose de perdu.
P. — Comment avez-vous travaillé avec Shakespeare à vos côtés ?
I. McE. — Tous les écrivains anglais évoluent à côté de Shakespeare, qu’ils l’aiment ou pas, qu’ils le connaissent ou pas. Car son apport à la langue anglaise a été extraordinaire : le nombre d’expressions de la langue anglaise qui viennent de Shakespeare est incroyable, sans parler du nombre de mots utilisés quotidiennement qu’il a inventés. C’est pourquoi j’ai eu cette impression d’être un enfant assis avec sa mère.
P. — Peut-on considérer Dans une coque de noix comme un feel good book ?
I. McE. — En tout cas, j’ai pris un grand plaisir à l’écrire. Dans ces pages, il y a quand même un projet de meurtre mais j’espère que son traitement, l’écriture, apportent du plaisir.
P. — Pourquoi avoir fait du père, John, un poète ?
I. McE. — Pour plusieurs raisons. La première est assez simple : j’avais besoin que le narrateur ait une description de sa mère. Ensuite, une fois le lien avec Shakespeare et plus particulièrement Hamlet dessiné, je voulais que les deux figures du père soient différentes. Hamlet père était un soldat, un grand guerrier. Troisièmement, cela m’intéressait de traiter de la poésie sous un angle différent du prisme habituel et cela permettait de franchement distinguer le père de l’oncle, Claude étant un homme si prosaïque avec deux grandes qualités : d’abord il est profondément ennuyeux et il est très doué sexuellement, ce qui peut expliquer pourquoi Trudy s’engage avec lui.
P. — S’agit-il d’un livre sur le désir ?
I. McE. — Une des joies que m’a apportée ce texte a été de réussir à écrire l’acte d’amour du point de vue de l’intérieur. Les écrivains cherchent toujours une manière d’écrire les scènes de sexe et je pensais que toutes les options avaient été prises. Mais non. Nous avons en Angleterre le « Bad Sex in Fiction Award » couronnant l’auteur ayant écrit la pire scène de sexe dans un roman. La question avec mon livre était : est-ce une mauvaise description d’une bonne scène ou une bonne description d’une mauvaise scène ? Un des membres du jury a fini par écrire que les passages de mon livre relevaient bien de la seconde proposition et j’ai été tiré d’affaire !
P. — Envisagez-vous une suite ?
I. McE. — Quand celui-ci sera mort ! (Rires.) Nous revenons au début de cette interview !
P. — Merci
I. McE. — Merci à vous. Et bonne chance à Page des Libraires !