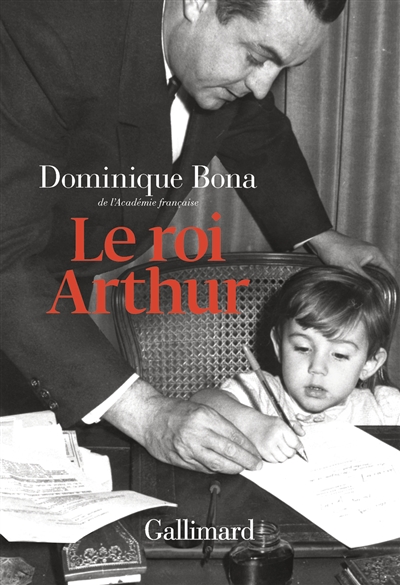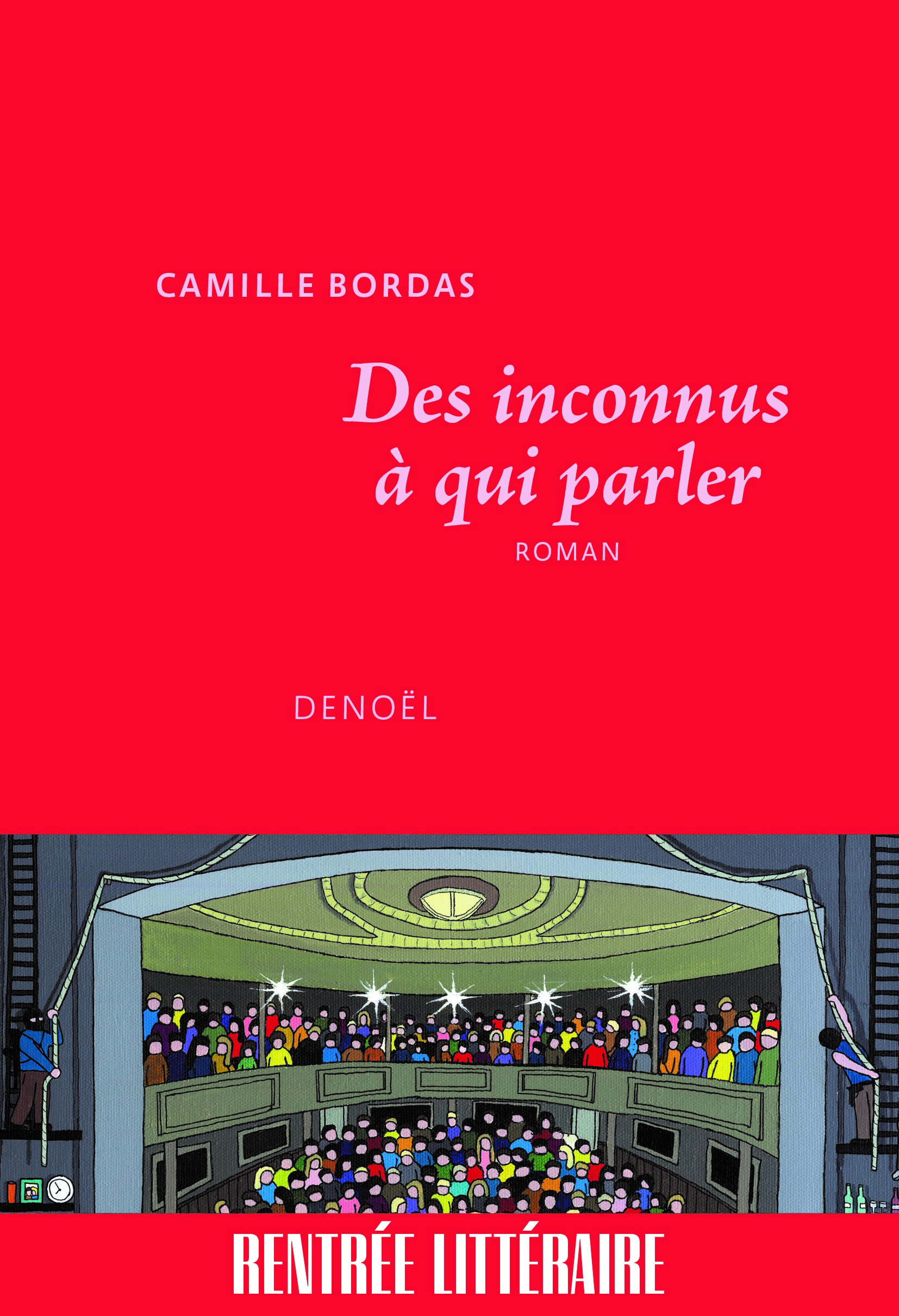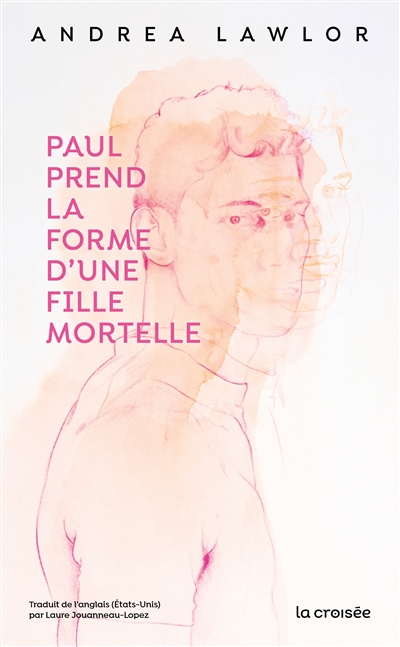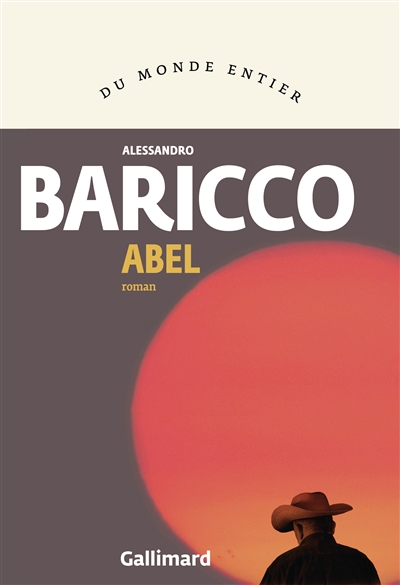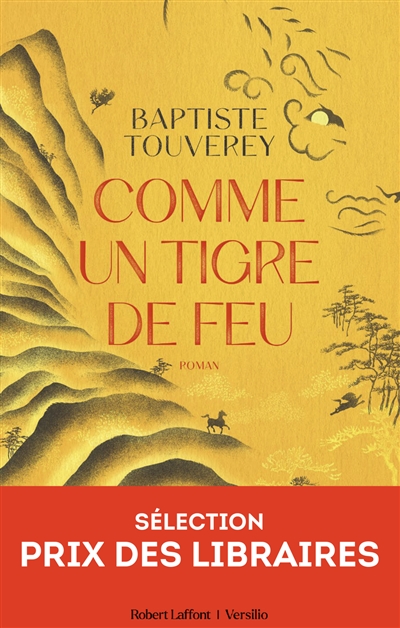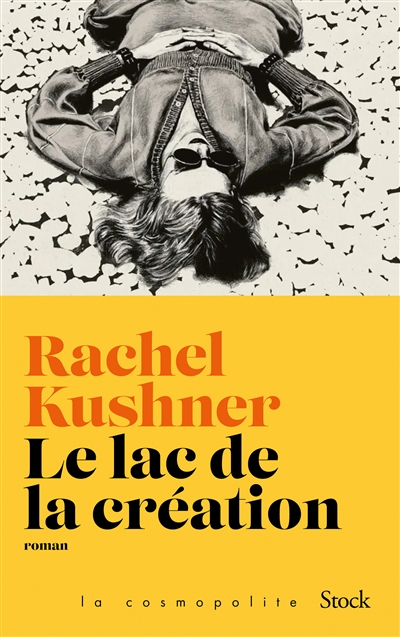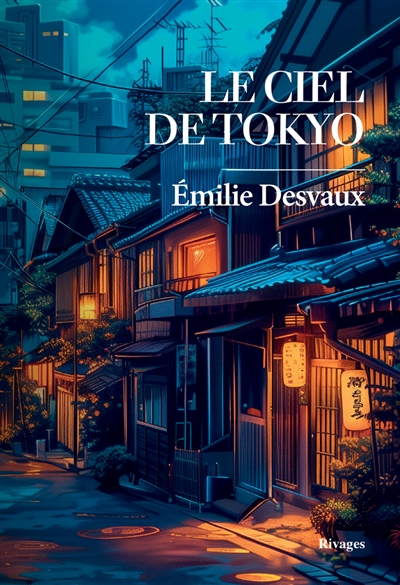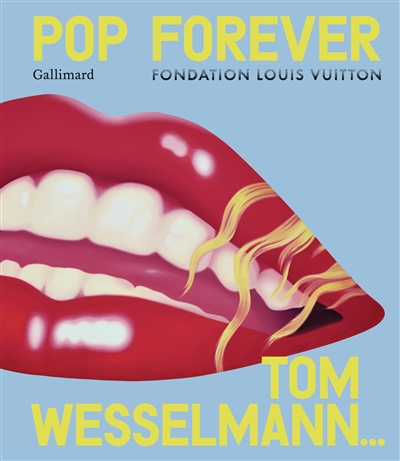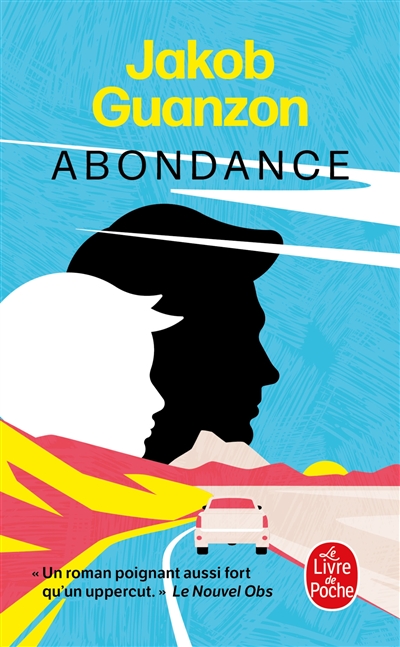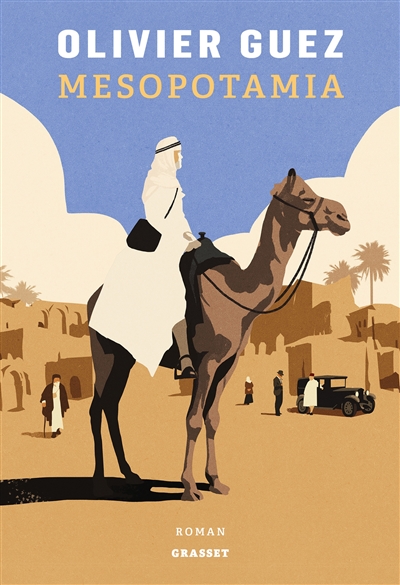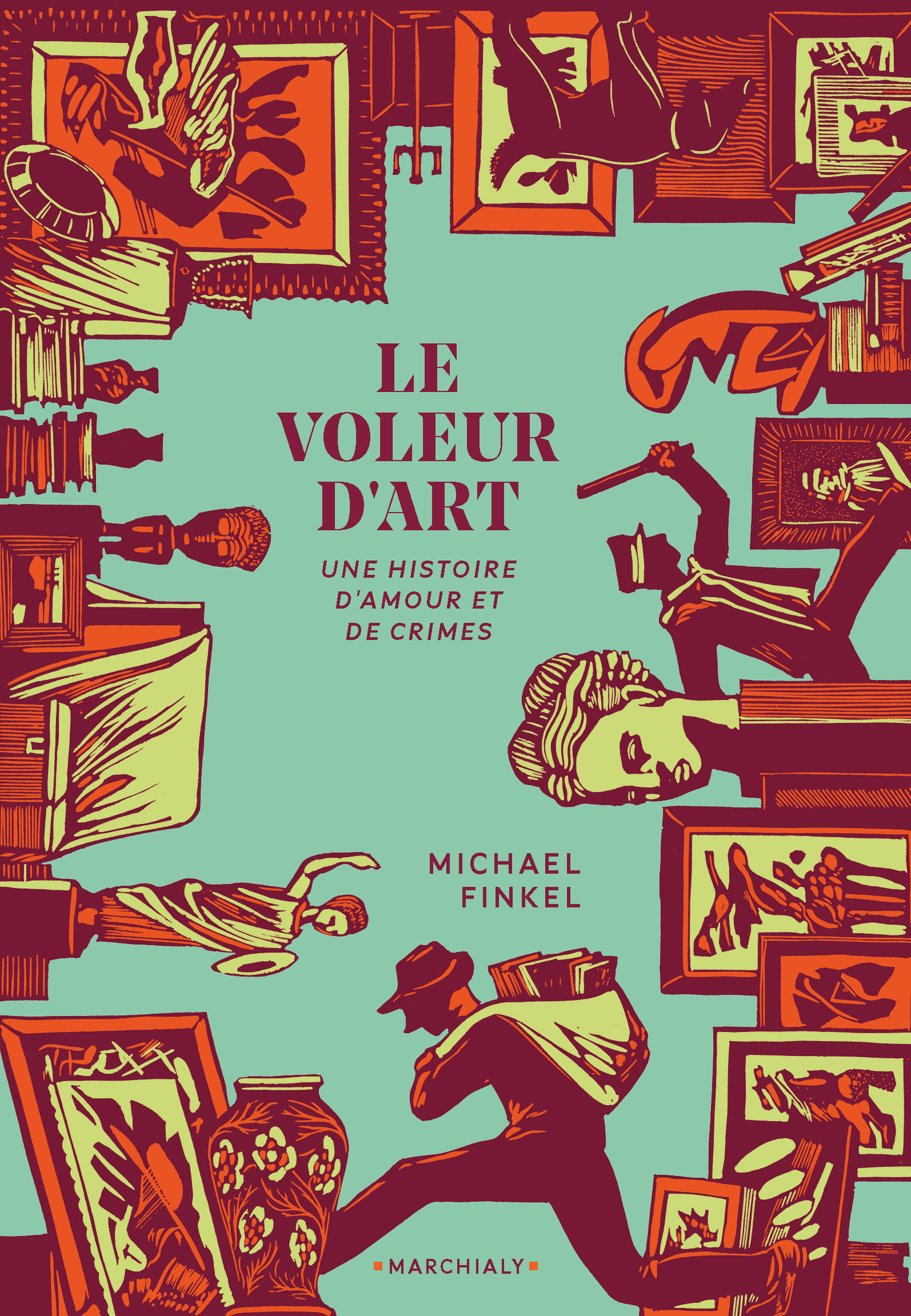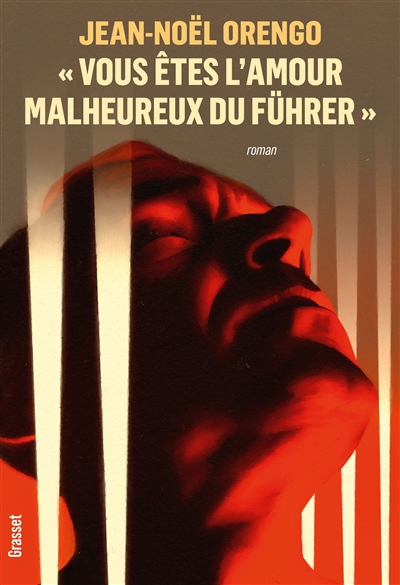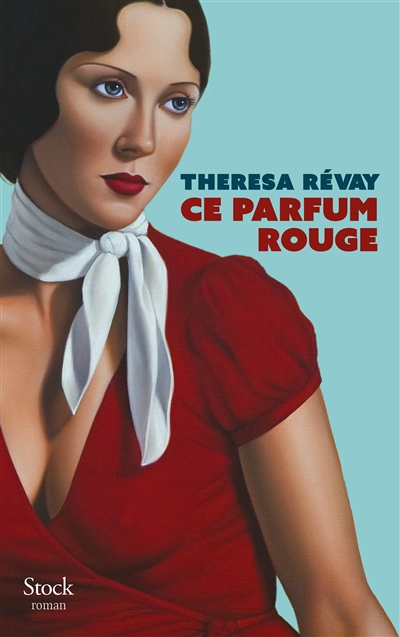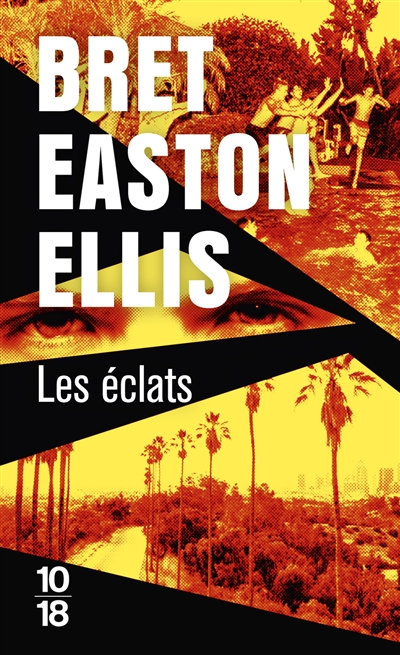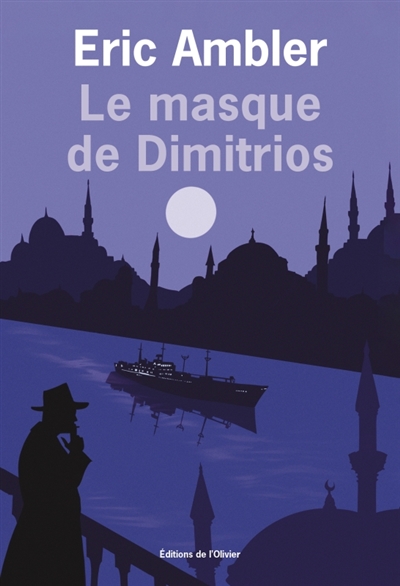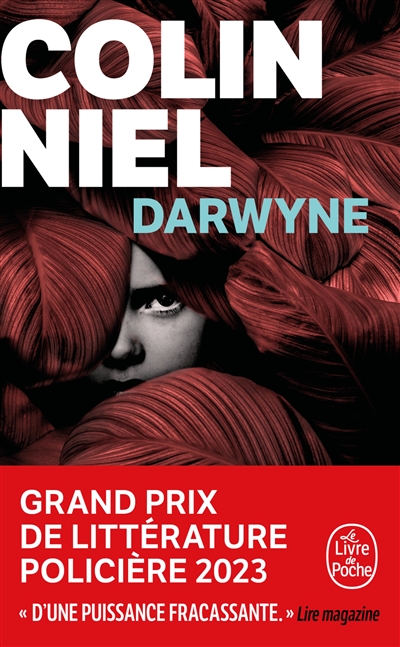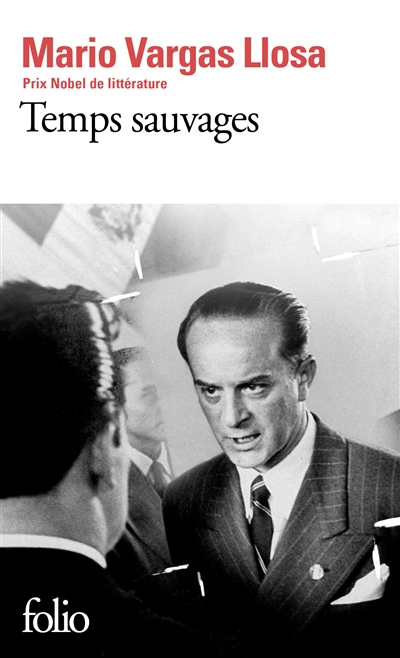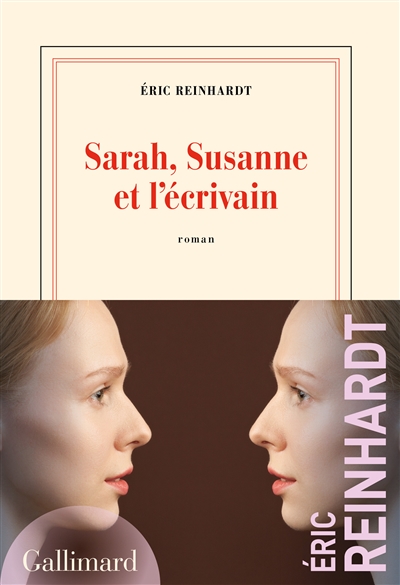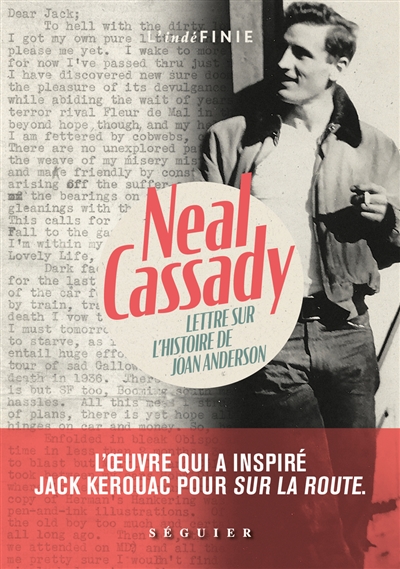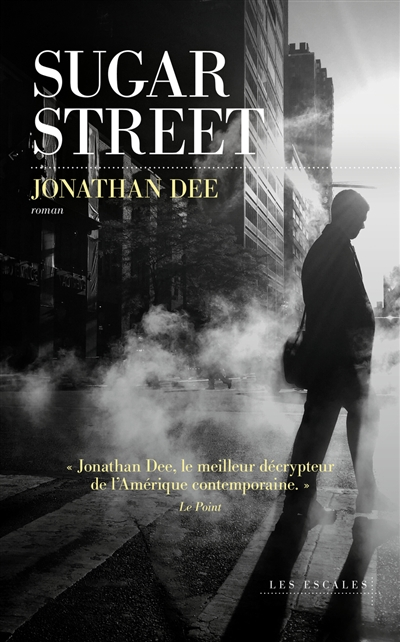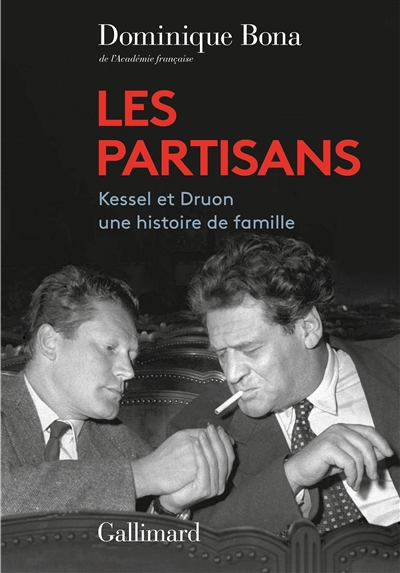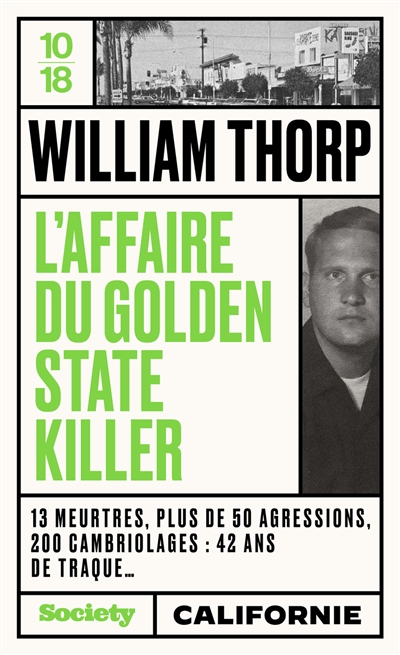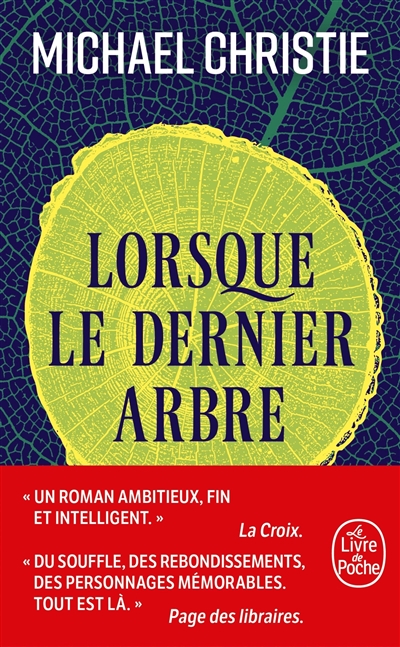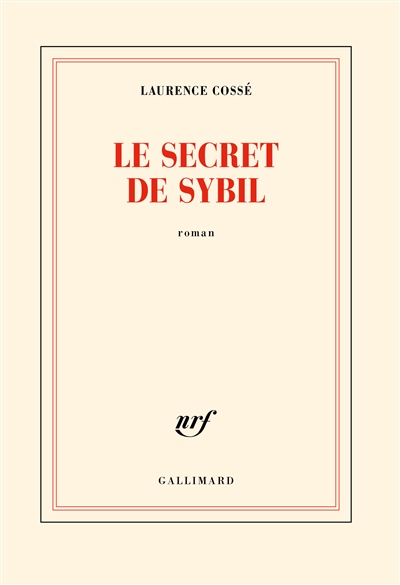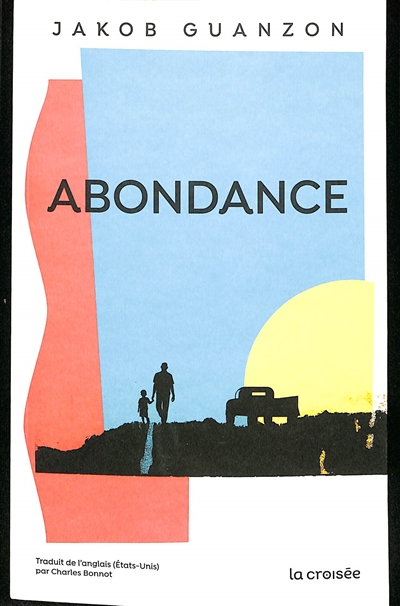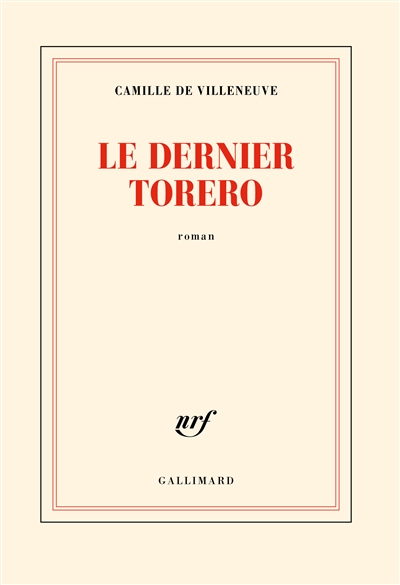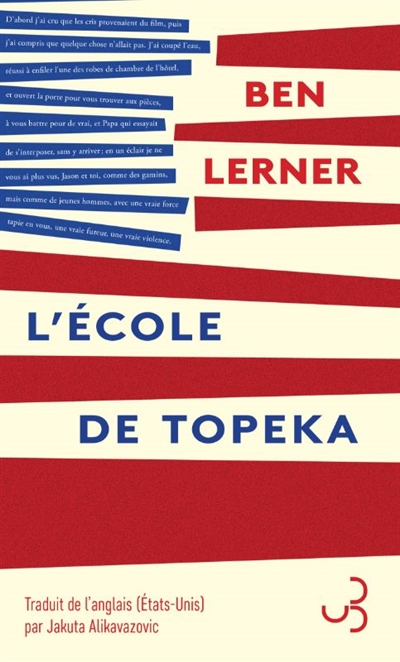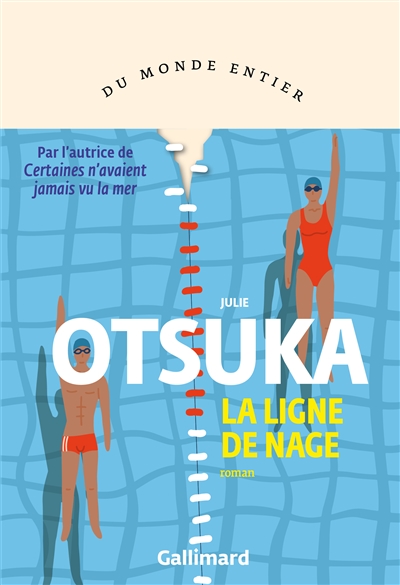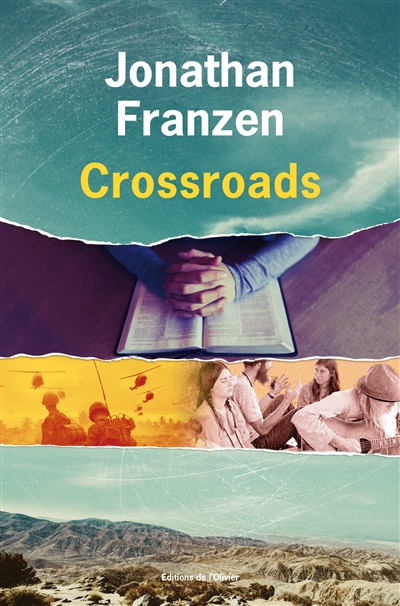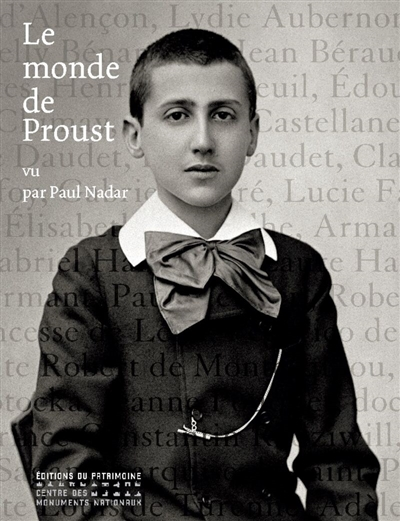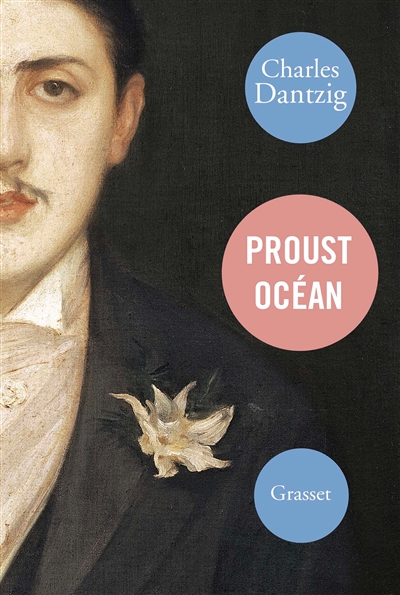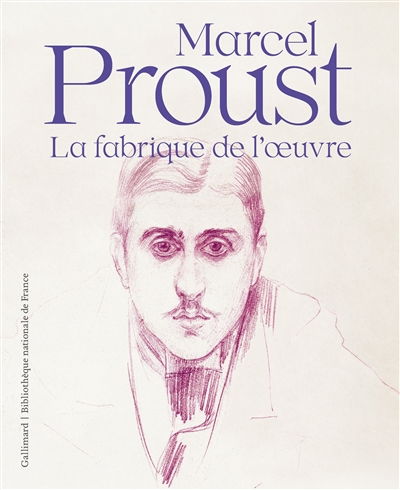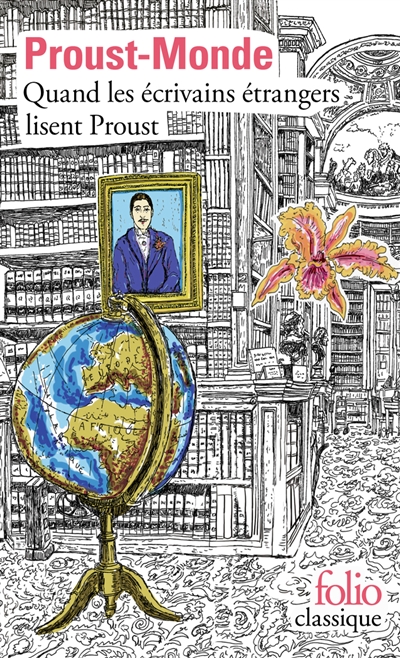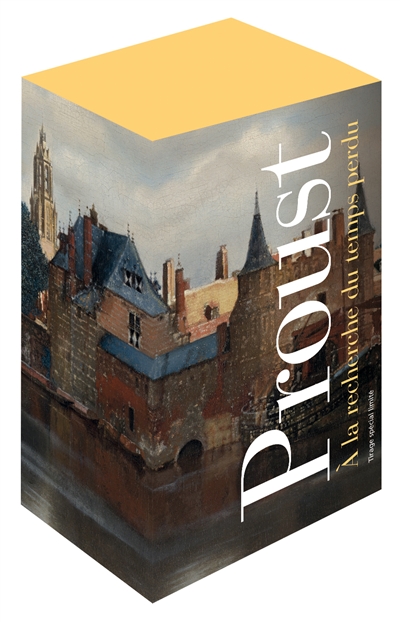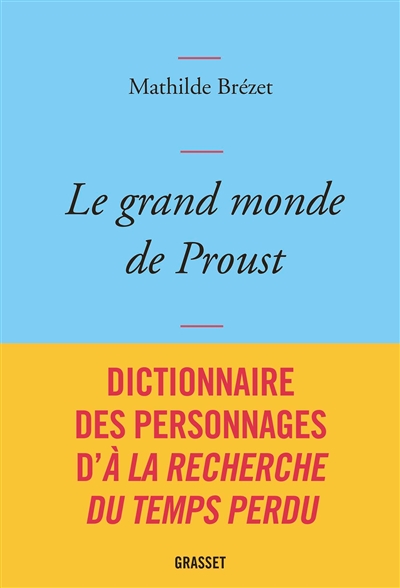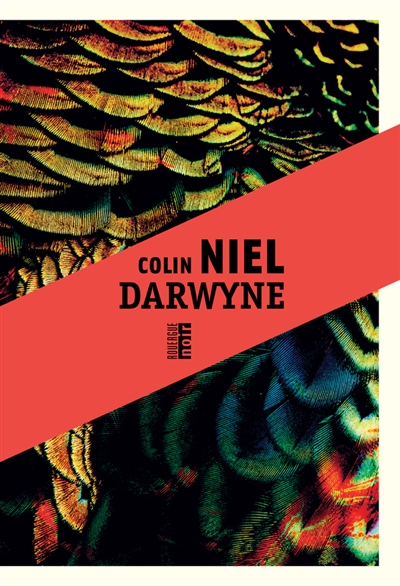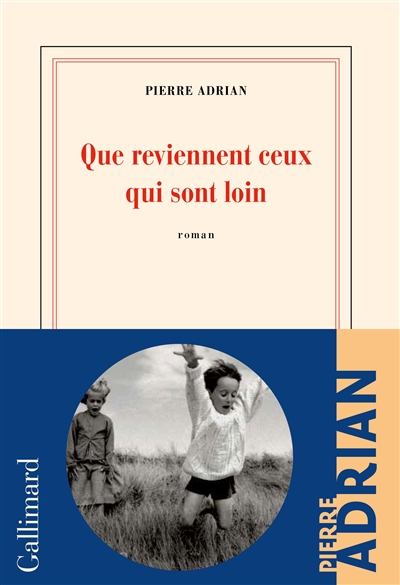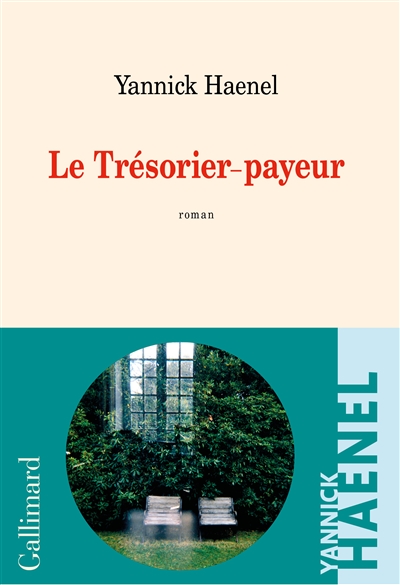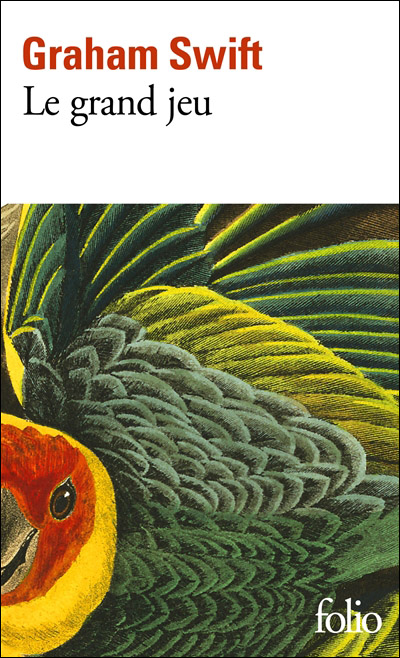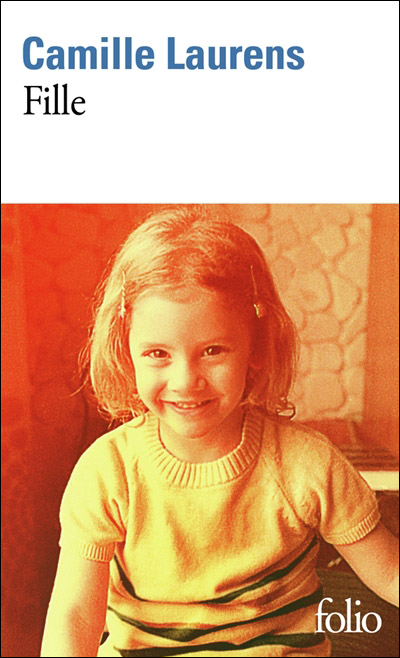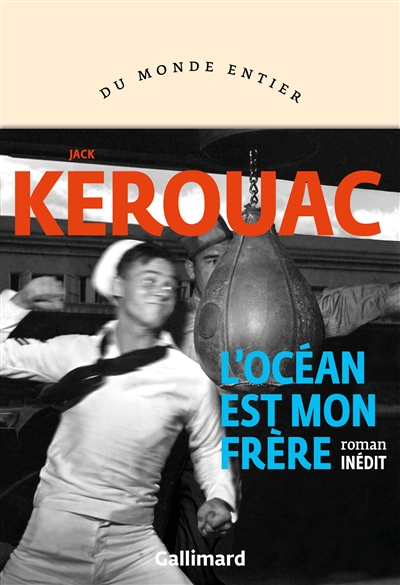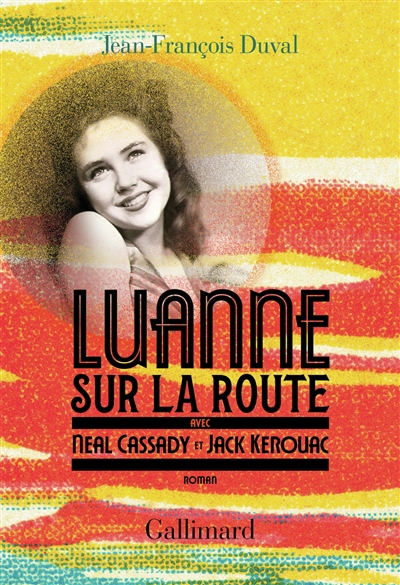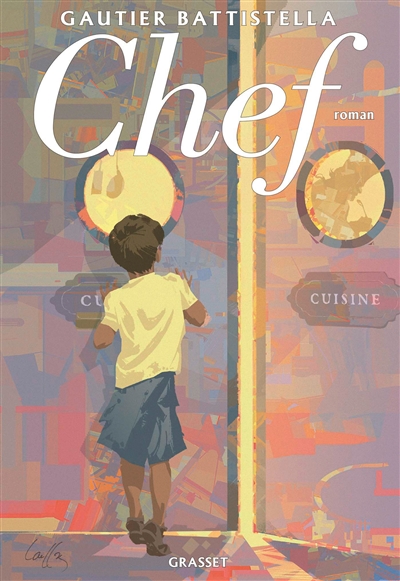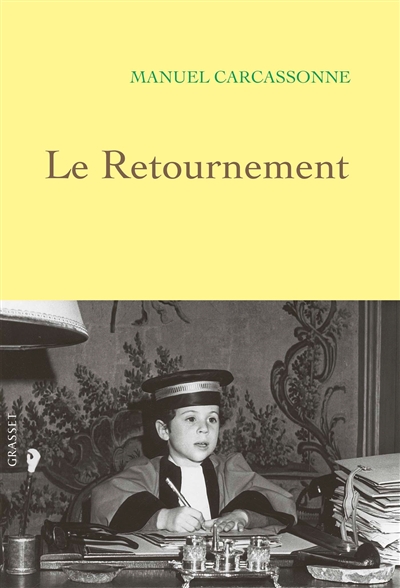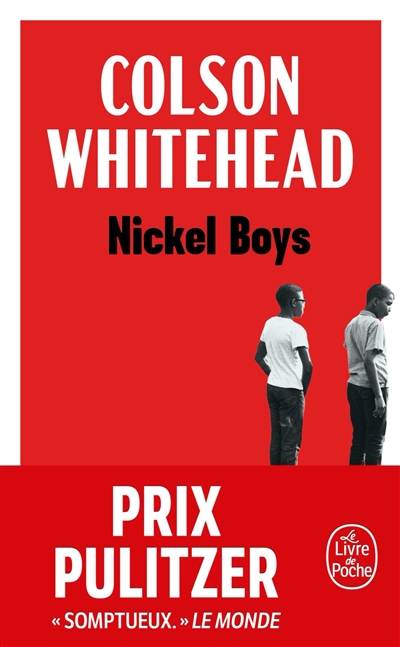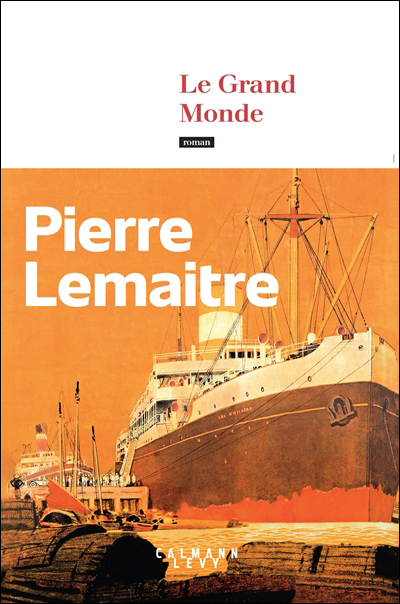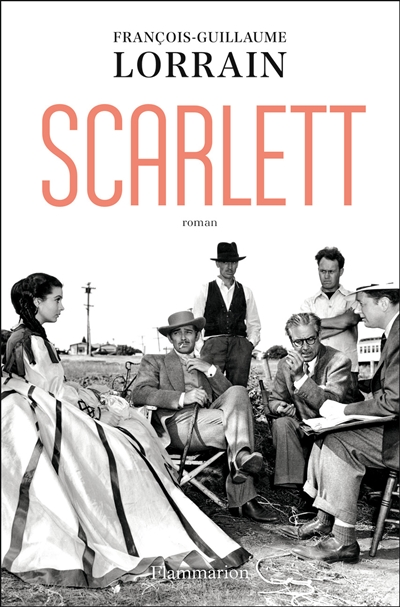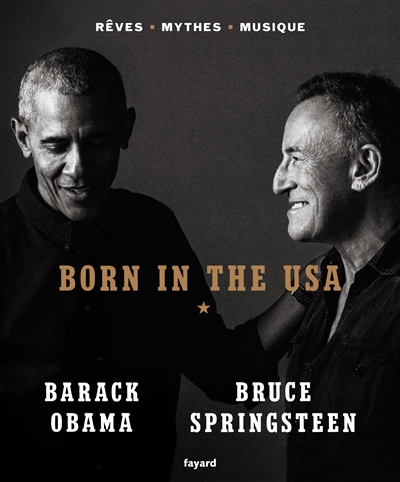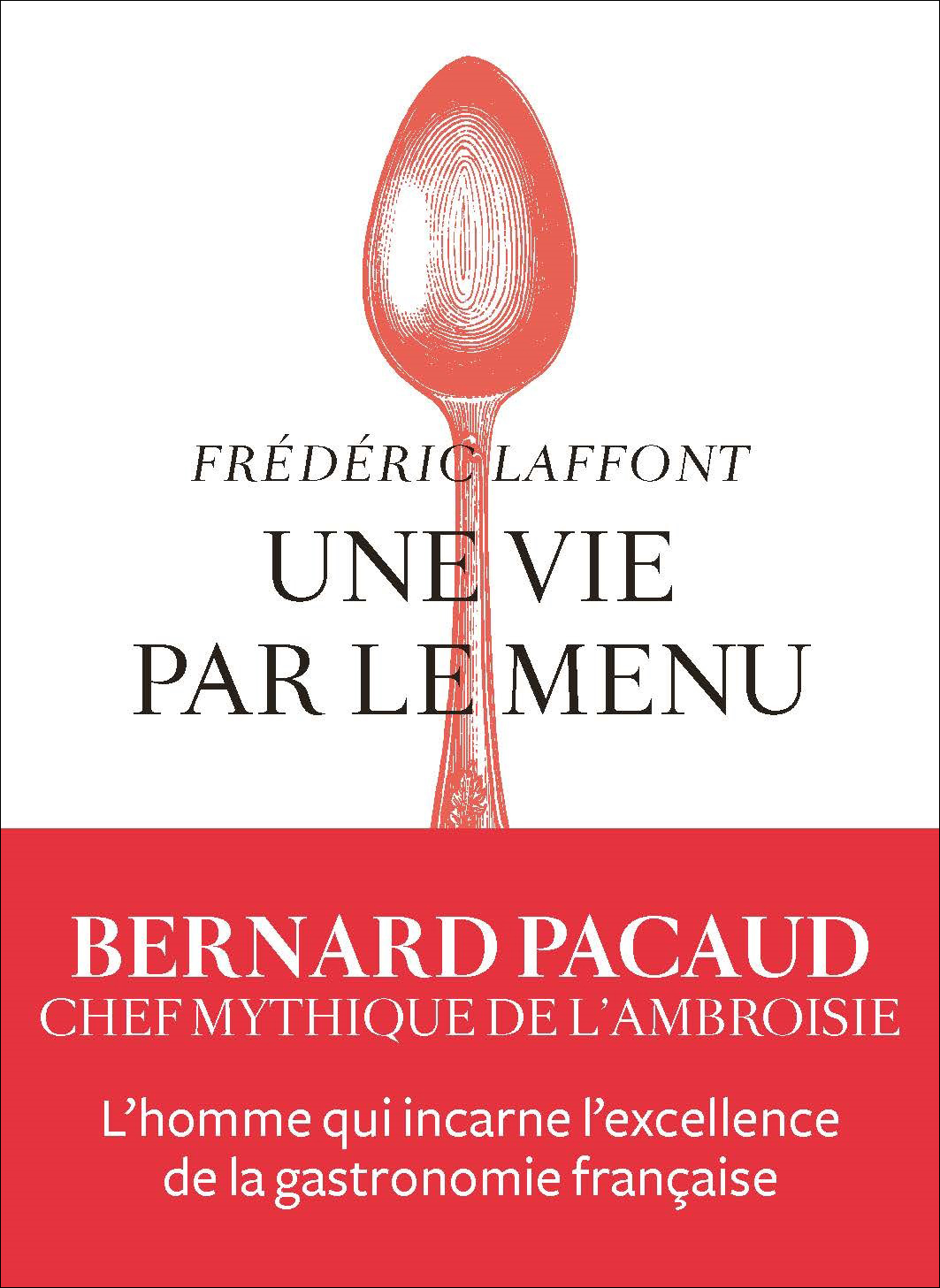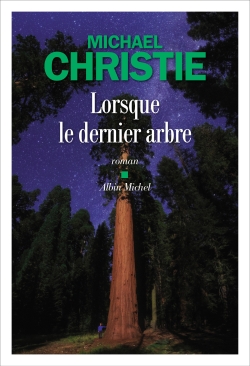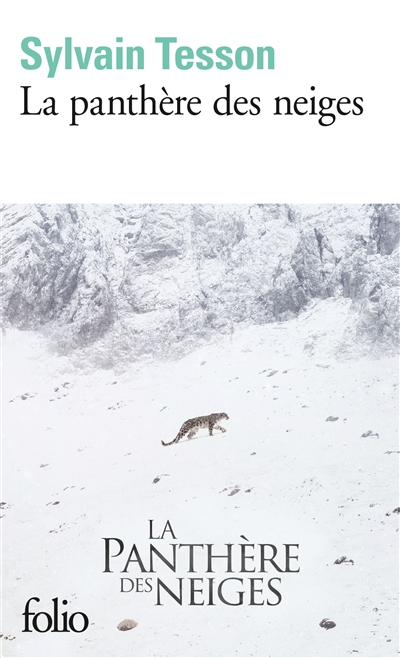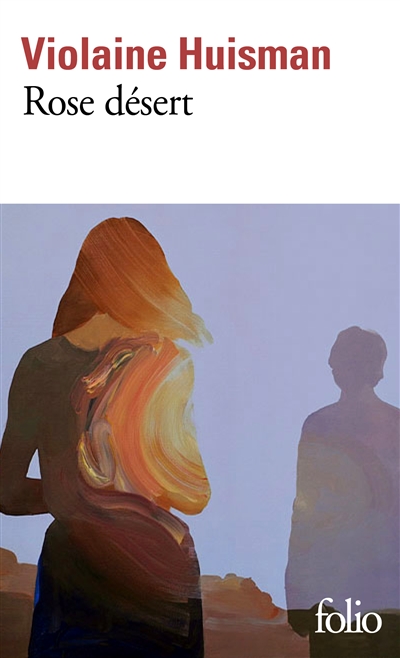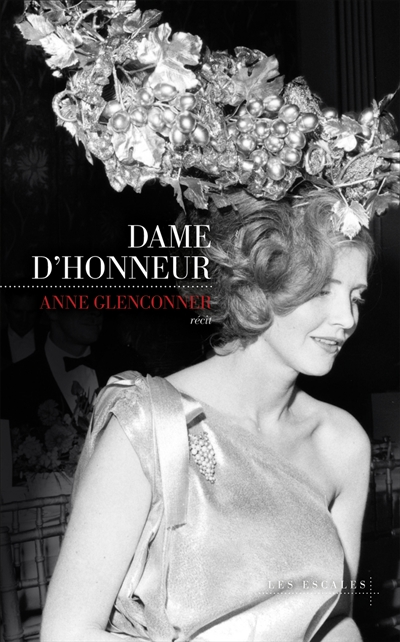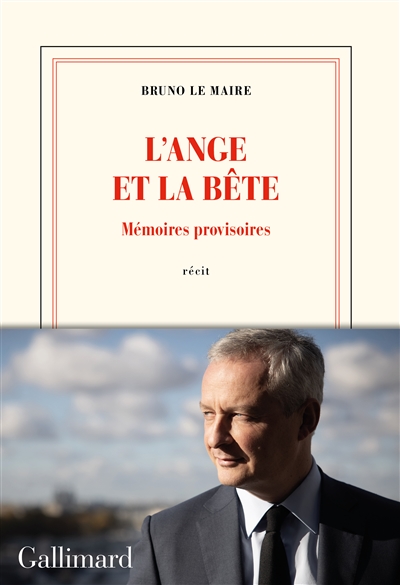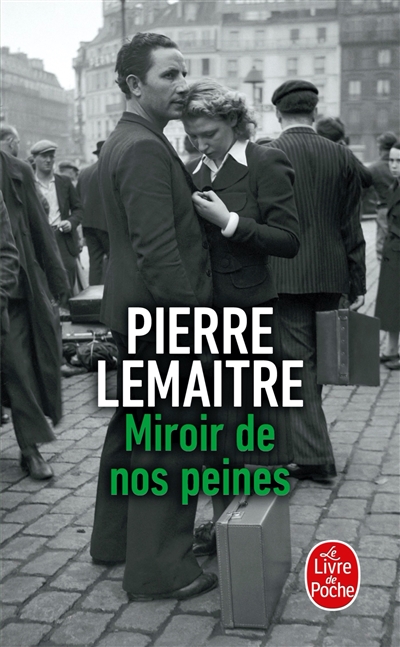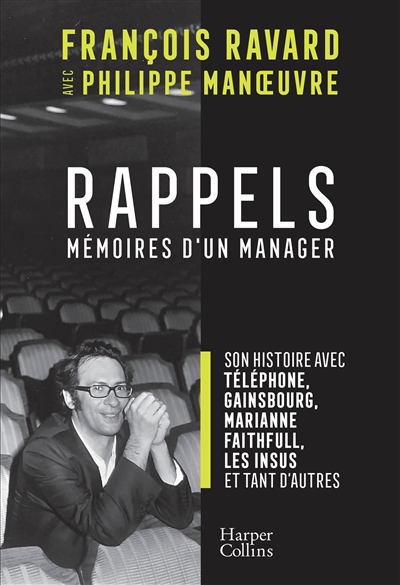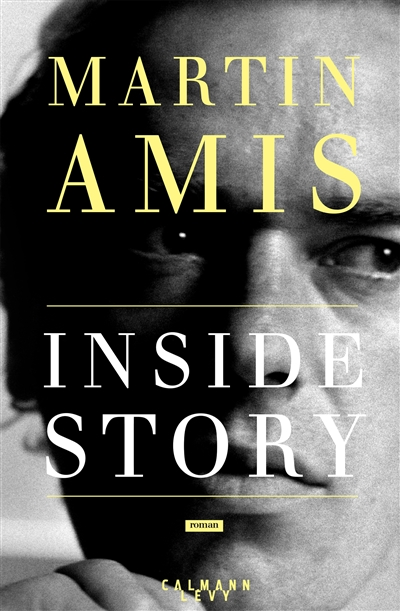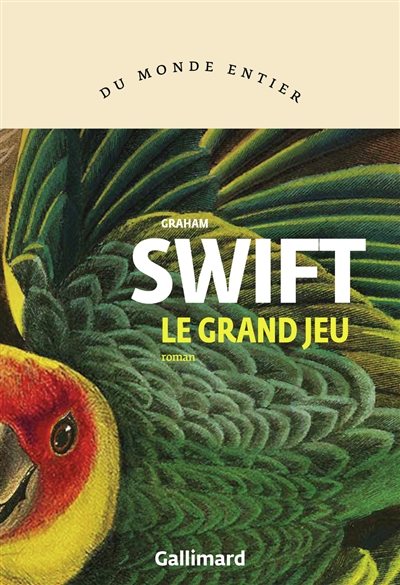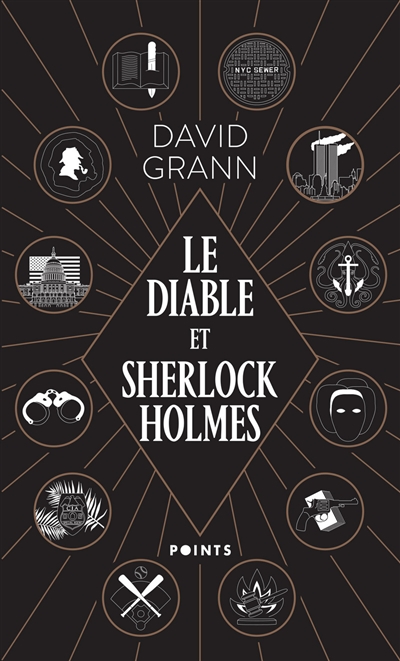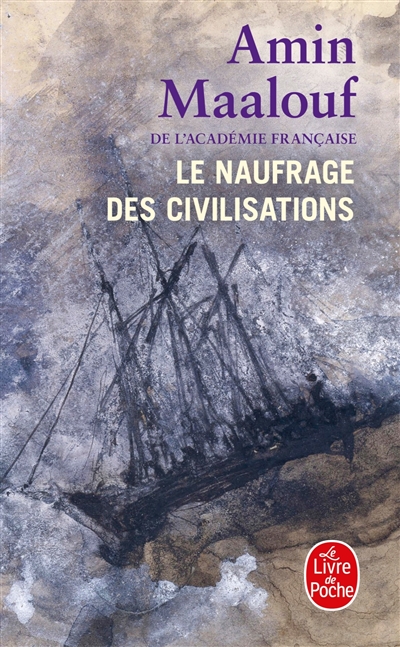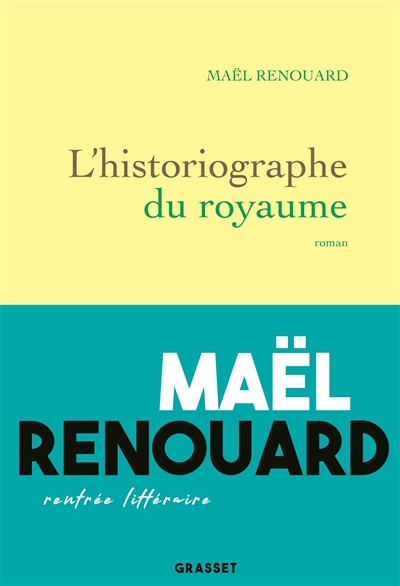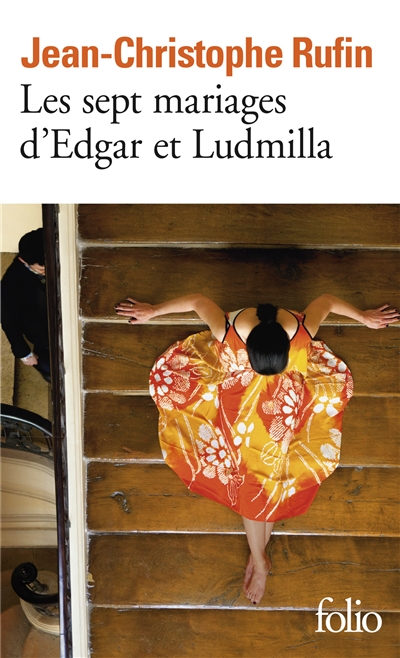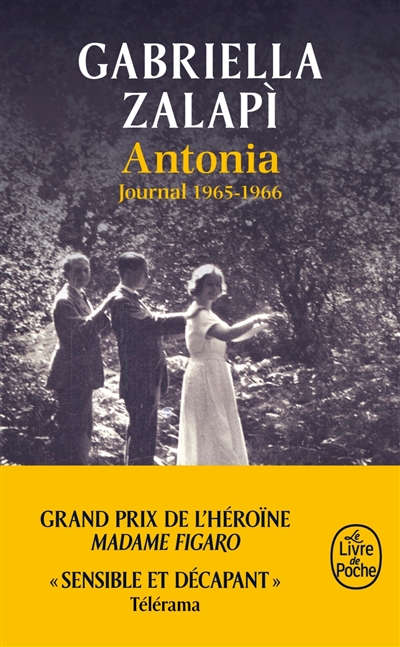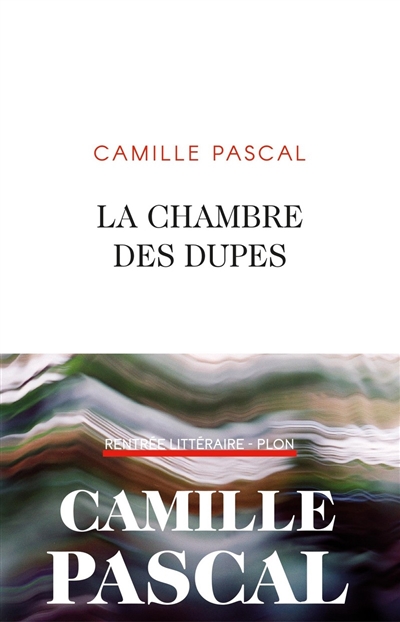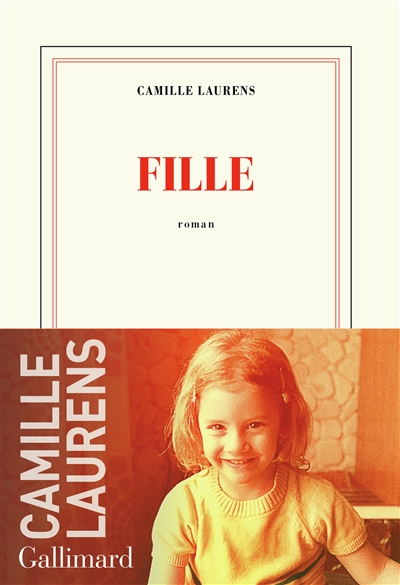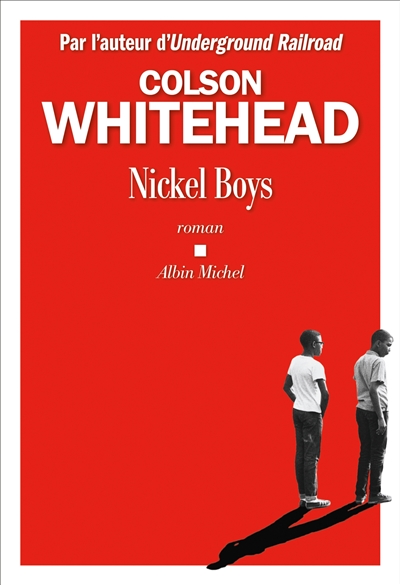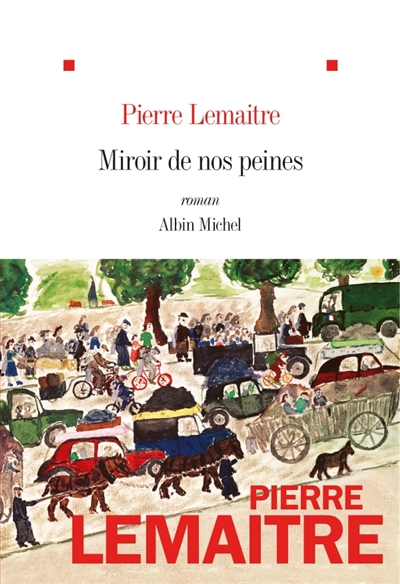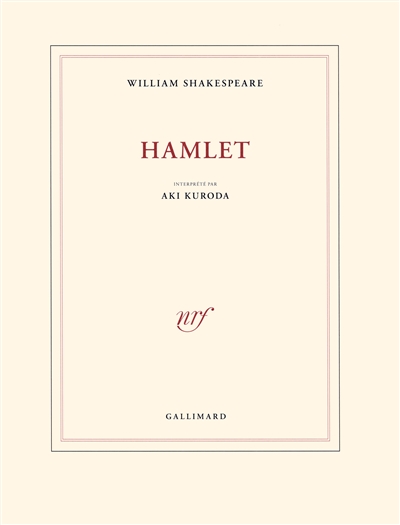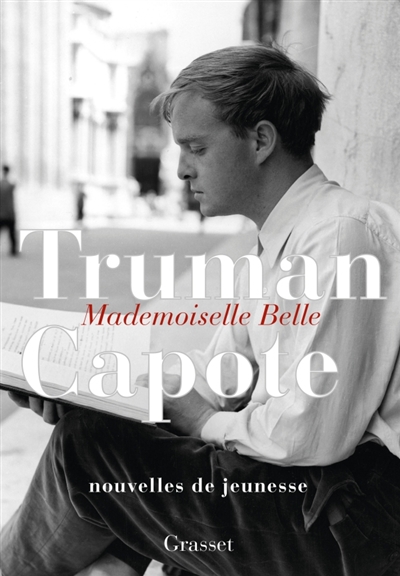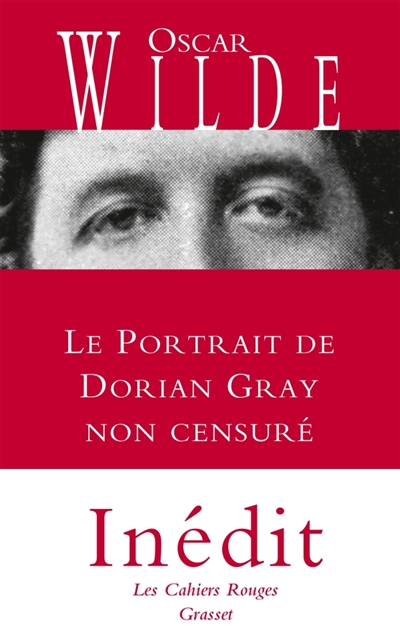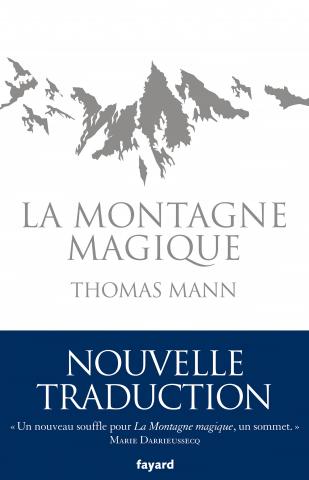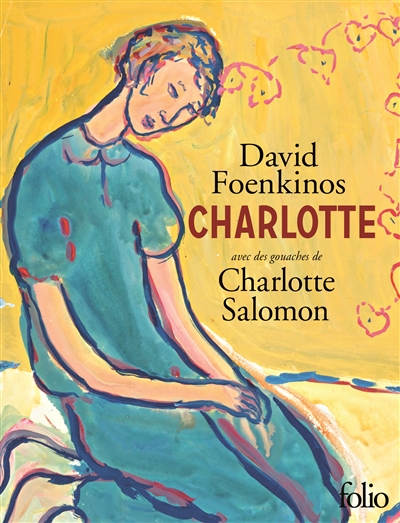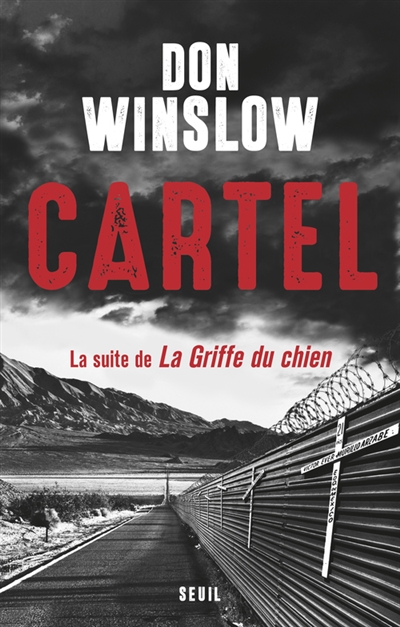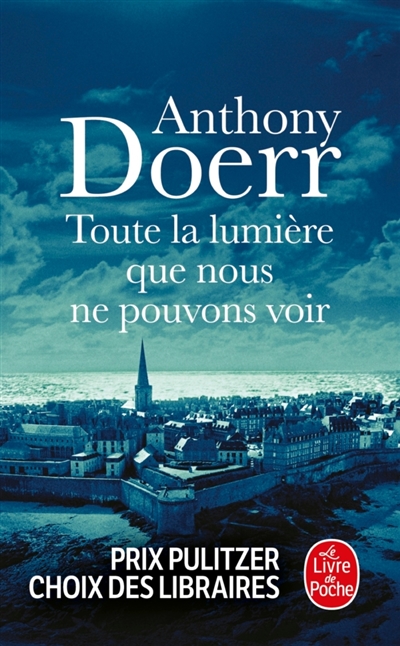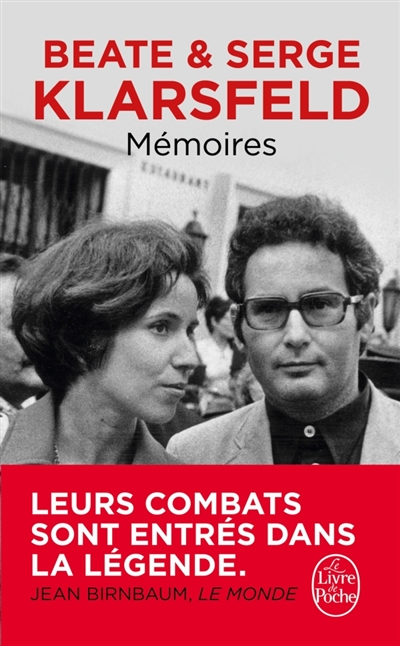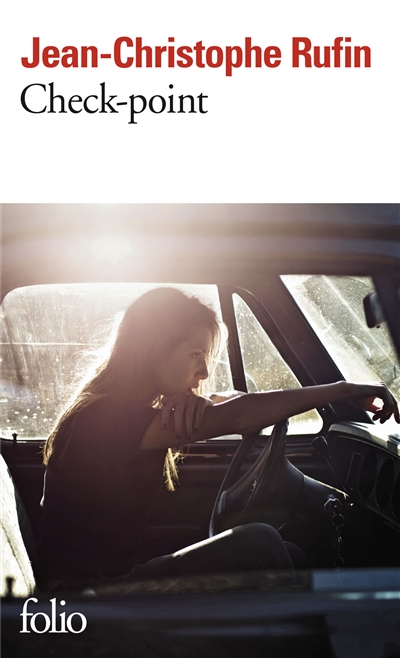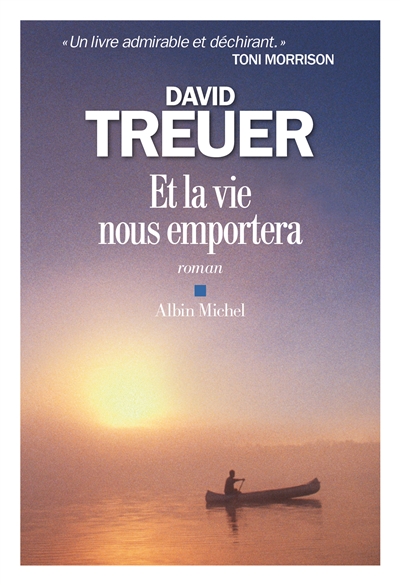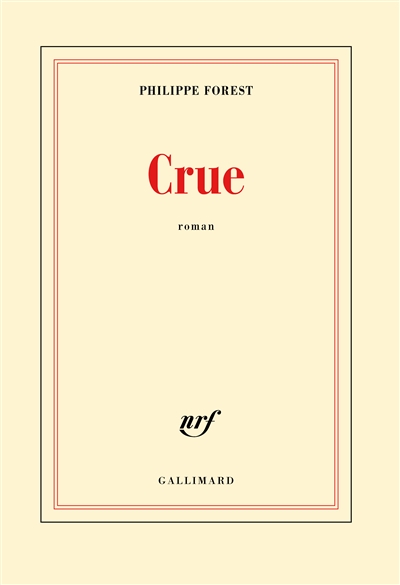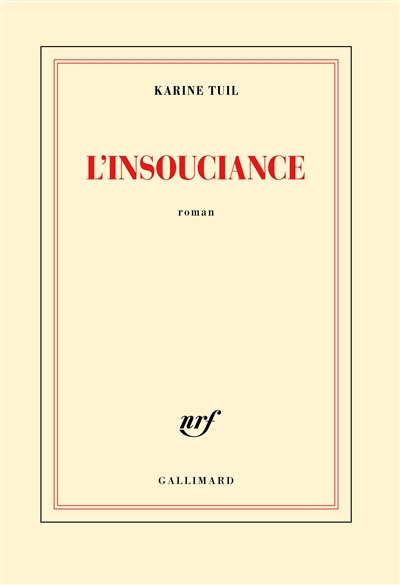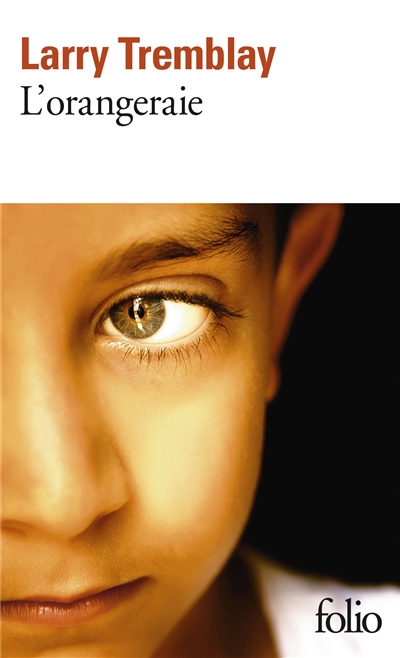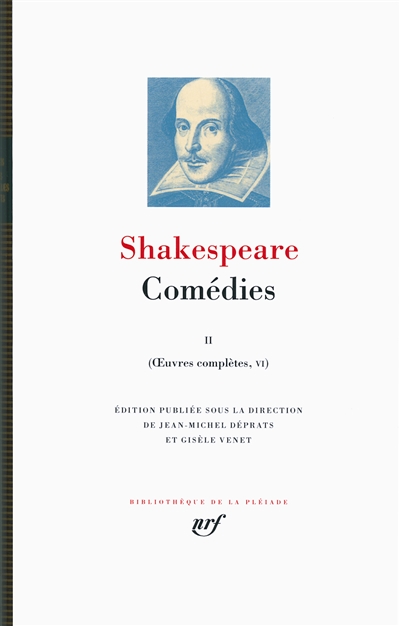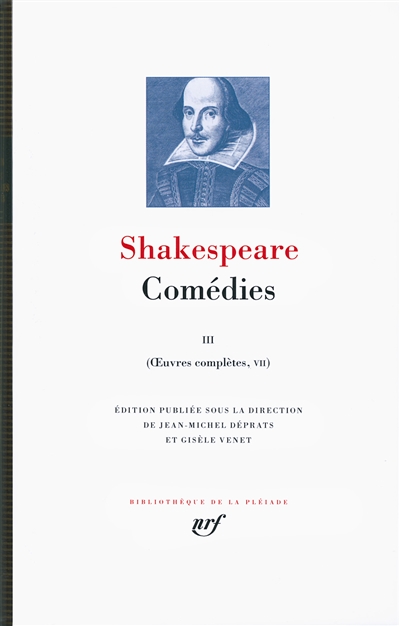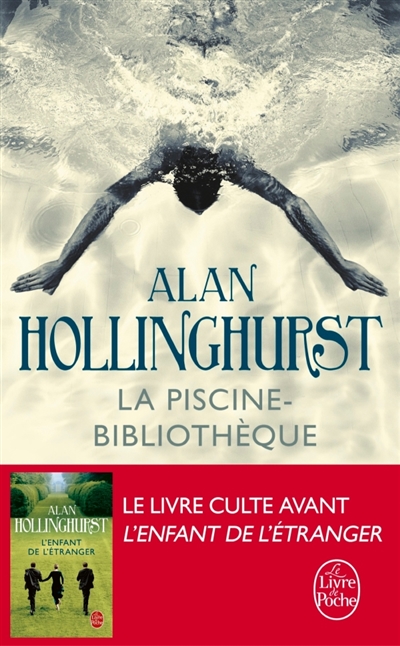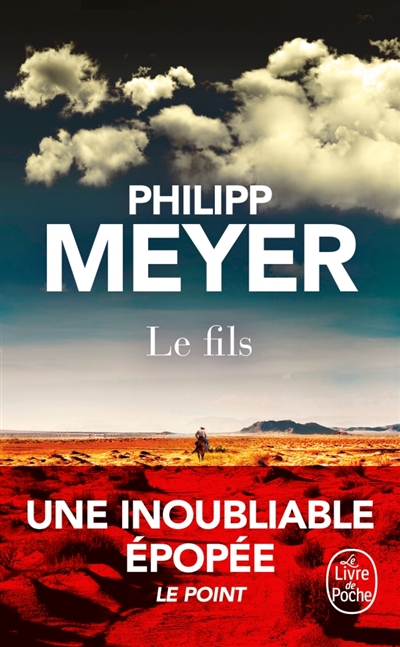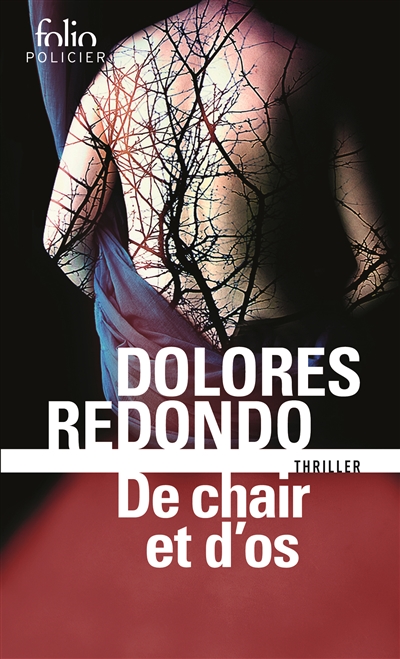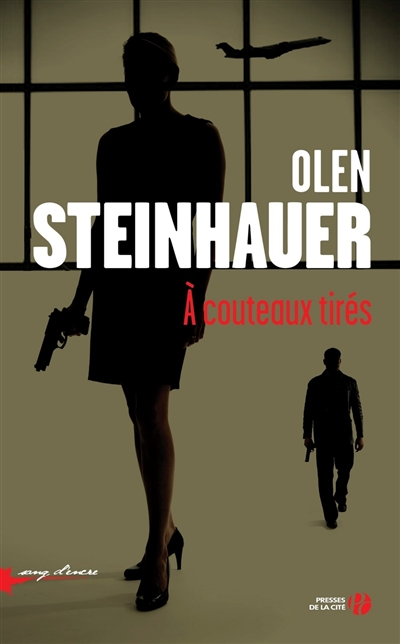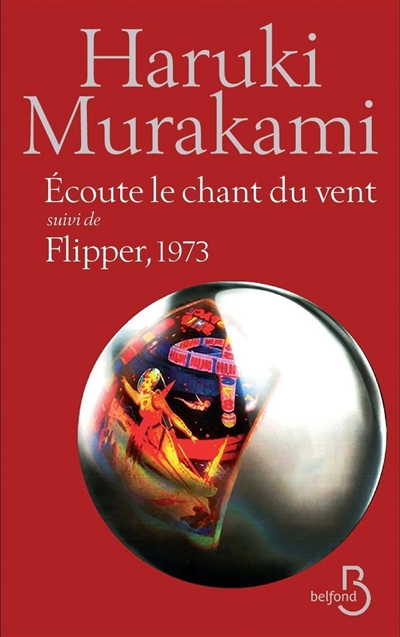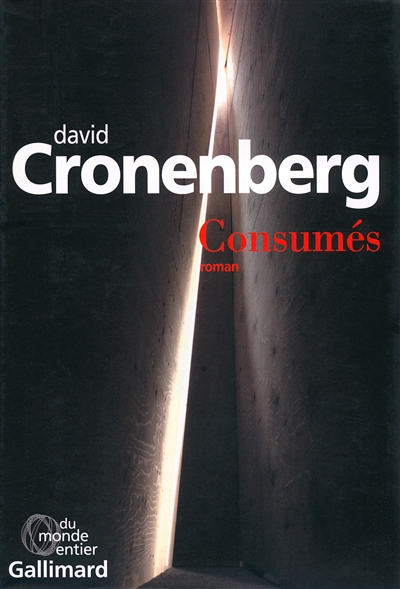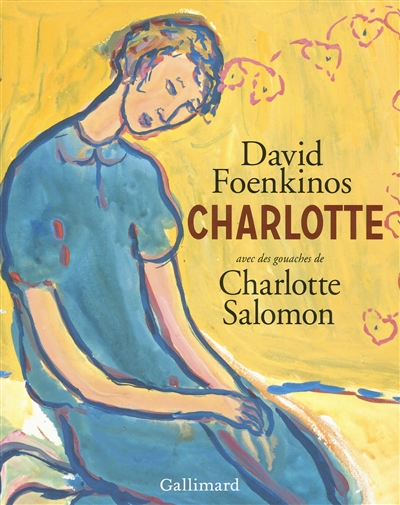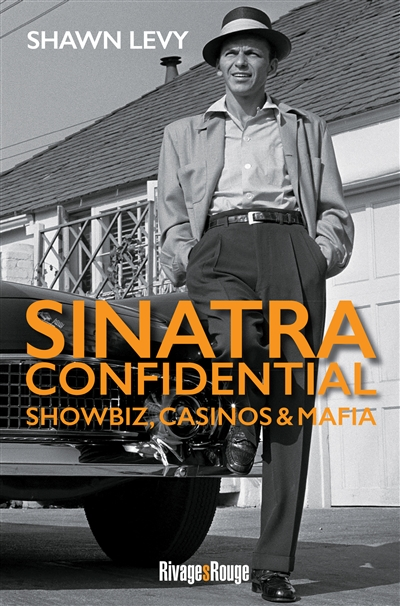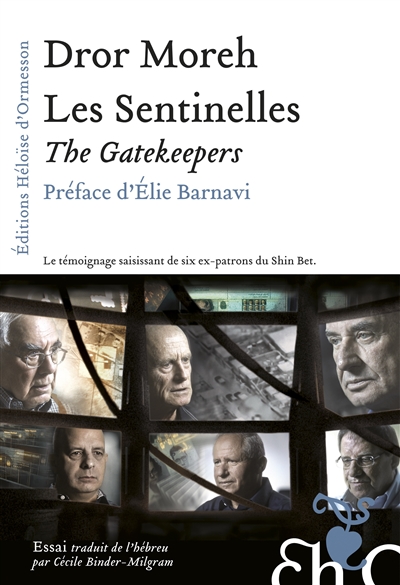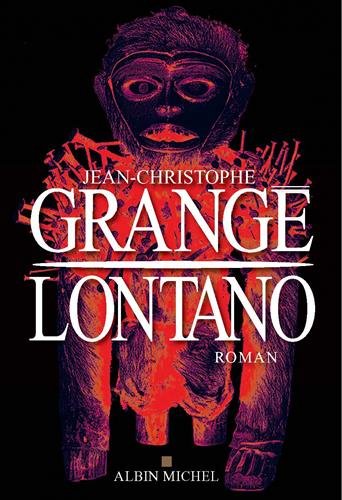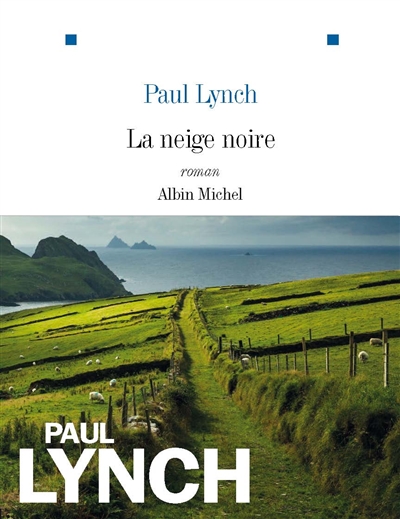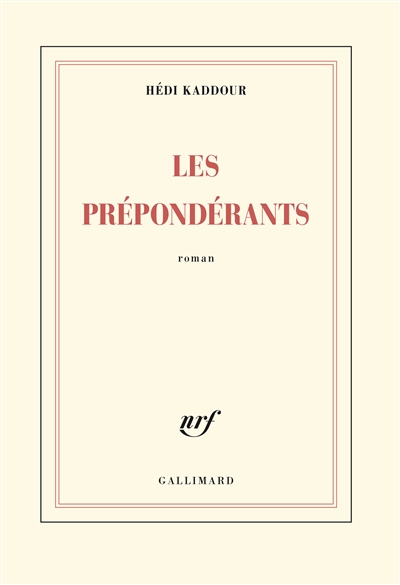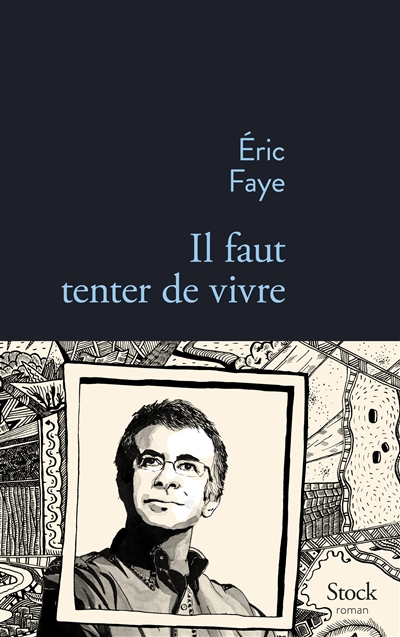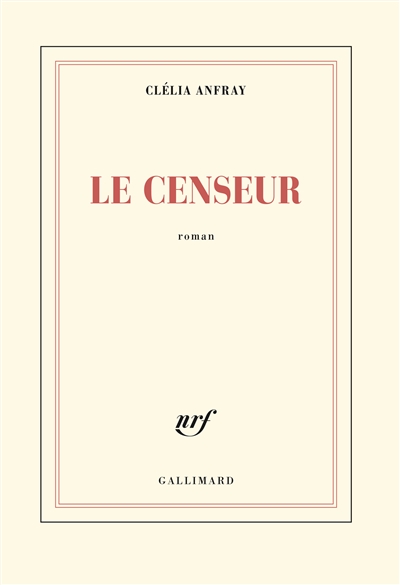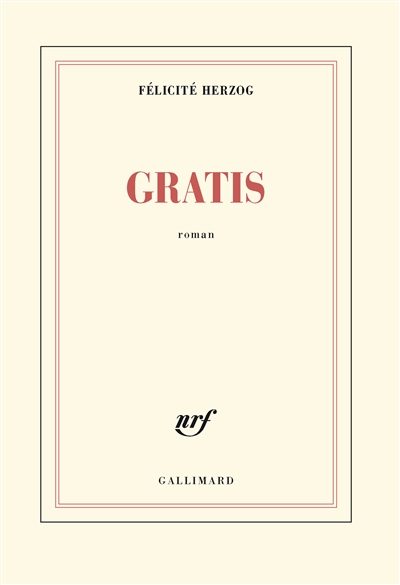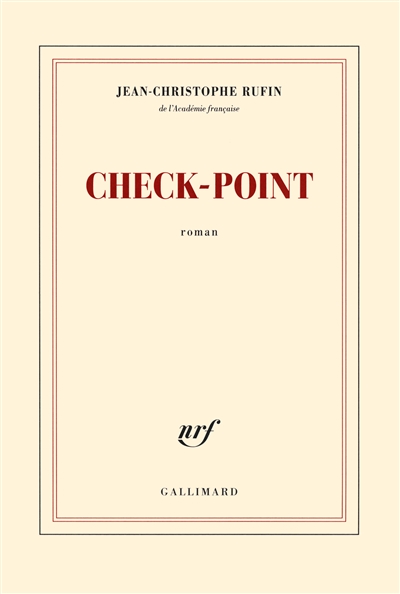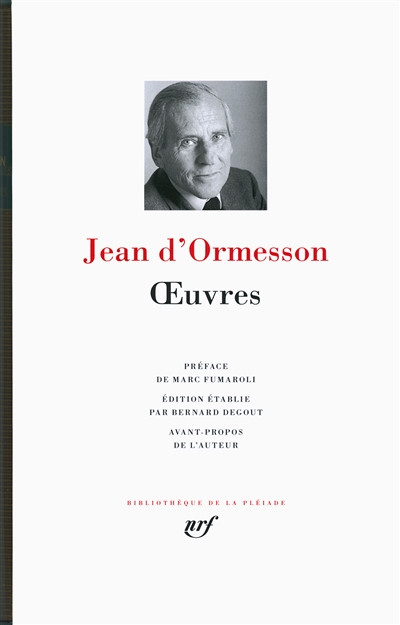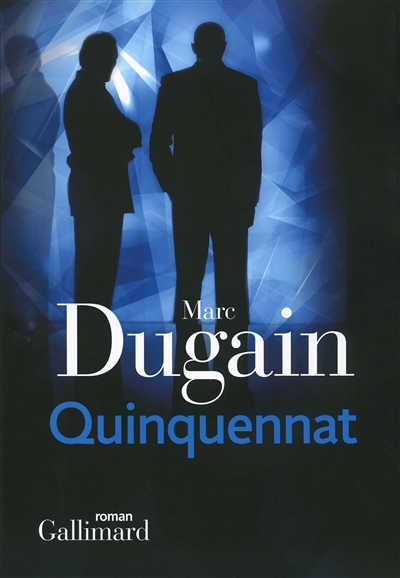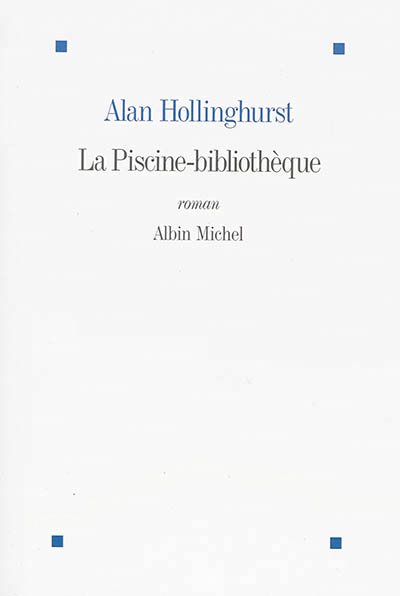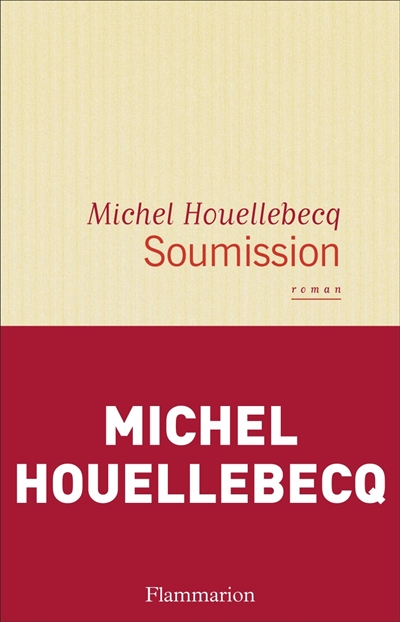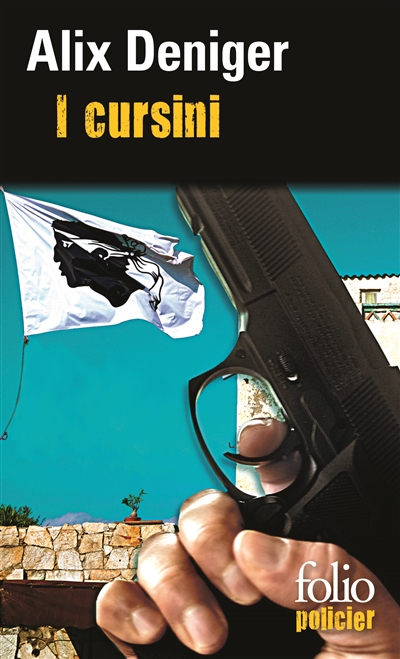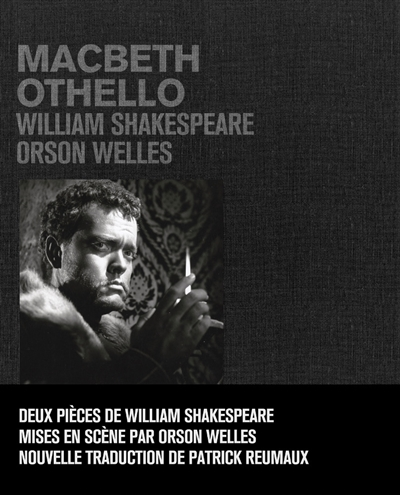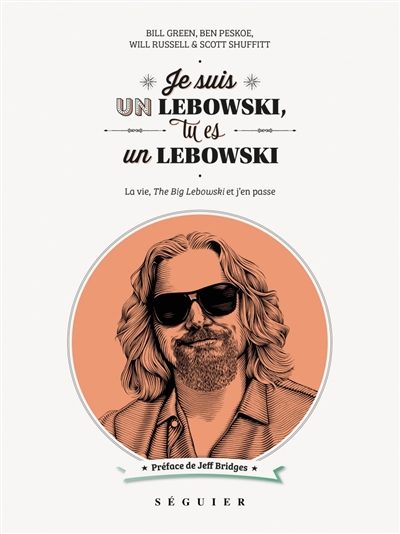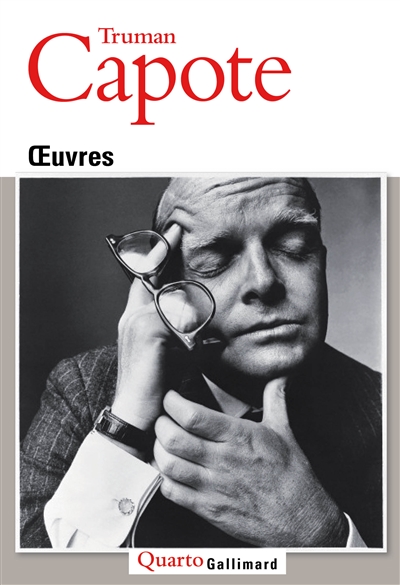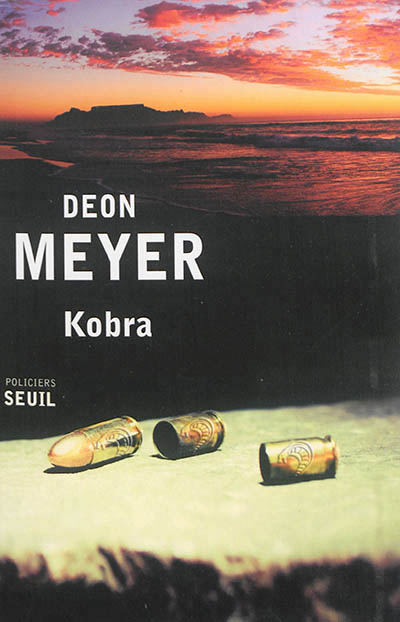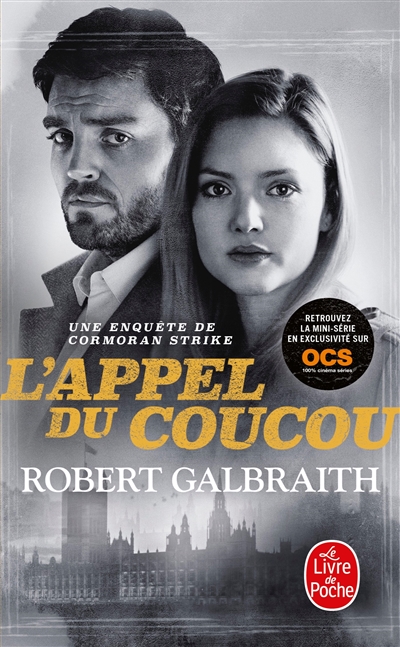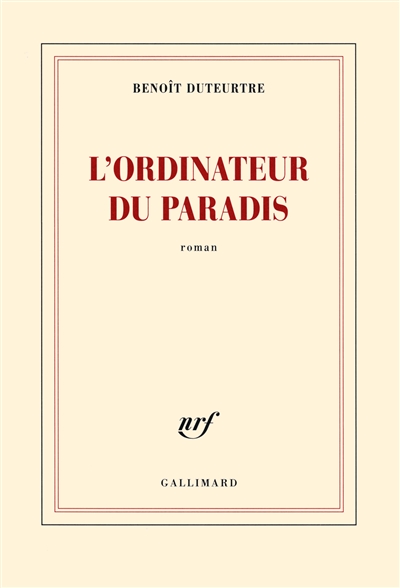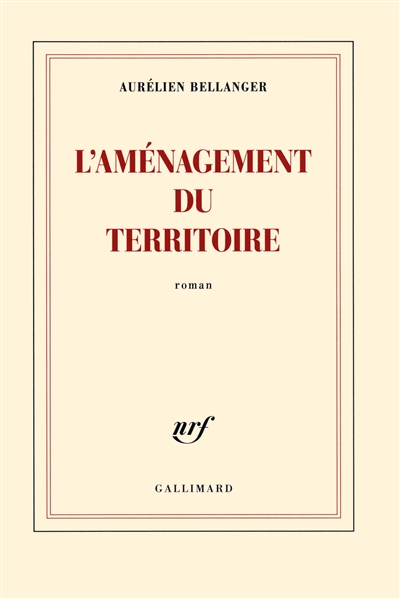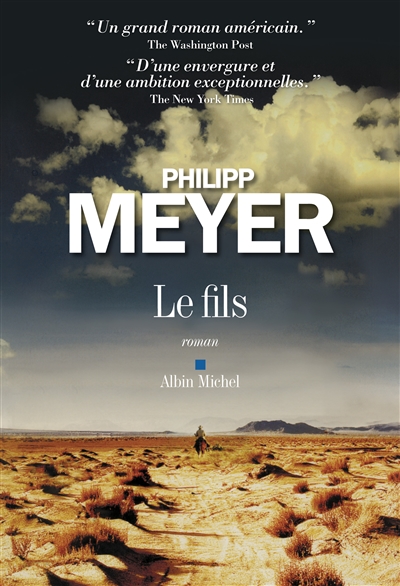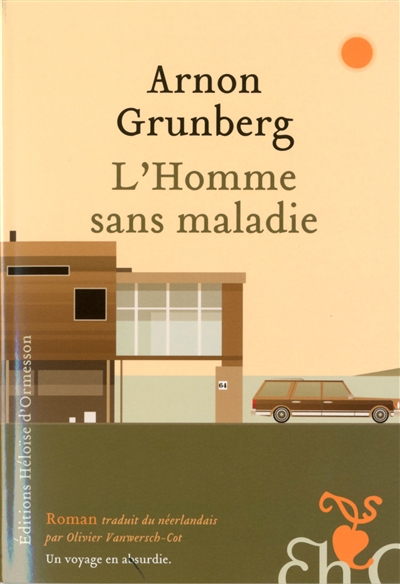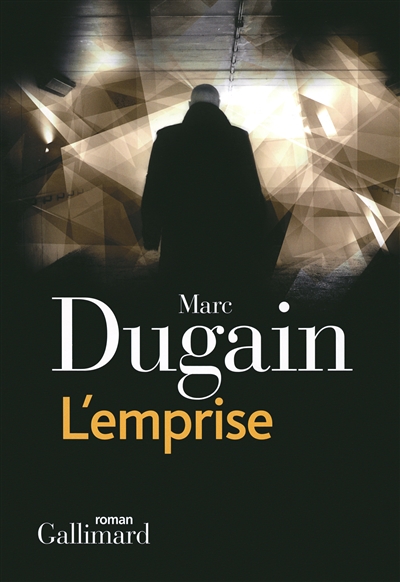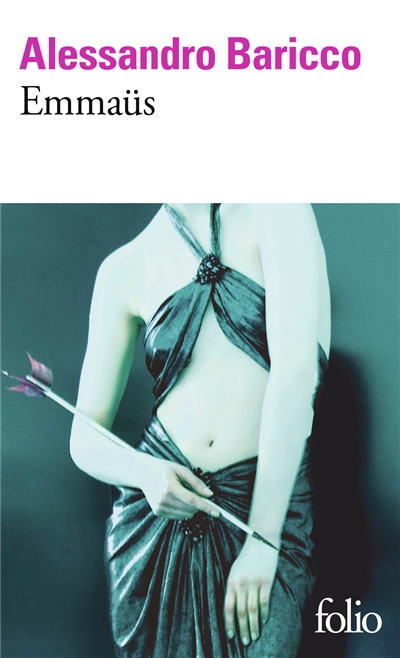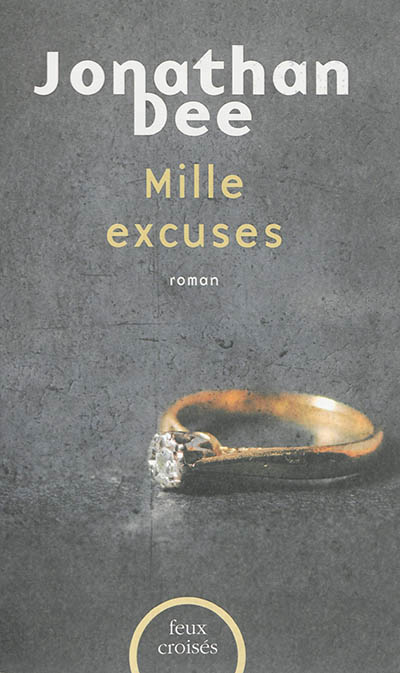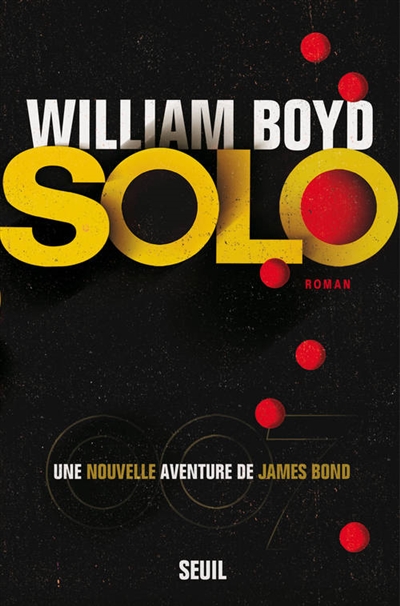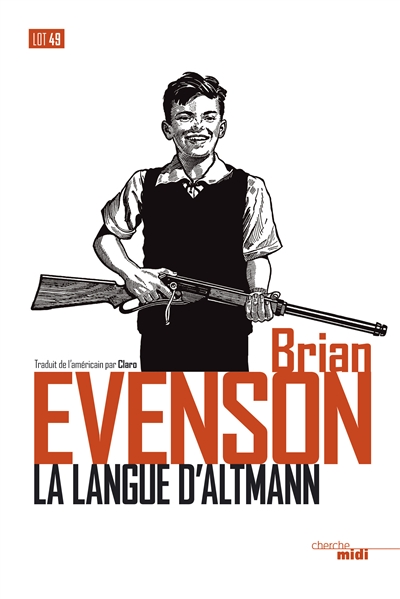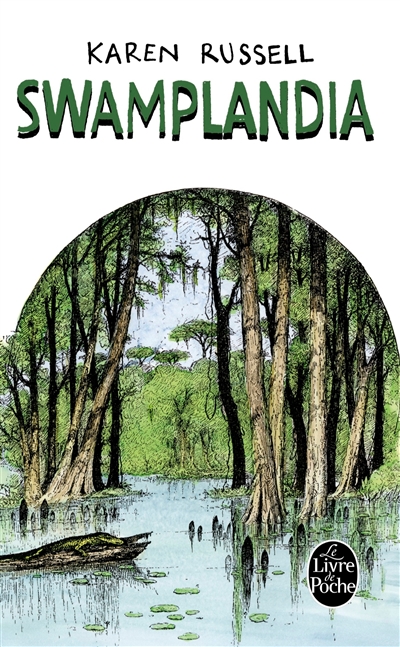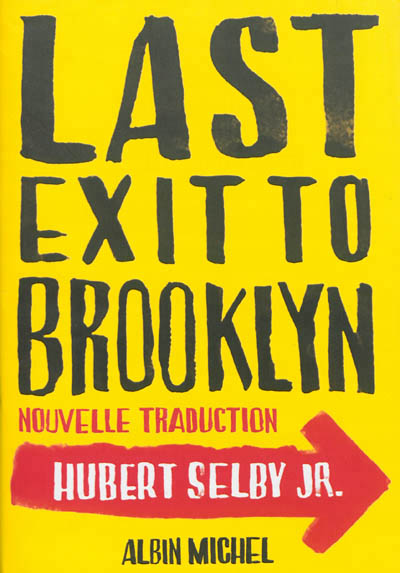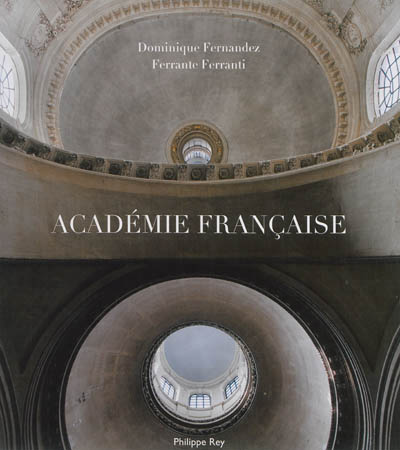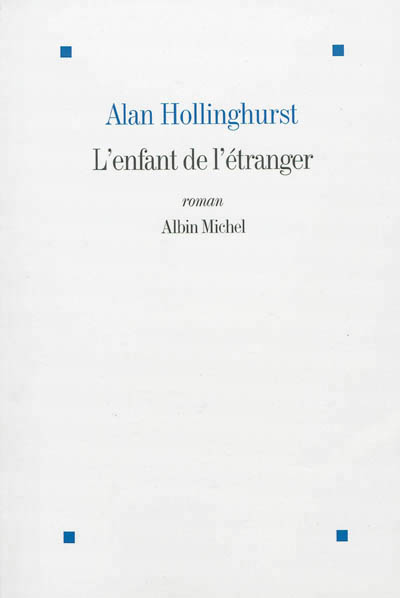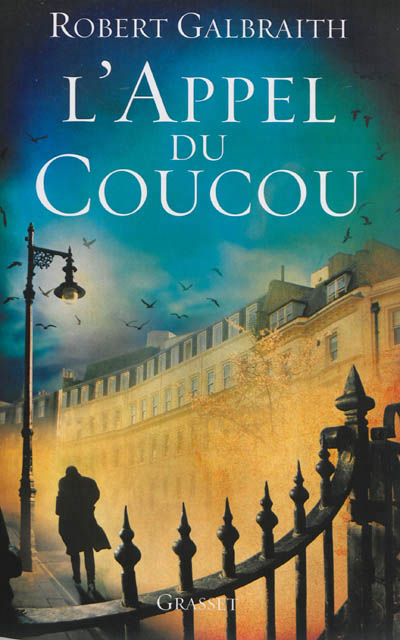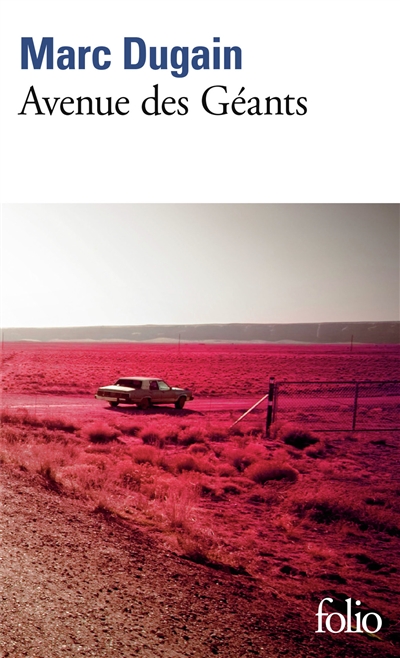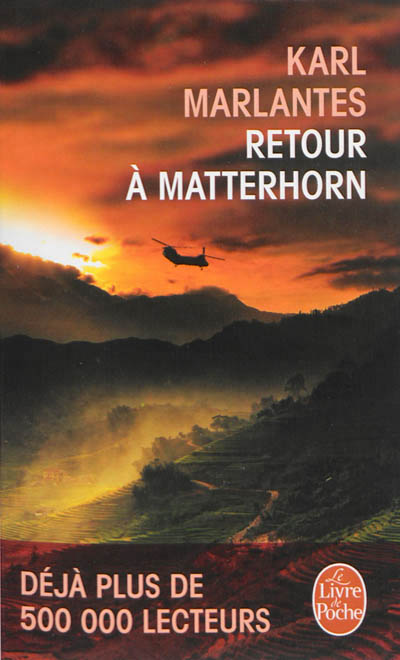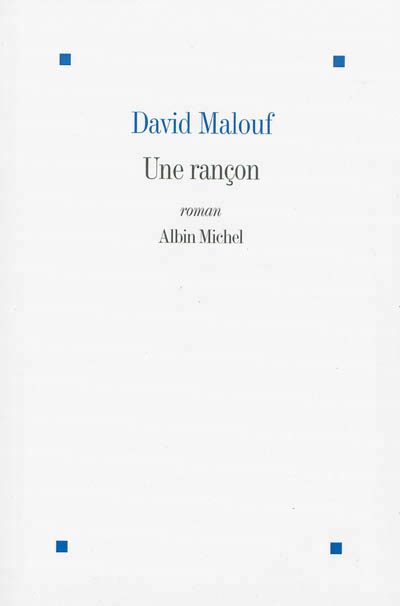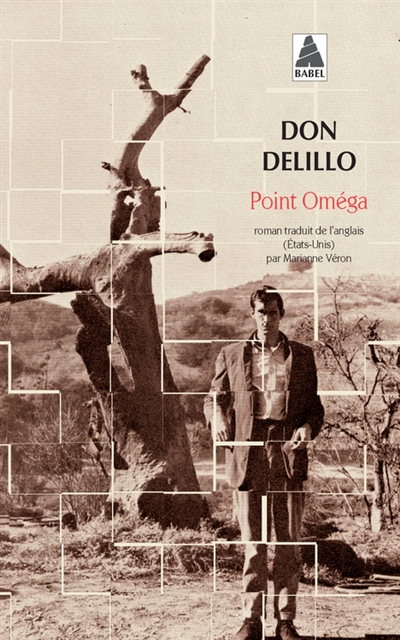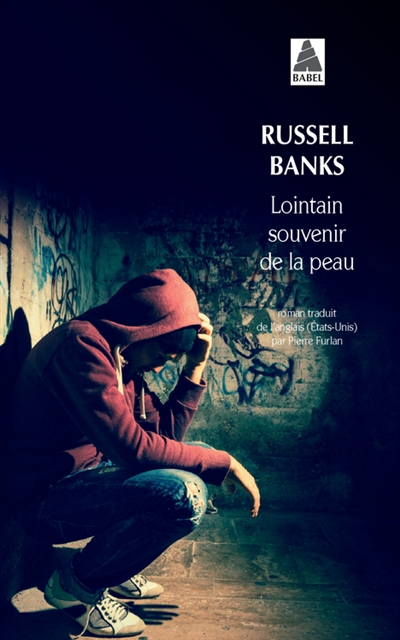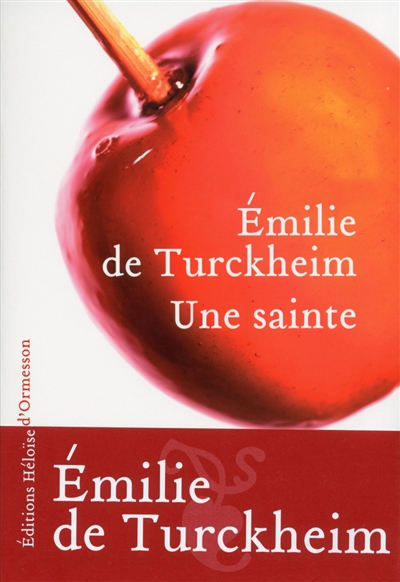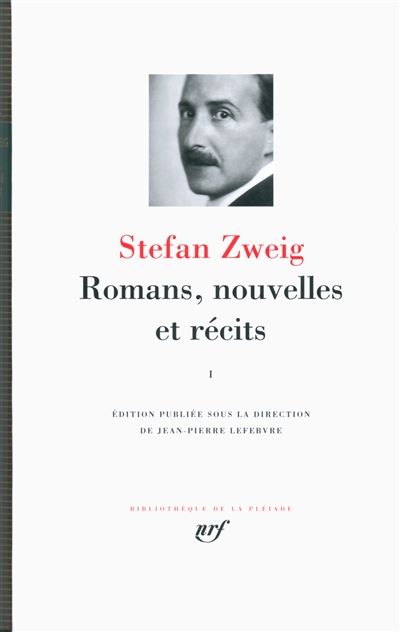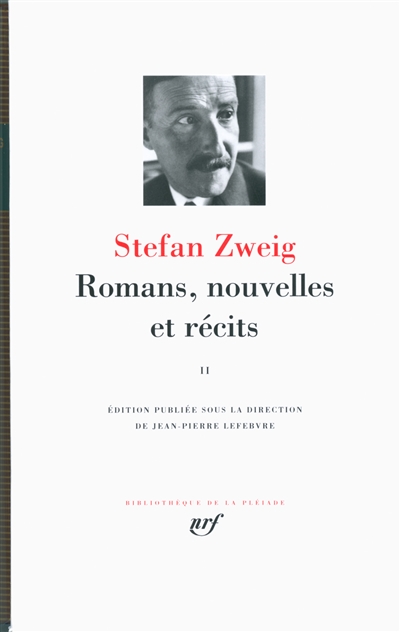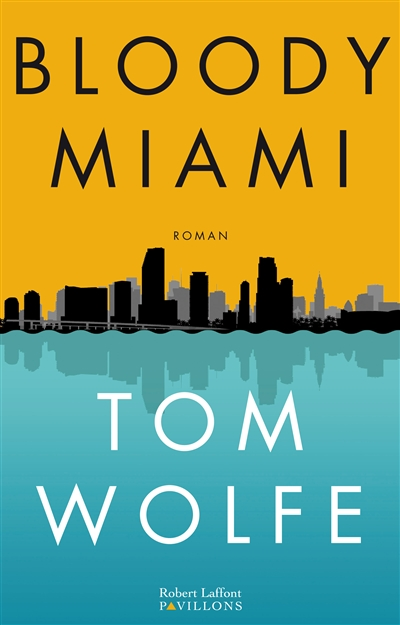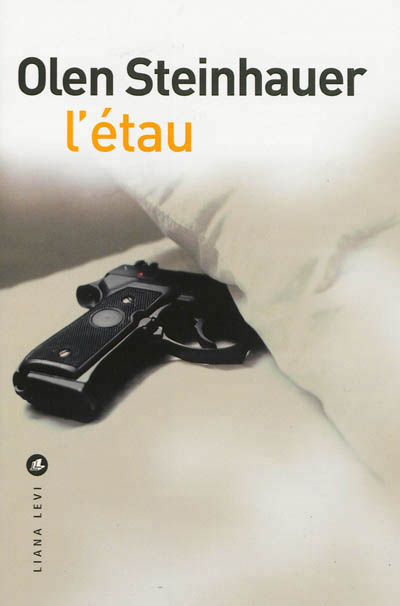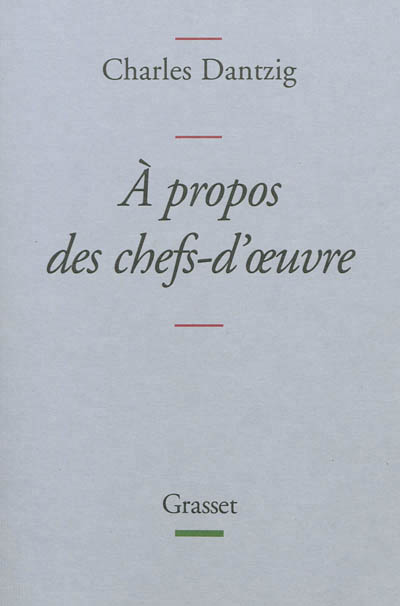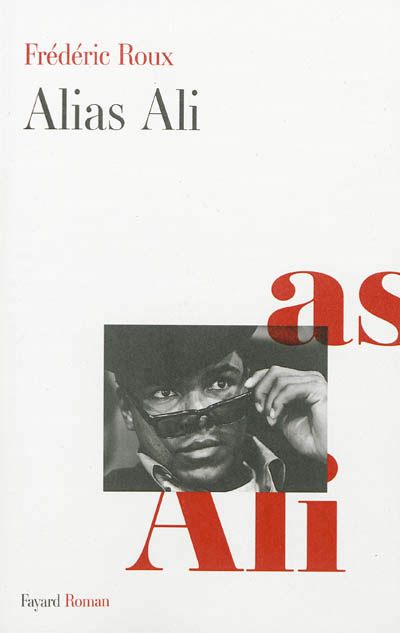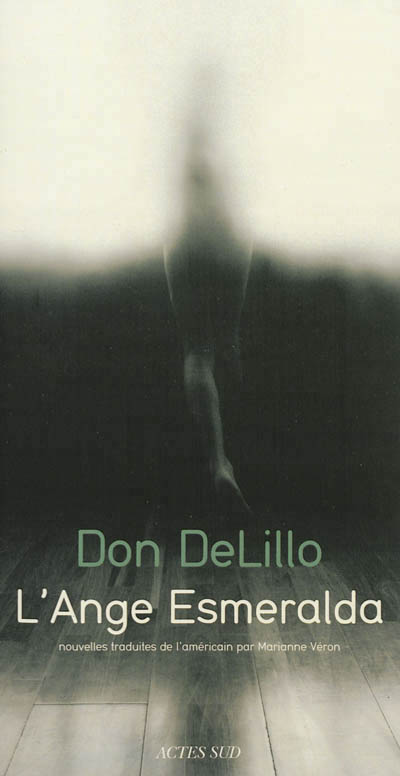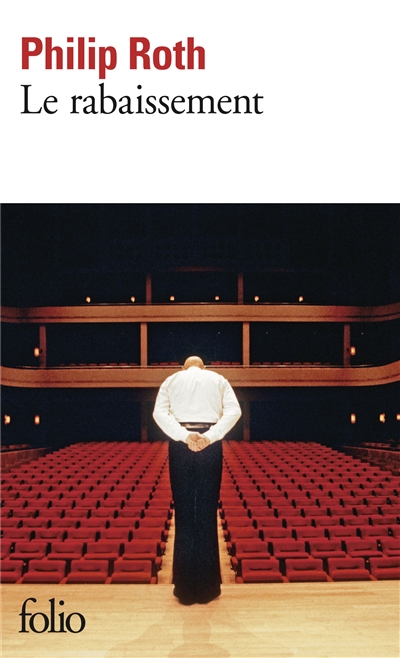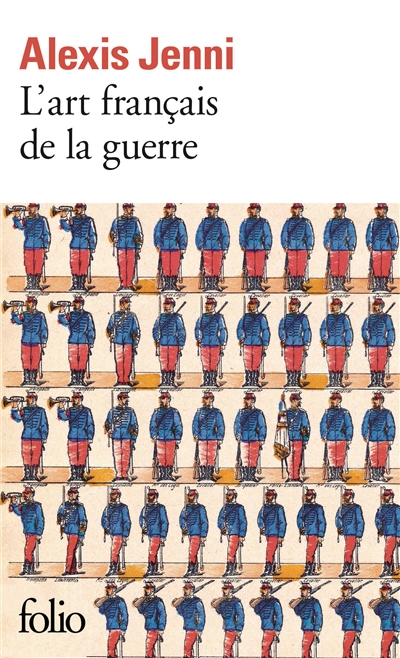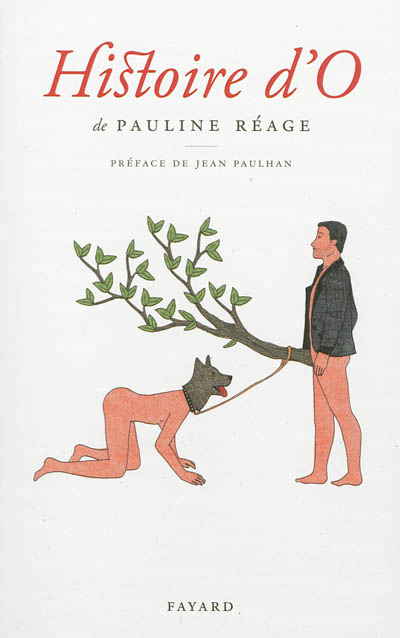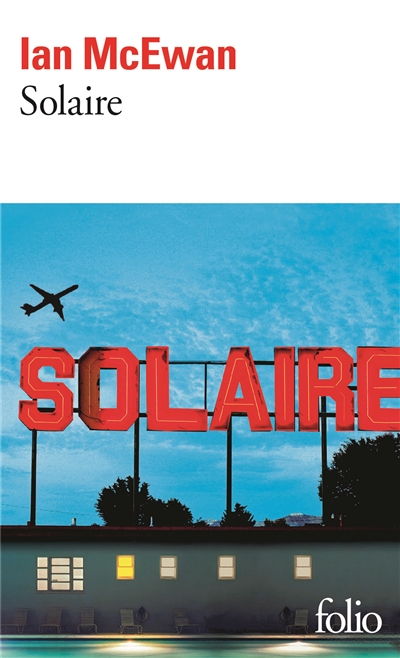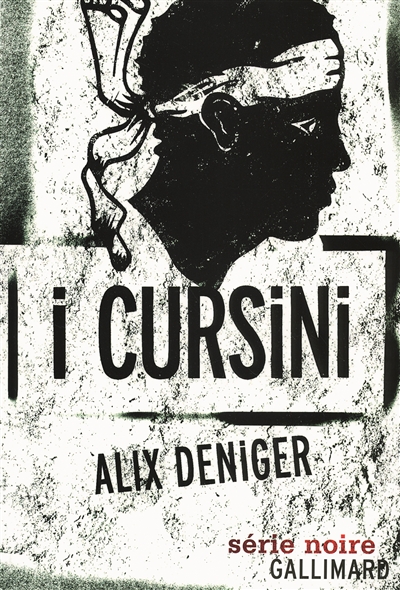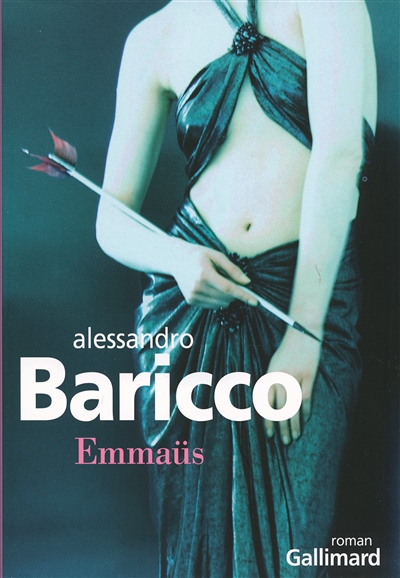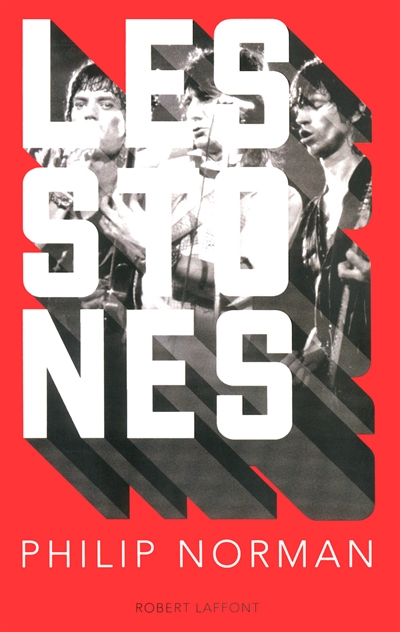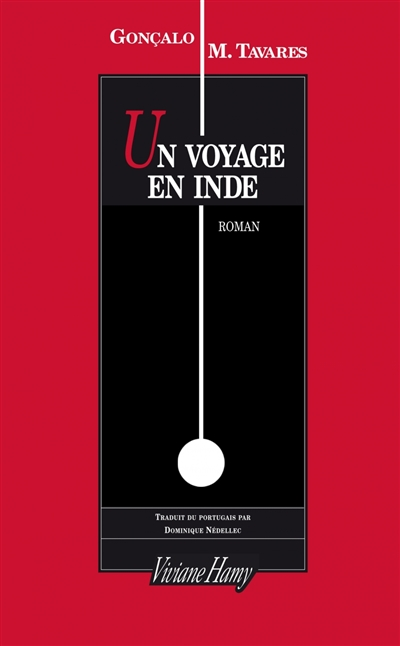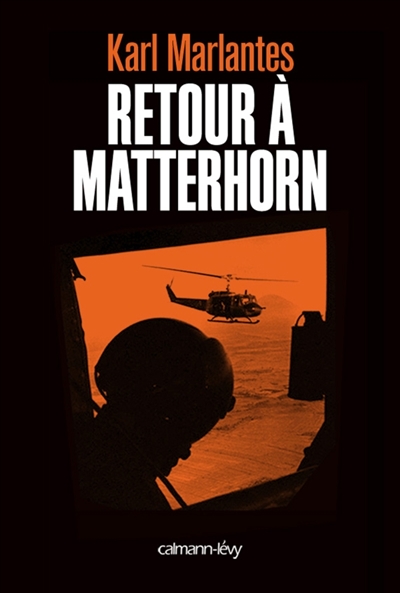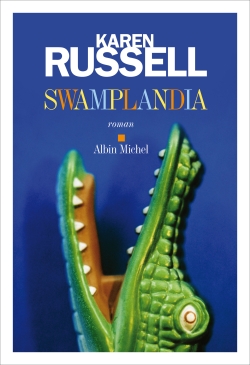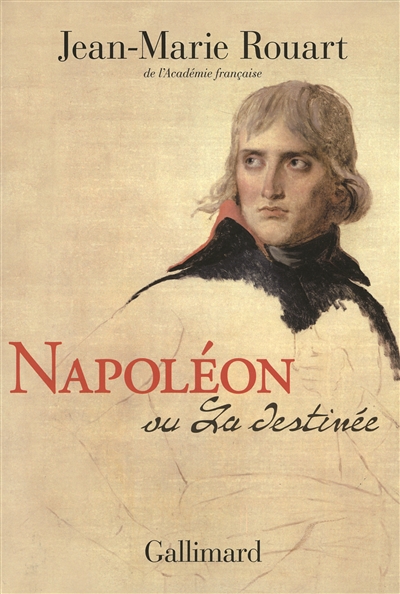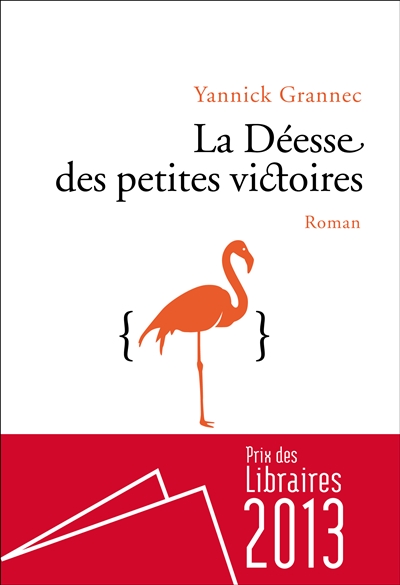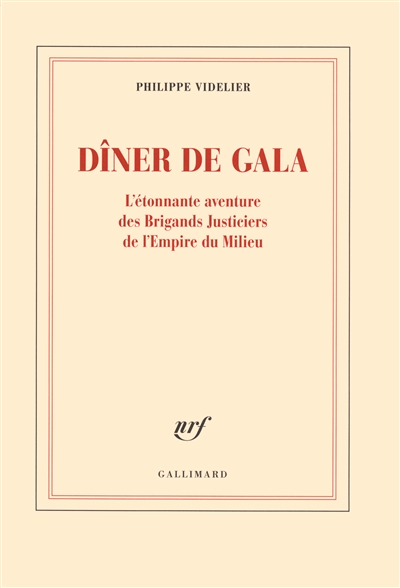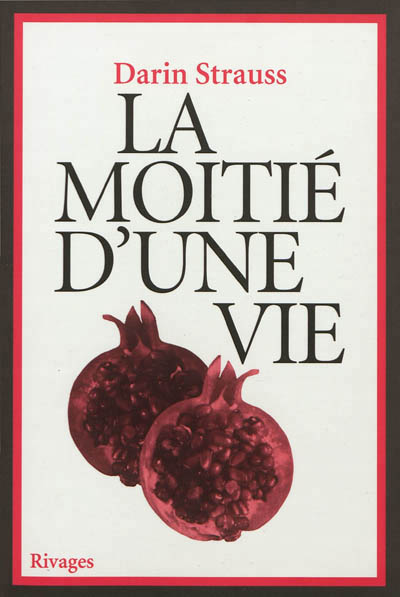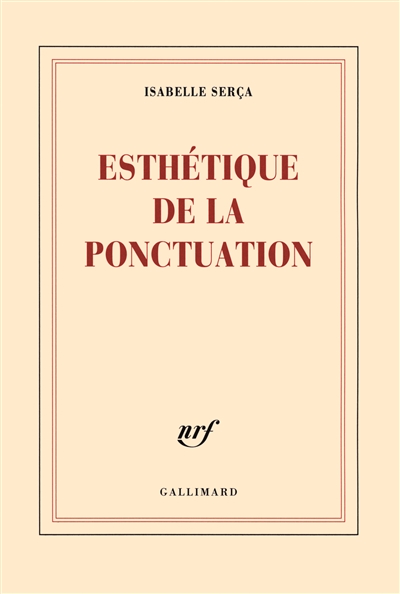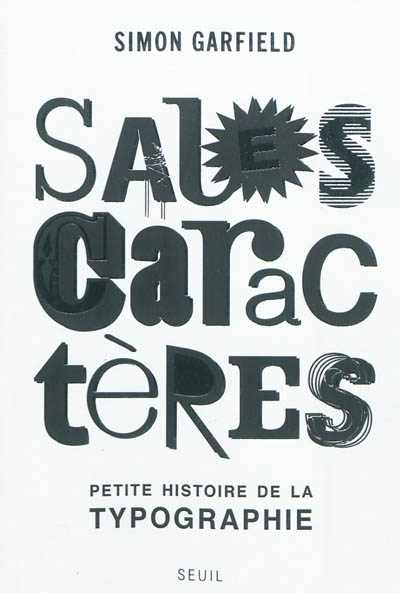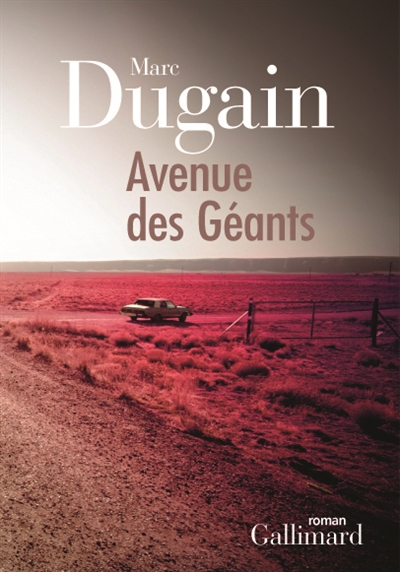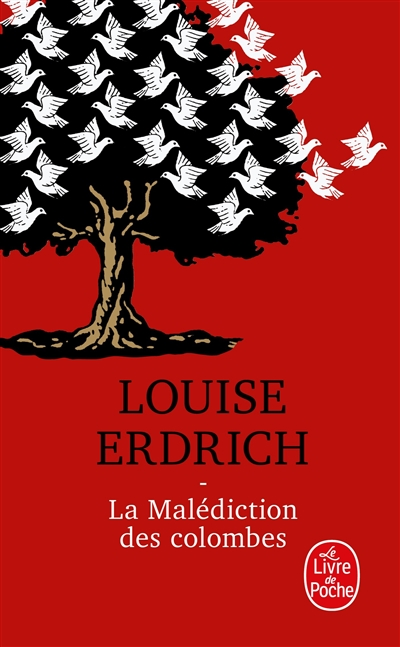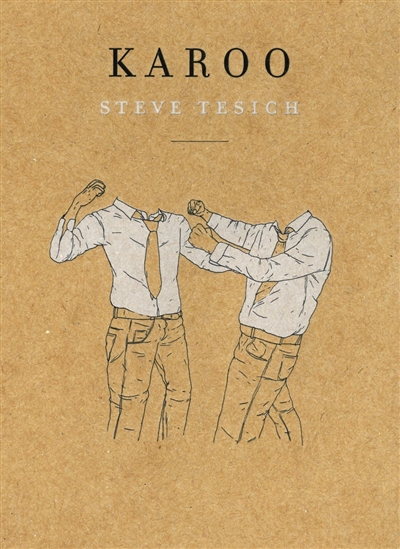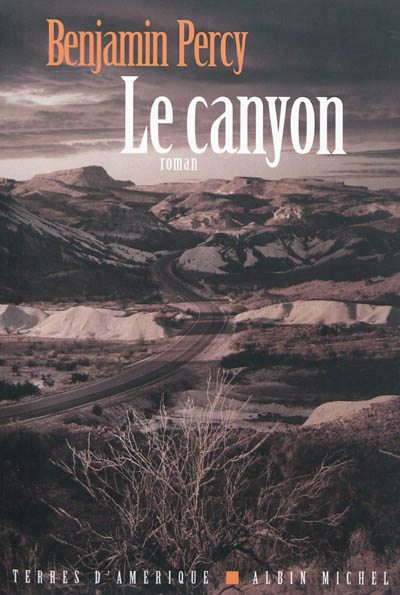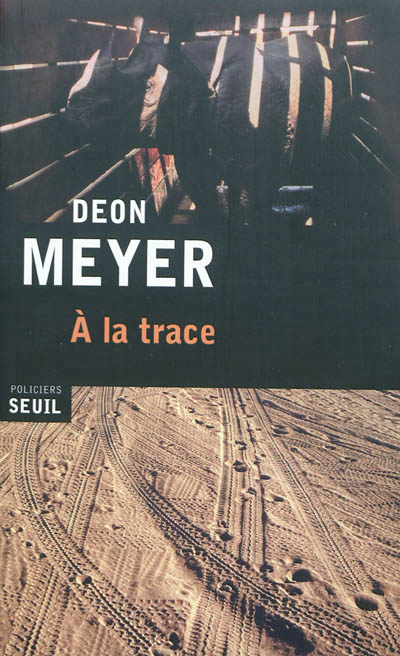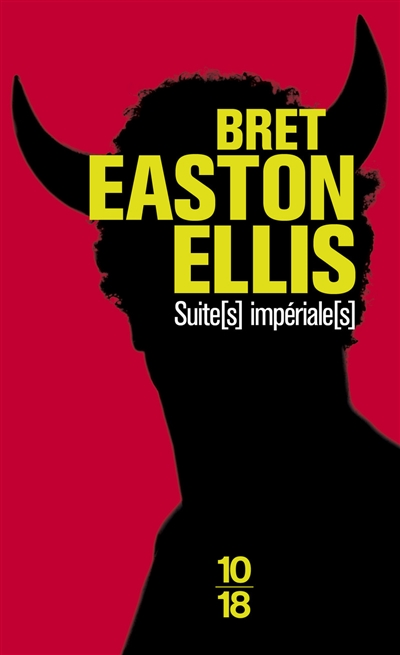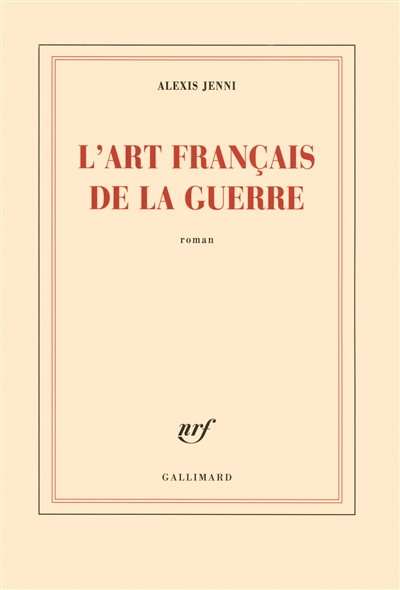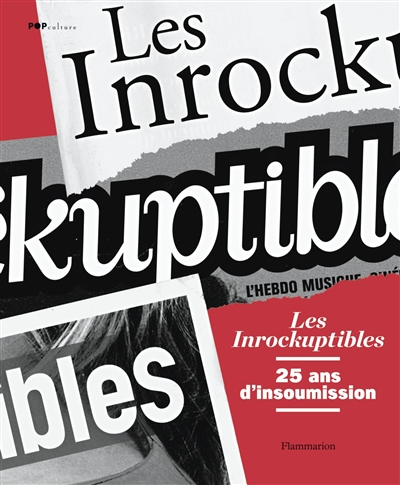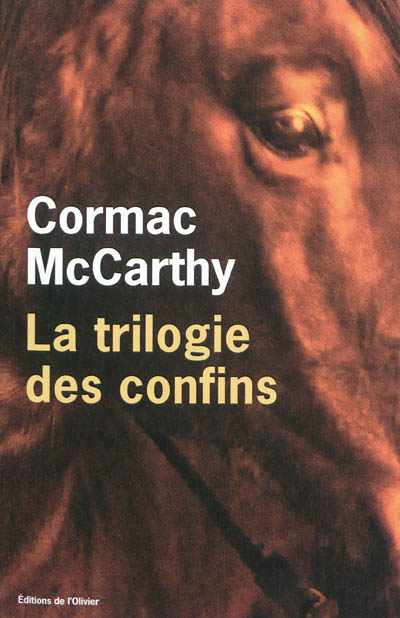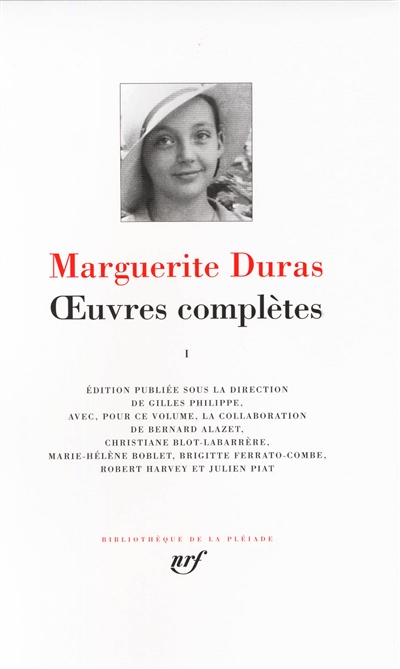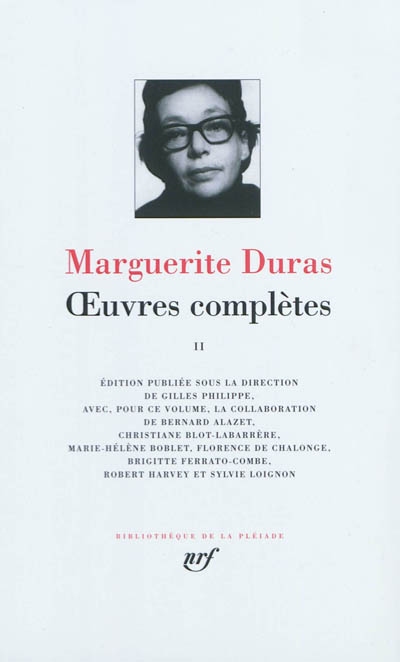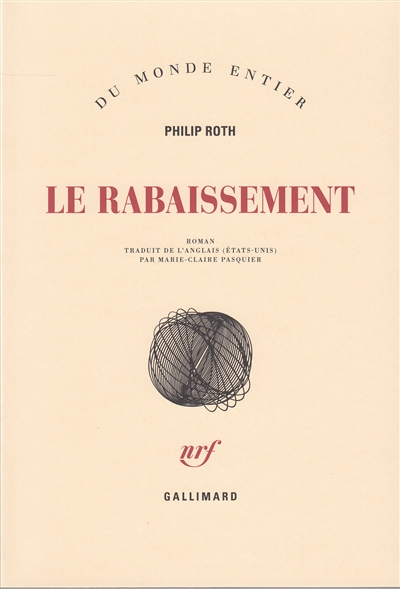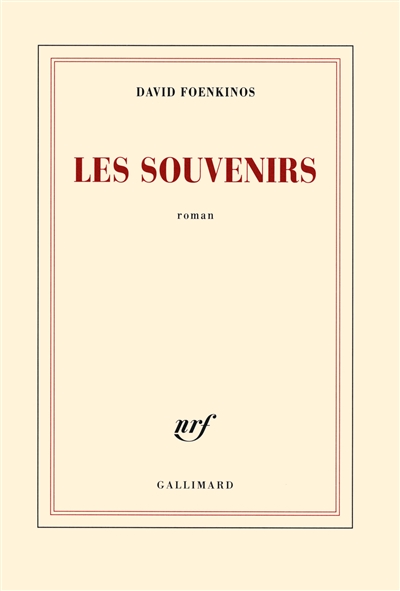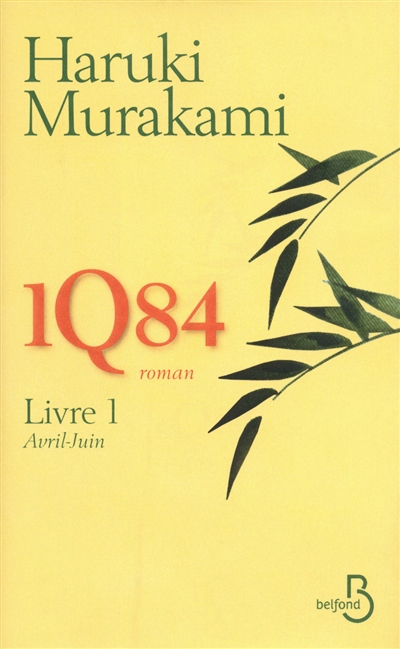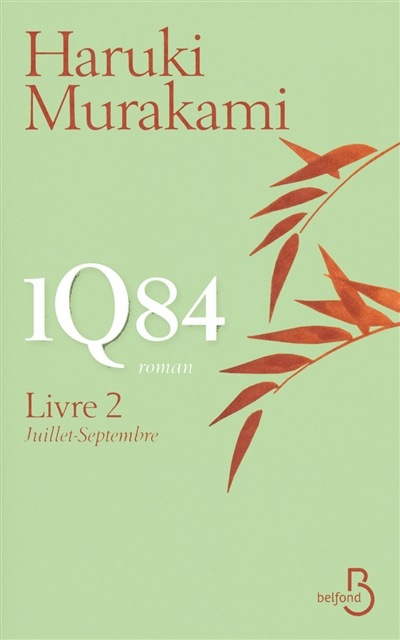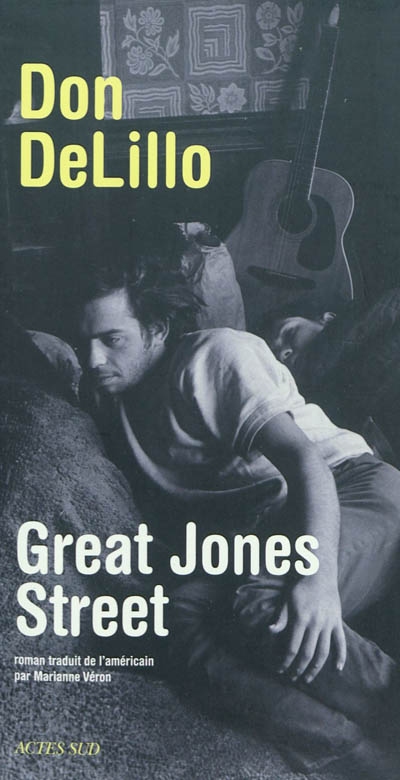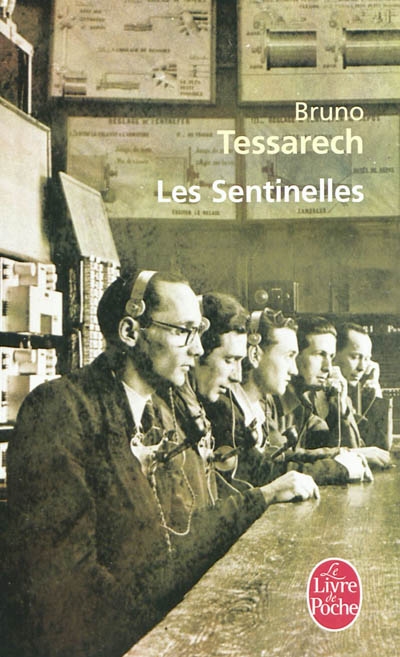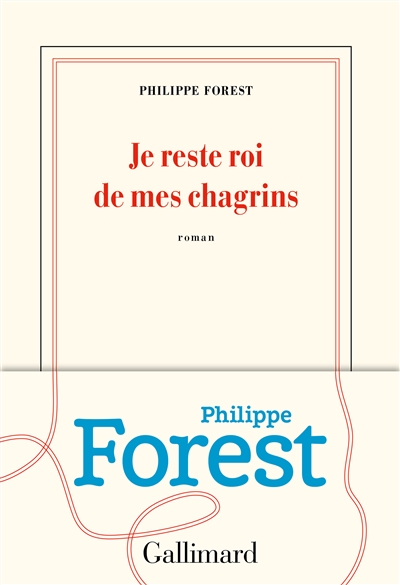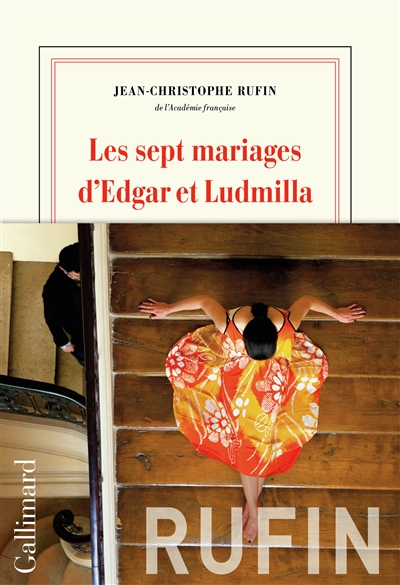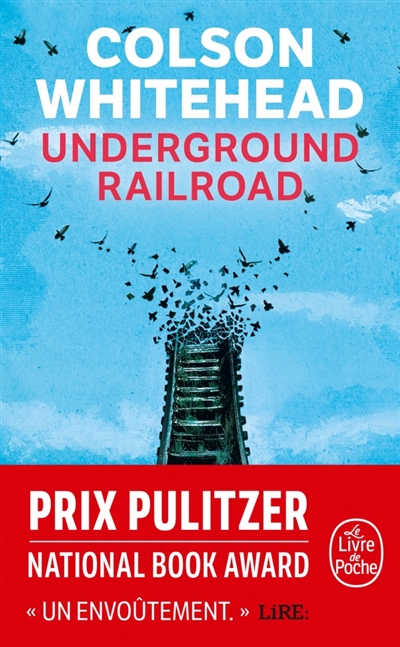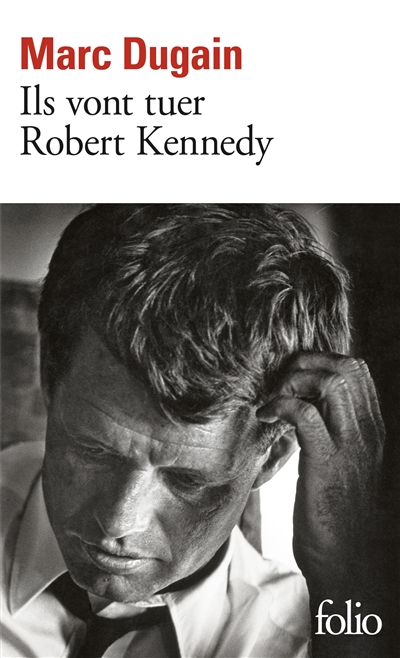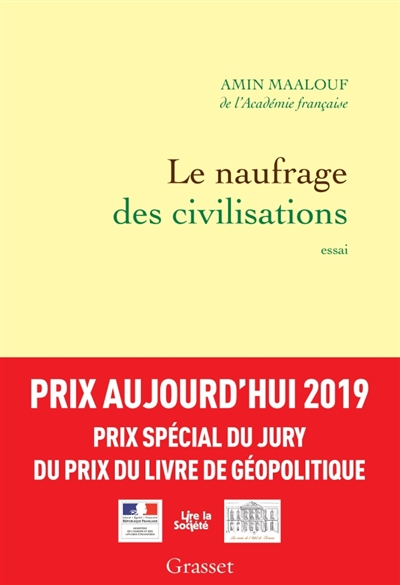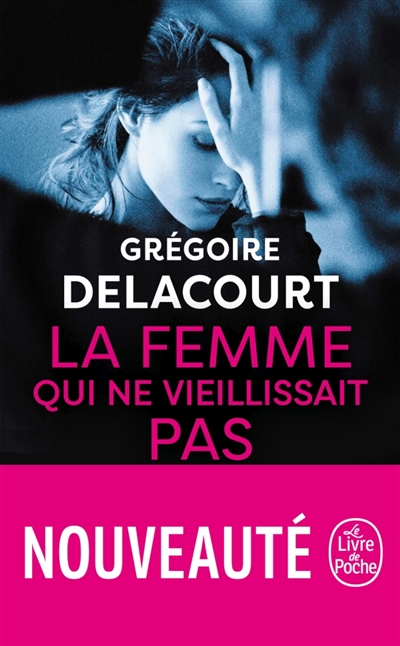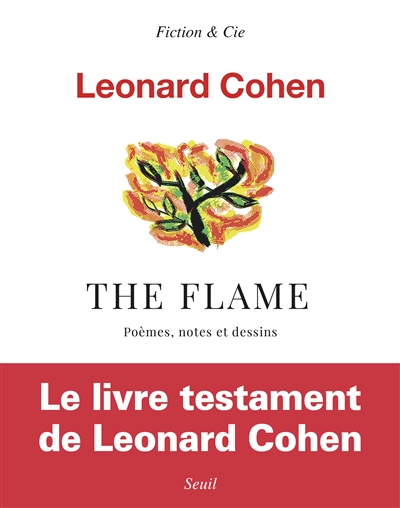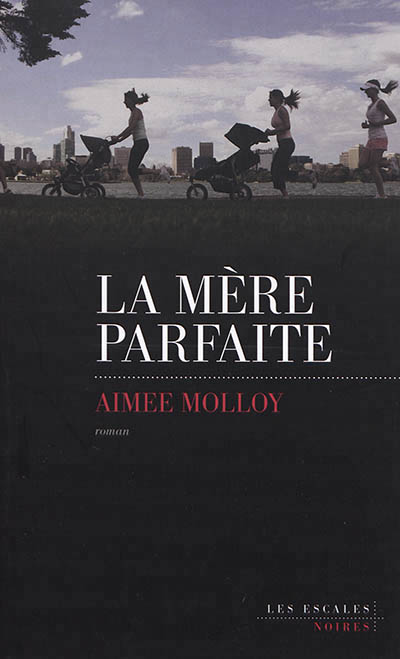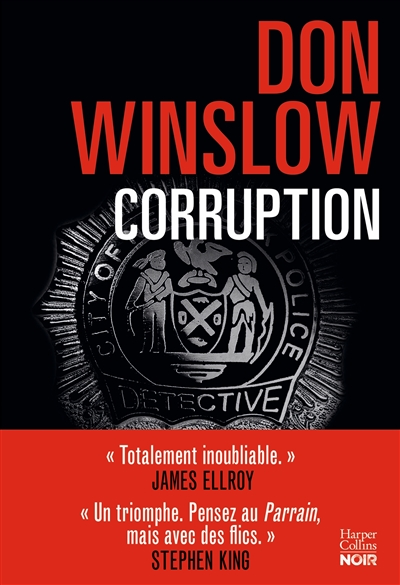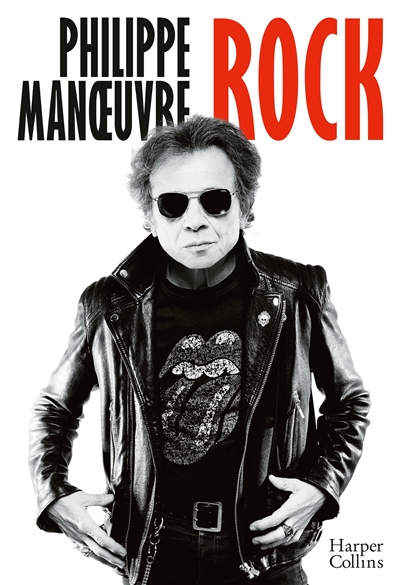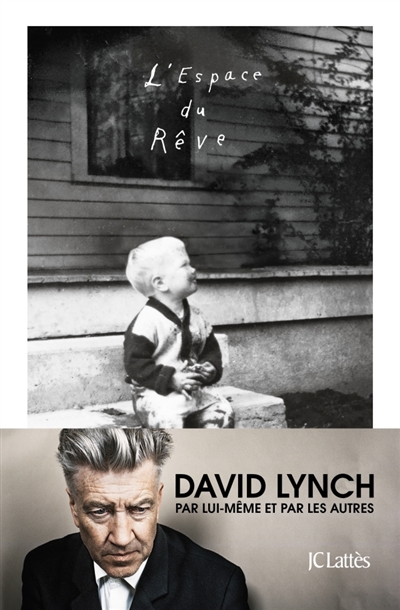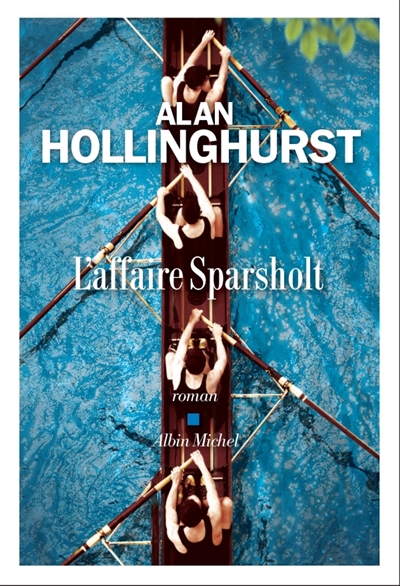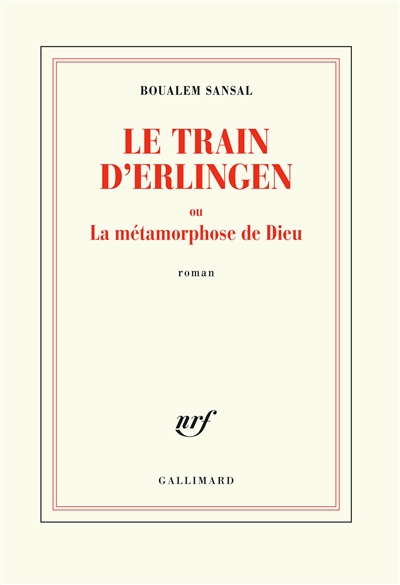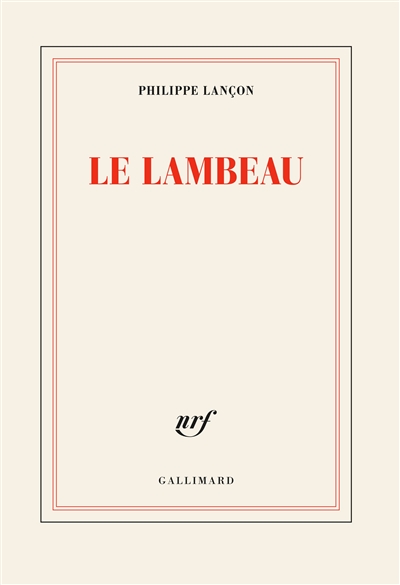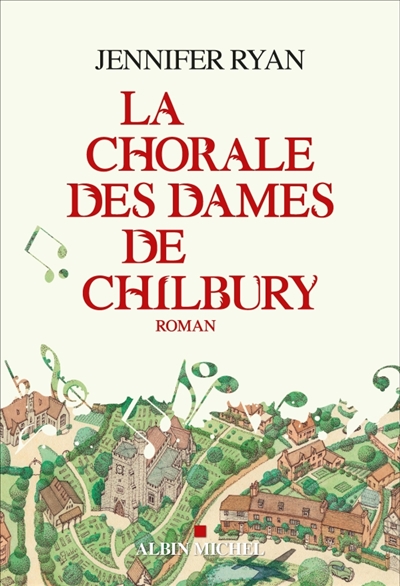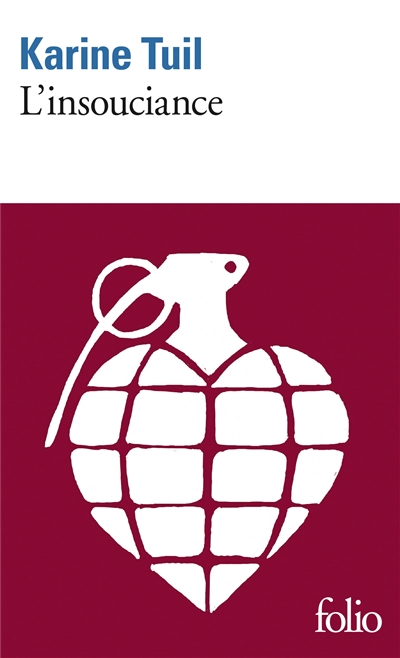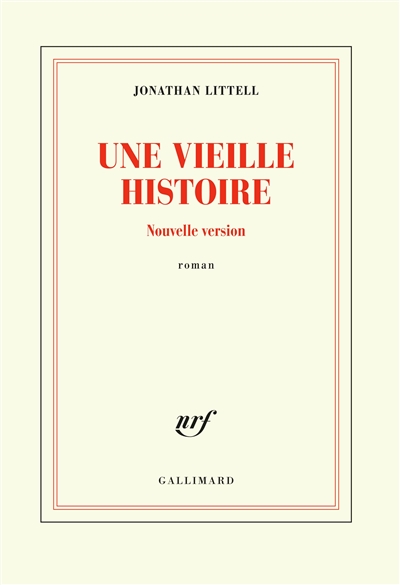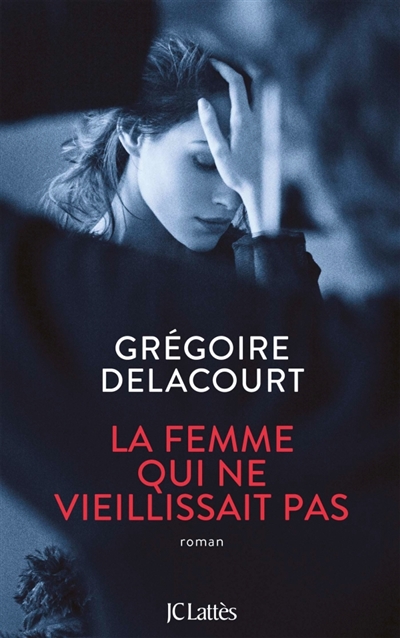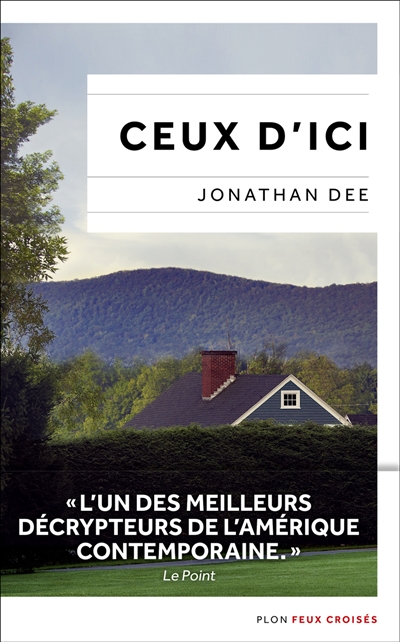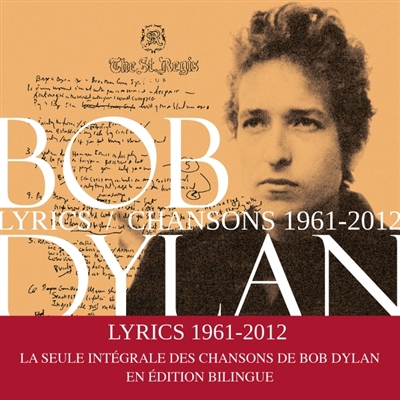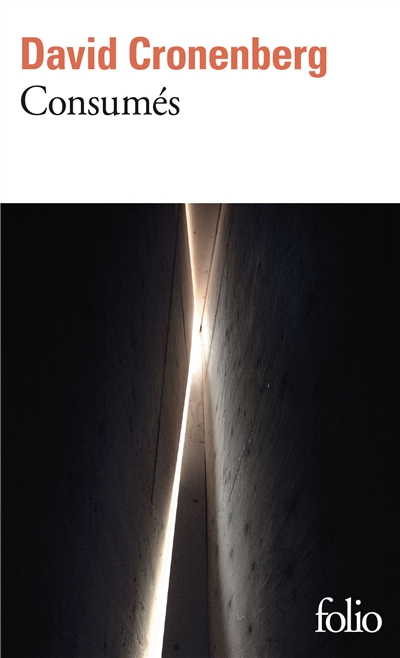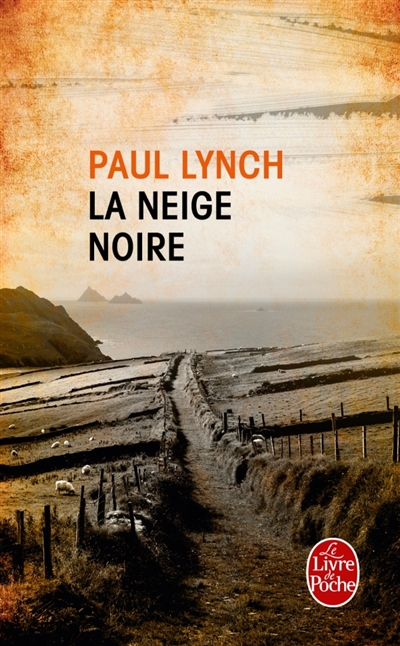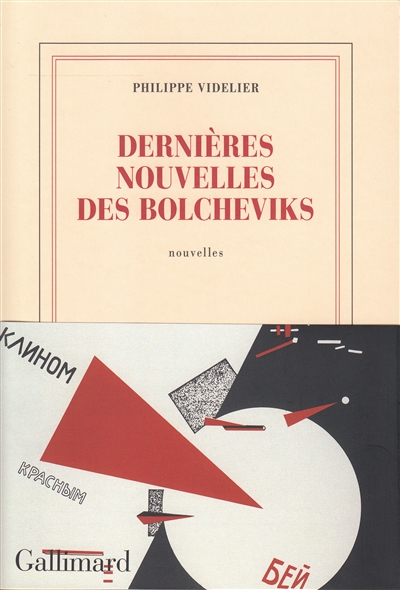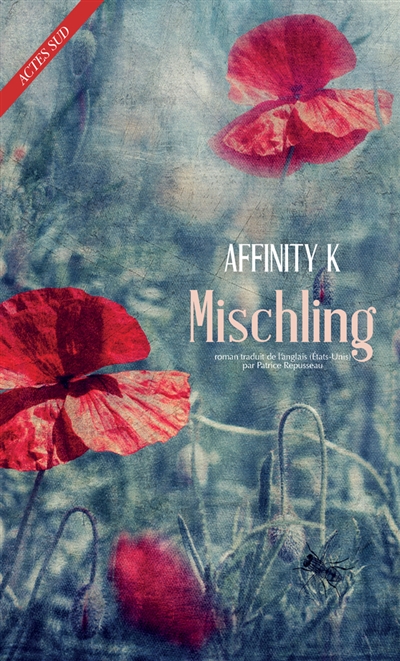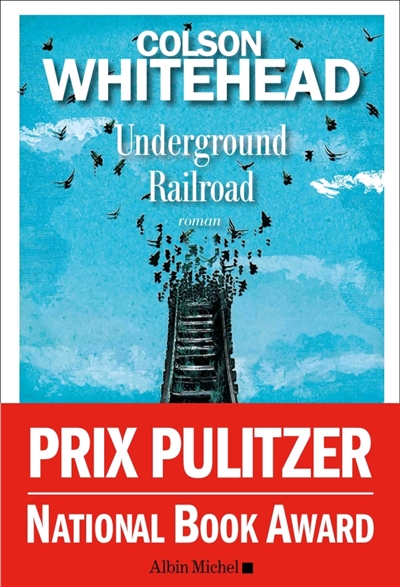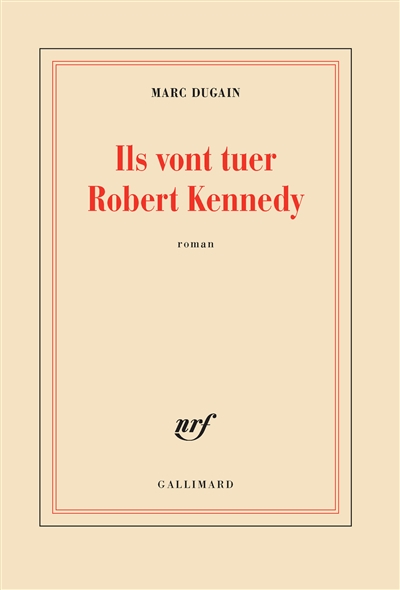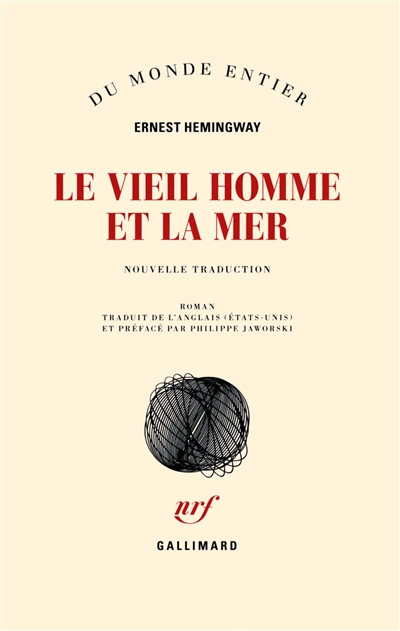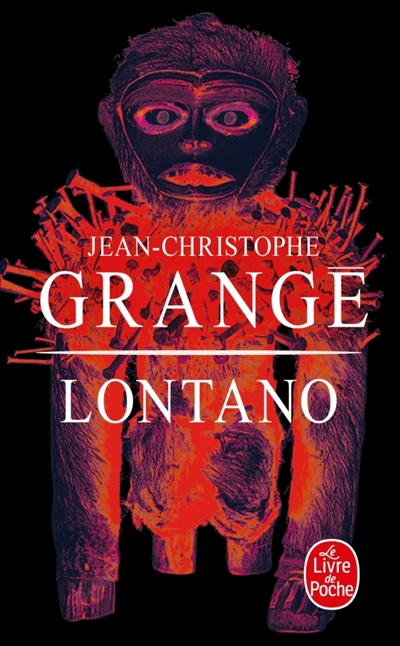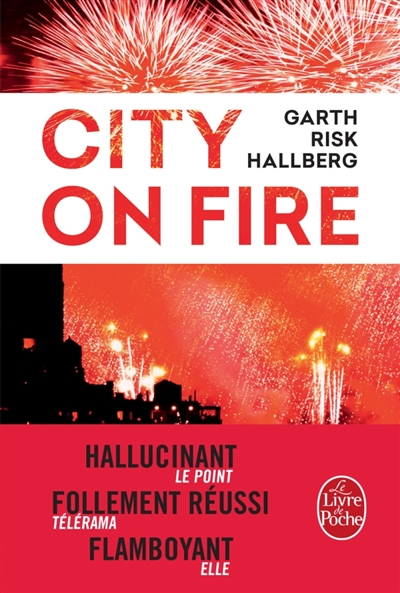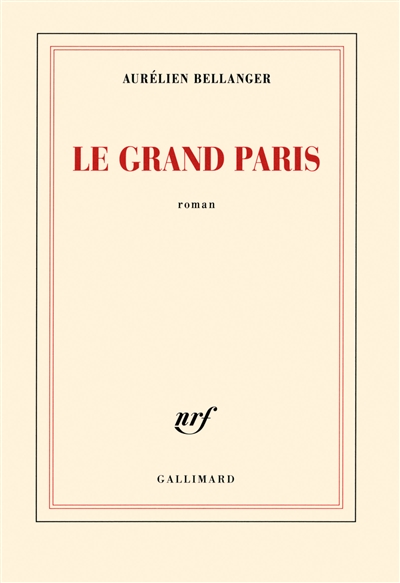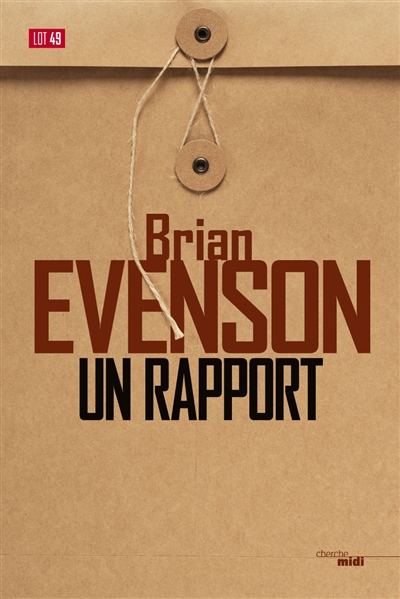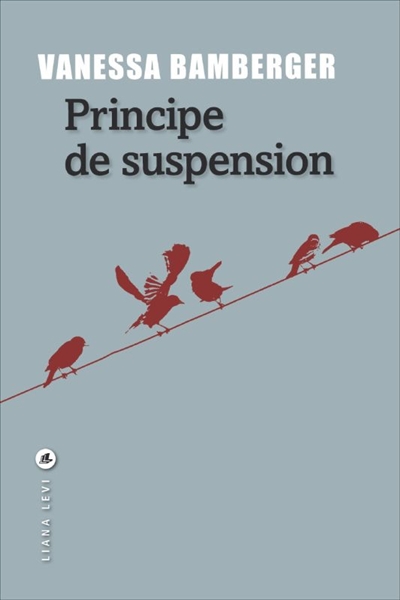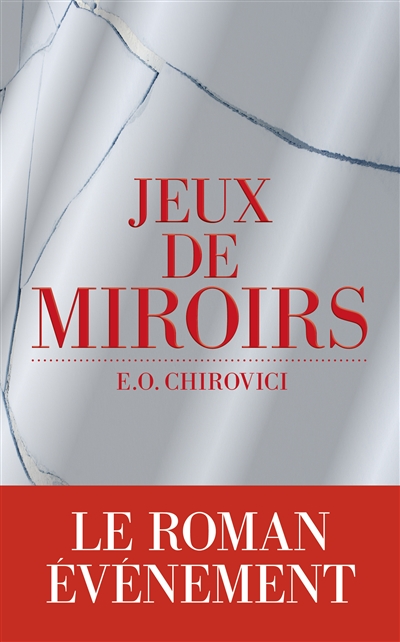Littérature étrangère
Anthony Doerr
Toute la lumière que nous ne pouvons voir
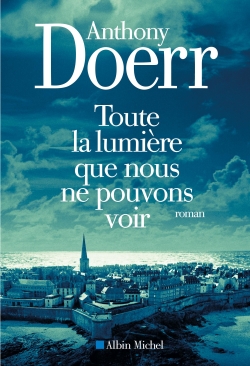
-
Anthony Doerr
Toute la lumière que nous ne pouvons voir
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Malfoy
Albin Michel
29/04/2015
624 pages, 23,50 €
-
Chronique de
Stanislas Rigot
Librairie Lamartine (Paris) - ❤ Lu et conseillé par 34 libraire(s)

✒ Stanislas Rigot
(Librairie Lamartine, Paris)
Annoncé avec moult roulements de tambours – prix Pulitzer, deux millions d’exemplaires vendus aux États-Unis, traduction en cours dans quarante langues, acheté par le cinéma… –, le roman d’Anthony Doerr fait plus que tenir ses promesses tant sa lecture emporte et laisse sans souffle. Mais heureux. Le raz-de-marée de cet été ?
Deux enfants dans l’entre-deux-guerres. Marie-Laure, aveugle, qui vit avec son père, serrurier de son état pour le Muséum d’Histoire naturelle de Paris ; Werner, orphelin, qui vit avec sa sœur, près d’une mine en Allemagne. Tout les éloigne mais la grande Histoire, à sa manière sinueuse, va les rapprocher. Voilà décrite en quelques mots l’amorce de Toute la lumière que nous ne pouvons voir, bouleversant roman d’Anthony Doerr. Alternant le destin des deux héros, y greffant une redoutable galerie de personnages secondaires, ce roman est un véritable tour de force. Il associe en effet l’efficacité du meilleur des romans policiers (soyez prévenu, les risques d’addiction sont élevés dès les premières pages : le rythme est redoutable, la construction implacable), la densité du grand roman historique (la précision de sa documentation) à une sensibilité, une fragilité et une poésie qui font souvent défaut à ces grosses machines qui nous arrivent régulièrement d’outre-Atlantique. Le lecteur y retrouve ce plaisir si rare et un rien masochiste d’être tiraillé par l’envie de finir au plus vite le livre pour en connaître la fin et l’envie de ralentir sa lecture pour rester un peu plus longtemps avec ces personnages. Lisez Doerr !
Page — Quel a été le point de départ de Toute la lumière ? à la fin du livre, vous remerciez votre éditeur Francis Geffard pour la découverte de Saint-Malo. Est-ce un indice ?
Anthony Doerr — J’ai commencé à penser au livre il y a onze ans de cela, dans un train du New Jersey. J’étais assis derrière un homme qui téléphonait. Alors que nous approchions de Manhattan, le train passant dans un long tunnel, cet homme a perdu son appel et il a commencé à s’énerver. Je me suis dit : ce téléphone contre lequel vous vous énervez, Monsieur, est un miracle ; et nous avons oublié que c’était un miracle. Ces téléphones sont plus petits qu’un jeu de cartes et ils peuvent nous relier à quelqu’un au Tibet ou à Tombouctou. À l’exception des trois ou quatre dernières générations, dans toute l’histoire de l’humanité, cela aurait été de la pure magie. Et c’est ainsi que cet après-midi, il y a plus de dix ans, j’ai écrit un titre dans mon carnet : Toute la lumière que nous ne pouvons voir. J’ai d’abord pensé aux ondes invisibles dans les airs (la lumière au sens mathématique est invisible). Et cette nuit-là, j’ai commencé à écrire l’histoire d’une fille lisant à la radio une histoire à un garçon. Je voulais placer cette histoire à un moment et un endroit où la radio était une technologie majeure, tout en étant toujours miraculeuse. J’ai essayé sans succès différentes périodes. En 2006, je suis venu présenter un livre en France et, avec Francis Geffard, nous sommes allés en Bretagne – pour moi, c’était une première. Après un long repas à Saint-Malo, je suis allé me promener à la nuit tombante sur les remparts. C’était ma première réelle vision de la ville. Il y avait la mer brillant sous la lune, les maisons silencieuses, les fenêtres allumées. J’ai eu l’impression de marcher dans une ville imaginaire du roman Les Villes invisibles de Calvino, un endroit entre le château de conte de fées, un dessin de Escher, le brouillard, le vent de l’océan et les réverbères. Je suis tombé sous le charme de ces maisons de corsaires, de marchands et de capitaines de marine. Le jour suivant, j’ai dit à Francis : « C’est incroyable de marcher dans une ville aussi vieille. » Il m’a répondu : « En fait, la ville a été entièrement détruite en 1944 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. » C’est là que je me suis dit : pourquoi ne pas essayer ici ?
P. — Pouvez-vous présenter les deux inoubliables personnages principaux, Marie-Laure et Werner ?
A. D. — Marie-Laure est une jeune Française aveugle qui grandit à Paris, au Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Elle aime les clefs, les puzzles, les livres. Werner est chétif et orphelin, il a les cheveux blancs et vit dans une ville minière allemande. Il est très doué pour construire et réparer les radios. Ce sont deux enfants curieux, nés à une époque très complexe. Et leurs destins sont liés de manière ténue mais importante.
P. — Comment avez-vous abordé la passion de Werner pour la radio et l’infirmité de Marie-Laure ?
A. D. — Pour Werner, j’ai commencé avec ma propre fascination pour la radio qui, avec l’avion et la bombe atomique, a été la technologie de pointe de la première moitié du XXe siècle. Durant le Troisième Reich, elle a été un outil important pour contrôler les citoyens, répandre les mensonges, semer la peur, restreindre les libertés. Mais la radio a été un outil pour la propagande alliée, la Résistance, la Libération. De plus, elle exerçait un pouvoir de fascination sur les enfants, de la même manière que les smartphones aujourd’hui. Alors j’ai essayé de me projeter dans le langage, la poésie et les détails techniques des radios. En ce qui concerne l’infirmité de Marie-Laure, j’ai lu des mémoires d’écrivains aveugles, des études. Je suis aussi allé marcher, les yeux bandés par mes enfants, dans les rues de ma ville natale.
P. — Pourquoi avoir choisi des enfants ?
A. D. — Comme de nombreux romanciers avant moi, je voulais explorer le passage à l’âge adulte. Le seul moyen de le faire est de traverser les années d’apprentissage des personnages. Ce que j’ai essayé de faire ici est de tresser deux romans initiatiques en un.
P. — Vous donnez de nombreux détails sur cette époque et les événements, la grande Histoire et le quotidien. Toute cette documentation a-t-elle été difficile à rassembler et difficile à utiliser ?
A. D. — J’ai voyagé trois fois en Europe. J’ai lu des dizaines et des dizaines de livres. J’ai étudié des milliers de photos. Mais j’ai toujours complété ces recherches avec l’imagination. Les recherches peuvent vous donner des détails, mais l’imagination donne la manière d’utiliser ces détails. Pour moi, écrire un roman historique revient à trouver un équilibre entre la lecture, le voyage, le regard, l’imagination, le rêve (et le vagabondage). Alors oui, c’était difficile mais c’était aussi fascinant.
P. — Il y a tellement de livres, de films sur cette période, était-ce une chance ou un écueil pour vous ?
A. D. — Les deux. La quantité de documents sur la Seconde Guerre mondiale est d’un côté très intimidante et de l’autre rassurante. Je me disais que personne ne ferait vraiment attention à un énième roman sur la Seconde Guerre mondiale et cela m’a libéré et permis de prendre des risques. Le plus grand obstacle était psychologique. Les recherches étaient si dérangeantes. Ce qui est arrivé aux Juifs et aux autres victimes du Troisième Reich, notamment en Europe de l’Est, est si brutal, si horrifiant, que je devais faire des pauses et travailler sur autre chose. Je peux voir comment mes jeunes fils apprennent la guerre, à la télévision principalement, ou au travers des jeux vidéos, et souvent les événements sont simplifiés, de basiques histoires du bien contre le mal. Ici j’ai essayé de raconter une petite histoire, une histoire d’enfants pour dire : ces choses sont arrivées et elles étaient très complexes pour les gens qui ont dû vivre ces événements ; et cela s’est passé il n’y a pas si longtemps.
P. — Des chapitres courts et des flash-back, un rythme incroyable mais aussi de nombreux personnages inoubliables, de la poésie… Comment avez-vous construit ce page turner et comment y avez-vous insufflé cette âme ?
A. D. — Dans la dernière décennie, j’ai essayé de construire des histoires avec des petites parties titrées. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être une manière de me forcer à écrire des grands romans en travaillant sur de très petites choses ? Ou peut-être est-ce simplement que j’aime travailler sur des miniatures, essayant de les rendre fonctionnelles et élégantes. Et un jour, vous commencez à les disposer sur le tapis et vous essayez de les assembler dans une structure plus importante.
P. — Quand vous avez commencé à écrire, aviez-vous déjà l’idée du plan général ?
A. D. — Ma manière d’écrire implique de nombreux essais et erreurs. J’ai écrit des centaines de paragraphes pour essayer de voir comment cette histoire fonctionnait et je finissais généralement par couper la plupart d’entre eux. J’ai su très vite que je voulais deux récits presque parallèles qui se dirigeraient doucement l’un vers l’autre doucement. Je savais, dès la première année, que Marie et Werner se croiseraient. Mais il m’a fallu longtemps pour savoir comment.
P. — Pourquoi avoir invité Jules Verne ?
A. D. — Enfant, 20 000 lieues sous les mers était un de mes livres favoris. Un roman sur l’émerveillement et la technologie. Mon projet est similaire. C’est ainsi qu’un jour, alors que j’avais recommencé à le lire, j’ai décidé que le texte de Jules Verne pourrait être un livre dans le livre et qu’il serait le texte parfait pour Marie-Laure, celui qu’elle devait lire à la radio.