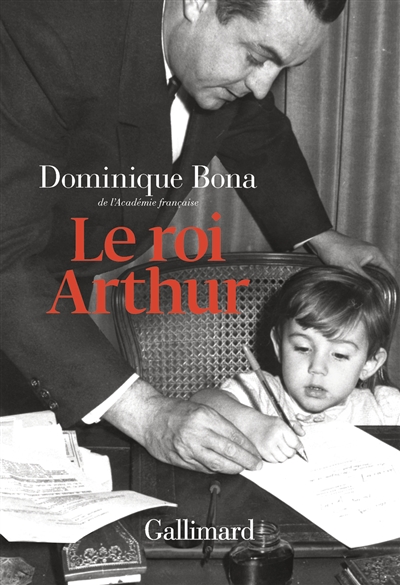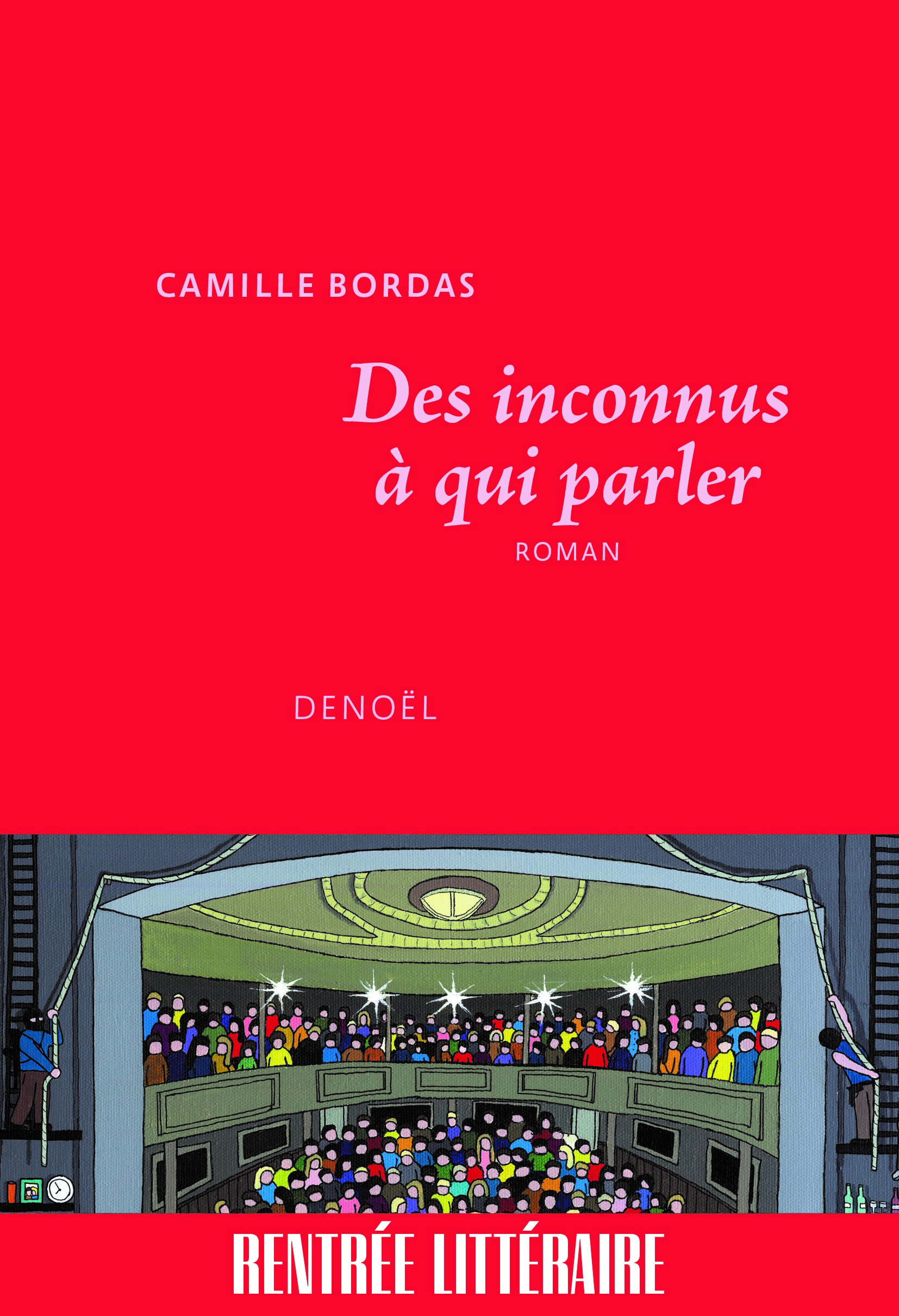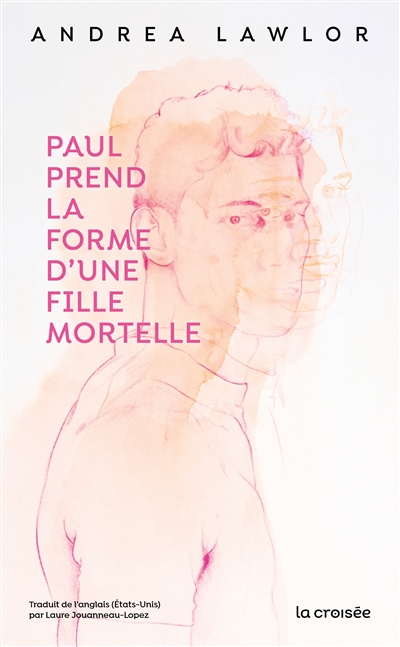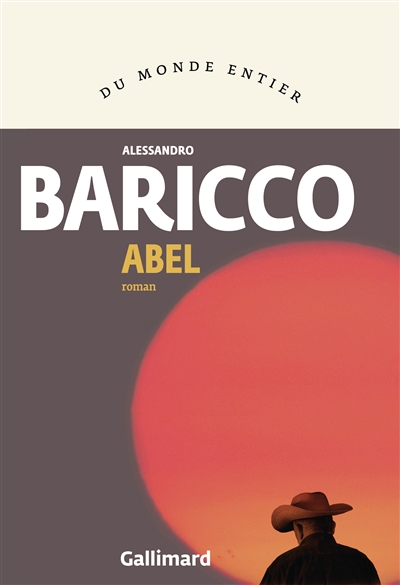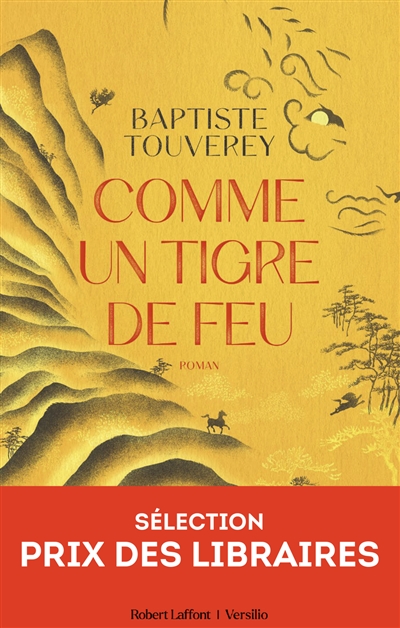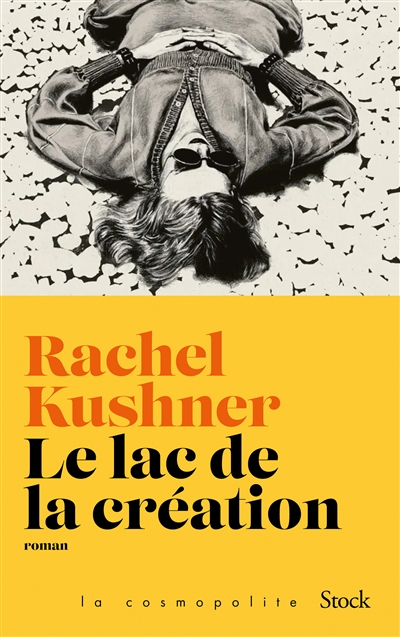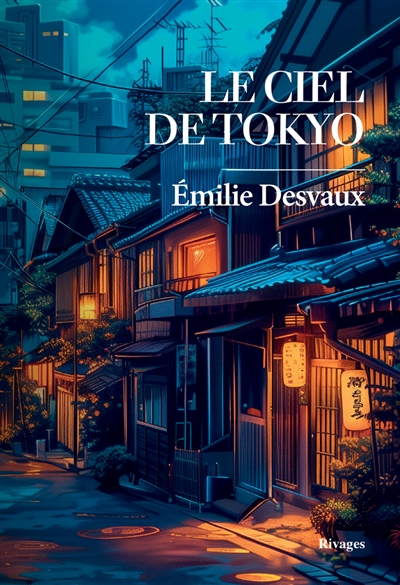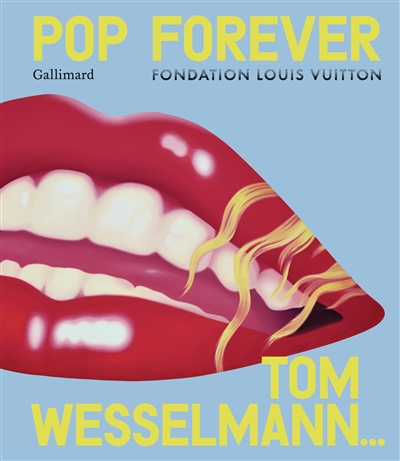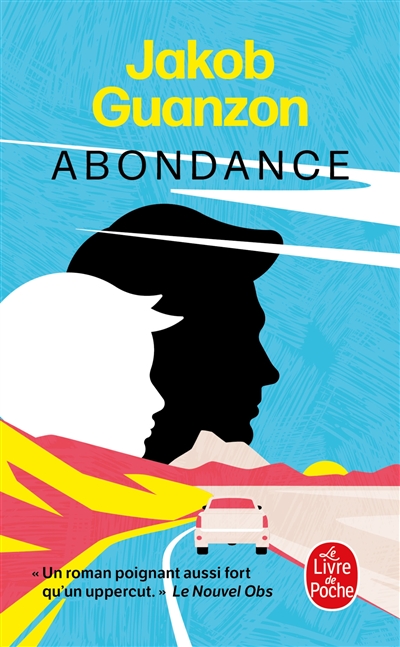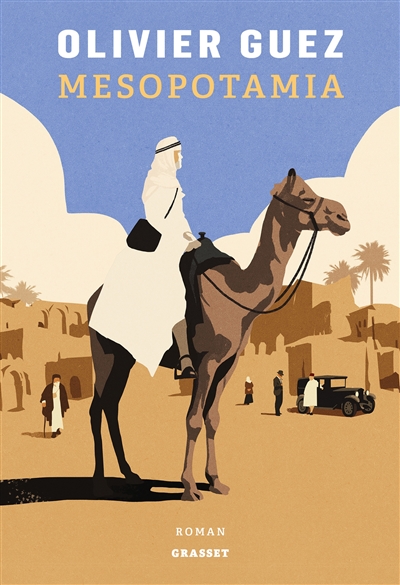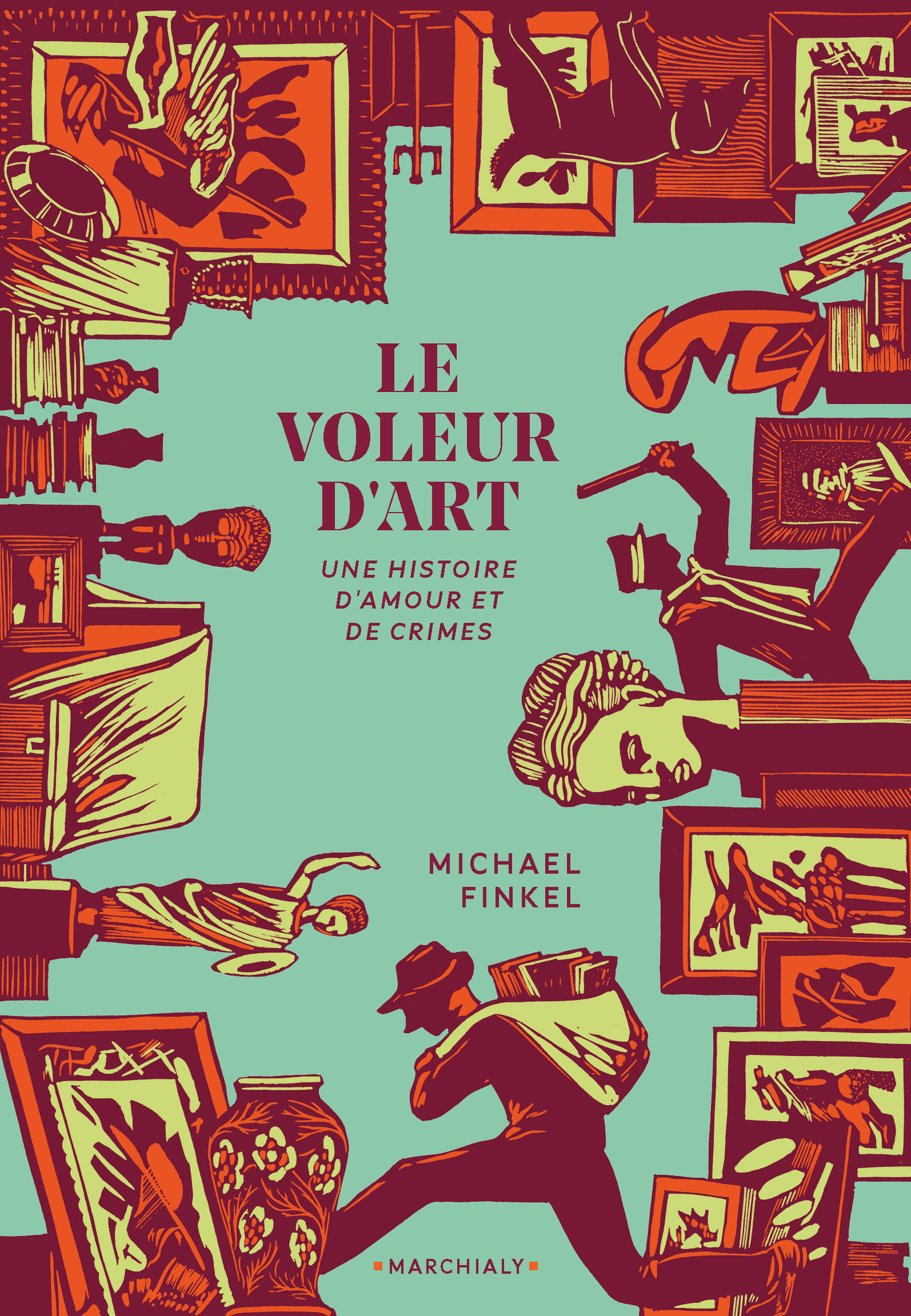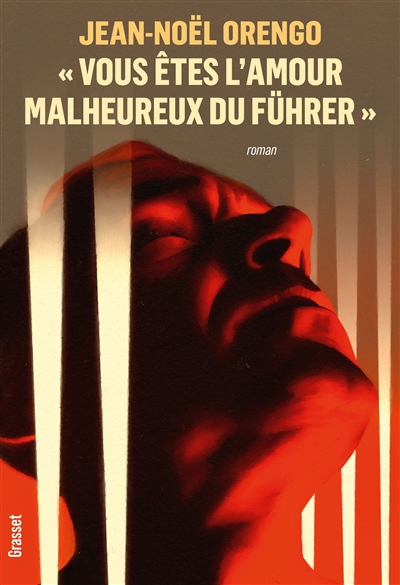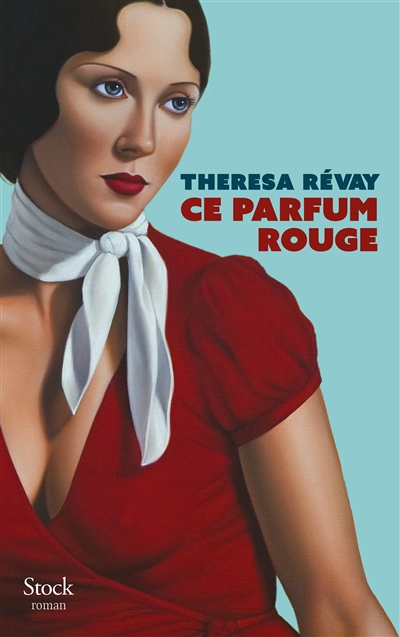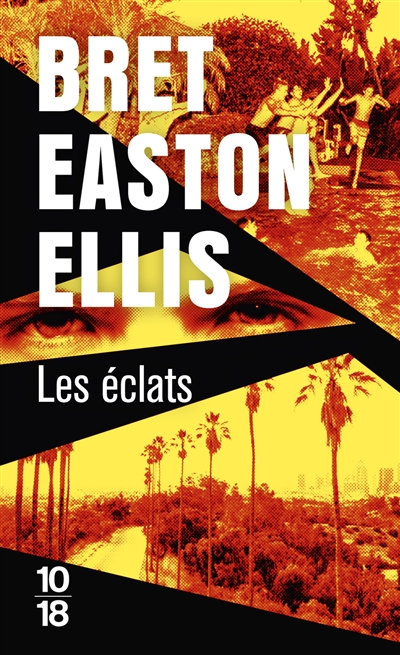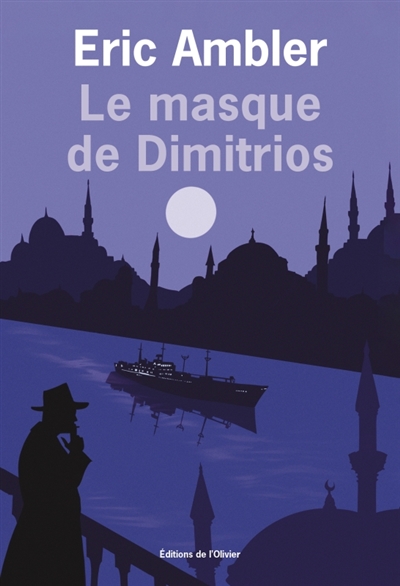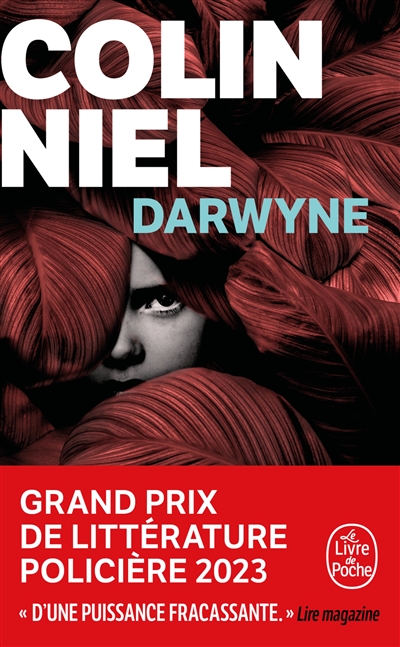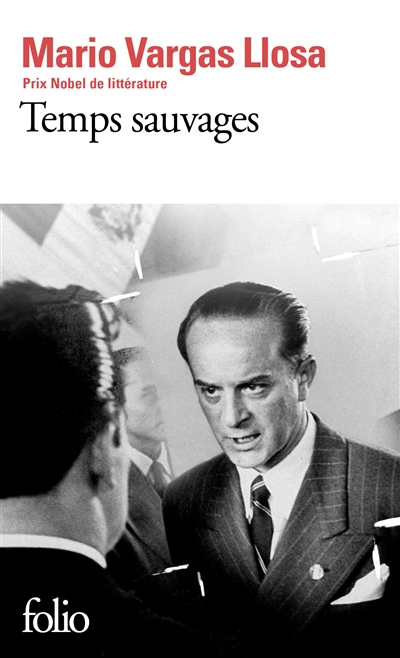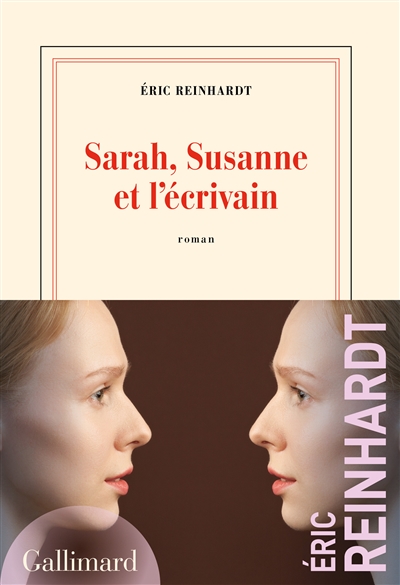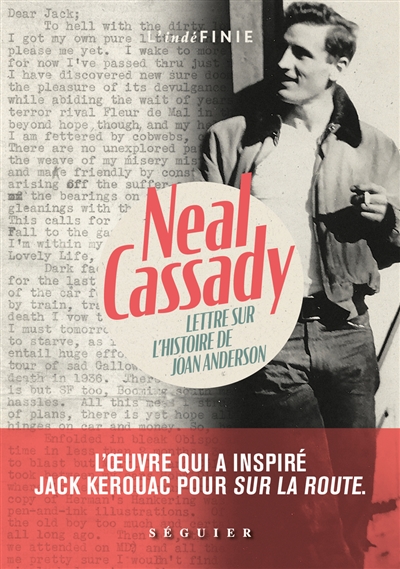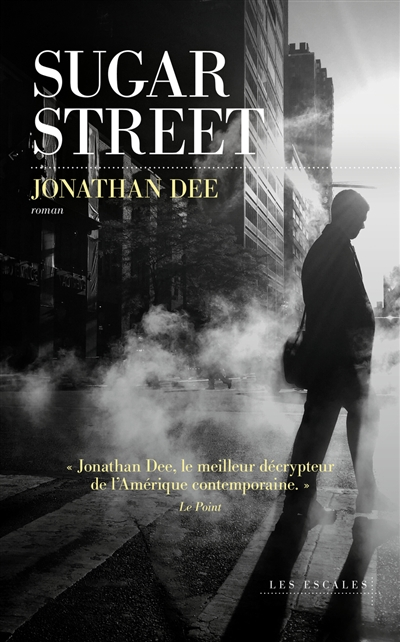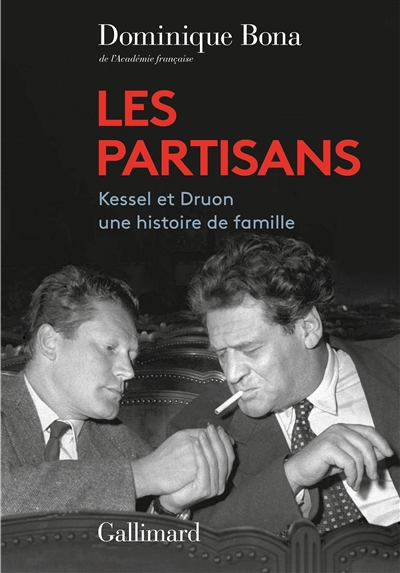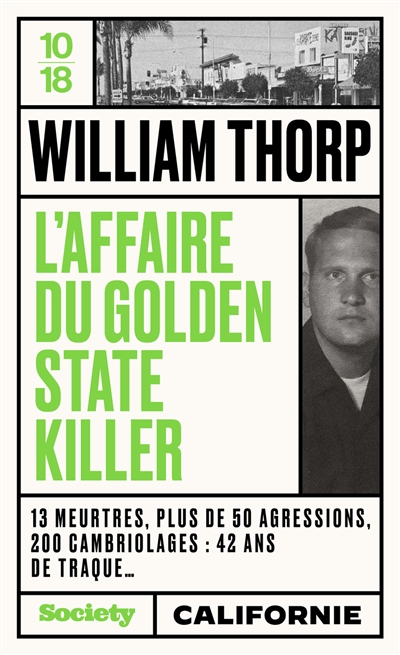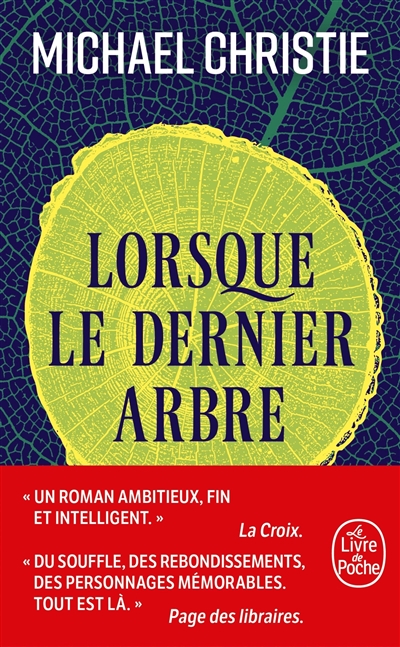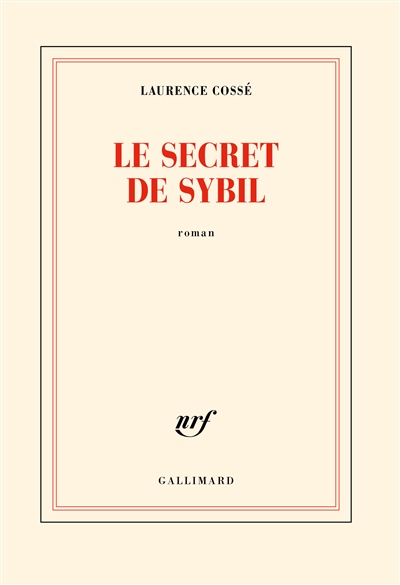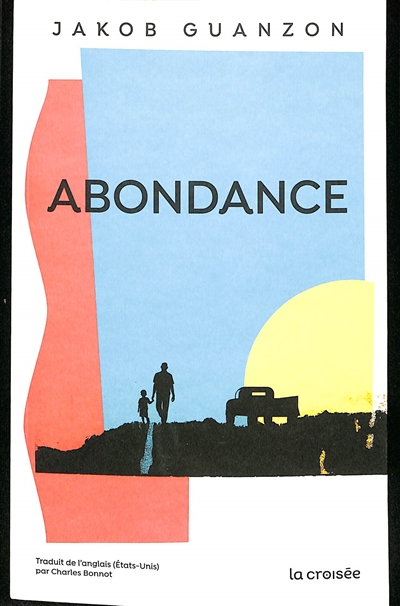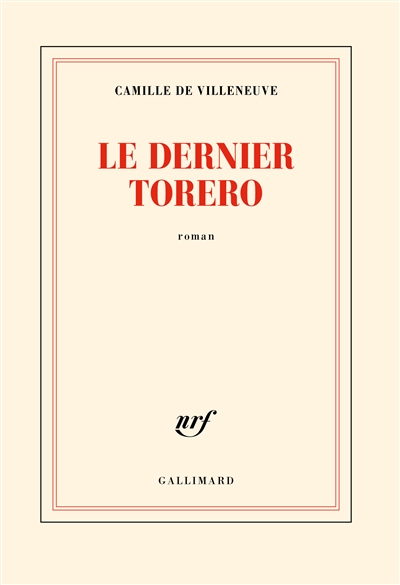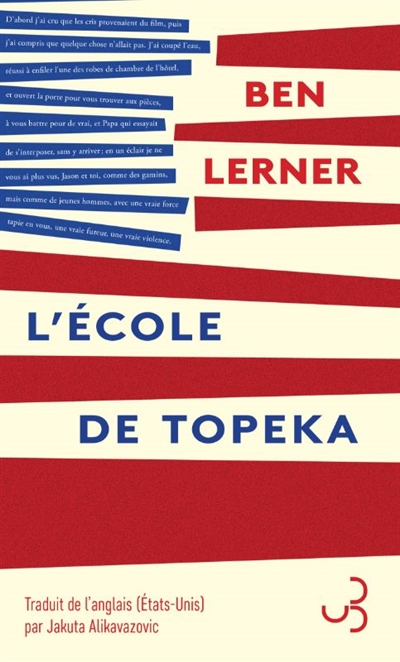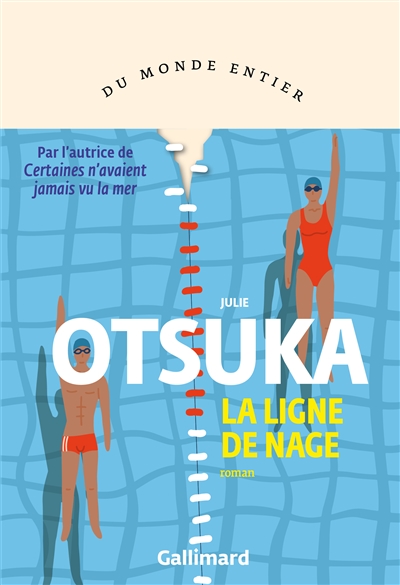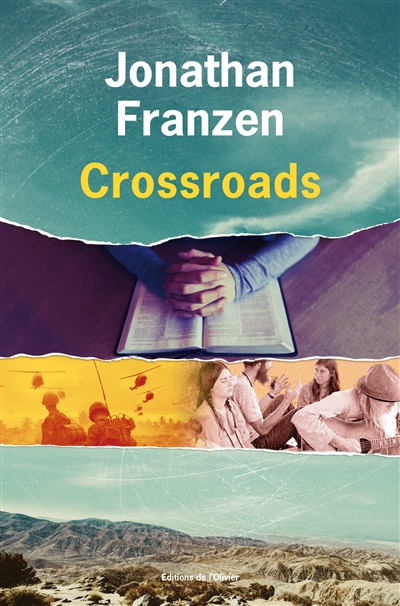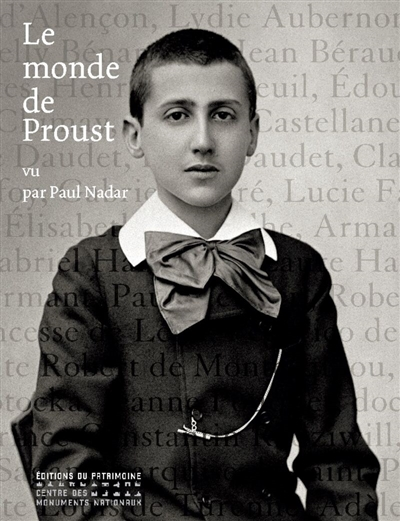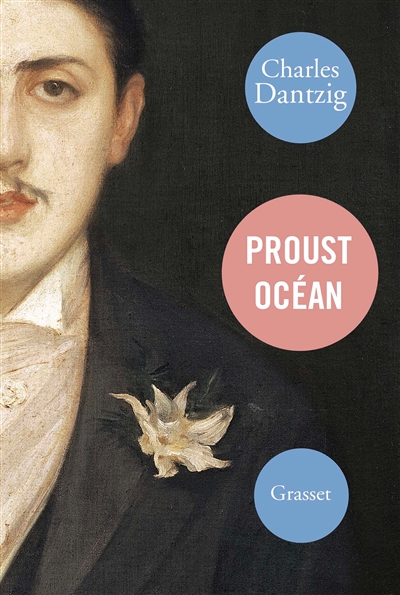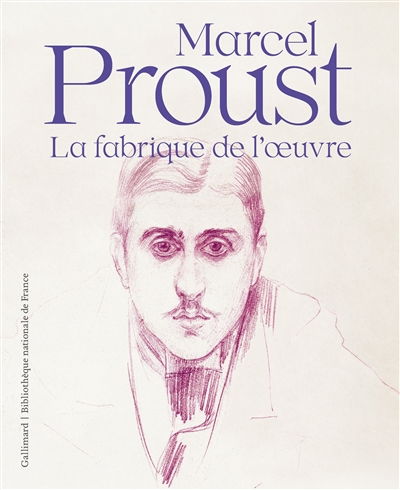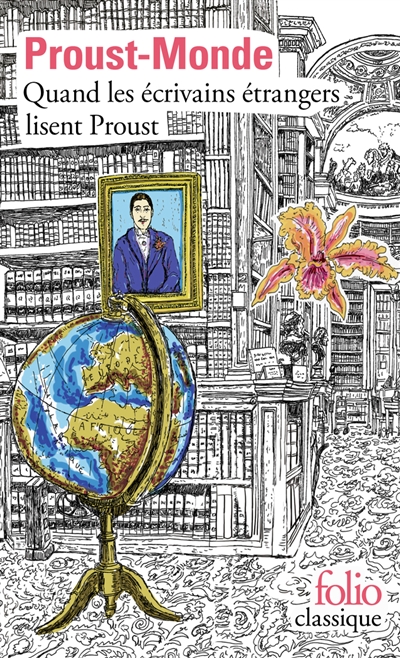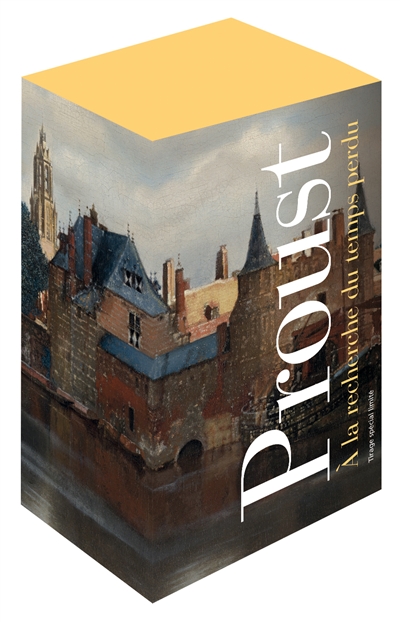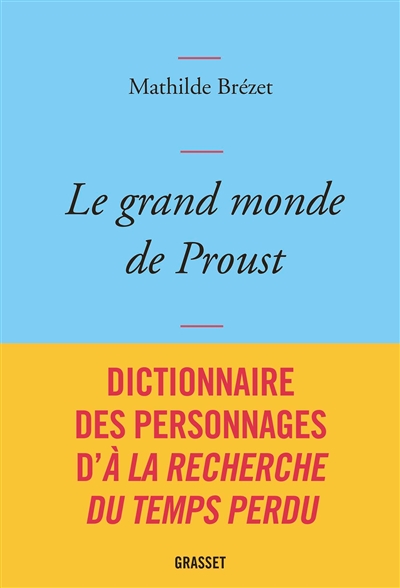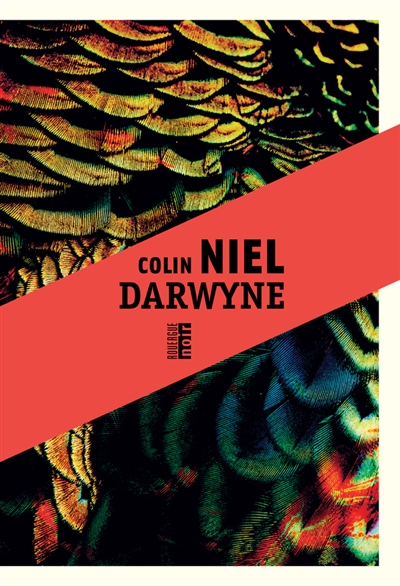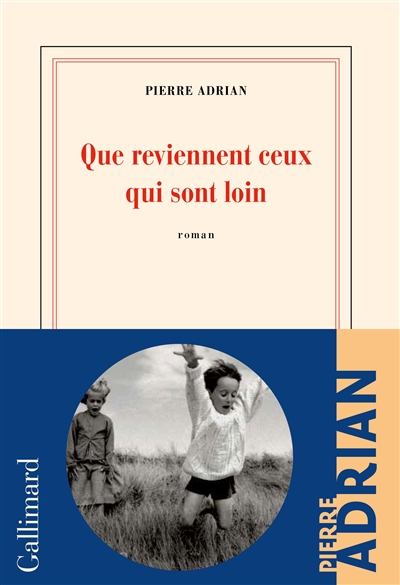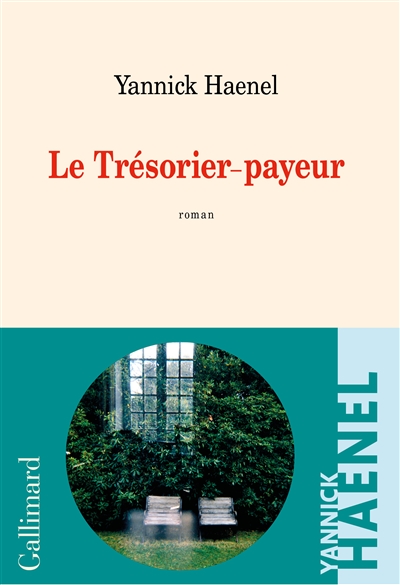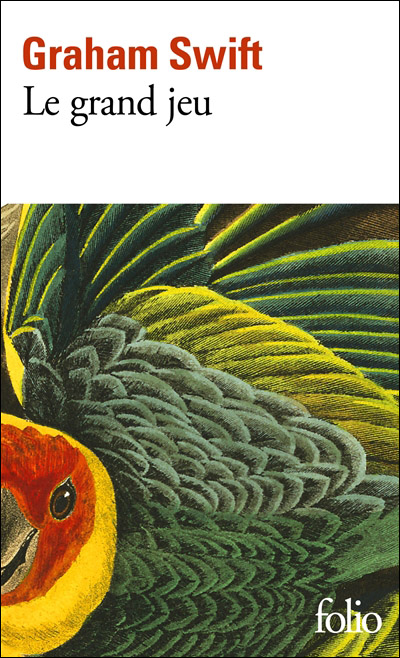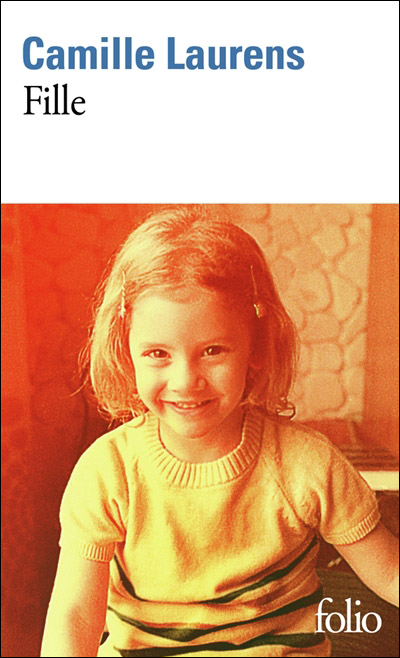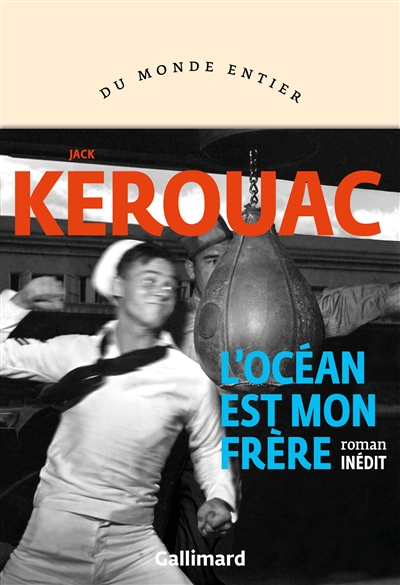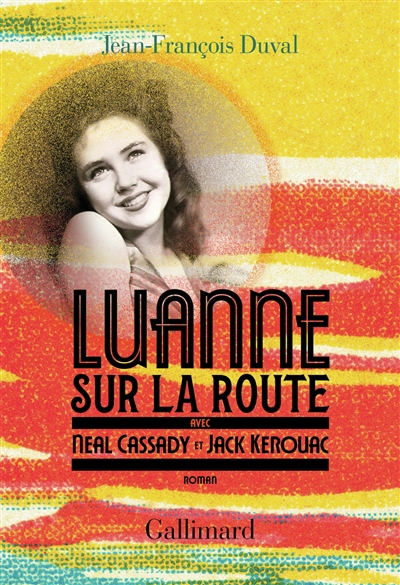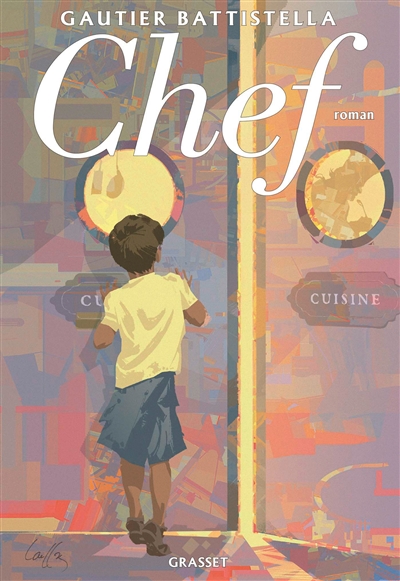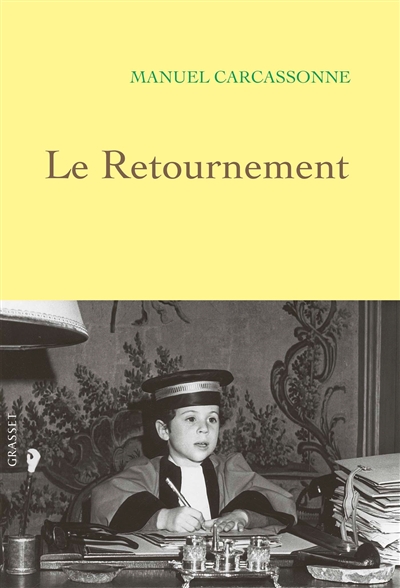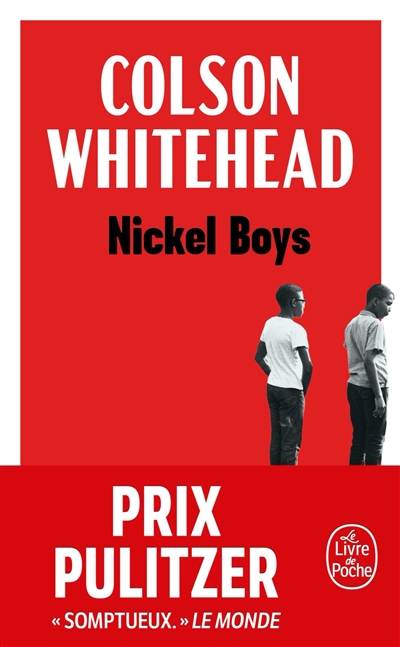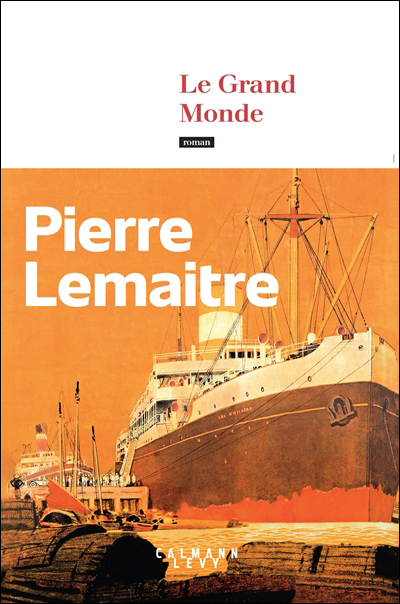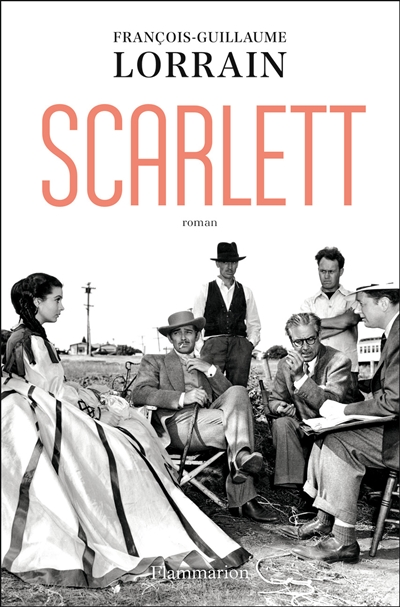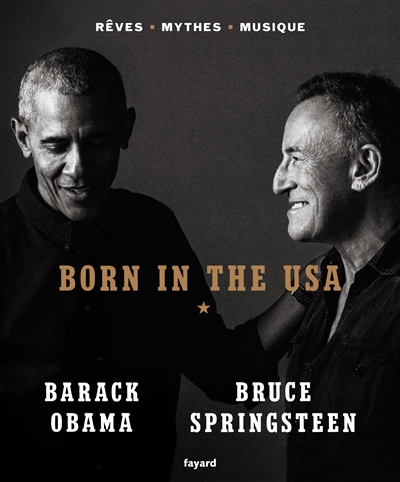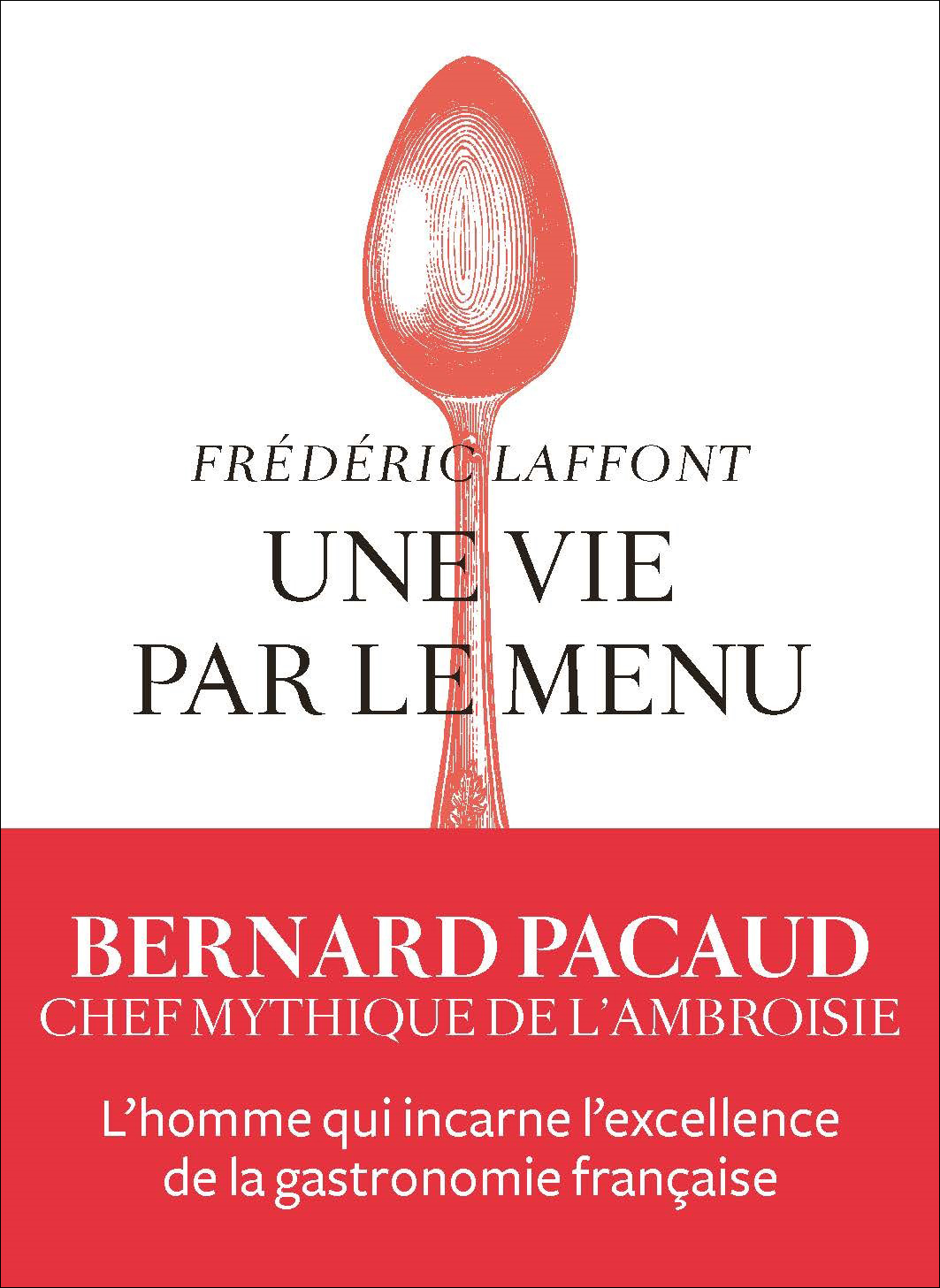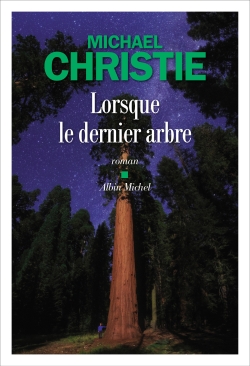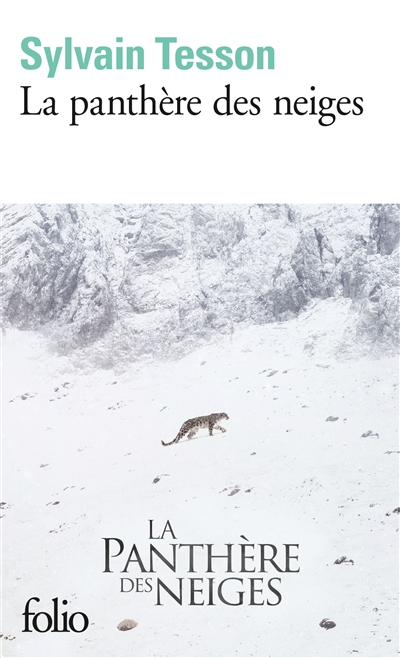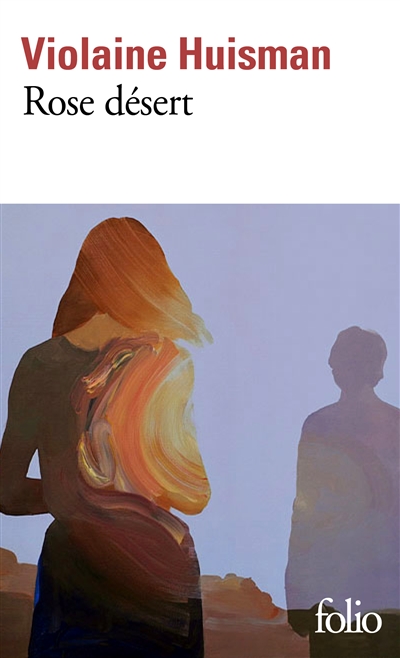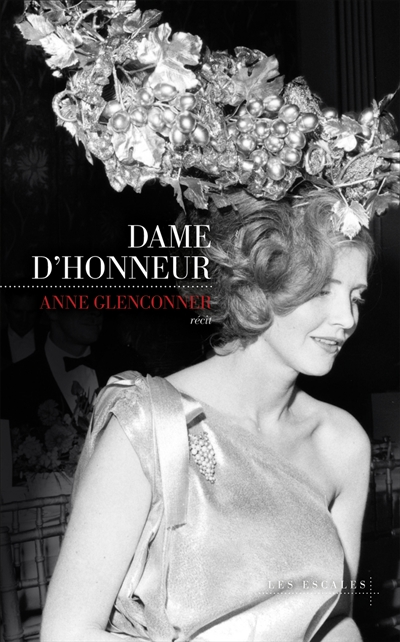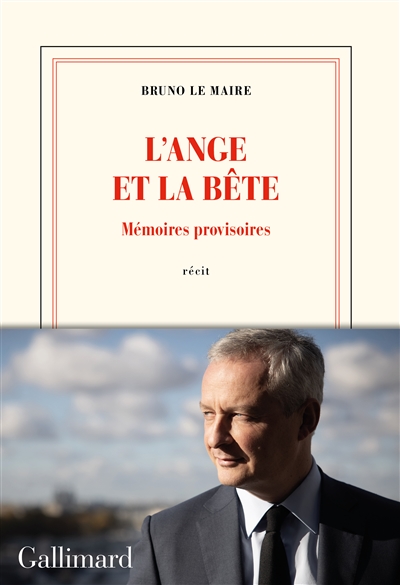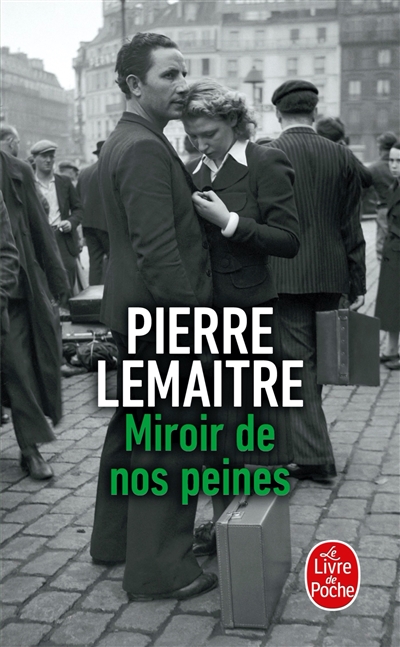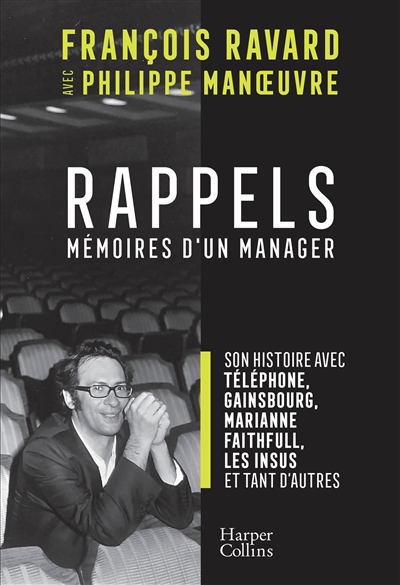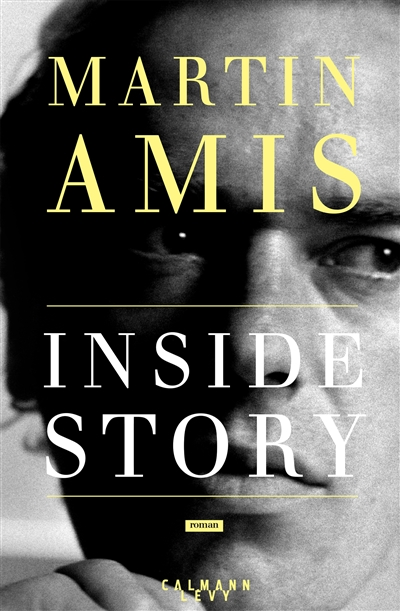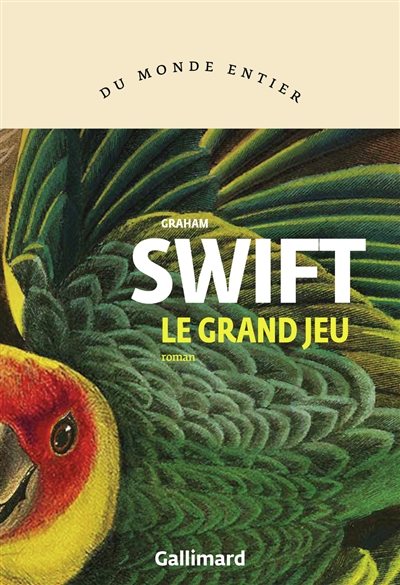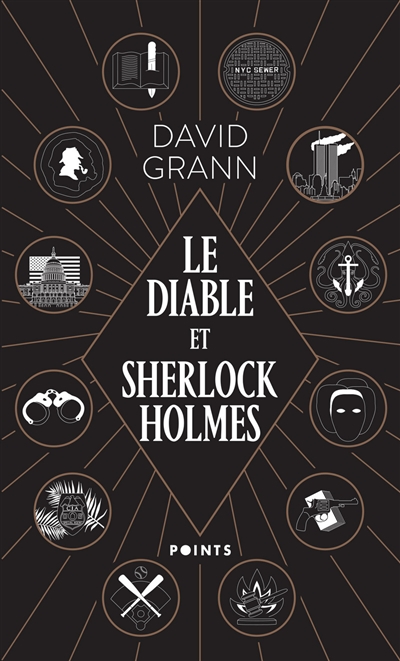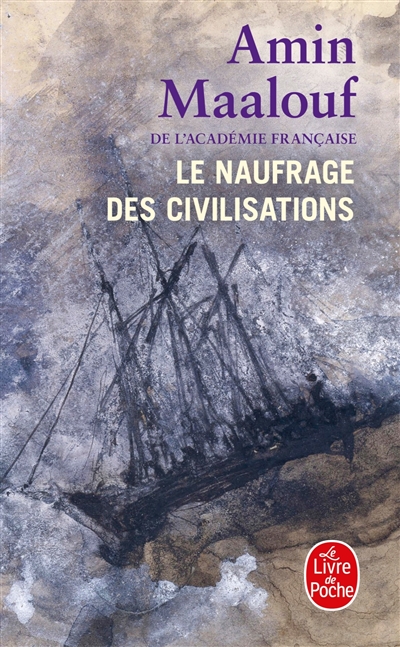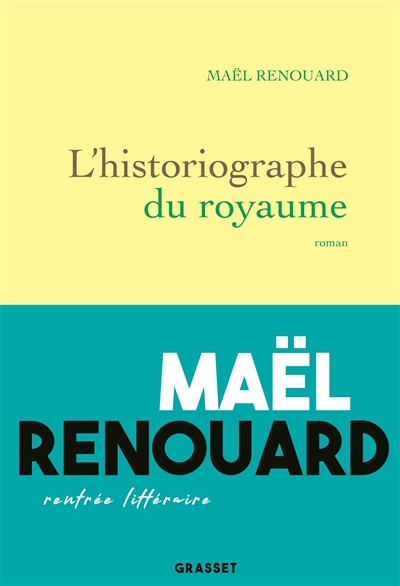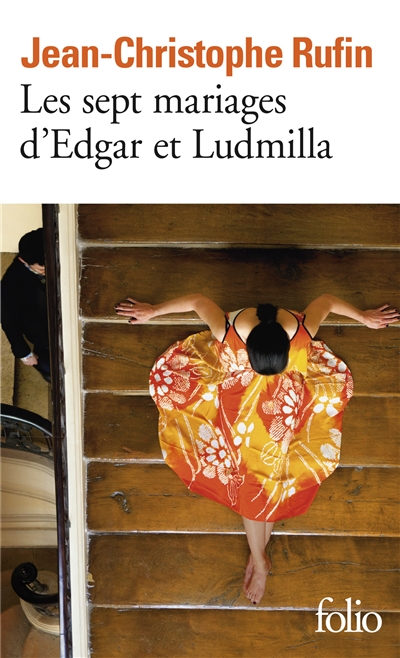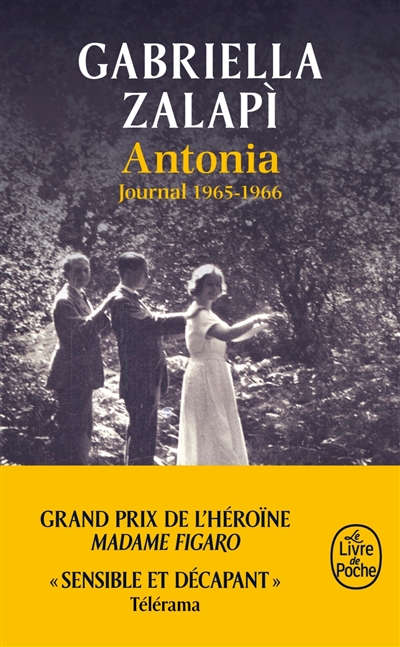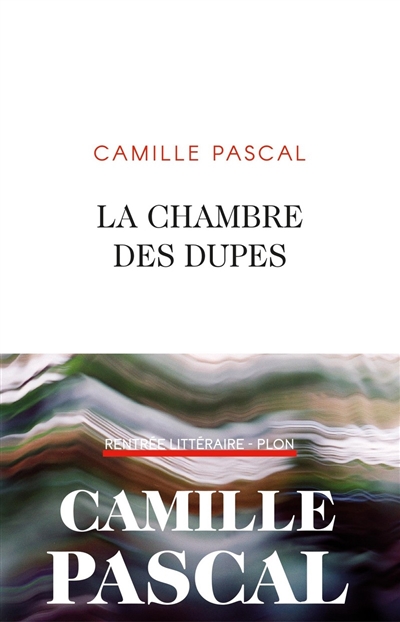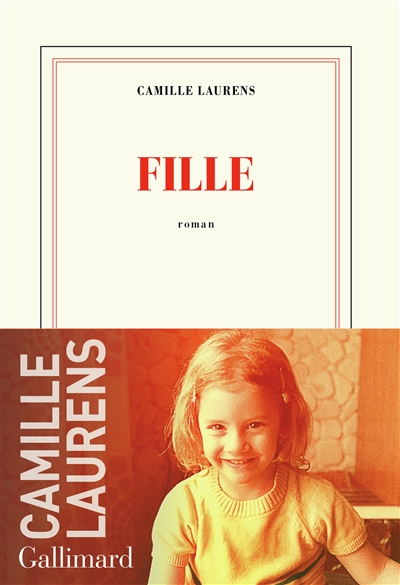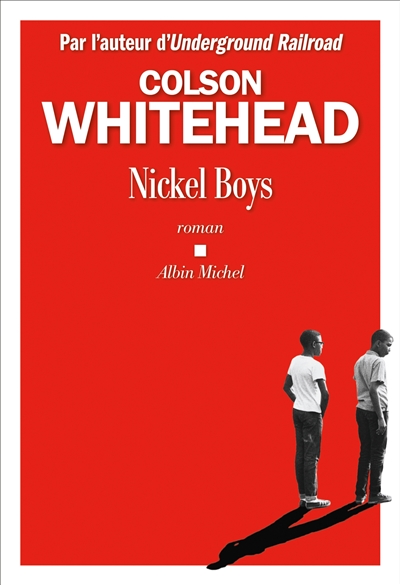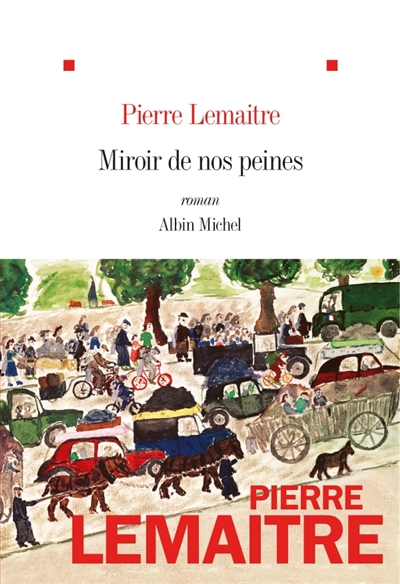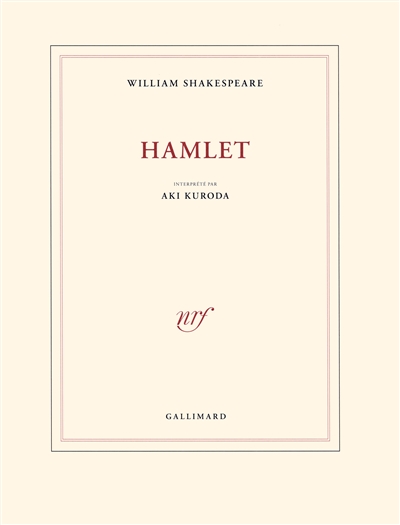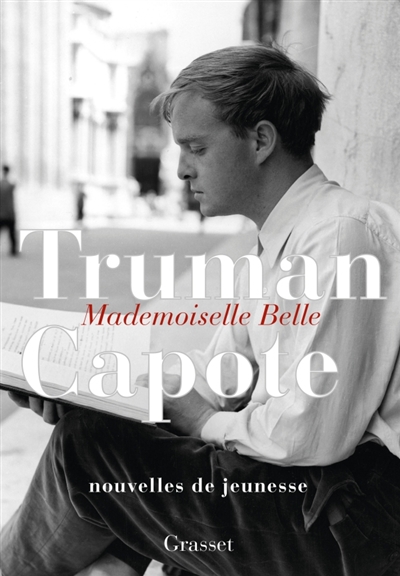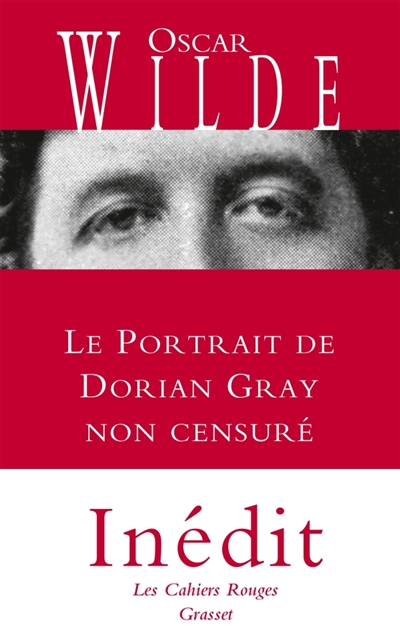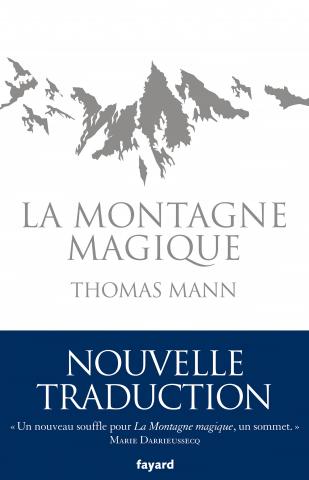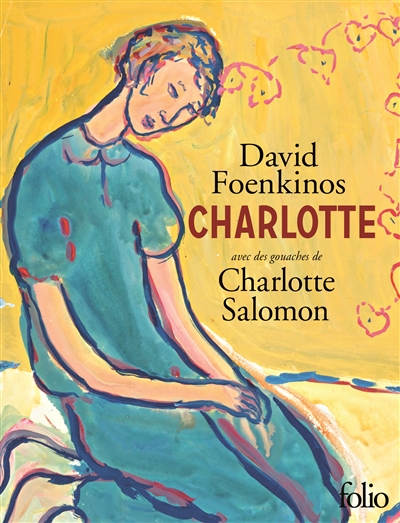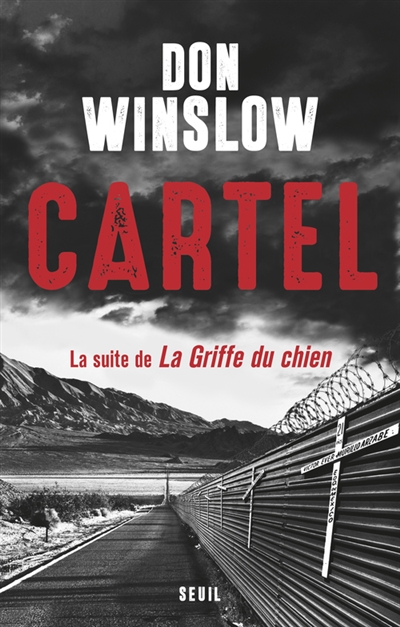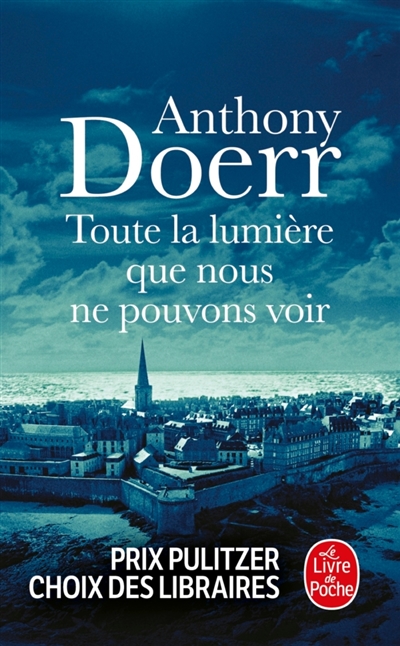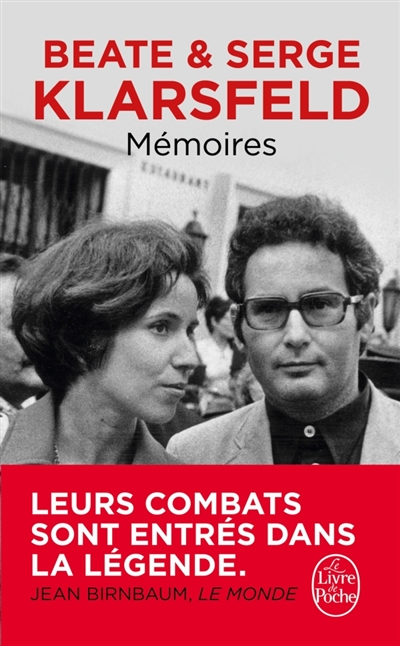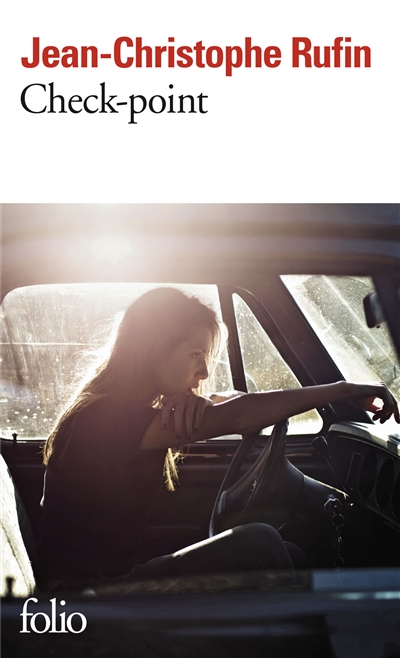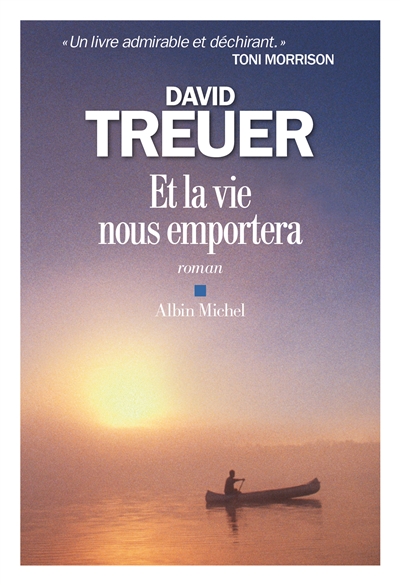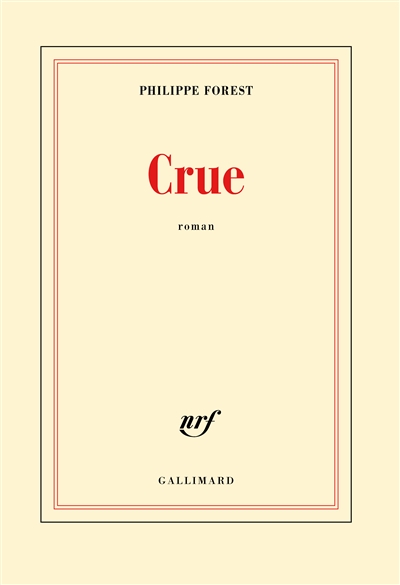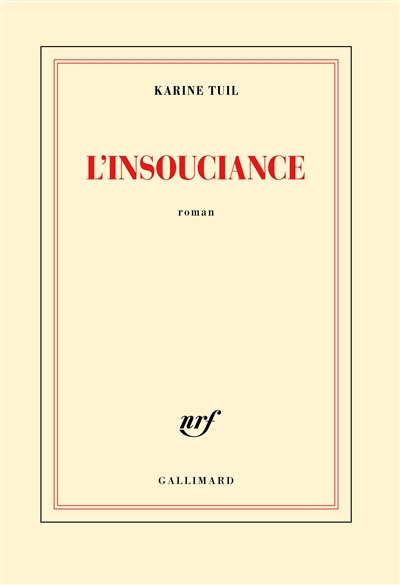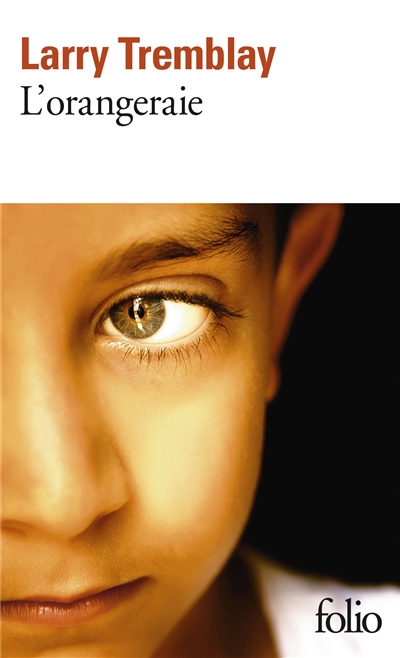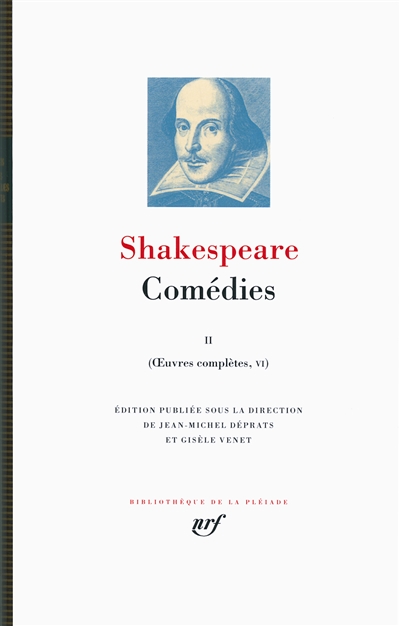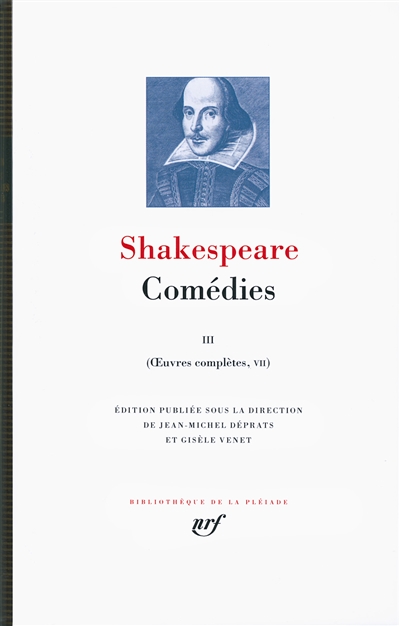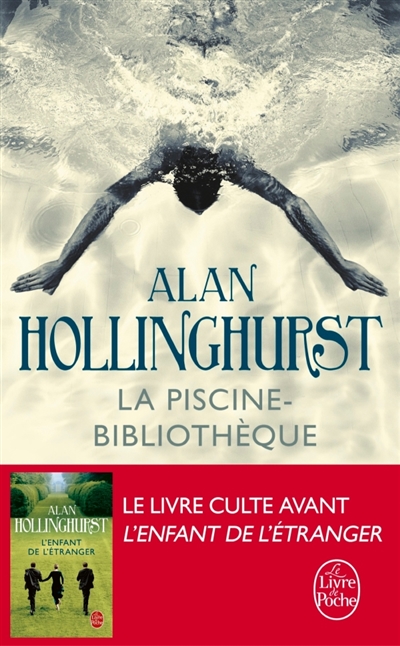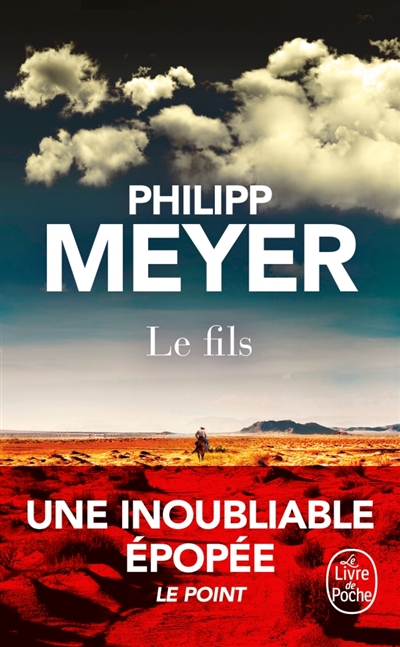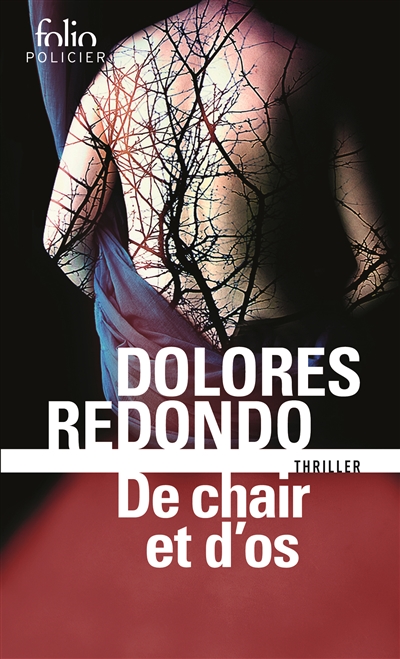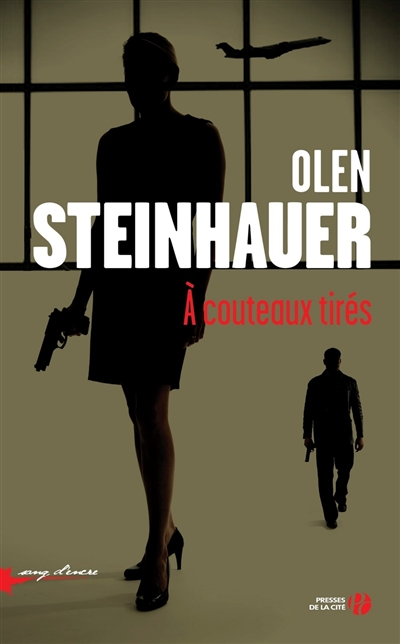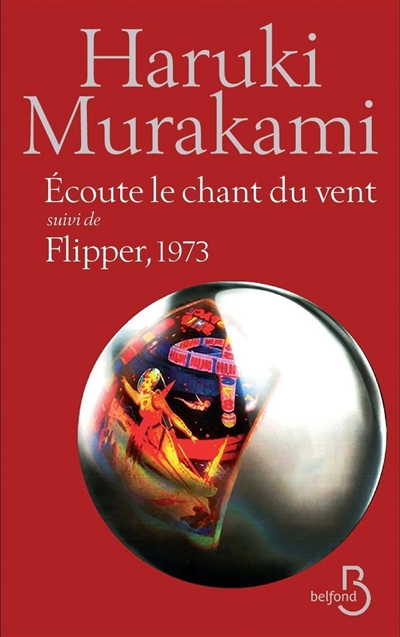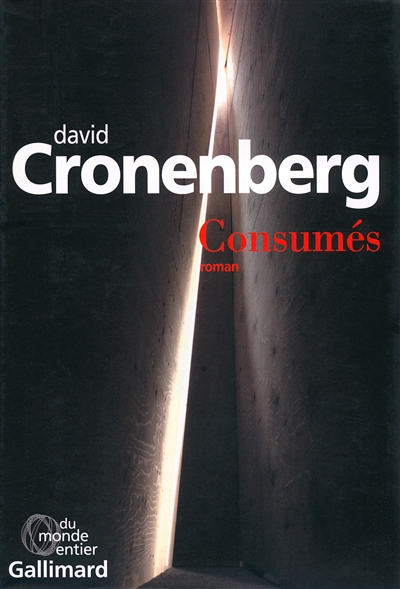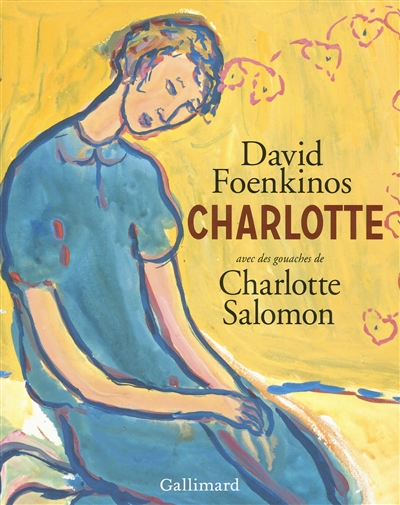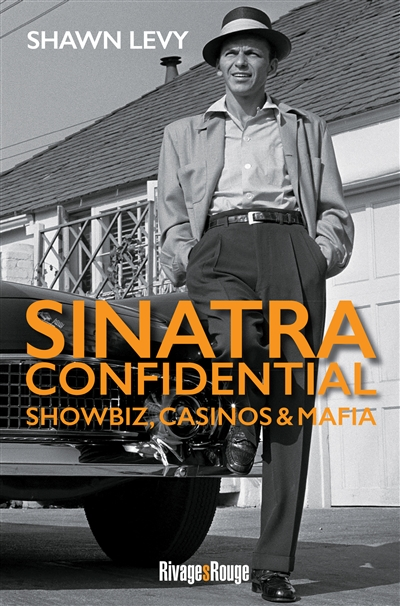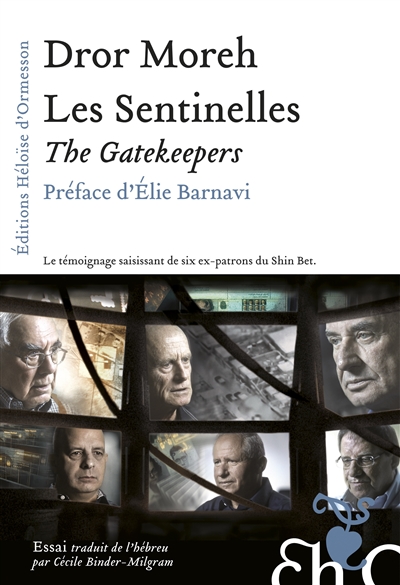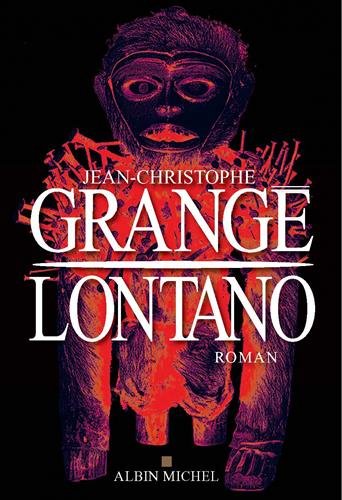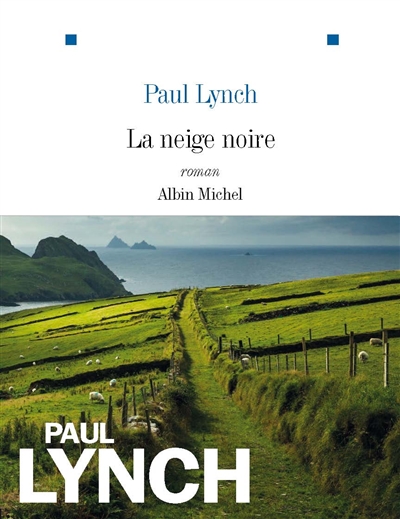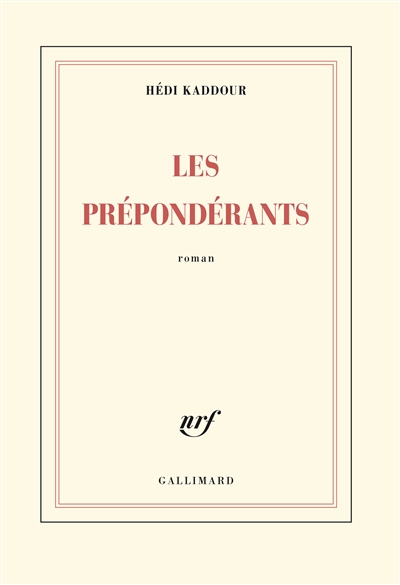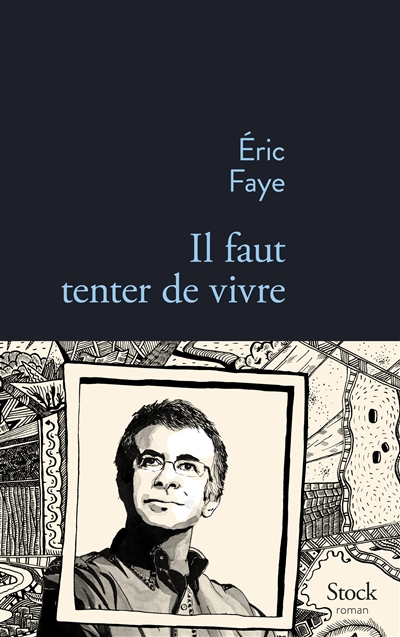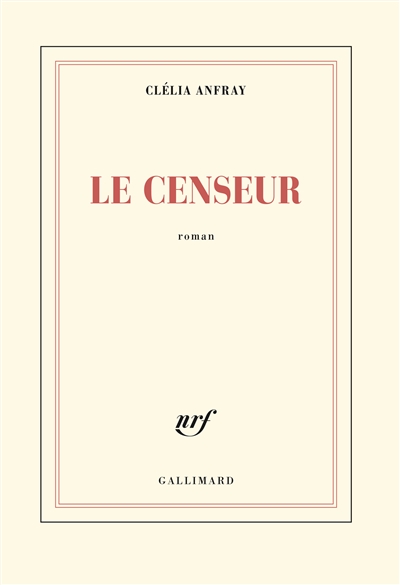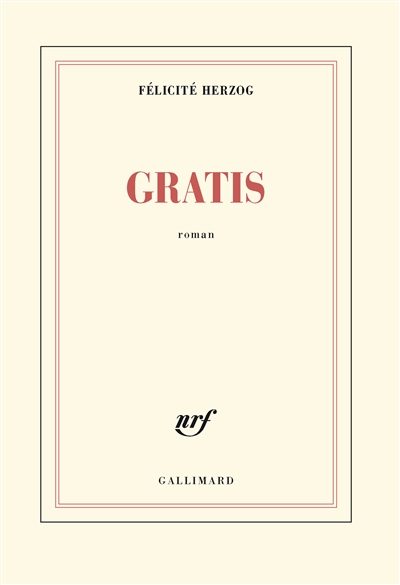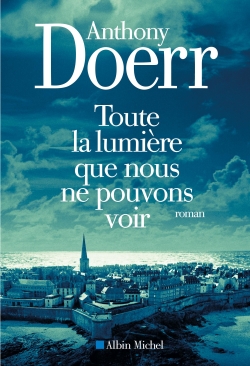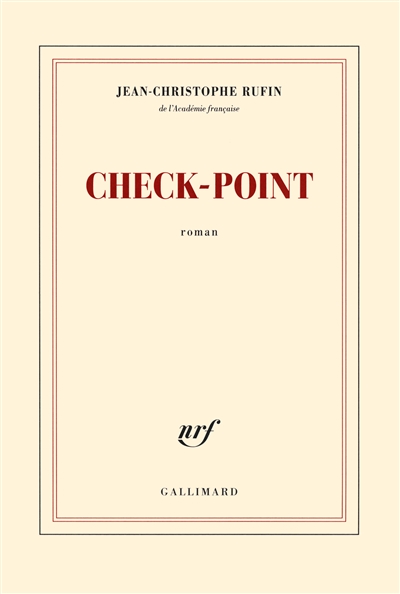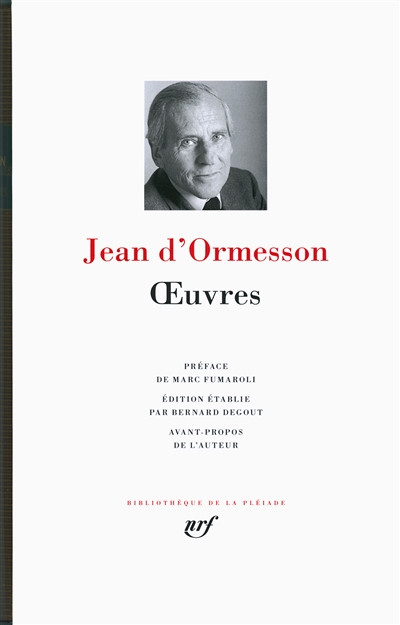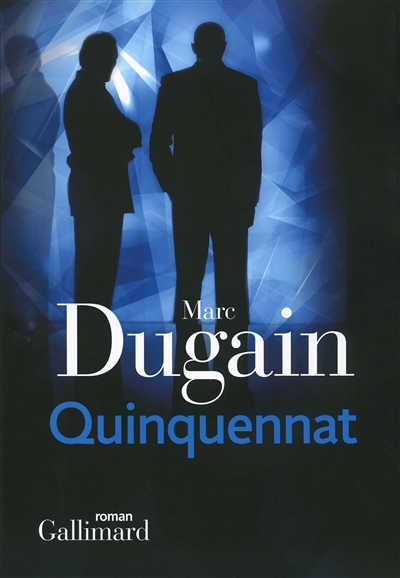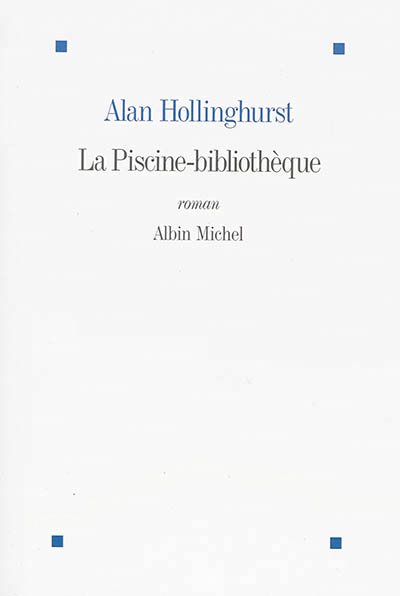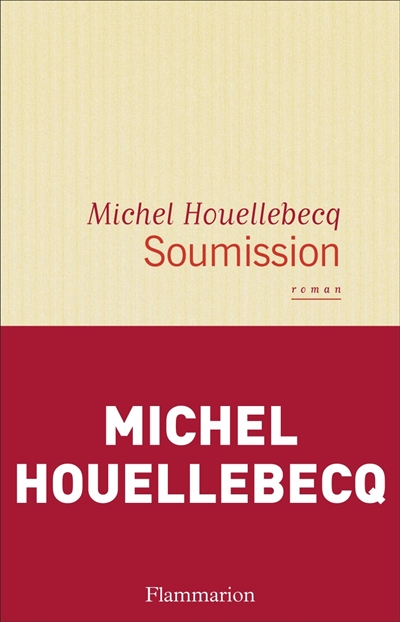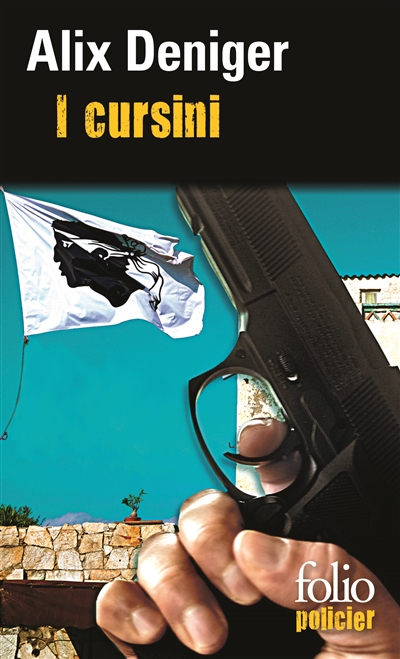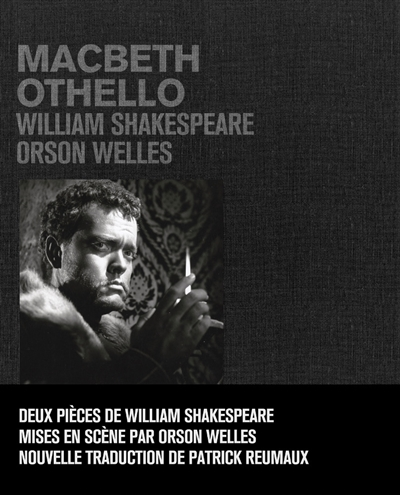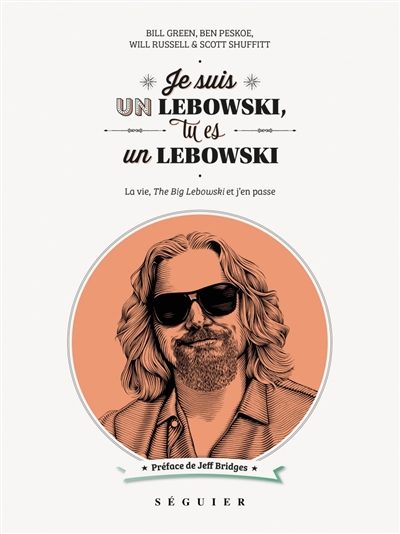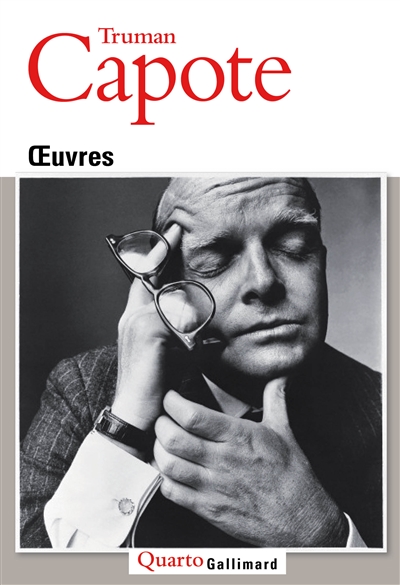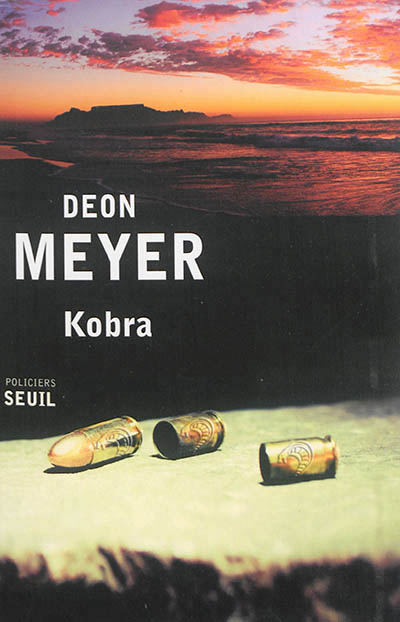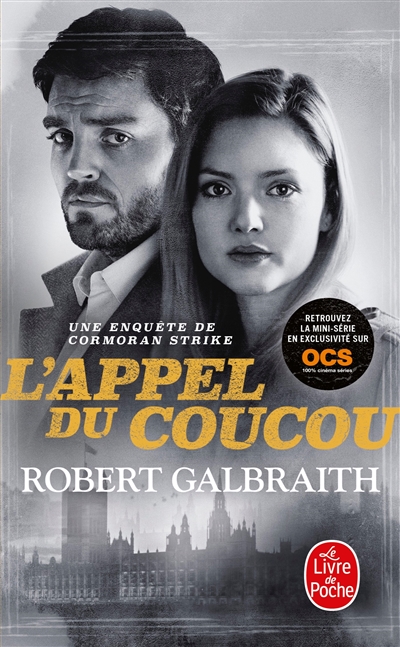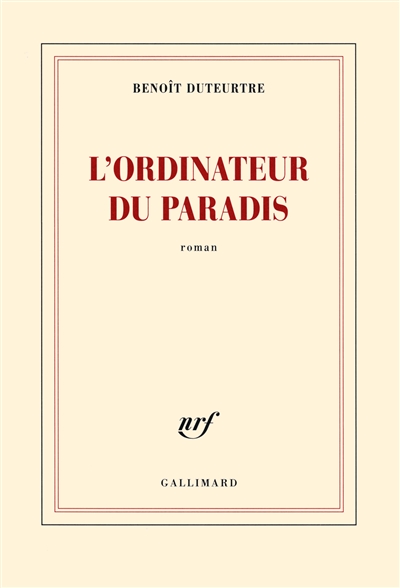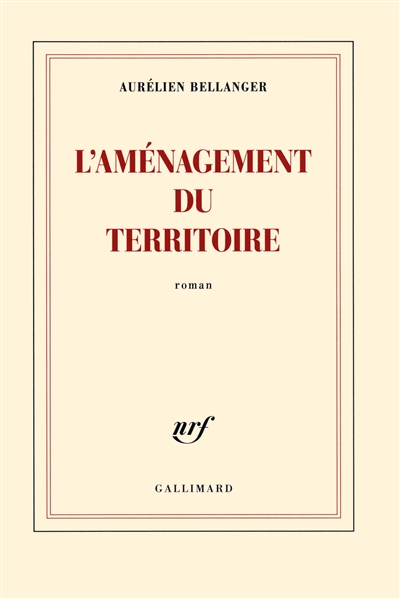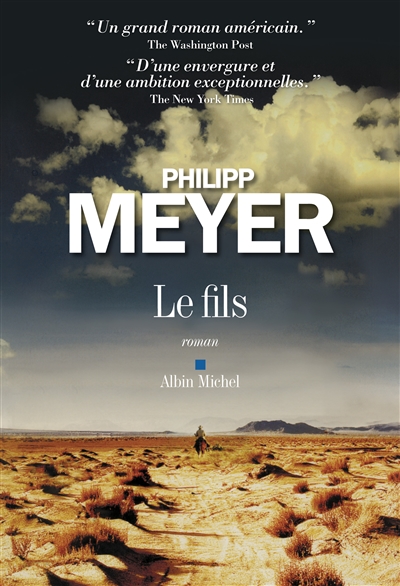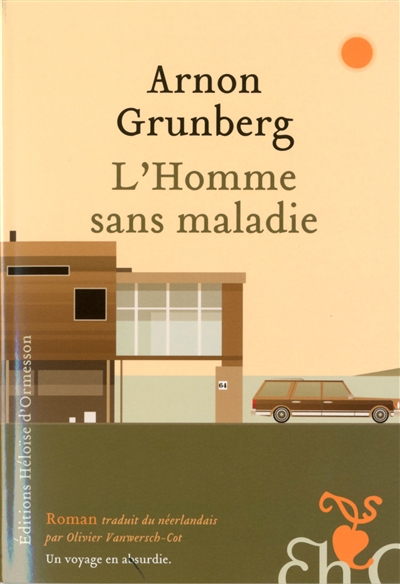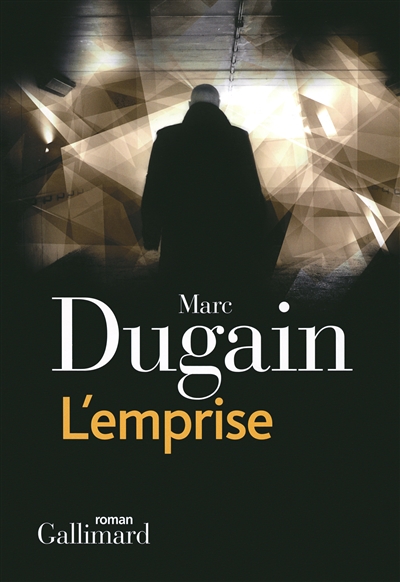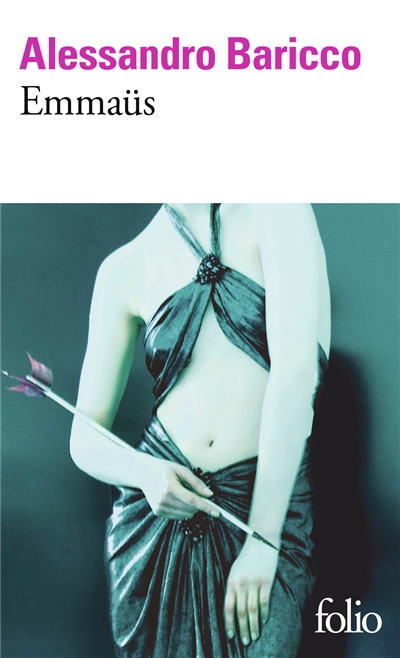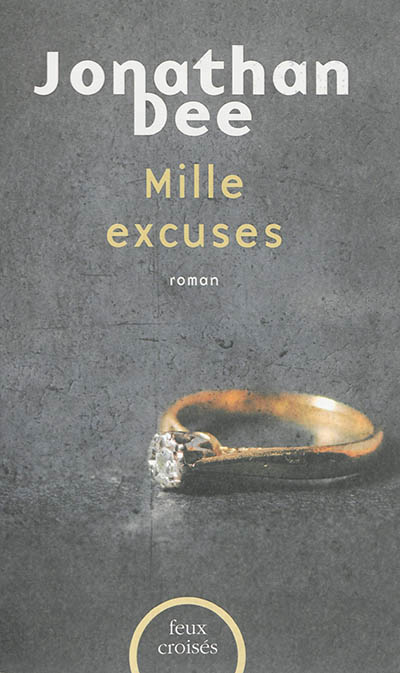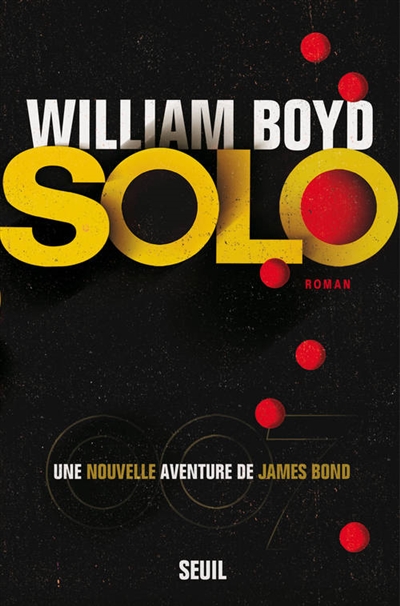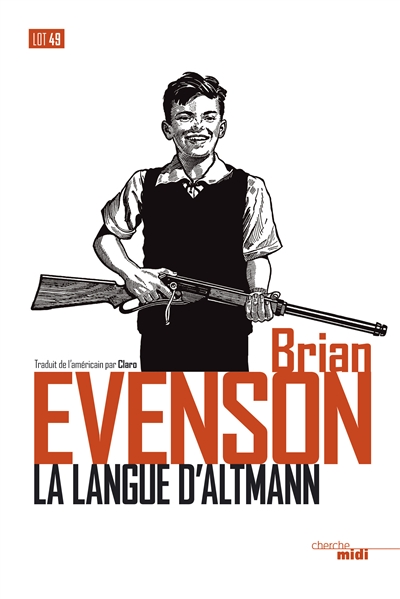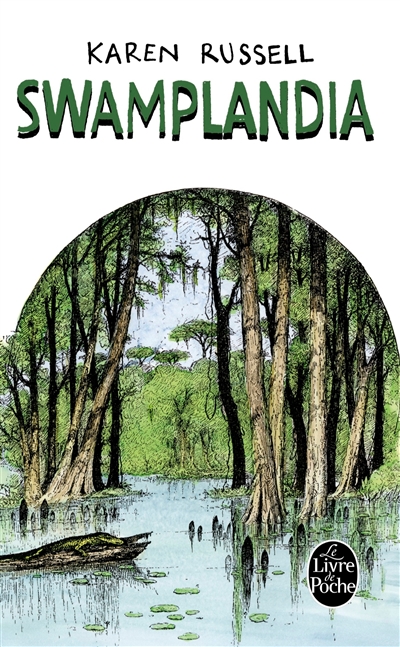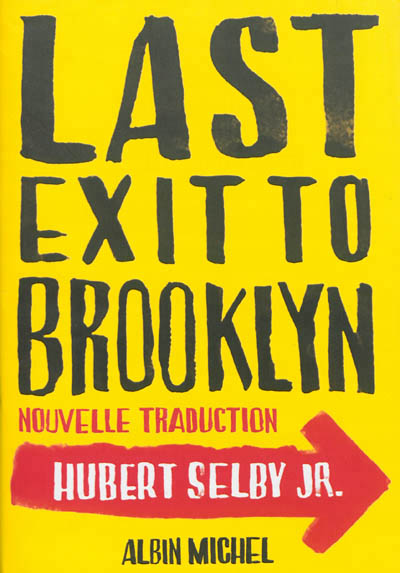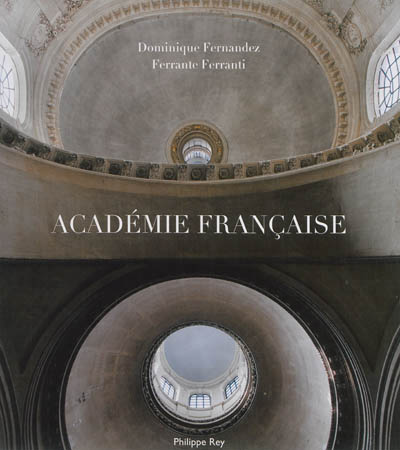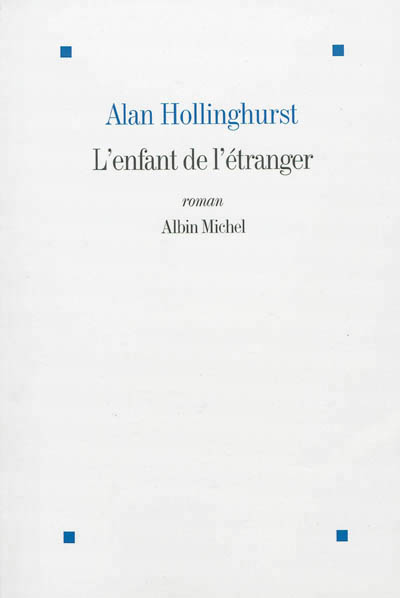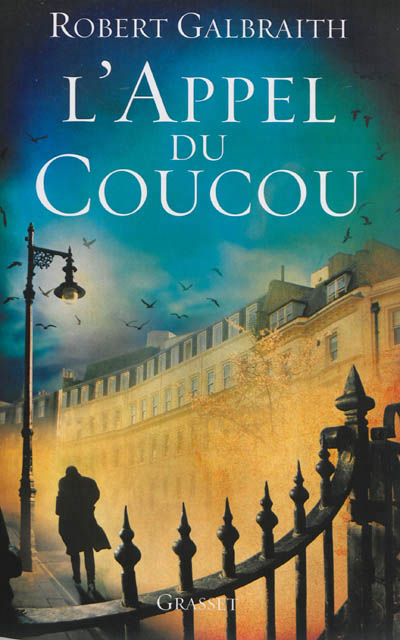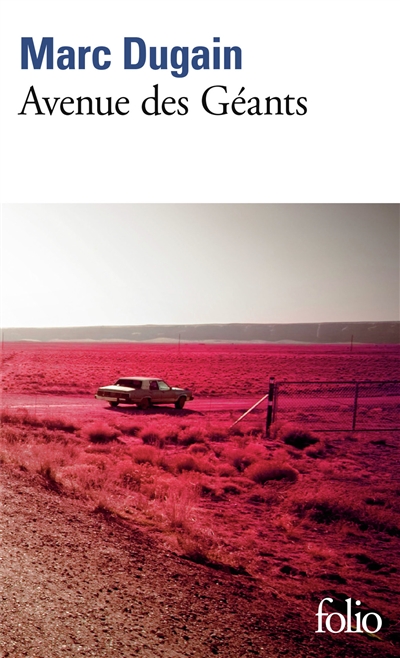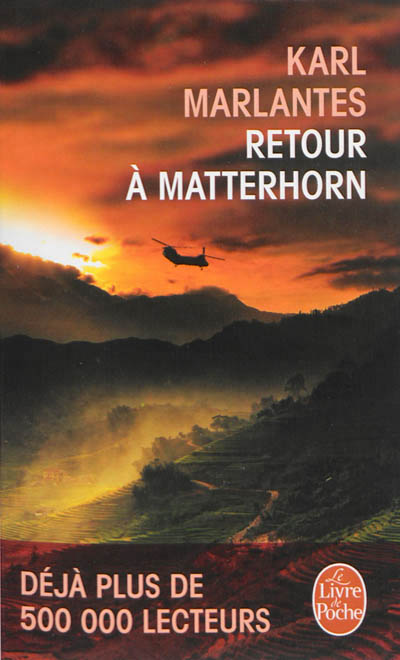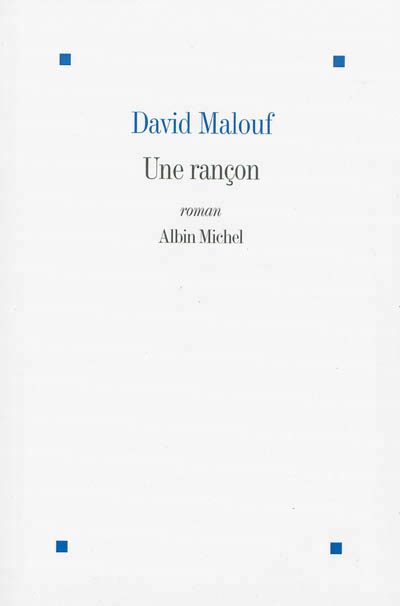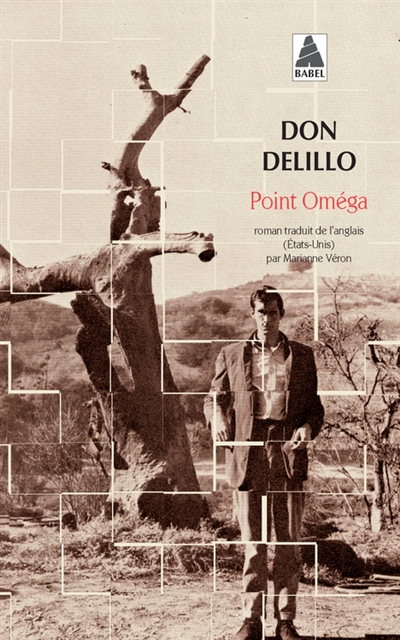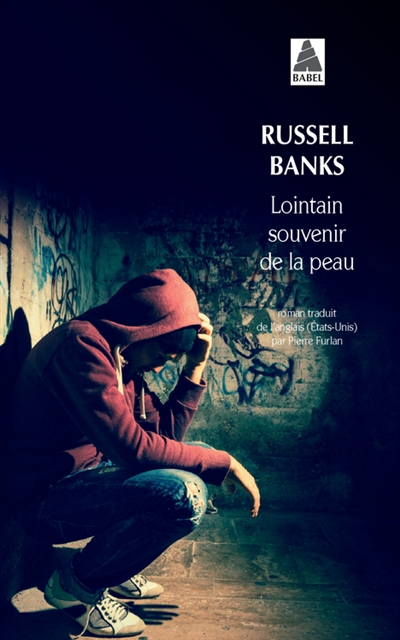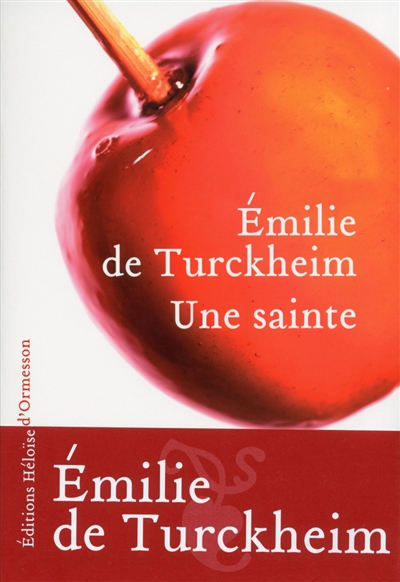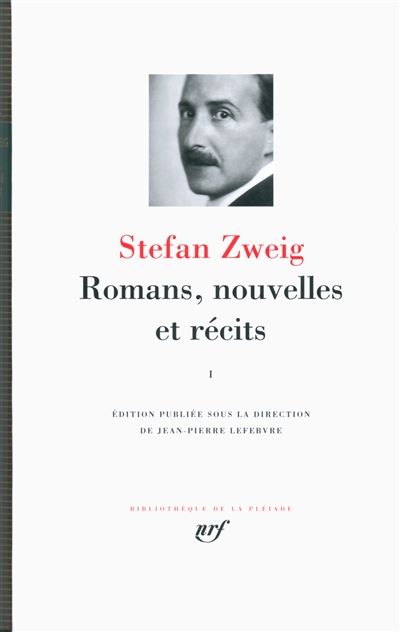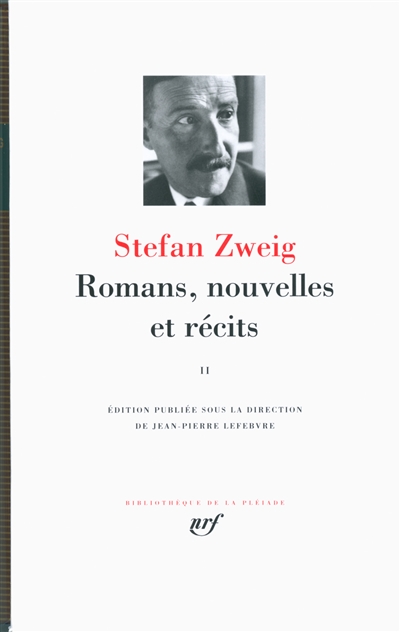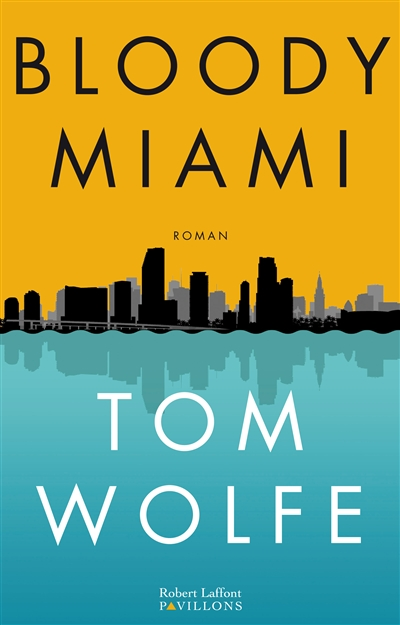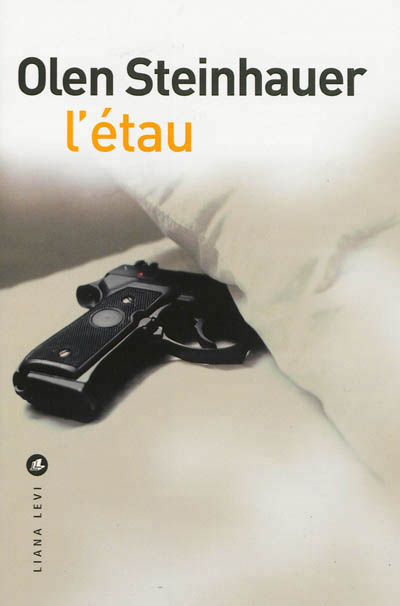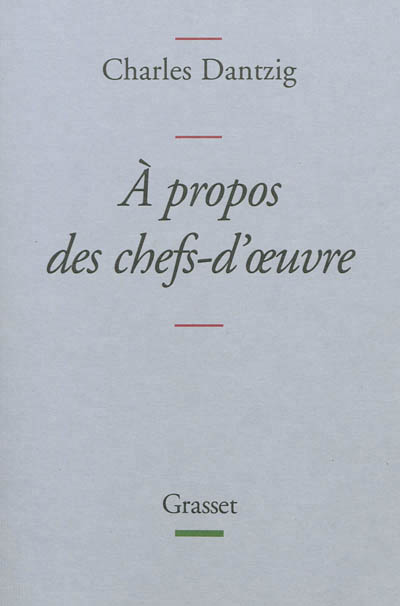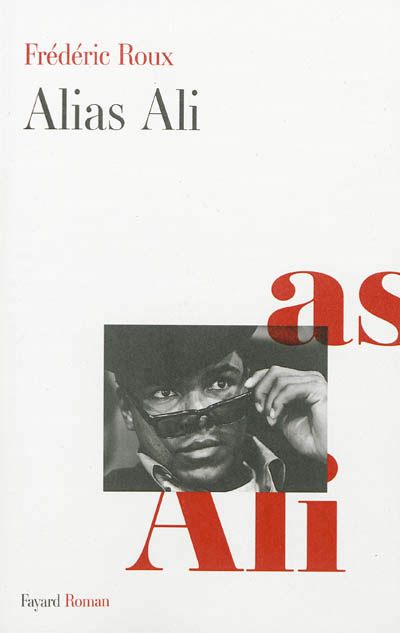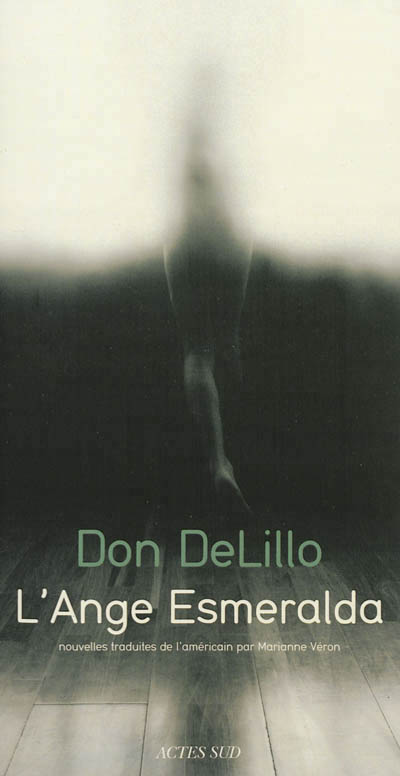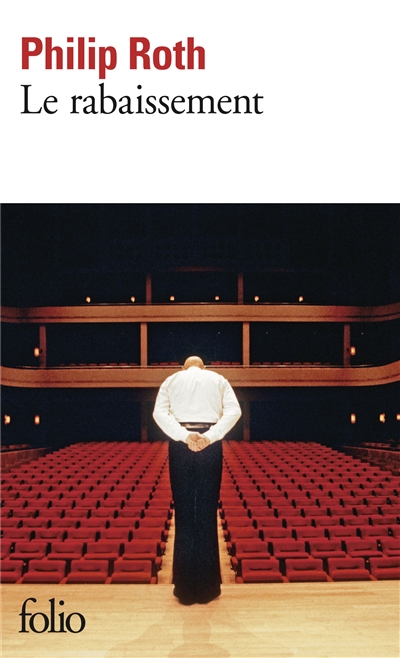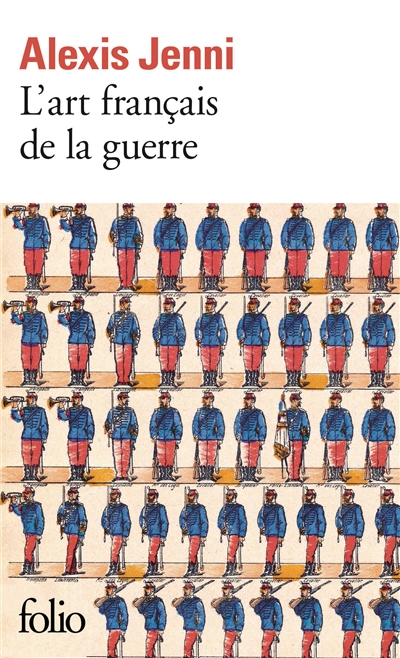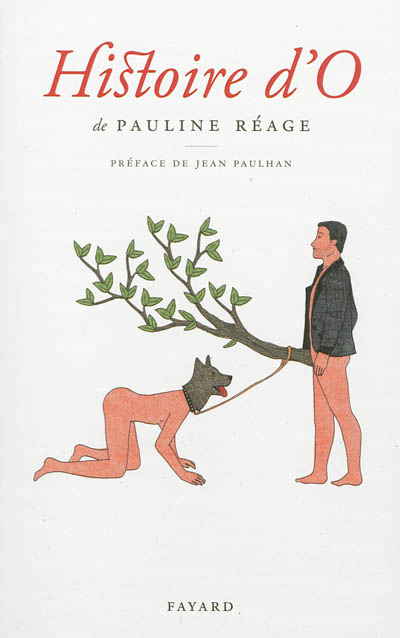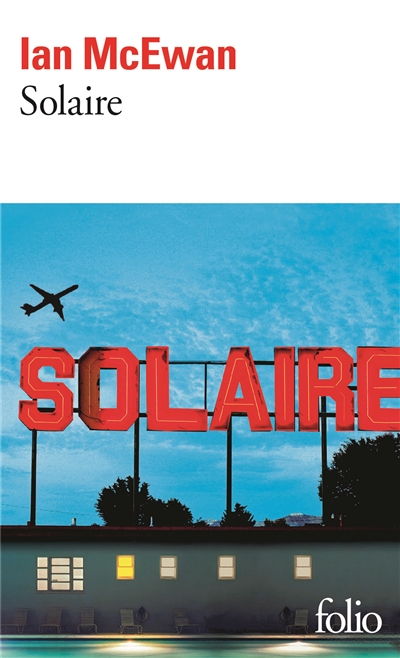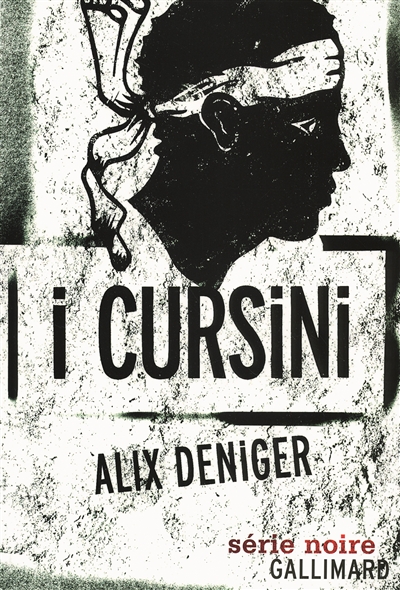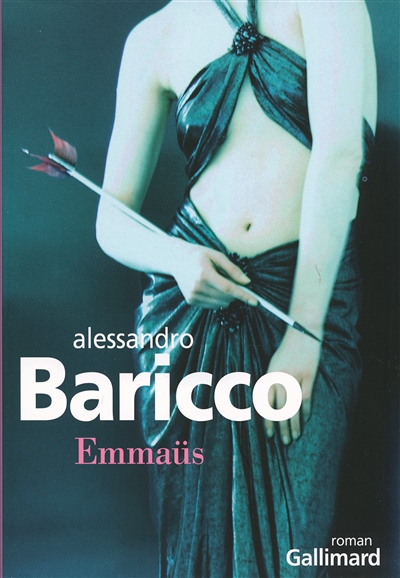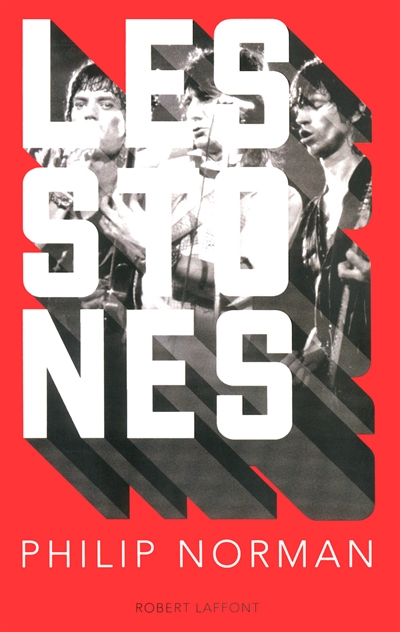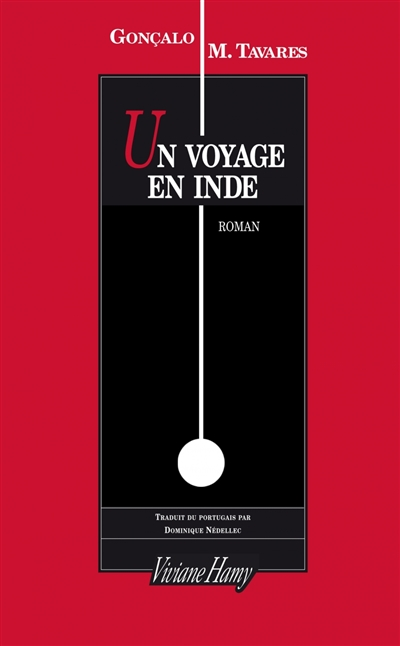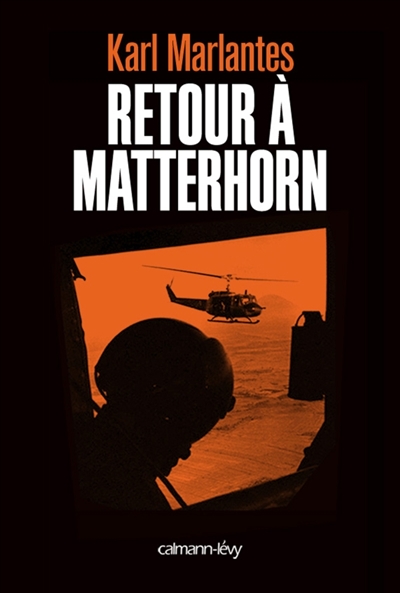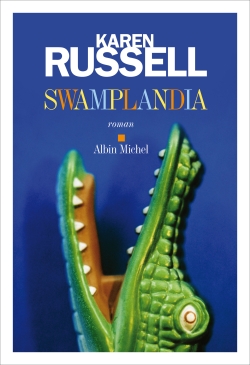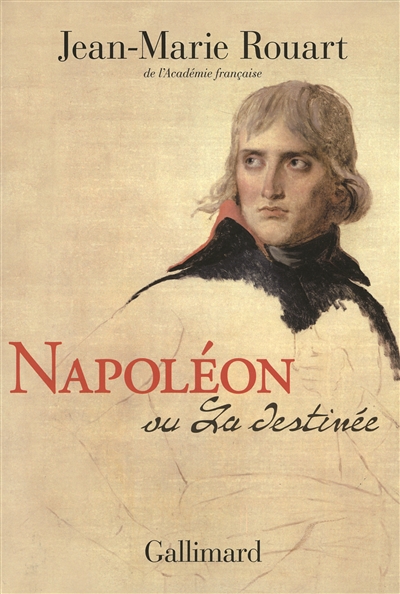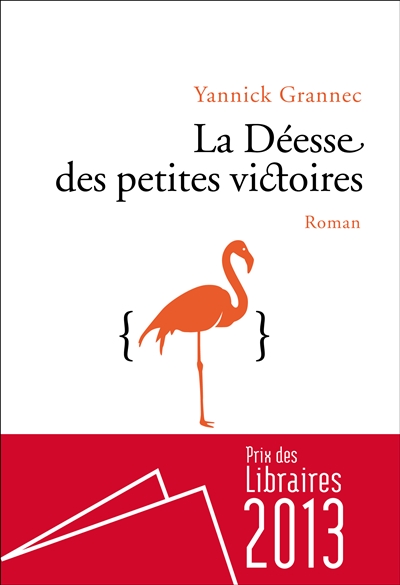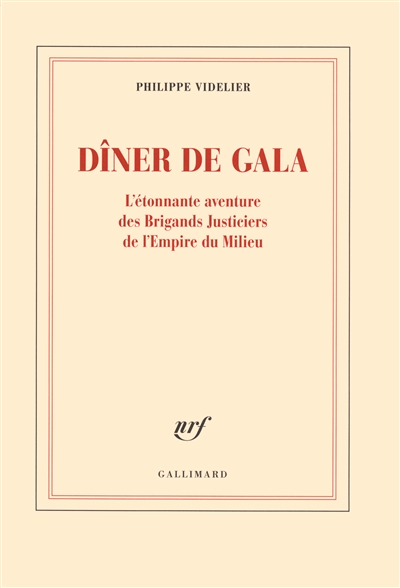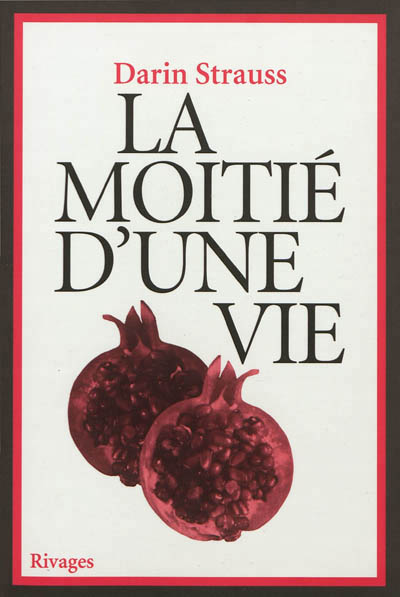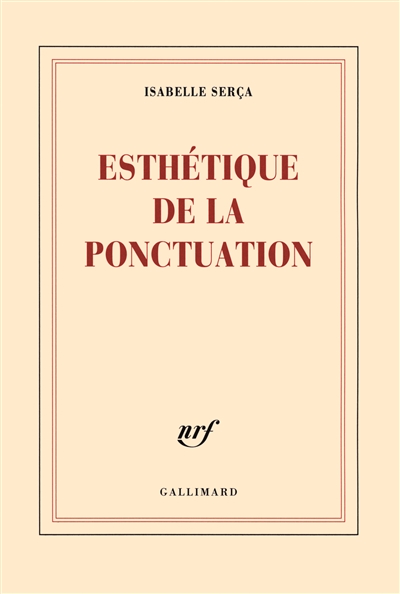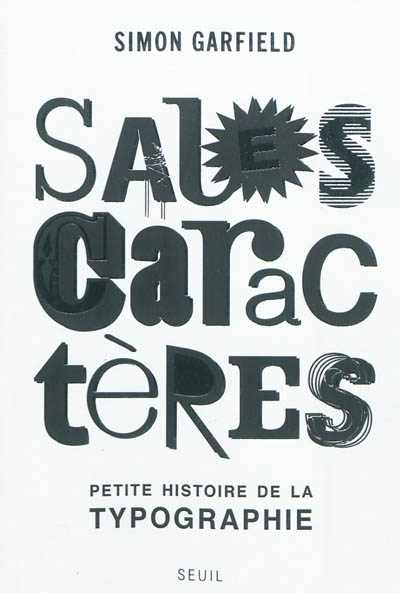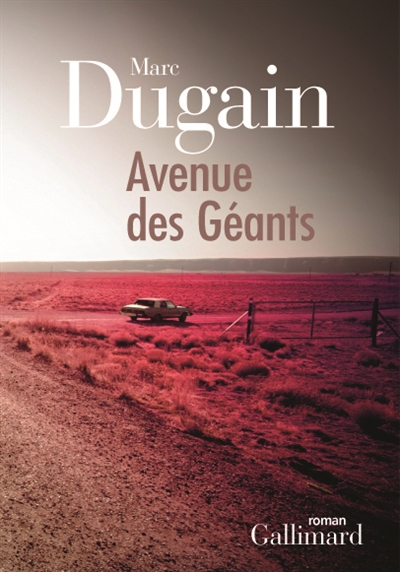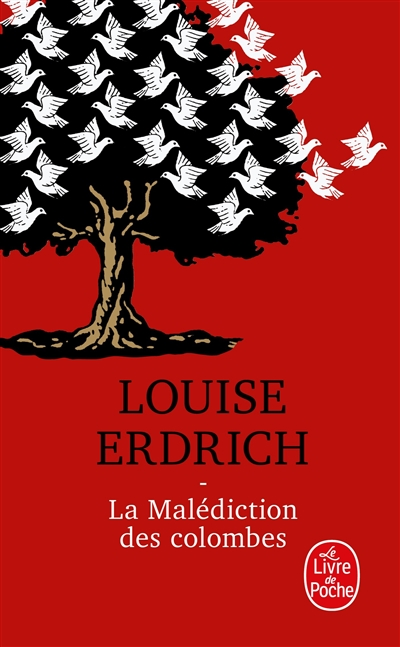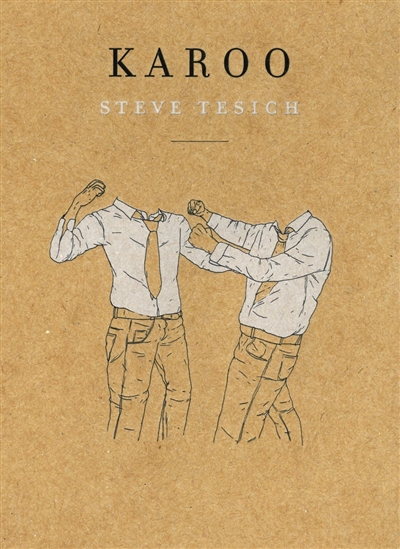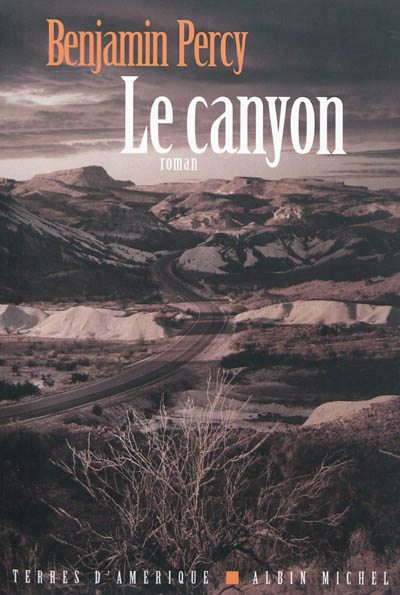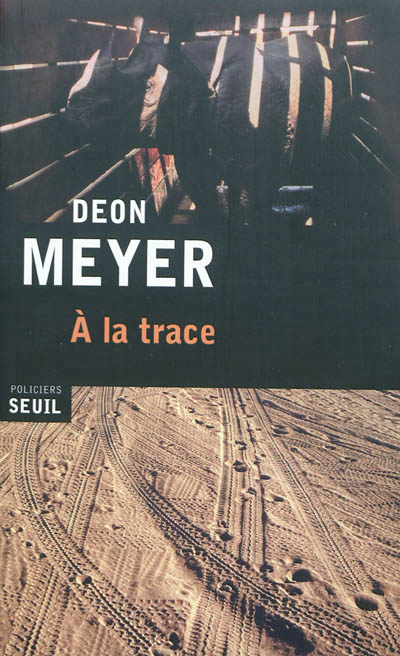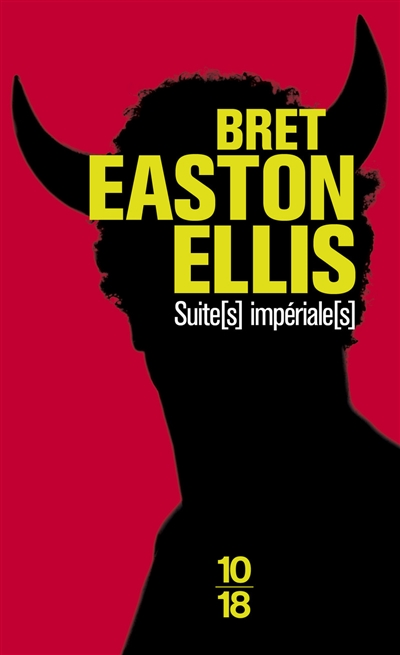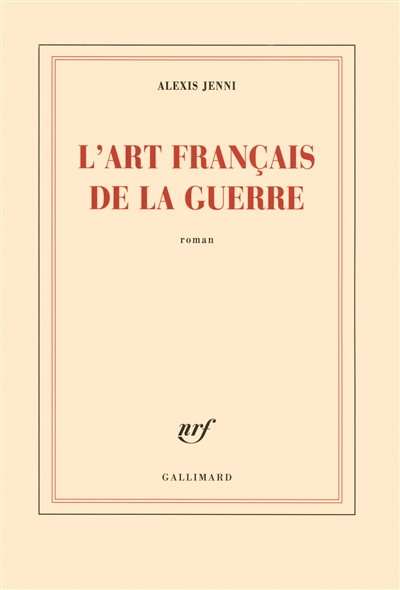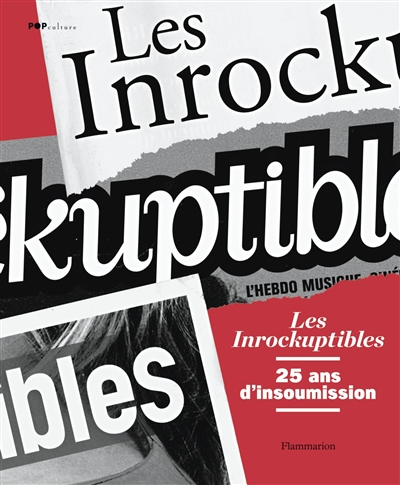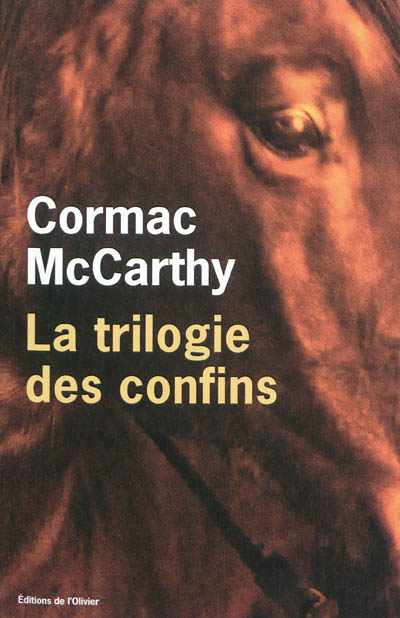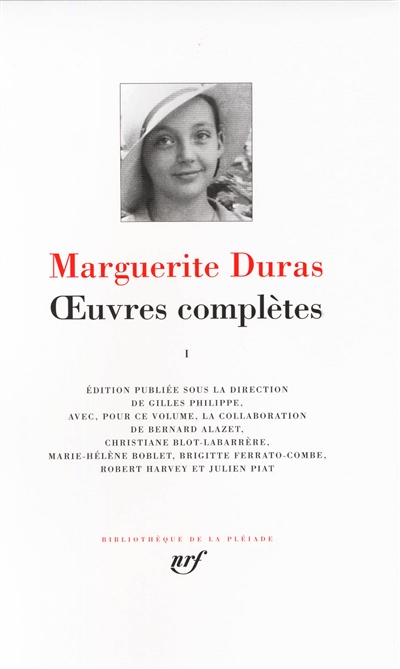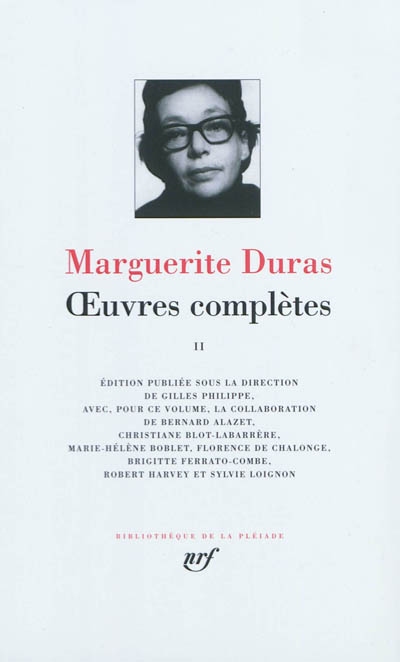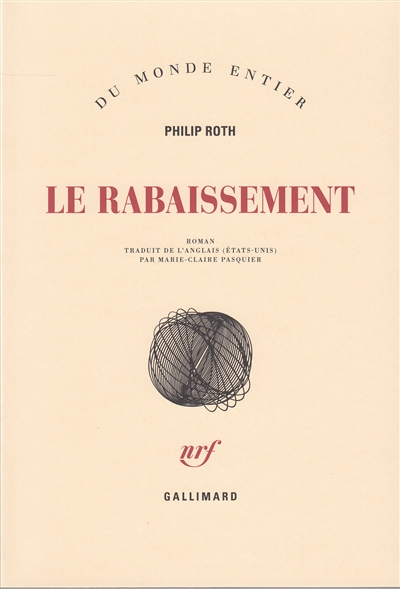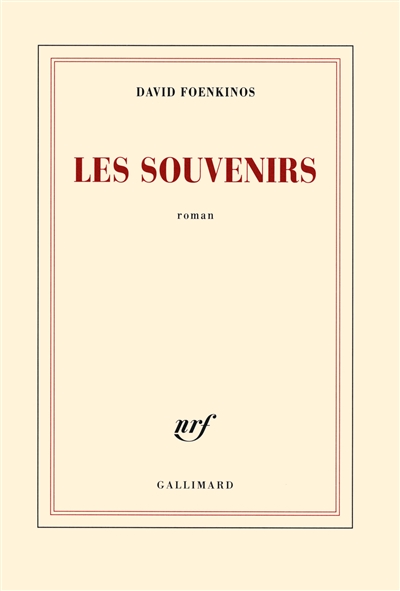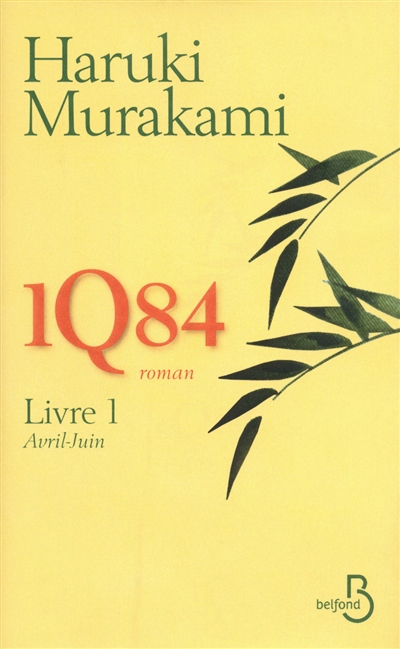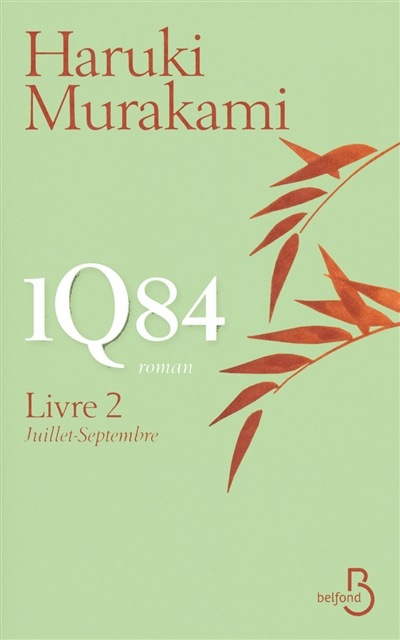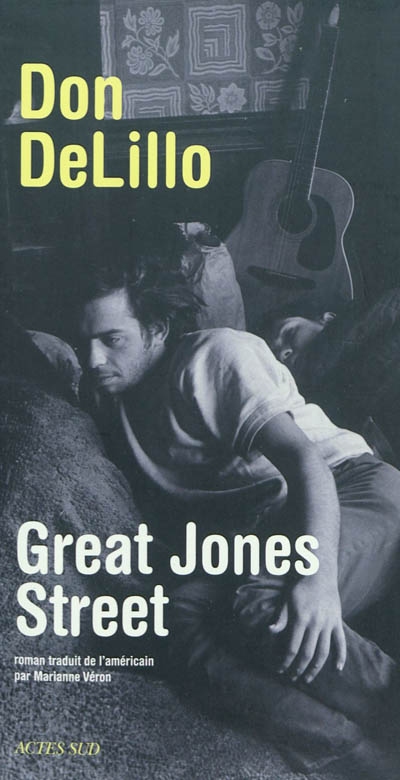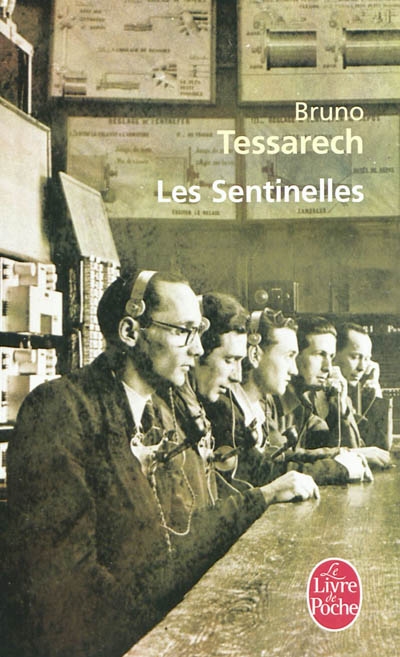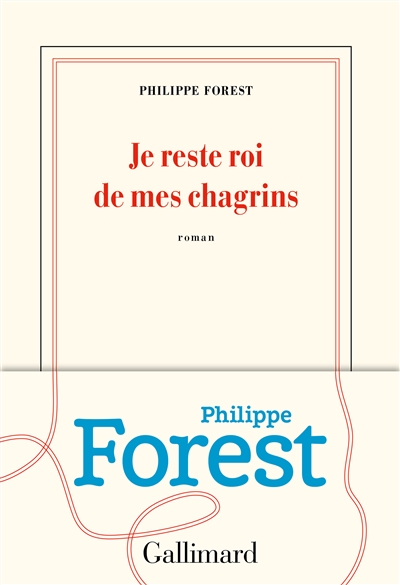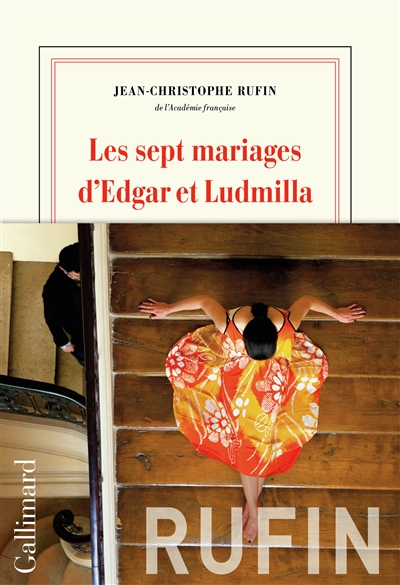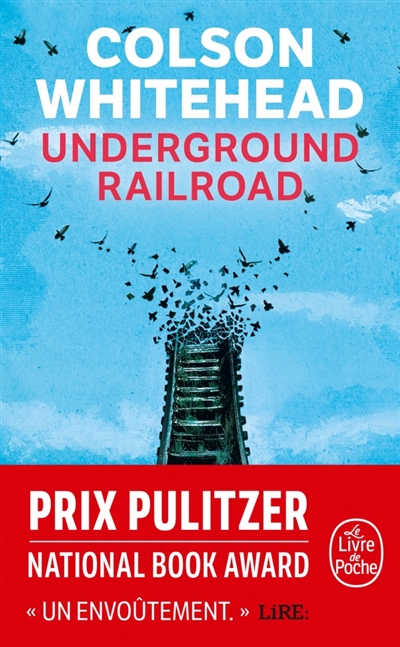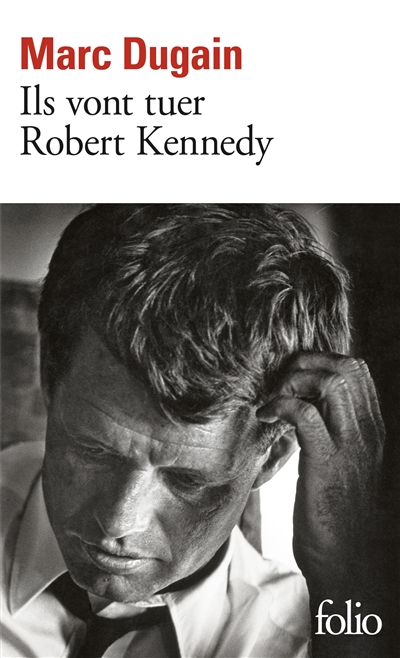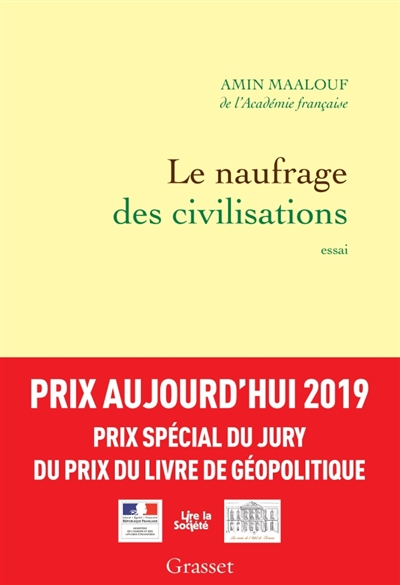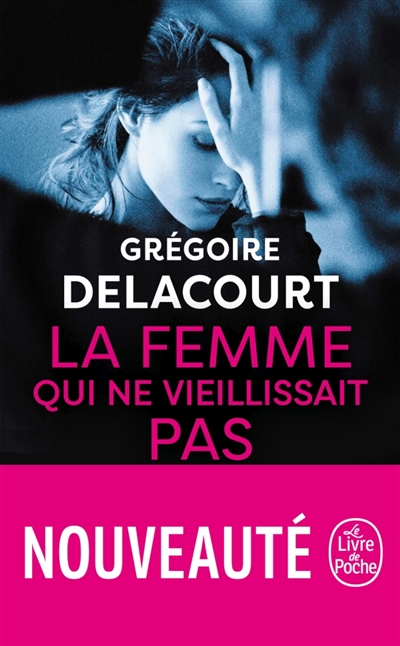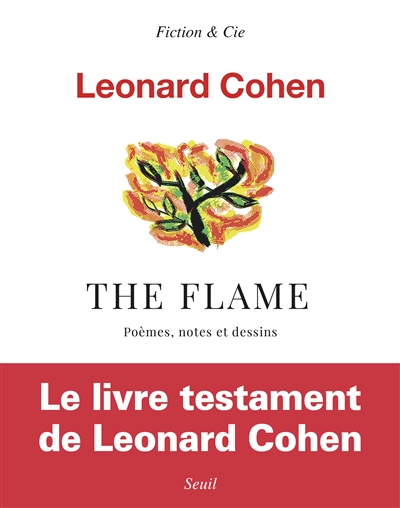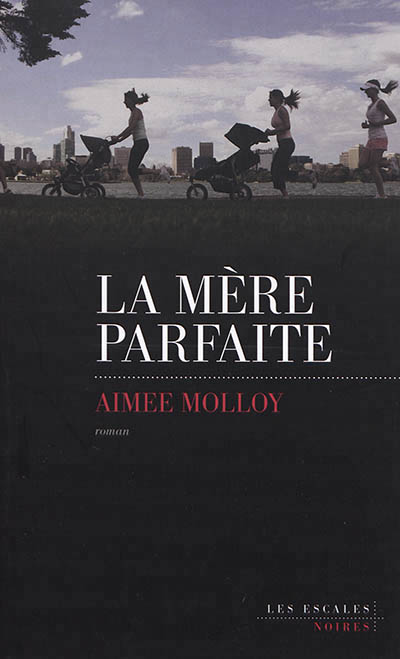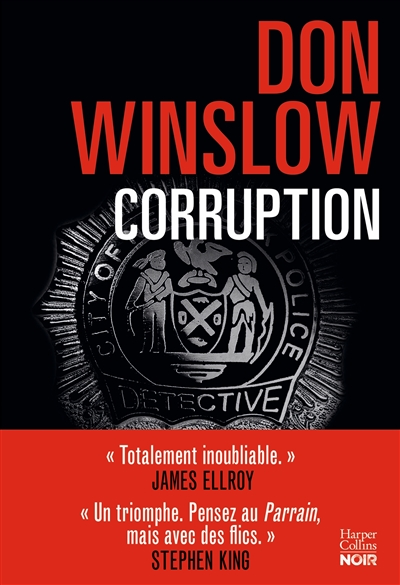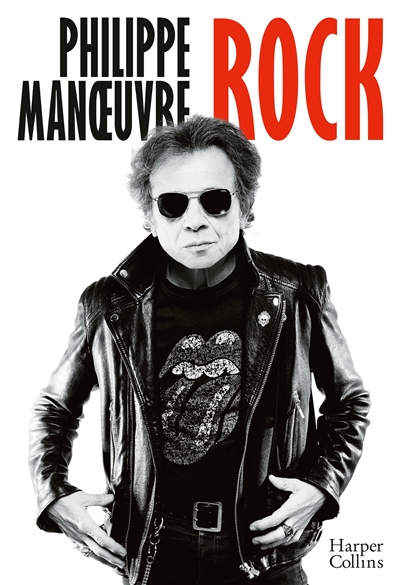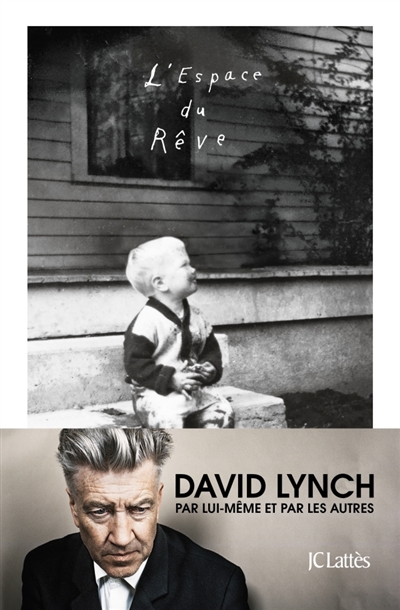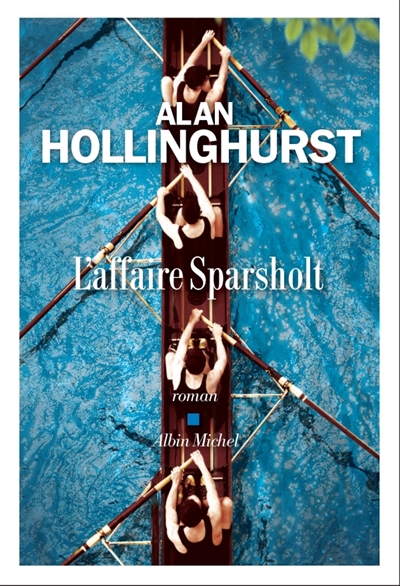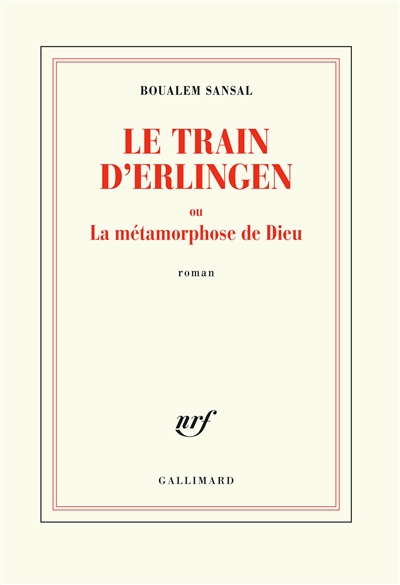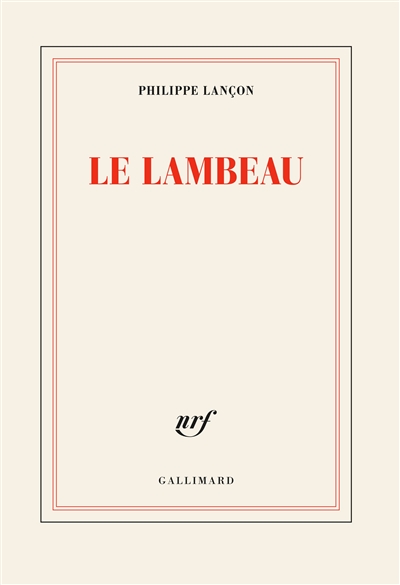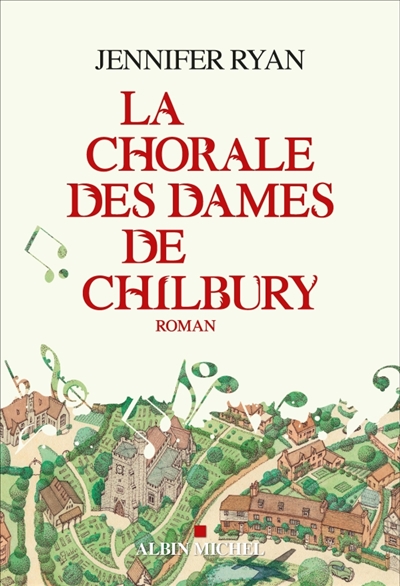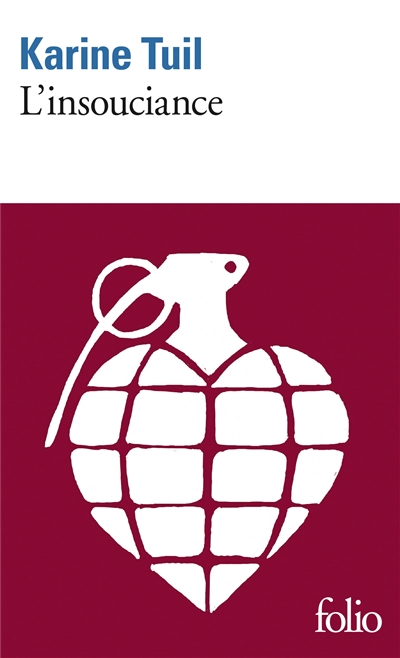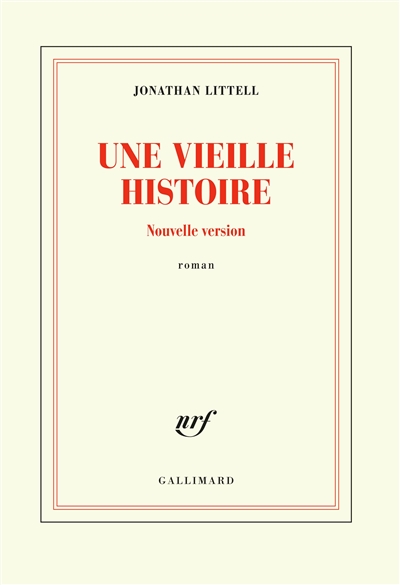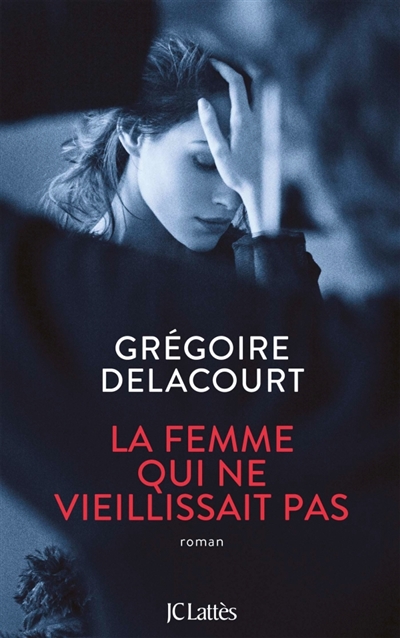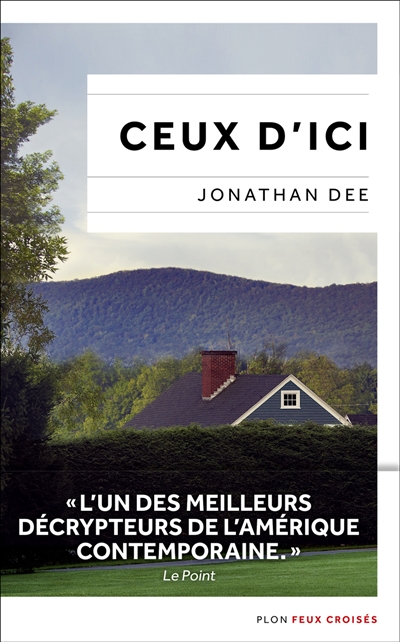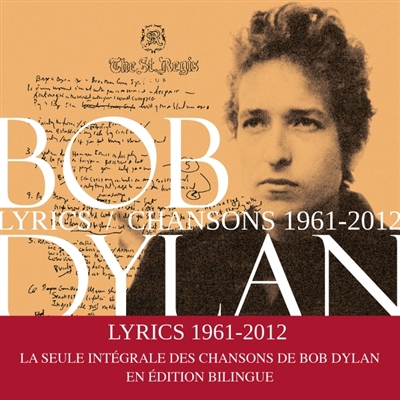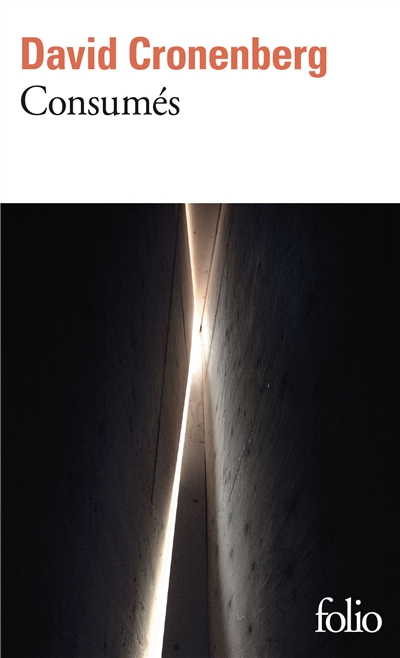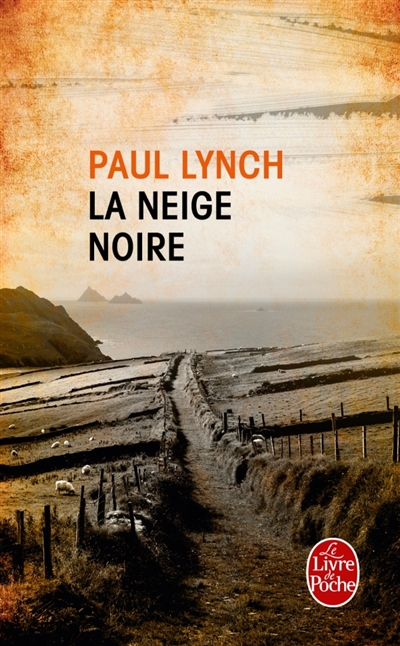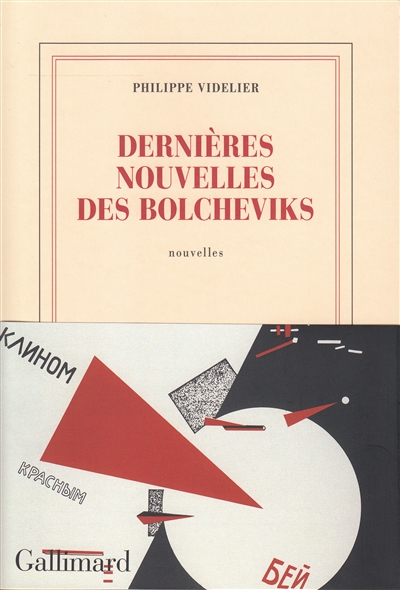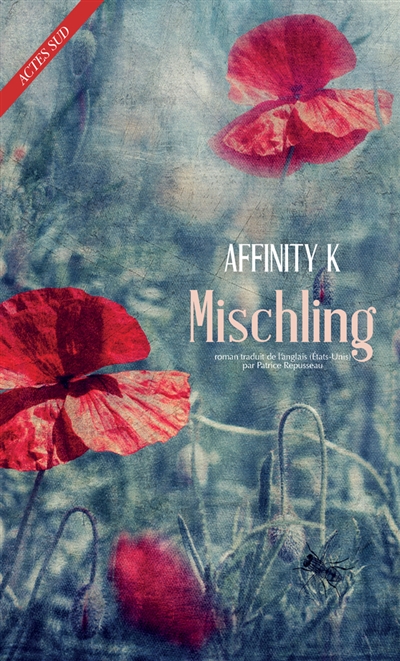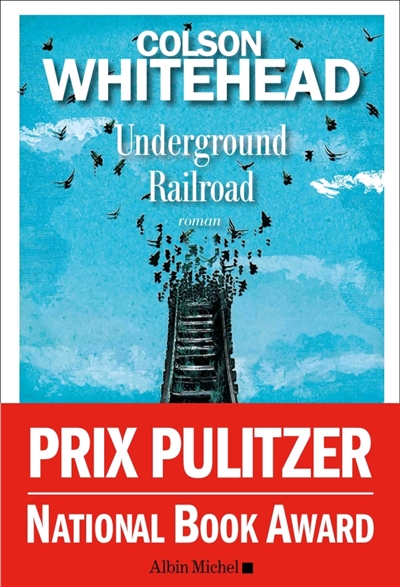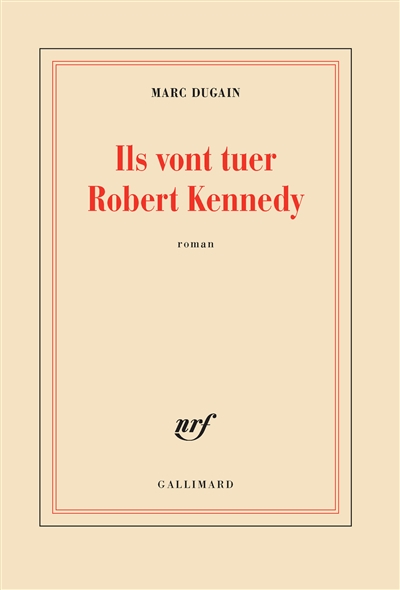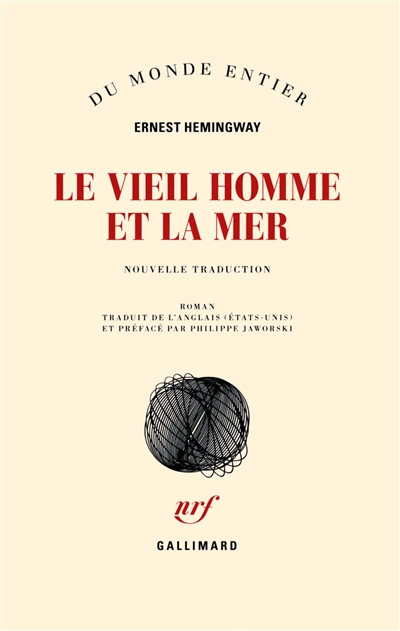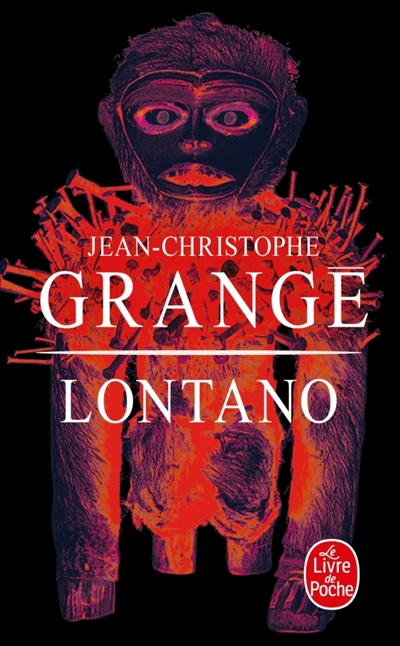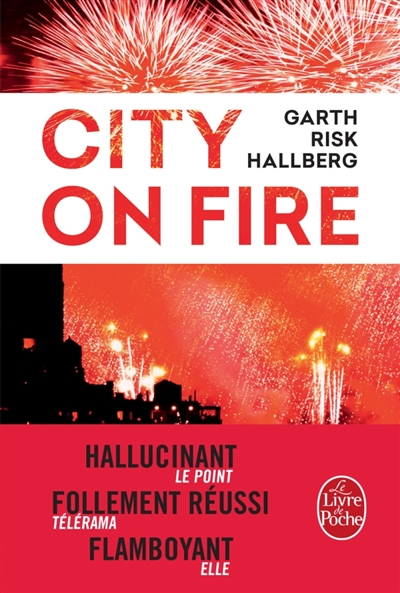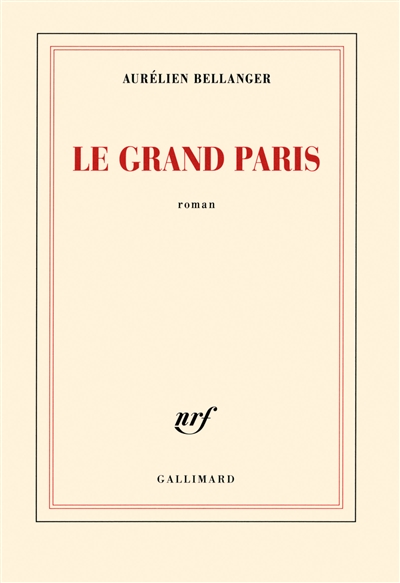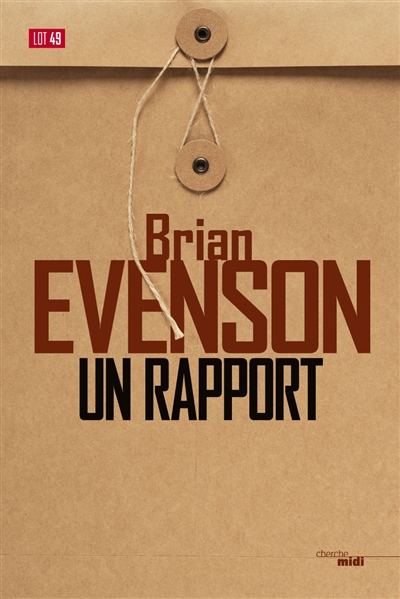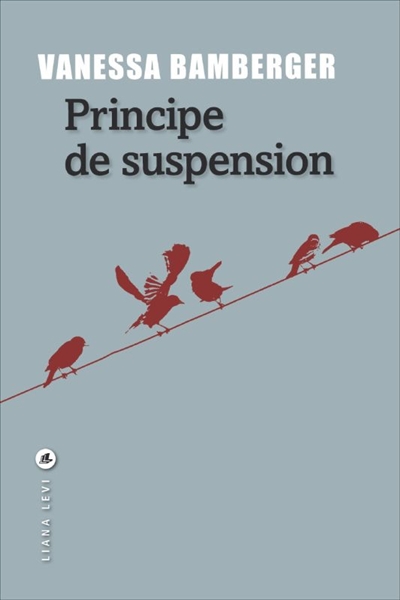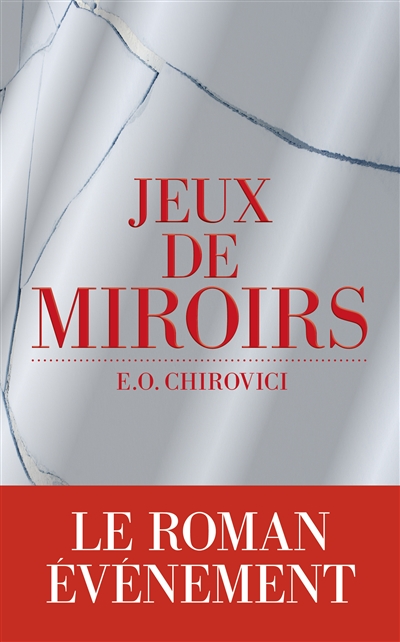Littérature étrangère
Sofi Oksanen
Norma

-
Sofi Oksanen
Norma
Traduit du finnois par Sébastien Cagnoli
Stock
15/03/2017
385 pages, 22 €
-
Chronique de
Stanislas Rigot
Librairie Lamartine (Paris) -
❤ Lu et conseillé par
5 libraire(s)
- Nathalie Iris de Mots en marge (La Garenne-Colombes)
- Annie Maubourguet de Le Jardin des lettres (Andernos-les-Bains)
- Valérie Ohanian de Masséna (Nice)
- Claire Lallement
- Pascale Bragard de Anagramme (Sèvres)

✒ Stanislas Rigot
(Librairie Lamartine, Paris)
Sofi Oksanen revient avec Norma, cinquième roman d’une œuvre que le succès de Purge (Le Livre de Poche) a mis mondialement en lumière. Dans ce récit aux multiples entrées (suspens aux relents policier, saga familiale, touches de fantastique), elle s’attaque aux travers d’une société malade de son insatiable quête de beauté physique.
Norma Norma a un rapport plus que particulier à ses cheveux qui poussent tellement vite qu’elle est obligée de les couper plusieurs fois par jour. Elle vient par ailleurs de perdre la seule personne qui comptait pour elle : sa mère. Celle-ci s’est mystérieusement suicidée en se jetant sous une rame du métro d’Helsinki. Norma est d’autant plus désemparée qu’elle est une fois de plus sur le point de perdre son emploi. Abordée à l’enterrement par un homme qui se prétend être un vieil ami de sa mère, surveillée à son insu, notamment par une certaine Marion qui semble en savoir beaucoup sur elle, elle cherche des explications qui l’amènent au salon de coiffure où travaillait sa mère, salon où travaille Marion… Se jouant des codes des littératures dites de genre, leur empruntant ici l’ambiance, là la tension, là la profondeur de champ, Sofia Oksanen délivre un roman acéré où l’argent, le corps, l’envie, la beauté se conjuguent tragiquement sur fond d’exploitation de la femme. Les nouvelles donnes d’une vieille malédiction.
PAGE — Norma est un roman dense, superposant plusieurs motifs. Quel a été le déclic de son écriture ?
Sofi Oksanen — Cela remonte à loin. À l’âge de six ans, pour Noël, j’ai reçu comme cadeau un livre sur la légende de Raiponce et j’ai été fascinée par cette histoire. À cette époque, à la maison, je ne disposais que de livres soviétiques : vous imaginez bien que l’on n’y trouvait ni princesse ni chevalier, mais plutôt des cosmonautes ou des leçons « d’éducation ». Raiponce a été mon premier livre finnois et me proposait quelque chose de radicalement différent qui m’a beaucoup marquée. Puis en 2011, je me suis intéressée à un procès qui traitait d’une affaire de trafic humain. Les accusés étaient des propriétaires de salons spécialisés dans la pose de faux ongles. Il y avait beaucoup de salons de ce type à cette époque, aux services très bon marché. Ce couple se servait de leur personnel comme d’esclaves. Ces femmes d’origine thaïlandaises, vietnamiennes se voyaient dès leur arrivée privées de leur passeport et devaient travailler pour rembourser leur voyage. Isolées, ne parlant pas finnois, ne connaissant pas leurs droits, elles restaient prisonnières. Et cela se passait chez moi, dans mon quartier. Ce fut pour moi un contact violent avec les trafics autour du commerce de la beauté et les dérives de celui-ci. La malheureuse originalité de cette affaire est qu’elle ne tournait pas autour du sexe, qu’il ne s’agissait pas de prostitution. Enfin, en 2013, en rentrant à la maison, je me suis retrouvée avec un peu de temps libre. J’ai donc décidé de m’amuser un peu et je me suis mise à écrire une nouvelle dont le sujet serait une version postmoderne de Raiponce. Prenant beaucoup de plaisir à écrire cette histoire, mon texte a rapidement pris de l’ampleur et logiquement, j’ai décidé d’en faire un roman.
P. — L’histoire au cœur du livre, le récit principal, est racontée par deux voix, celle de Norma, mais aussi, de manière plus surprenante, celle de Marion. Pourquoi ce choix ?
S. O. — Norma est bien évidemment venue en premier dans l’écriture mais je me suis vite rendu compte que j’avais besoin d’un point de vue extérieur à son histoire. C’est ainsi que Marion, impliquée à sa manière dans le trafic, est apparue. Ensuite, j’ai amené Anita, la mère de Norma, elle aussi impliquée et qui, dans la première version du roman, était bien vivante. J’ai pu ainsi développer l’histoire sur plusieurs générations, évoquant le rapport parent/enfant autour de cette question « biologique » et la manière dont cela pouvait les affecter. De plus, cela m’a permis de ne pas mettre en scène un(e) client(e), ce que je voulais éviter.
P. — Vous construisez les différents récits en utilisant beaucoup l’ellipse. La première version de Norma était-elle un pavé ?
S. O. — Non, pas du tout. Pour moi, l’écriture est ma manière aussi bien de penser que de construire et les personnages et l’histoire ; et c’est dans l’écriture que j’ai bâti Norma de cette manière.
P. — Le roman emprunte à plusieurs genres.
S. O. — Je pioche dans tous les éléments qui me semblent convenir. Partir sur cette idée de Raiponce et de conte de fées m’a permis d’introduire de manière évidente un élément fantastique, un imaginaire magique, une ambiance et cela m’a permis de m’affranchir de l’aspect « roman contemporain », de me libérer : le naturalisme est une forme d’écriture à laquelle je suis opposée. Pour ce qui est de la dimension historique, c’est toujours plus compliqué car l’Histoire avec un grand H est un personnage assez effrayant et impose des limites que vous devez respecter. Et avec l’actualité tout peut arriver ! Ainsi, en 2014, la révolution en Ukraine m’a posé un problème : mon sujet était les cheveux et non la guerre qui allait obligatoirement affecter le commerce ! J’ai donc dû décaler mon histoire en 2013 pour éviter de me confronter à cela. Cela fut facilité par le contexte d’alors : une population très pauvre, des salaires bas qui pouvaient aussi justifier les trafics.
P. — Bien qu’ancré en Finlande, Norma affiche aussi une dimension mondiale.
S. O. — Oui, même si là encore, comme je vous le disais précédemment, ce n’était pas quelque chose de prévu à l’origine, n’ayant pas d’idée en commençant le livre sur la manière dont les événements aller se dérouler, pas plus que sur la fin de l’histoire. Tout allait prendre place dans son ensemble. Les choses sont venues et le récit a gagné différents territoires.
P. — Peut-on dire qu’il s’agit d’un roman sombre ?
S. O. — C’est une question de point de vue. J’aime à penser que mes personnages sont des survivants, des personnages qui traversent des situations complexes. Ce sont des gens qui agissent et réagissent : ce n’est pas sombre d’essayer de changer votre manière d’être et de vivre. Et puis, c’est une question de sujet. Pour en revenir au trafic, si les gens ne sont pas sensibilisés, ils ne réagissent pas et s’ils ne réagissent pas, il n’y a aucune chance pour qu’on se décide à légiférer et à apporter une solution à ce problème. Le monde devient global et je pense que l’on ne parle pas assez de ce sujet qui tourne autour du marché de la beauté et du corps. Il n’y pas vraiment de statistiques en Finlande mais quand l’Estonie est devenue indépendante, de nombreux Finlandais sont allés là-bas pour soigner leurs dents – la chirurgie esthétique était aussi meilleur marché. Et ces mouvements sont la première étape du trafic. Quant aux traitements autour de la fertilité, ils sont très chers et les législations dans les différents pays sont très variables. Ce que j’essaie de faire, c’est créer des émotions sinon le lecteur s’ennuie. La littérature vous fait ressentir et je pense qu’il n’y a pas de meilleur moyen de rendre le monde meilleur que la fiction.
P. — Comment avez-vous travaillé vos sources ?
S. O. — J’ai travaillé sur beaucoup de documents, notamment avec les communautés sur Internet (les Américains sont en pointe sur les différents aspects du sujet). J’ai aussi utilisé les reportages des journalistes infiltrés.
P. — Que représentent les cheveux pour vous ?
S. O. — Les cheveux m’ont toujours fascinée. L’histoire des cheveux se confond avec l’histoire de la société, l’histoire des femmes. S’y ajoute une dimension mystérieuse, magique (les différentes symboliques). Ainsi l’histoire de ces Amérindiens engagés dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. L’armée avait besoin de pisteurs et ils étaient considérés comme les meilleurs. Seulement, à leur arrivée à l’armée, on leur a rasé les cheveux comme à tout le monde et un grand nombre d’entre eux ont perdu leur don pour pister. Il n’y a aucune explication scientifique mais c’était comme s’ils avaient perdu leur identité avec leurs cheveux. Je pense que dans notre monde industrialisé, urbanisé, nous avons perdu notre sensibilité et notamment notre capacité à lire nos cheveux.