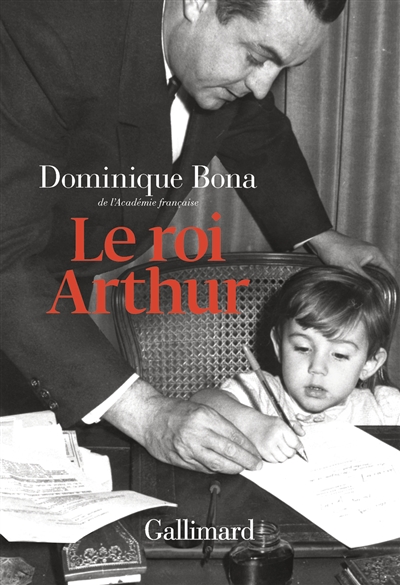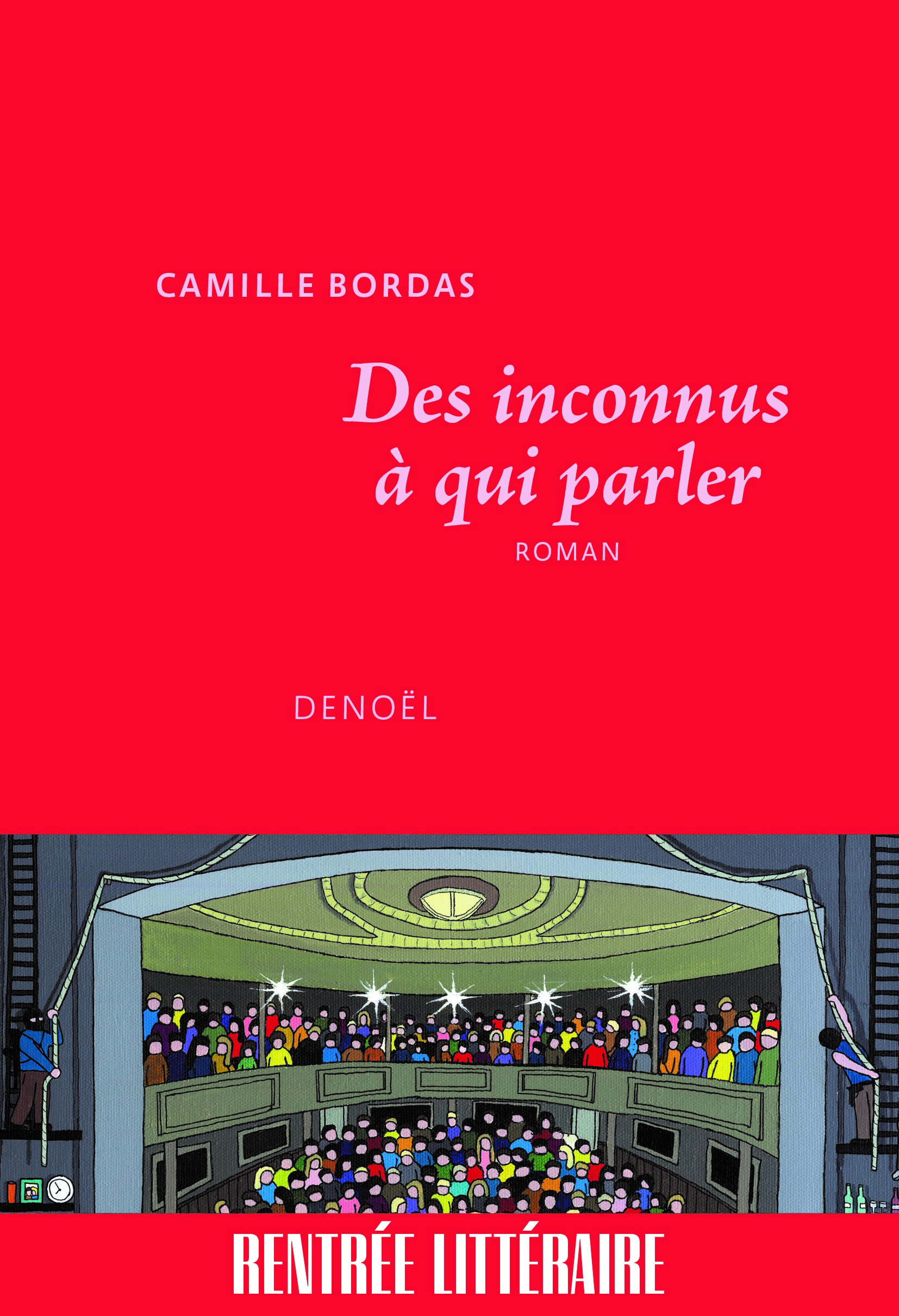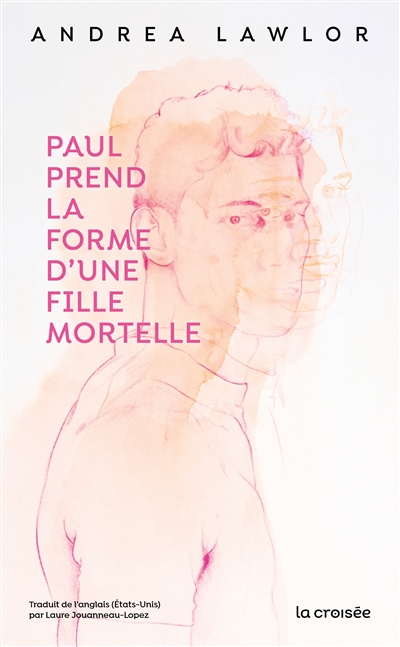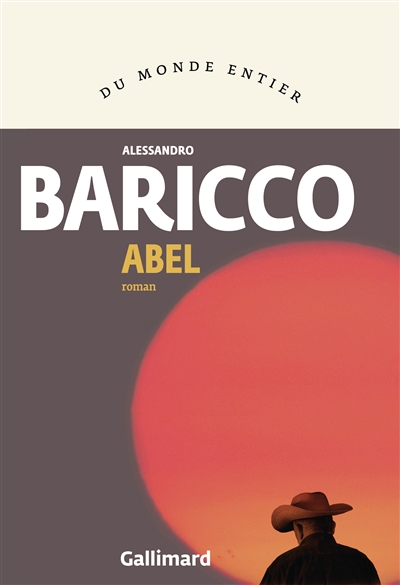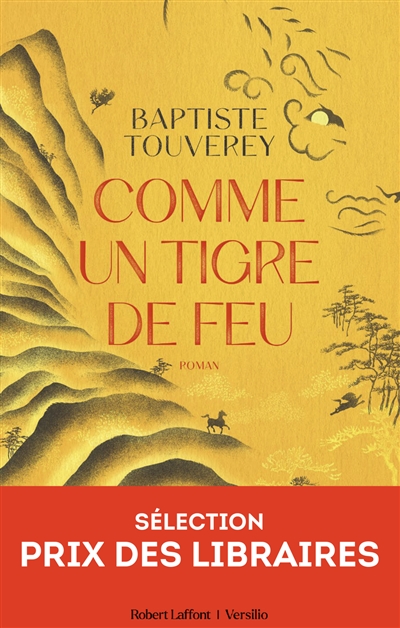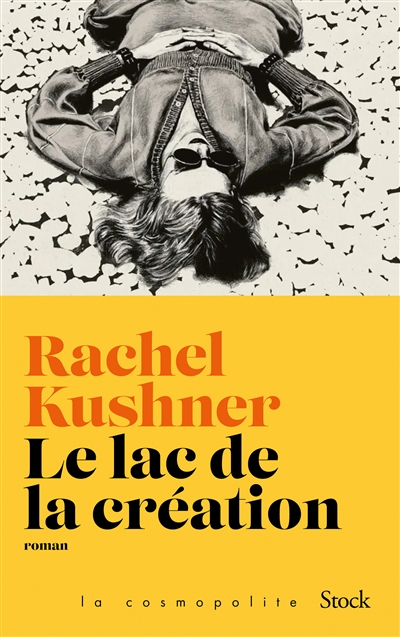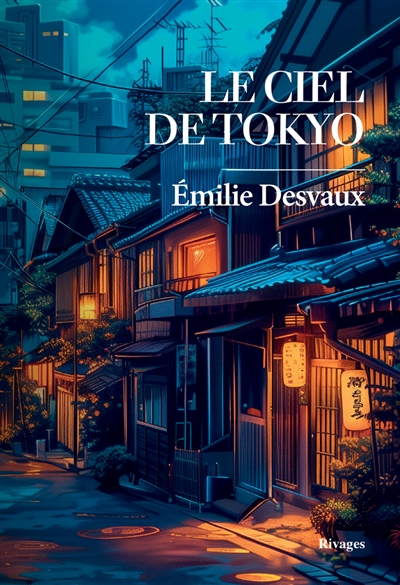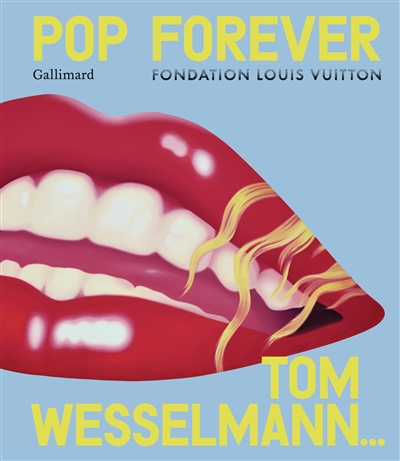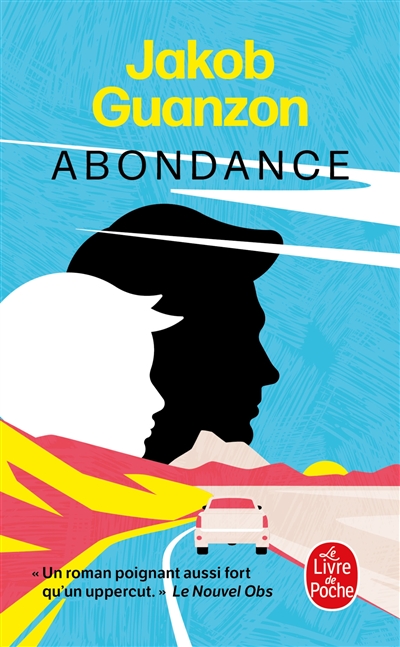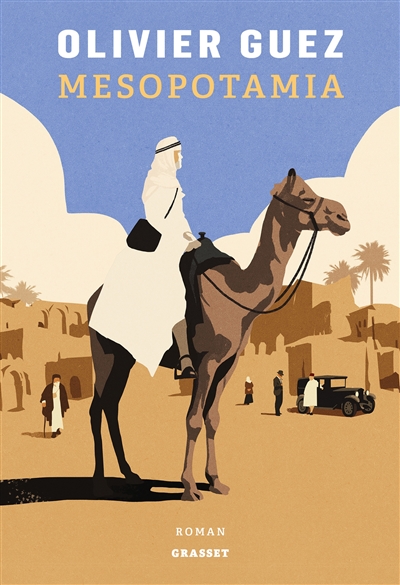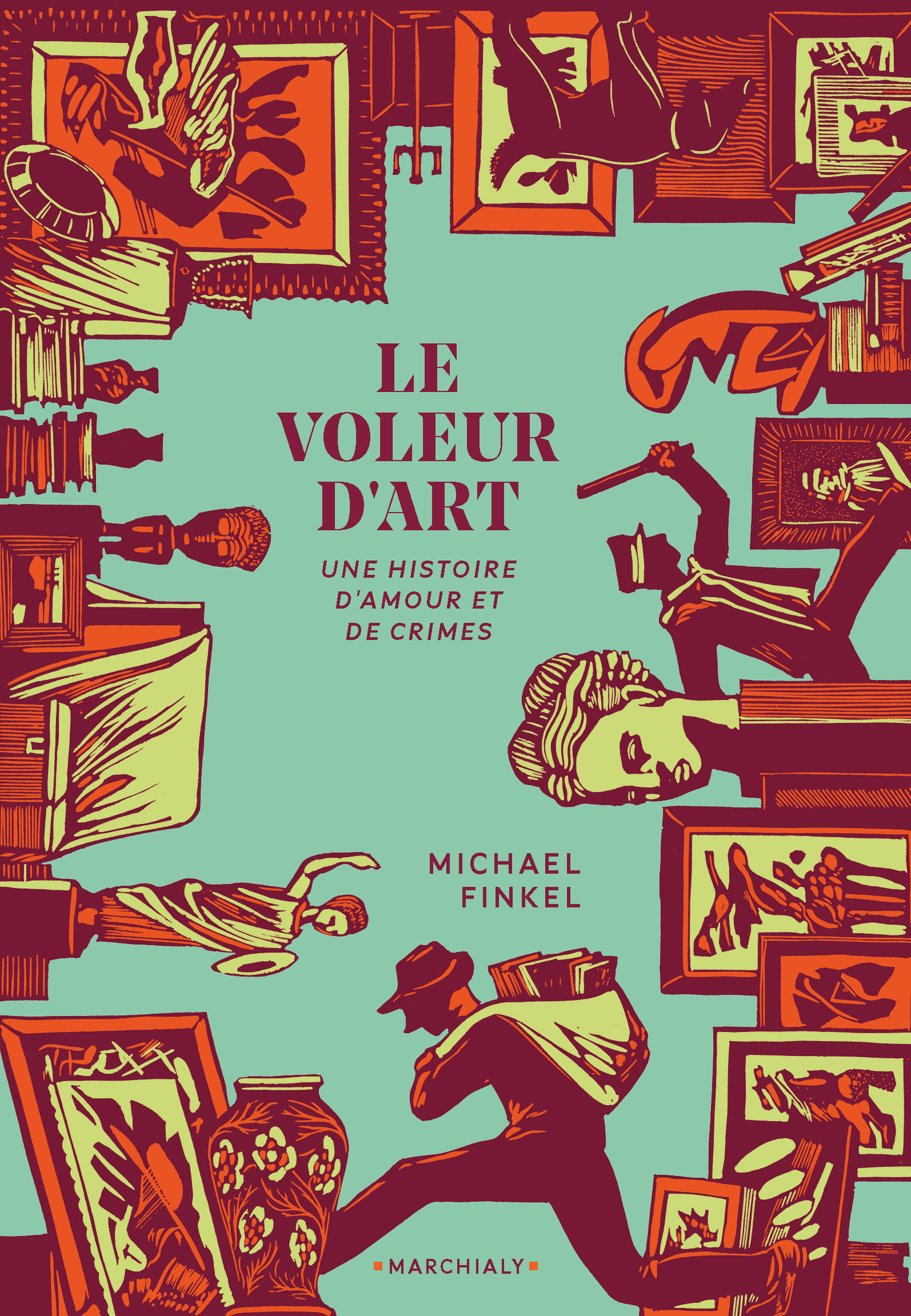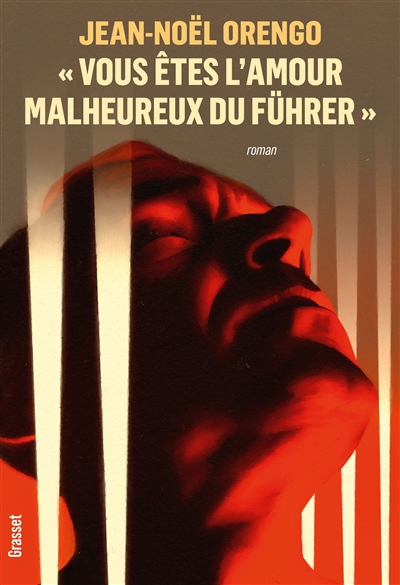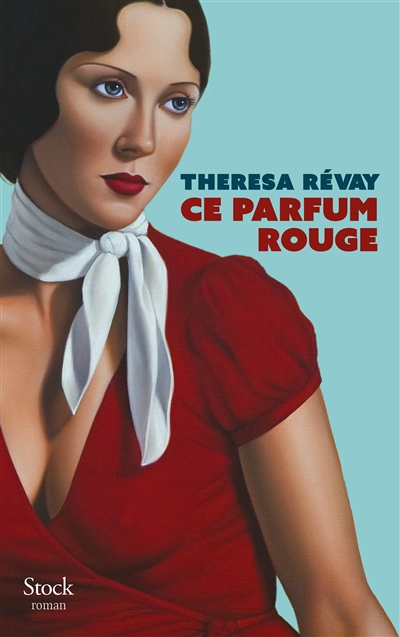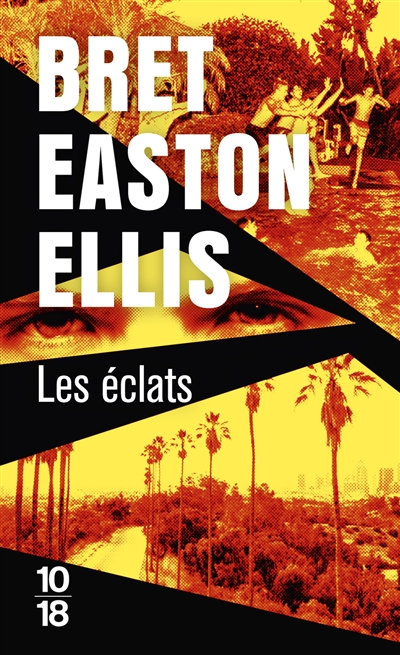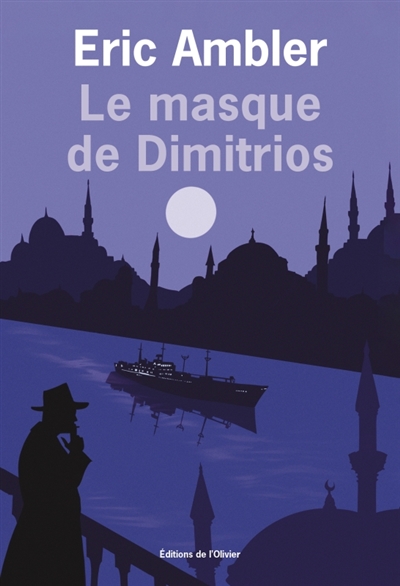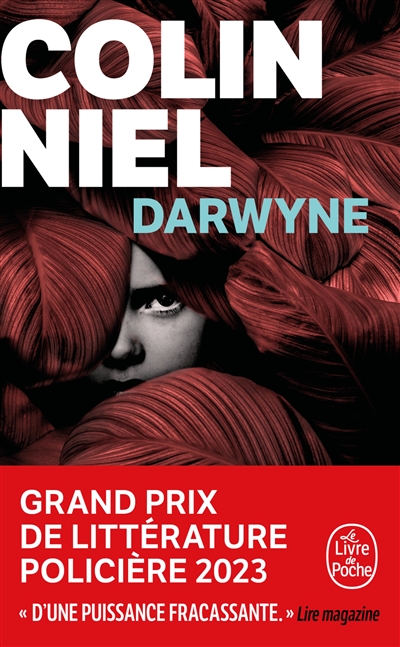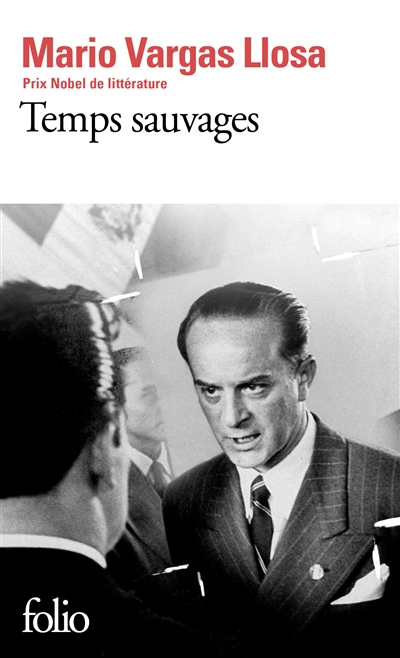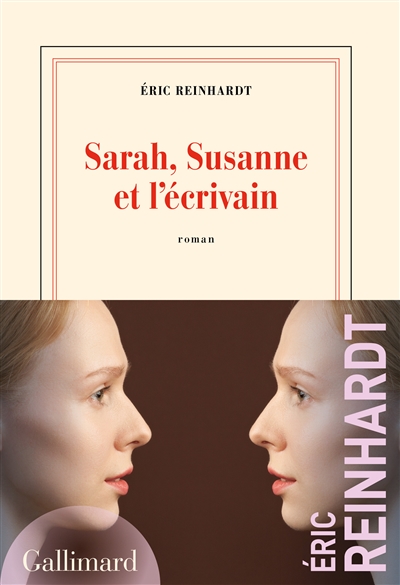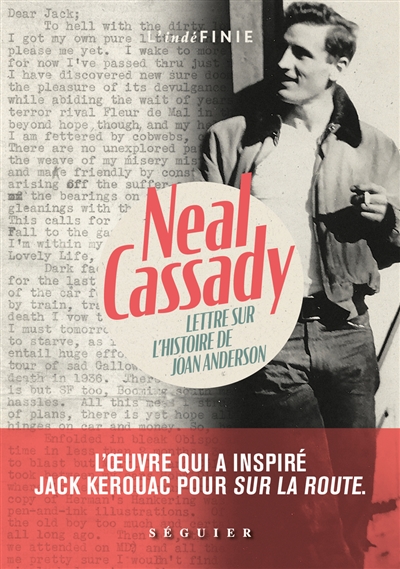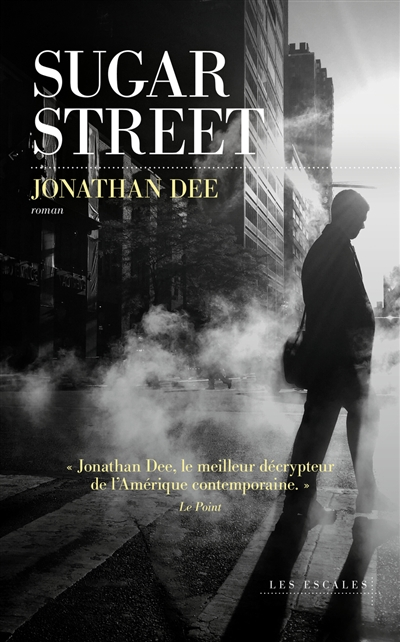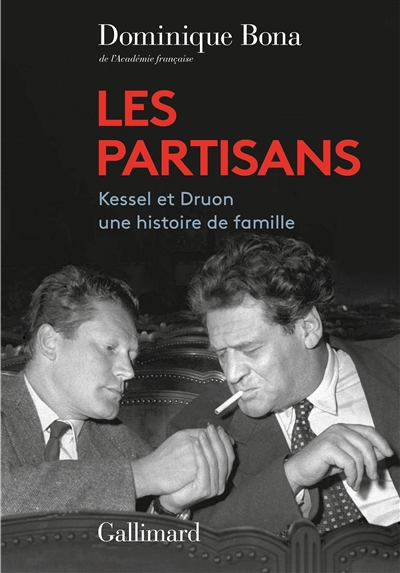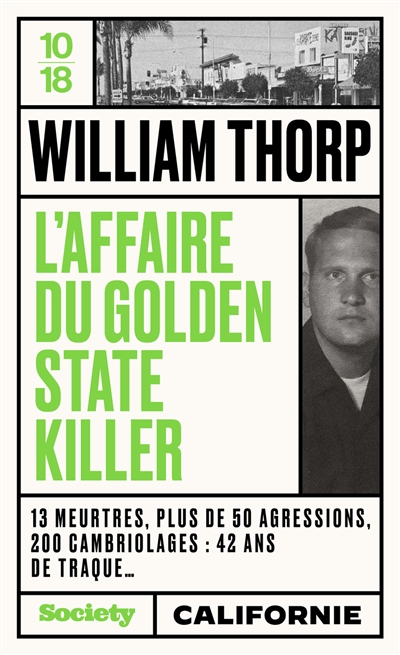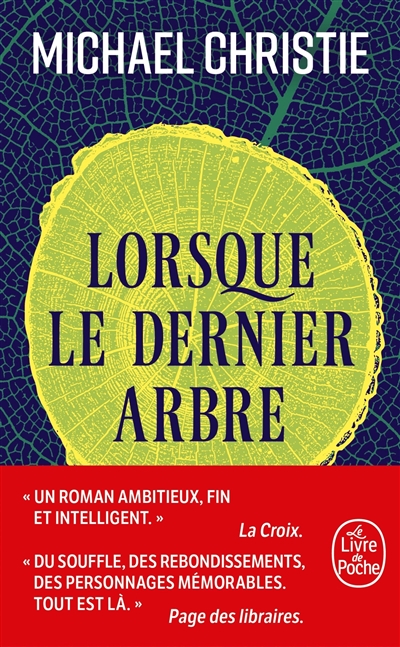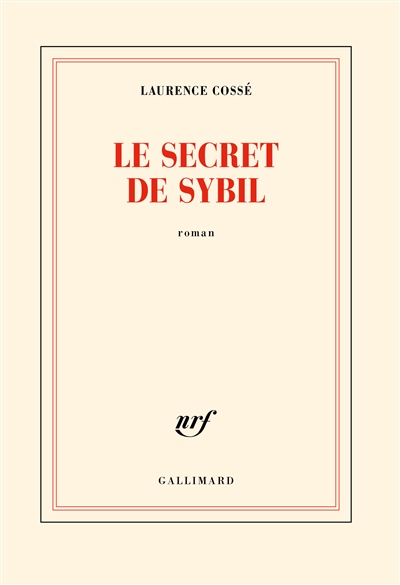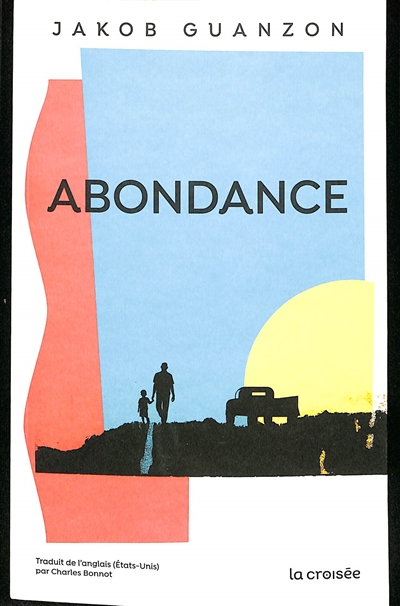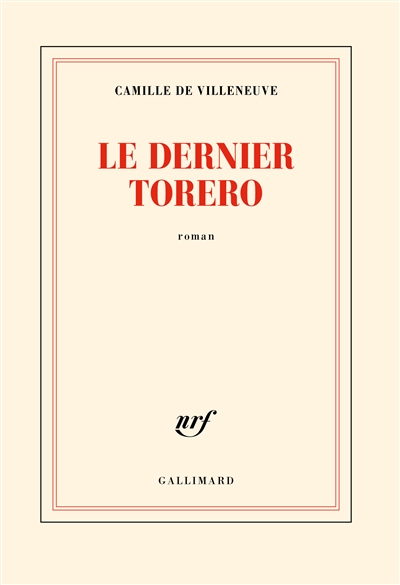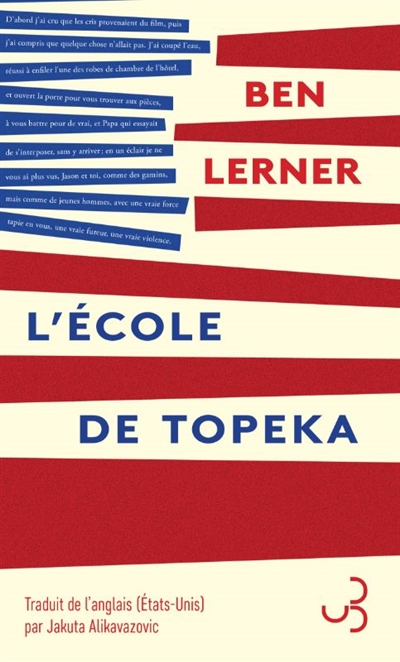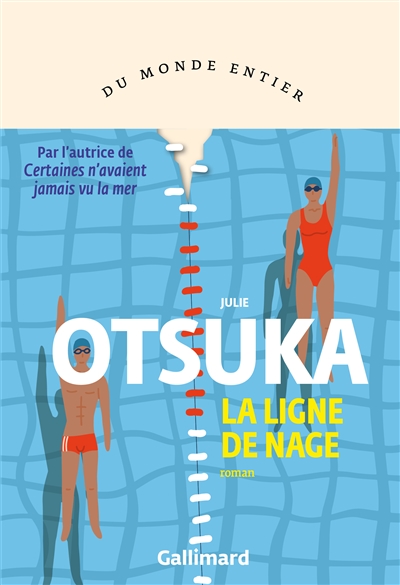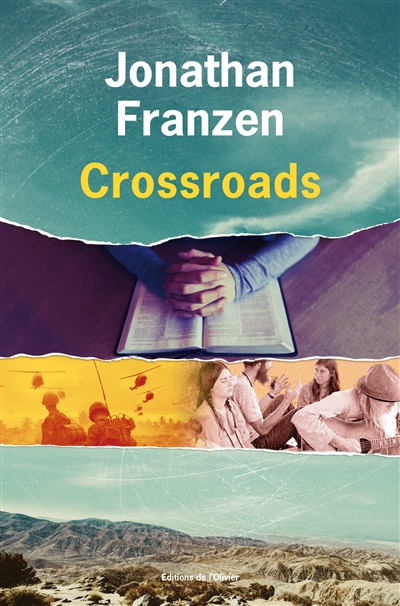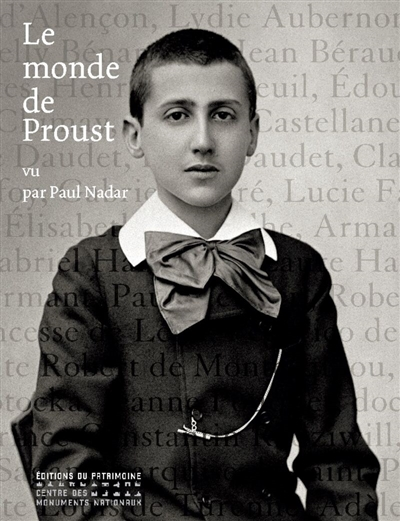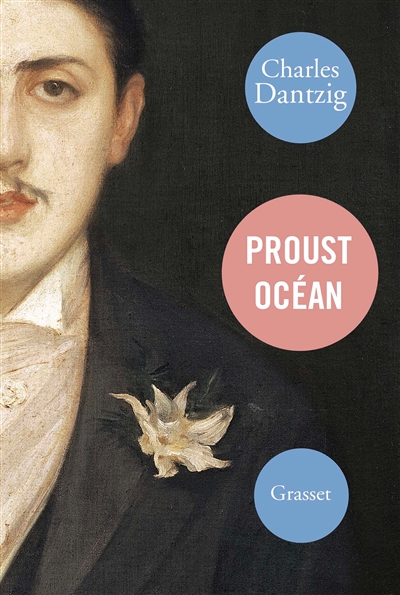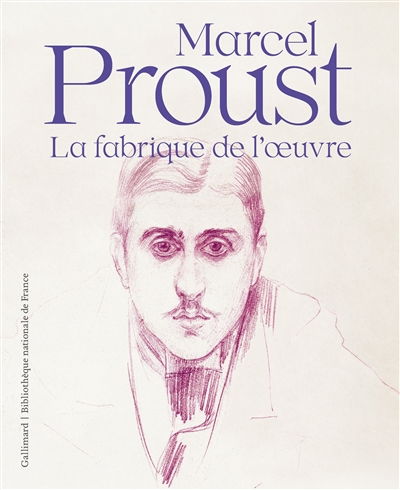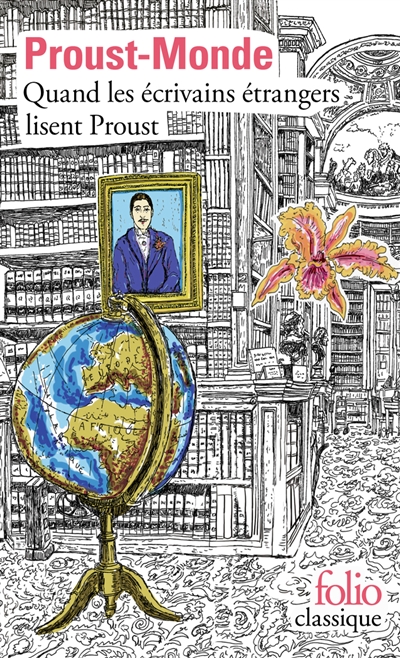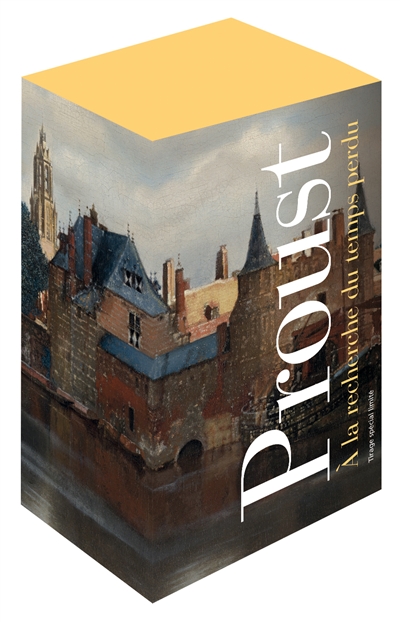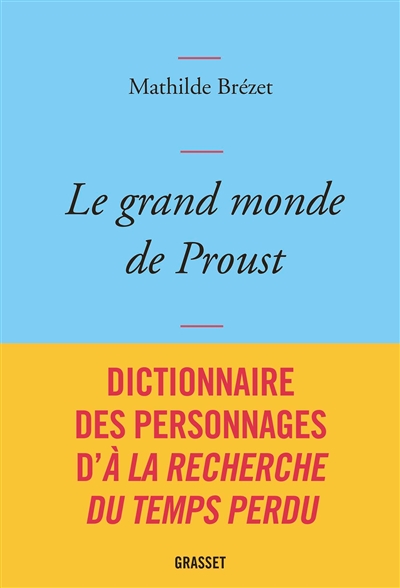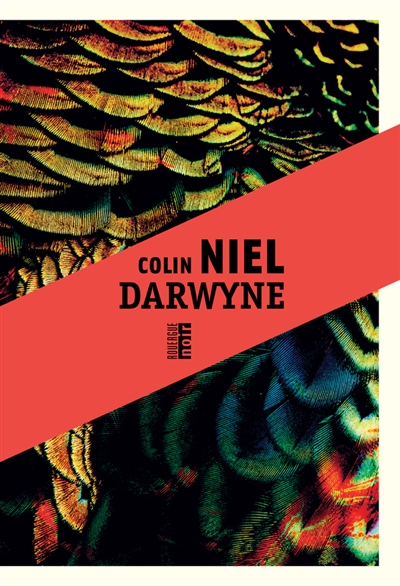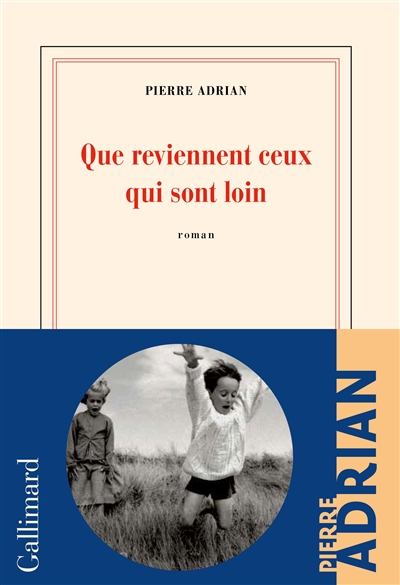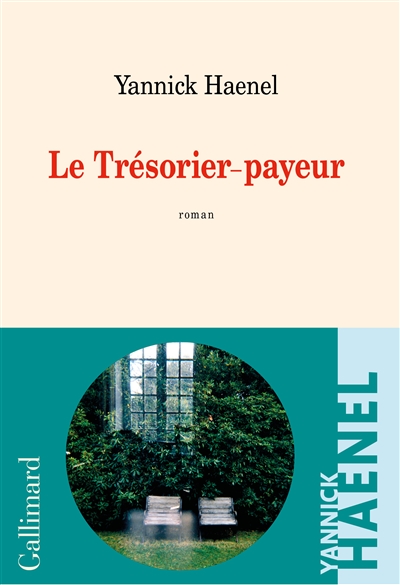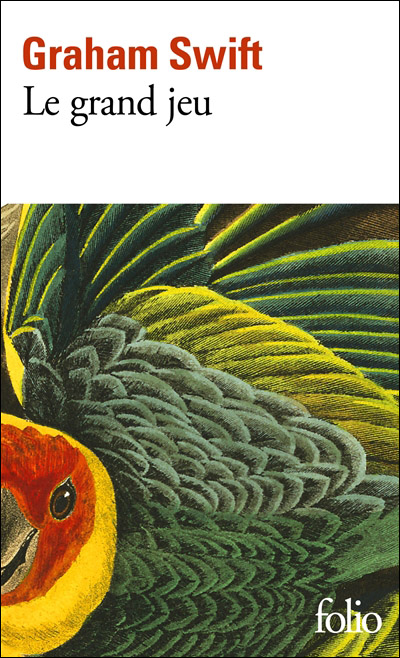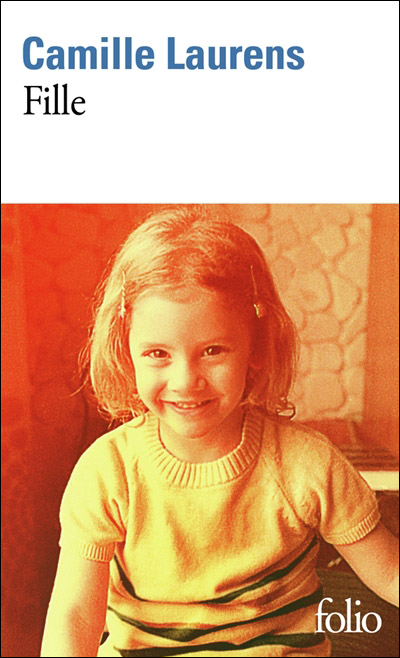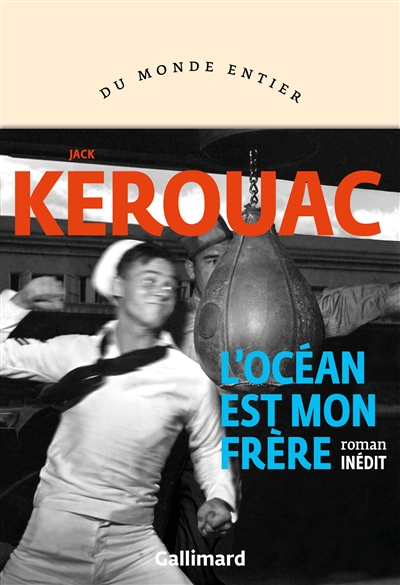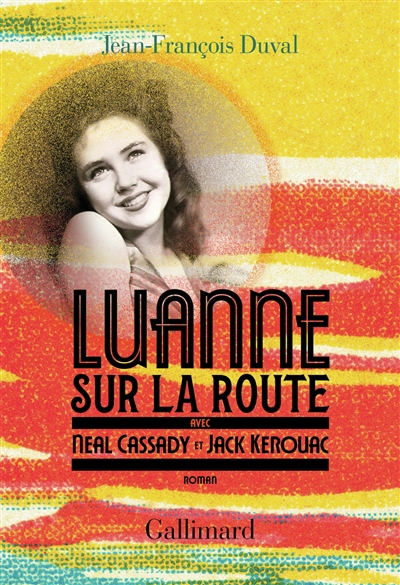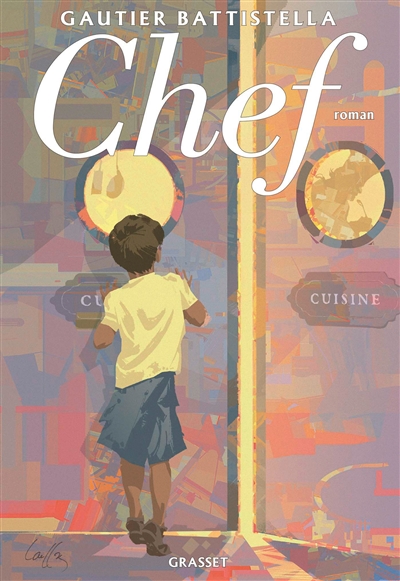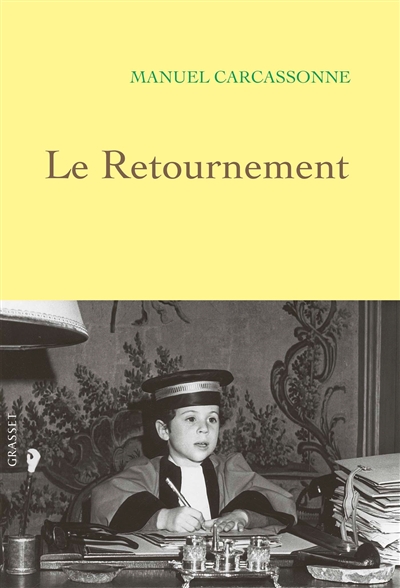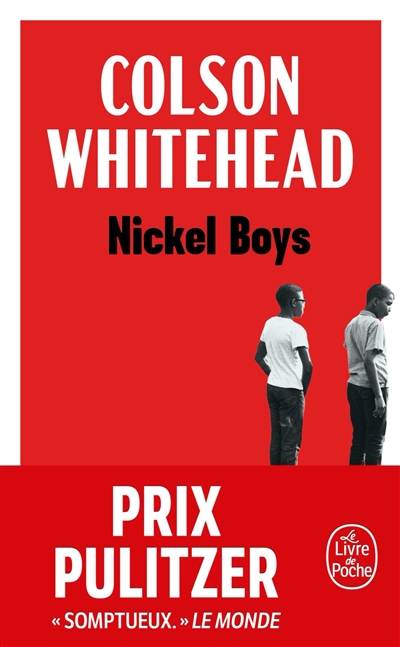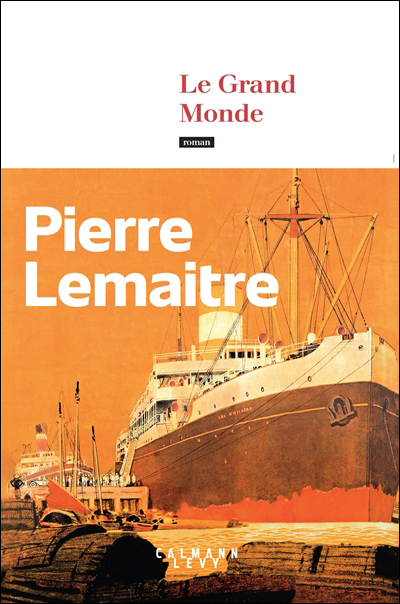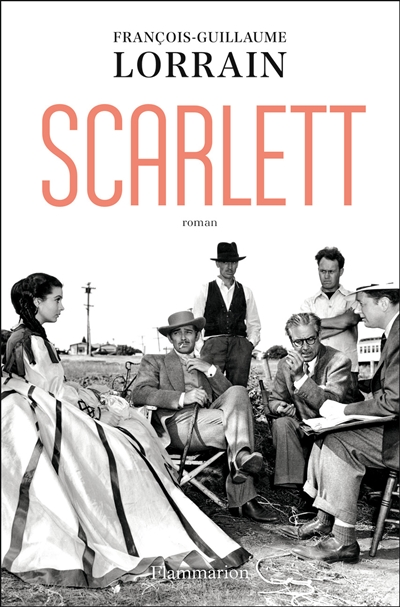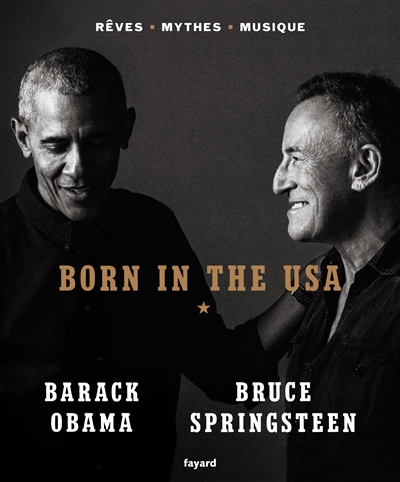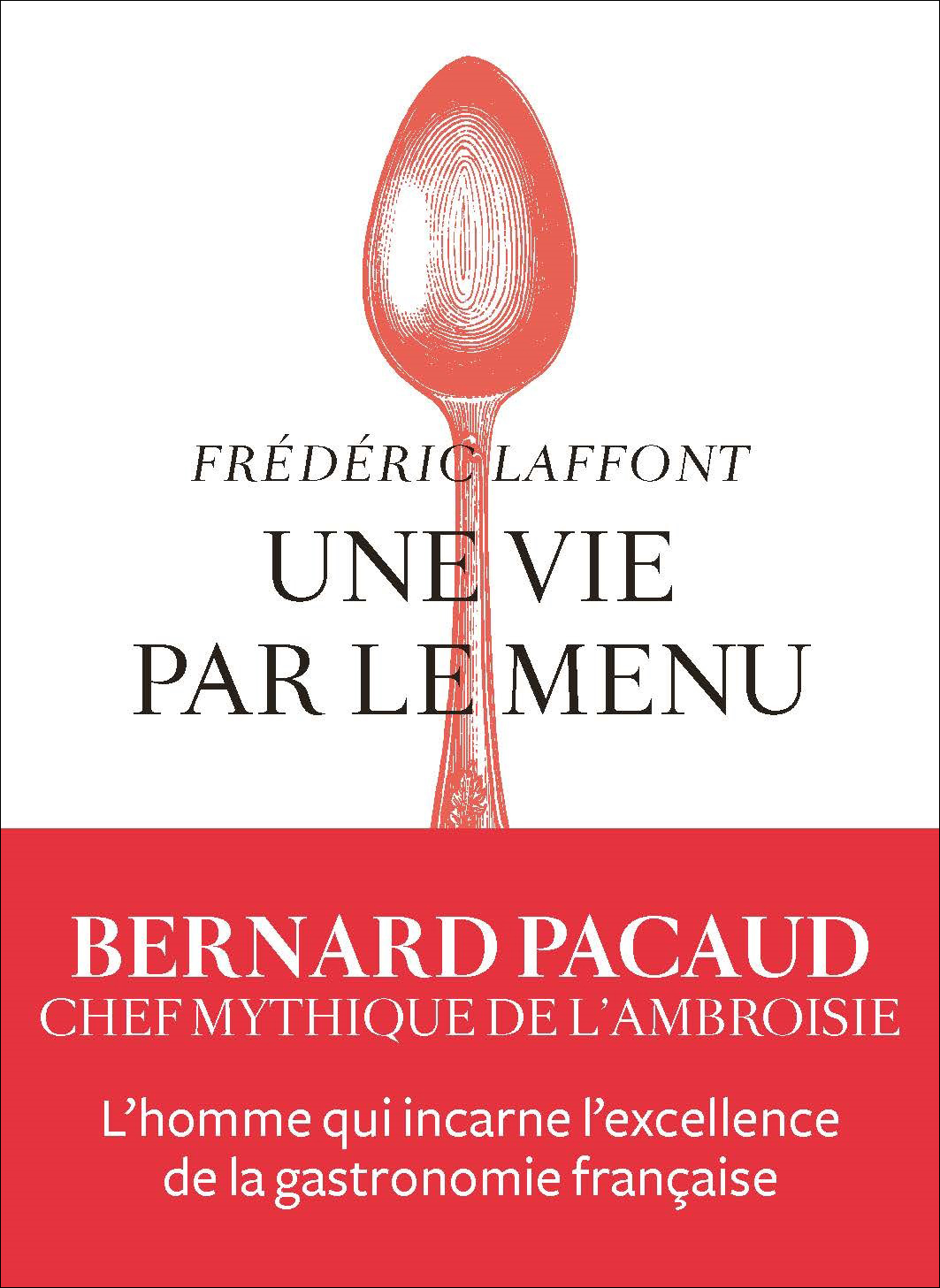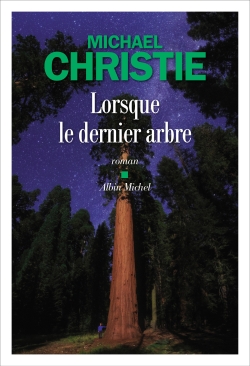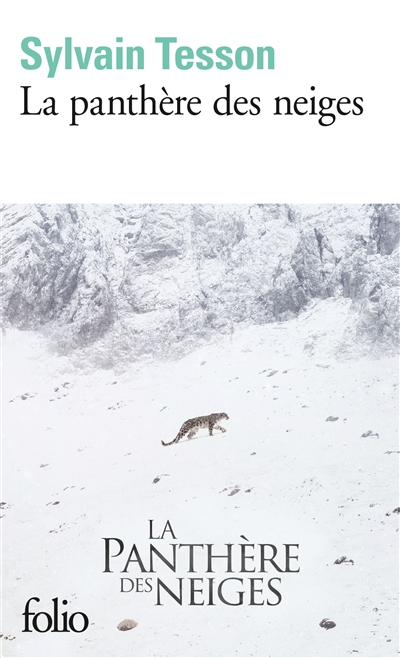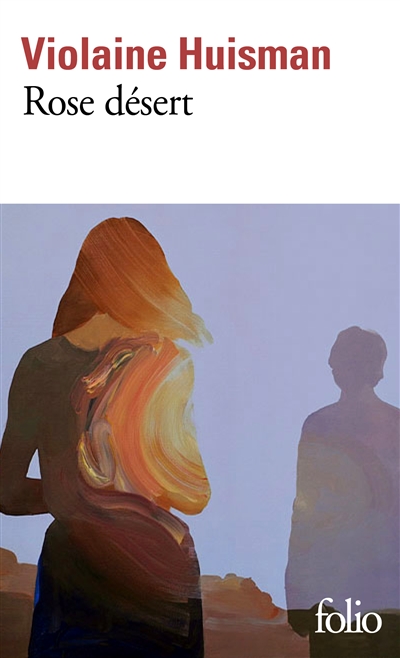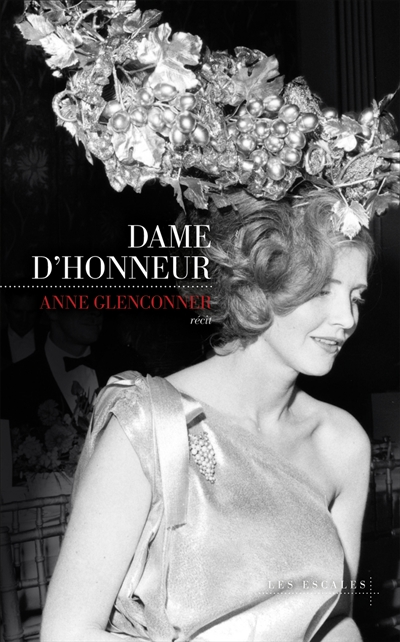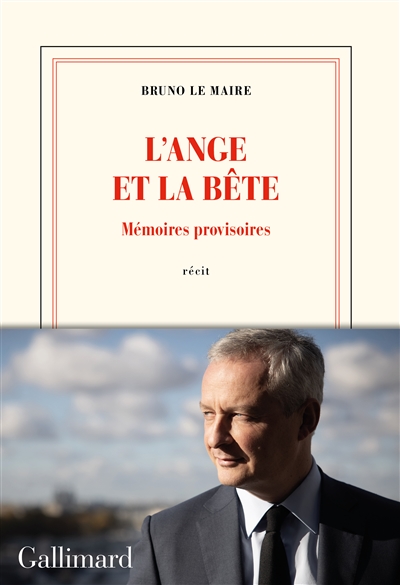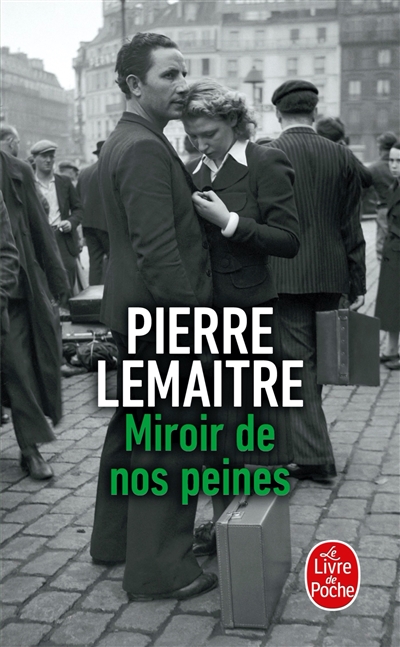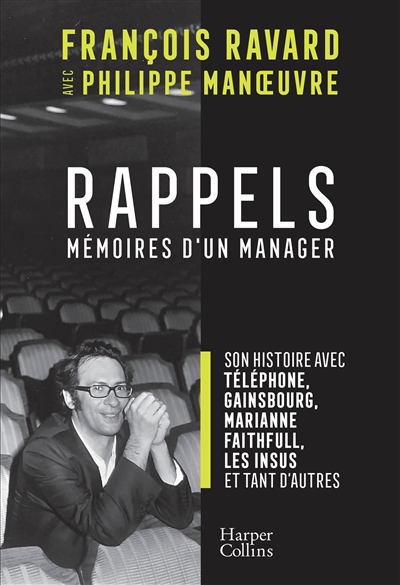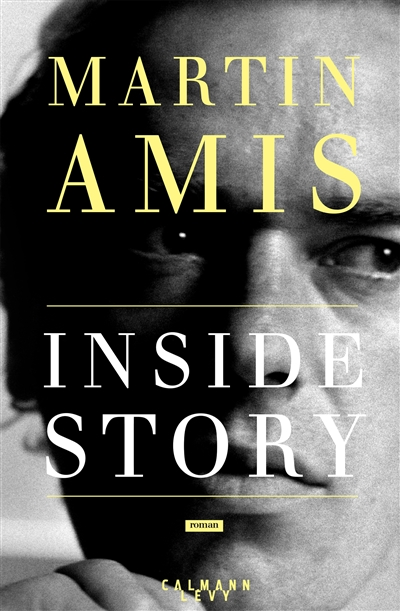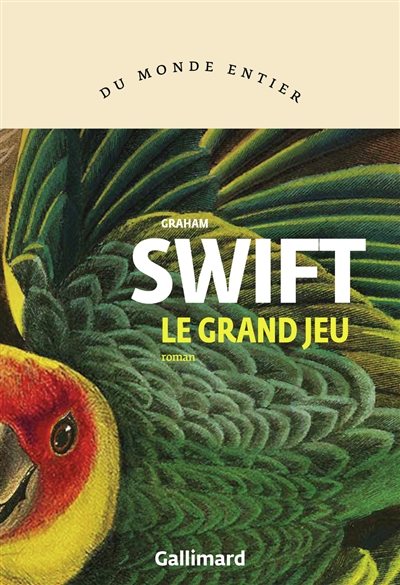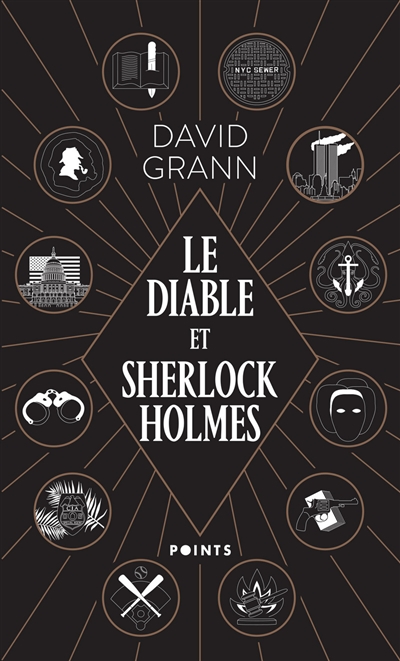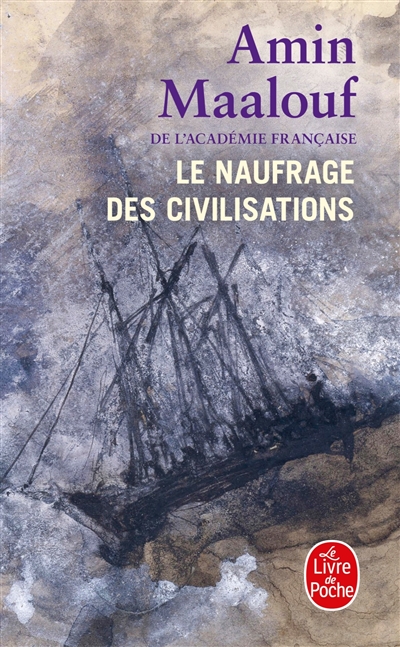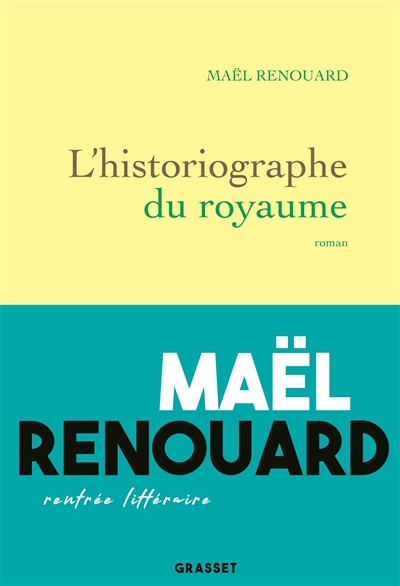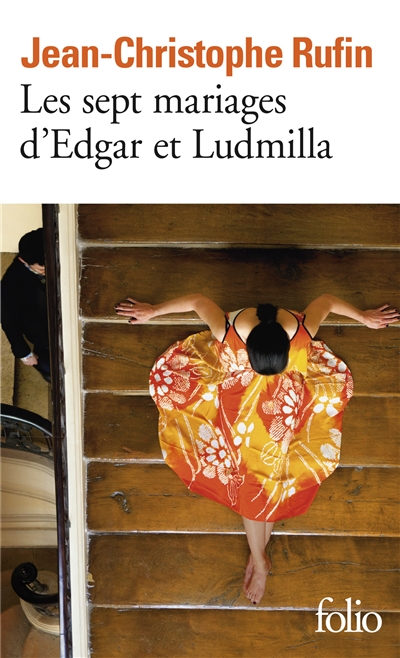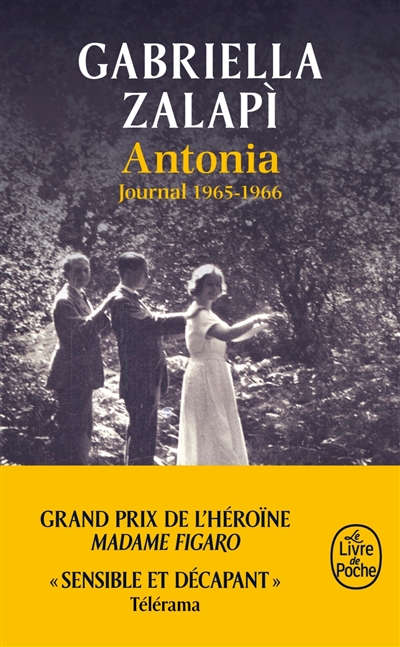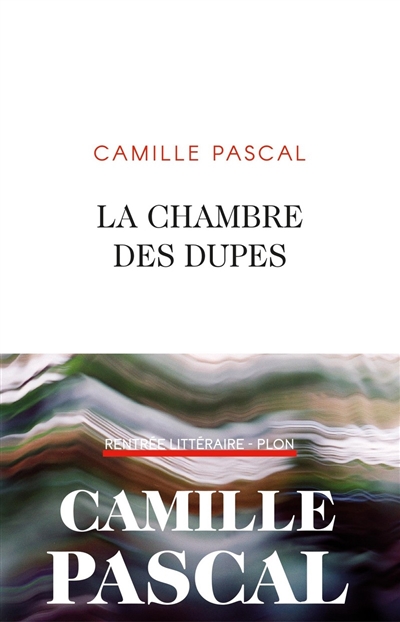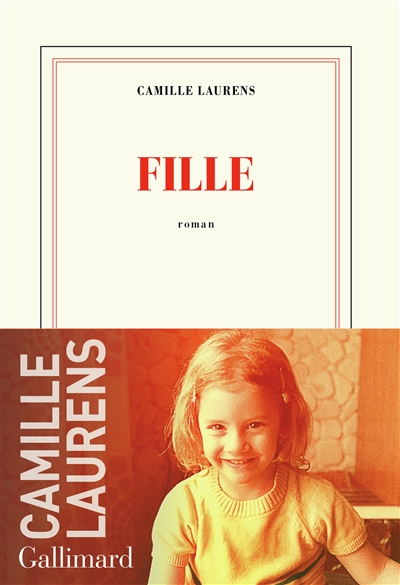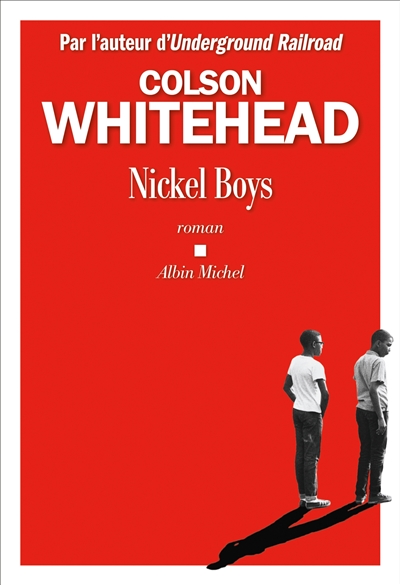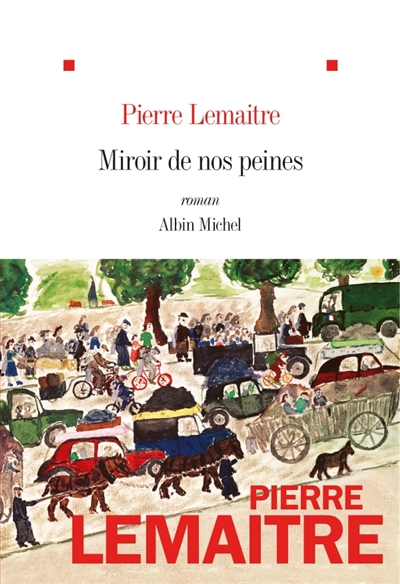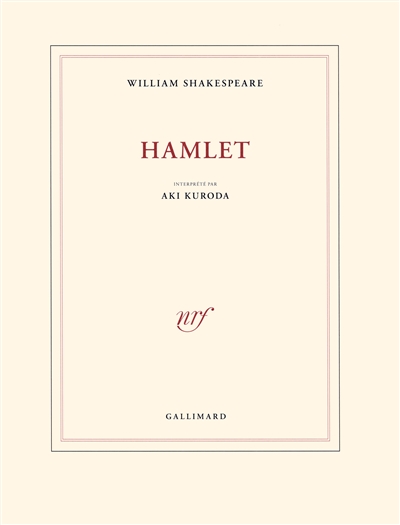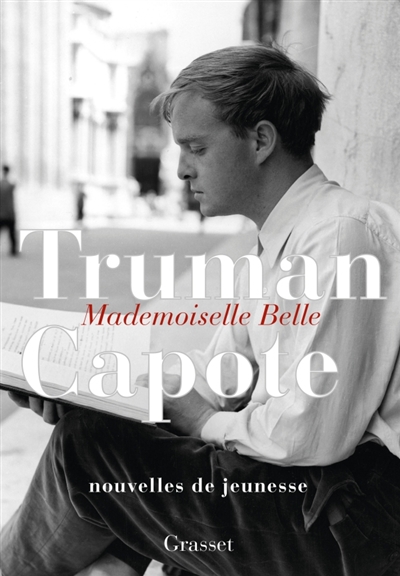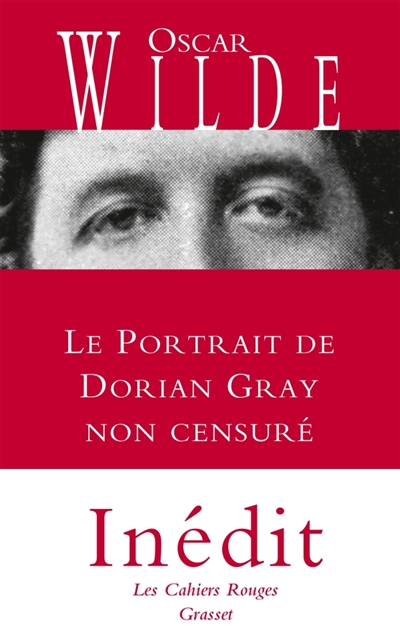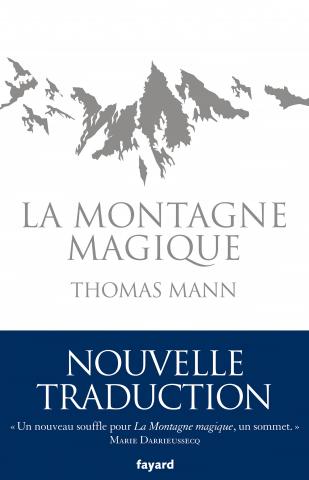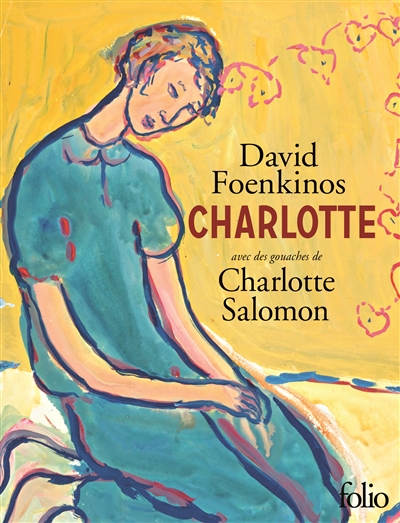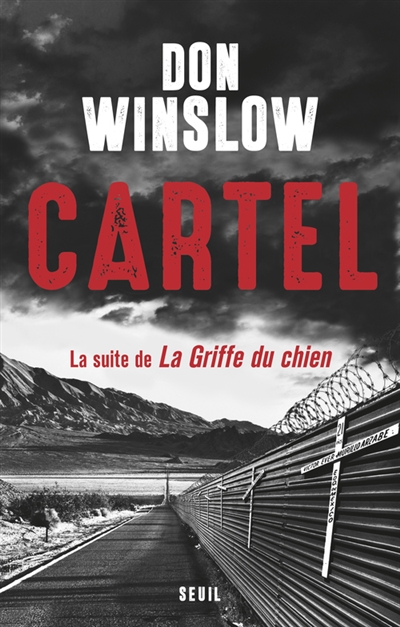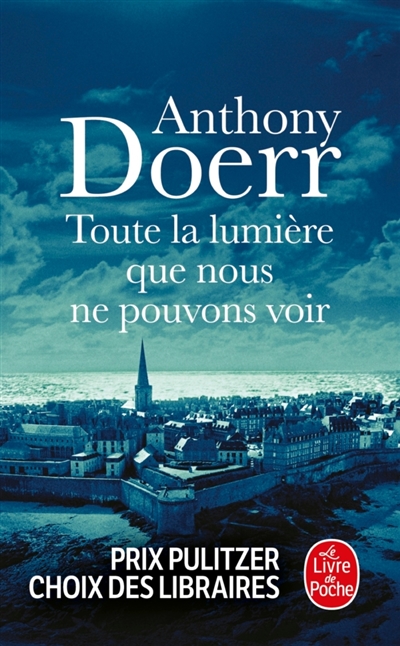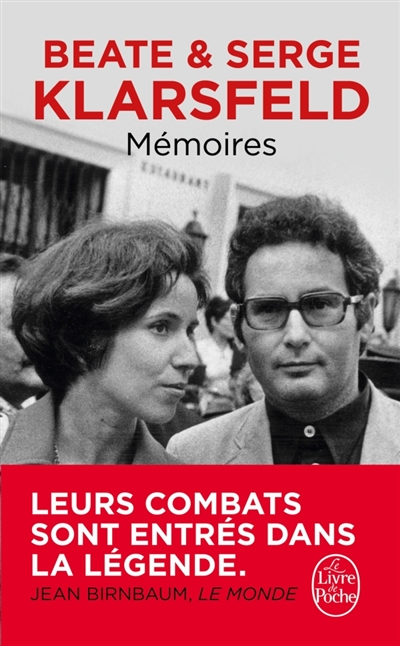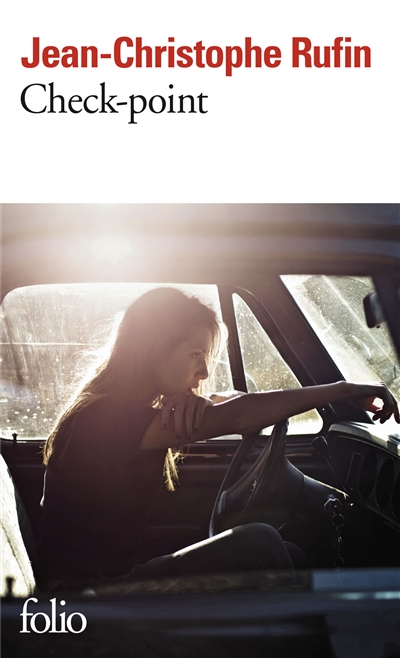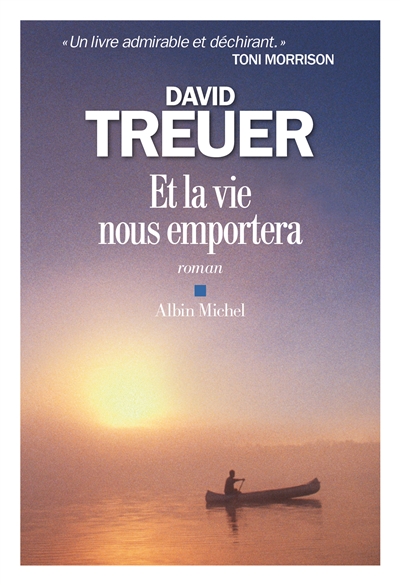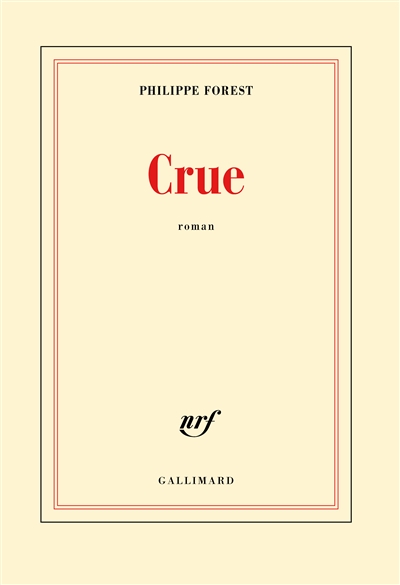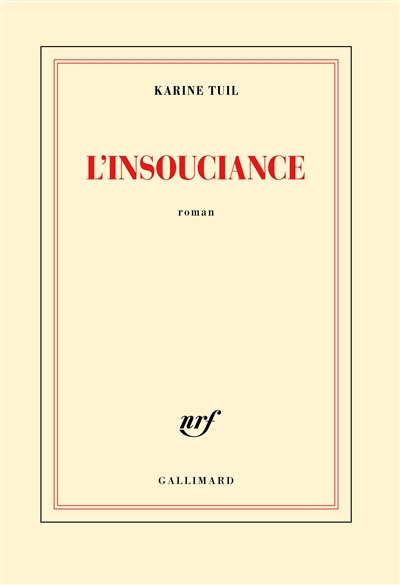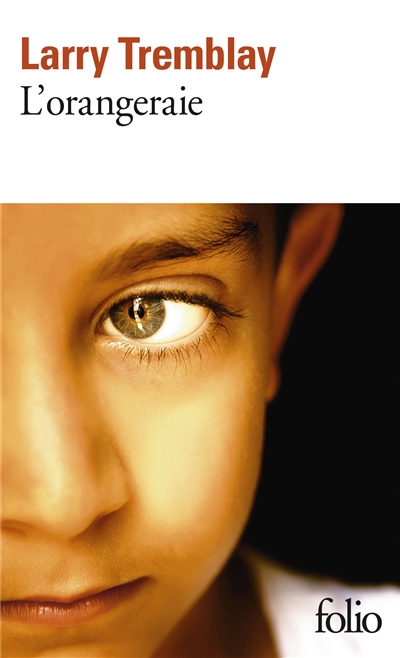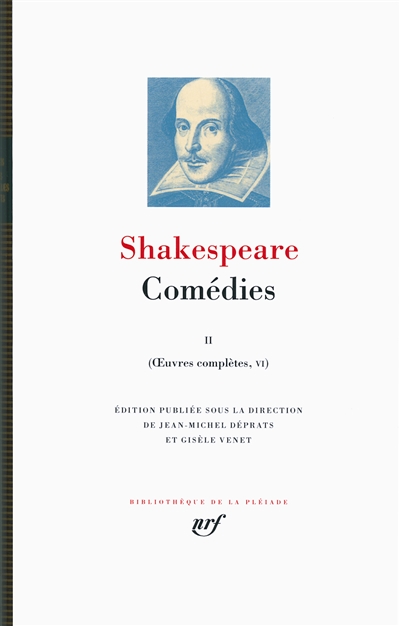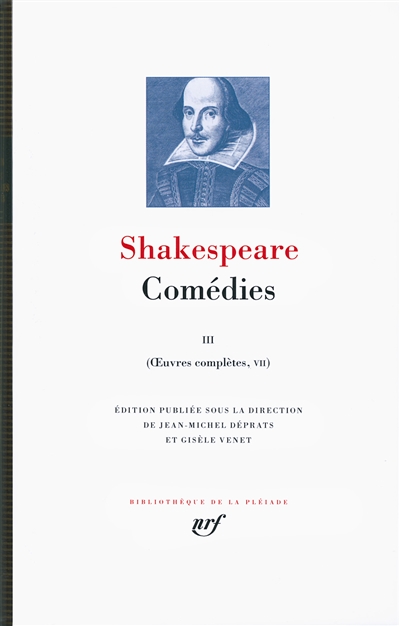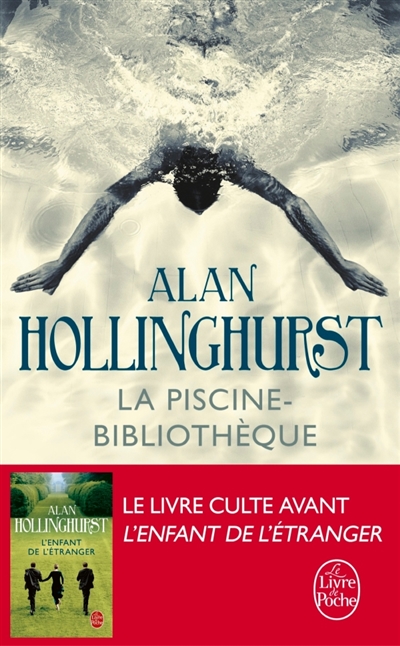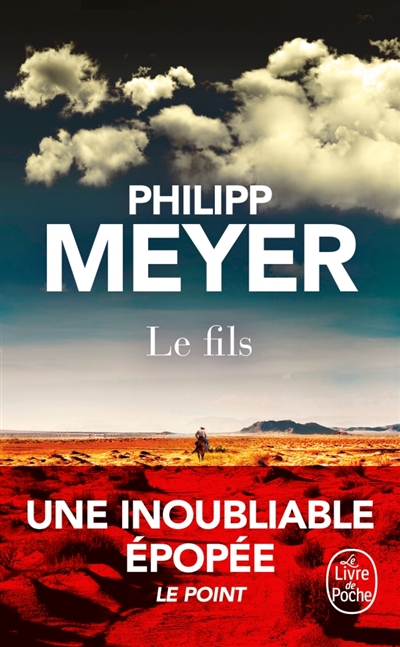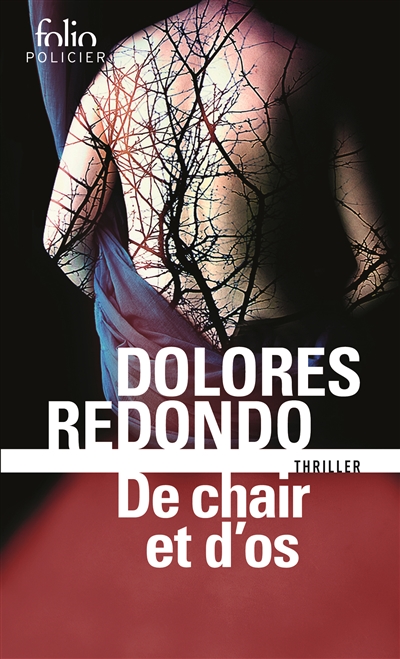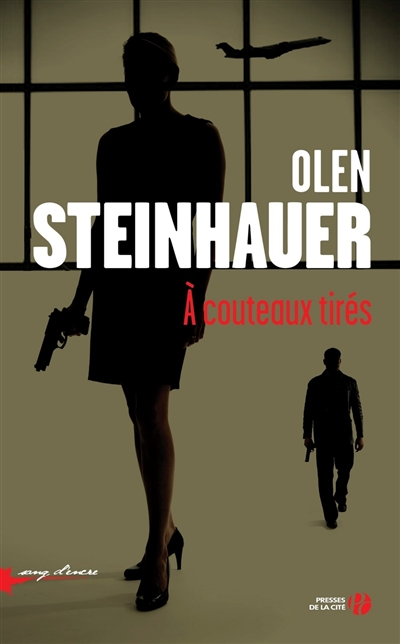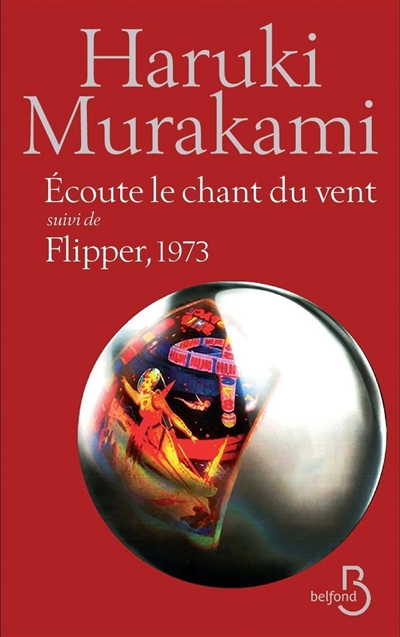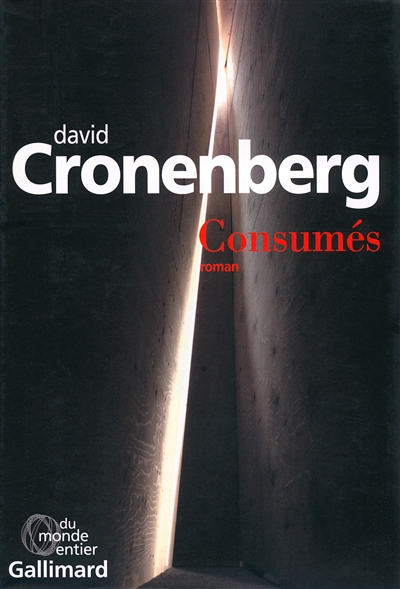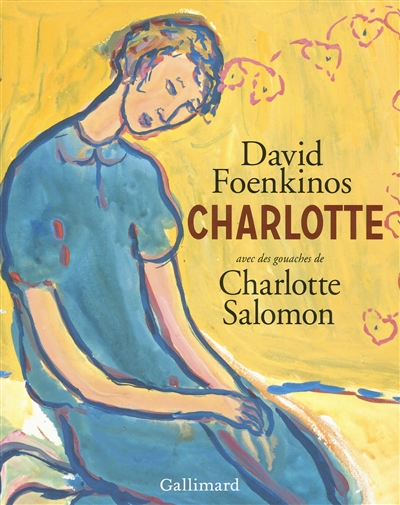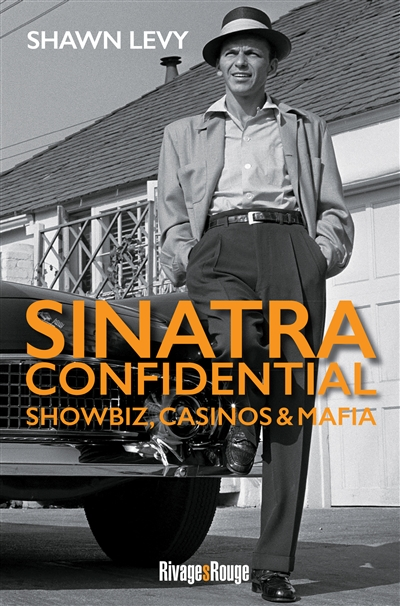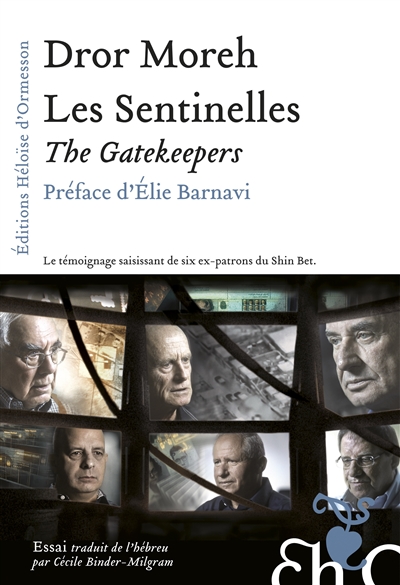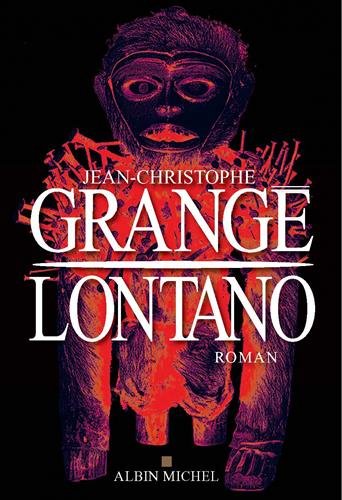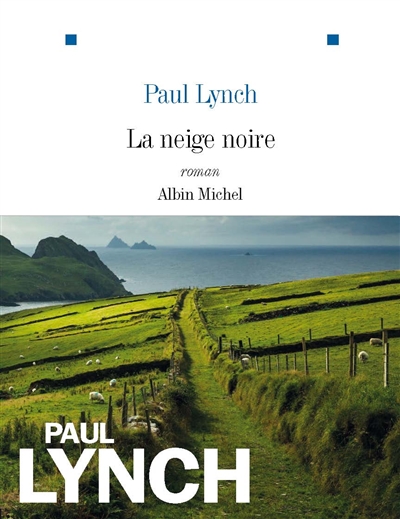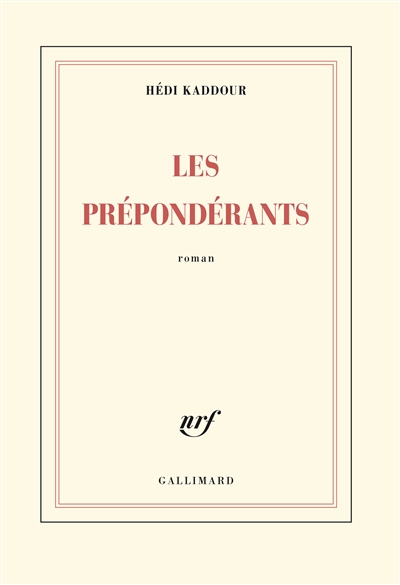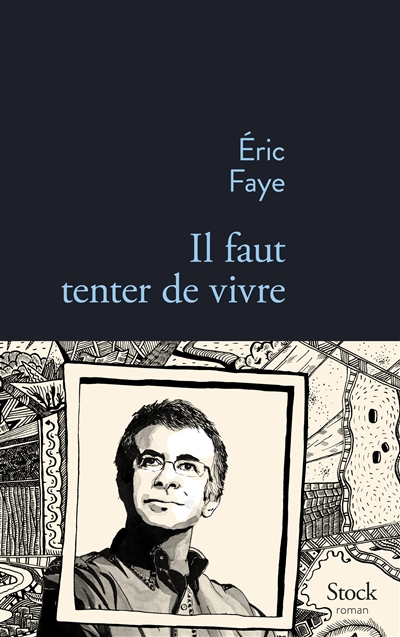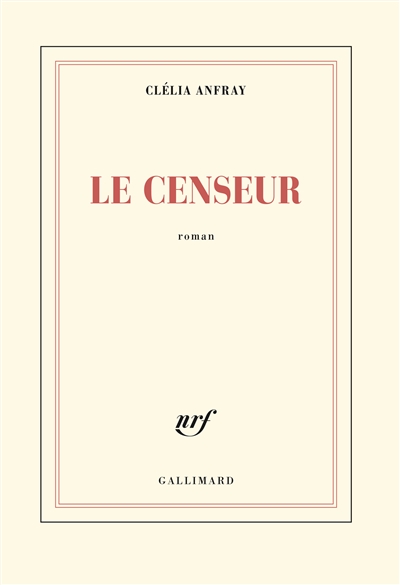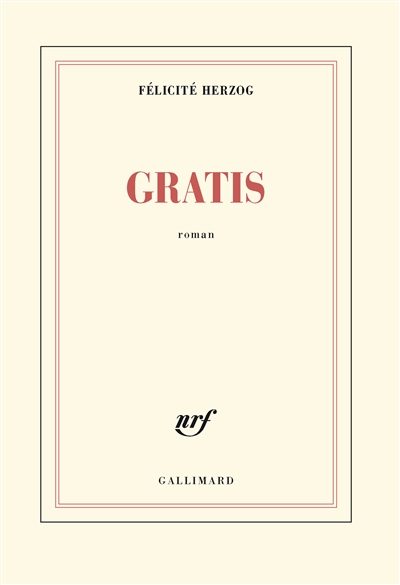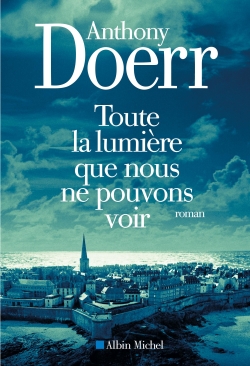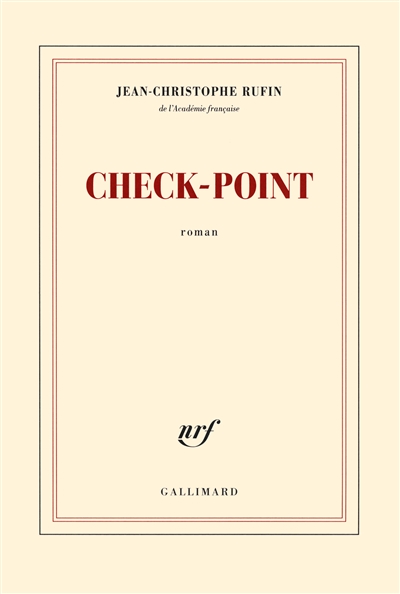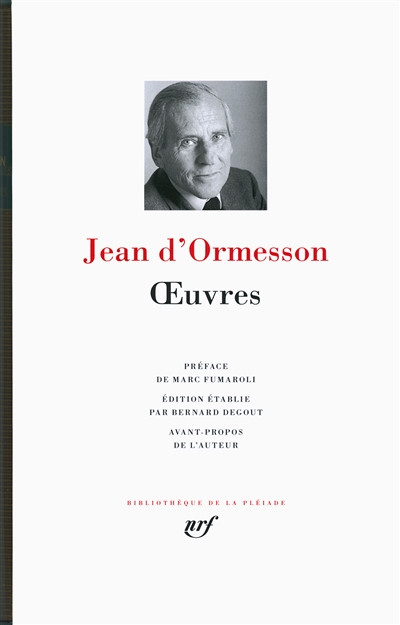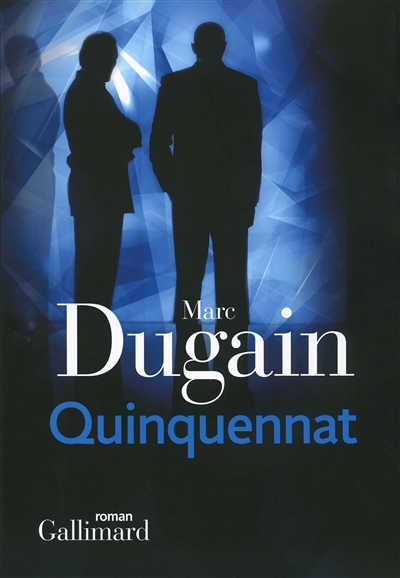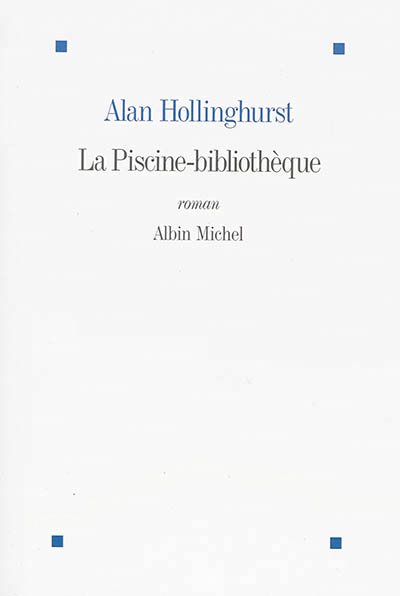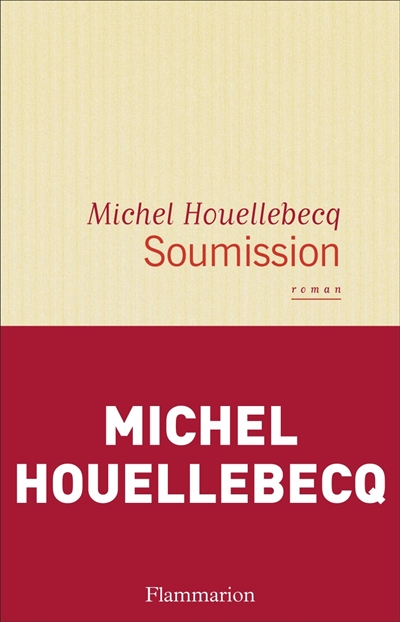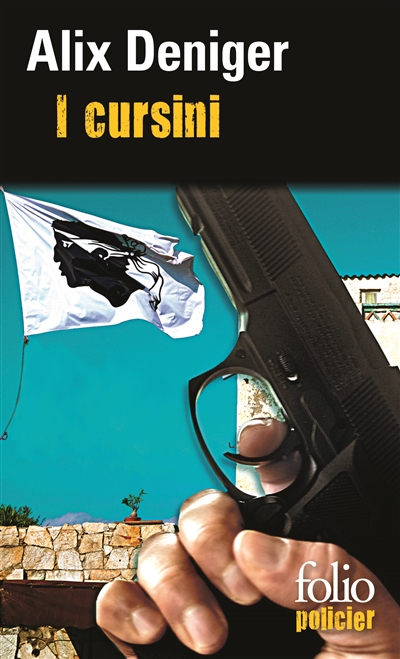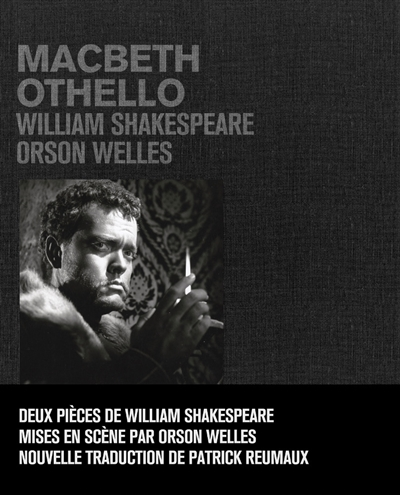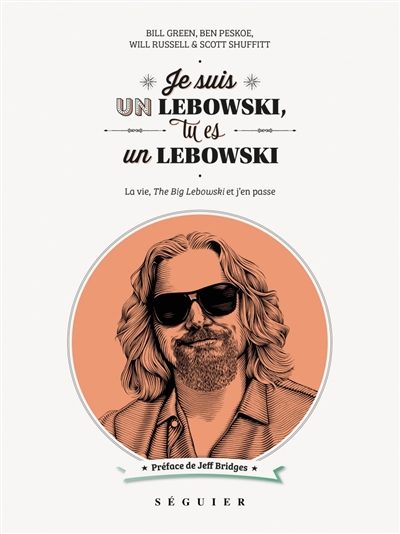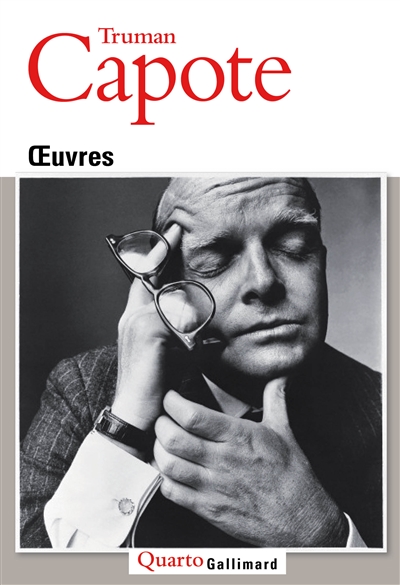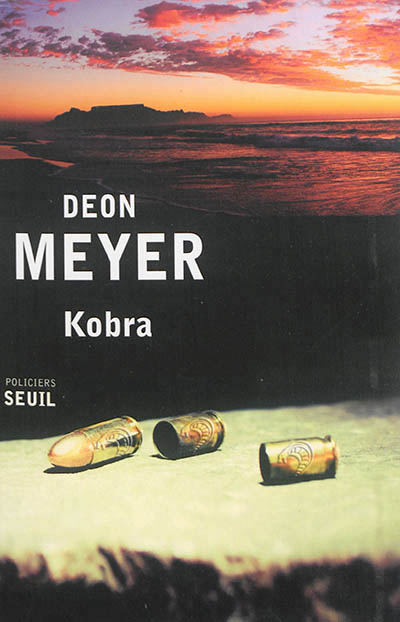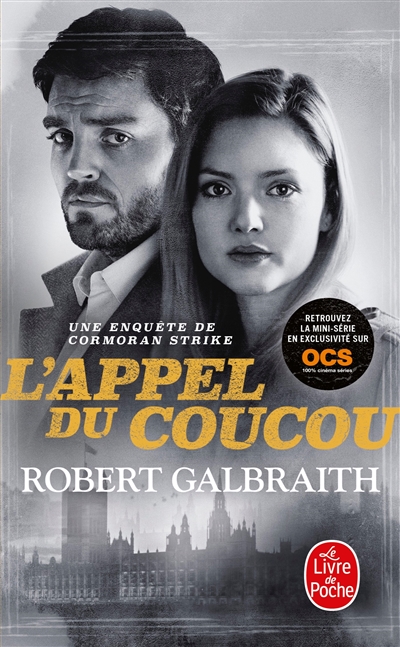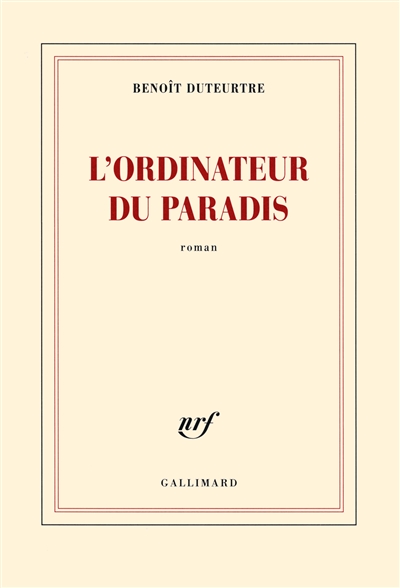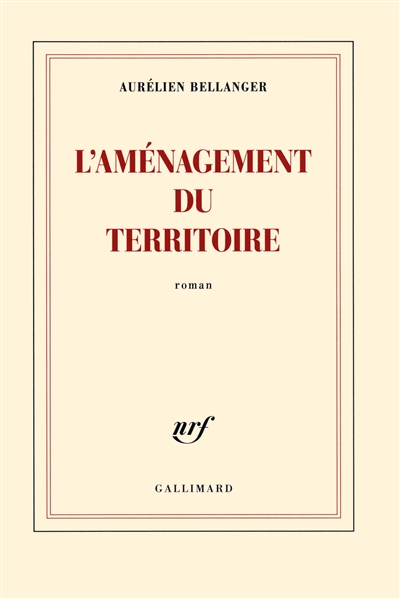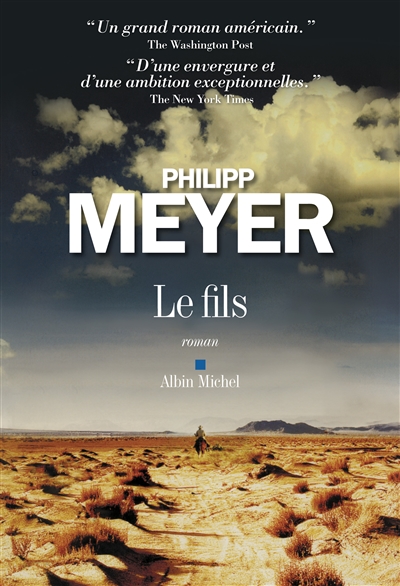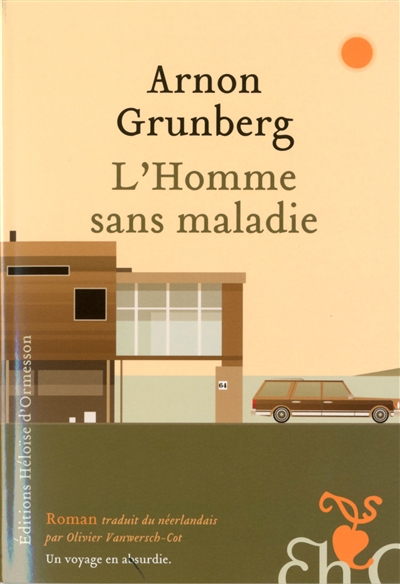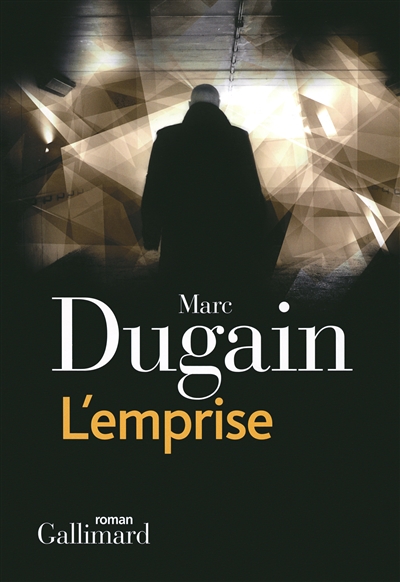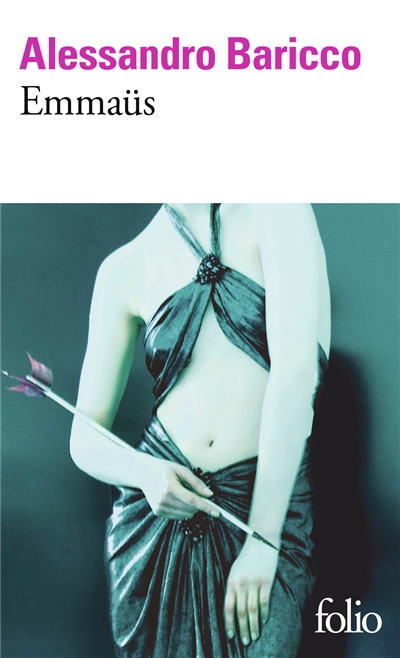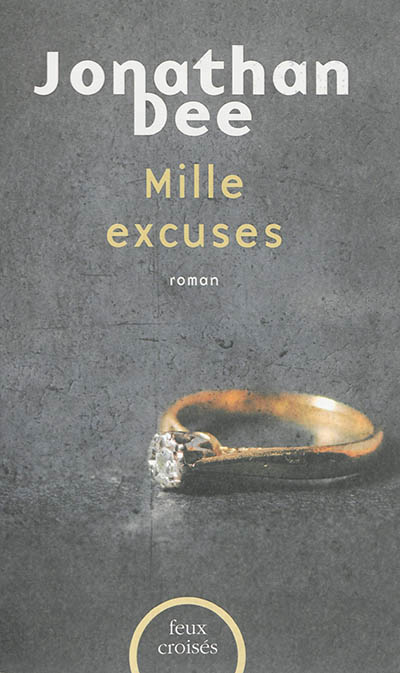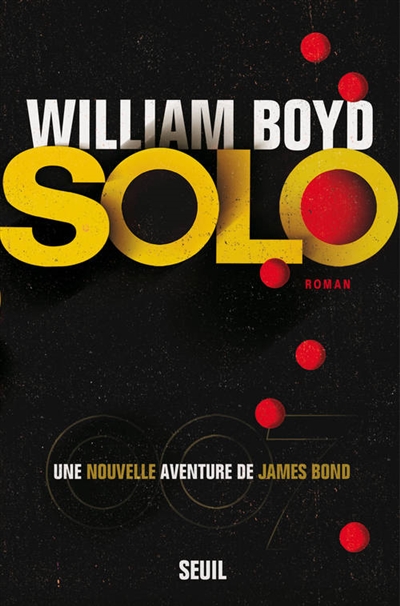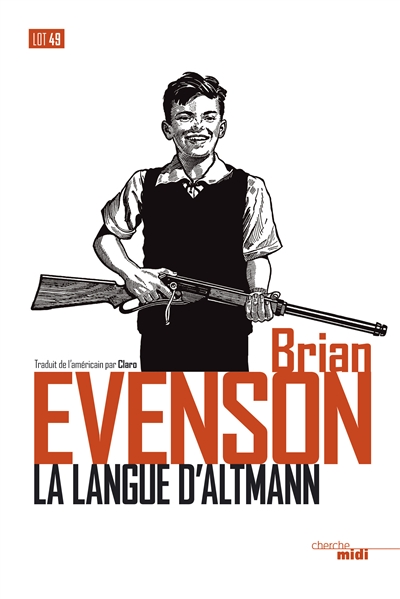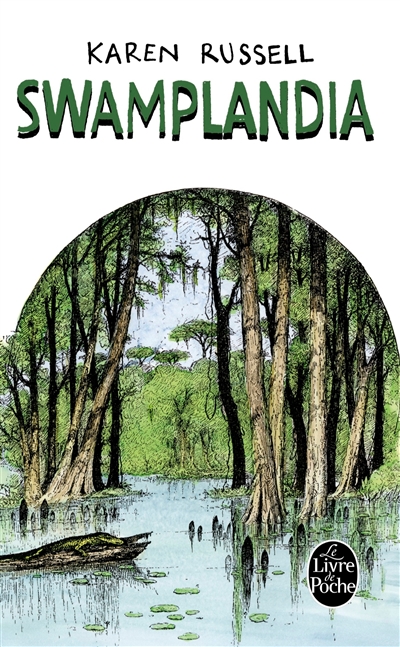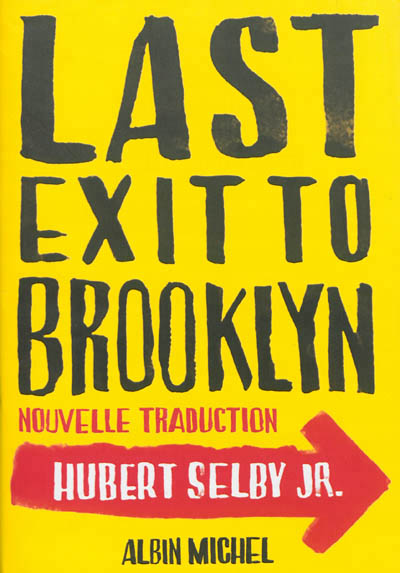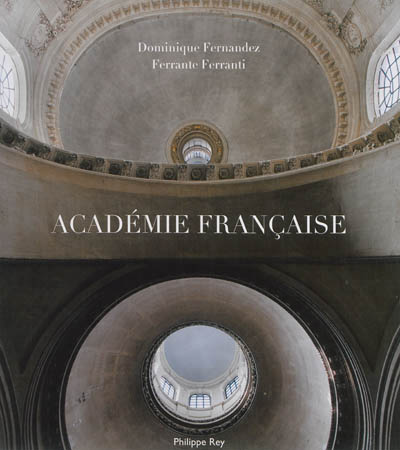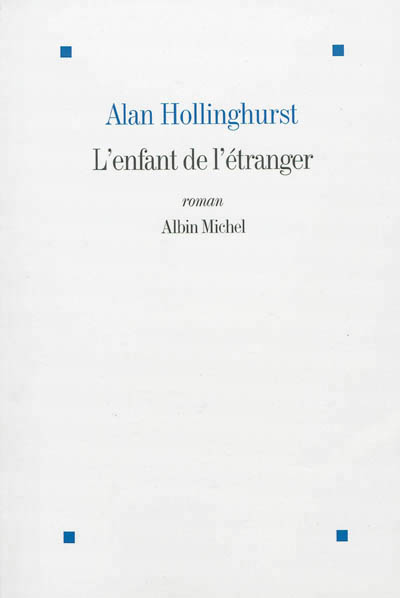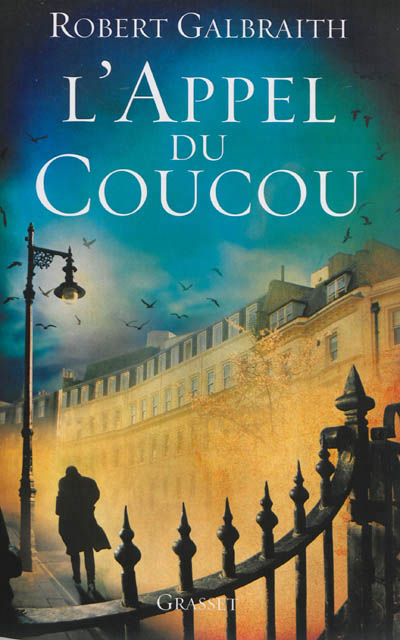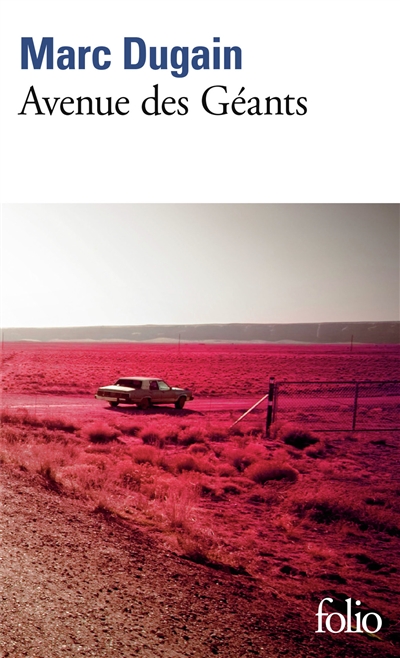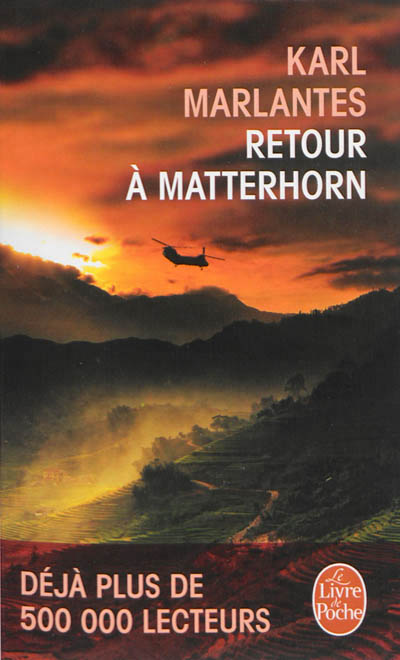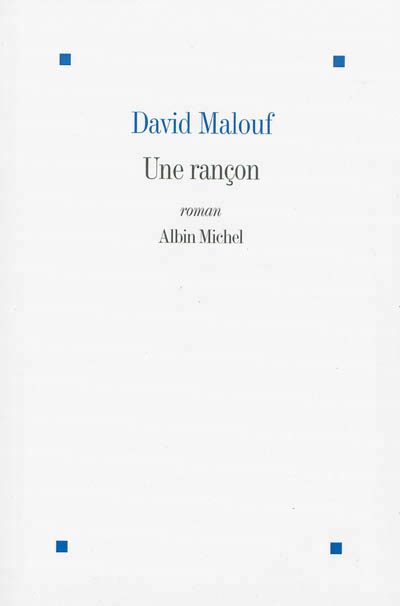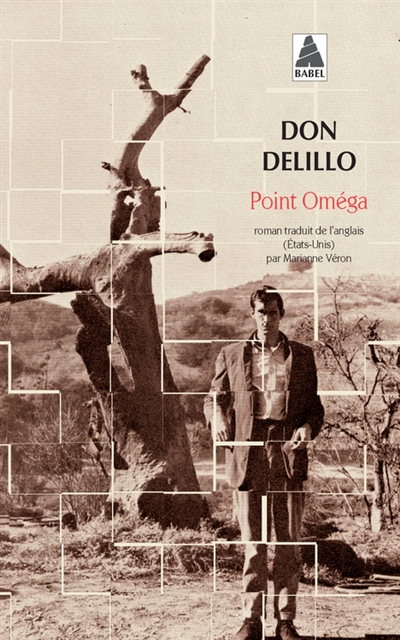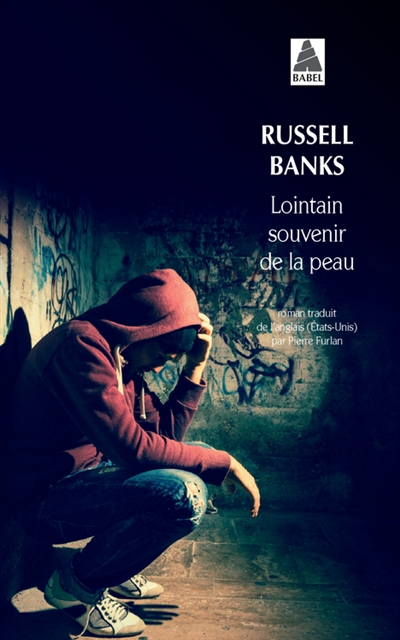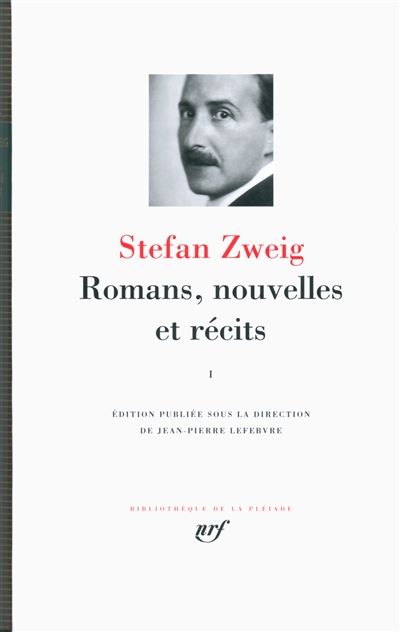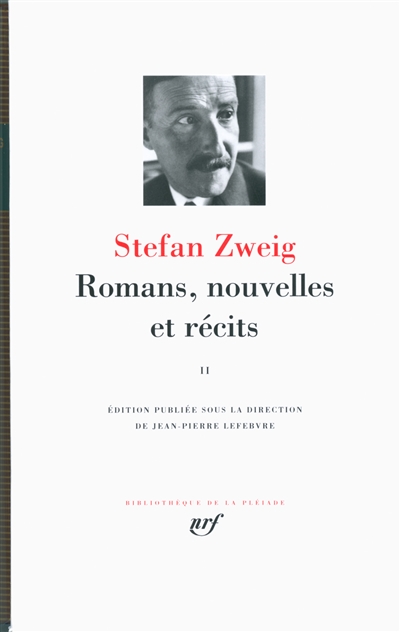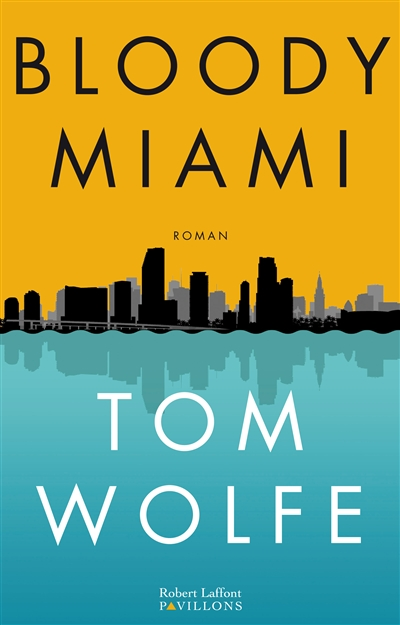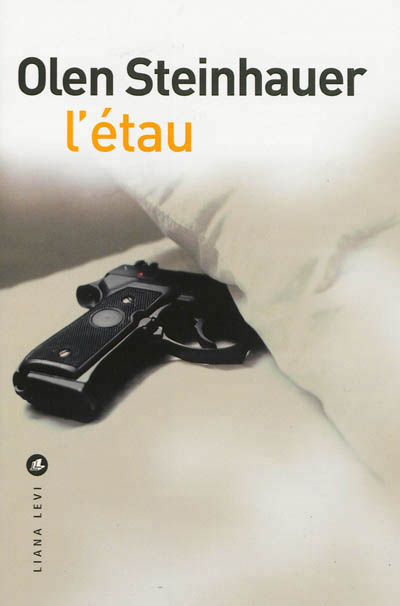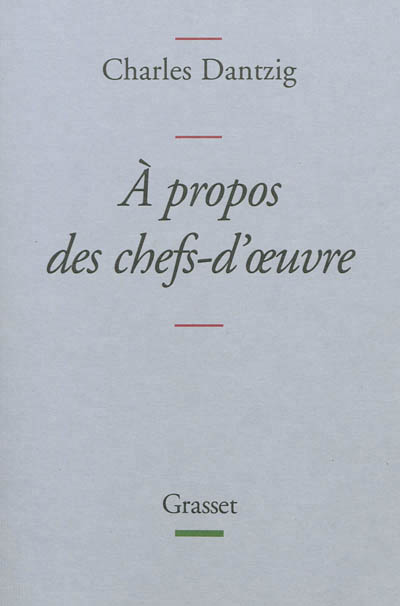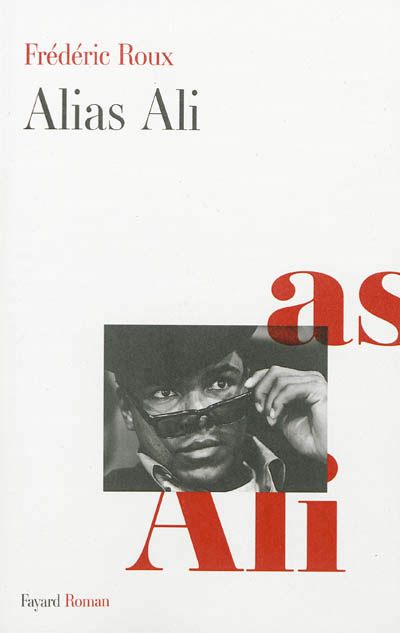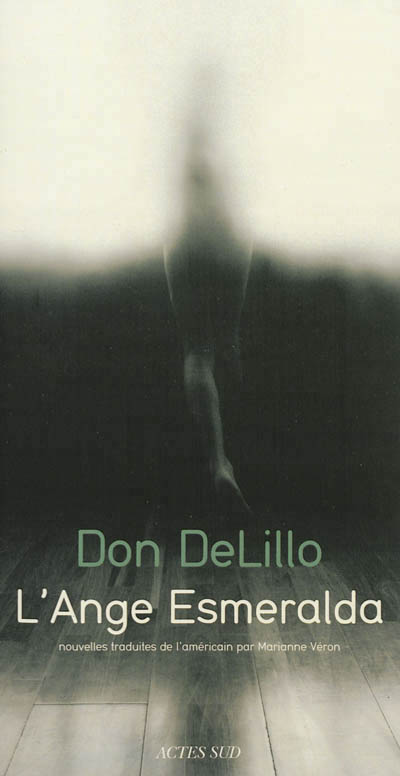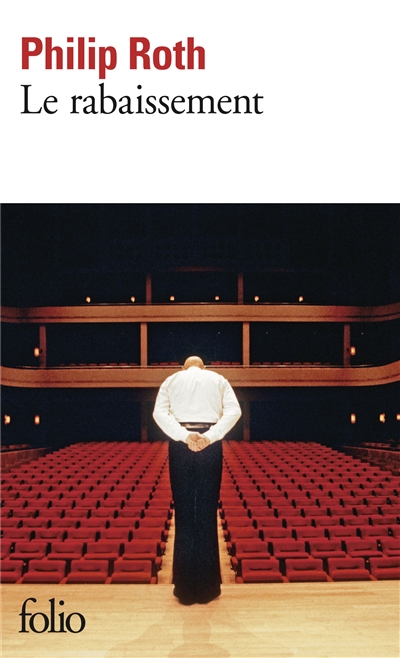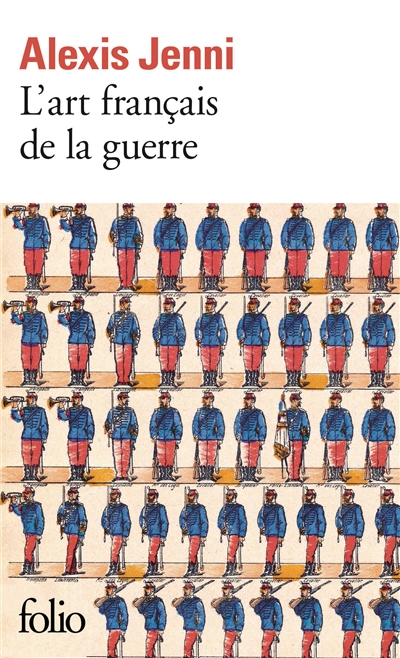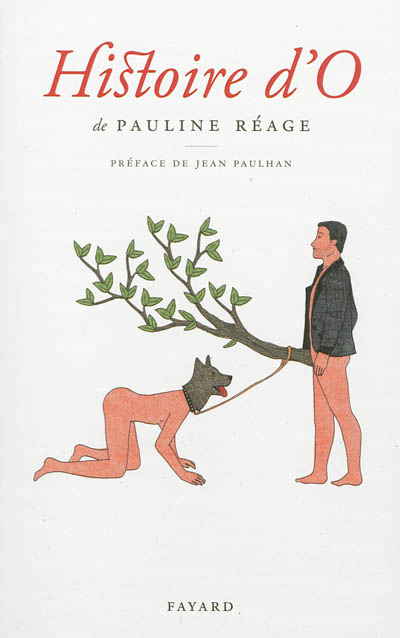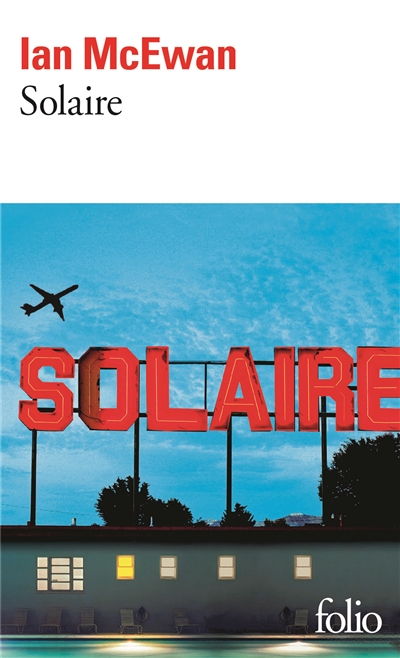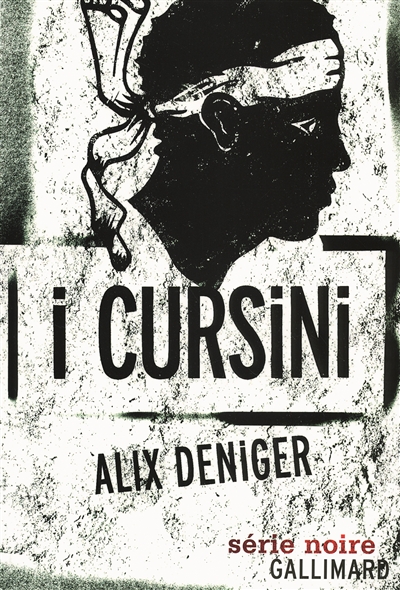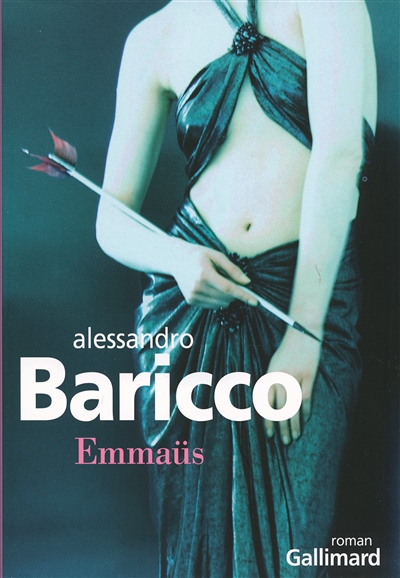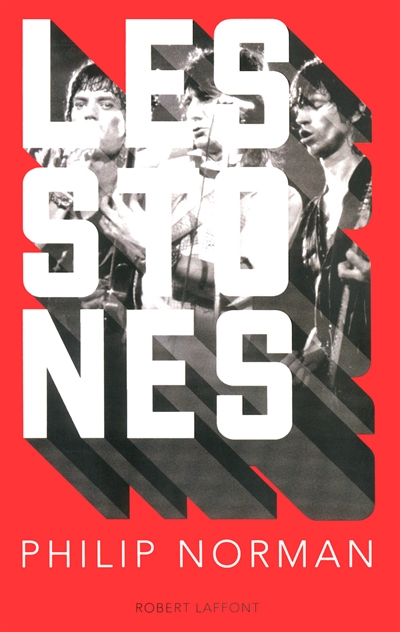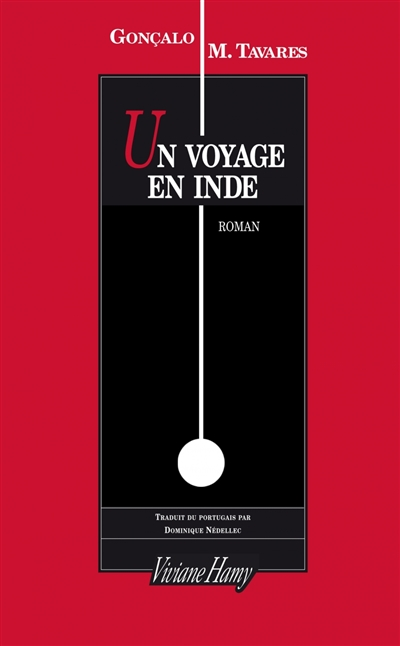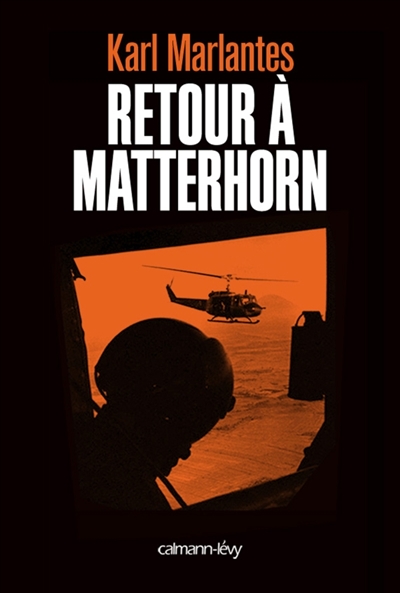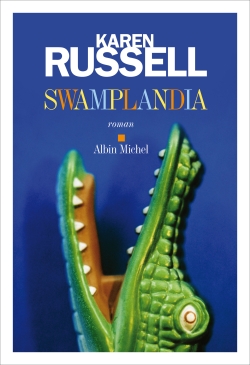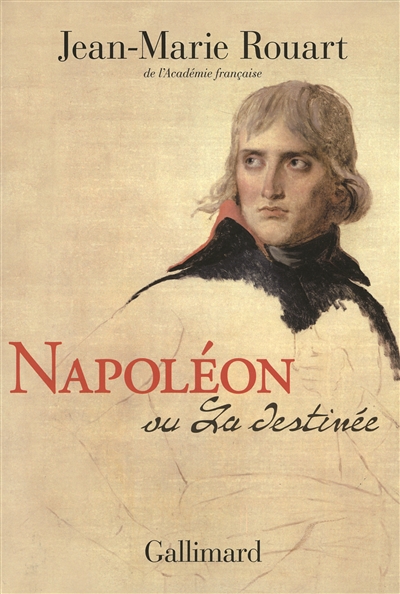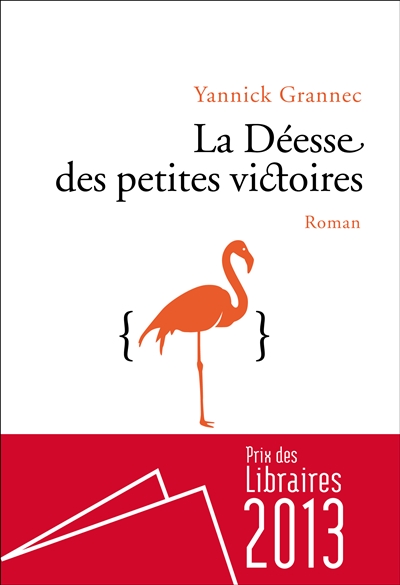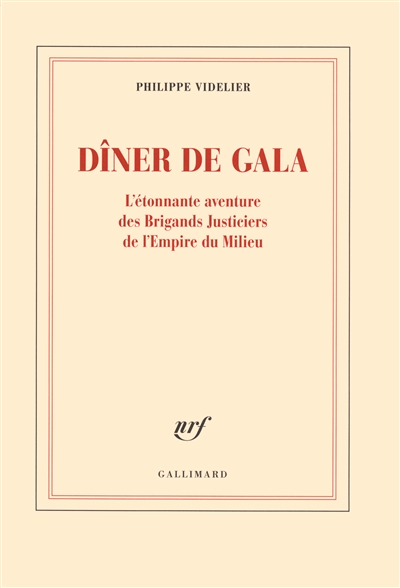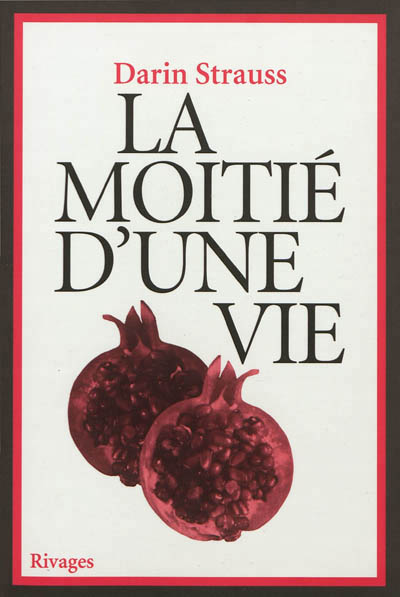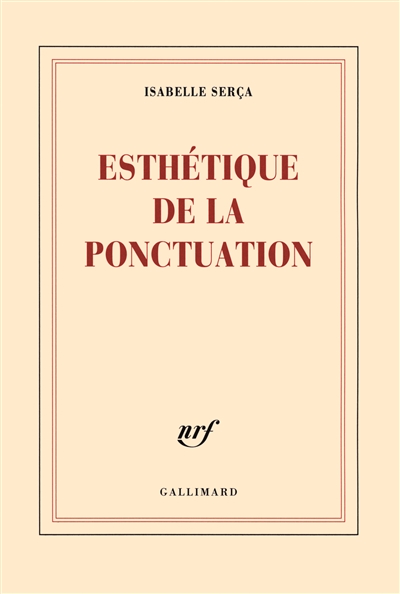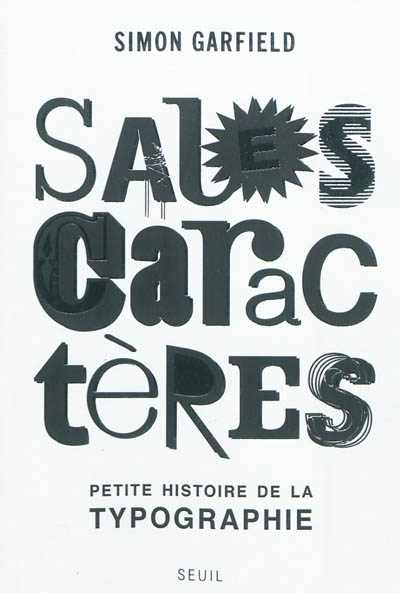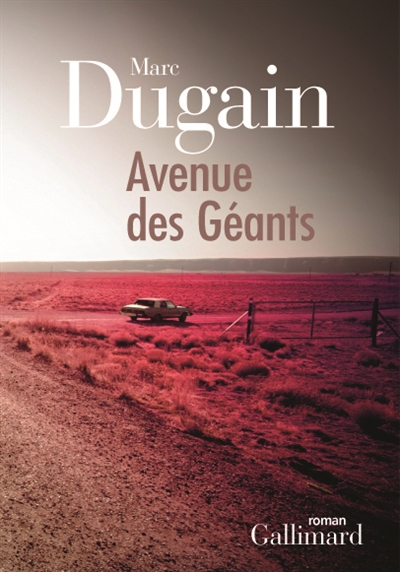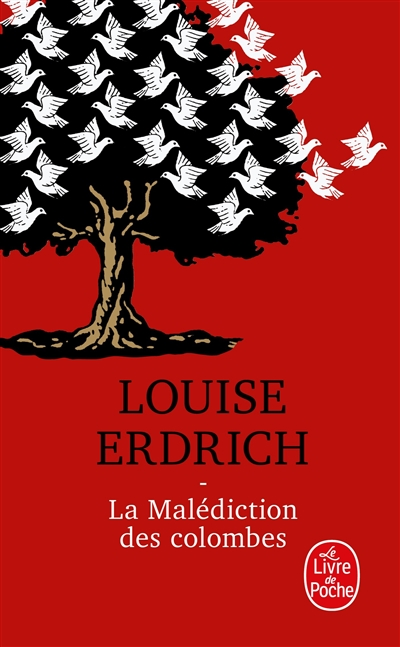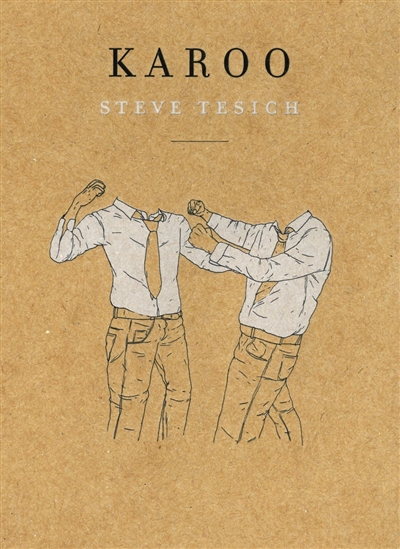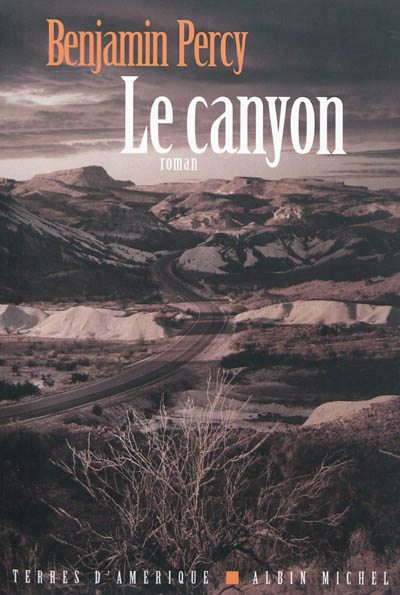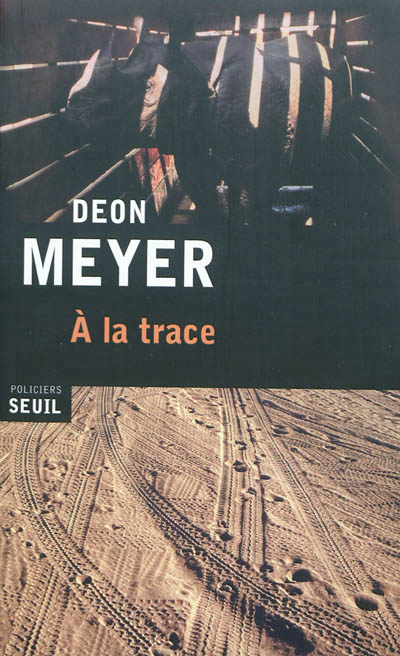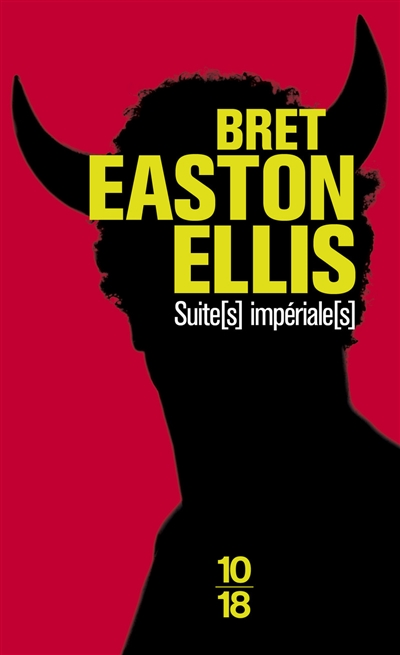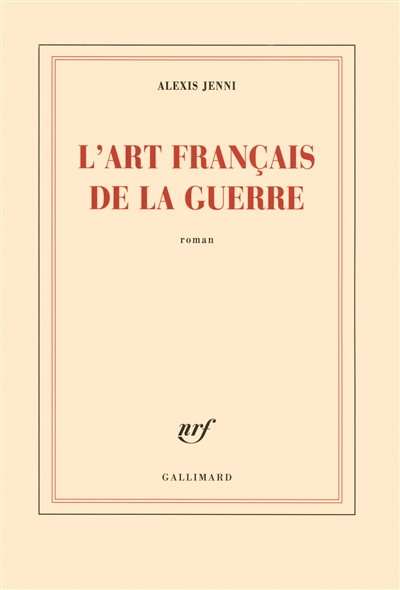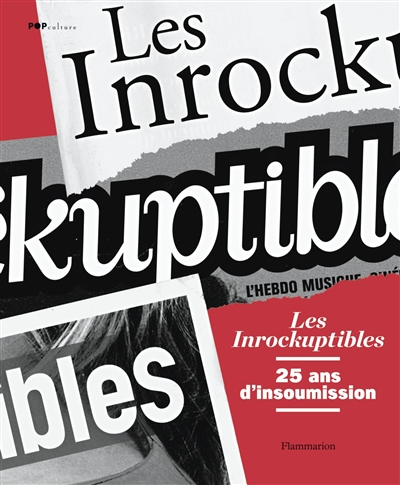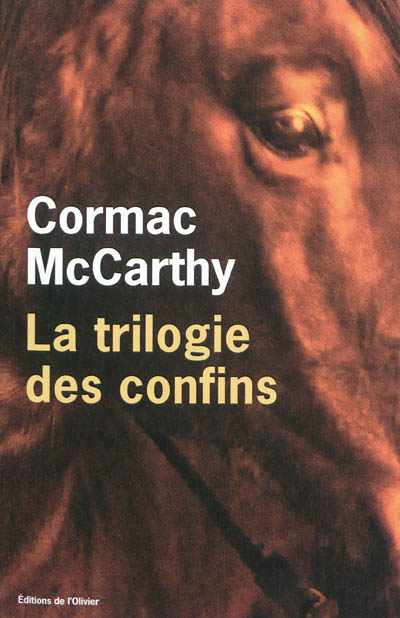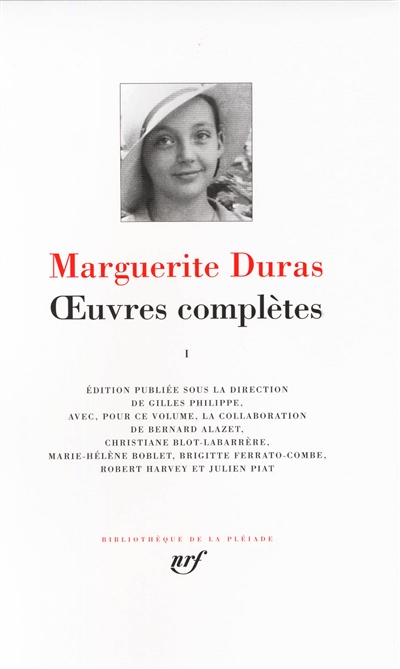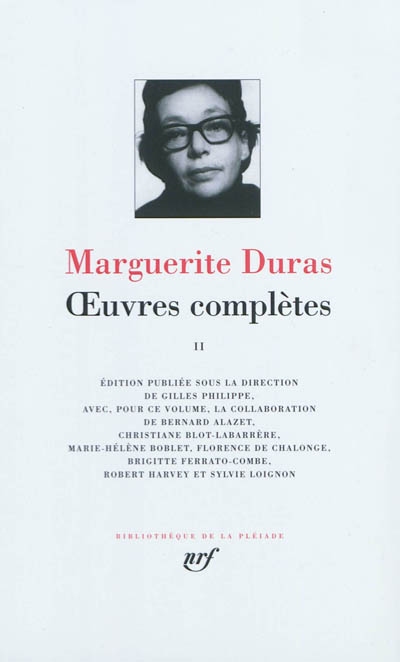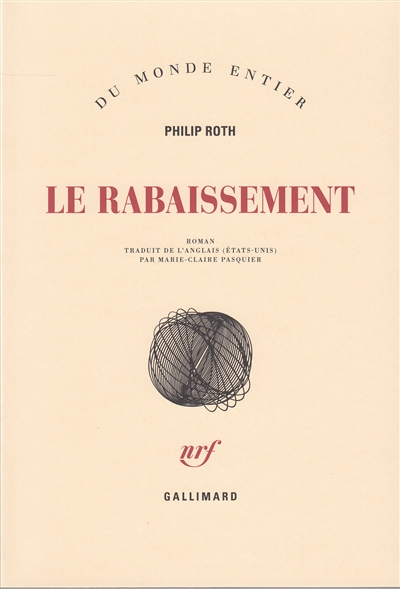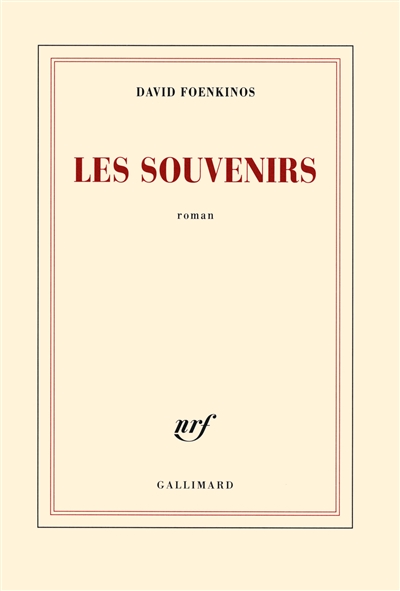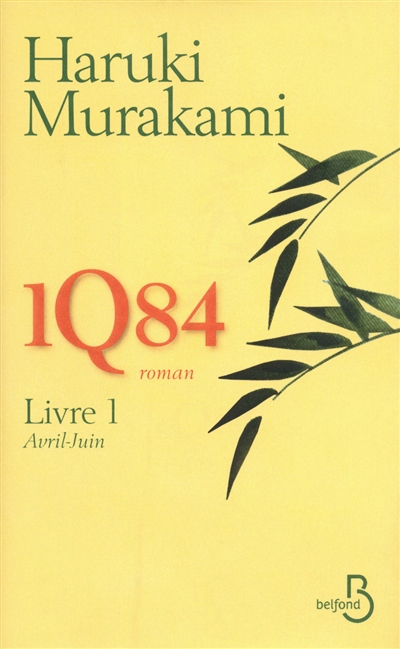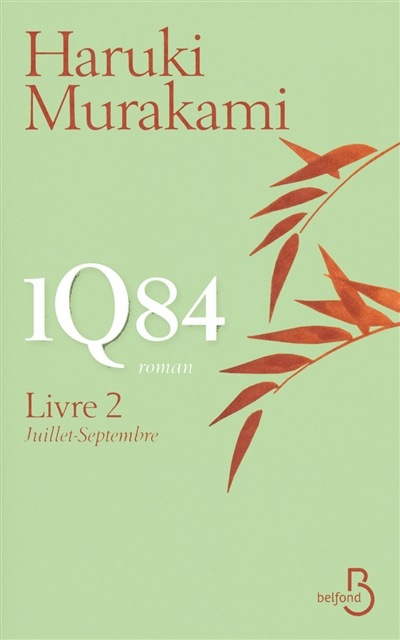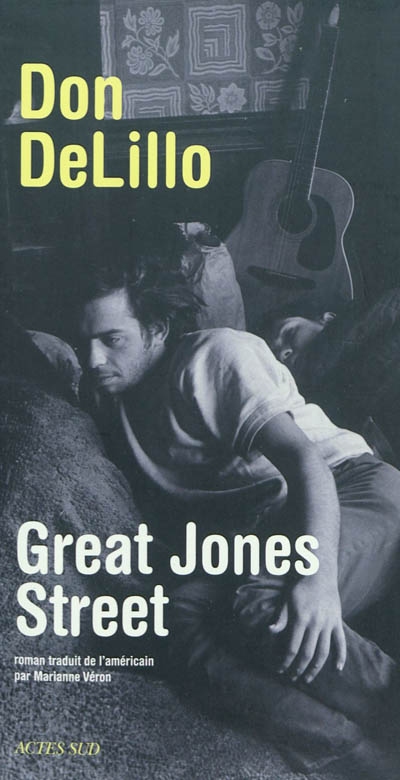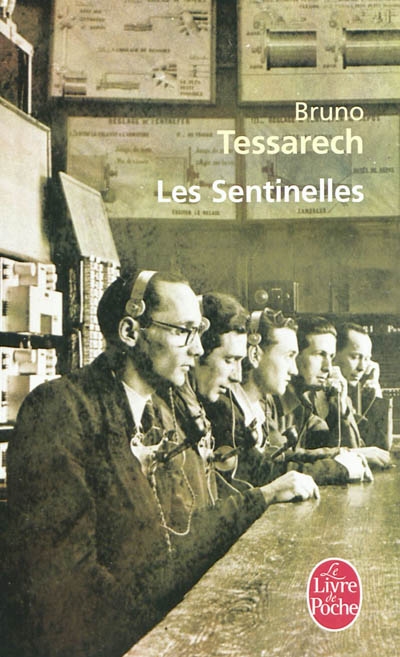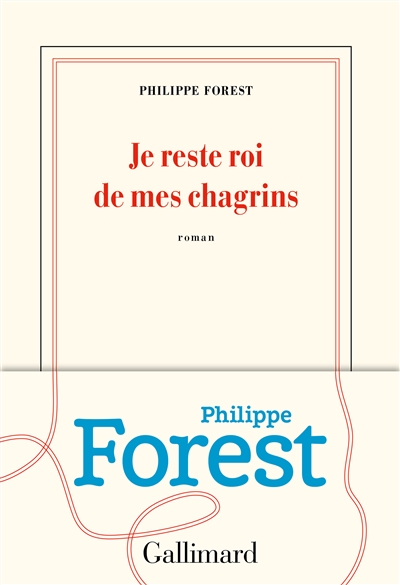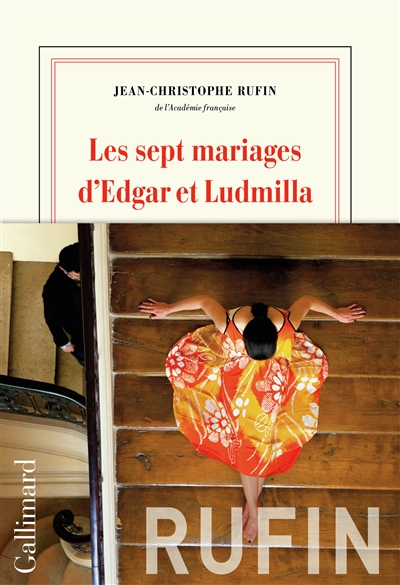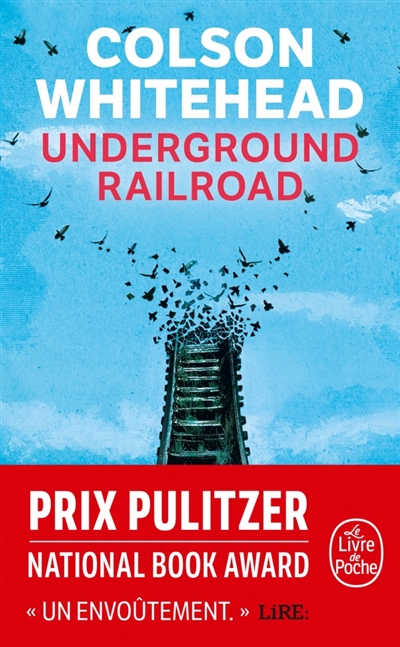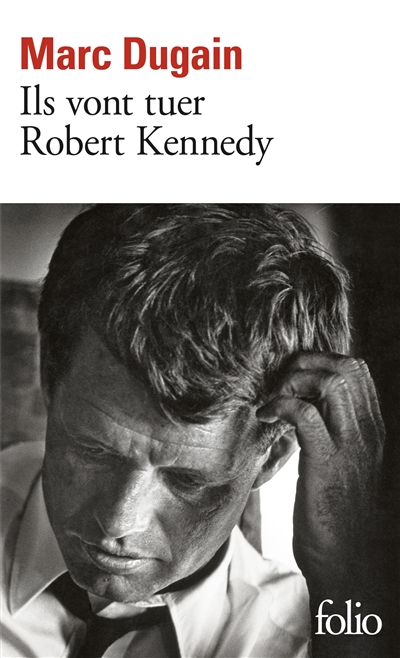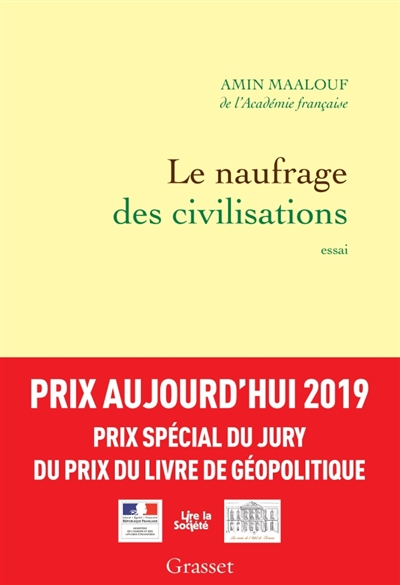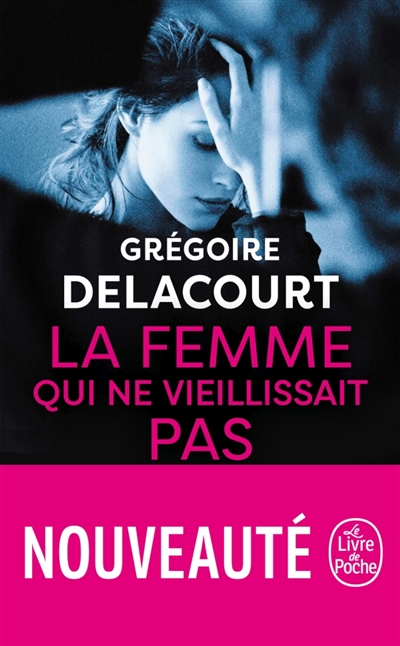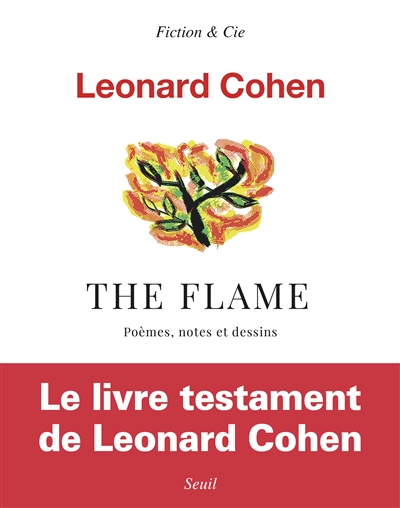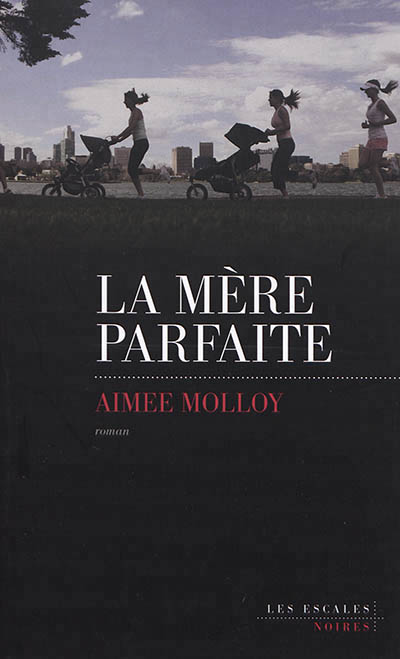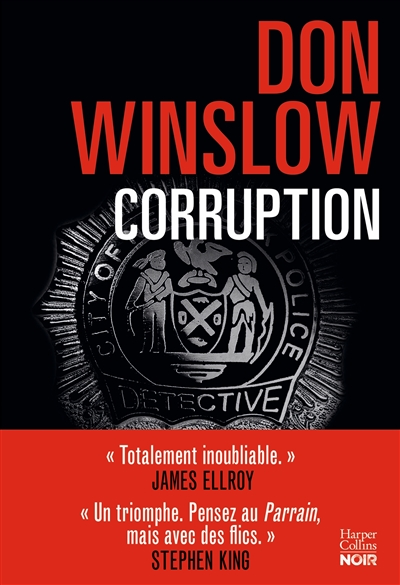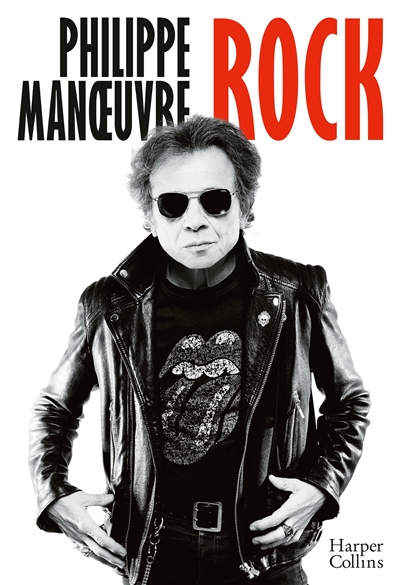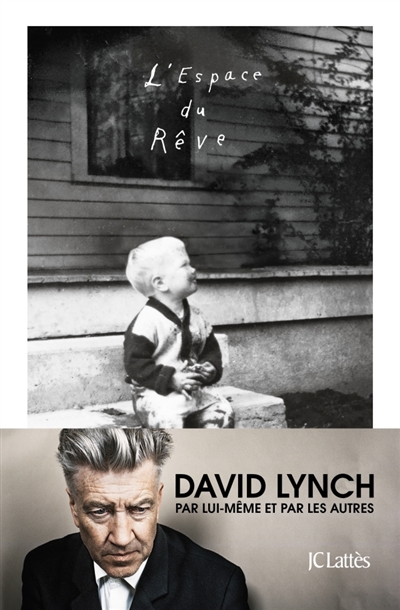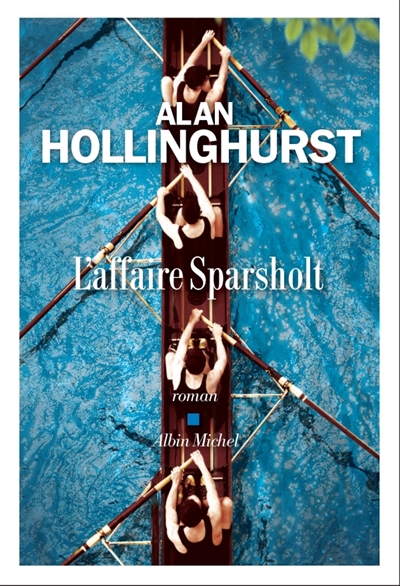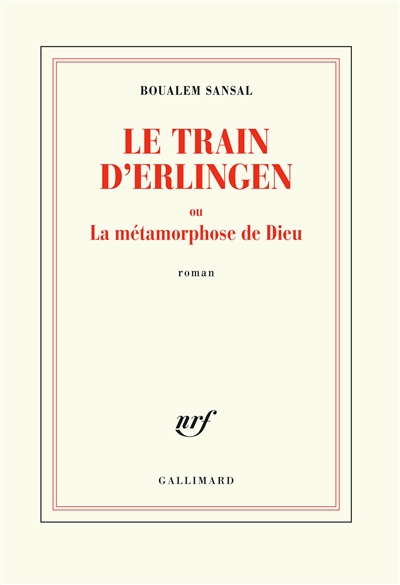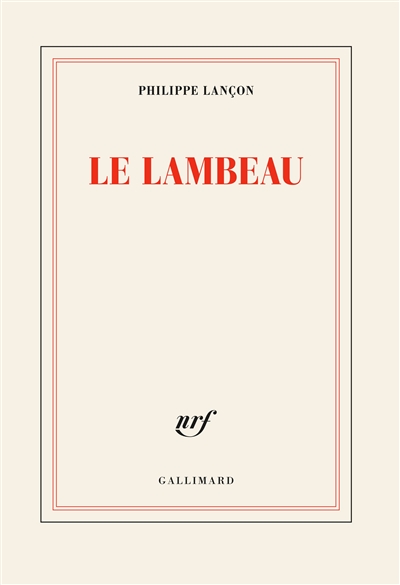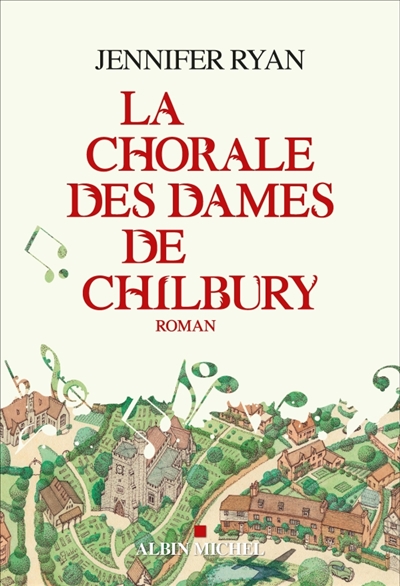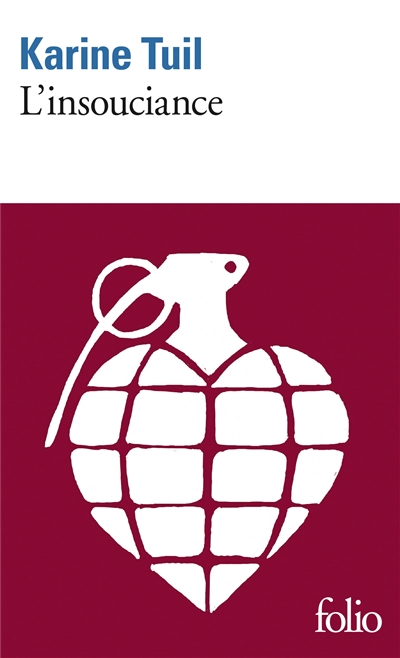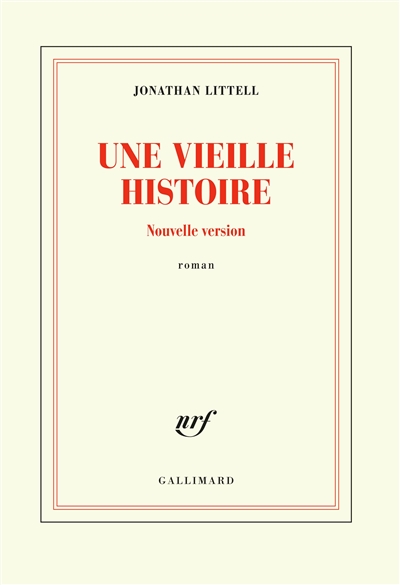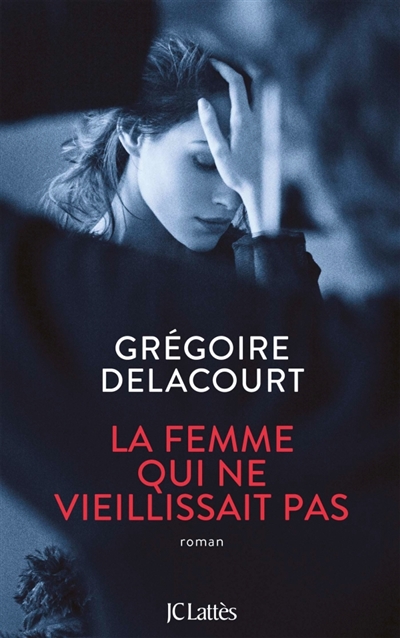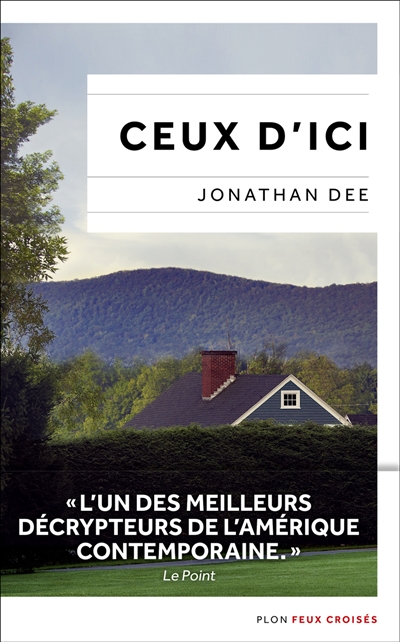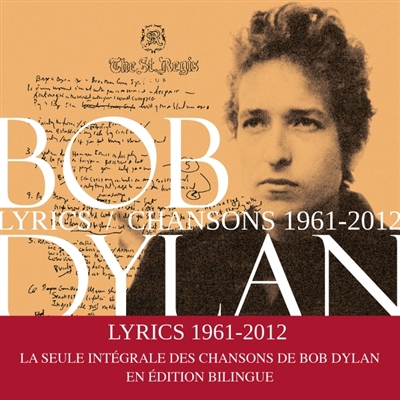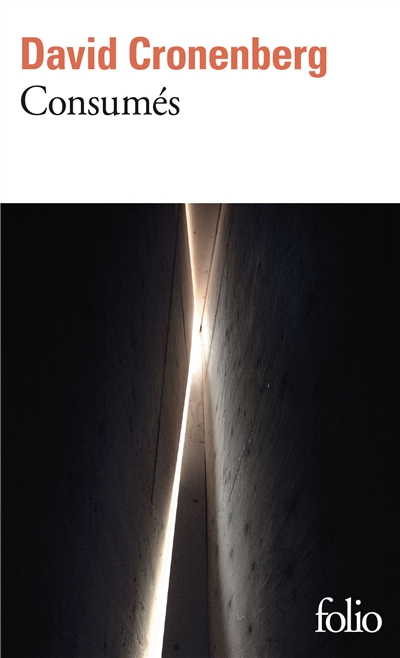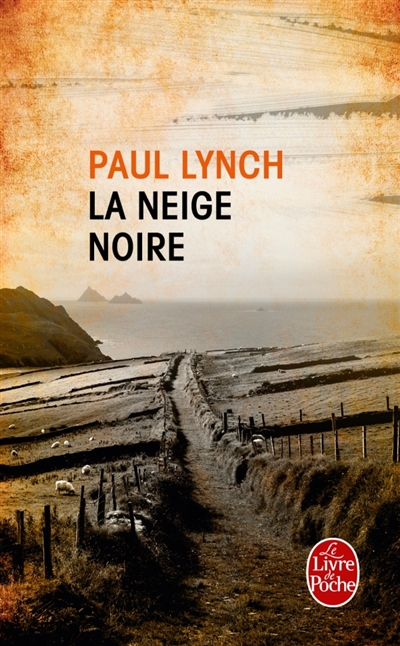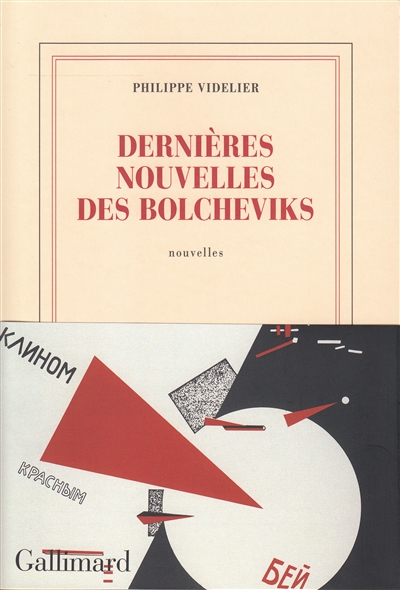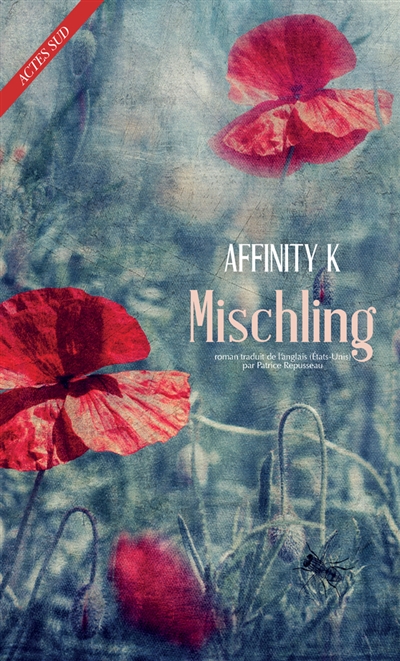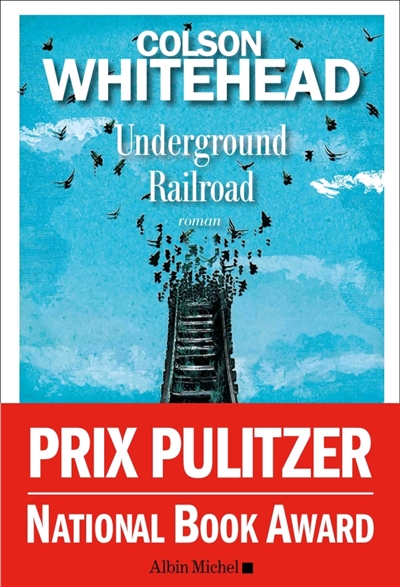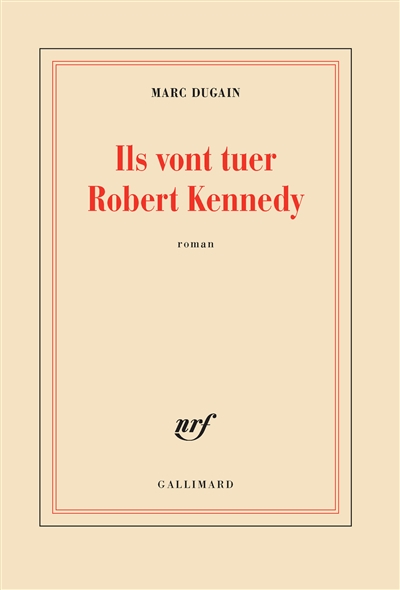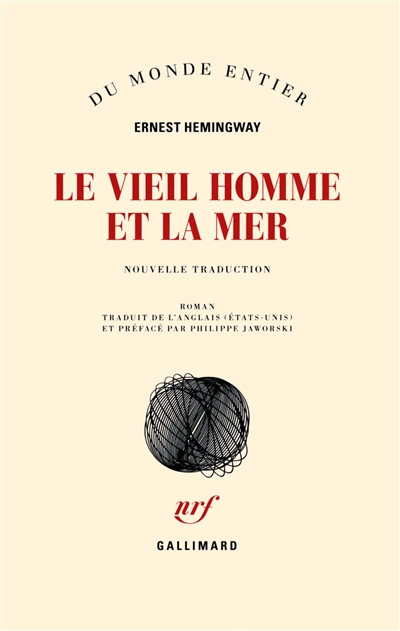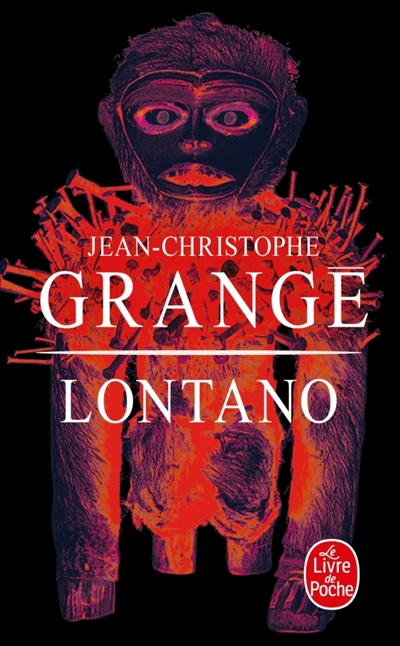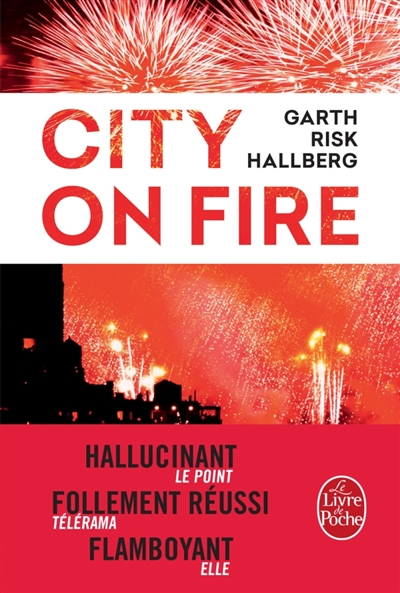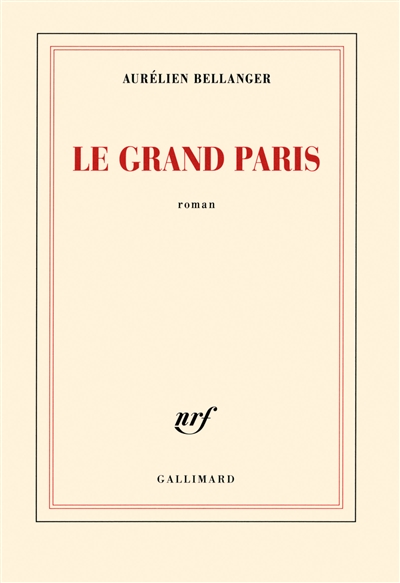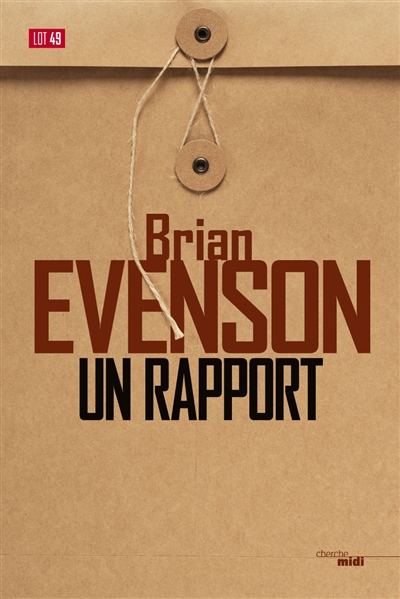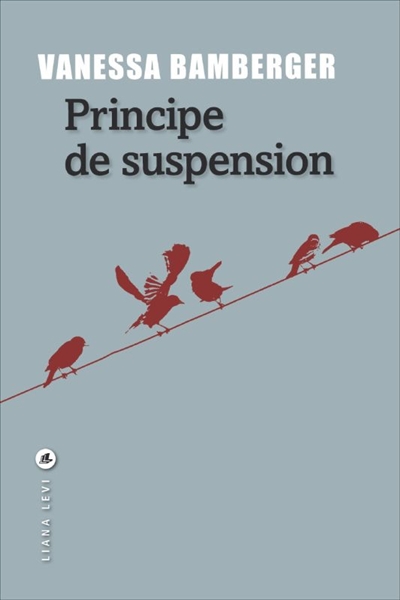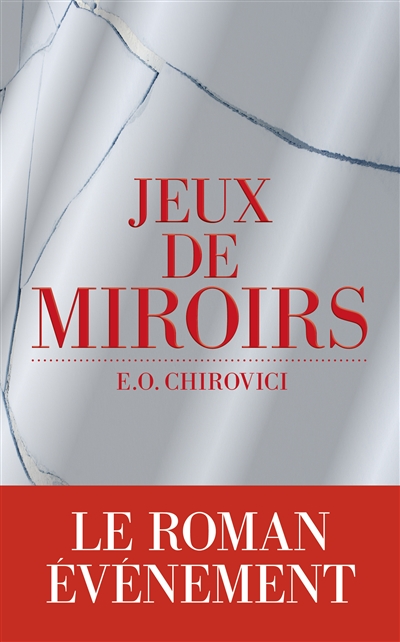Littérature française
Émilie de Turckheim
Une sainte
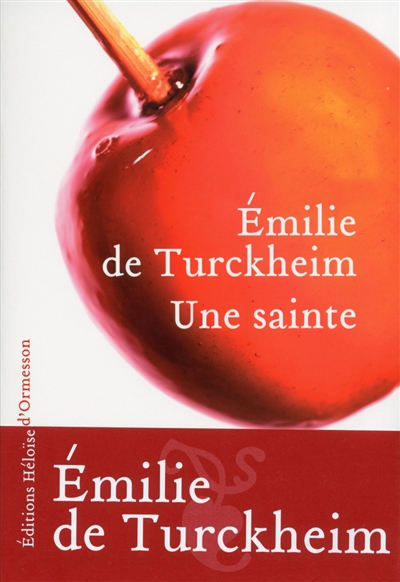
-
Émilie de Turckheim
Une sainte
Éditions Héloïse d’Ormesson
22/08/2013
208 pages, 18,50 €
-
Chronique de
Stanislas Rigot
Librairie Lamartine (Paris) -
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Nadège Badina de Le Square (Grenoble)
- Catherine Béchet de Spicilège (Lagny-sur-Marne)

✒ Stanislas Rigot
(Librairie Lamartine, Paris)
Ne cherchez pas plus loin l’ovni littéraire de cette rentrée : il est en effet difficile d’imaginer que le nouveau roman d’Émilie de Turckheim ne remporte ce titre haut la main. Avec les félicitations du jury que l’expérience n’aura pas manqué de laisser un rien secoué.
Une héroïne, une jeune femme et un objectif : devenir sainte. Voilà le point de départ d’une histoire qui n’a pas fini de surprendre le lecteur embarqué dès les premières pages dans ce drôle de roman aux allures de montagnes russes, aux creux et aux sommets desquelles vous trouverez de l’amour et de la violence, du rire et de la poésie, de l’espoir et des larmes, des agacements, des souffrances et de petites et grandes joies, mais avant tout de la vie majuscule. L’originalité du récit, qui ne laisse jamais la possibilité d’anticiper un quelconque rebondissement, et la force de son écriture, tour à tour coulante et revêche, imaginative en diable, colle parfaitement à cette folle aventure dans une détonante adéquation de fond et de forme, propulsant Une sainte dans un hors catégorie toujours réjouissant au milieu du flot de copié/collé que propose bien trop souvent les massifs arrivages romanesques de la rentrée littéraire. Et le fait que ce maelström ne puisse faire l’unanimité est définitivement une bonne nouvelle !
Page — Pouvez-vous nous présenter l’héroïne de votre roman, la peut-être sainte du titre ?
Émilie de Turckheim — Petite, mon héroïne était fascinée par les crucifix accrochés au-dessus des tableaux noirs de son école. De là naît la grande conviction de sa vie : tôt ou tard, elle sera sainte. En attendant sa canonisation, elle déborde d’une folle énergie, généreuse et mystique, et consacre tout son temps aux autres : à son vieux voisin de palier, réactionnaire et fou amoureux d’elle ; à sa mère vivant recluse dans une « maison de repos » aux frontières du théâtre et de la réalité ; à sa meilleure amie qui a l’ambition de devenir une grande comédienne mais s’enlise dans de petits rôles attristants d’actrice porno. Et comme, dans ce roman, tout part des contes et des petites histoires, il suffit d’un rêve, une nuit, dans un donjon en compagnie d’un prisonnier, pour que mon héroïne décide à son réveil de devenir « visiteuse de prison ». Écouter et consoler les hommes que la société a bannis et mis en cage : quel idéal passe-temps pour une sainte en herbe ! C’est décidé : elle illuminera le quotidien de Dimitri, criminel au bord du gouffre rencontré au parloir. Mais que faire d’un homme qui refuse d’être sauvé ? Puis qui ne sait même pas dire merci pour sa liberté retrouvée ? Peut-être serait-il préférable de le renvoyer bien au chaud, derrière les barreaux…
Page — Dès l’entame du texte, la surprise stylistique est totale : comment avez-vous envisagé l’écriture de ce roman, le travail nécessaire ?
É. de T. — Pour écrire ce roman, j’avais plein de musiques en tête et je les ai jouées tour à tour : l’air lapidaire et mystérieux des contes pour enfants et de la Bible ; la voix intérieure qui murmure et accompagne parfois les rêves (j’ai pensé à la voix off de Marcello Mastroianni dans 8 ½ de Fellini) ; les moments impressionnistes où la syntaxe devient molle et sans contour, sans limite (à la façon des descriptions soûles de paysages mexicains verdoyants dans Au-dessous du volcan de Lowry) ; les passages qui résonnent en fanfares, exagérés et bruyants, réservés aux moments burlesques (par exemple, les scènes avec les championnes du monde de curling assassinant les policiers). Et bien d’autres formes dont j’aime la poésie empruntée à des registres étrangers à la littérature : l’« essai » (sur la course à pied), l’ordonnance médicale, l’arrêt de la cour d’assises (lorsque les deux pythons sont traduits en justice), les conversations entre l’héroïne et les prisonniers rapportés sur le mode sec du « verbatim », la « critique » de ciné ou de théâtre. Le style que j’ai employé est une mise en abyme en soi, car toute une partie de l’intrigue (notamment la façon dont l’héroïne accuse Dimitri de l’avoir violée) suggère que « tout dépend toujours de la façon de raconter ». Or la « façon de raconter », dans son expression la plus élémentaire, c’est précisément « le style », qui n’est jamais une décoration, mais qui est la vérité du roman, la couleur de sa voix.
Page — Pouvez-vous nous parler de ces petits contes qui traversent l’histoire, multiples et vertigineuses mises en abyme du récit ?
É. de T. — Le roman est parsemé de petits contes : à chaque fois que l’héroïne rend visite à sa mère dans la maison médicalisée où elle vit, la mère demande à la fille de lui raconter une histoire et la fille invente aussitôt un conte. Ces contes jouent plusieurs rôles. D’abord, ils sont la façon qu’ont la fille et la mère de communiquer : tout ce que la fille ne peut pas directement dire à sa mère – par pudeur, par peur, par émotion d’amour –, elle le dit par le truchement de ces petites histoires. Ensuite, ces histoires sont une sorte de double du roman, qui nous renseignent sur les personnages principaux (l’héroïne, sa meilleure amie Marie, sa mère, le vieux voisin…) et font progresser l’intrigue. Enfin – et c’est le plus important – les contes sont une allégorie qui nous rappelle sans cesse que le roman entier est une « petite histoire », que la vie elle-même est une « petite histoire » avec ses personnages, sa magie et ses sentiments, et que lorsque nous racontons des histoires (lorsque nous écrivons un roman, lorsque nous inventons un mensonge pour arranger une situation, lorsque nous lisons une histoire d’ogres à nos enfants), nous ne nous exilons pas dans le monde inconsistant de l’imaginaire : nous vivons. Parce que raconter est notre façon d’être au monde.
Page — Vous emmenez le lecteur très loin, vous étiez-vous fixé des limites ?
É. de T. — Je ne m’étais pas fixé de limites, pour la bonne raison que je ne m’étais pas fixé de territoire. Je sais à peine de quoi vont parler mes romans quand j’en écris les premières phrases. J’écris comme je marche, ou plutôt comme je cours, en mettant un pied devant l’autre et pleine d’élan, la musique du premier mot entraînant le mot suivant qui me donne l’idée, surgie de nulle part ou de ma mémoire, du troisième, et ainsi de suite. Parfois je suis complètement étonnée par l’étrangeté de ce que j’écris (la folie, l’humour noir, la violence), je me demande d’où tout cela vient, de quels souvenirs, de quels rêves, de quelles choses vues, lues et oubliées de moi, et qui continuent de tricoter dans un coin de mon ventre. Ma seule limite, c’est d’écrire un roman. Ce que je veux dire par-là, c’est que même s’il me prenait l’envie d’écrire une fabuleuse accumulation de phrases insensées, sans début ni fin, sans aucun souci de narration, je ne cèderais pas à cette tentation parce que je veux préserver le plaisir, pour le lecteur (et pour la lectrice que je suis !), de lire un roman. Quelle que soit la forme difforme qu’on lui donne, un roman est fait de lieux, de personnages, d’un minimum d’action, et j’aime cette loi.
Page — L’originalité du texte est totale : par qui avez-vous été influencée ?
É. de T. — J’ai l’impression que tout m’influence et qu’en relisant un roman dont l’écriture a occupé une année de ma vie, je pourrais retrouver l’emploi du temps de mes douze derniers mois. Je peux me souvenir, en me relisant, de la discussion, de l’arbre, du rêve, du livre, du visage croisé dans le métro, m’ayant « donné » l’idée d’écrire telle phrase, tel paragraphe… mais le plus souvent, je n’ai aucune conscience de ces mécanismes d’inspiration. Parfois, au contraire, l’influence est très explicite. Quand j’écrivais Une sainte, j’étais plongée dans la lecture de Viol de Botho Strauss, qui est une adaptation de Titus Andronicus de Shakespeare. Viol s’interroge sur la possibilité de dire et de montrer la violence au théâtre ; et plus généralement sur la possibilité de faire un « spectacle », de mettre en scène ce qui appartient au domaine de l’intimité, de la folie et de l’animalité. Comme dans la pièce de Botho Strauss, il y a un viol au centre de mon roman, et comme dans la pièce de Strauss, je me demande si le fait de dire les mots de la violence n’est pas une manœuvre poétique incapable de transmettre la vérité de la violence (notamment dans la scène où le vieux voisin de palier énumère les supplices qu’il fait subir en rêve à l’héroïne, présentant cette énumération de violences comme une déclaration d’amour). J’ai laissé la trace de cette influence : le chat, dans mon roman, s’appelle Botho…
Je sais aussi que Cormac McCarthy m’a inspirée dans sa façon minimaliste de fondre les dialogues dans le reste du texte, sans que l’on sache précisément qui parle et avec quelle intonation : ces nuances-là se devinent, et cette incertitude est à la fois naturaliste (on restitue les dialogues comme une discussion enregistrée, avec ce qu’elle a d’incomplet pour un auditeur extérieur) et très poétique parce qu’aucun gros sabot (verbes introducteurs, tiret à la ligne, guillemets, etc.) ne vient jamais casser la musique et le rythme du roman.