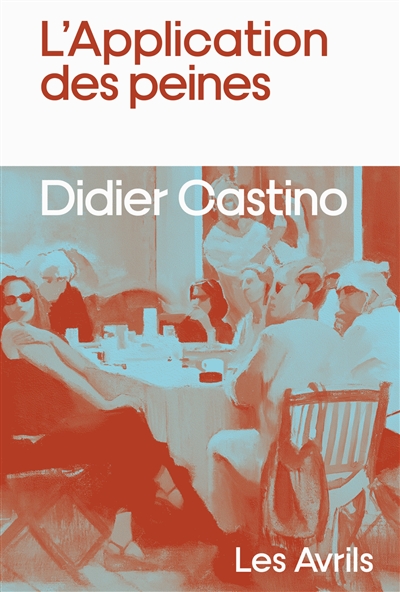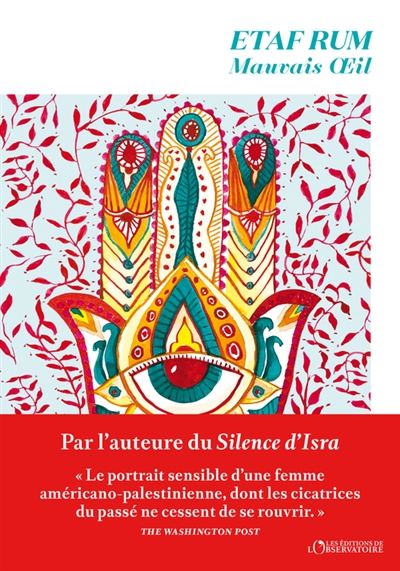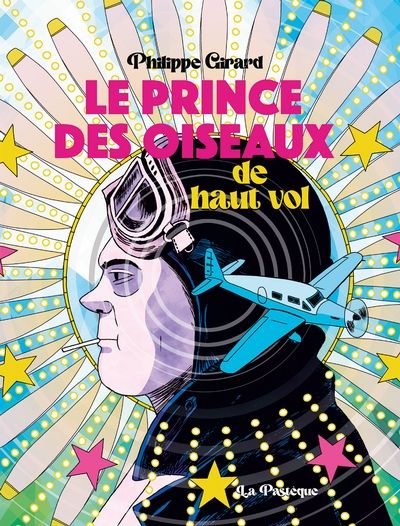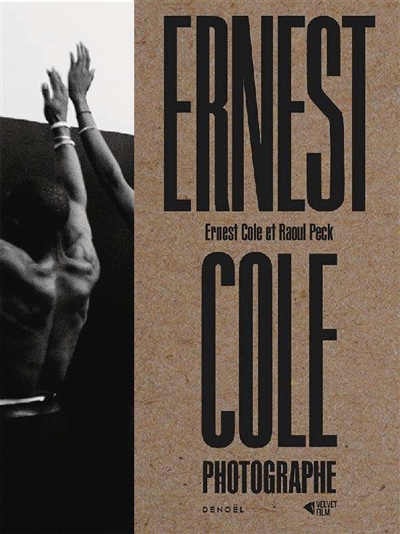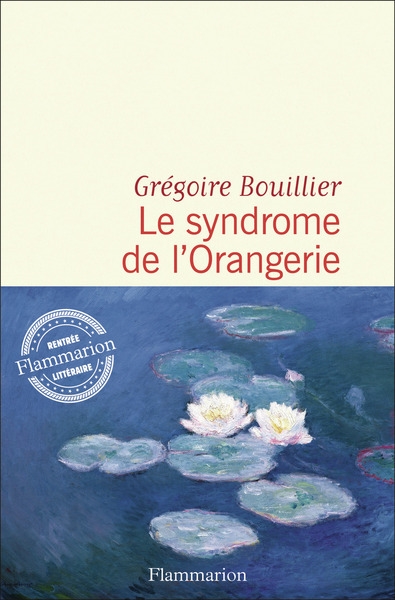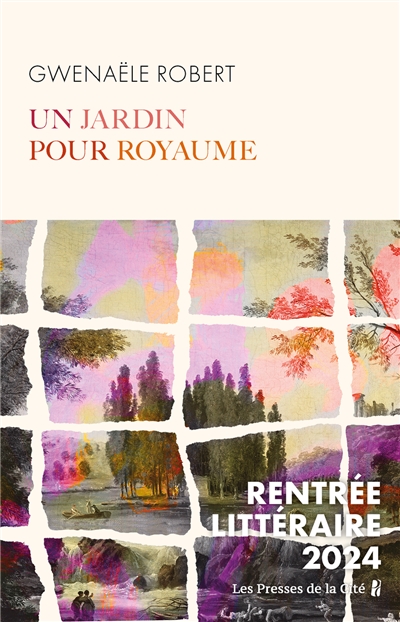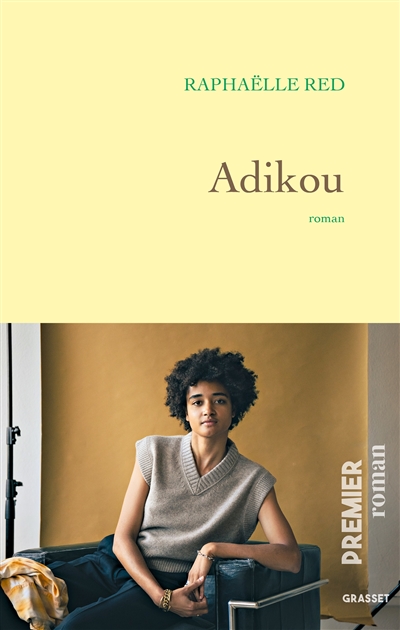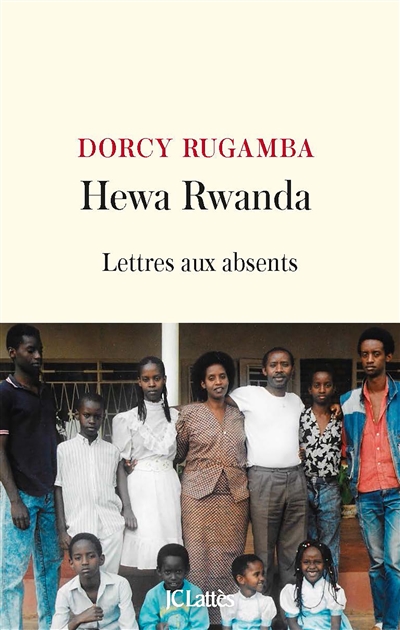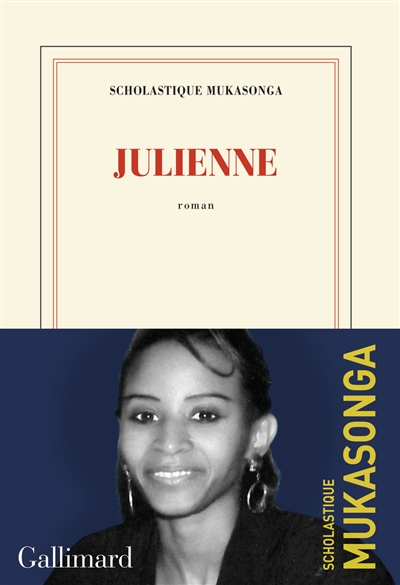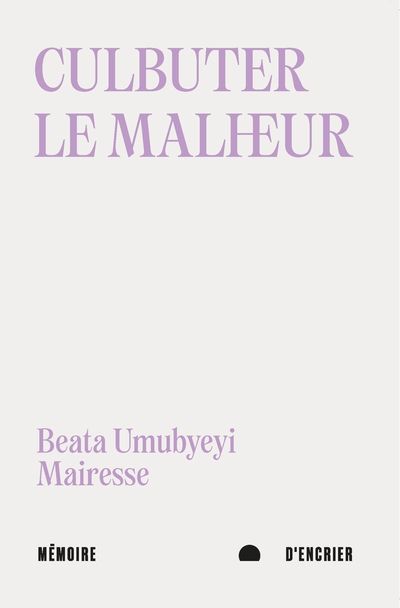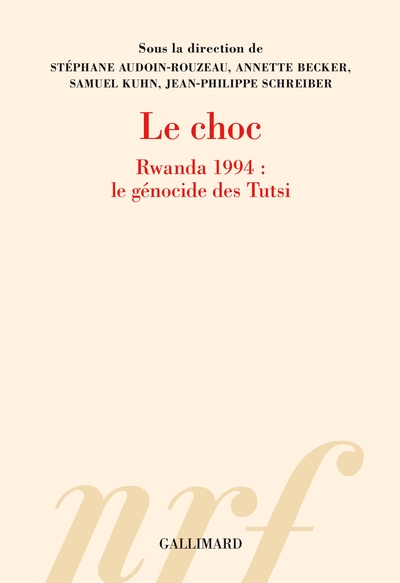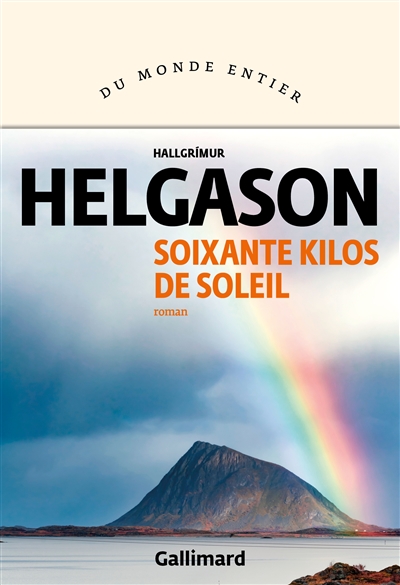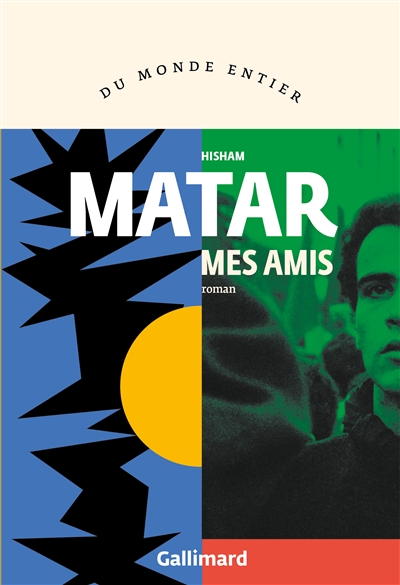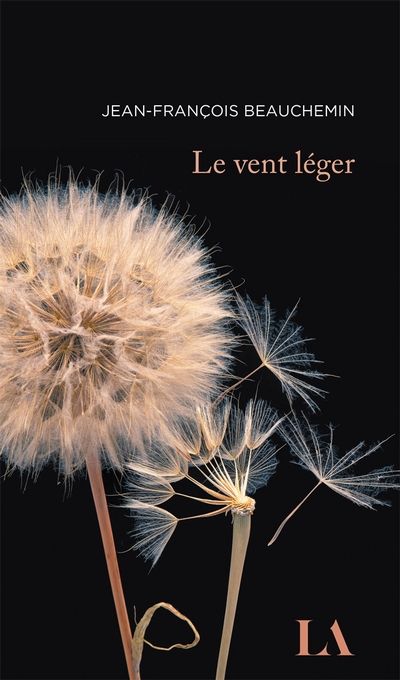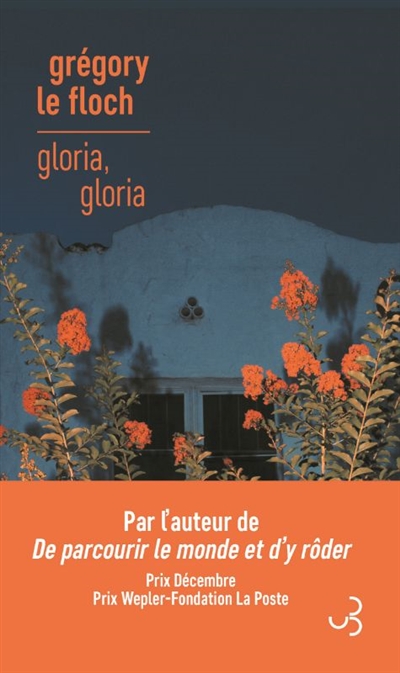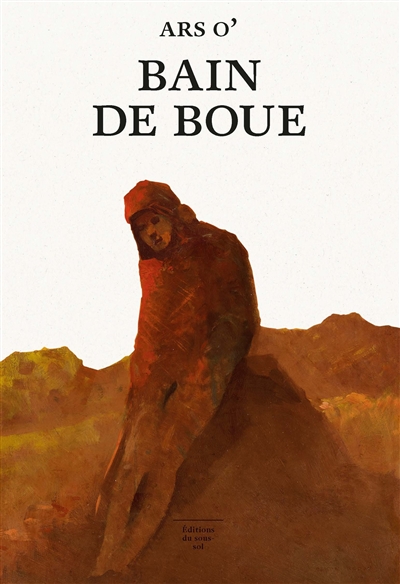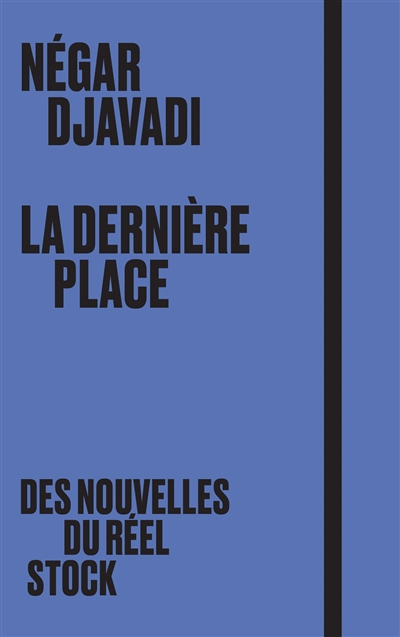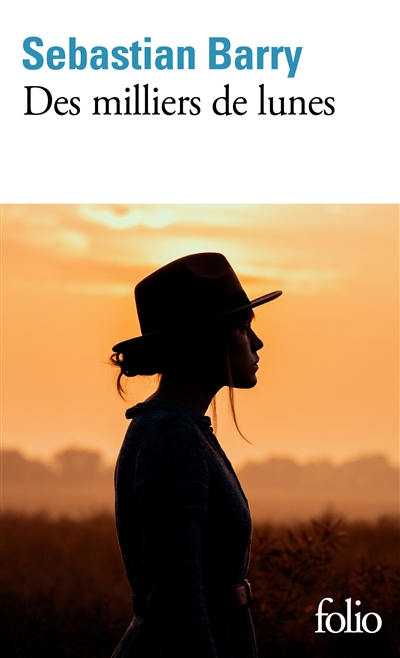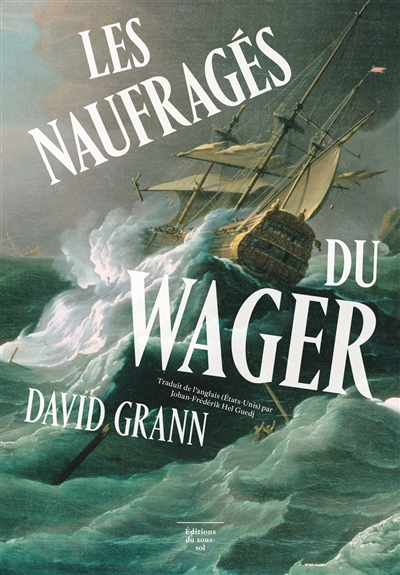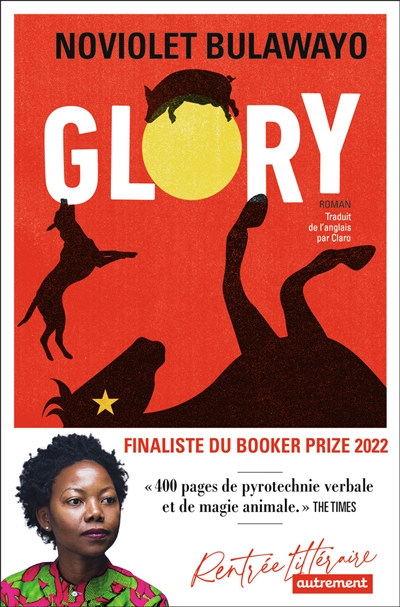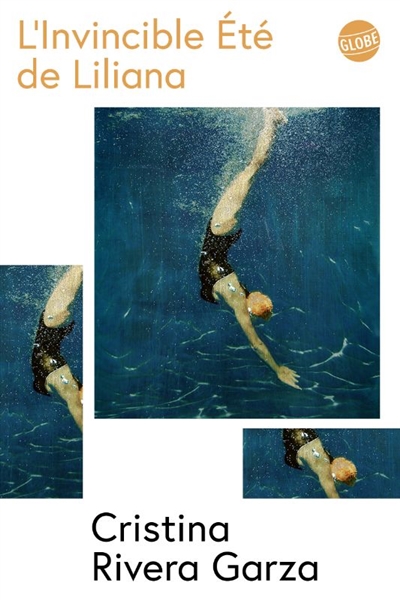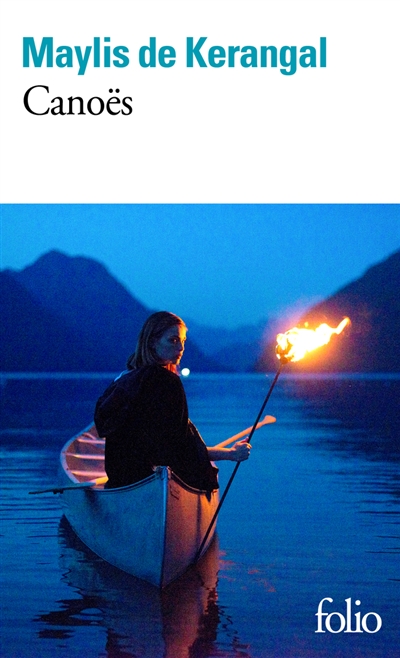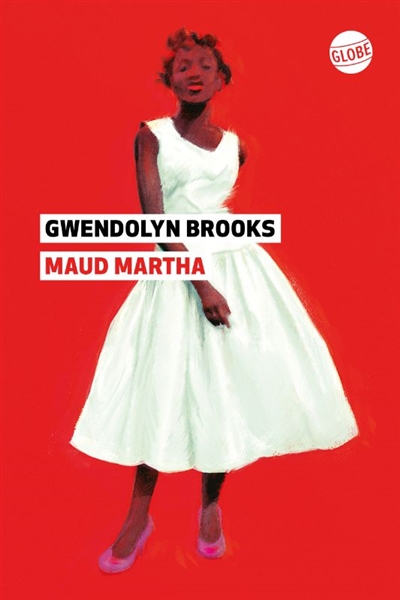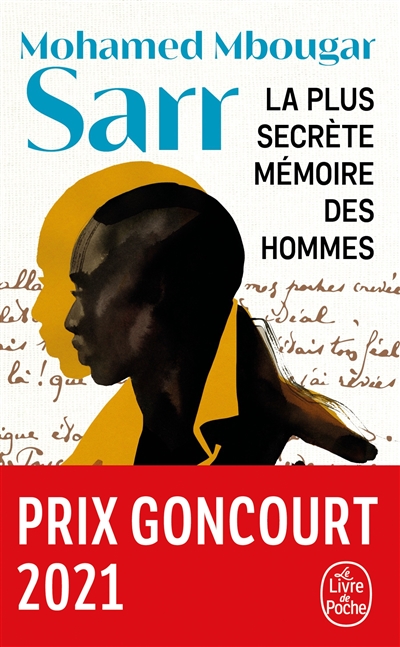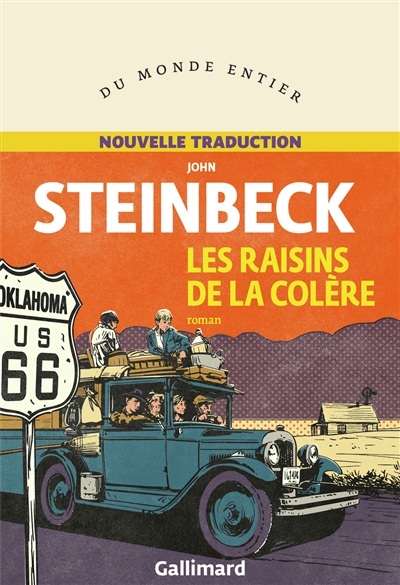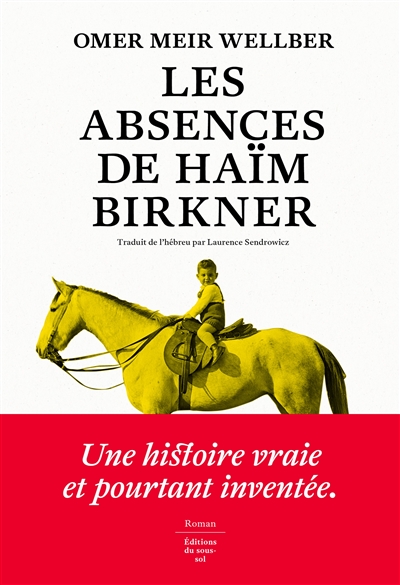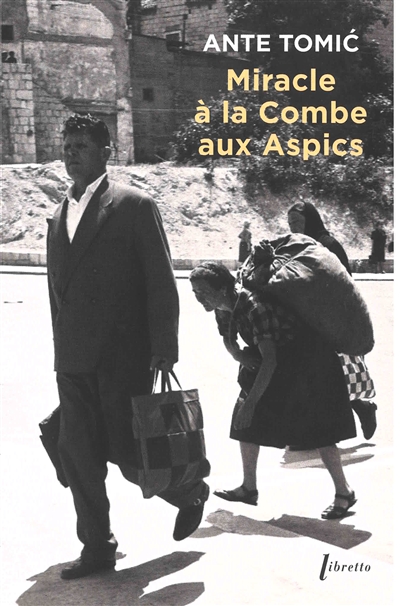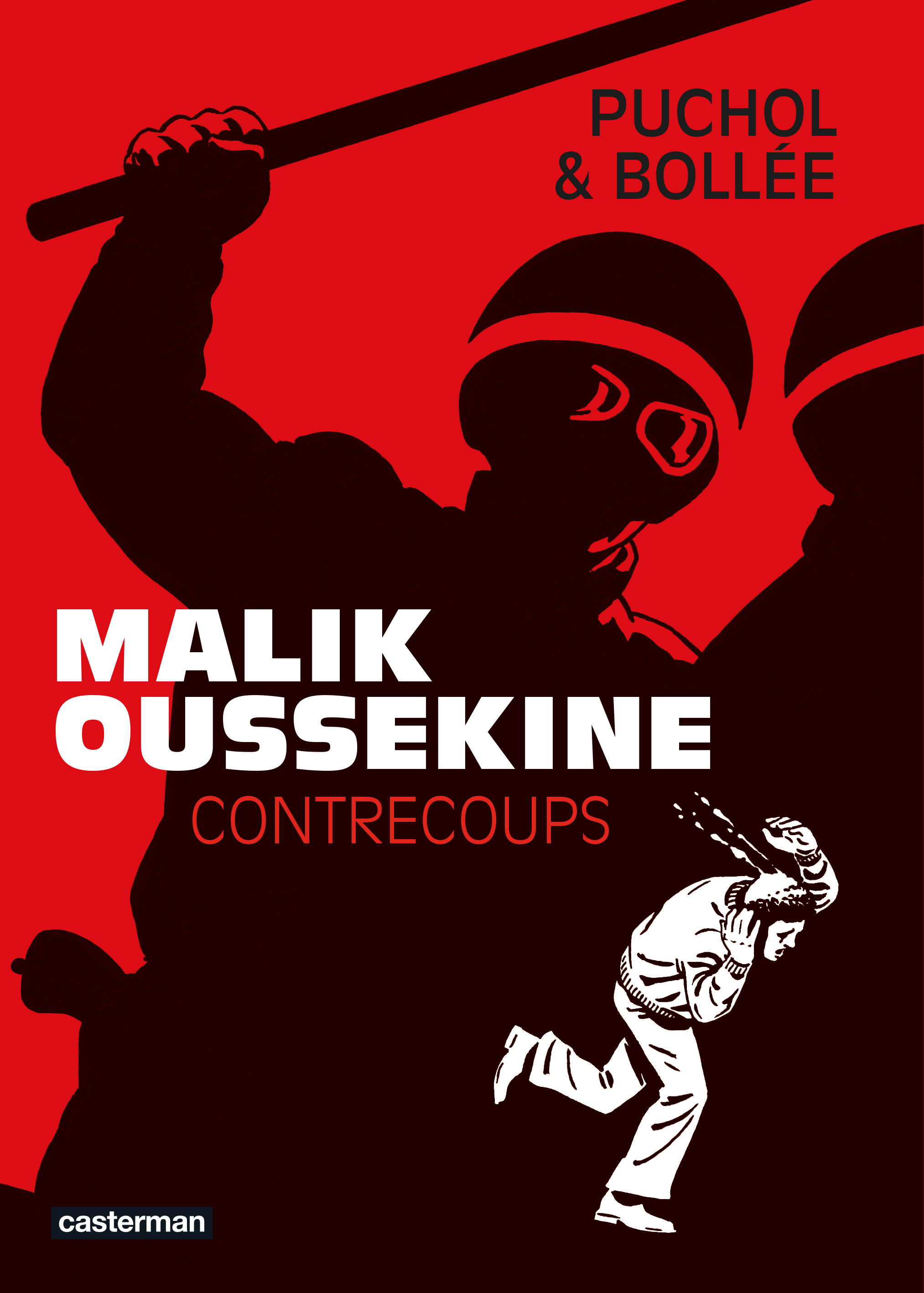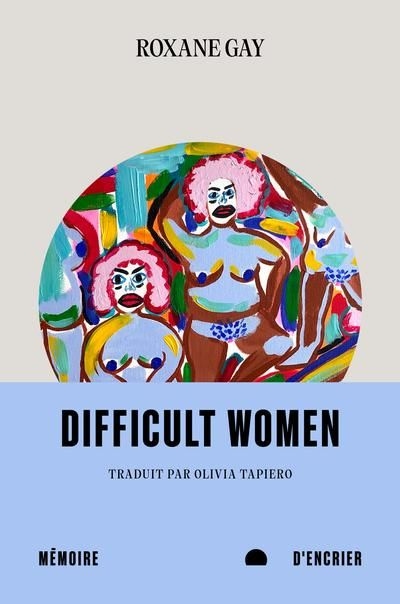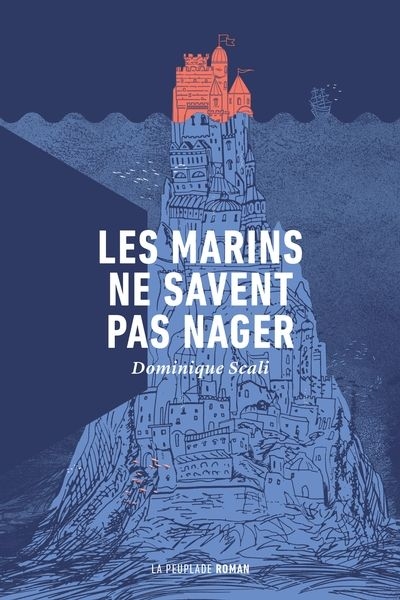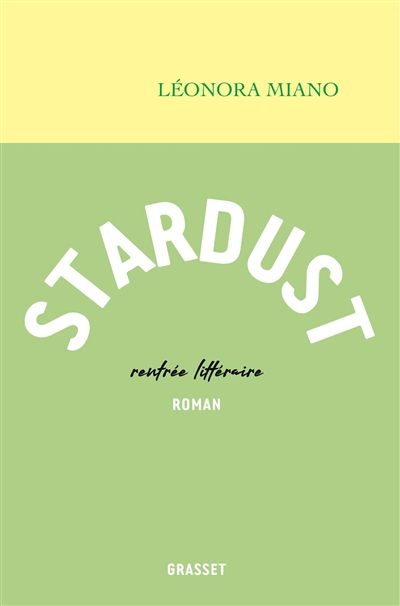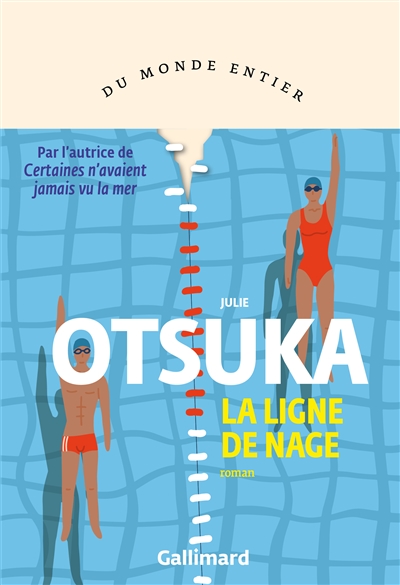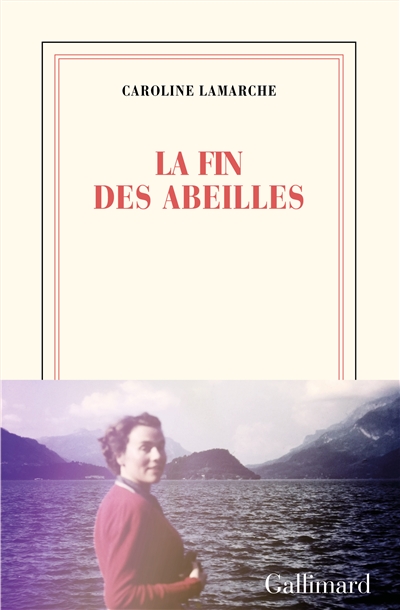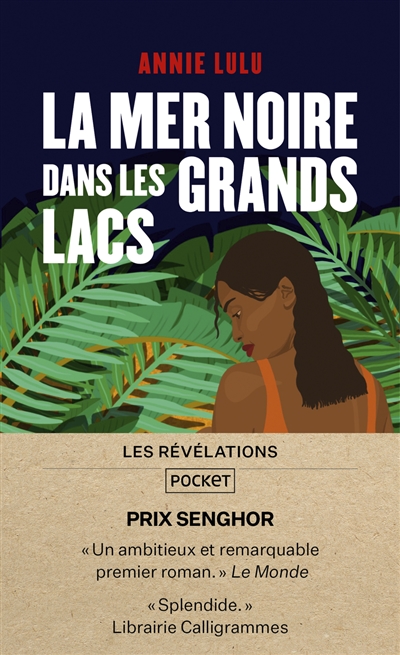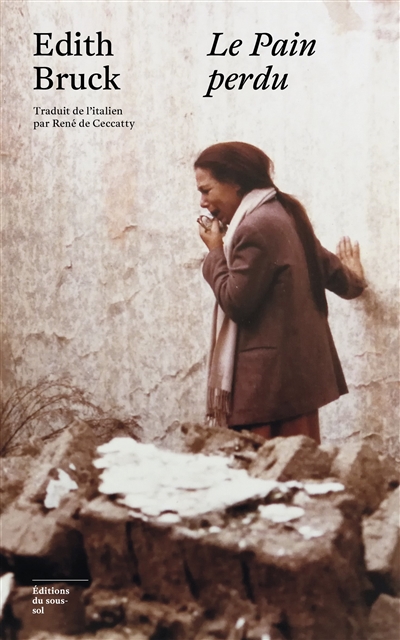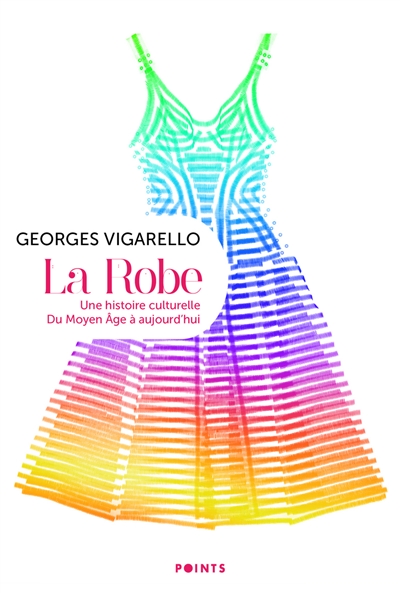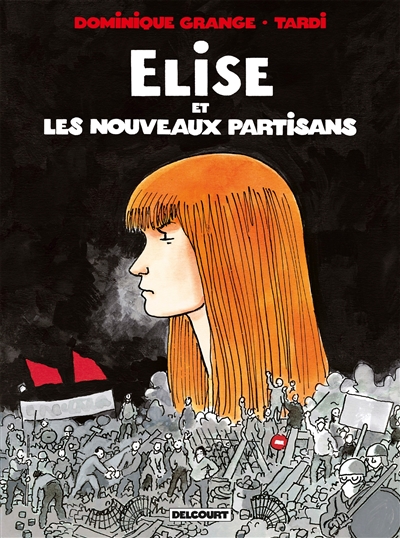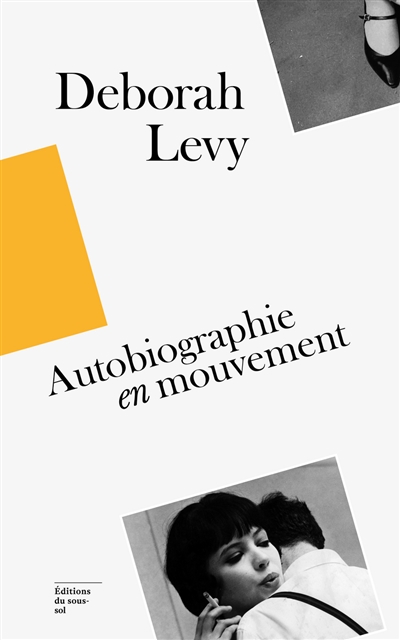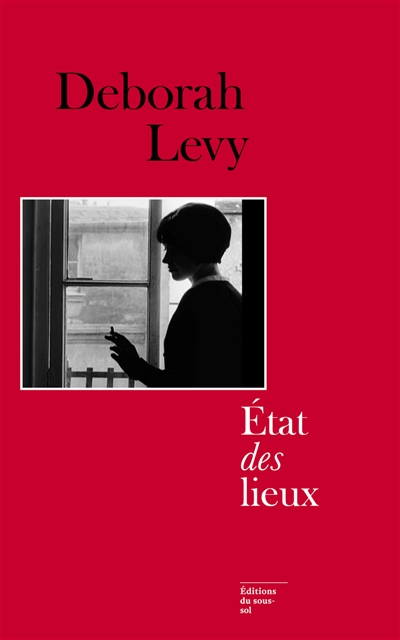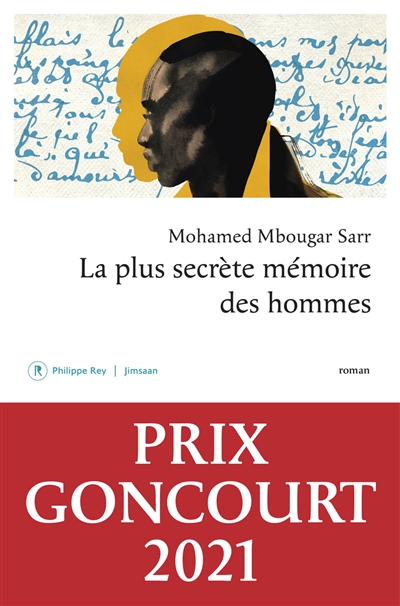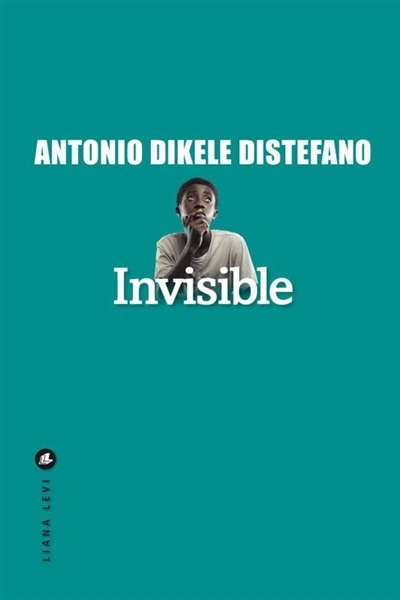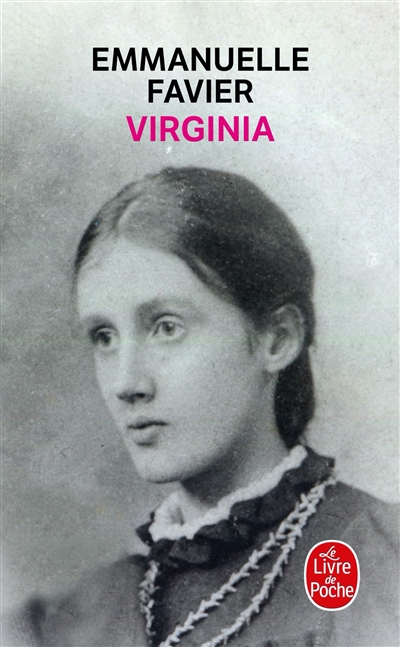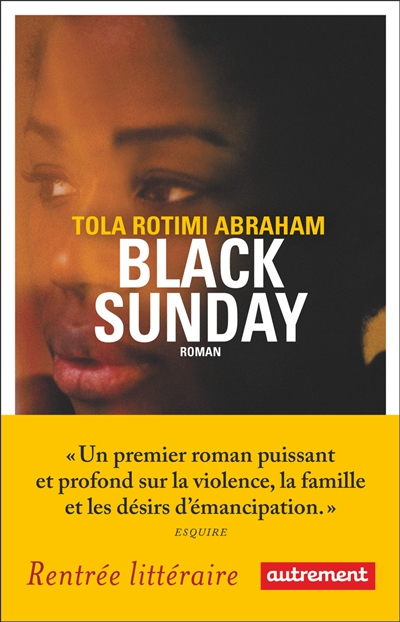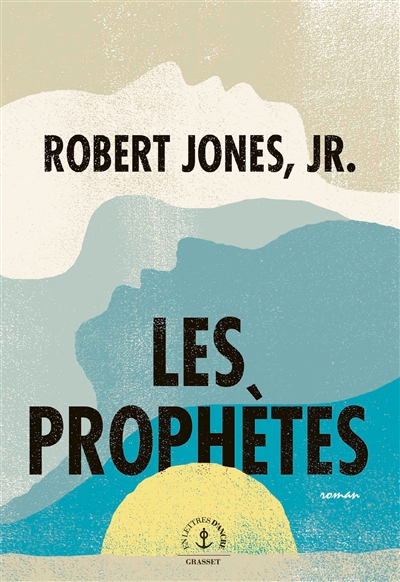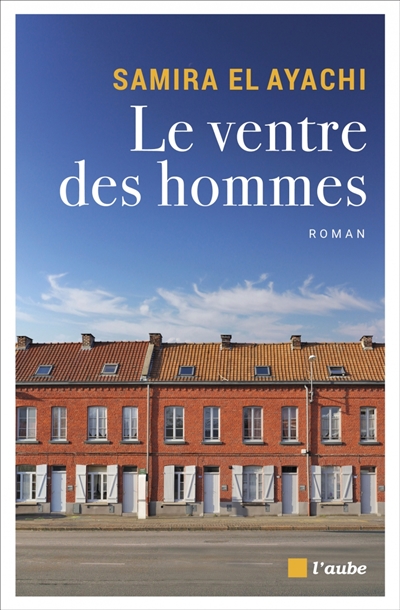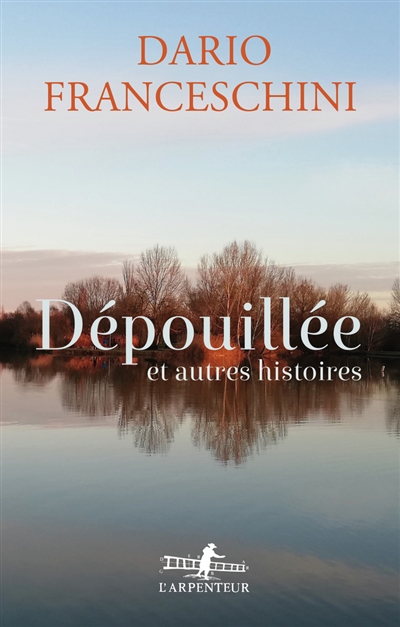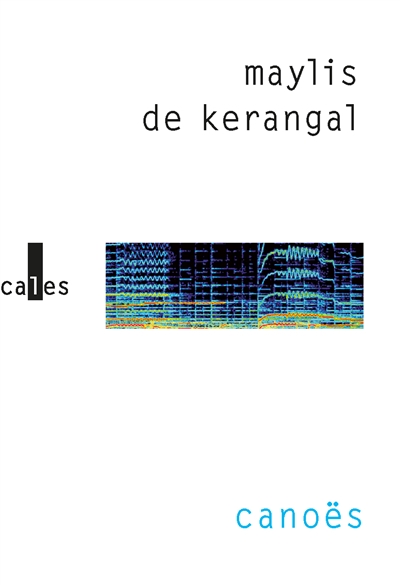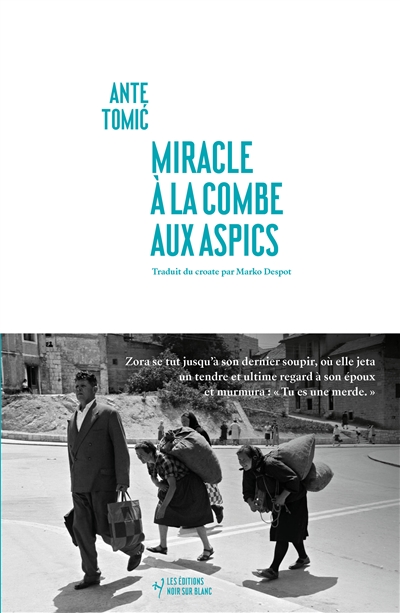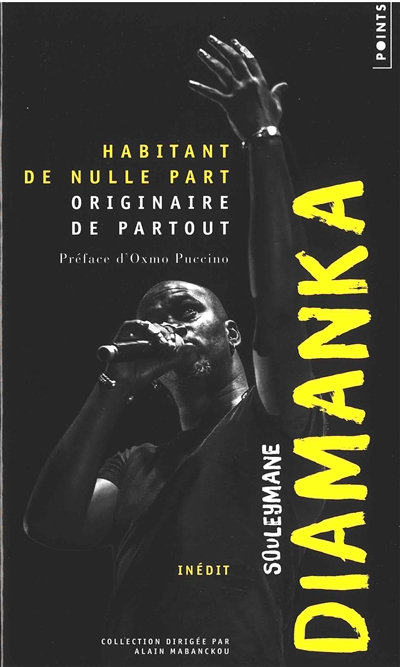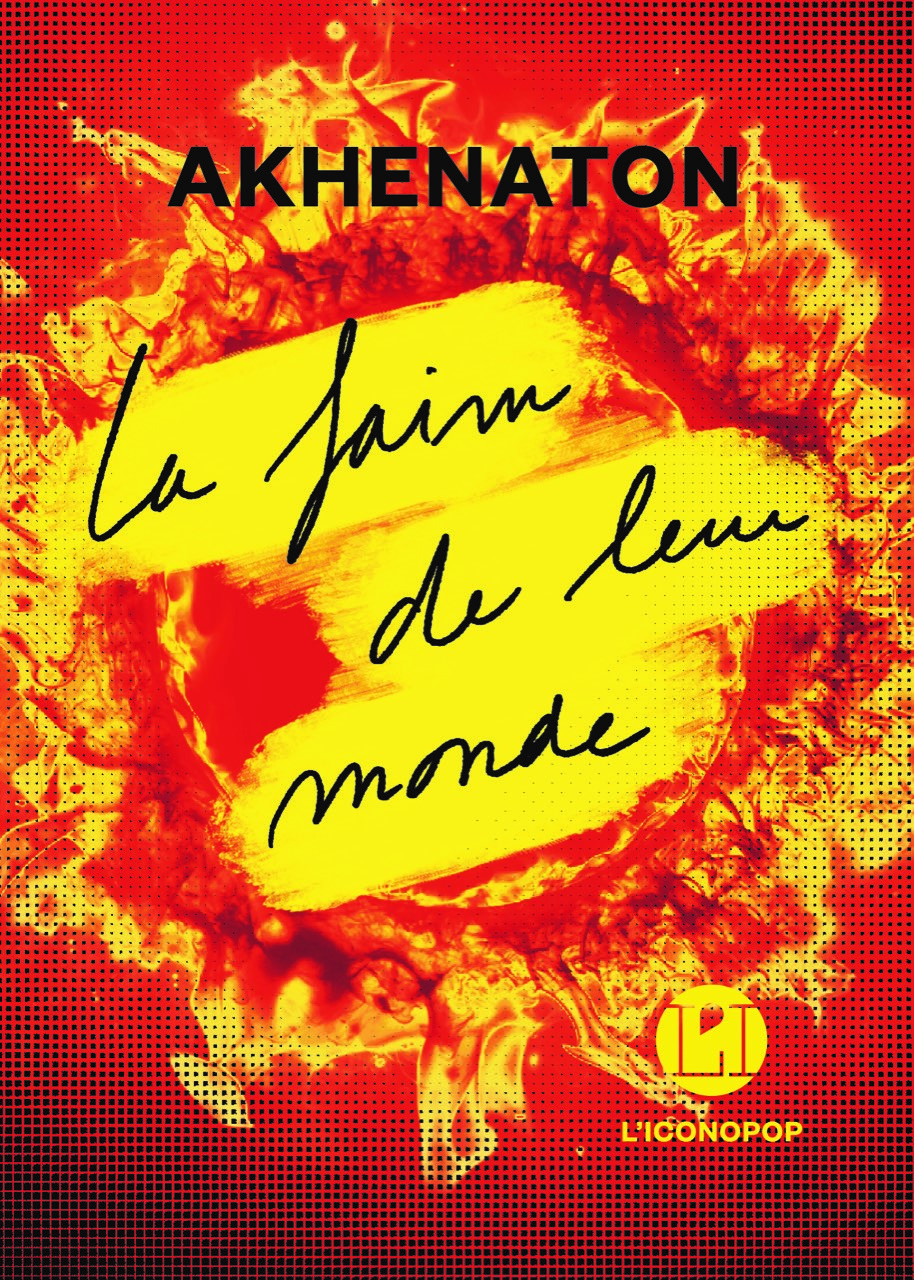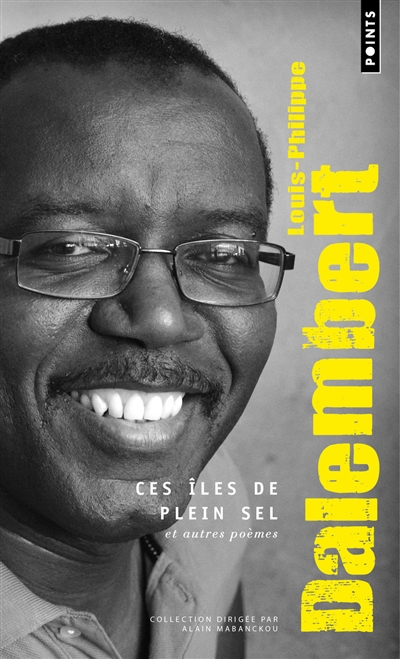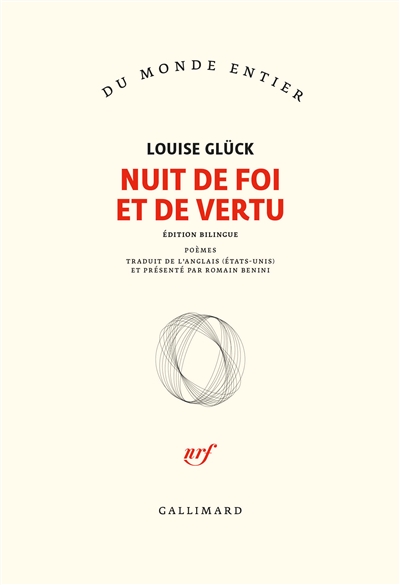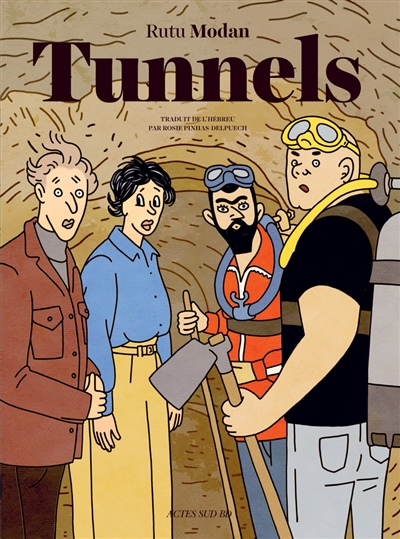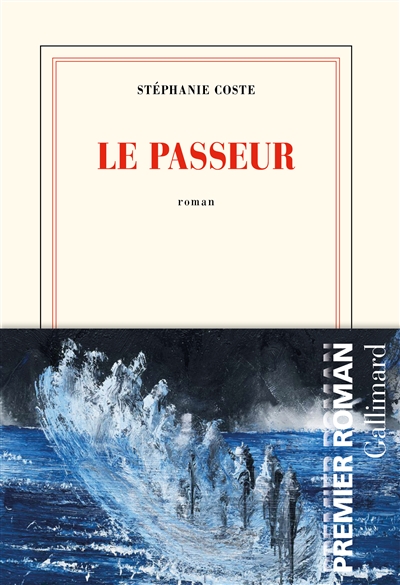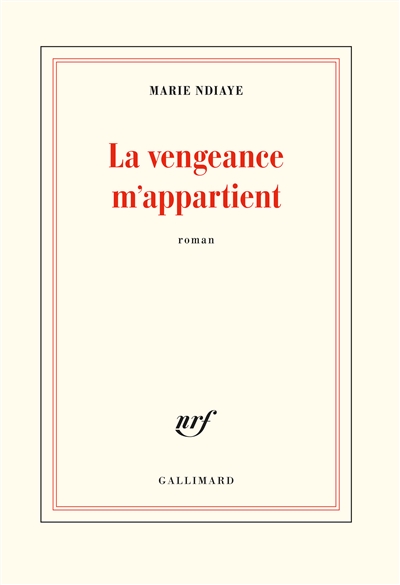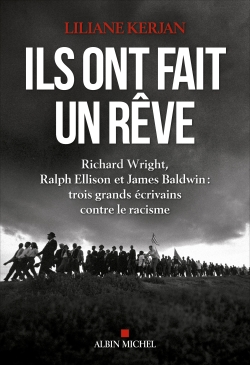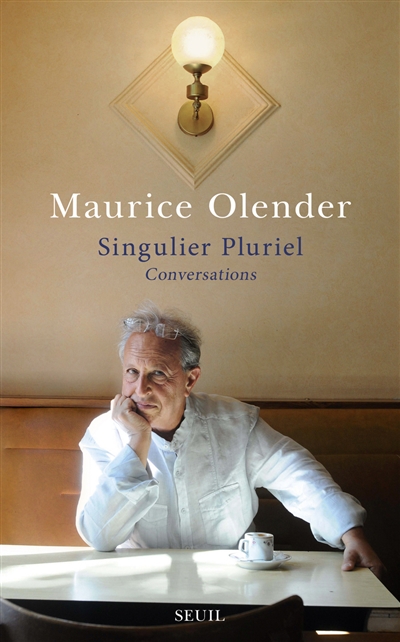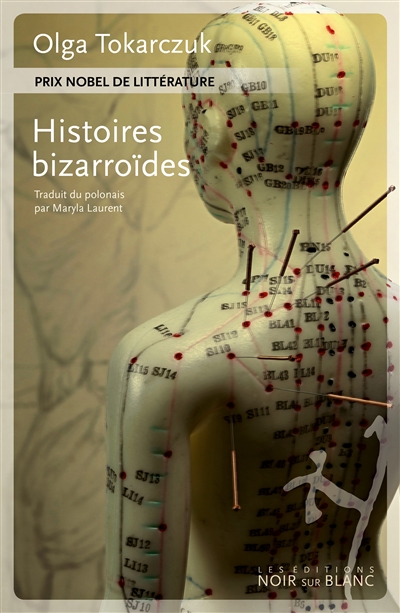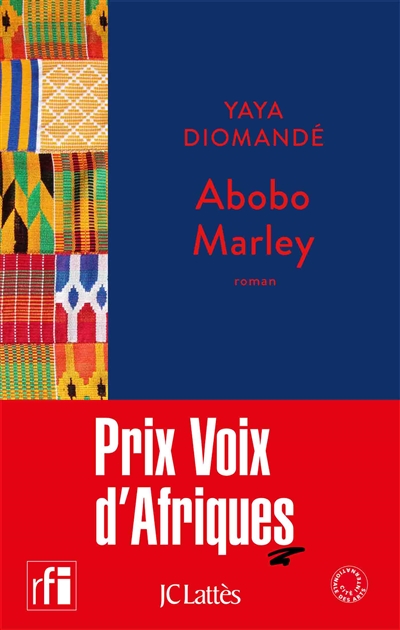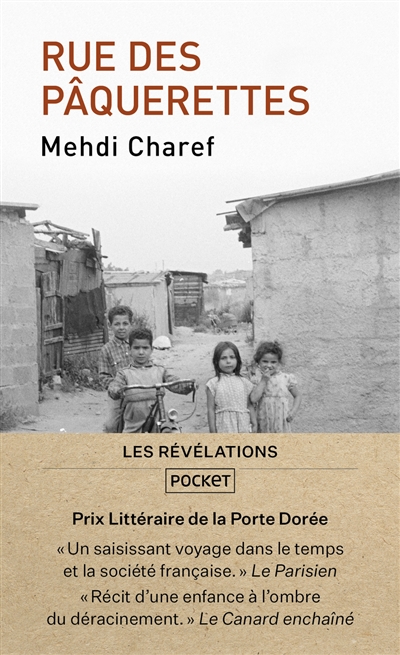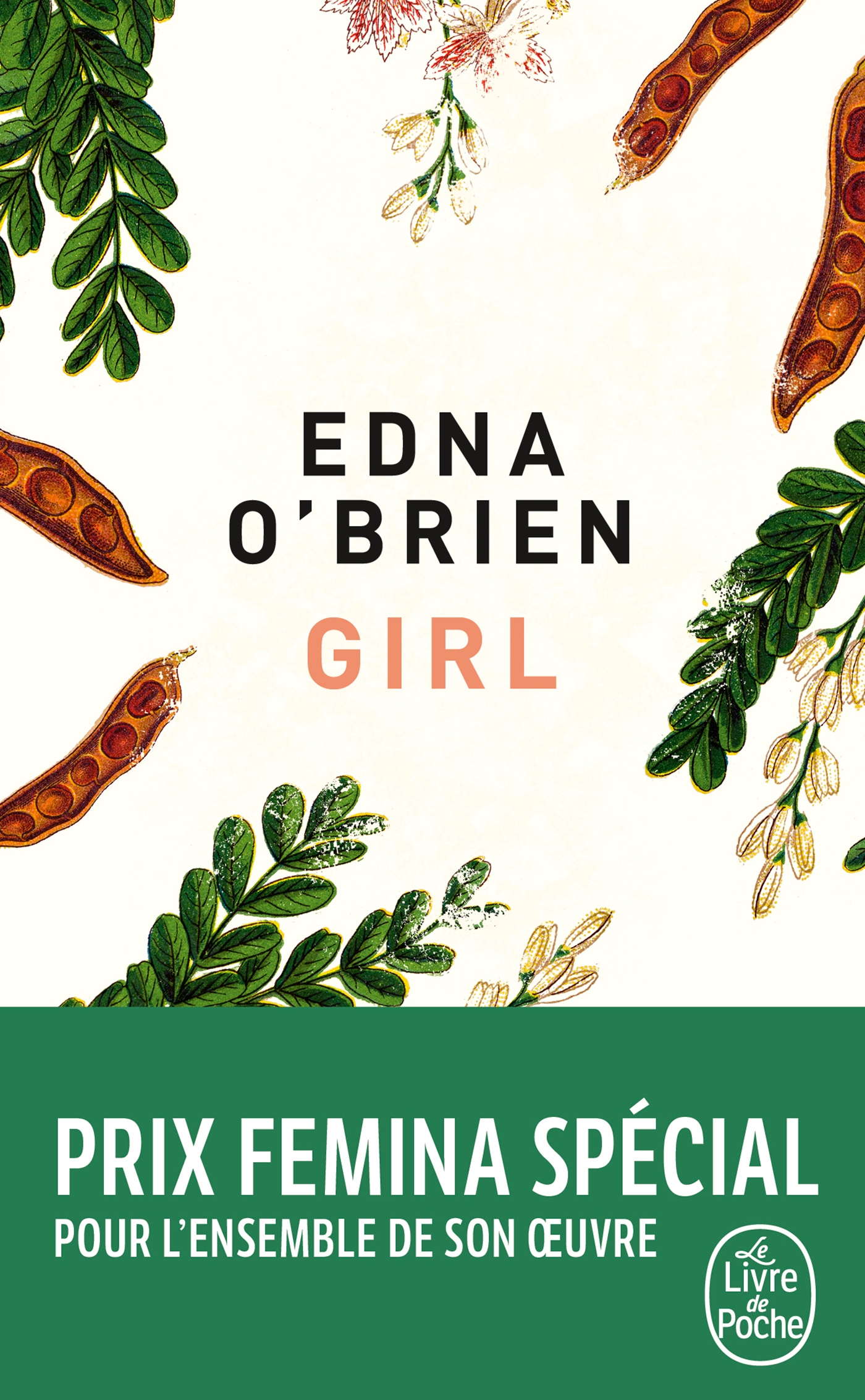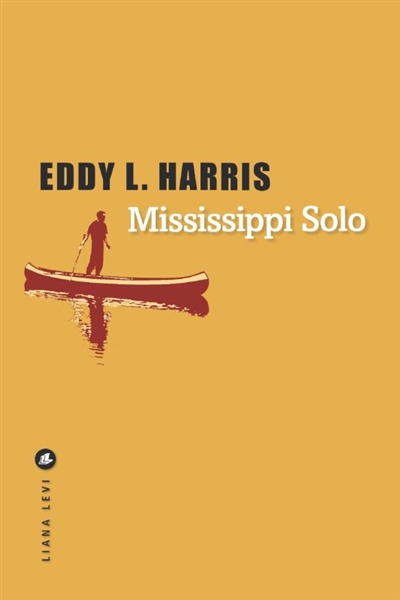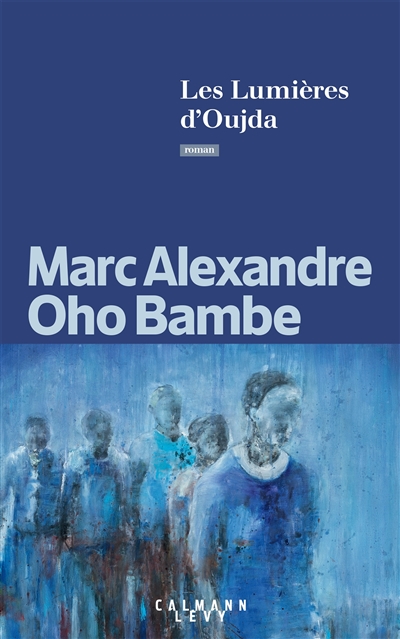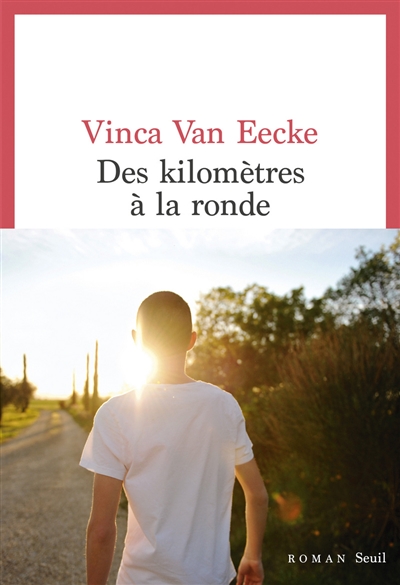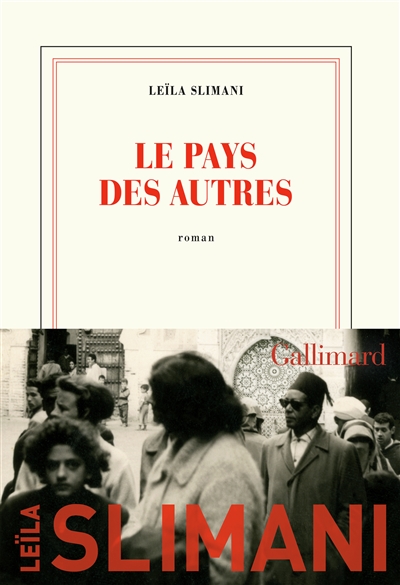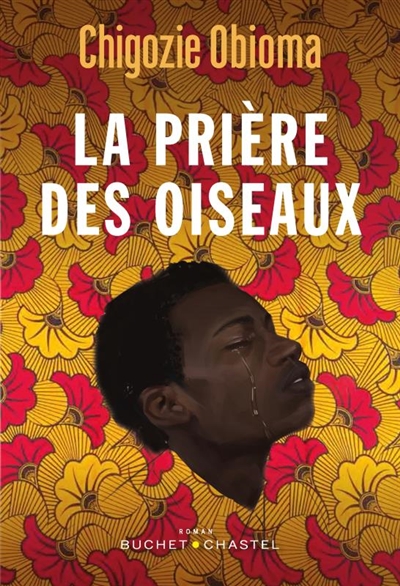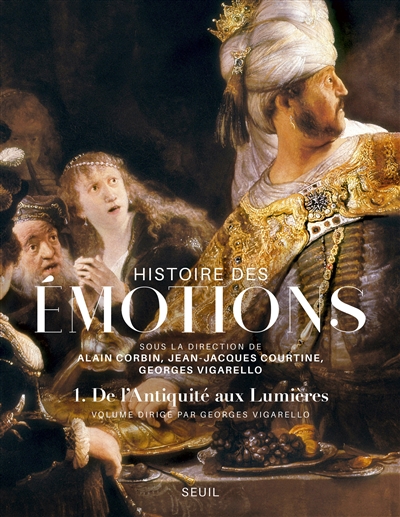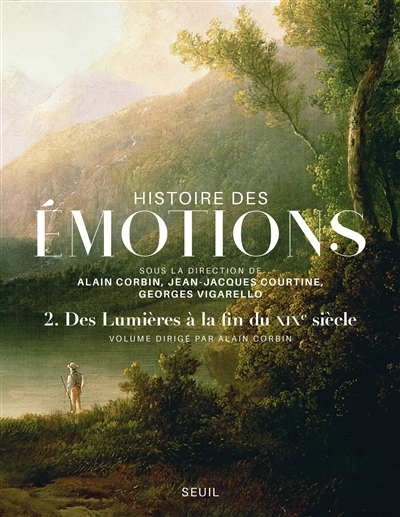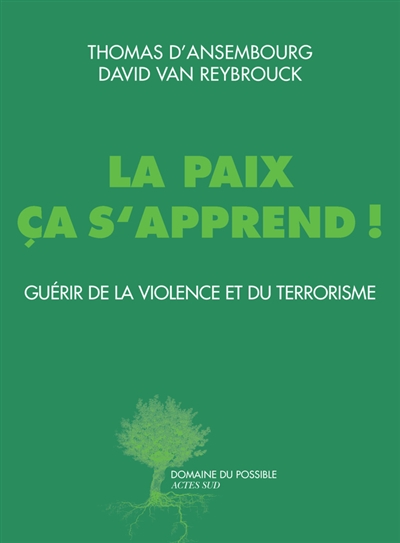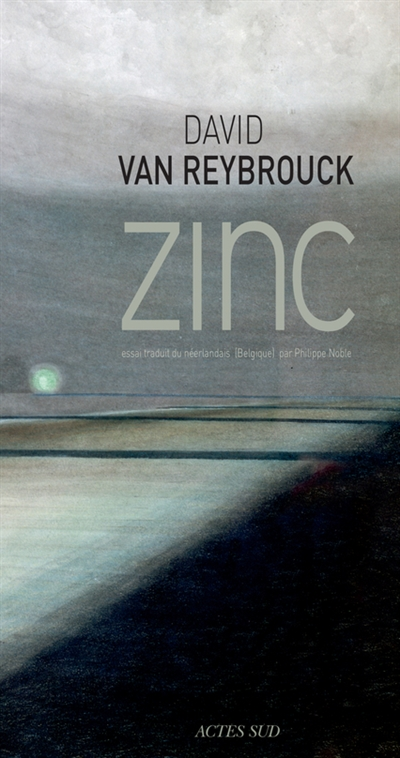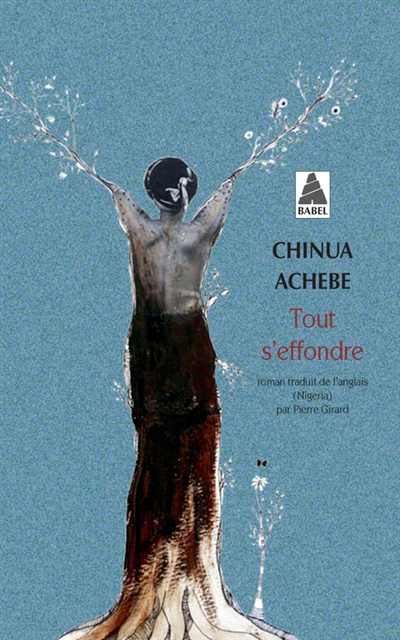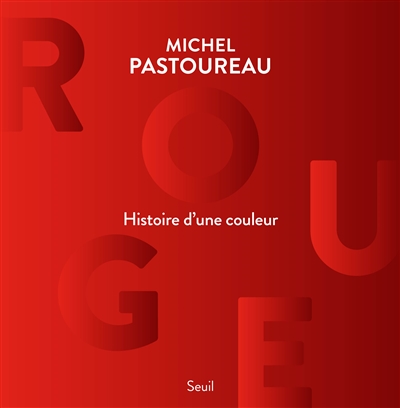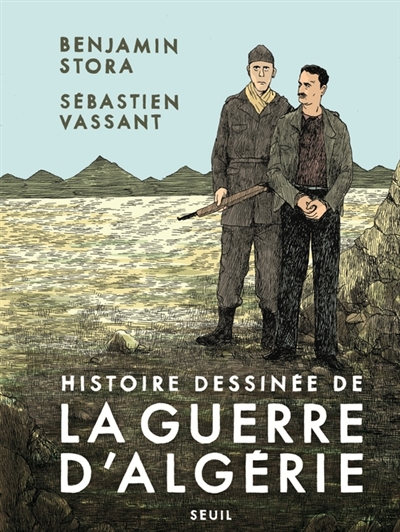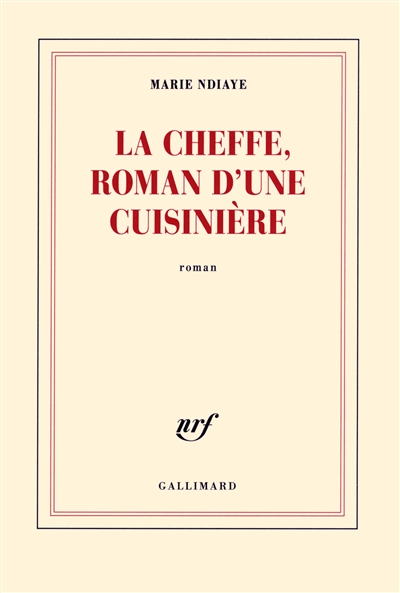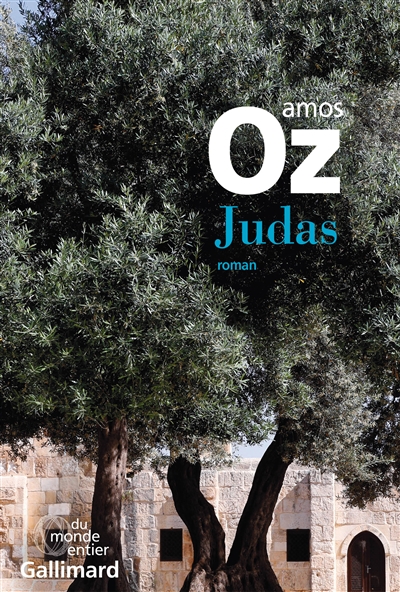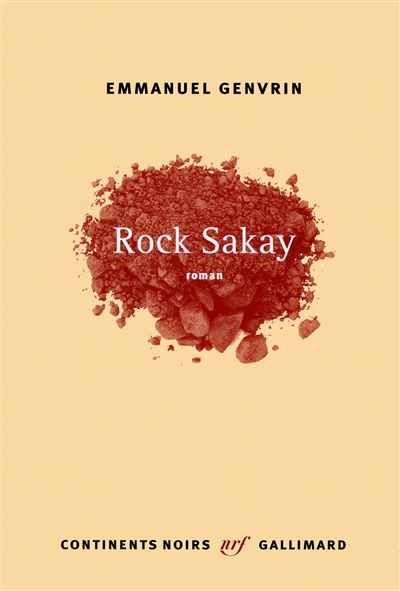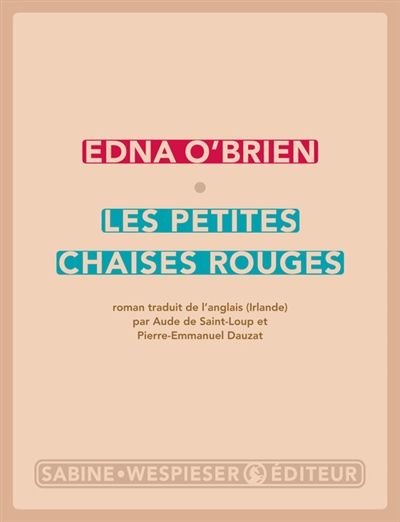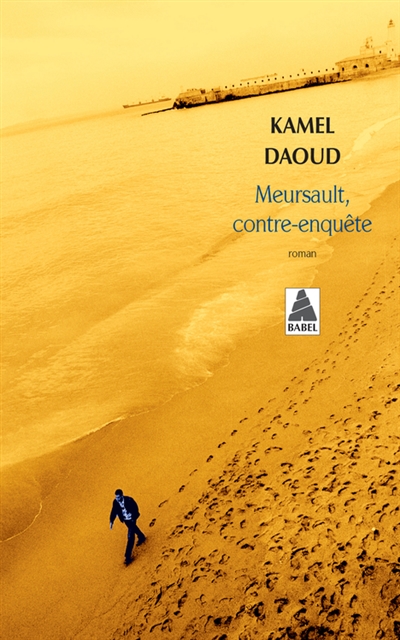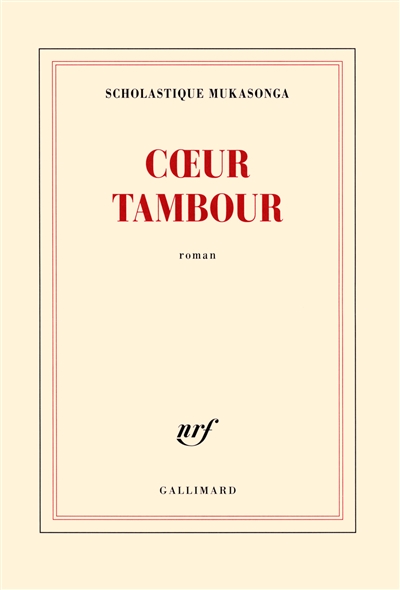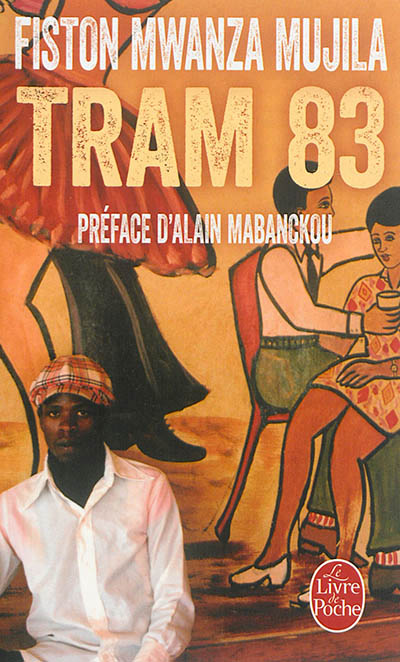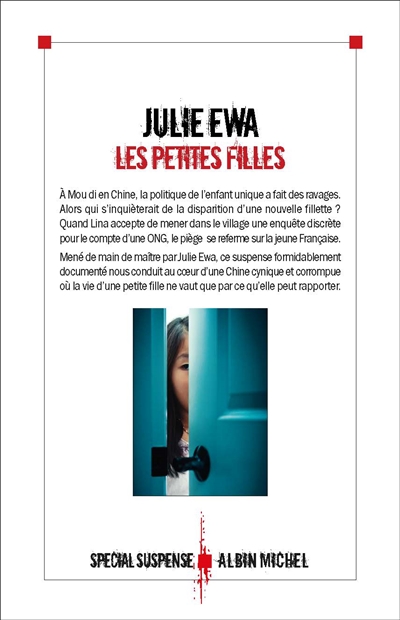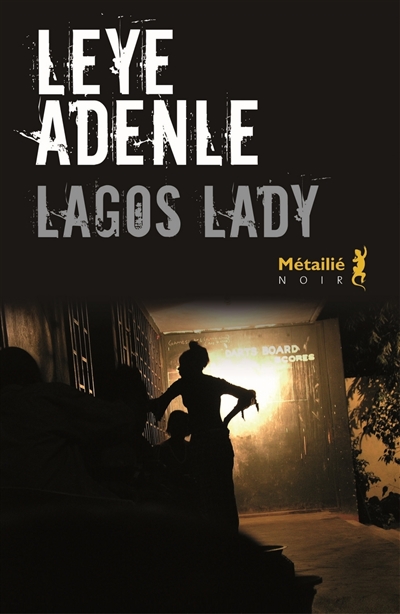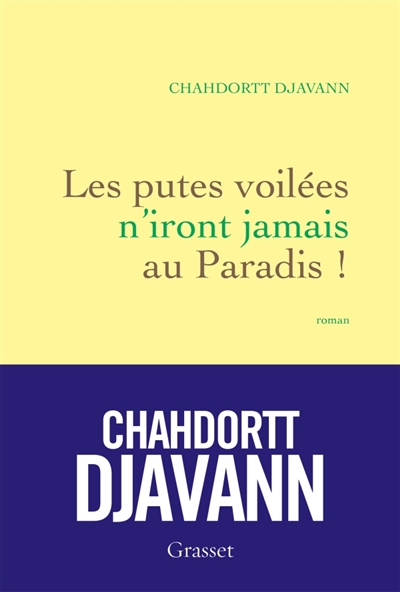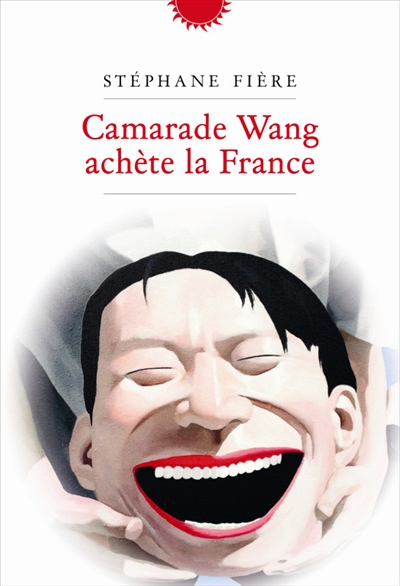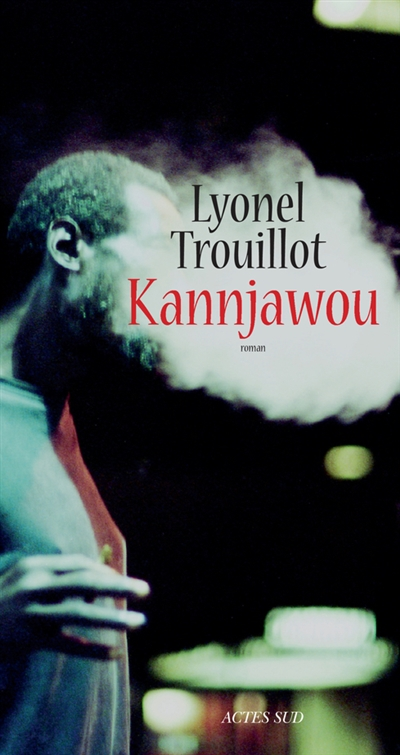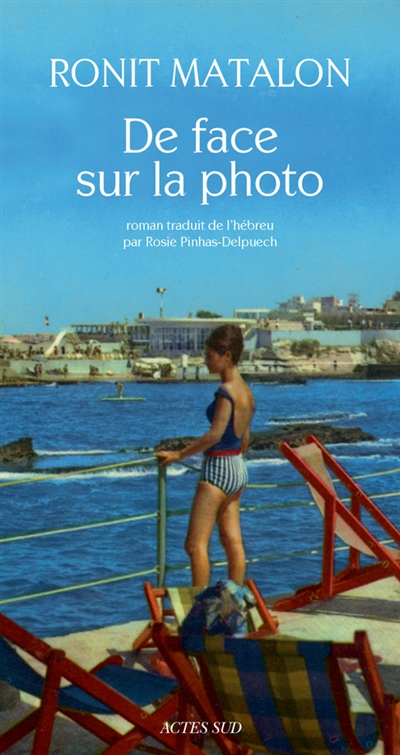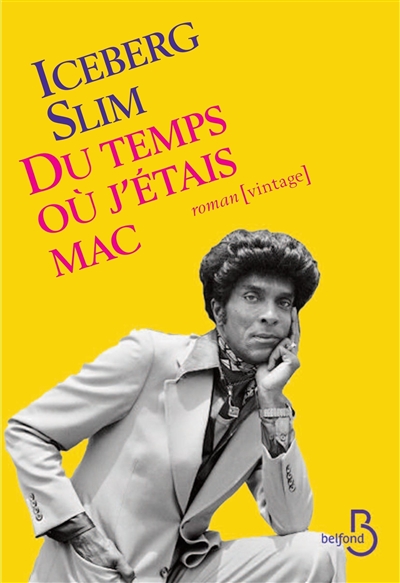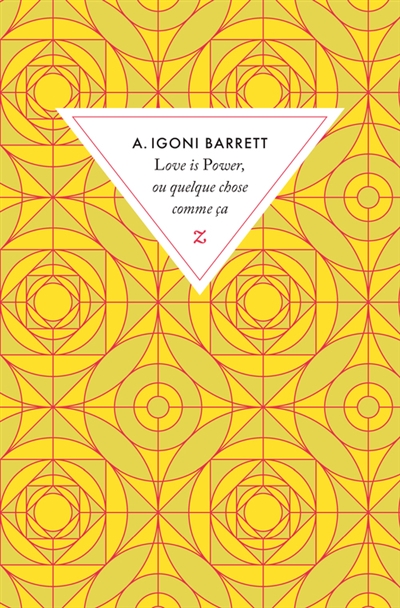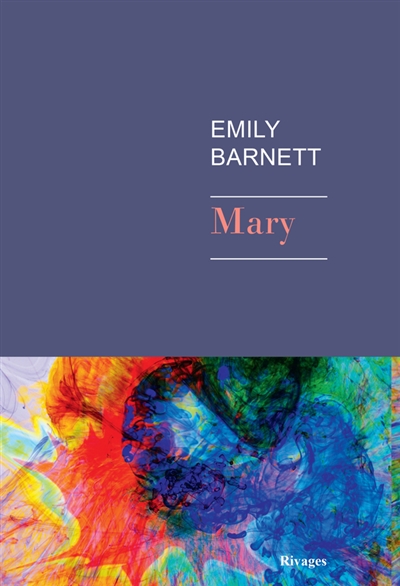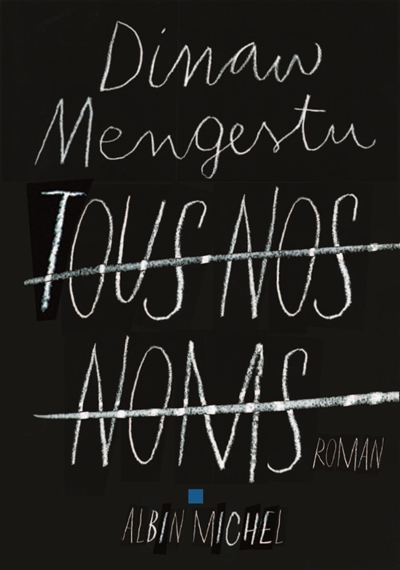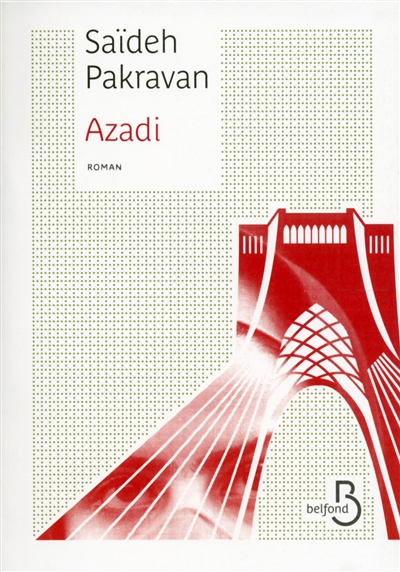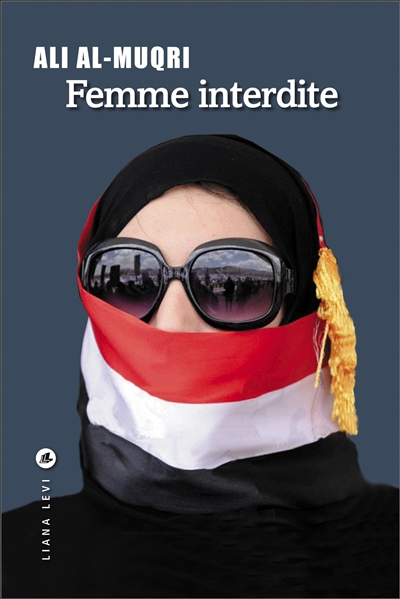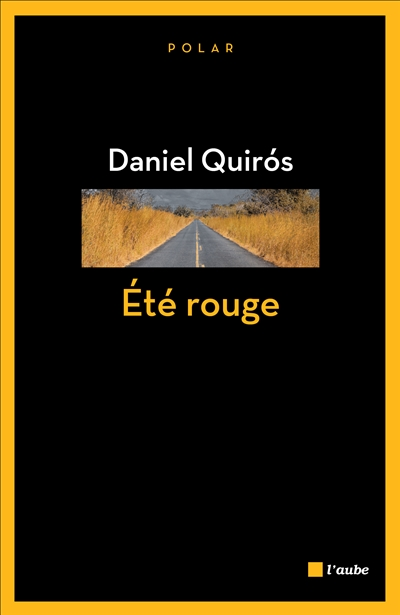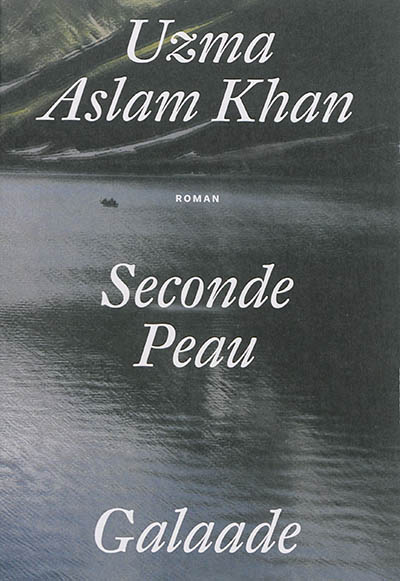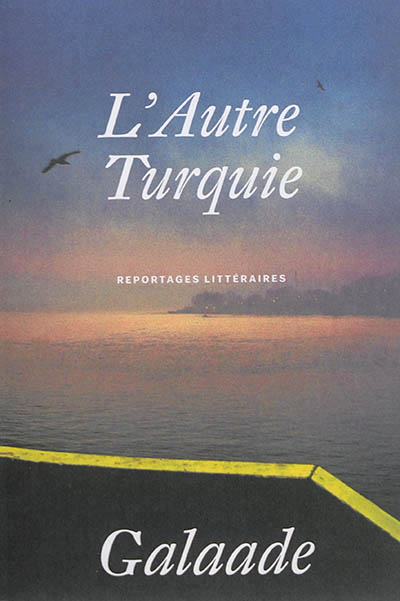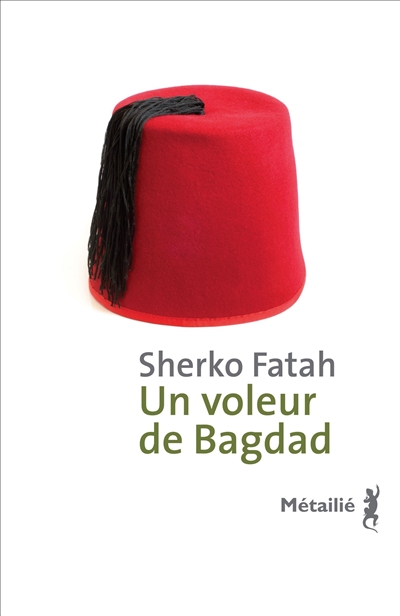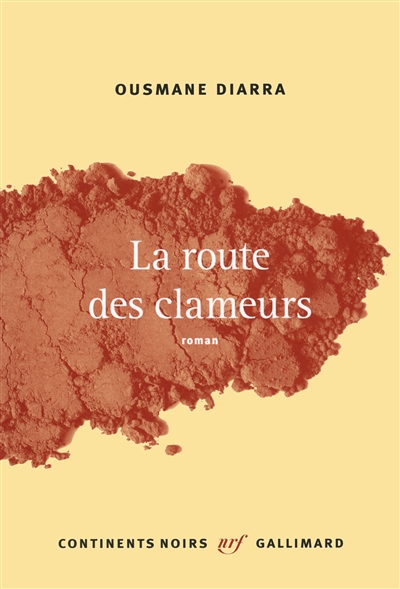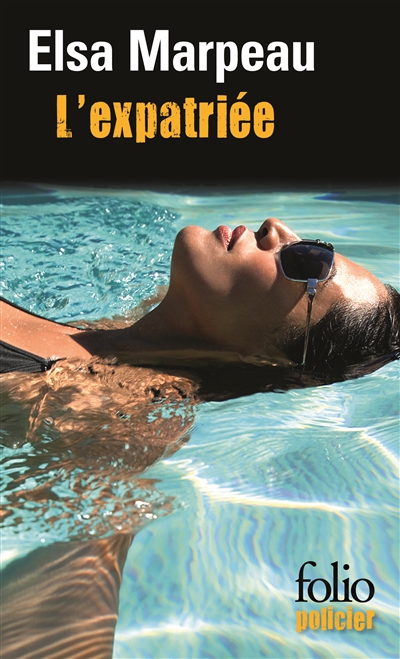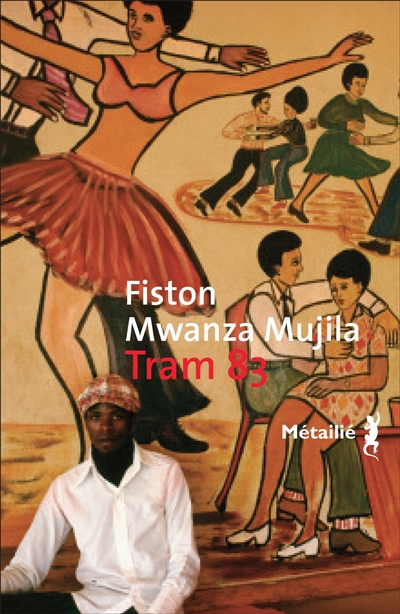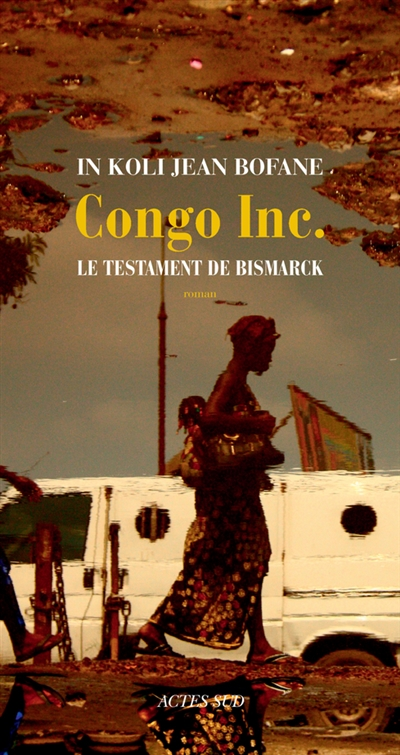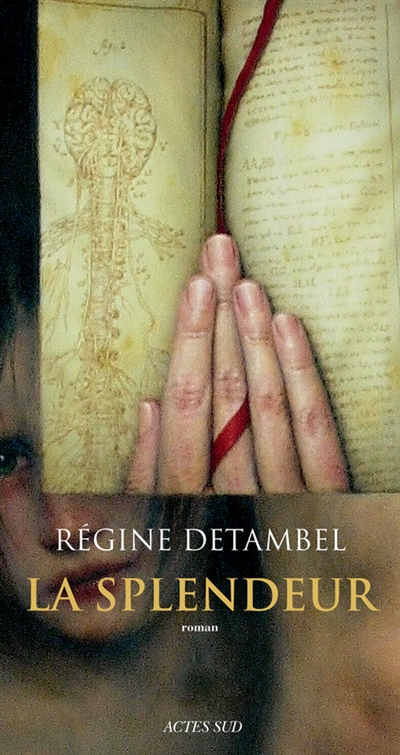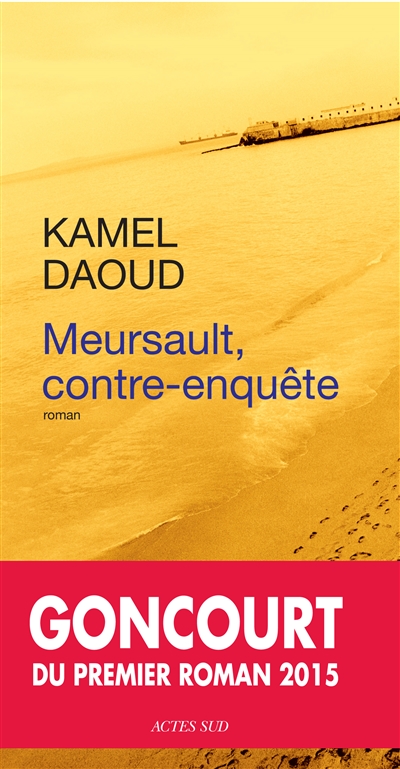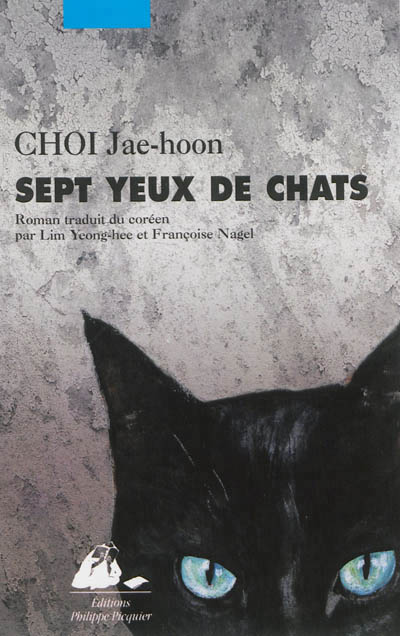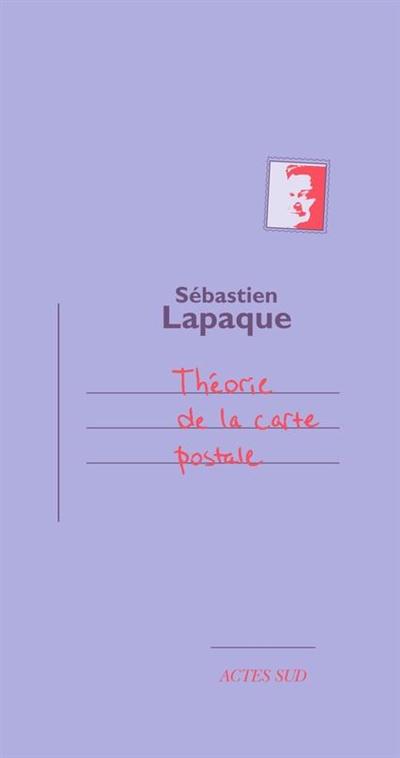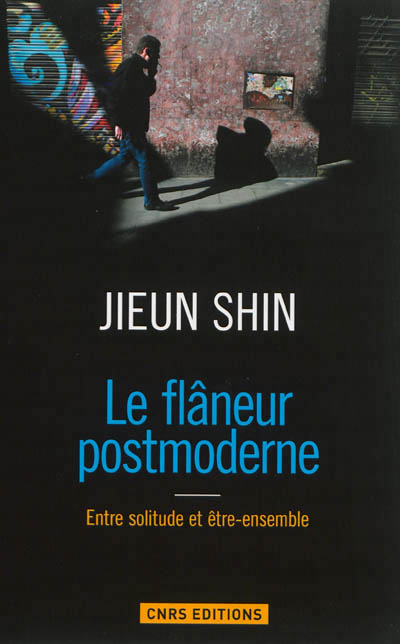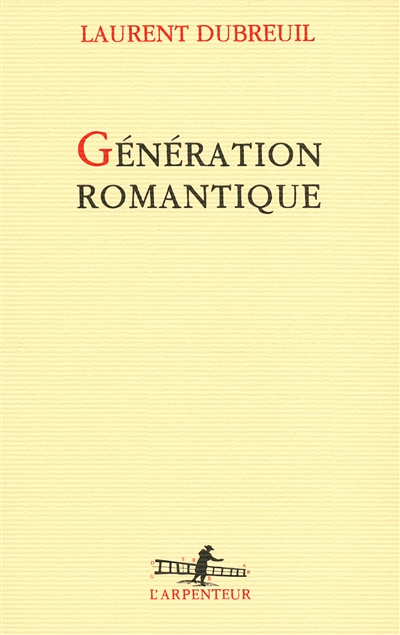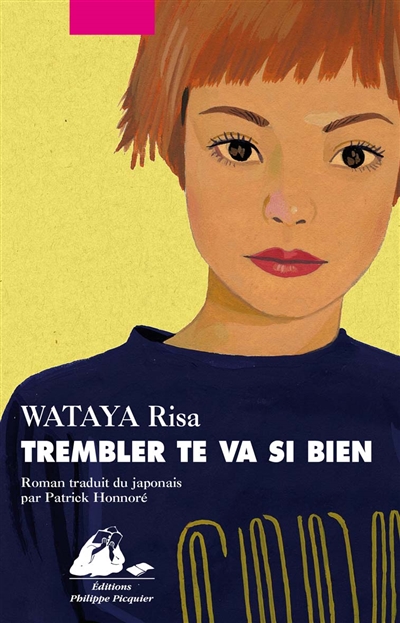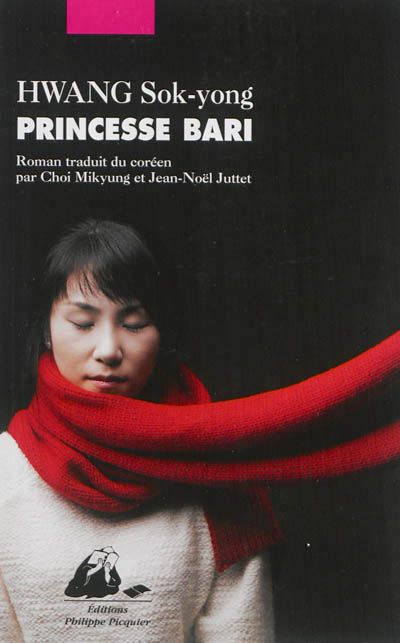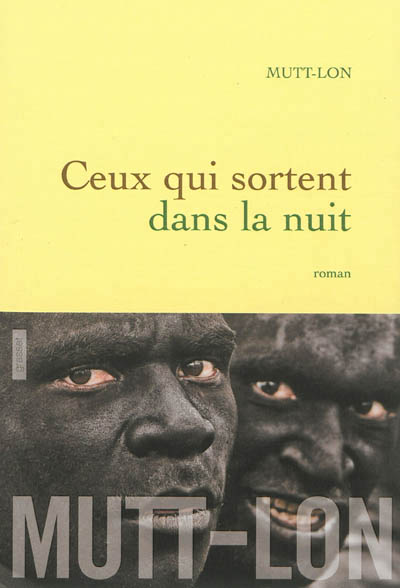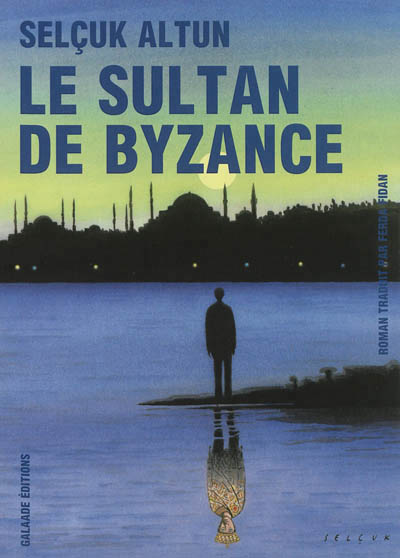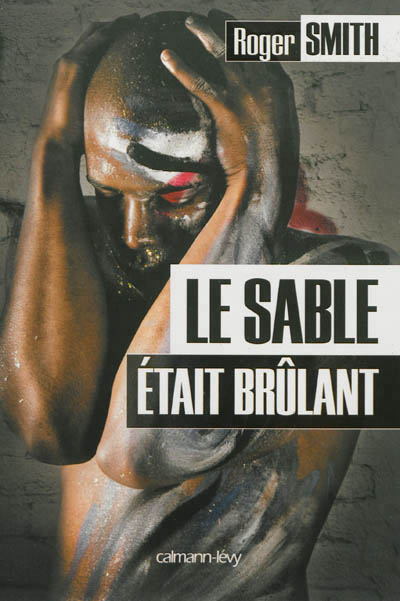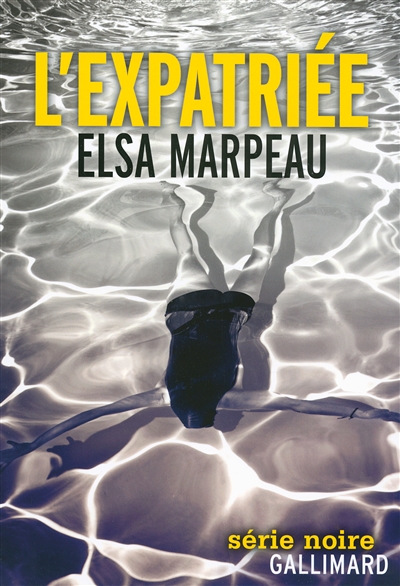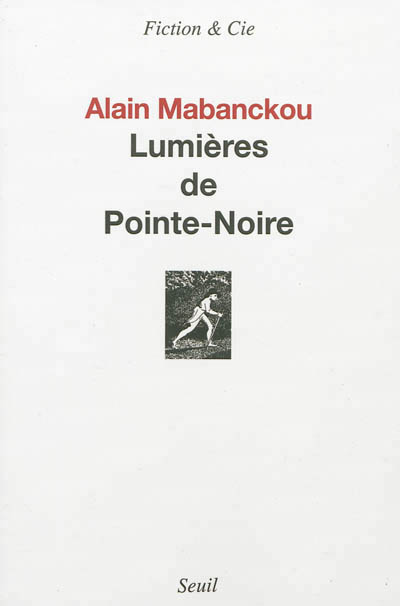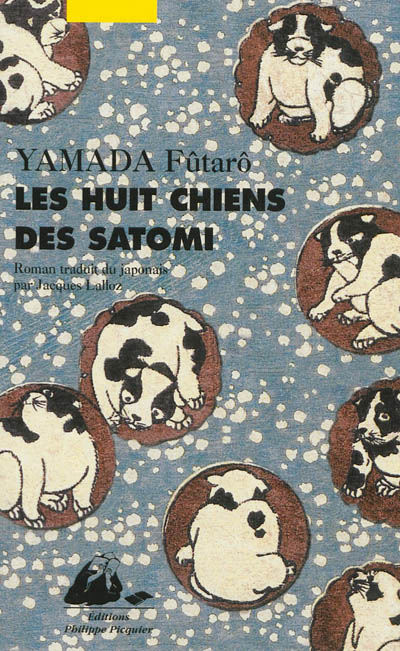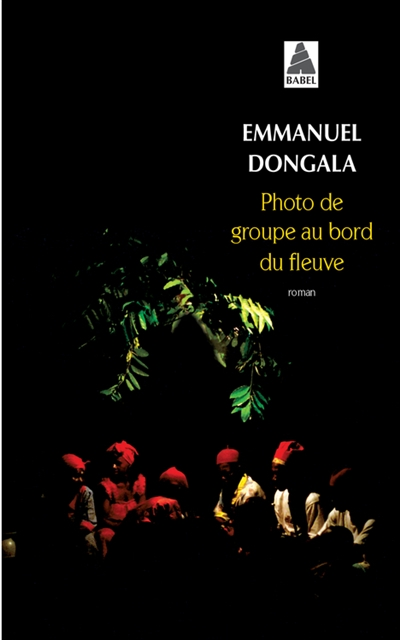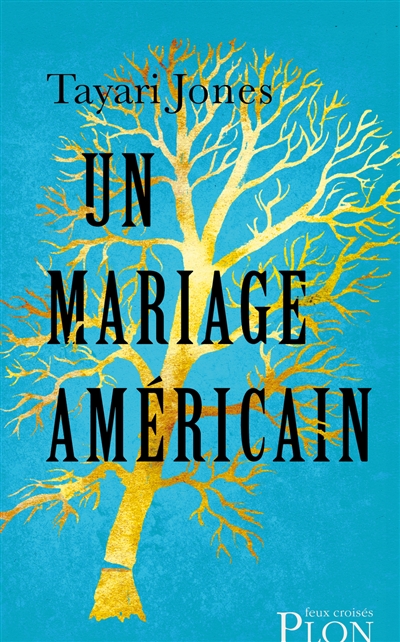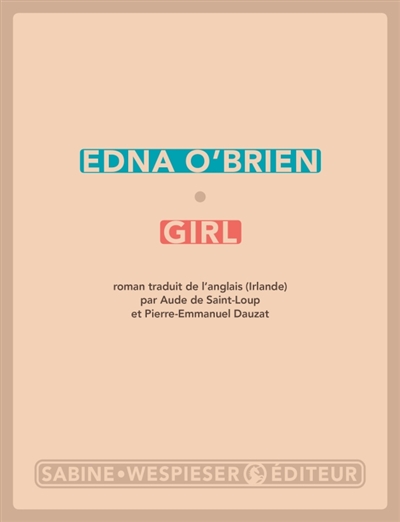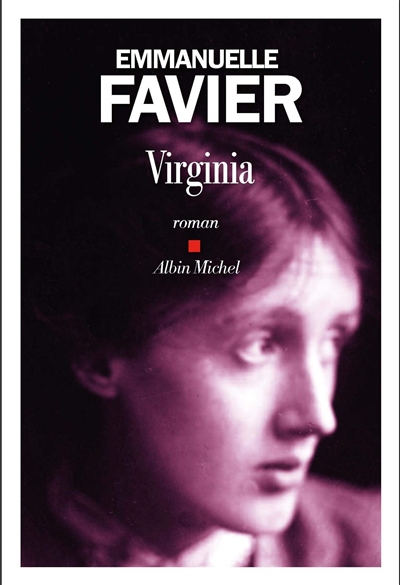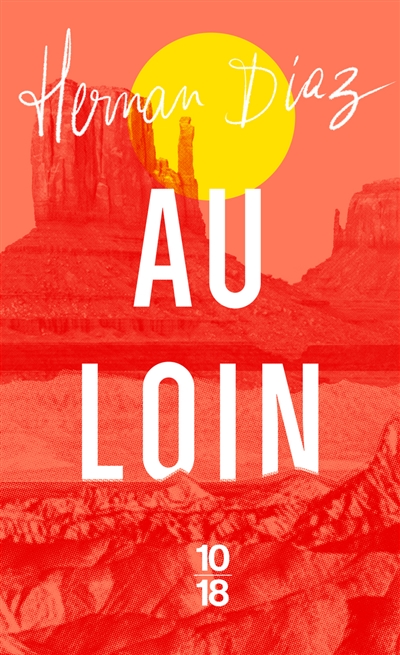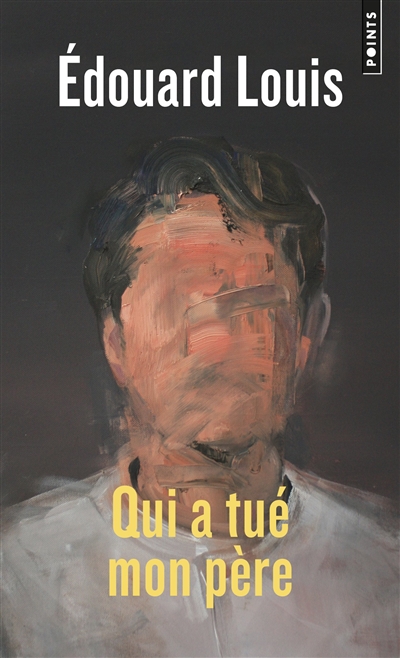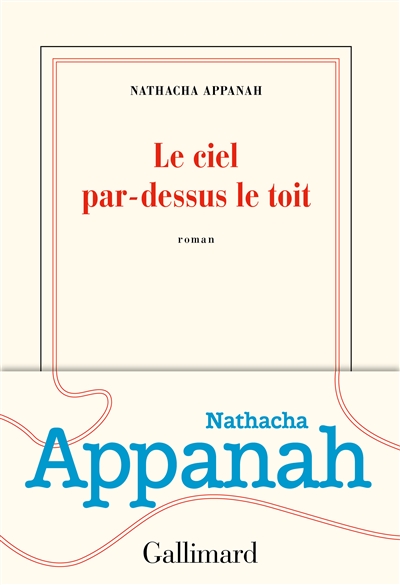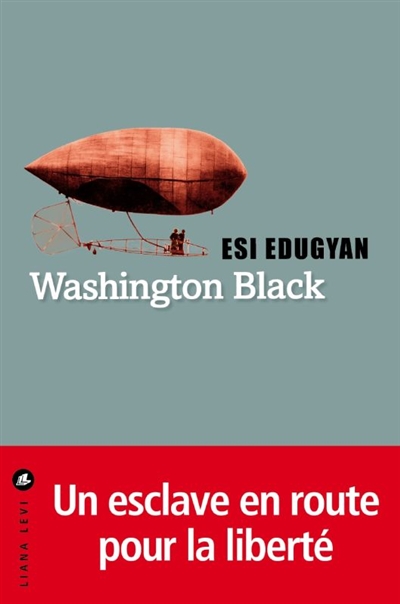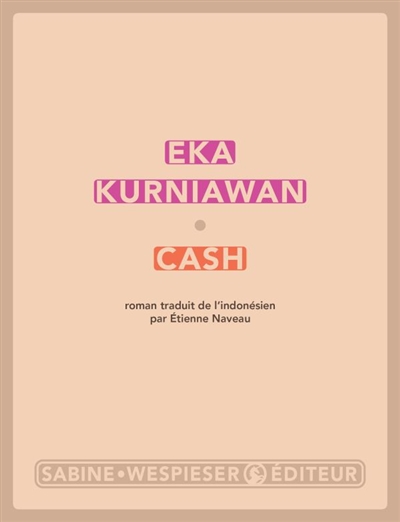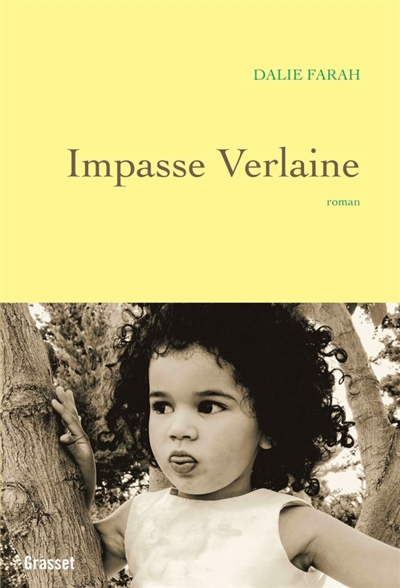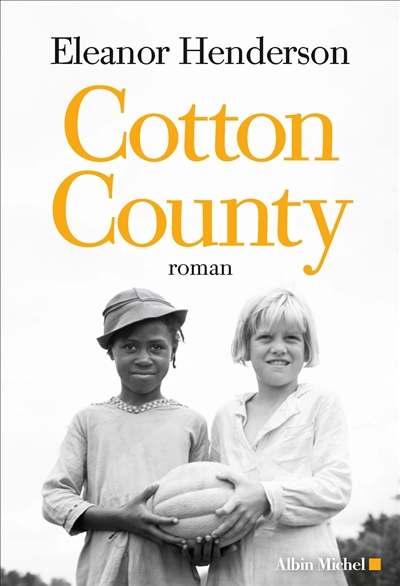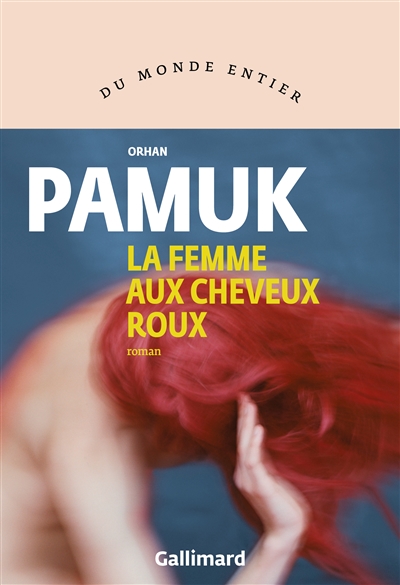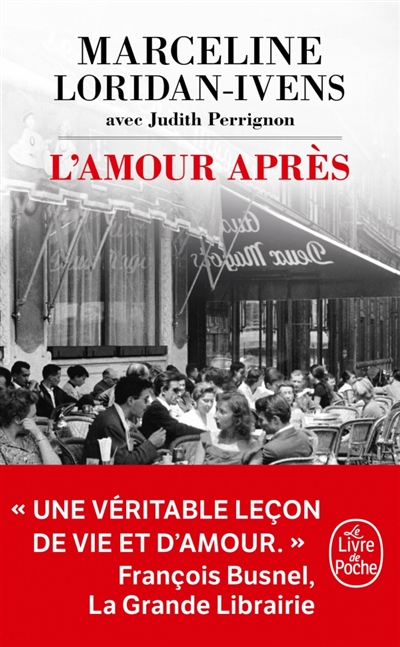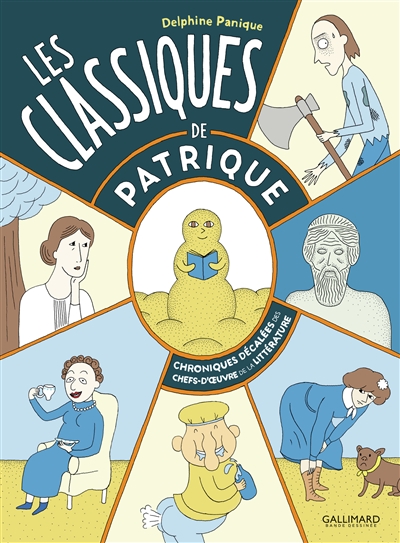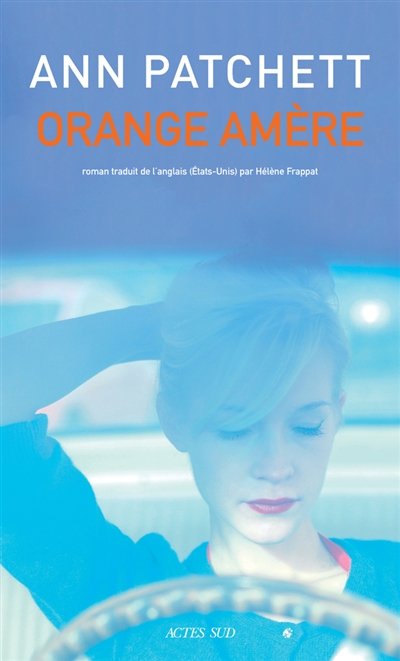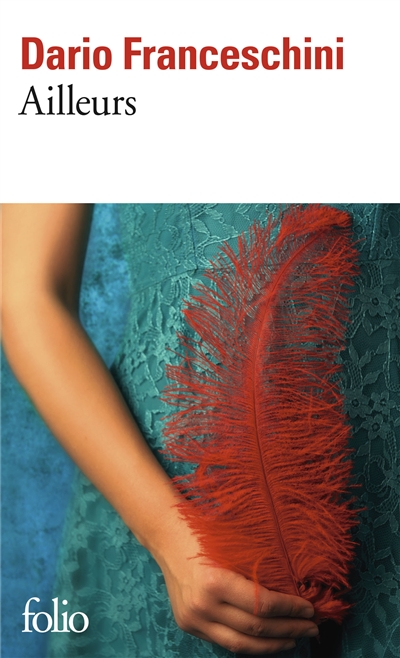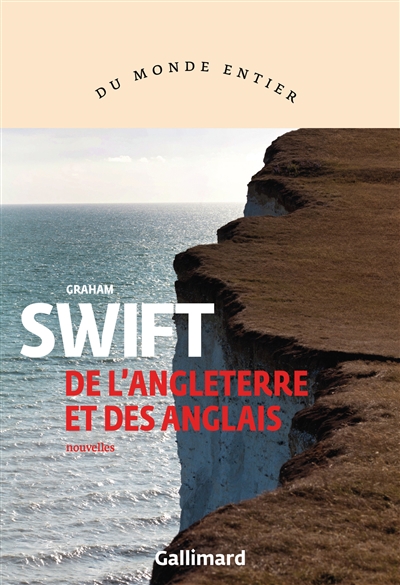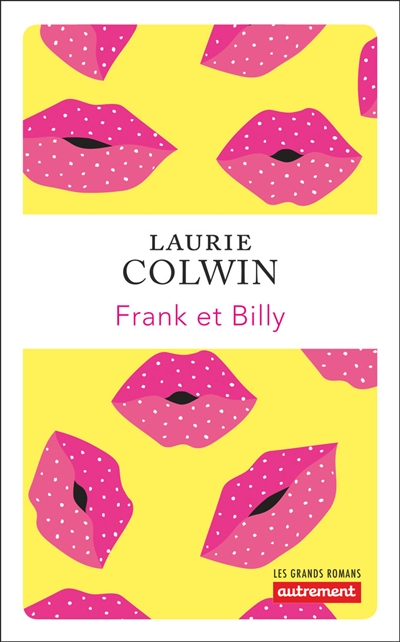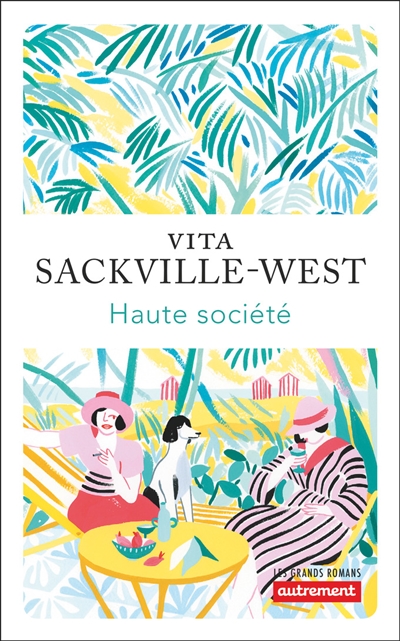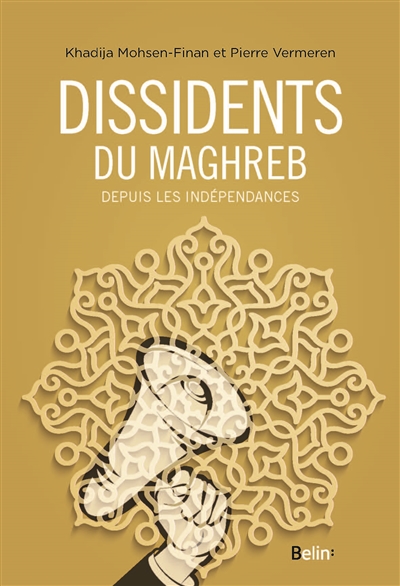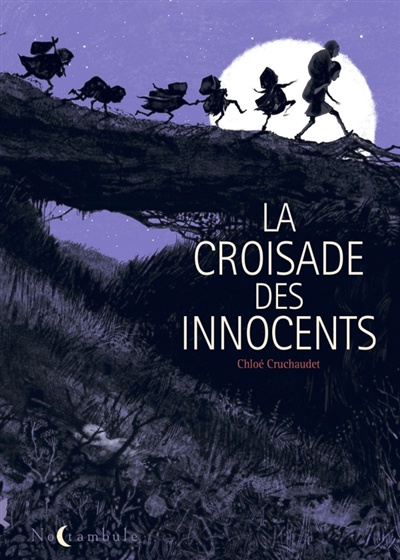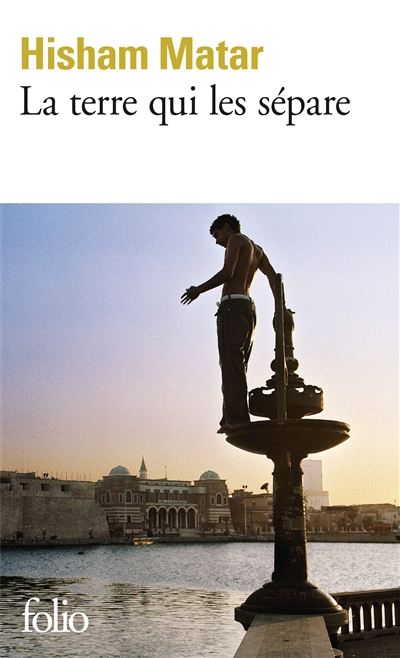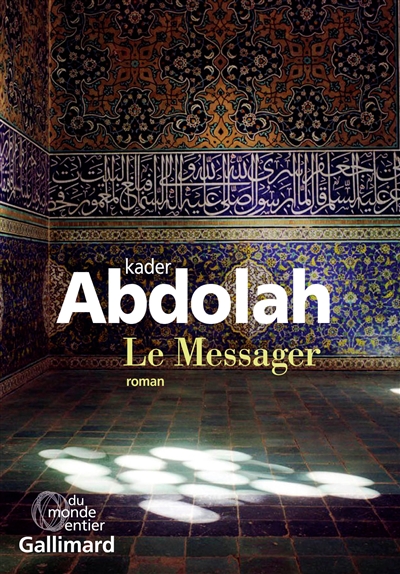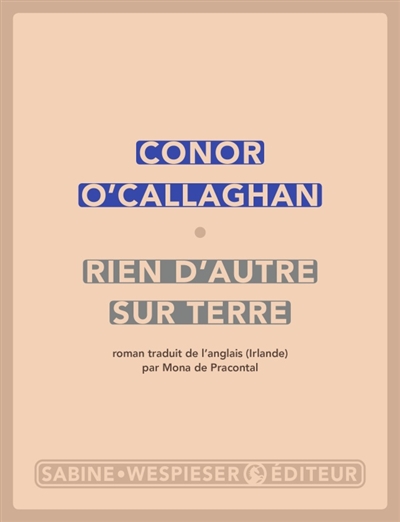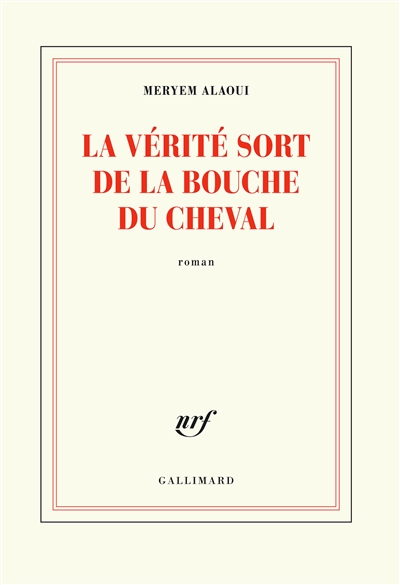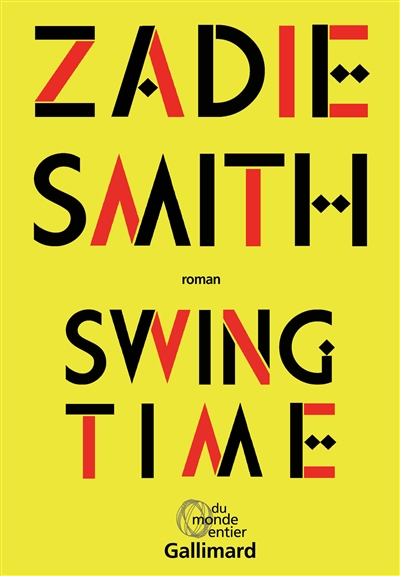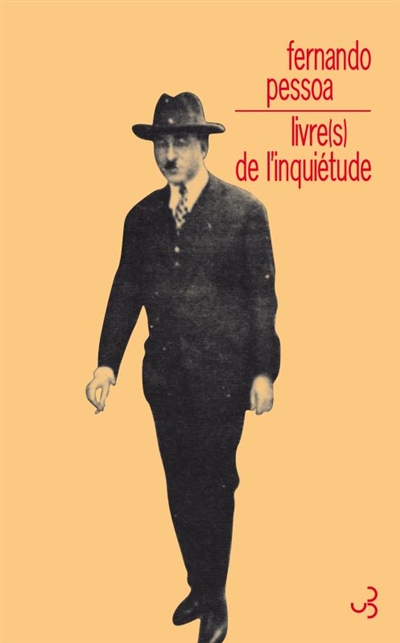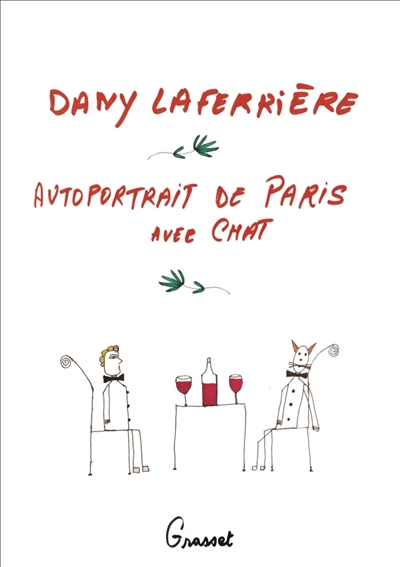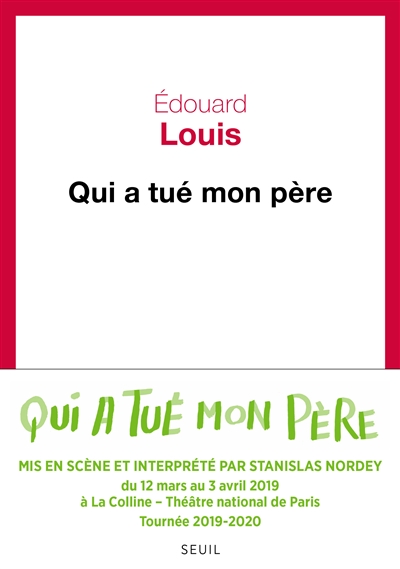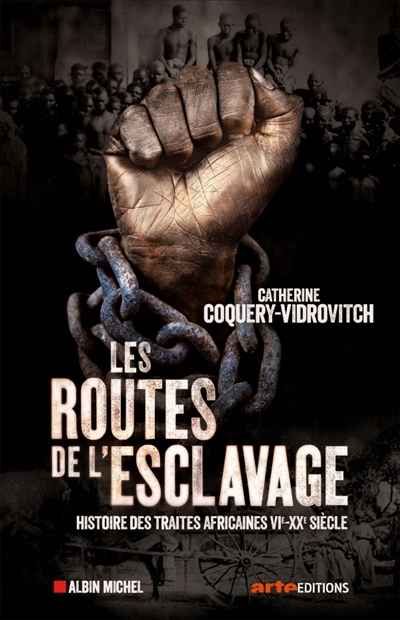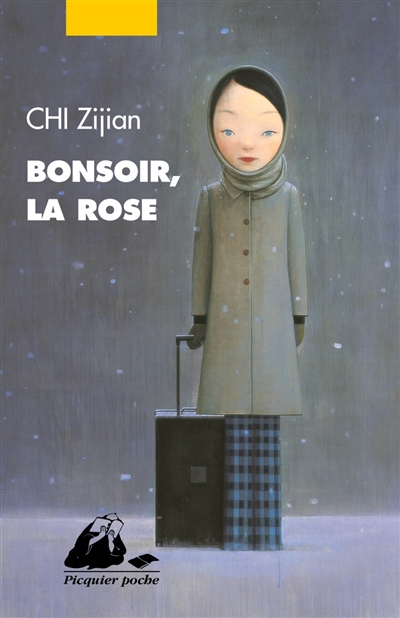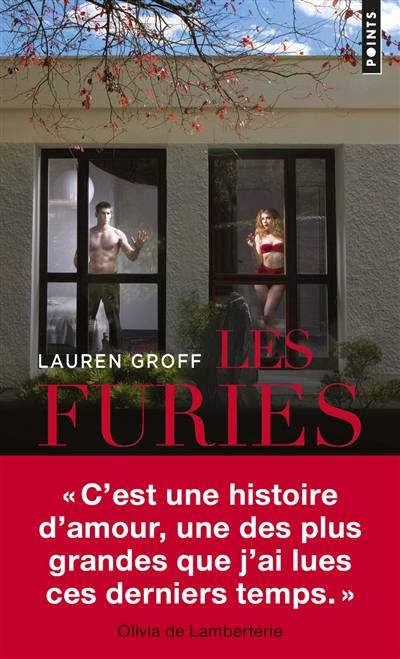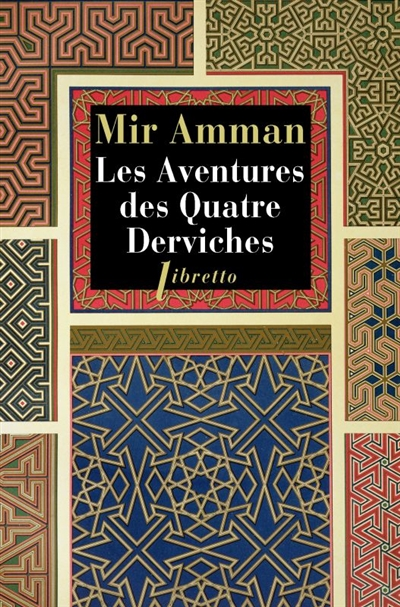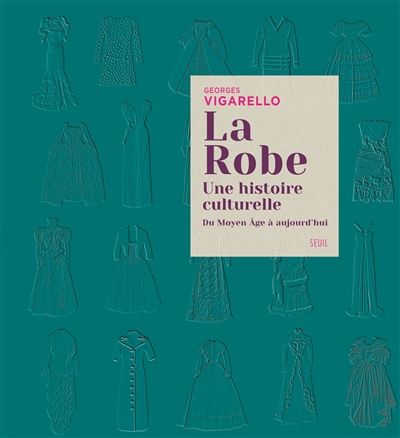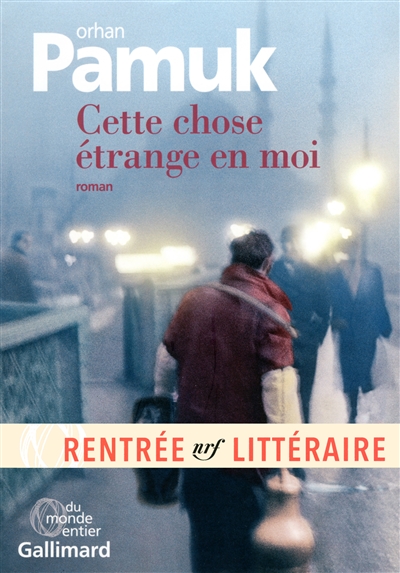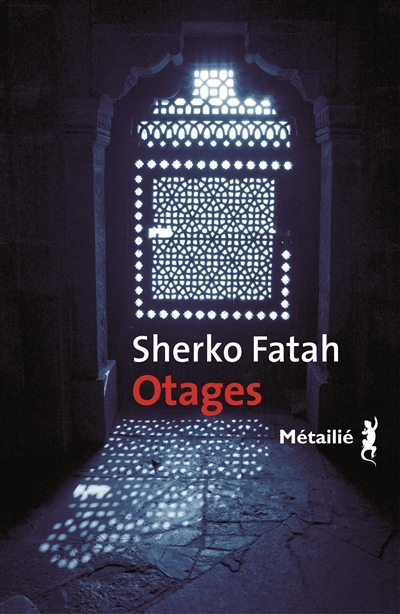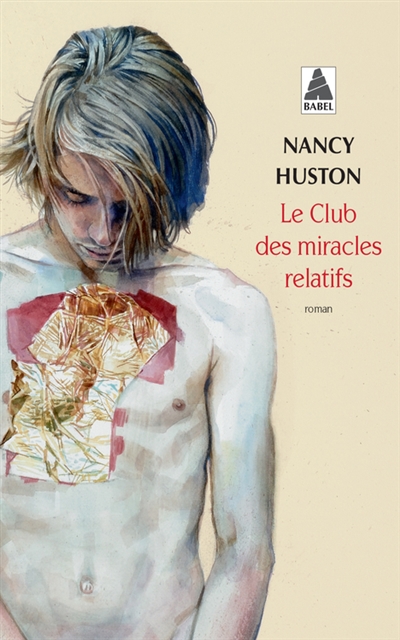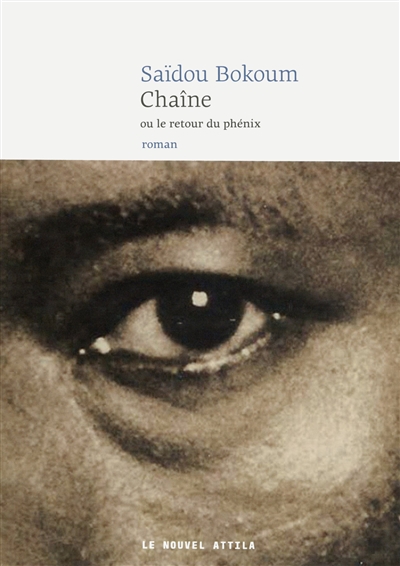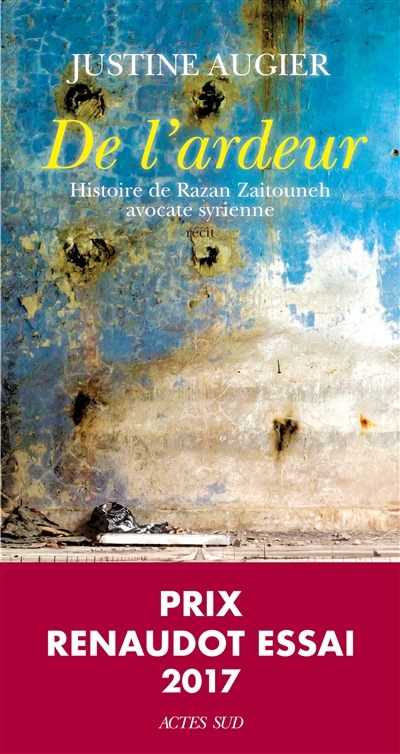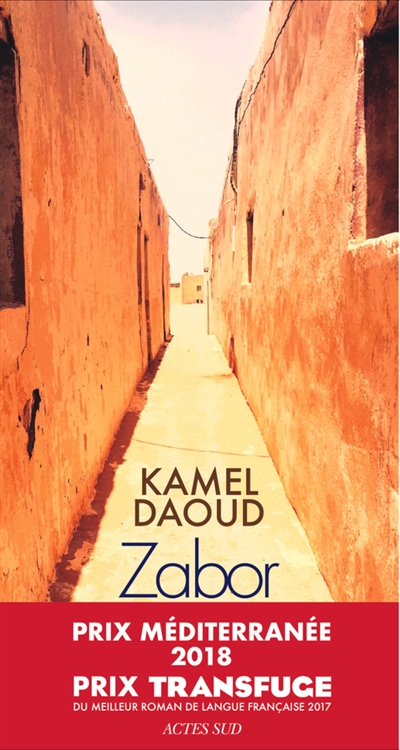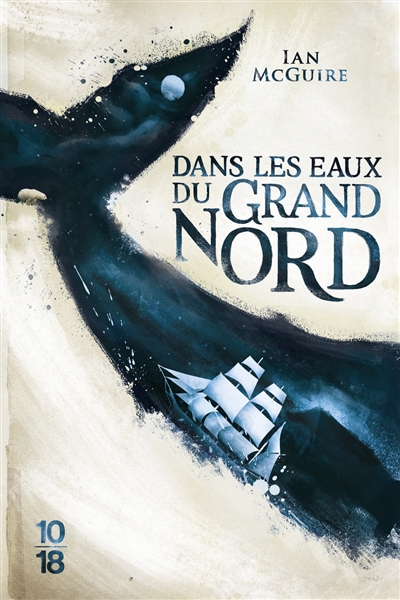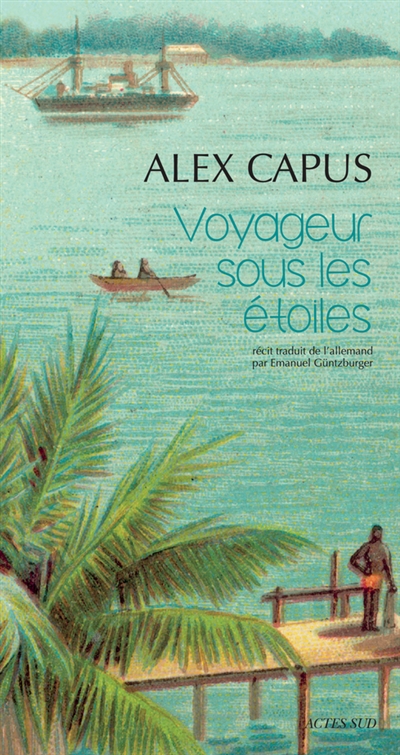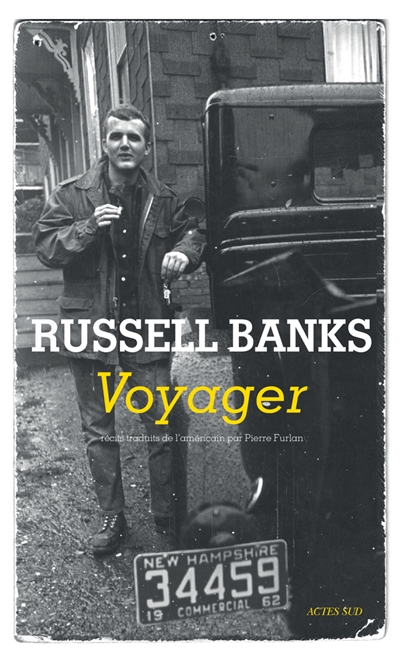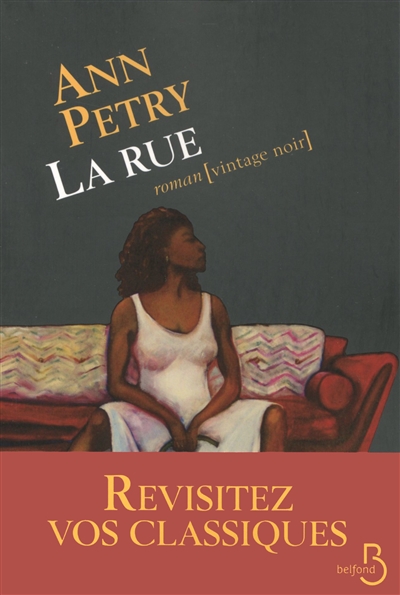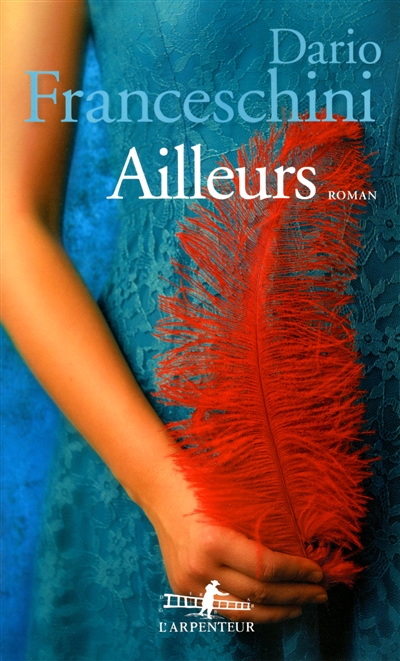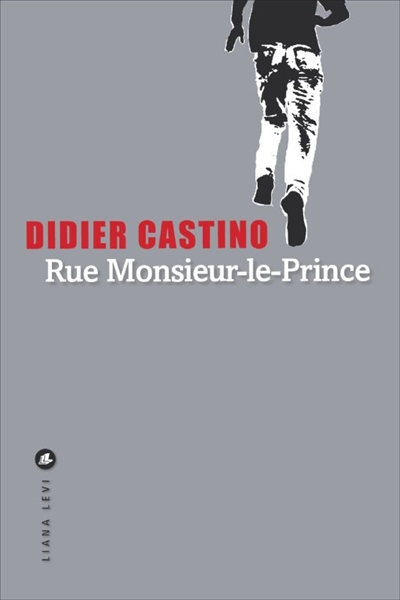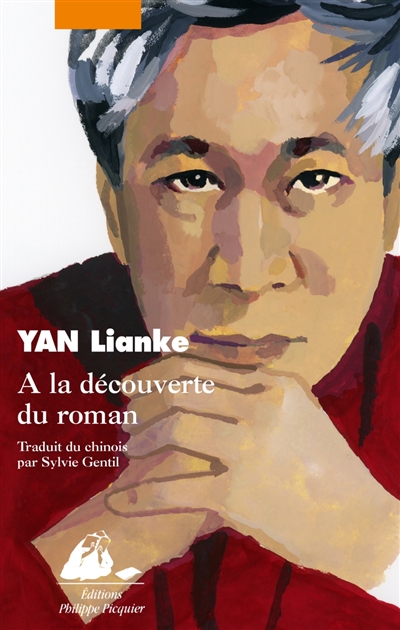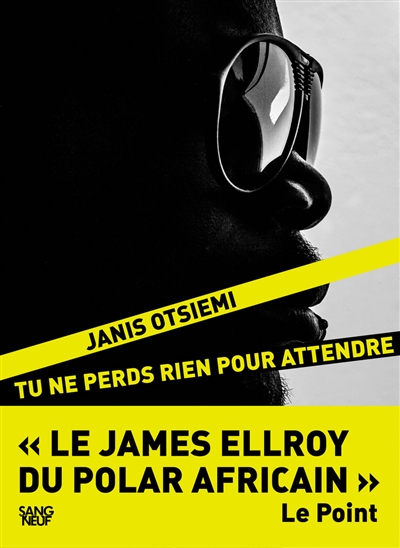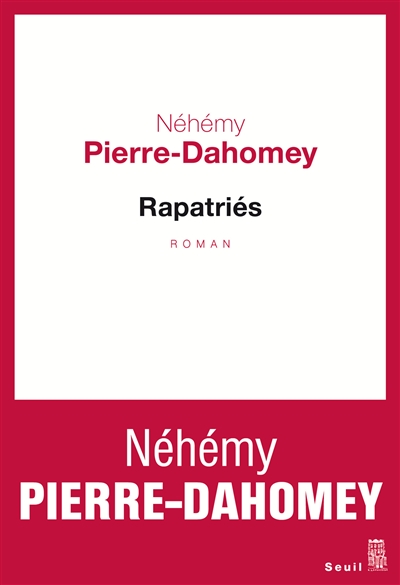Littérature française
Sébastien Spitzer
Ces rêves qu’on piétine

-
Sébastien Spitzer
Ces rêves qu’on piétine
Les éditions de l’Observatoire
23/08/2017
320 pages, 20 €
-
Chronique de
Sarah Gastel
Librairie Adrienne (Lyon) - ❤ Lu et conseillé par 23 libraire(s)

✒ Sarah Gastel
(Librairie Adrienne, Lyon)
Plongée dans notre mémoire commune, Ces rêves qu’on piétine est un premier roman d’une rare beauté et délicatesse. Une voix singulière sur l’expérience de l’abîme. Et parce qu’il puise dans le désordre de l’Histoire la matière vivante pour une réflexion sur notre monde, il est d’autant plus précieux.
PAGE — La foisonnante production littéraire inspirée par la Seconde Guerre mondiale montre bien à quel point cette période continue de nos jours à marquer les esprits. S’agit-il d’un moment historique dont on ne consume jamais le sens ?
Sébastien Spitzer — Ces rêves qu’on piétine est un roman inspiré de ce « moment » où nos humanités ont été poussées dans leurs derniers retranchements, chez les puissants comme chez les faibles. Une période où le Mal absolu s’est abattu sur des millions de personnes. Le « moment », comparable à aucun autre, où l’Histoire est devenue complètement folle. On en parlera encore dans mille ans. Pour l’écrivain, la difficulté réside dans les termes mêmes de cette singularité historique. Des noms comme Hitler, Reich et Nazi sont devenus des épouvantails. Ce sont des mots de tombe, d’outre-tombe, gavés de sens à force de récits et d’images. Je les ai abordés sous l’angle le plus intime possible pour greffer mon roman sur les racines du mal, quand « le temps se disloque » comme l’écrivit Shakespeare. C’est la bouture d’une enfant rescapée des camps ; l’histoire d’une femme, Magda, prête à tout sacrifier ; et la figure tragique d’un père, Richard Friedländer.
P. — Vous saisissez ces événements sous un angle inattendu. Votre roman se déroule à la fin du conflit autour de la figure de Magda Goebbels. Pourquoi ce focus sur ce personnage monstrueusement humain ?
S. S. — Parce que les monstres fascinent ! Ils vont au bout de nous-mêmes. Poussés par une logique infernale, ils commettent l’impensable. À l’origine de mon roman, il y a la question de l’infanticide. Comment cette fameuse Magda a-t-elle pu tuer ses enfants, cinq petites filles et un tout jeune garçon ? J’ai beaucoup lu : des essais, des thèses de psychiatres… Mais rien ne m’a convaincu. Alors, je me suis glissé dans les méandres intimes de l’histoire de cette femme, rigoureusement, méthodiquement, à rebours de son apocalypse intime.
P. — La rigueur documentaire comme garde-fou et un sens prodigieux de la narration. Comment avez-vous construit cette histoire avec ces deux pôles géographiques qui alternent au fil des pages ?
S. S. — J’ai passé des milliers d’heures à lire et fouiller les archives du Mémorial de la Shoah. Et puis j’ai oublié. J’ai fait le vide pour éviter d’écrire un énième livre d’Histoire et tenter de rester maître de mon récit, des phrases, du rythme. Puis vint l’image de l’homme qui éleva Magda. Je m’y suis accroché pour éviter de sombrer dans les milliards de mots écrits sur le dernier refuge de Magda et des autres.
P. — Face au nazisme, cette machine infernale qui déshumanise et qui tente de faire disparaître, il y a Ava, dépositaire de la mémoire des camps. Elle a en sa possession les derniers mots de centaines de vies effacées, un nom, une date de naissance, une profession et les lettres d’un père à sa fille. Qui est Richard Friedländer, héros en creux du livre ?
S. S. — Vous avez raison. Tout tourne autour de lui. Friedländer a élevé Magda. Il en était le beau-père. Je suis même persuadé qu’il en était le père. Il était commerçant. Juif. Très tôt raflé. Parmi les premiers morts des camps. La découverte de son histoire a marqué un tournant. Agissant comme un révélateur intime, il a fait remonter la mémoire de mon père, Billy. Séducteur sympathique qui avait ce qu’il voulait et croquait tout de la vie. Mais il n’en avait jamais assez. Il a fait de la prison. Plusieurs fois. Enfant, j’ai découvert cette part de lui un lendemain de Noël. Je n’avais pas de nouvelles. Bien sûr, toute ma famille s’est bien gardée de répondre. Secret. Tabou. Il était mis au ban de la légende familiale. Mais comme je l’aimais par-dessus les légendes, je suis allé le chercher. Imaginez un peu ce que l’histoire de Friedländer, père caché, emprisonné, a pu faire naître en moi. Il est le cœur battant de ce livre.
P. — Et votre mère ?
S. S. — Elle a tout fait comme une mère, pour protéger ses petits. Rien à voir avec Magda.
P. — À l’image de votre écriture, le titre frappe par sa puissance d’évocation. Pouvez-vous nous éclairer sur sa signification ?
S. S. — Ce titre, nous l’avons choisi ensemble avec Lisa Liautaud, directrice littéraire aux éditions de L’Observatoire. Il fallait trouver un titre qui fasse écho à ce contexte et le dépasse. Finalement, Ces rêves qu’on piétine s’est imposé à nous. Il prolonge les magnifiques vers de Yeats, très présents dans ce livre.
À propos du livre
Avril 1945, le compte à rebours de la Seconde Guerre mondiale bat ses dernières mesures. Acculée, la femme la plus puissante du IIIe Reich plonge avec ses six enfants dans le Führerbunker où se terrent les derniers figurants de l’Allemagne hitlérienne. Elle s’appelle Magda Goebbels. Enfermée vivante, cette reine déchue, qui s’est façonné un personnage à la mesure de ses ambitions, se remémore son passé. Loin de ce huis clos, les Américains progressent tandis que des rescapés des camps tentent d’échapper à la furie du désastre. Parmi eux, on suit Ava, trois ans, qui a pour seul compagnon de voyage un rouleau de cuir. À l’intérieur, la mémoire des camps et les lettres d’un certain Richard Friedländer à sa fille, une certaine Magda… Explorant les limites du possible, Ces rêves qu’on piétine est un roman nécessaire qui comble le gouffre de toutes ces vies absorbées à l’image de ce père jetant inlassablement des ponts vers celle qui l’a rejeté de sa vie.
« Si seulement je pouvais prendre les broderies du ciel
Ciselé de lumière d’or et d’argent,
Les voiles bleus et pâles et sombres
De la nuit et de la lumière et de la pénombre,
Je les étendrais sous tes pas.
Mais moi, qui suis si pauvre, je ne possède que mes rêves ;
Je les ai répandus à tes pieds ;
Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. »