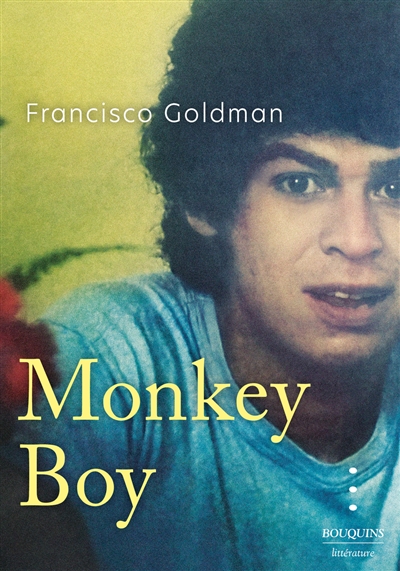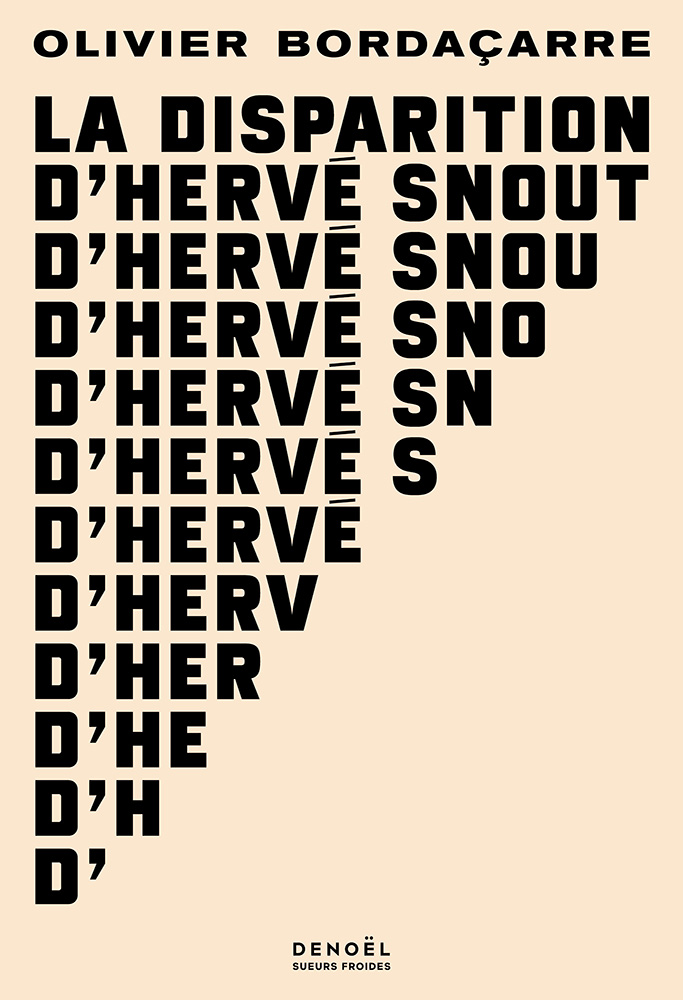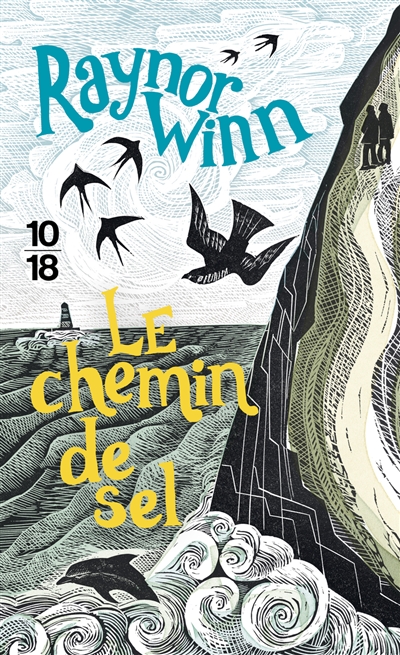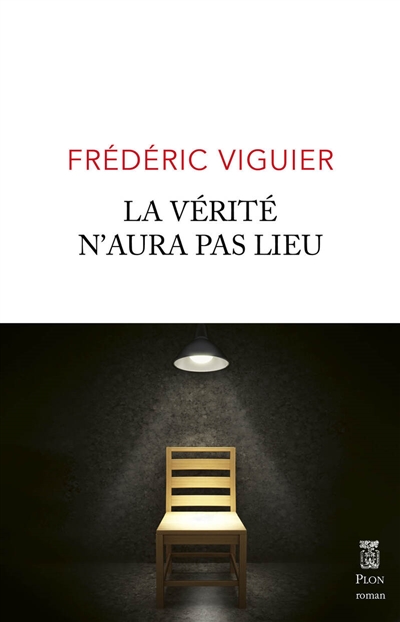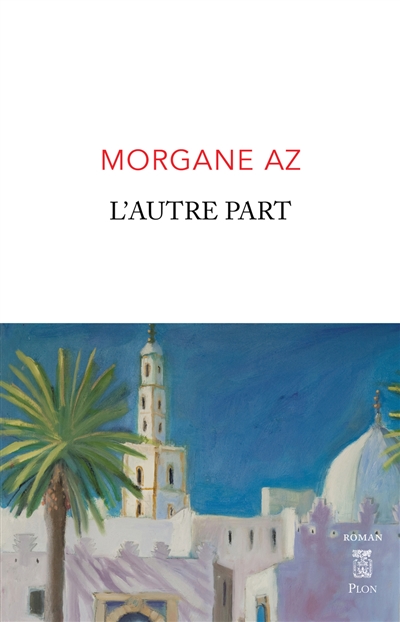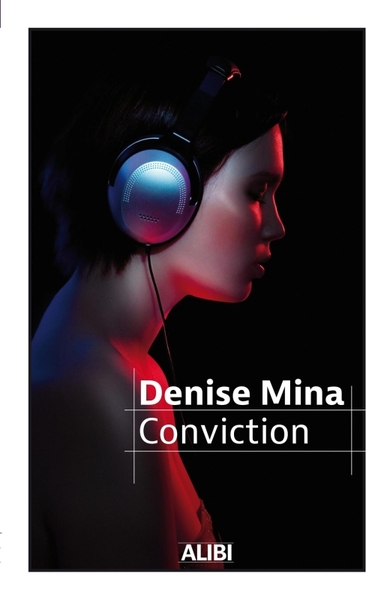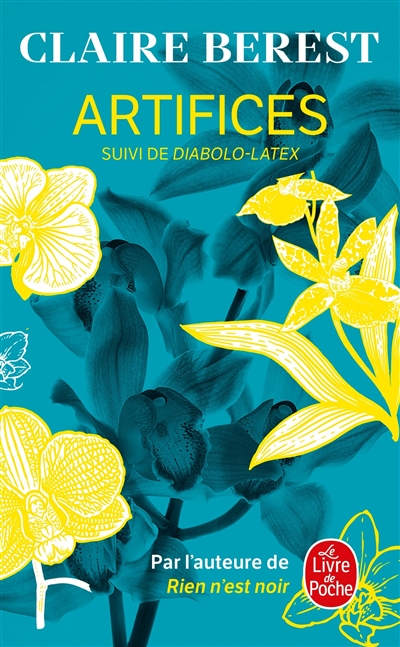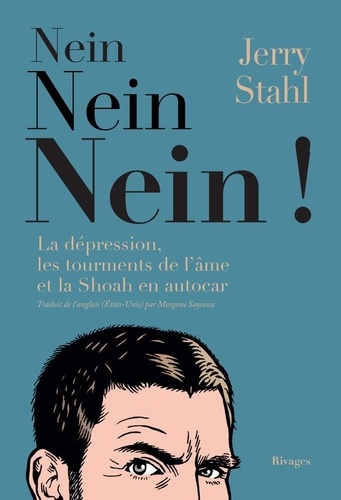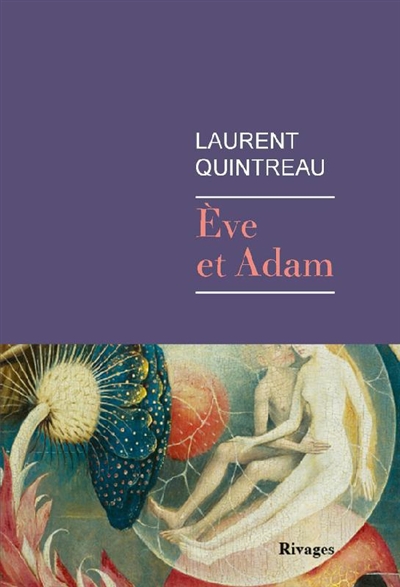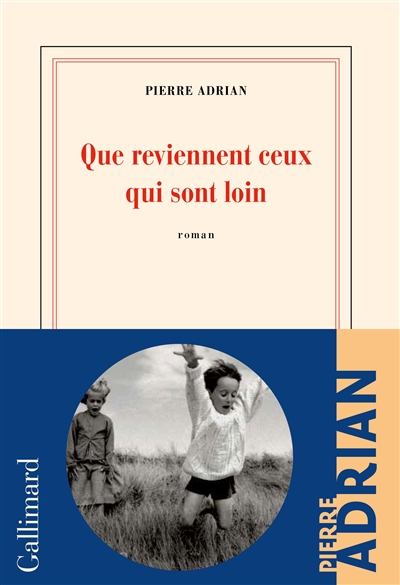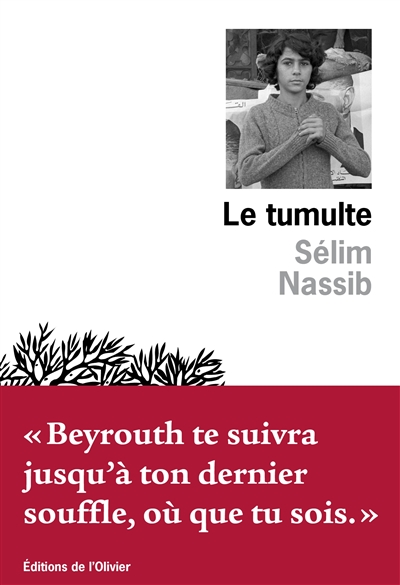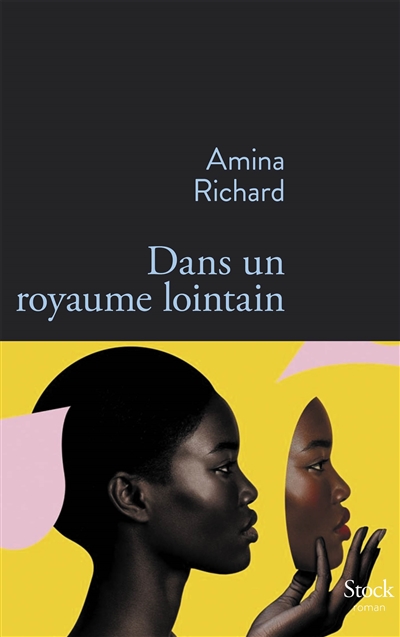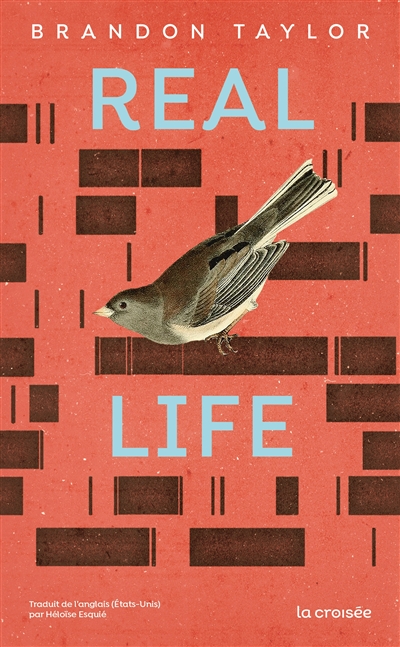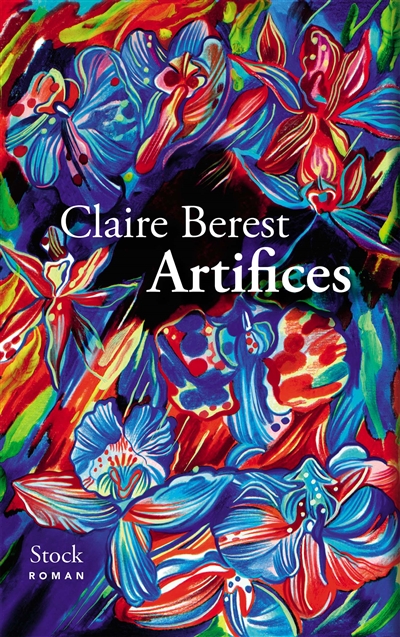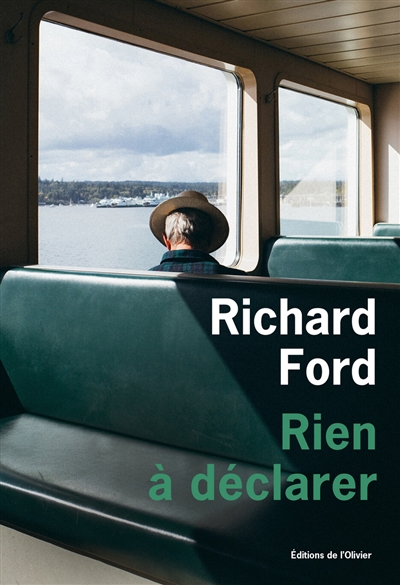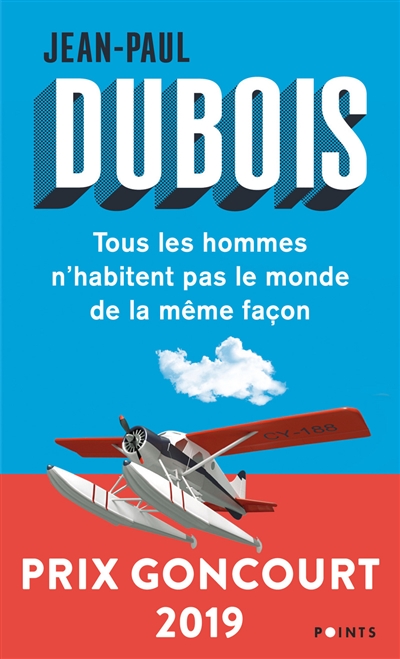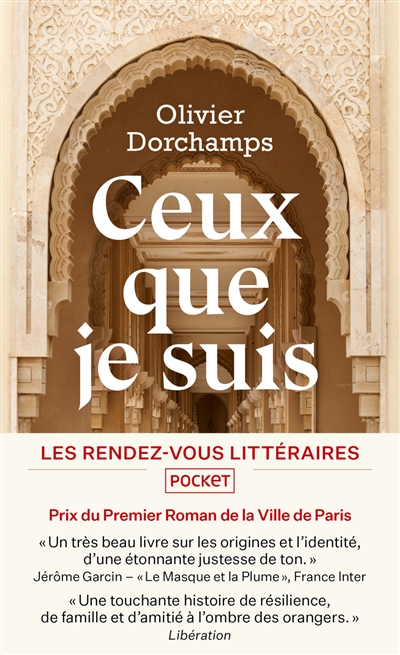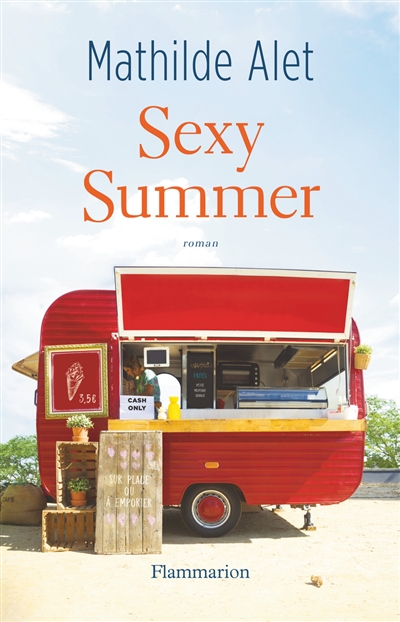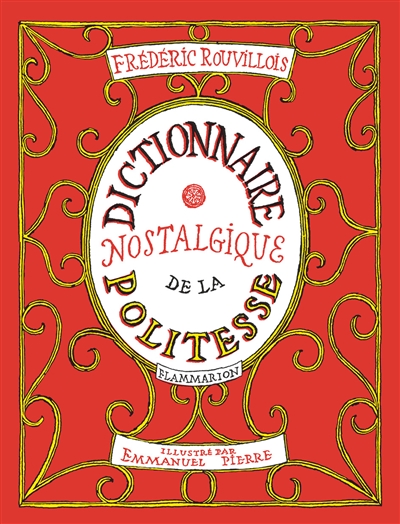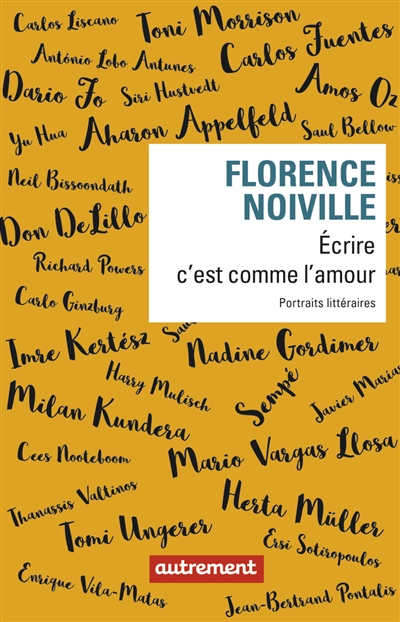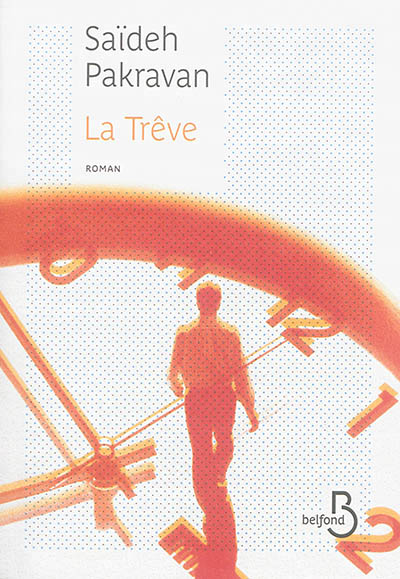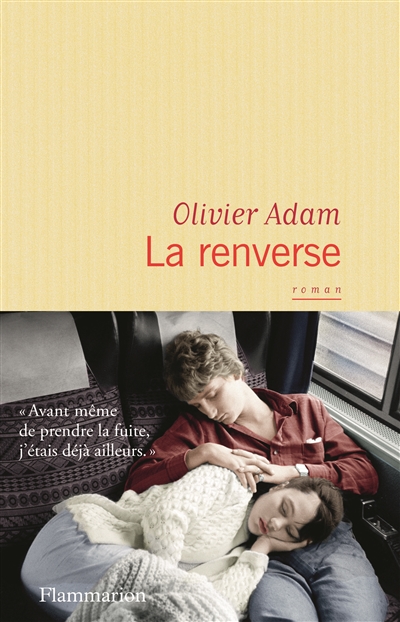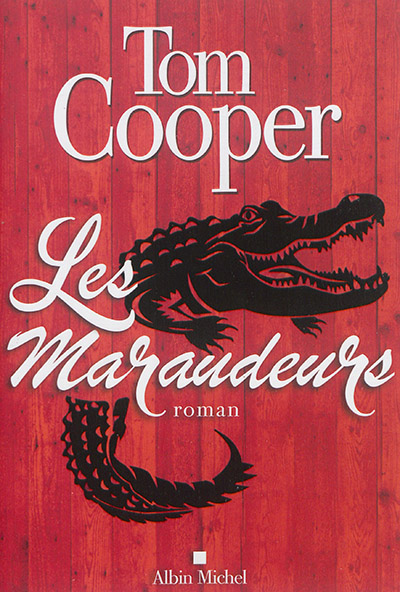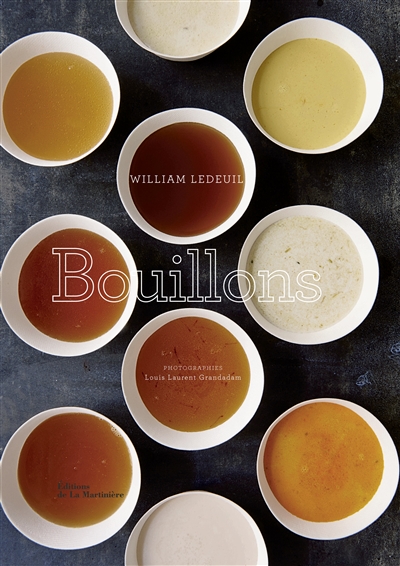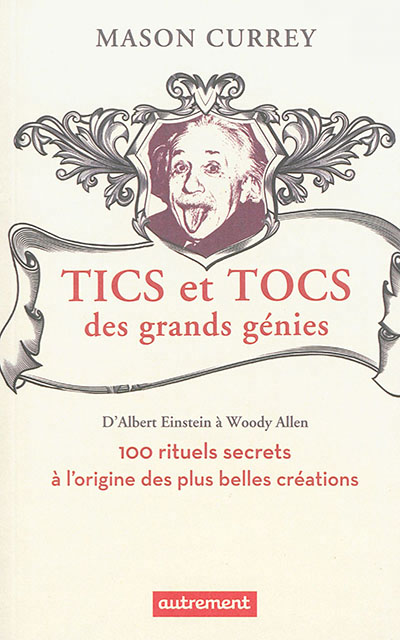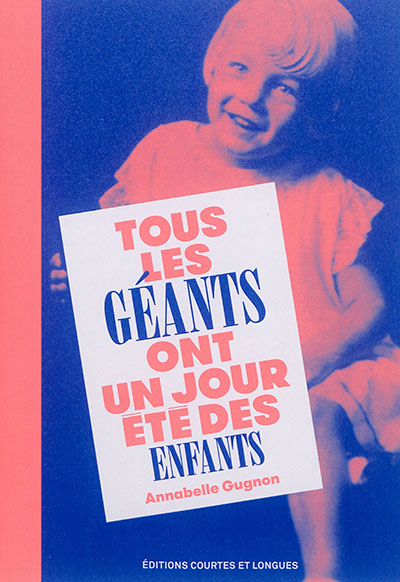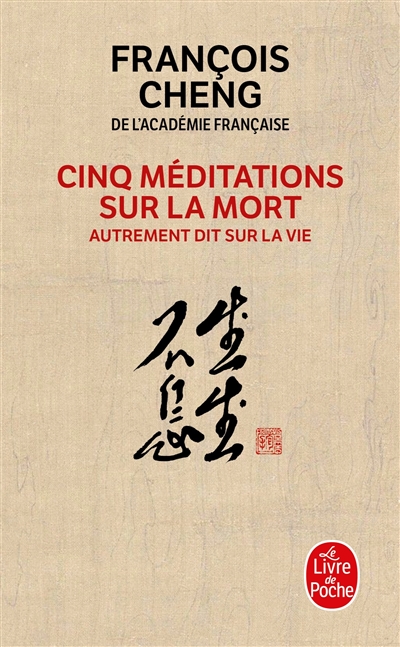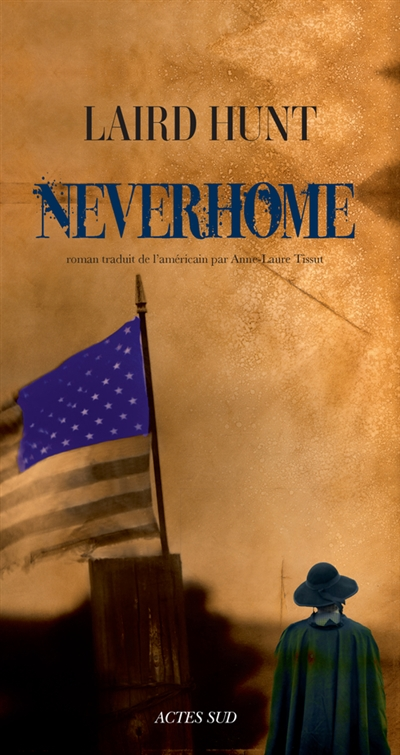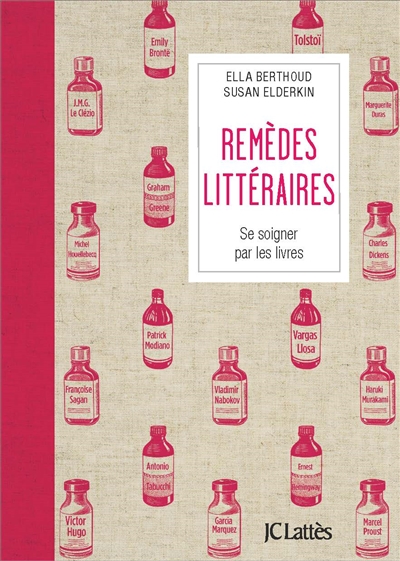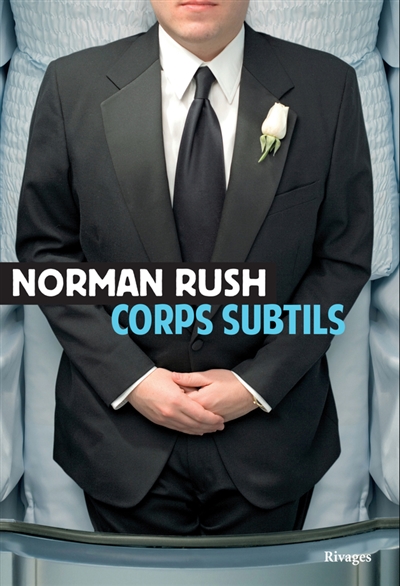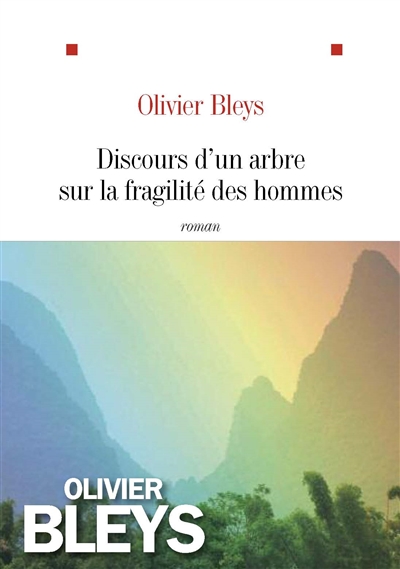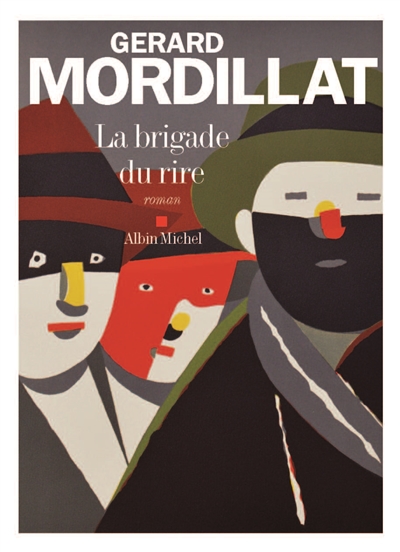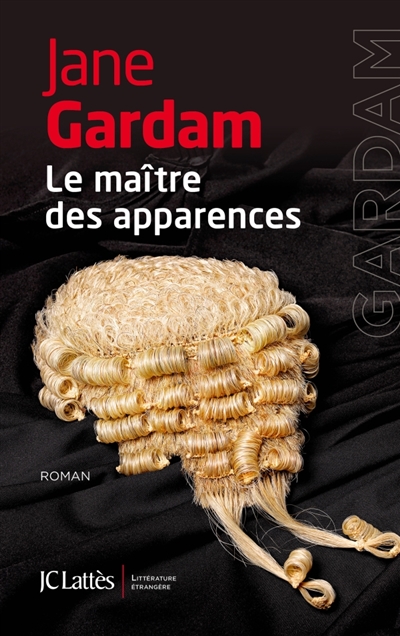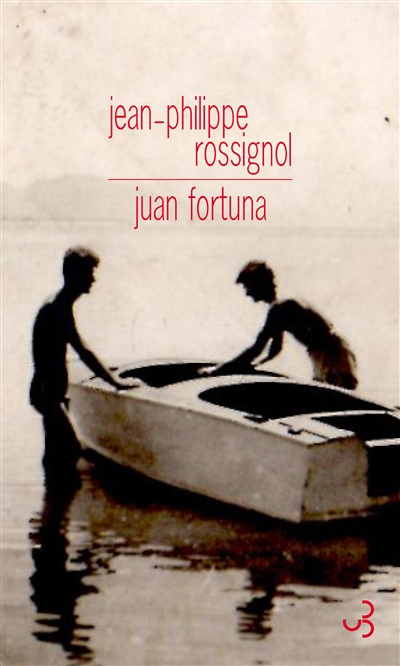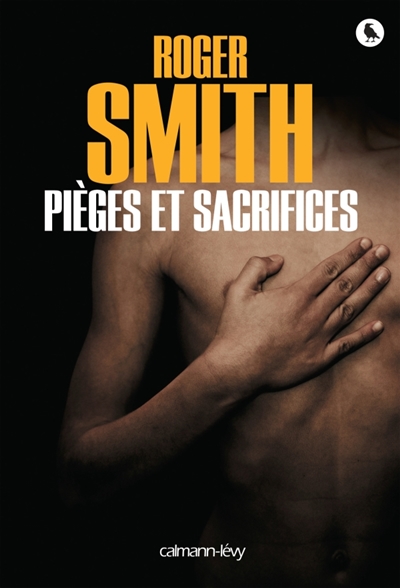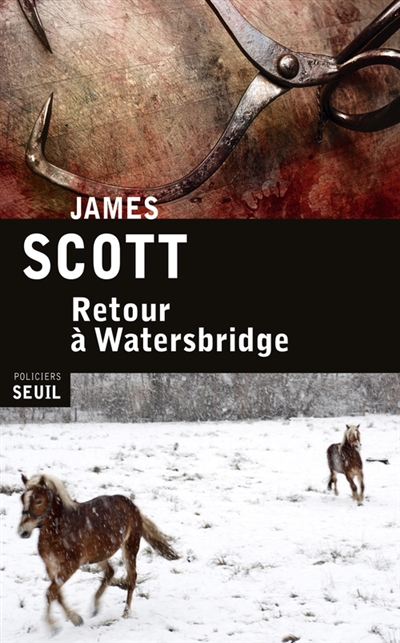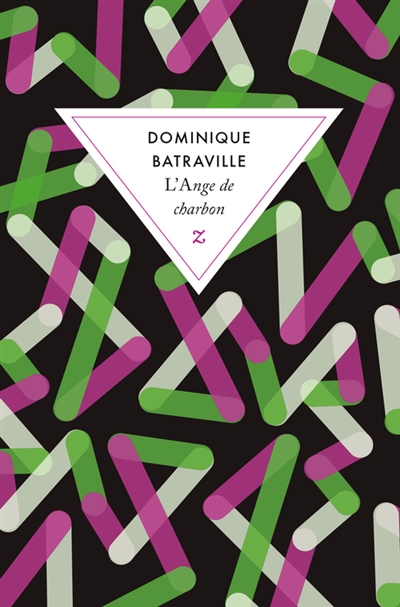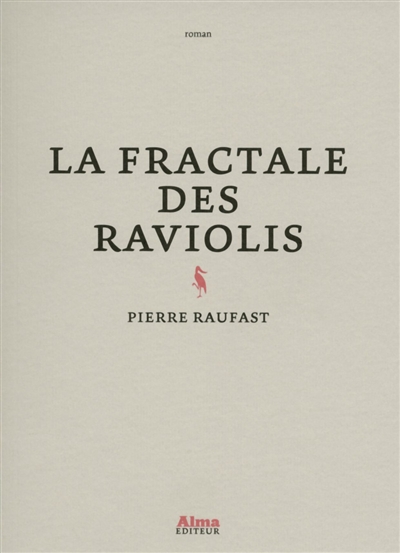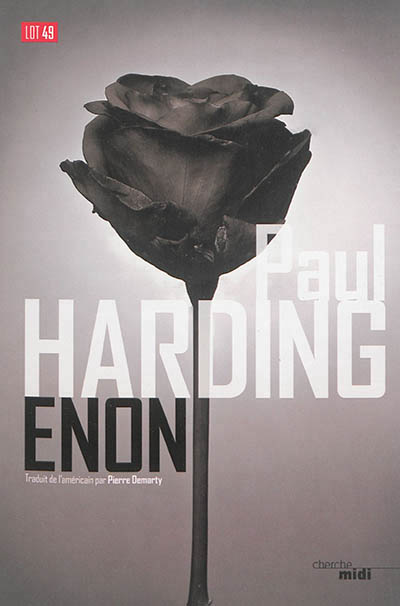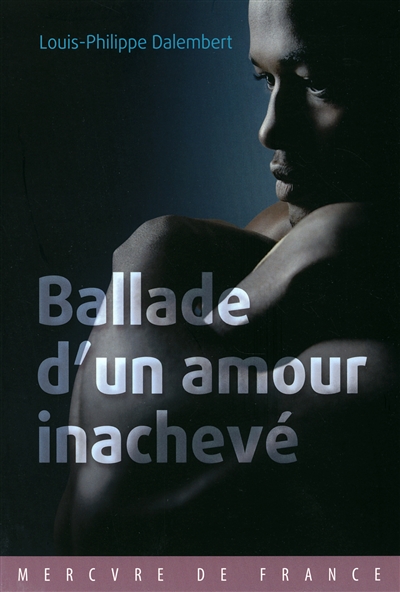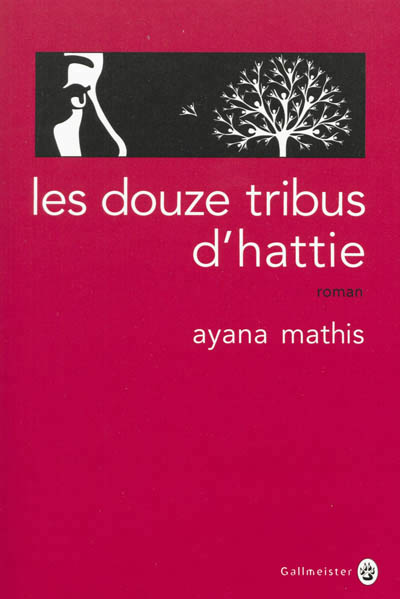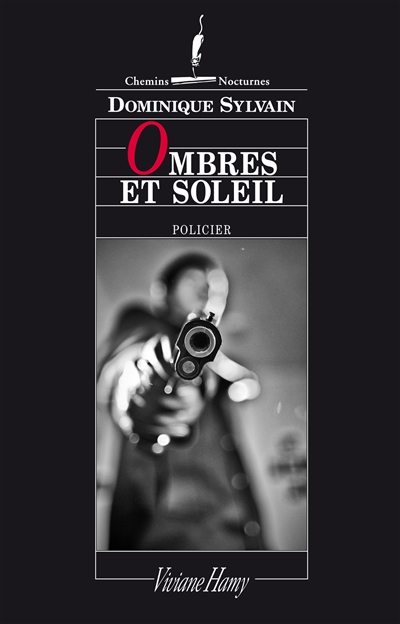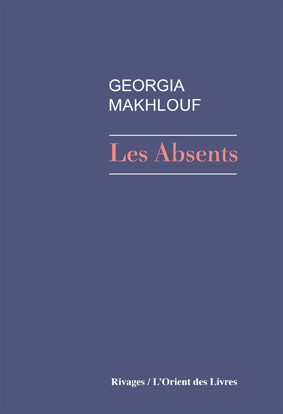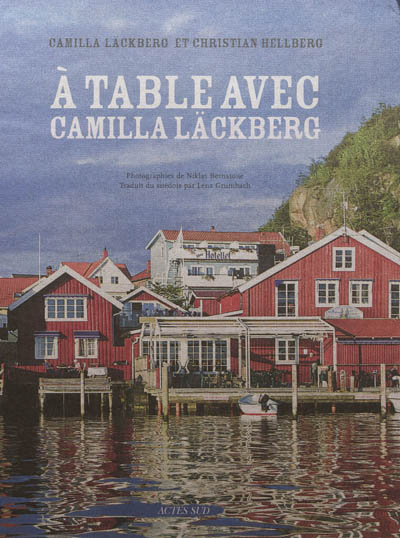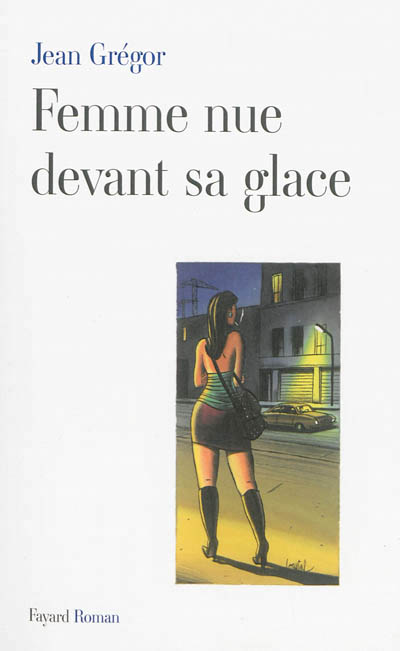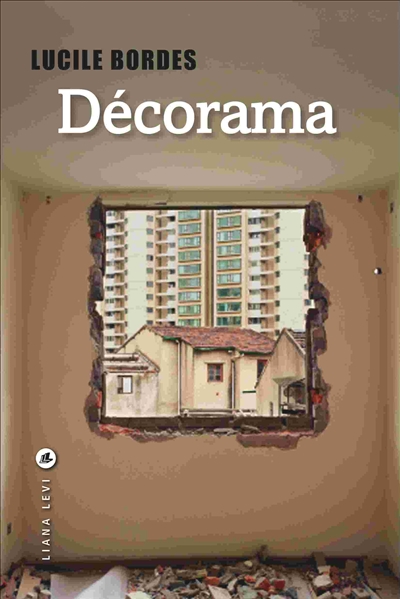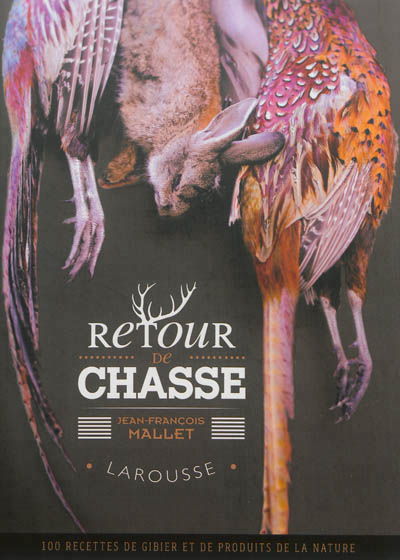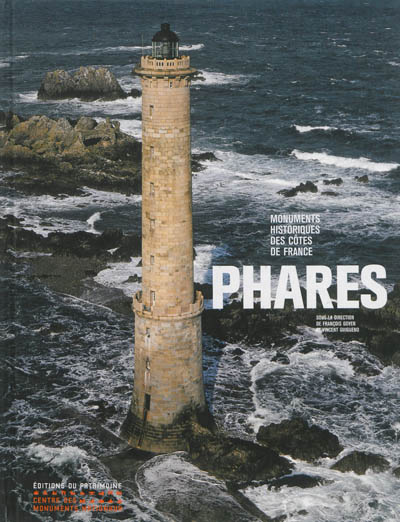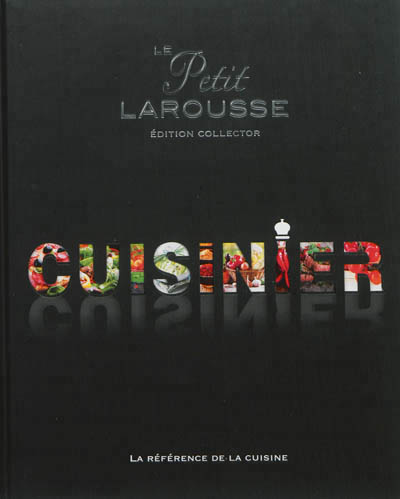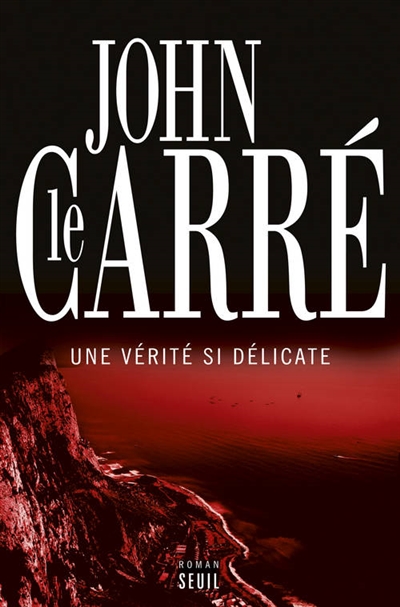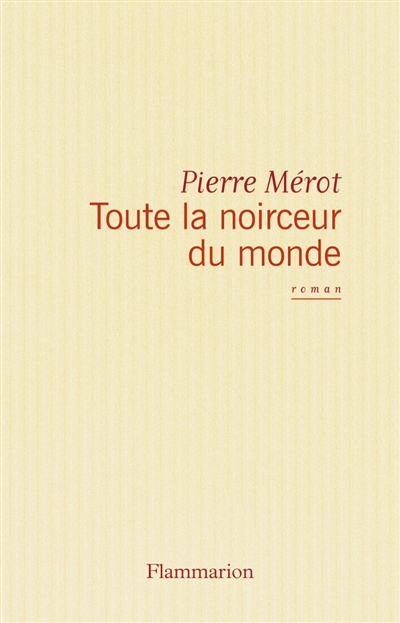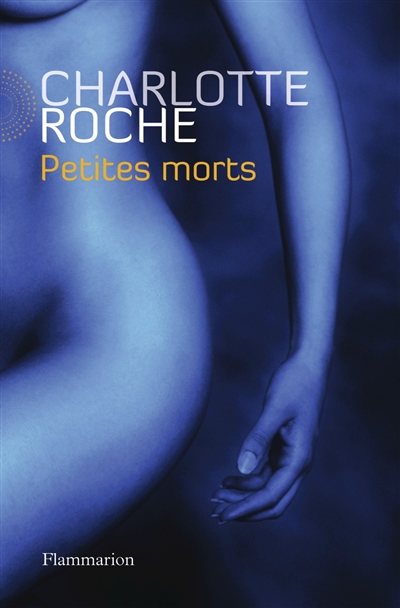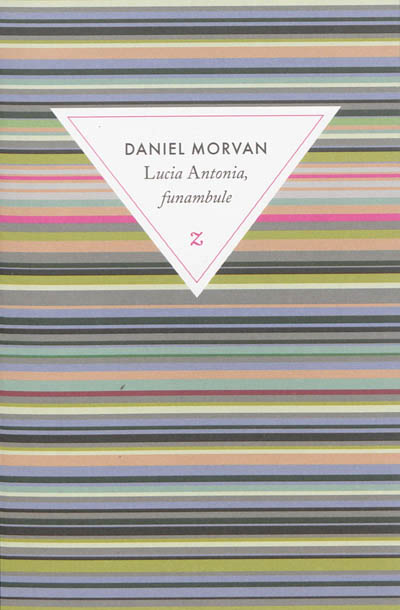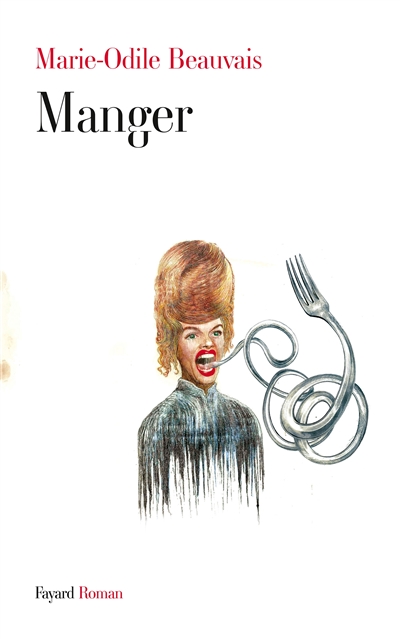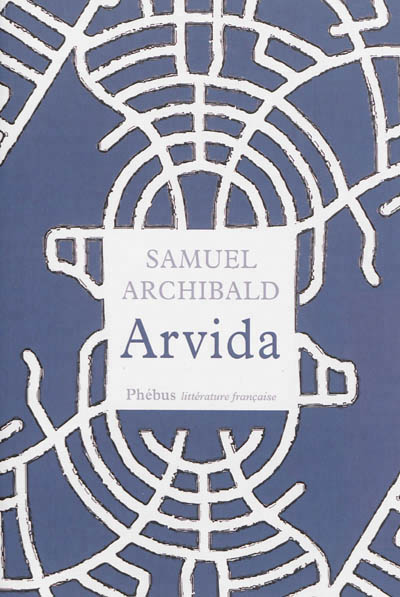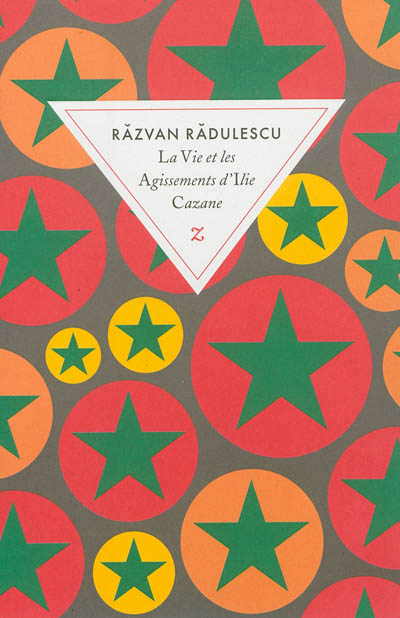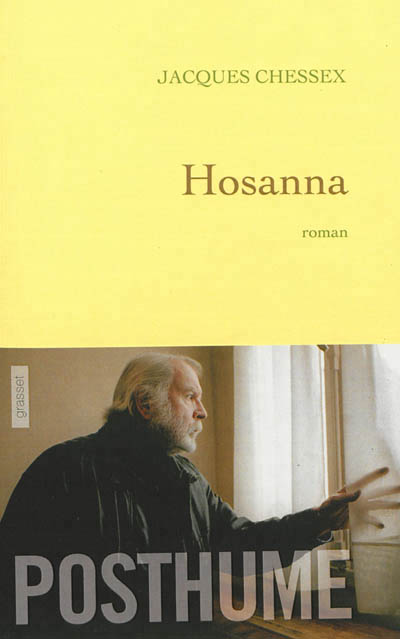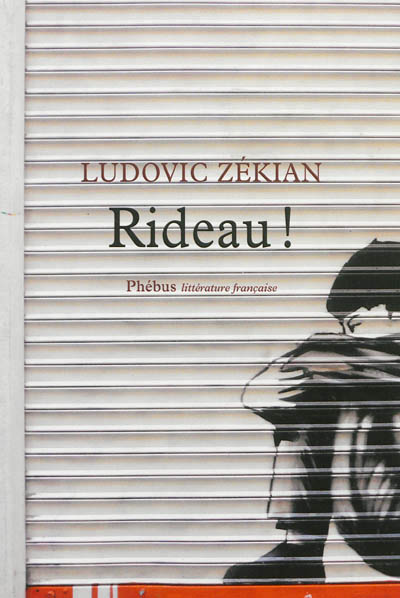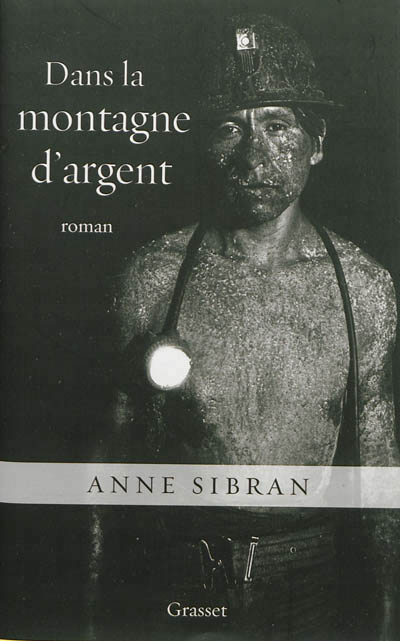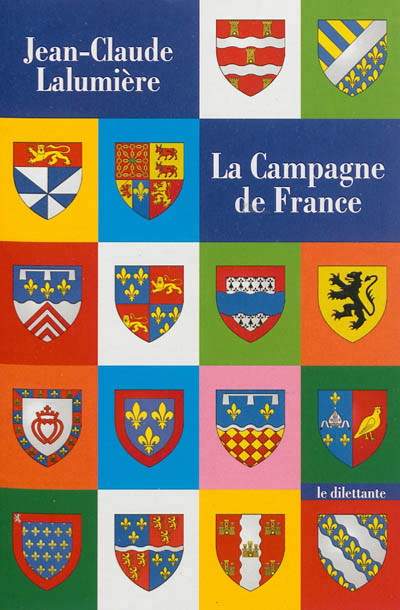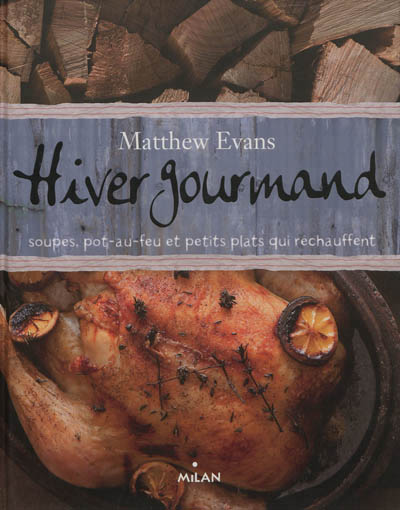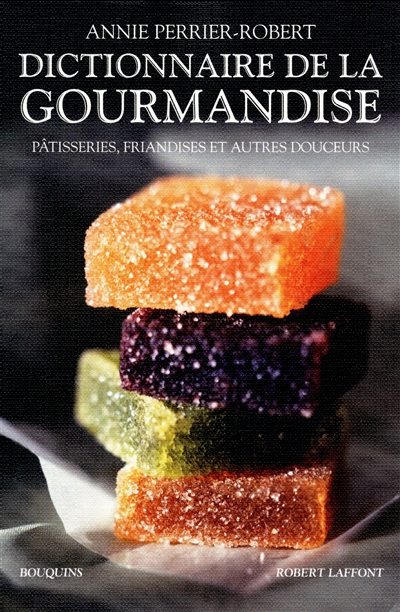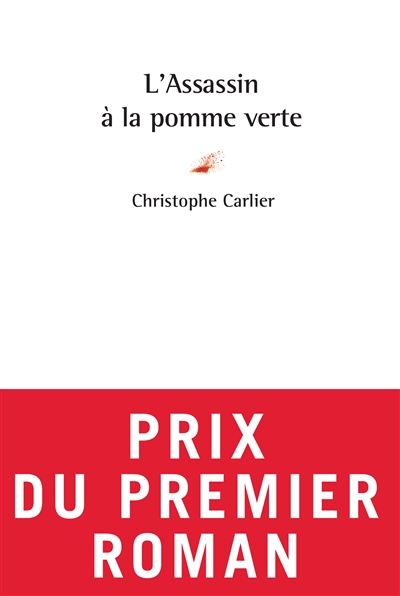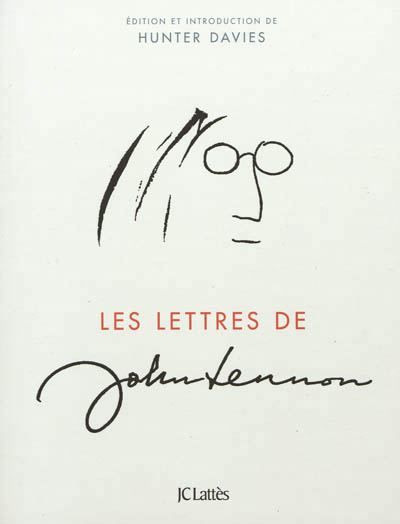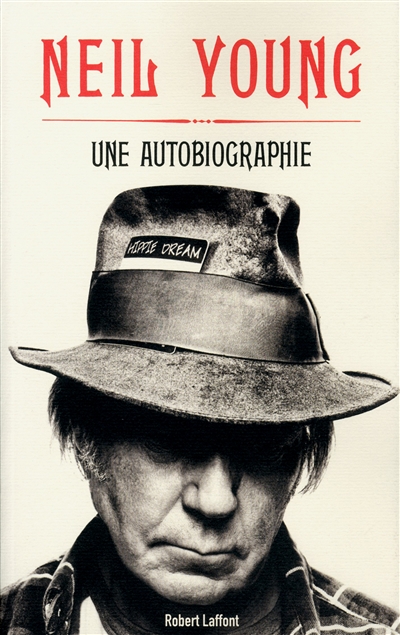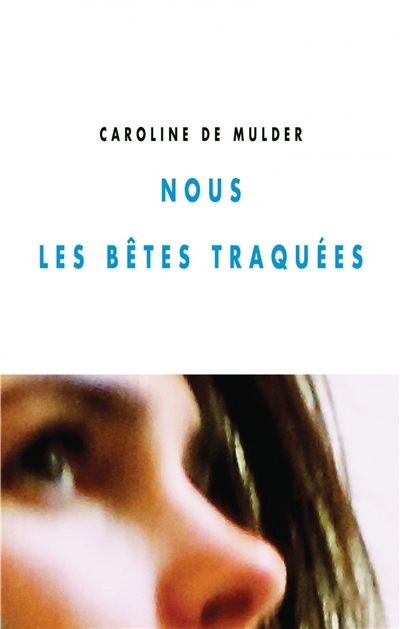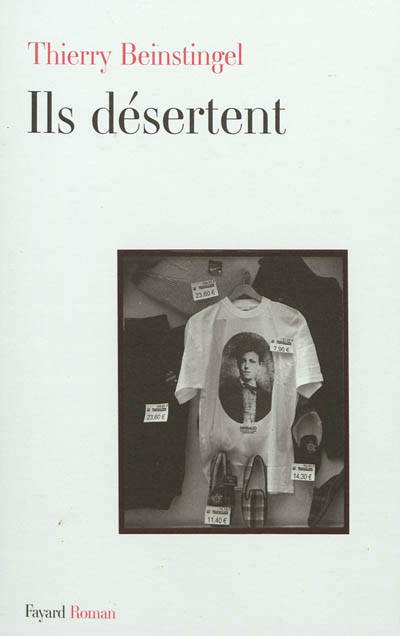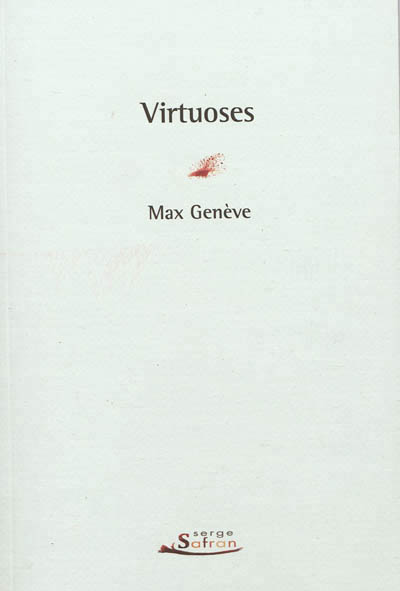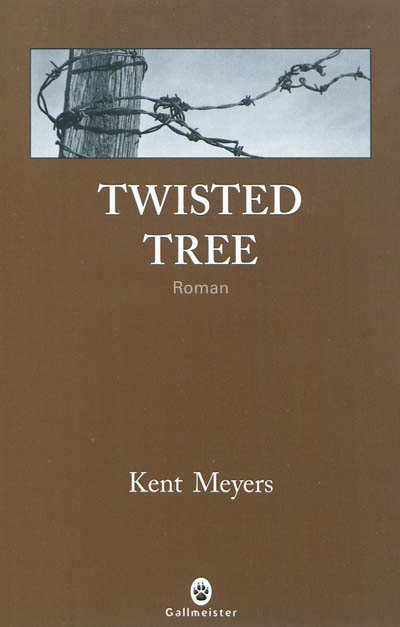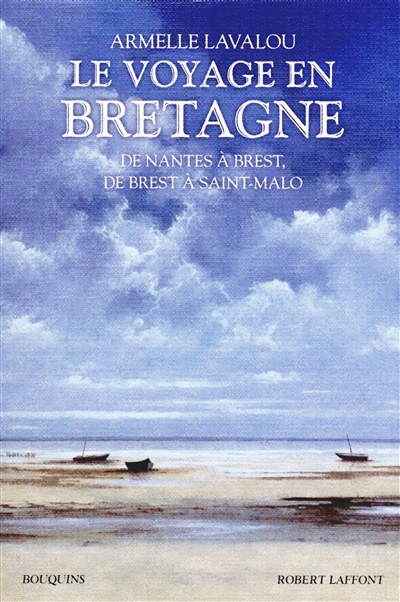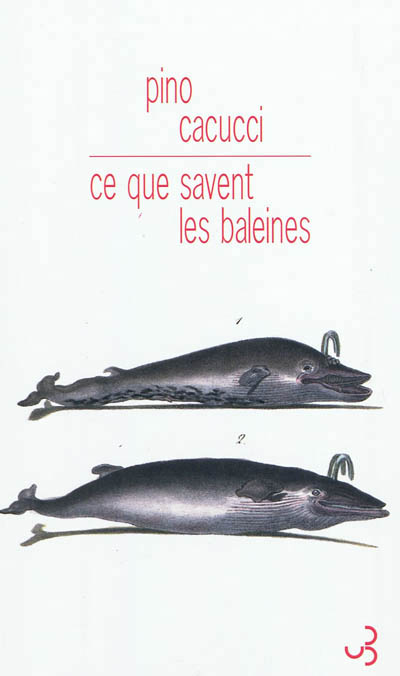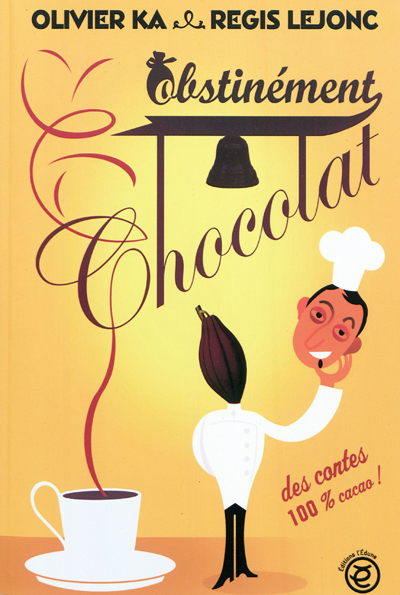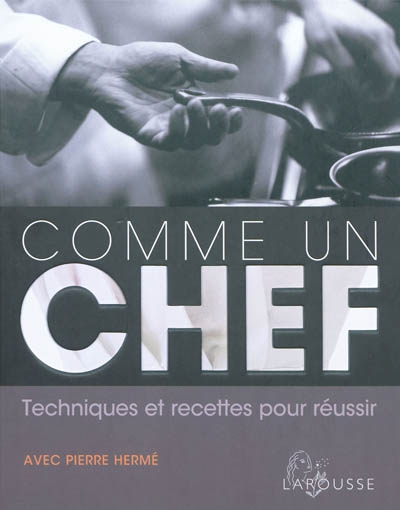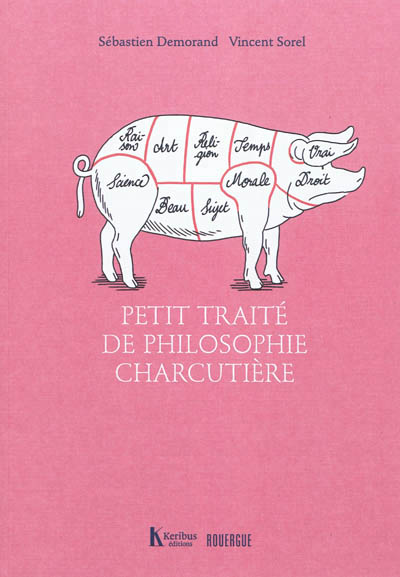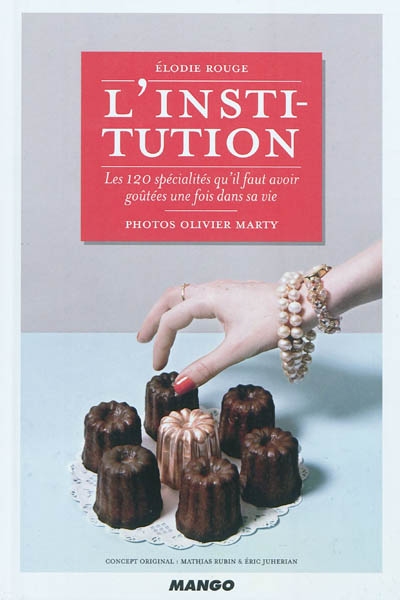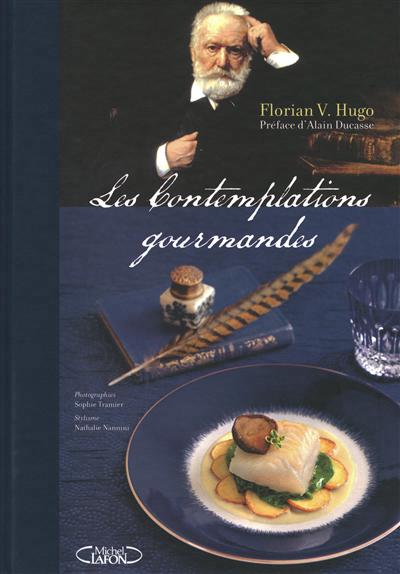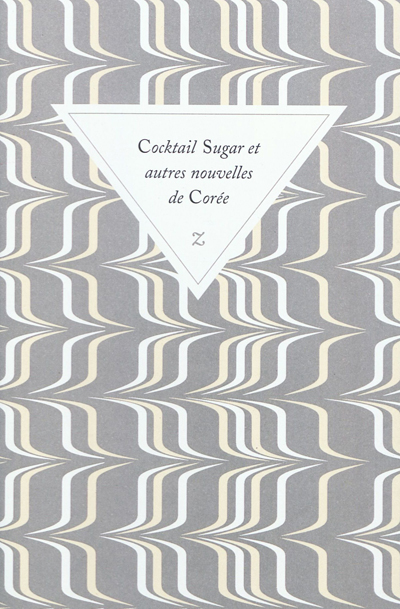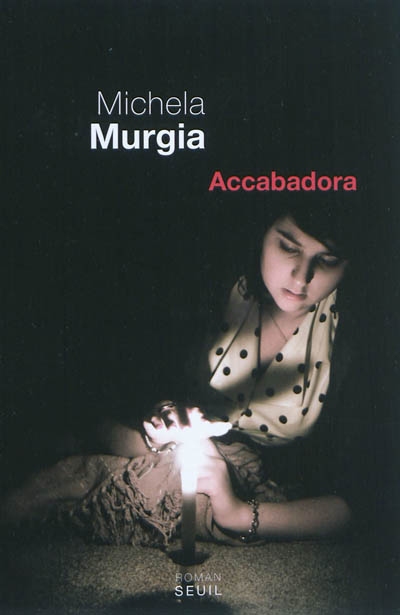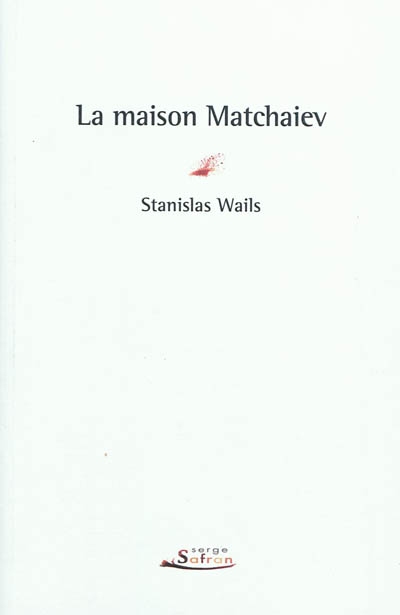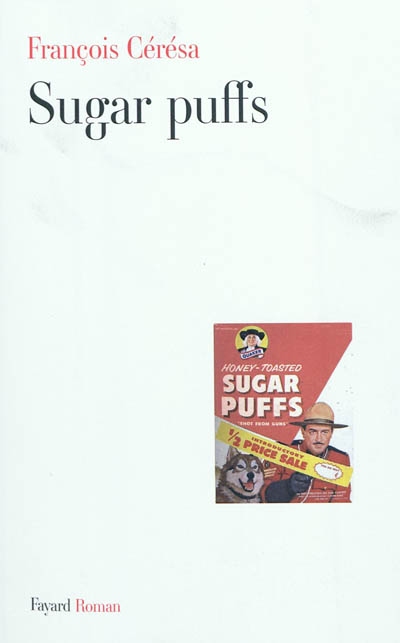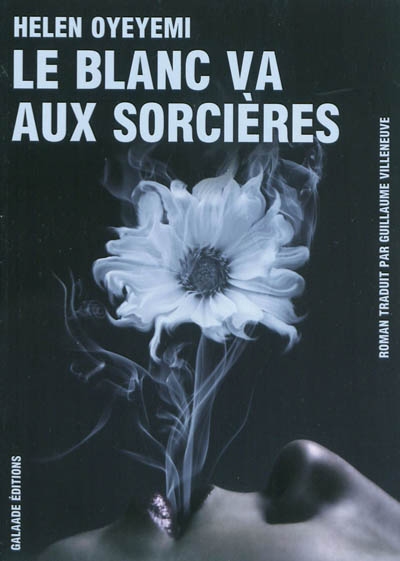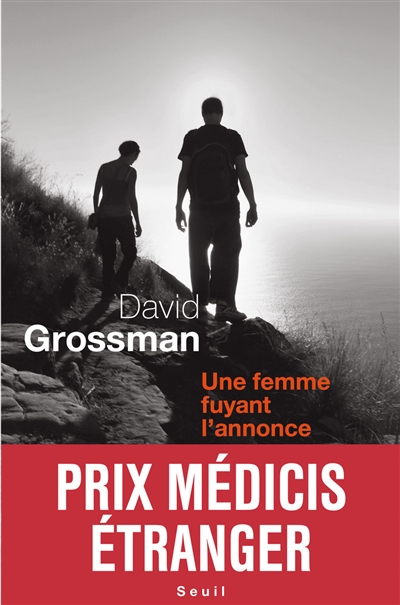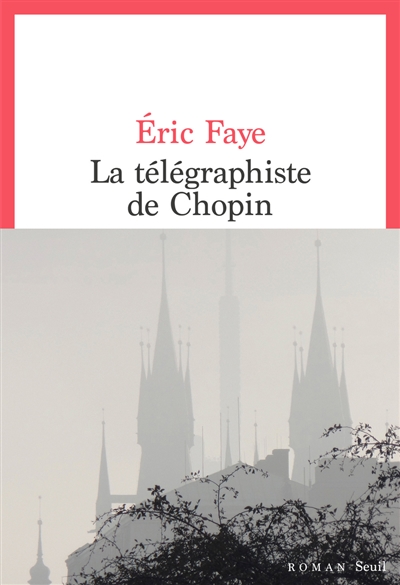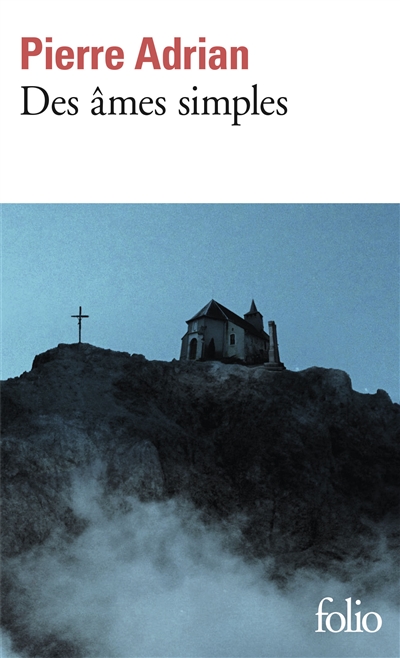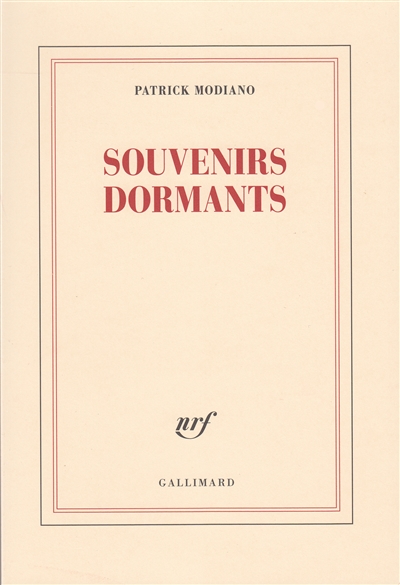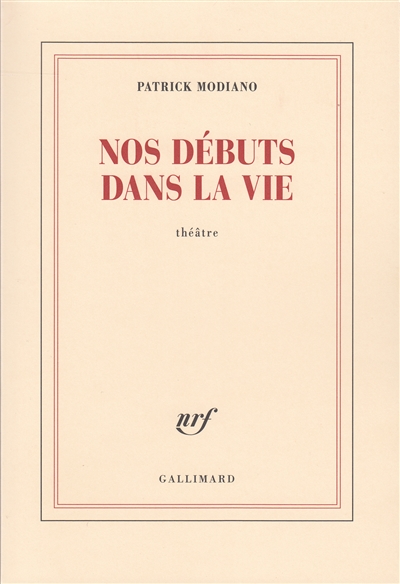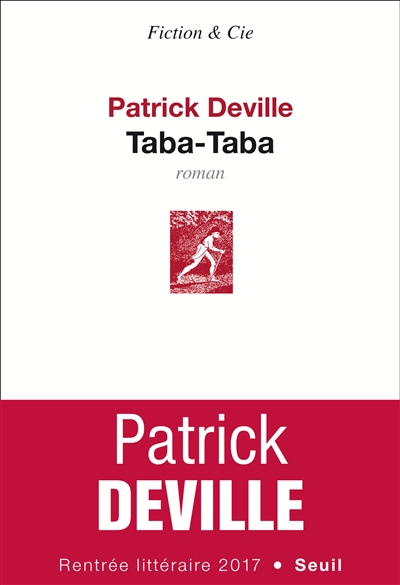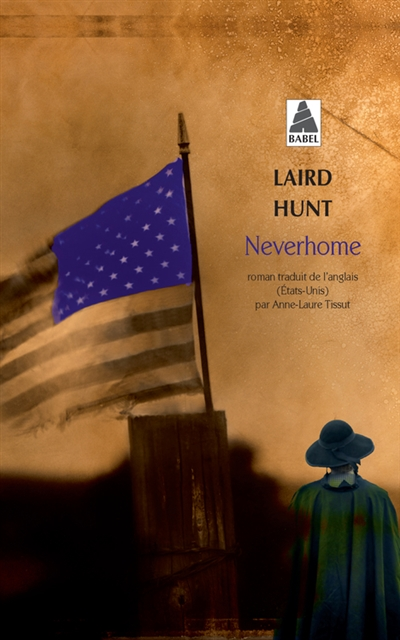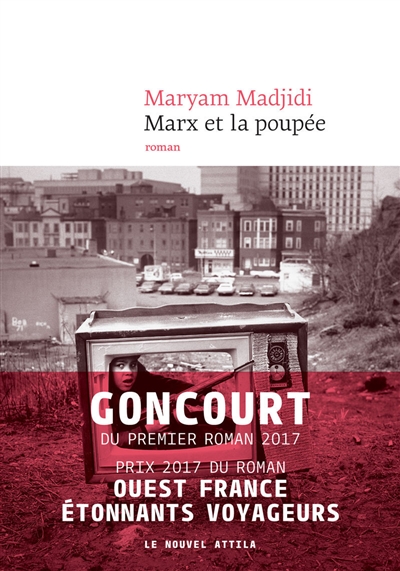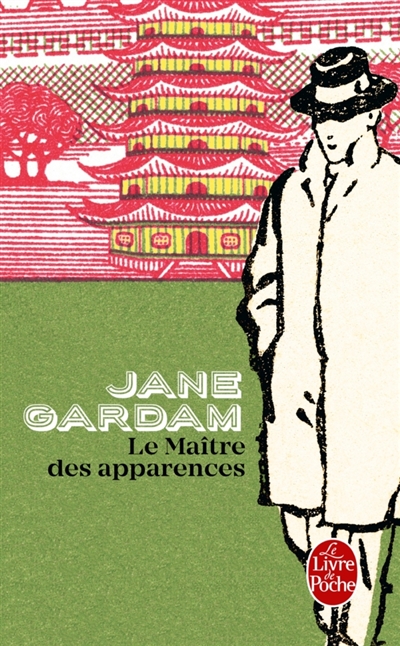Littérature française
Patrick Modiano
L’Herbe des nuits
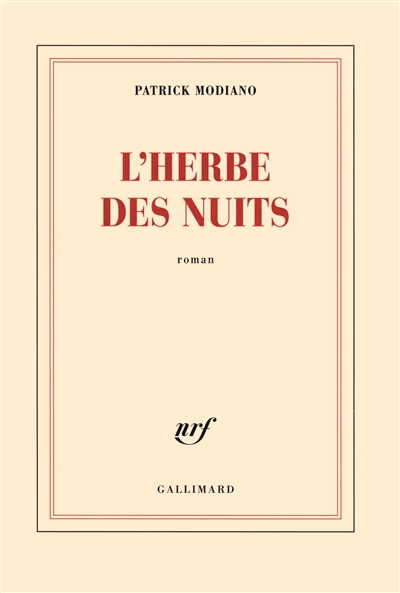
-
Patrick Modiano
L’Herbe des nuits
Gallimard
04/10/2012
192 pages, 16,90 €
-
Chronique de
Jean-François Delapré
Librairie Saint-Christophe (Lesneven) -
❤ Lu et conseillé par
5 libraire(s)
- Damien Rodriguez de du Contretemps (Bègles)
- David Bélair
- Philippe Soussan de Les Vraies Richesses (Juvisy-sur-Orge)
- Olivier Huguenot de Le Neuf (Saint-Dié-des-Vosges)
- Eva Brayet de municipale de Wissous (Wissous)

✒ Jean-François Delapré
(Librairie Saint-Christophe, Lesneven)
Qui peut dire qu’il sait lire Modiano ? Qui sait déchiffrer les pages du carnet que lui-même peine parfois à relire. Ici, le carnet est un brouillard, un rêve peut-être : « Pourtant, je n’ai pas rêvé. » Dans cette première phrase, tout est dit. Ensuite, tout s’écrit.
Il nous faut partir à pied et le suivre encore une fois dans les méandres de Paris. Il nous le dit, il se promène tout en essayant de se rappeler ce qui était écrit dans le carnet noir, ce qui motivait ces rendez-vous avec Dannie. Et ce lieu, l’Unic Hôtel, perché en haut de la rue Monsieur-Le-Prince, sixième arrondissement. Et ces noms égrenés comme des sentences : Paul Chastagnier, Aghamouri, Duwelz, Gerard Marciano. Le carnet n’est pas un souvenir, mais un précipité dangereux d’un moment de la vie de ce narrateur qui n’a pas de nom – du moins pour l’instant… Car l’auteur ne sait pas bien s’il est le narrateur ou le passeur du carnet. Il cherche encore à comprendre. Lire Modiano, c’est accepter de se perdre dans des méandres qui ne sont pas du fleuve, mais du souvenir, du temps passé, de ces photos en noir et blanc qui font revivre les visages oubliés. Dannie, évidemment, à moins qu’elle ne s’appelle Mireille Sampierry, ou autrement… Il se fiche bien du nom, après tout, et ne se souvient que de celle qu’il accompagnait au long des rues de Paris, celle qui l’emmenait dans sa maison en Sologne. Il y a un meurtre dans ce livre. Est-ce vraiment important ? Il y a des noms qui reviennent comme des antiennes grégaires, des rues mal éclairées et des appartements désuets. Il y a souvent des ampoules grillées sous les abat-jours et des lumières qu’on oublie d’éteindre. Jean (nous apprendrons son prénom par la bande, comme s’il fallait le cacher jusqu’au bout) et Dannie (saurons-nous jamais son identité véritable ?) continuent leurs errances entre le 23 de la rue Blanche et l’entrée de l’Unic Hôtel où Chastagnier et consorts continuent de fumer, de boire et d’observer Dannie qui rejoint sa chambre. Lire Modiano, c’est laisser le temps se dissoudre, c’est fréquenter les fantômes, ceux de l’après-guerre et des années 1960, comprendre aussi que le Paris d’aujourd’hui est peuplé de souvenirs troubles. Les numéros de téléphone ont pris de la rallonge, les hôtels sont devenus des banques, les filles ont changé de trottoir, les loufiats des bistrots ont abandonné le gilet noir et la montre à gousset. J’ai envie de lire à mon aimée des phrases du livre, non pas des phrases d’amour, il n’y en a pas, mais lire le phrasé de Modiano, ce qui fait de lui un unique papillon de nuit sur les réverbères de la littérature française, ce qui fait que lui seul ne peut s’y brûler, car il sait louvoyer dans la phrase, éviter les écueils. Je disais qu’il y a un meurtre, et sans doute que les deux balles tirées n’auront pas manqué leur cible. On fermera des portes cochères, on portera un corps, on laissera tout cela se fondre dans la nuit. Il faudra des dizaines d’années à Jean pour remonter le cours du carnet. Nous revenons au fleuve, remonter un fleuve à la force des bras et des souvenirs, tenter de relire les pattes de mouche, déchiffrer des noms, arpenter les rues, vérifier des noms dans des annuaires, être Modiano encore une fois. Elle lui dira : « Est-ce que tu crois que j’ai vraiment une tête à m’embarquer dans une sale histoire ? » Bien sûr qu’il va la croire, car tout ici est écrit sur le fil d’un funambule prêt à rompre, à tomber du sale côté de l’histoire, celle des bandits, des Chastagnier, Duwelz, Gerard Marciano, ceux qui fument du côté de l’Unic Hôtel. Lire Modiano, c’est accepter une fois pour toutes de faire des rencontres improbables, de convertir certaines vérités en joli mensonge, comme le dernier de Dannie, qu’elle fait croire à Jean comme si c’était le premier : « Je t’ai fait un petit mensonge qui me pèse, je n’ai pas 21 ans comme je te l’ai dit. J’en ai 24. Tu vois, je serai bientôt vieille. » Lire Modiano, c’est laisser croire que le temps ne s’écoule pas, il advient, se pose, ne se discute pas, et c’est pour cela que c’est beau.