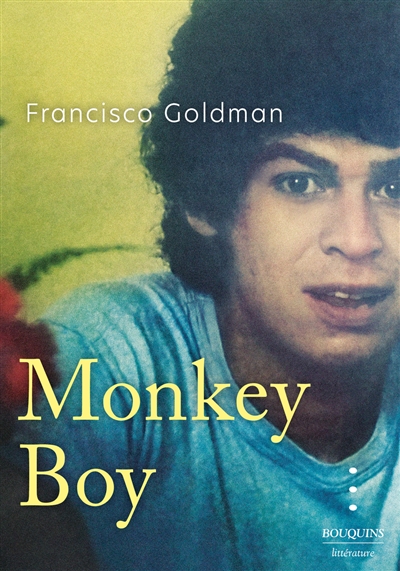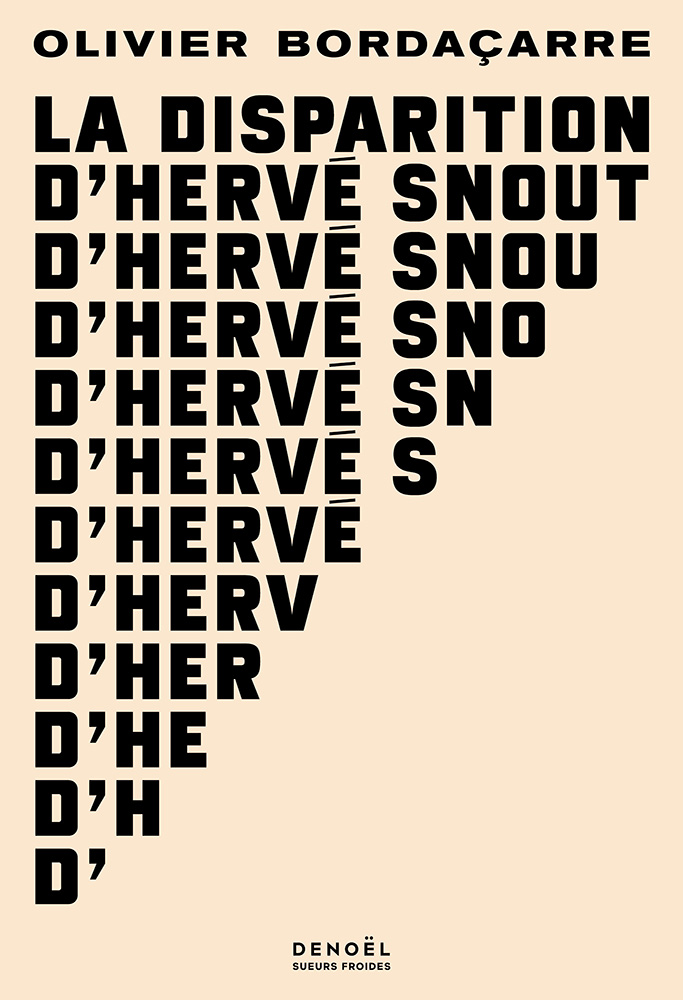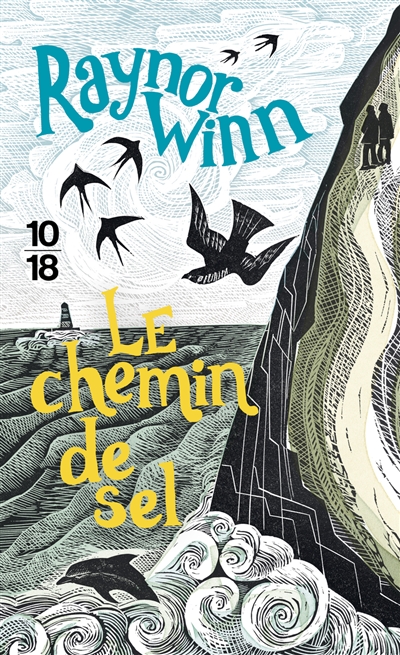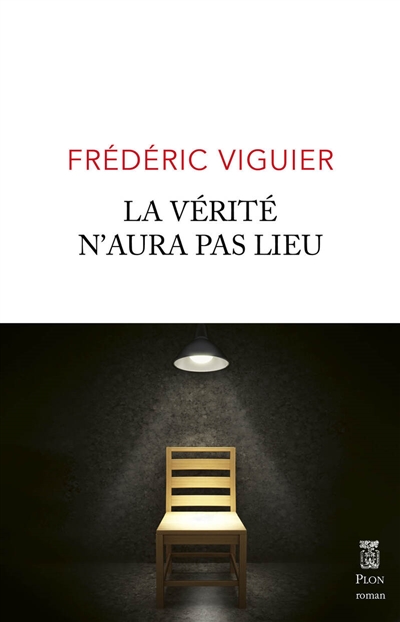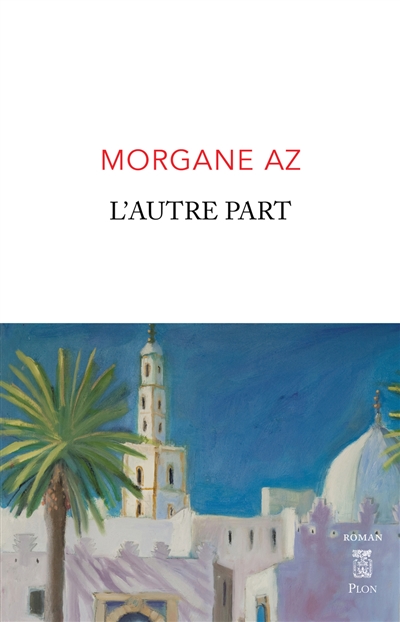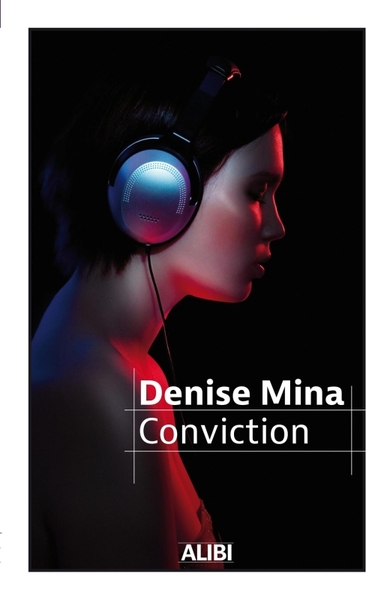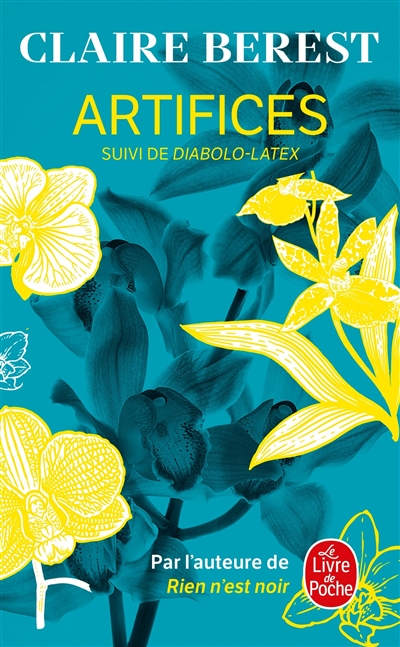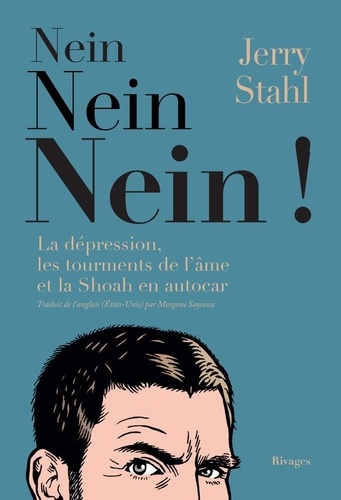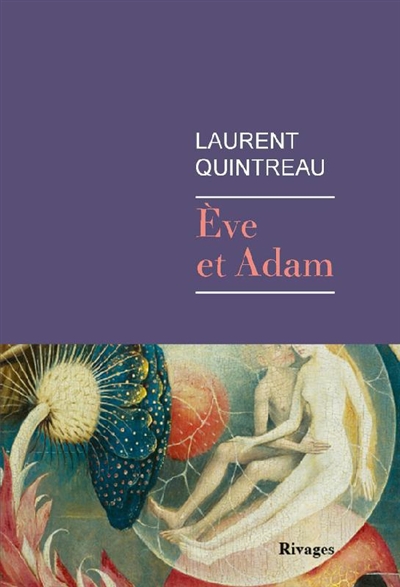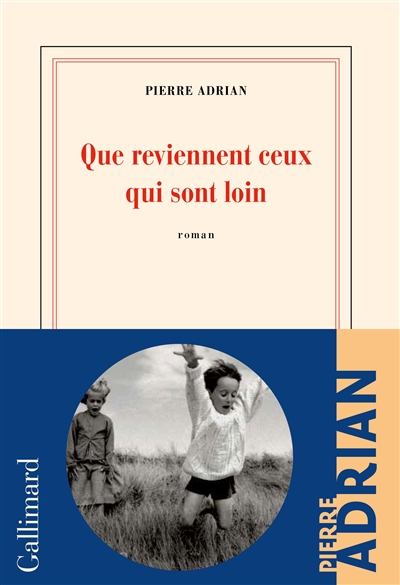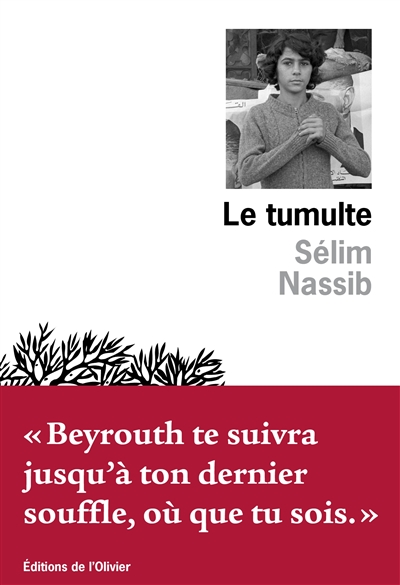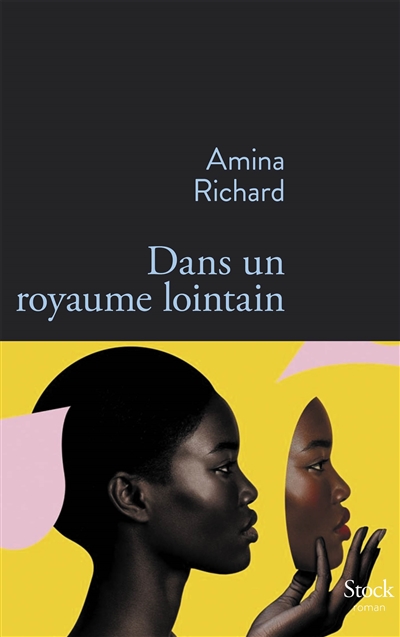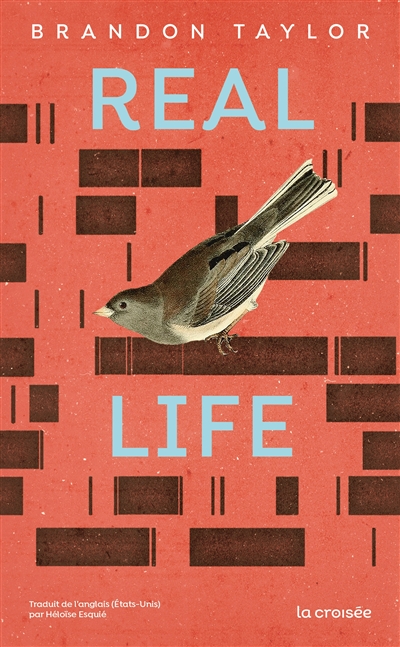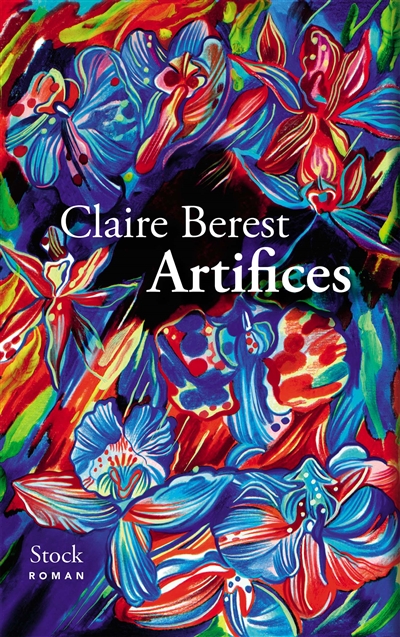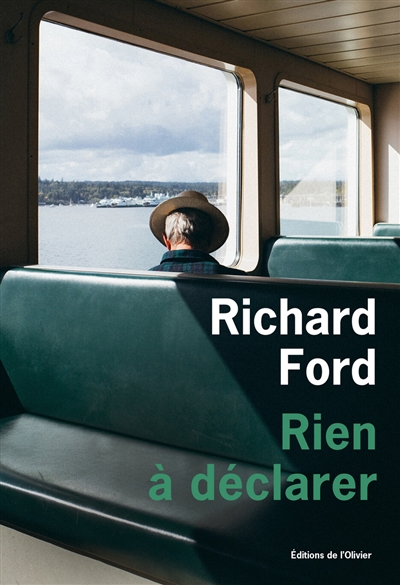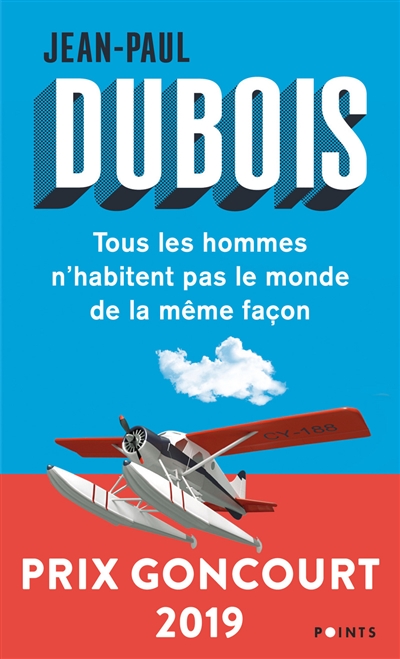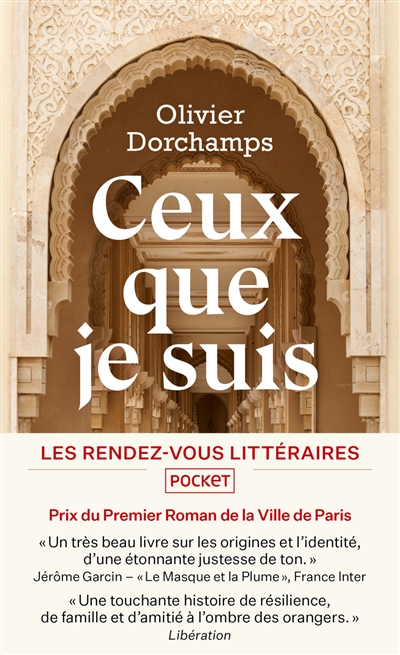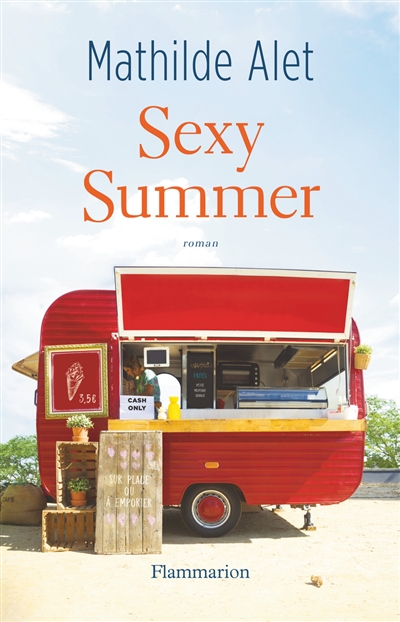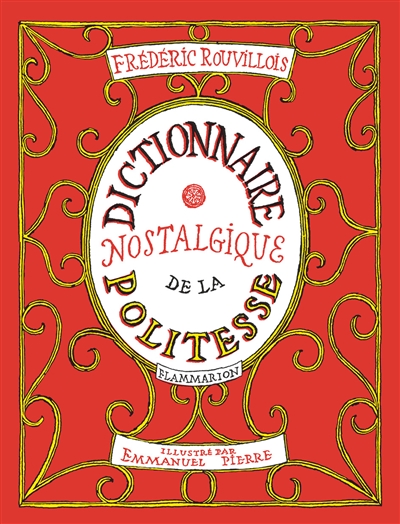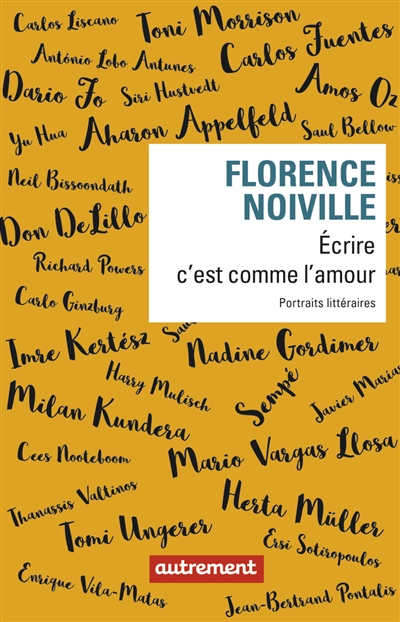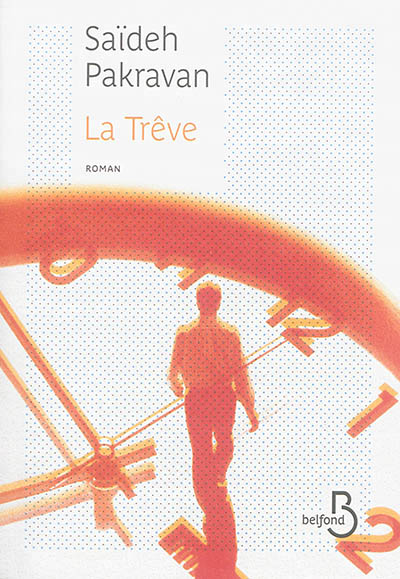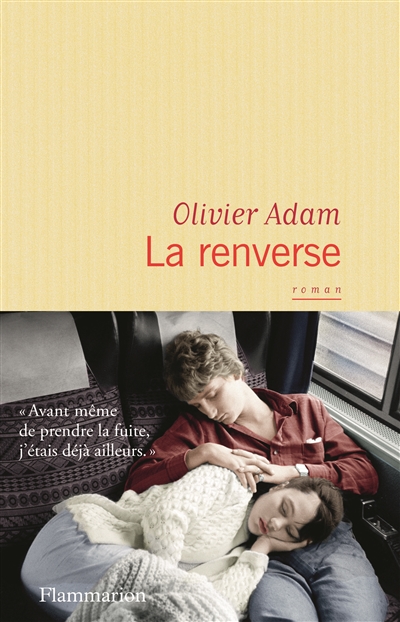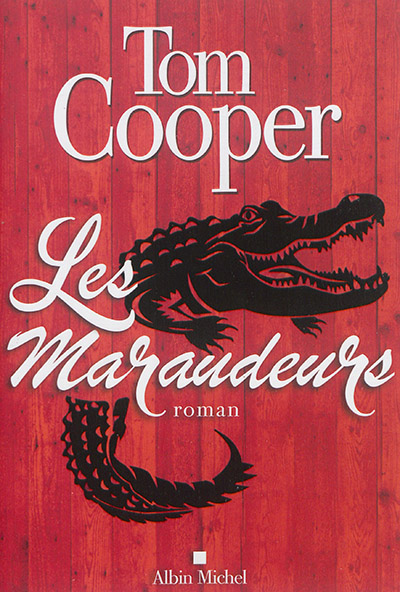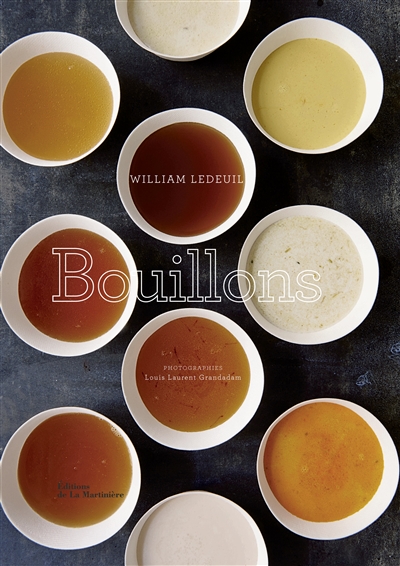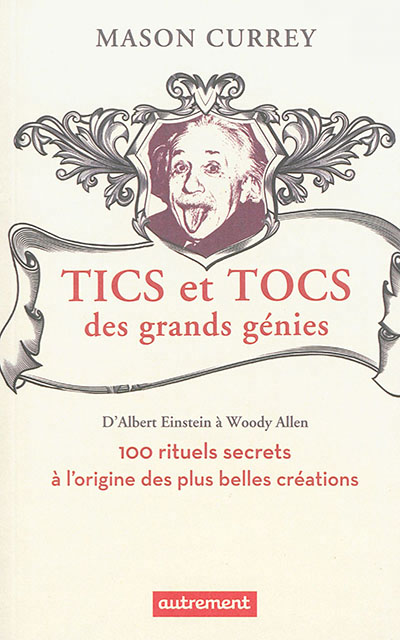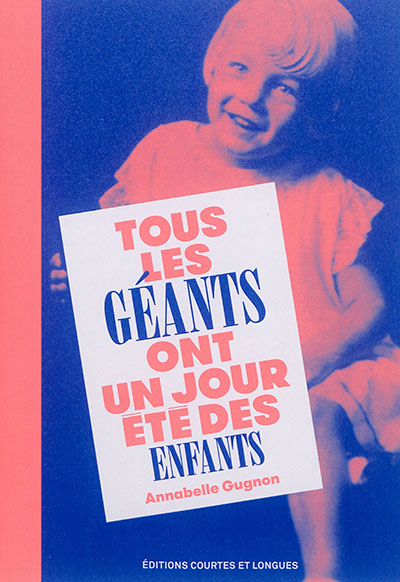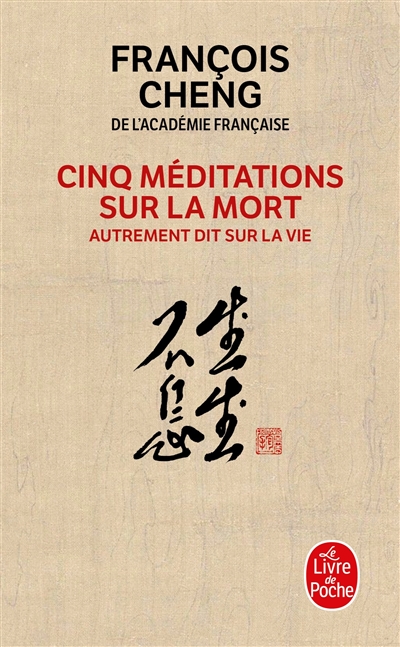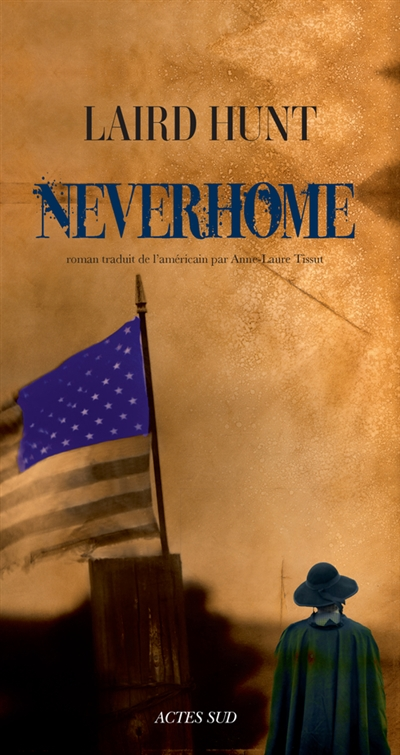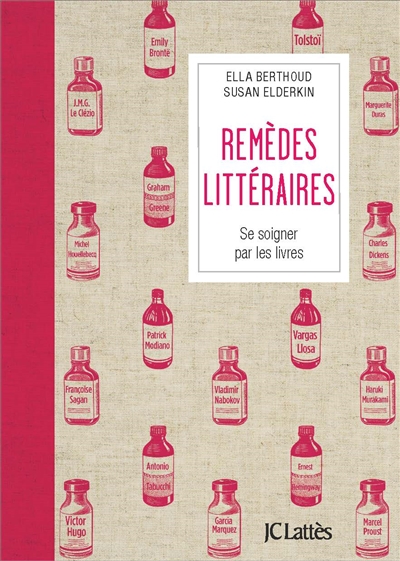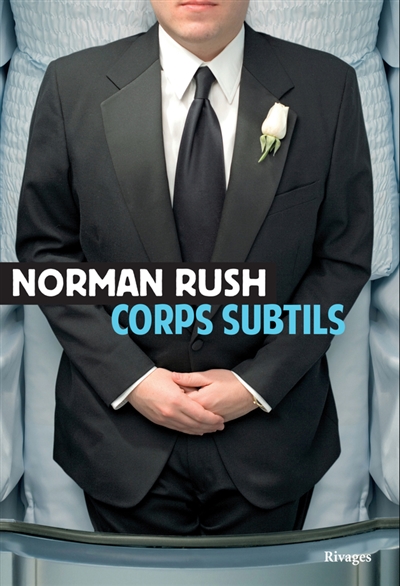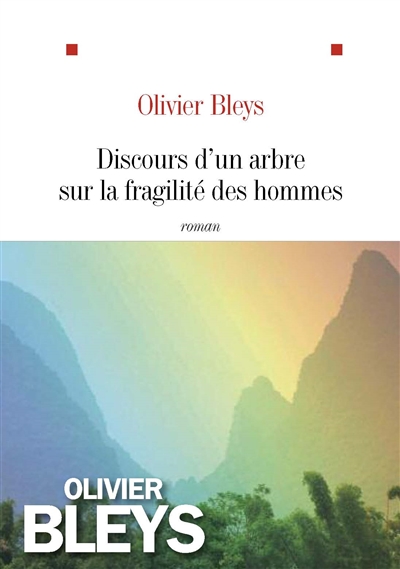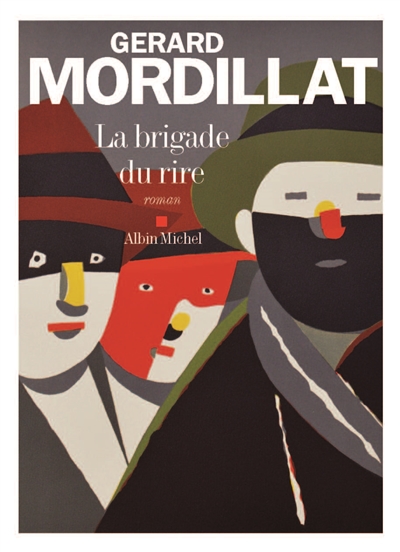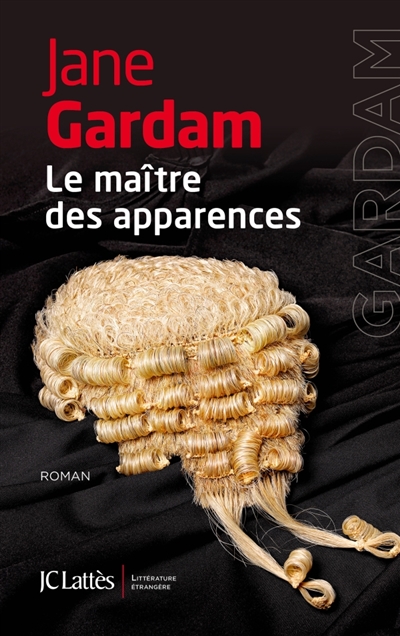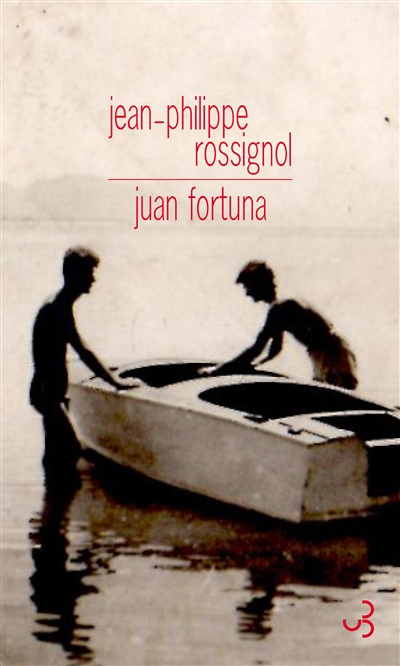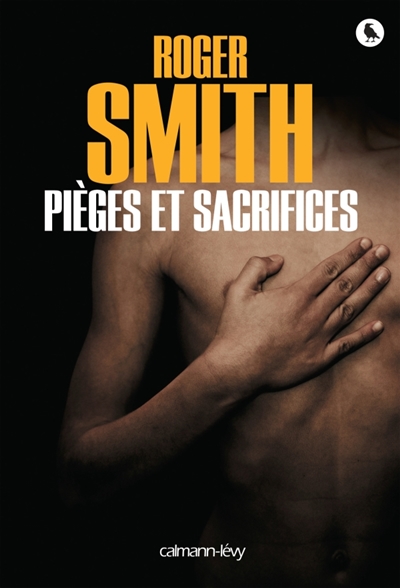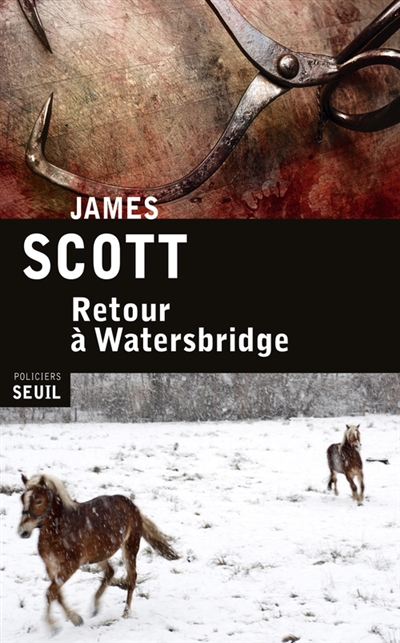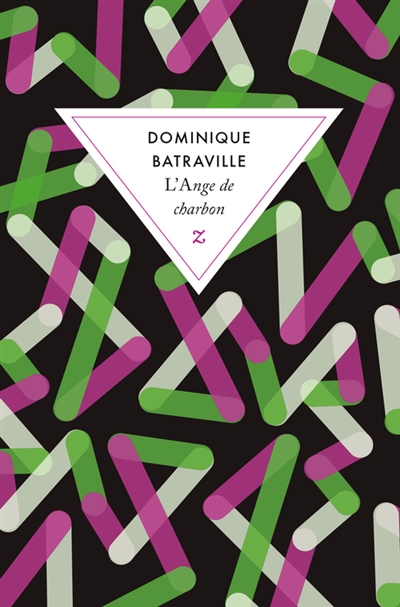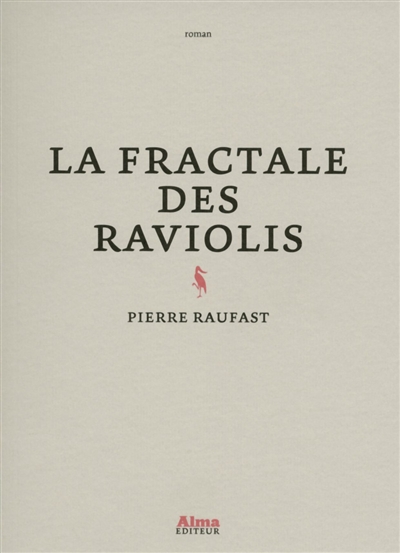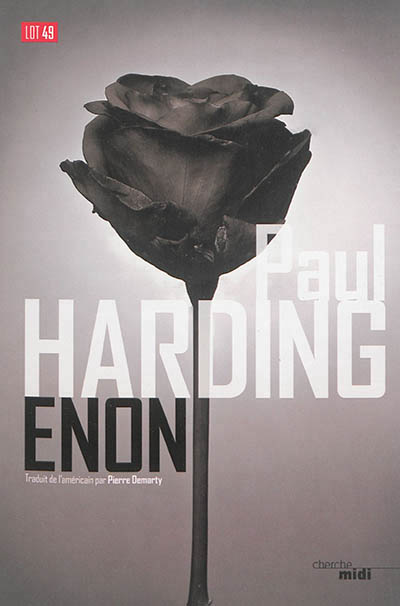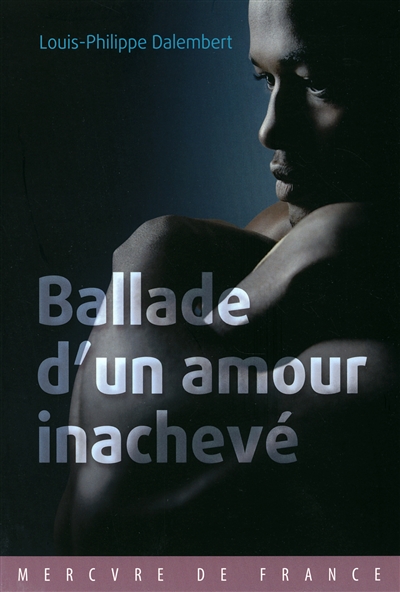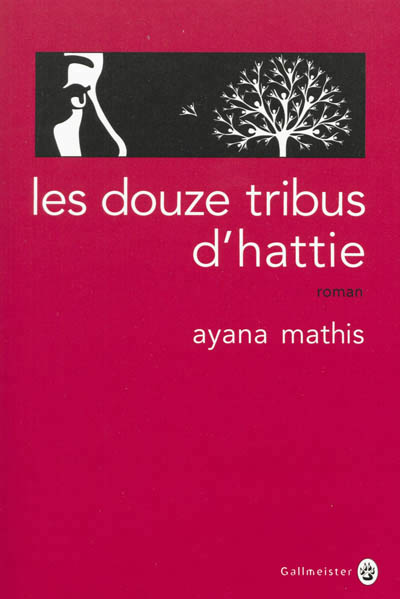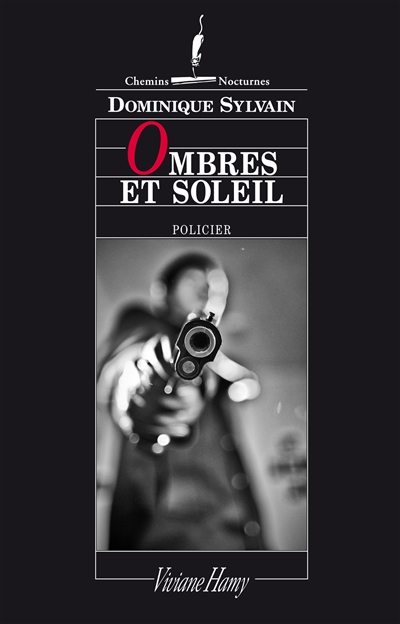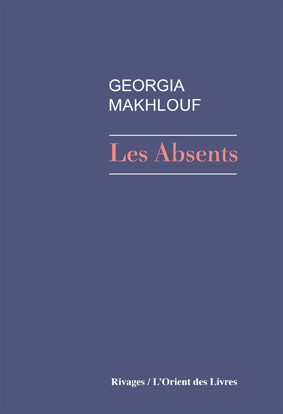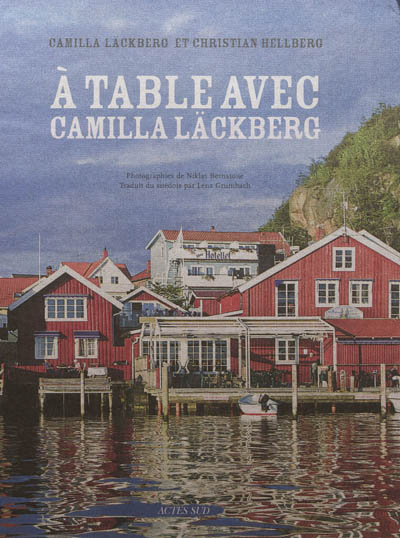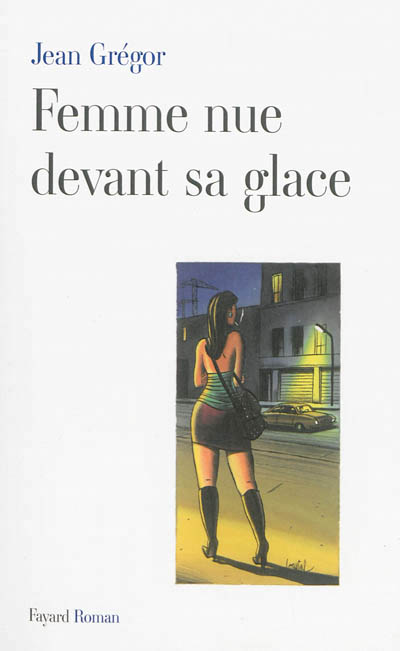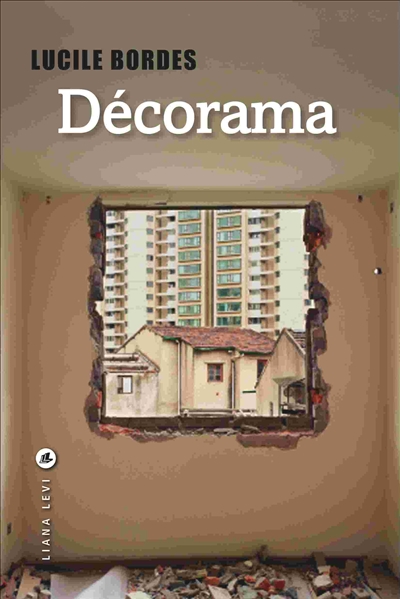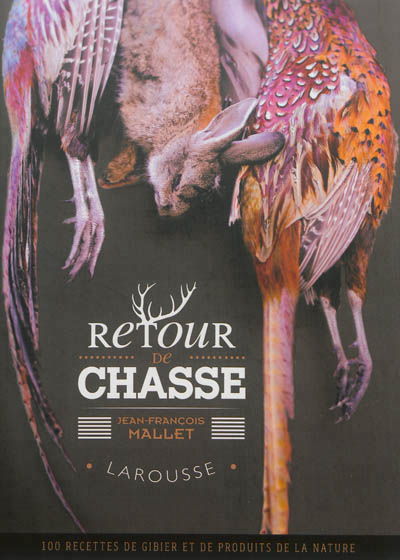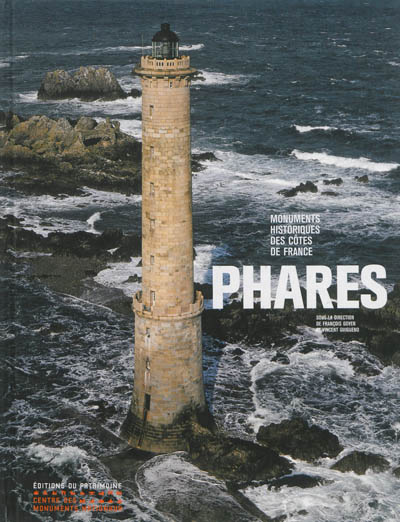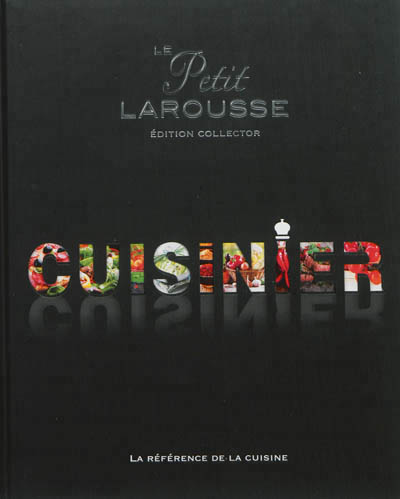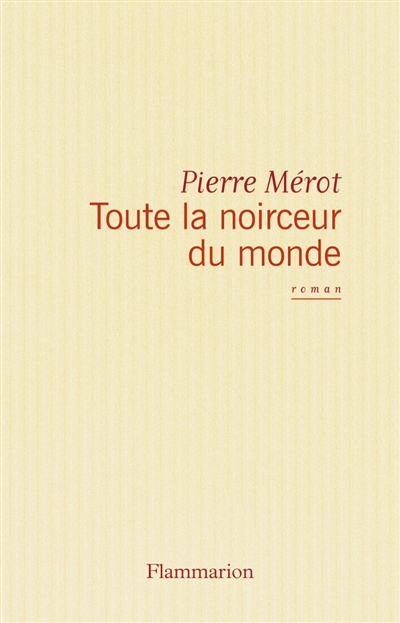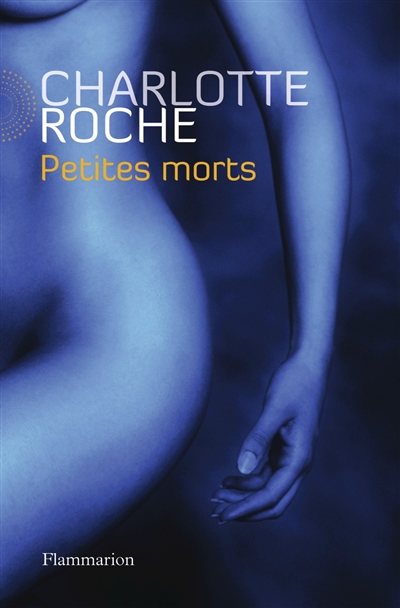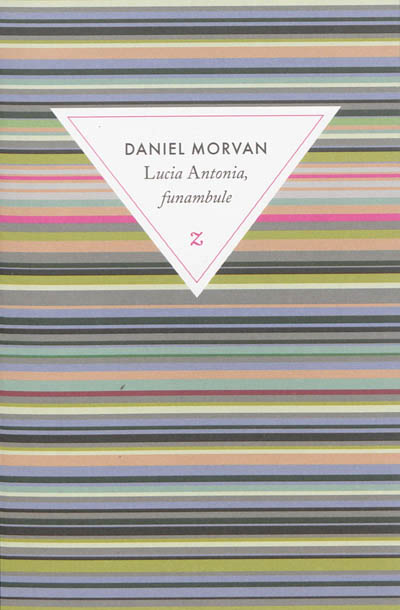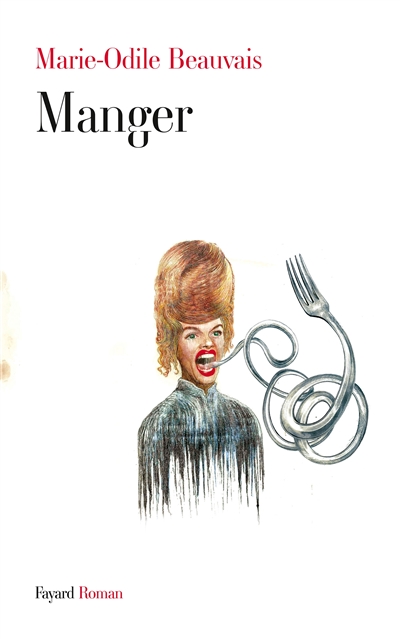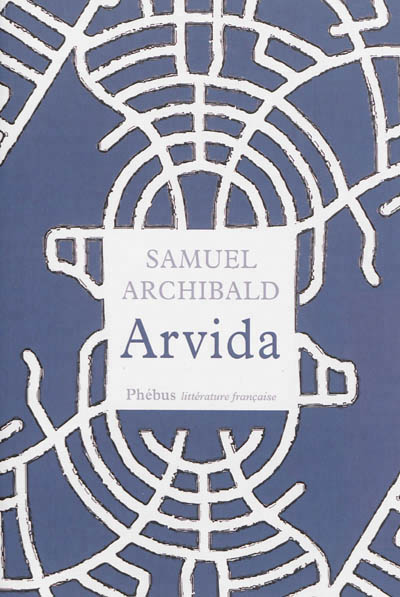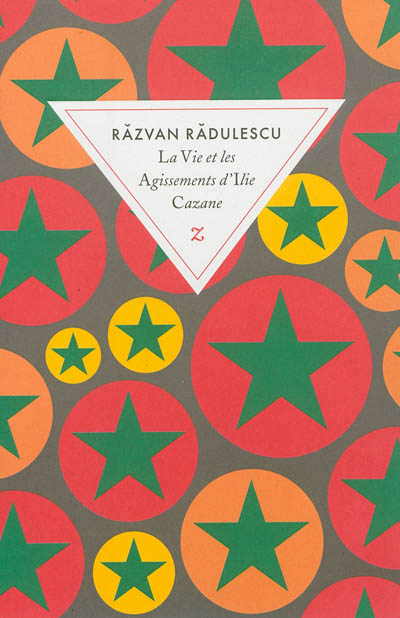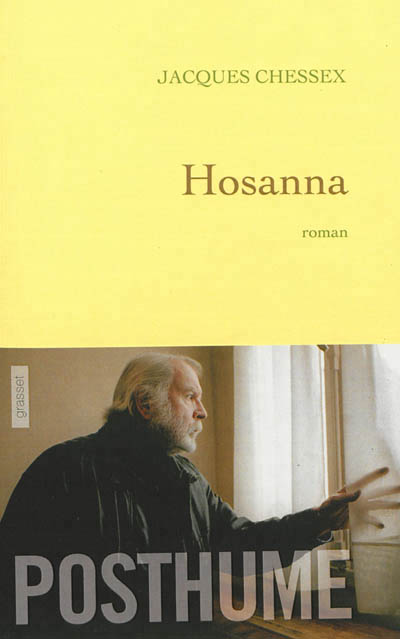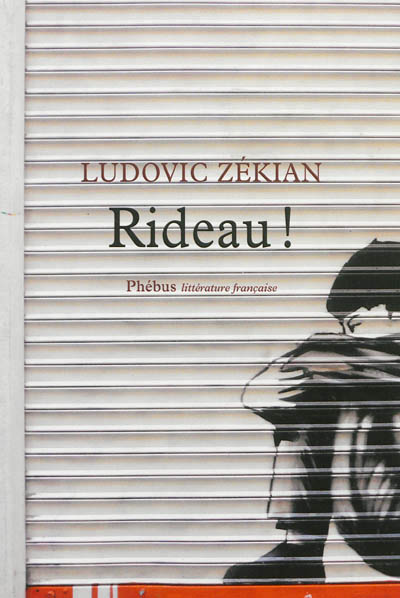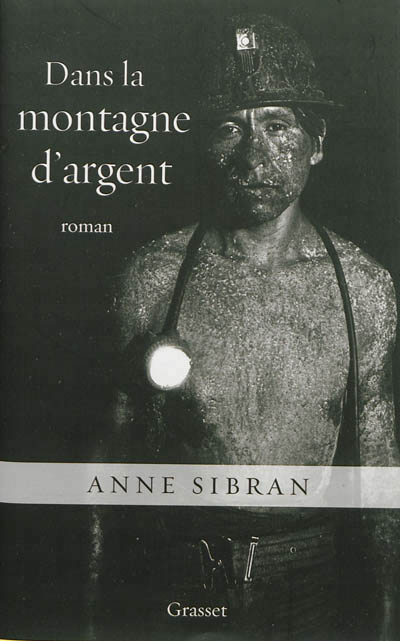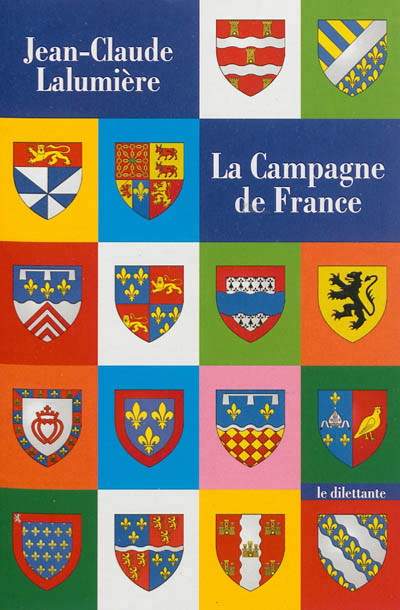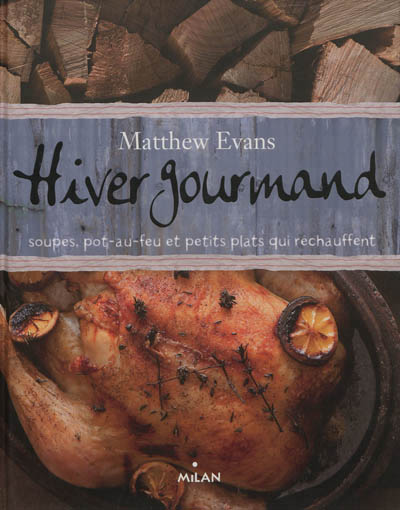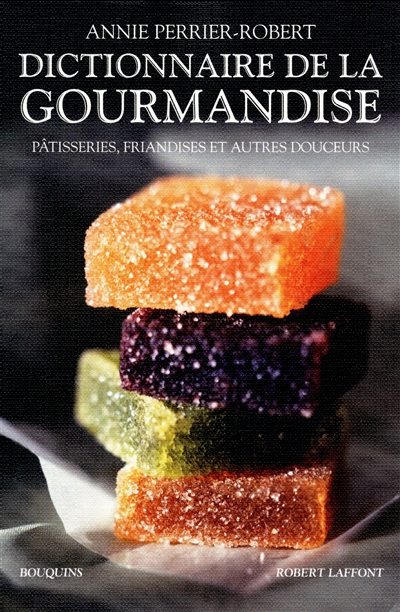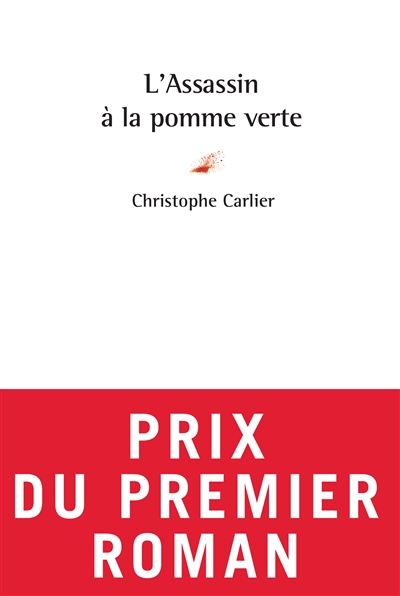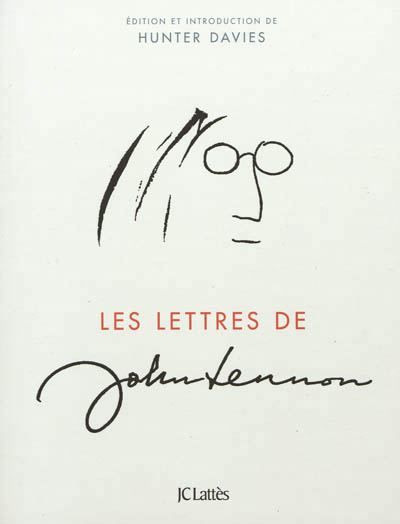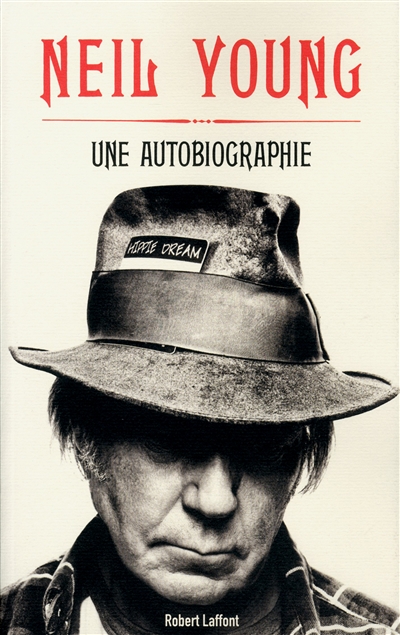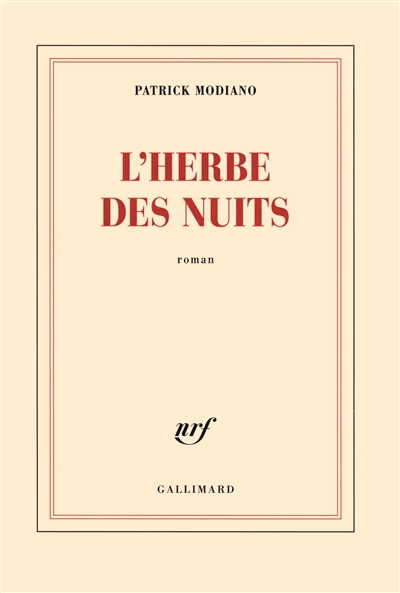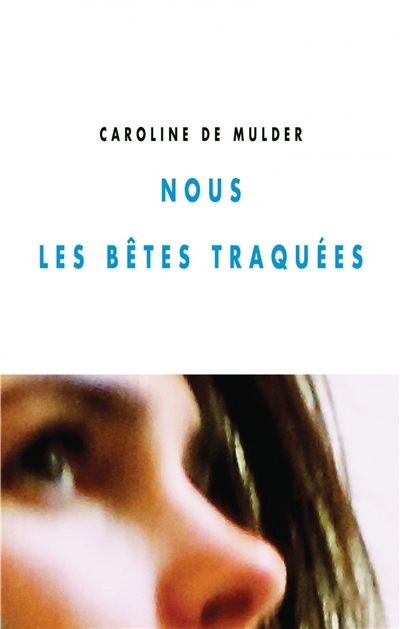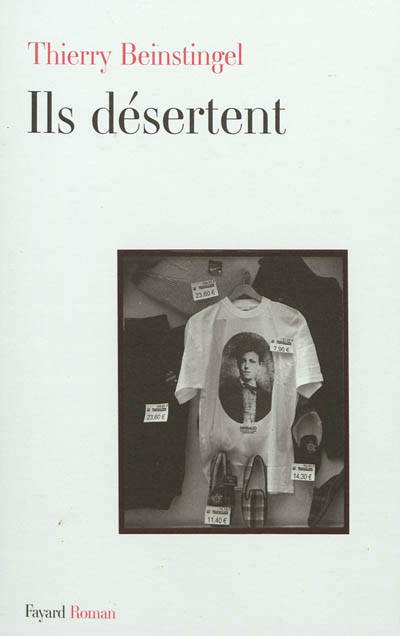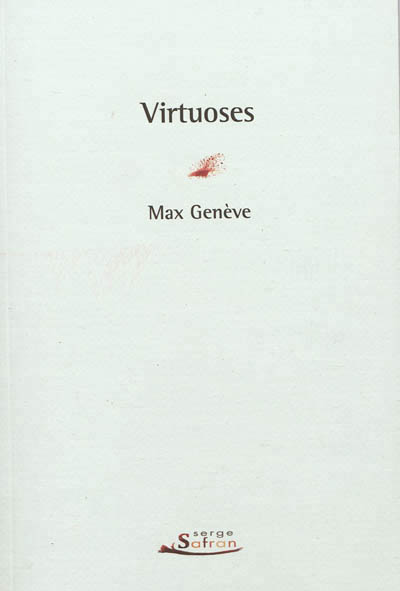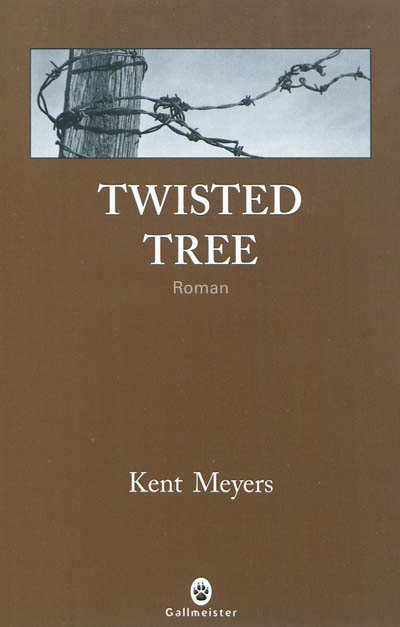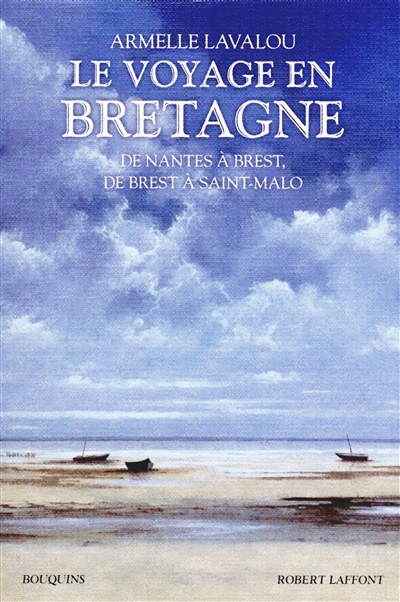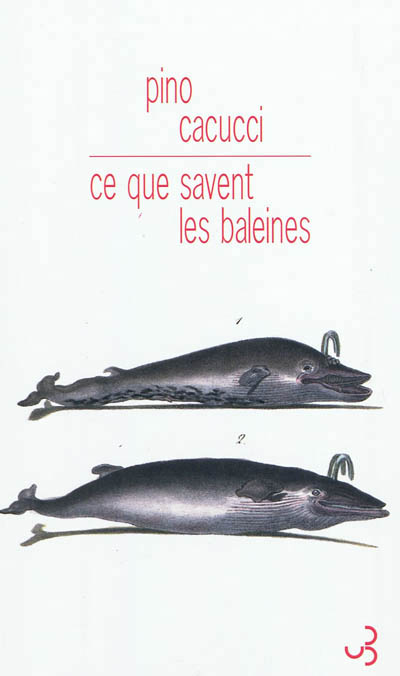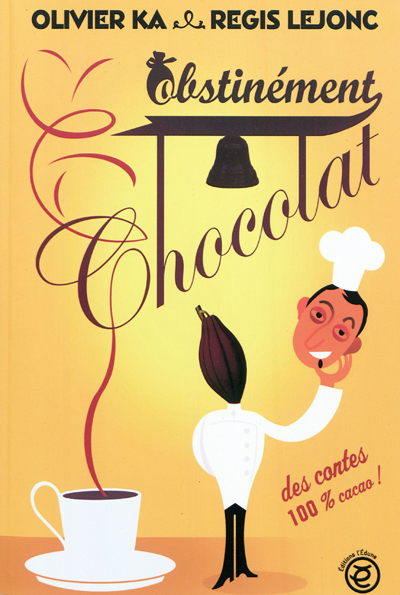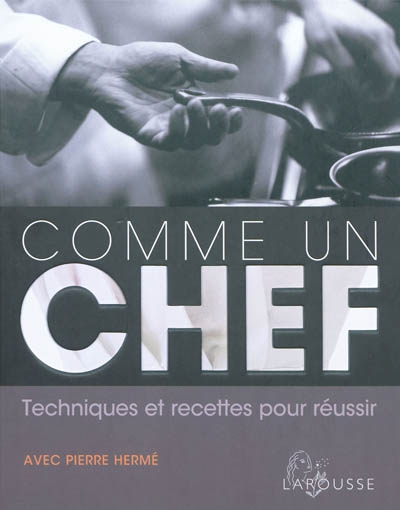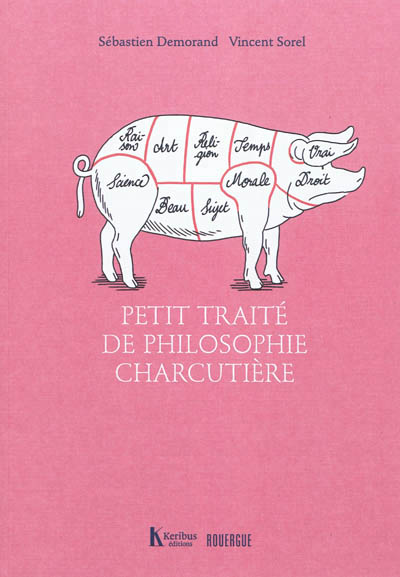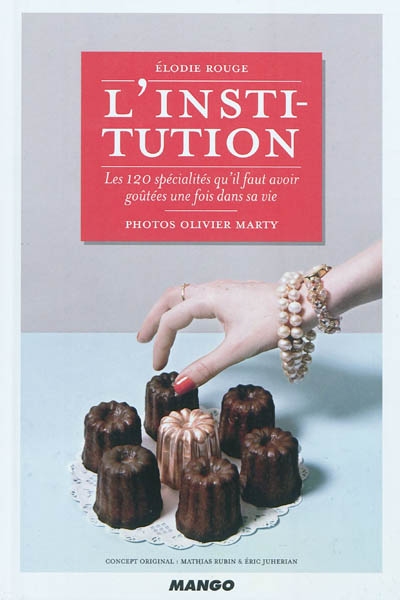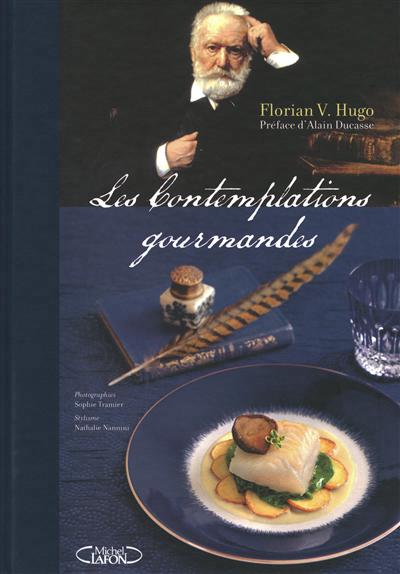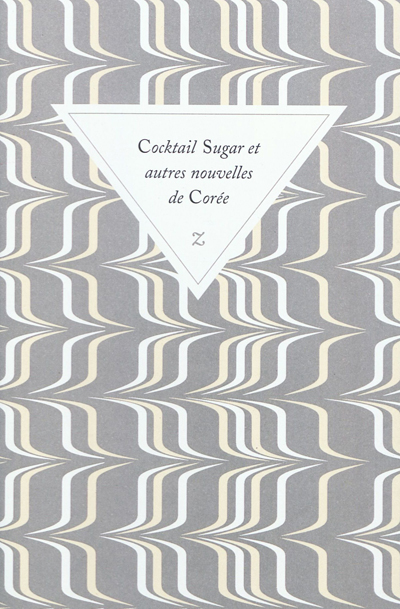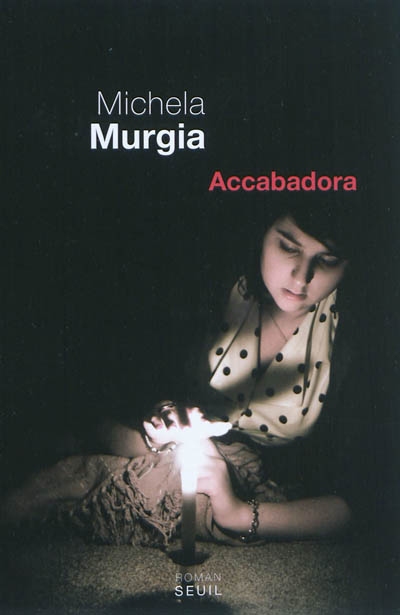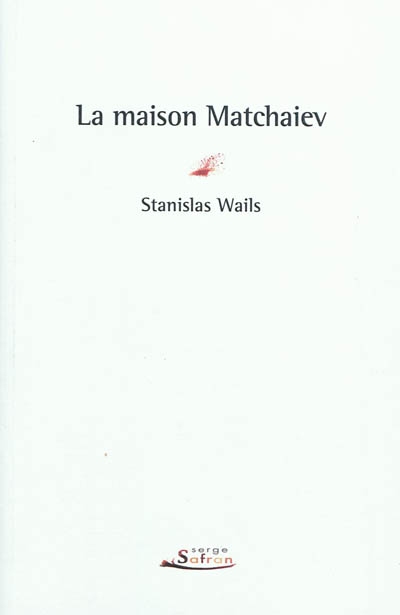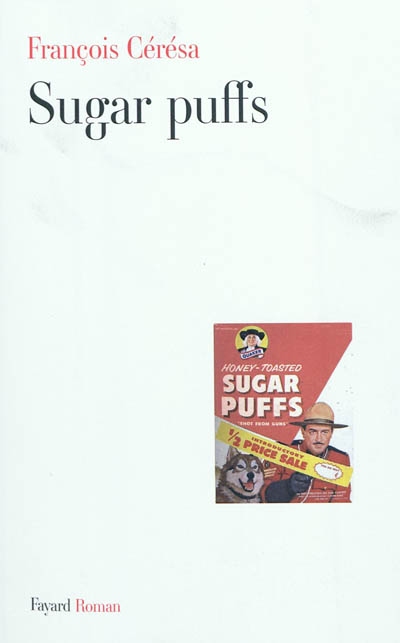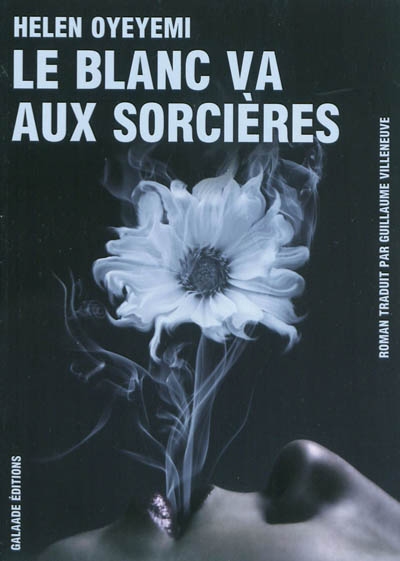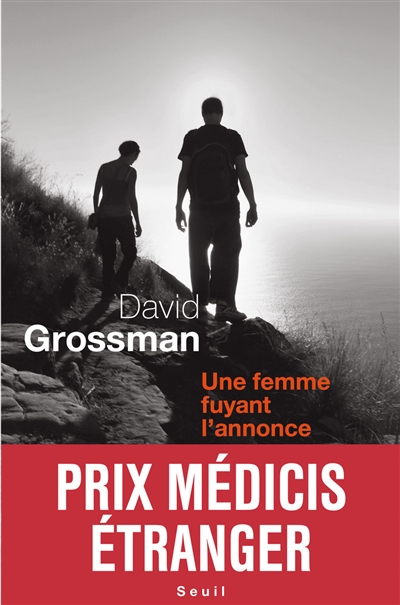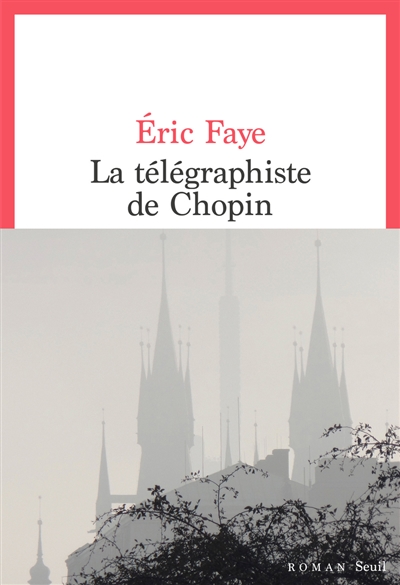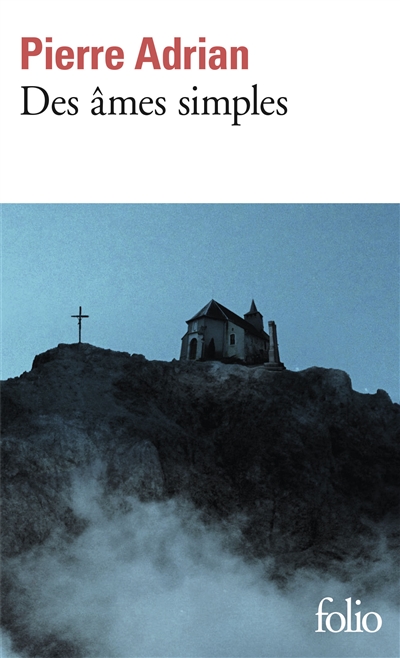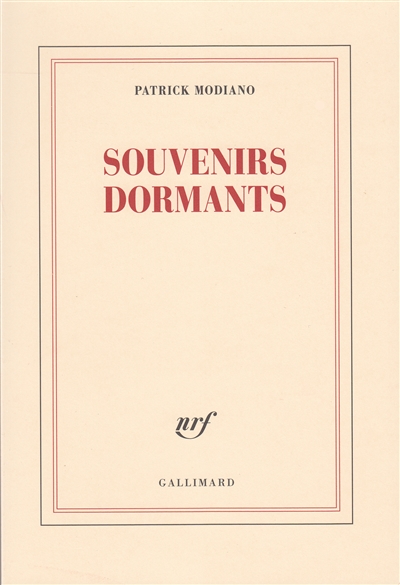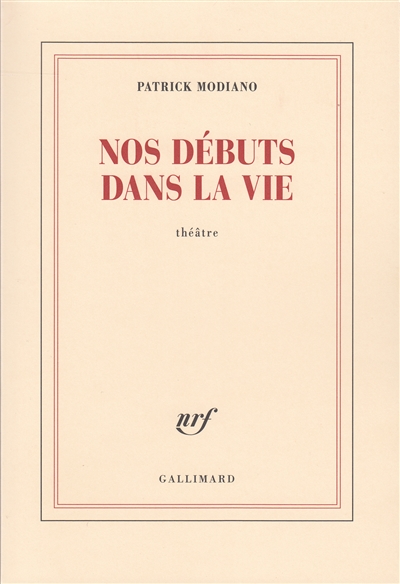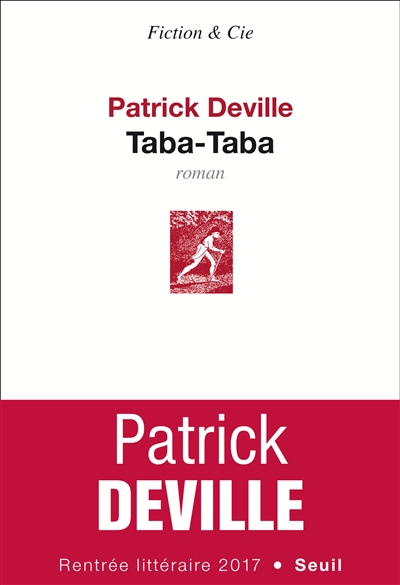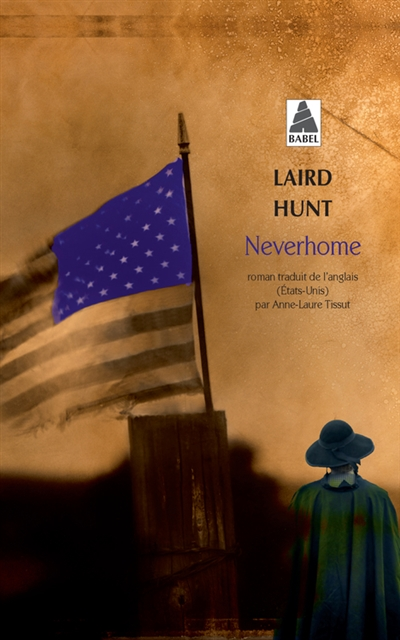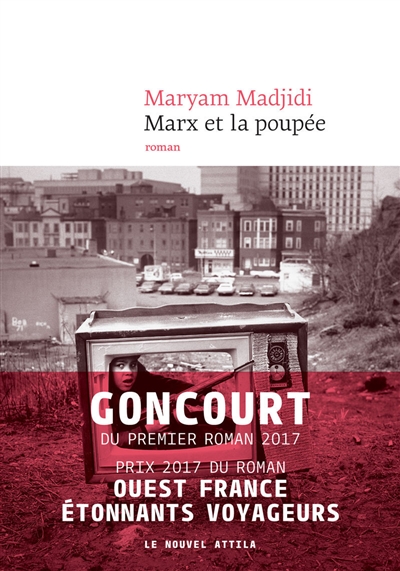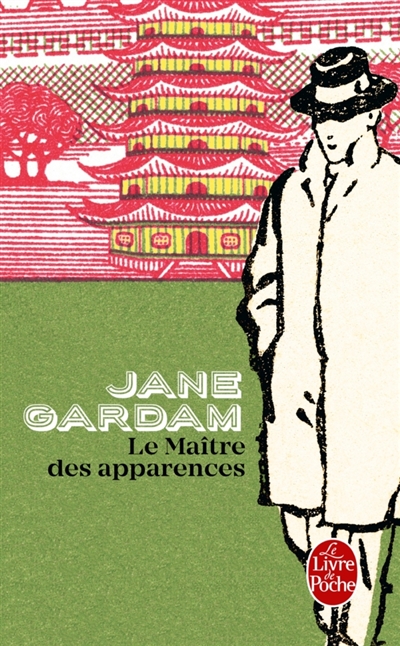Littérature étrangère
John Le Carré
Une vérité si délicate
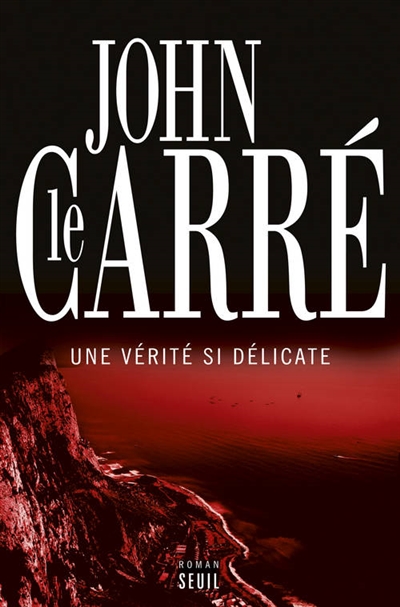
-
John Le Carré
Une vérité si délicate
Traduit de l’anglais par Isabelle Perrin
Seuil
17/10/2013
336 pages, 21,50 €
-
Chronique de
Jean-François Delapré
Librairie Saint-Christophe (Lesneven) -
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales, Université (Tours)
- Jean-Pierre Maillet de La Parenthèse (Beaupréau)

✒ Jean-François Delapré
(Librairie Saint-Christophe, Lesneven)
Que voulez-vous demander de plus à John le Carré, sinon cette manière so british de rester ce fidèle, ce loyal sujet de sa Majesté, au bouton de guêtre près ? Mais parfois, les rouages se grippent, les paroles se délient et tentent de répondre aux actes. L’espionnage a changé, le Carré non, toujours magistral !
« Paul Anderson, je suis Paul Anderson », se plaît à répéter le personnage en énonçant son nom d’emprunt. Comment a-t-il fait pour se retrouver sur ce rocher de Gibraltar, entité britannique posée à l’extrême sud de l’Espagne ? Un hasard ? Non, pas vraiment. Une folie peut-être, car qui aurait misé un seul cent sur lui, sinon ces gens du Foreign Office pour qui Paul, Paul qui déjà ?… Paul Anderson est l’homme de la situation. S’ils le disent, comment ne pas les croire. Nous sommes en 2008, Wildlife peut commencer. Anglais de sa Majesté et barbouzes américains se lancent, les uns par la terre, les autres par la mer. Tout se passe comme prévu, opération réussie, cible neutralisée, même pas un foutu grain de sable. Paul Anderson peut rentrer chez lui tranquille... Tranquille ? 2011, Paul ne s’appelle plus Paul. Il a repris son vrai nom. Retraité en Cornouailles, il veille Suzanna, sa femme qui combat un cancer. Quand il comprend que l’opération Wildlife n’a pas été celle à laquelle il avait cru participer, quand il comprend qu’il n’a été qu’un faire-valoir, Christopher Probyn cherche à comprendre, remue la boue avec l’aide de Toby Bell, secrétaire du ministre, et recherche ce qui lui a été caché. Remonter les traces, retrouver ceux qui ont participé, Shorty, Jeb... Le parcours sera semé d’embûches, on ne fouille pas impunément les poubelles des ministères ! Toby Bell devra faire un choix entre sa carrière rectiligne ou mettre au jour une affaire d’État. Plus on avance dans le roman, plus on se laisse prendre par la violence qui gouverne en coulisse. Un seul petit doigt dans l’engrenage nous entraîne là où ne pensait jamais devoir se retrouver, dans la noirceur des officines privées qui régentent désormais les conflits – des conflits qu’elles réinventent sans cesse, telle l’Hydre de Lerne, dont les têtes se régénéraient au fur et à mesure qu’on les coupait. Ce qu’il y a de formidable dans l’écriture de John le Carré, c’est cette faculté de plonger son lecteur dans tous les tourments de l’aventure. Si rien n’est caché, si tout semble affleurer au fur et à mesure qu’il nous entraîne derrière Probyn et Bell, il montre surtout la complexité de ces guerres nouvelles, tellement éloignées de celle de L’Espion qui venait du froid. Désormais, la guerre n’est plus l’apanage des États, elle est devenue celle des sociétés privées qui se partagent le monde à coups de milliards de dollars. Les derniers chapitres se lisent en apnée. Dans un style plus resserré que d’habitude, John le Carré nous convie à un final percutant, nous abandonnant avec cette interrogation qui ne cesse de planer, ce doute qui fait que, en regardant son propre téléphone, on se demande bien si, nous aussi... Mais non, je dois rêver, tout cela est impossible, comment dites-vous ? Ah oui, Schiller écrivait : « contre la stupidité, les dieux eux-mêmes luttent en vain ». En vain, vraiment ?