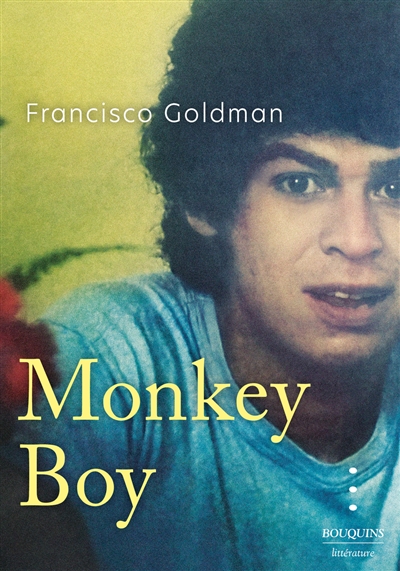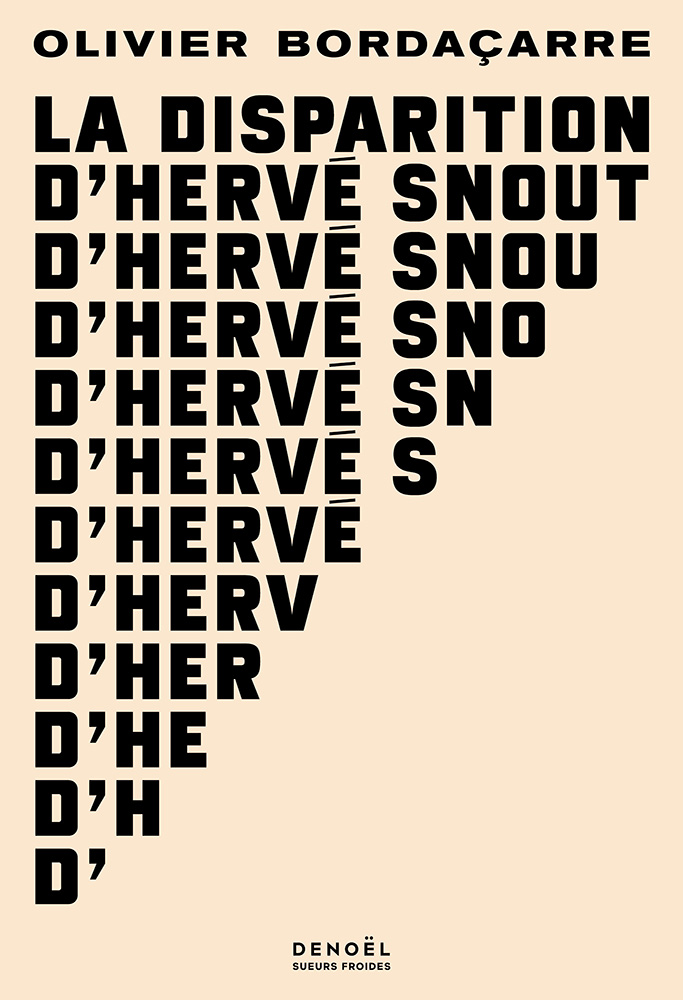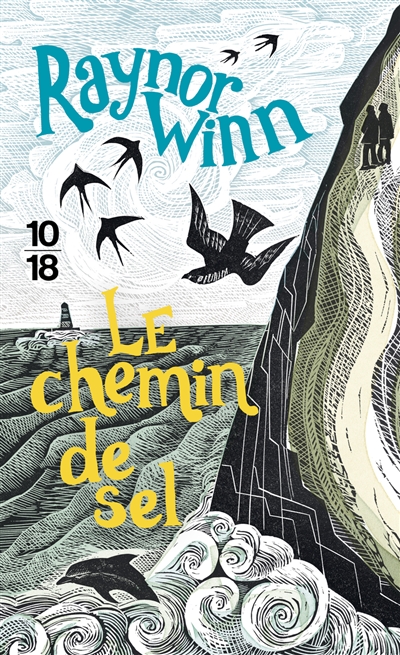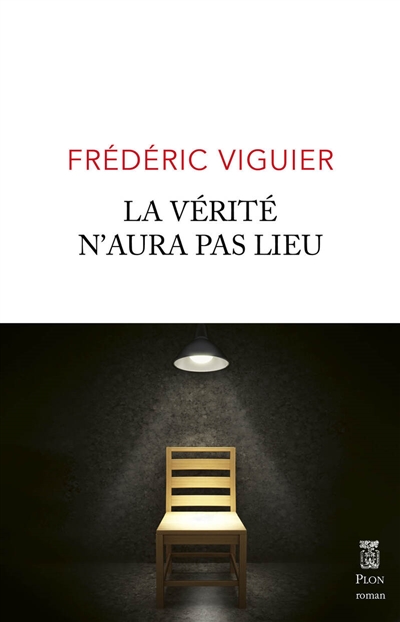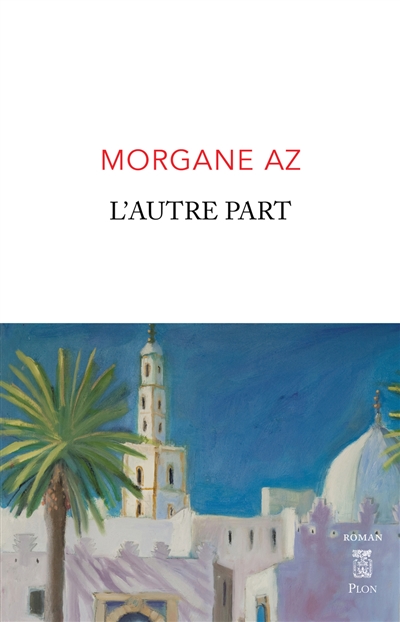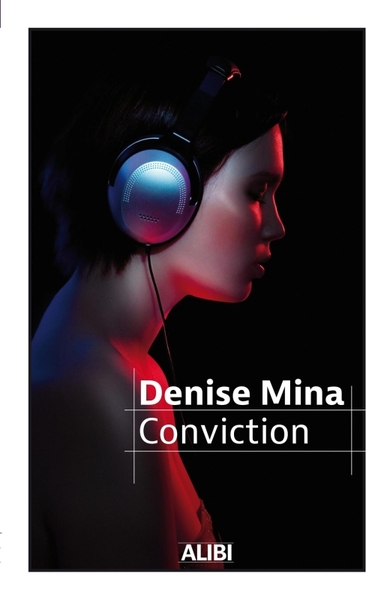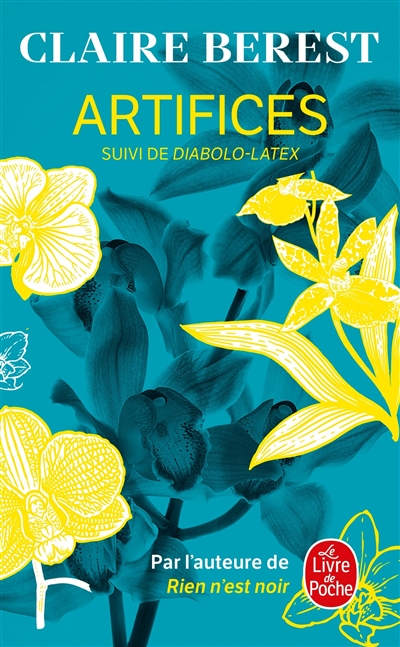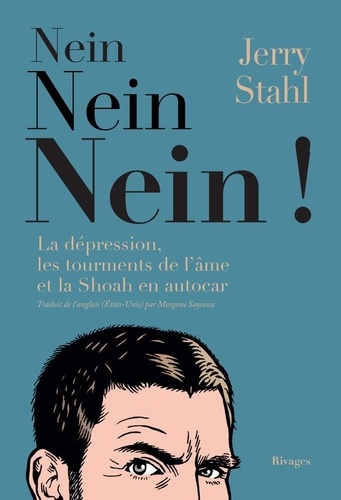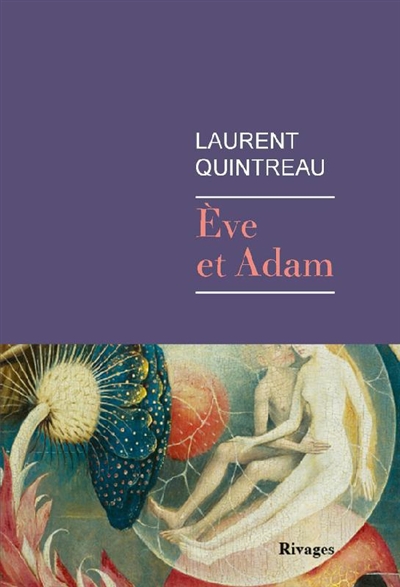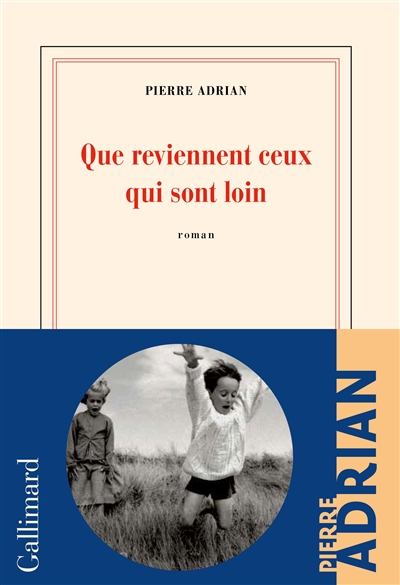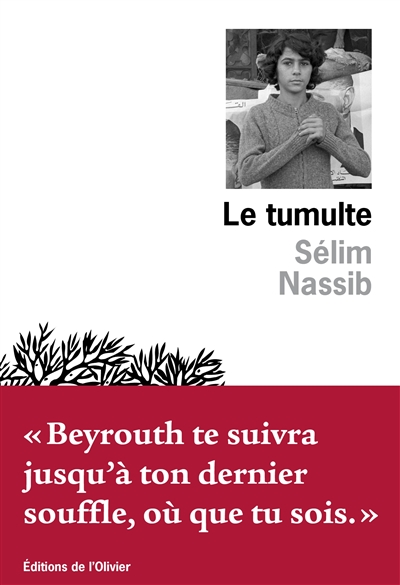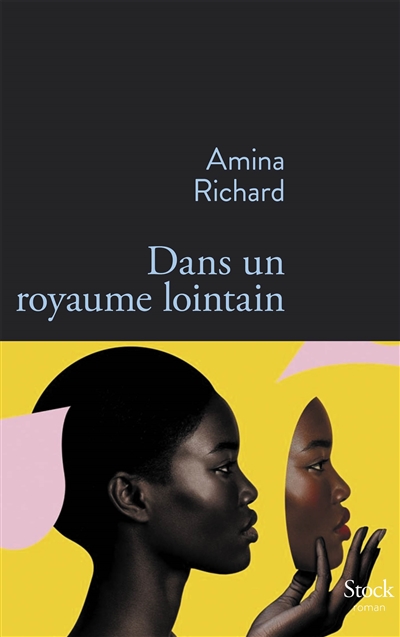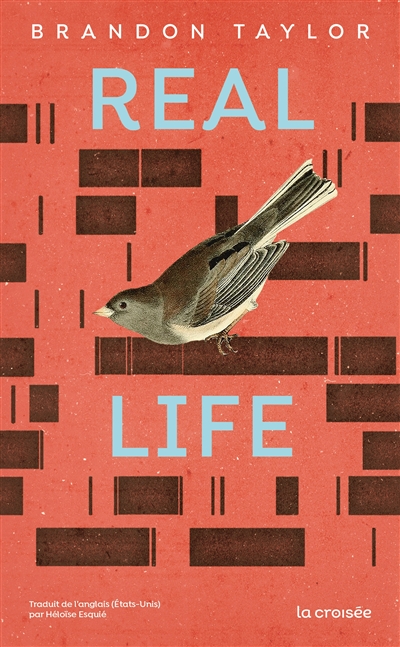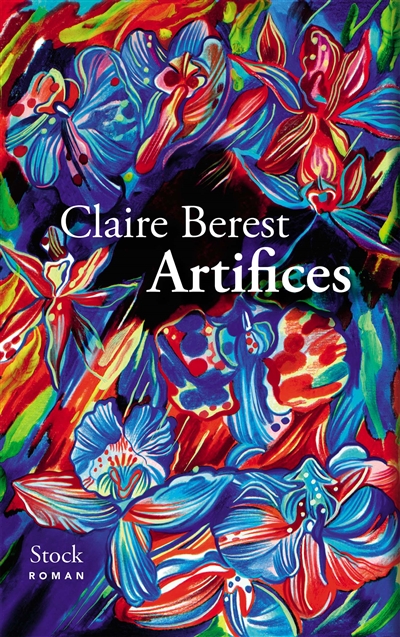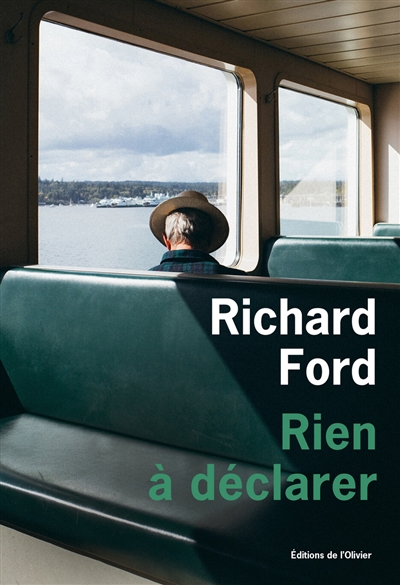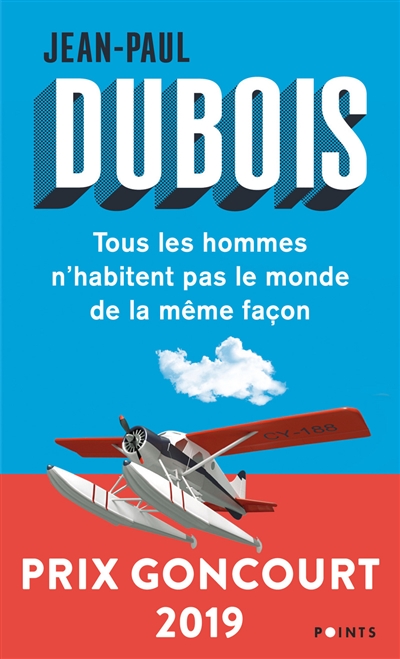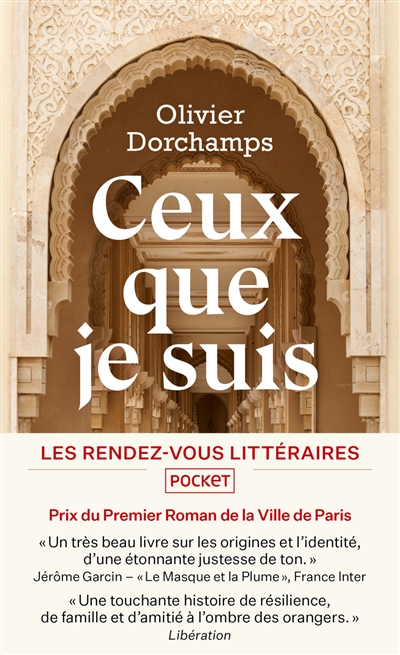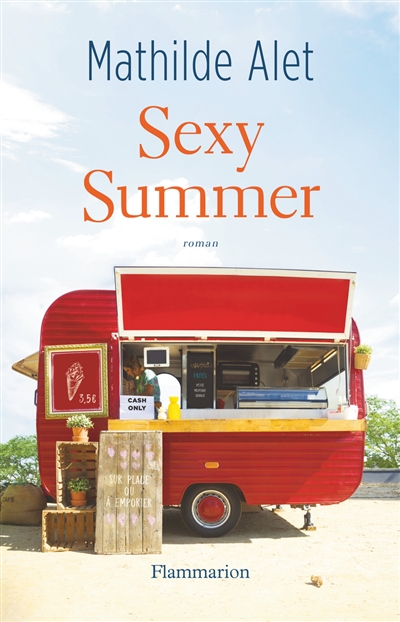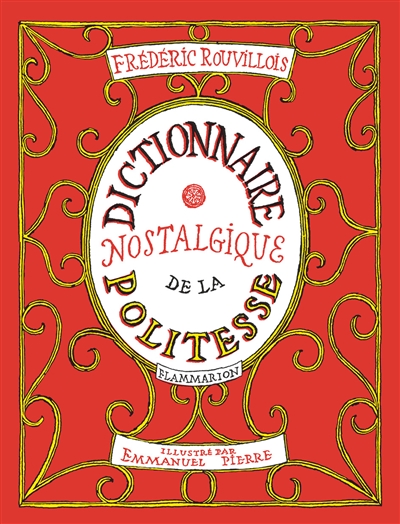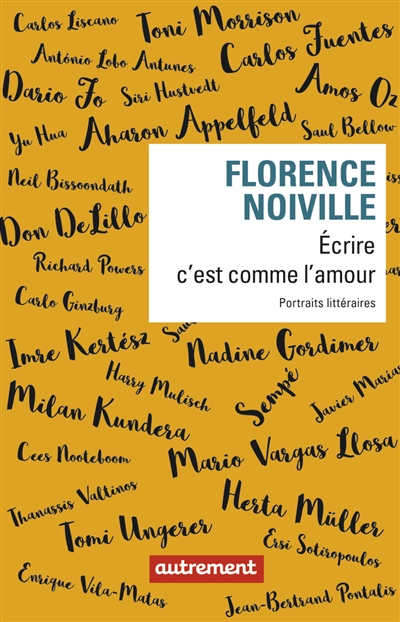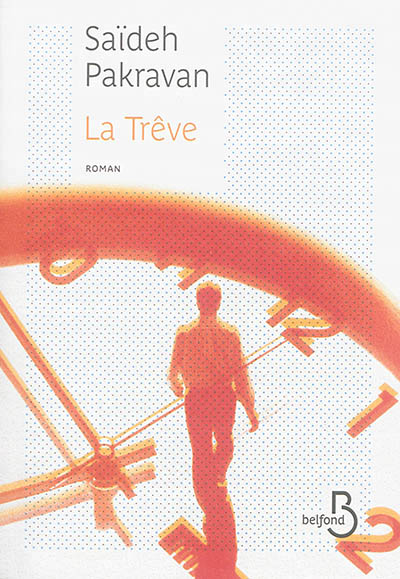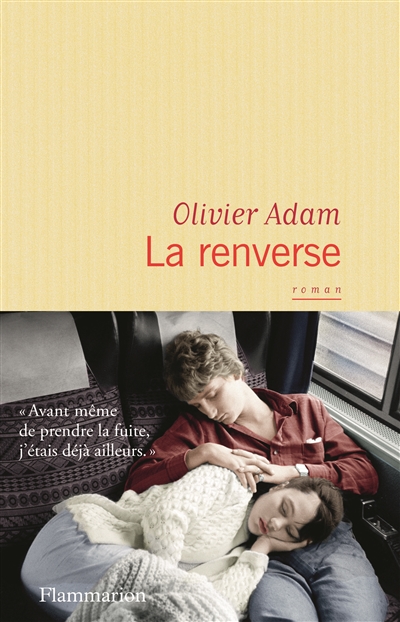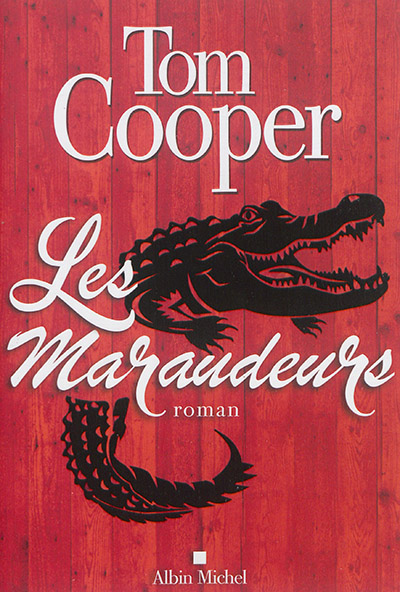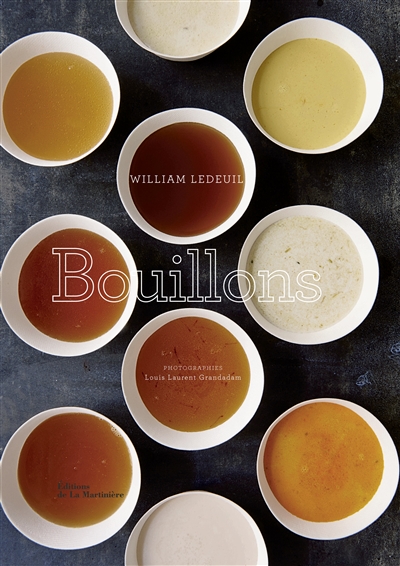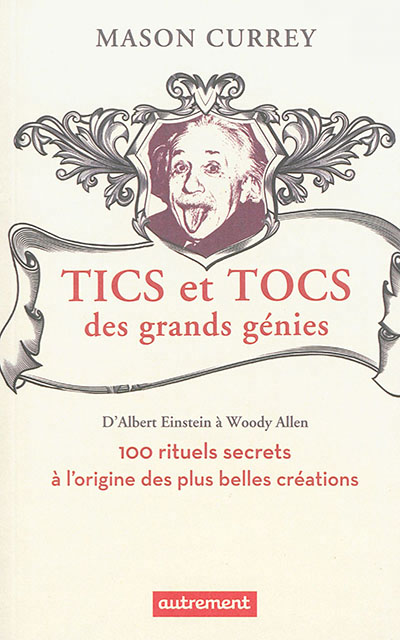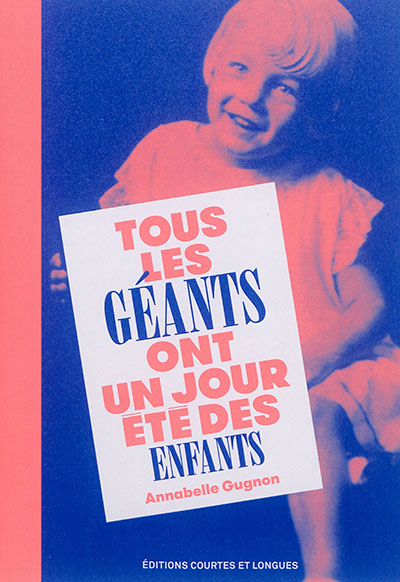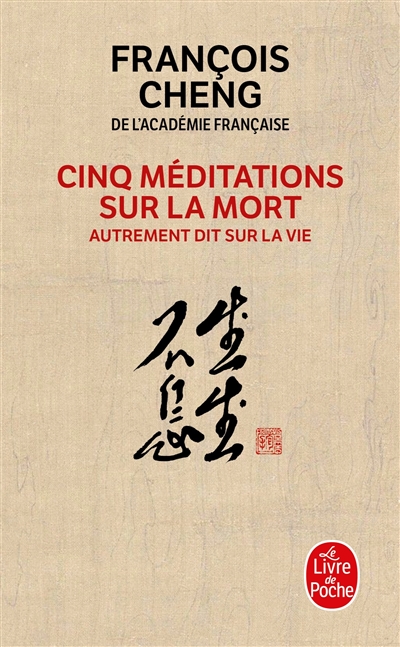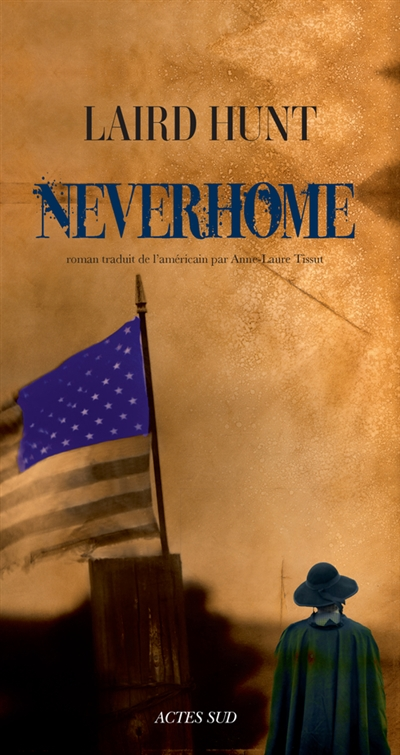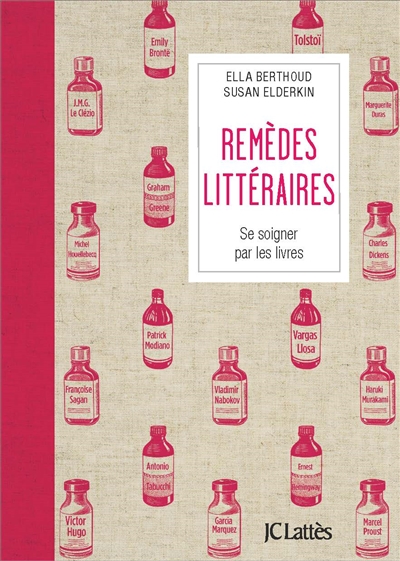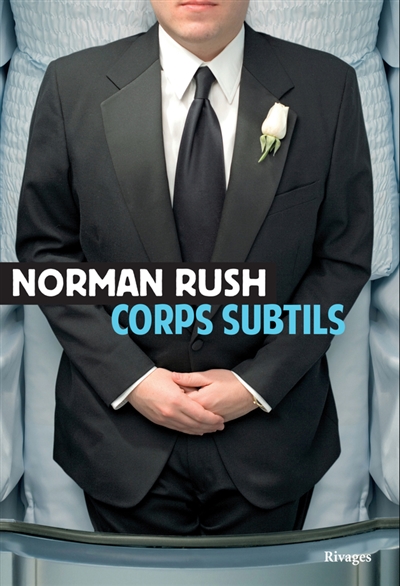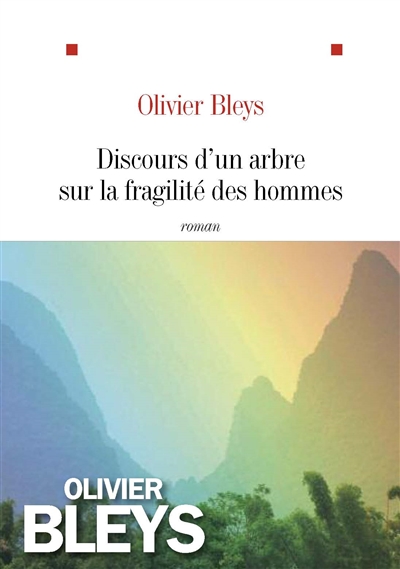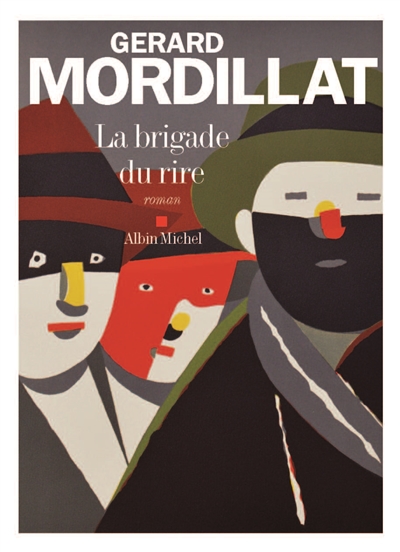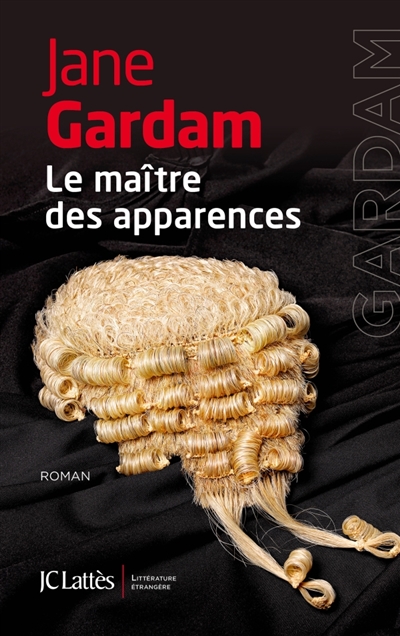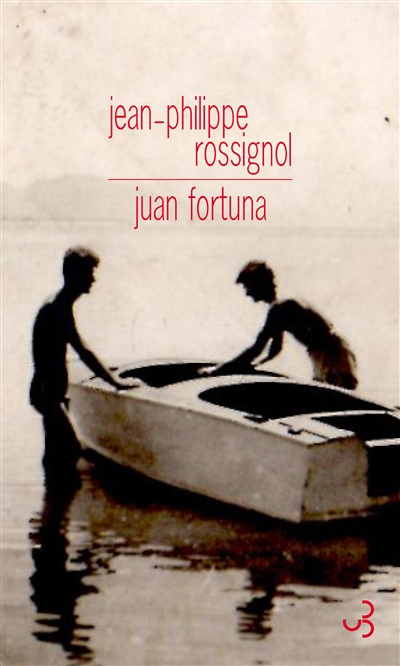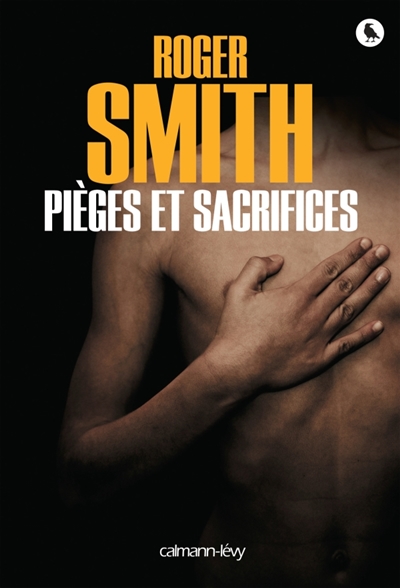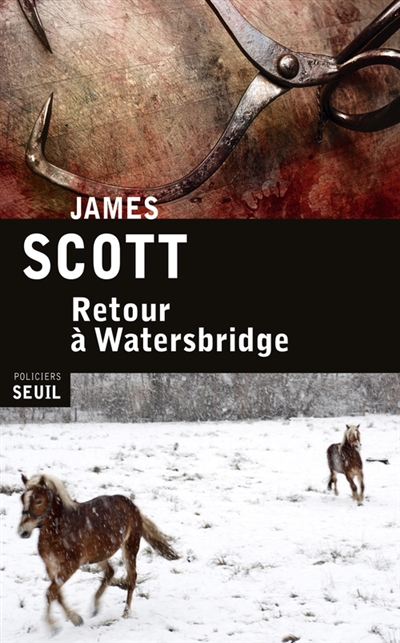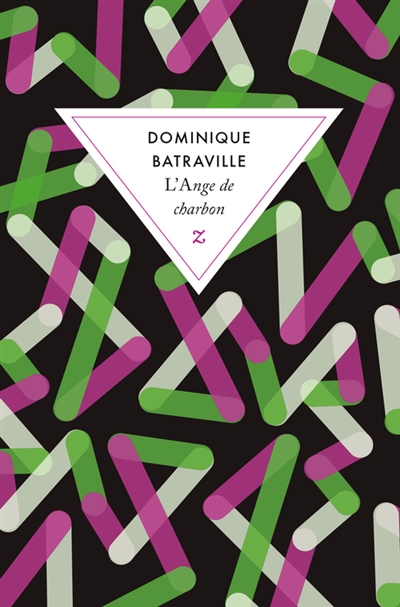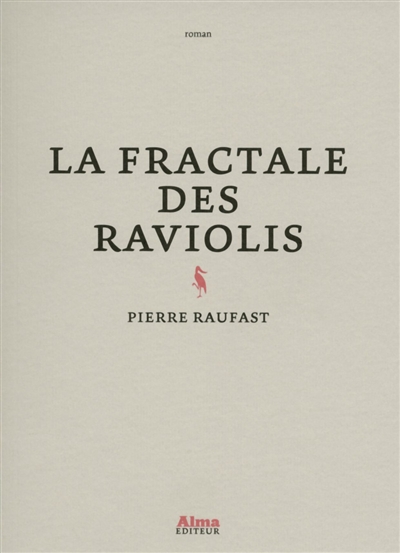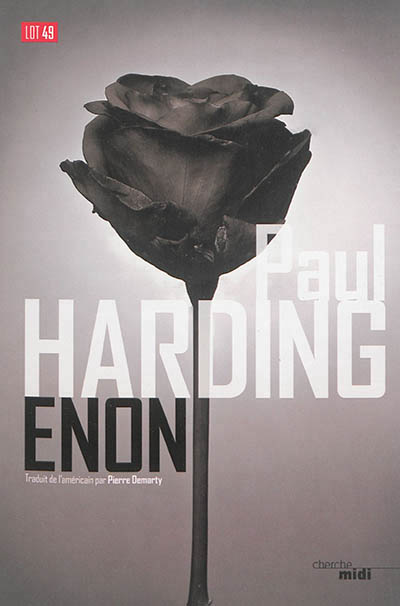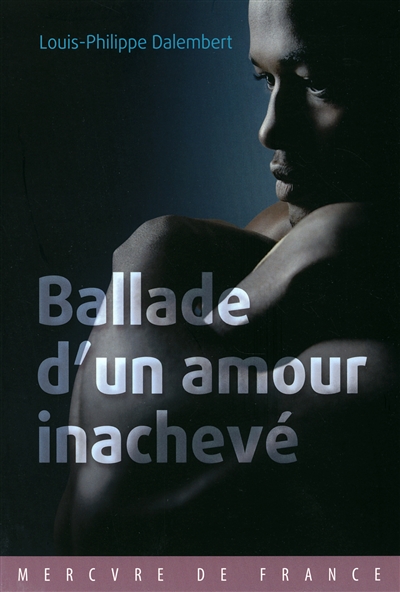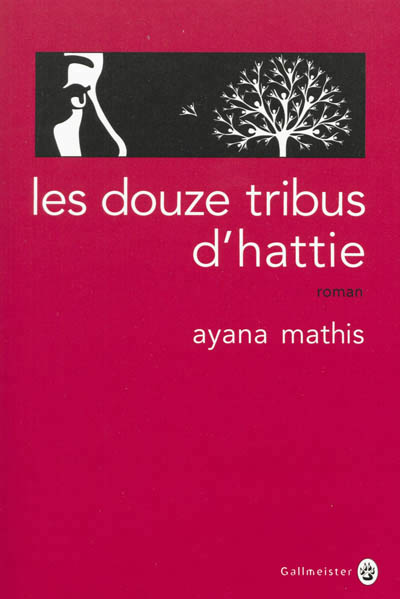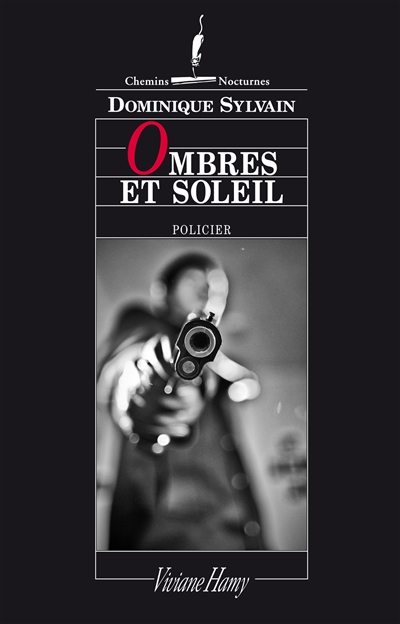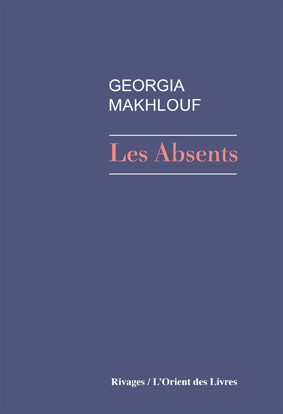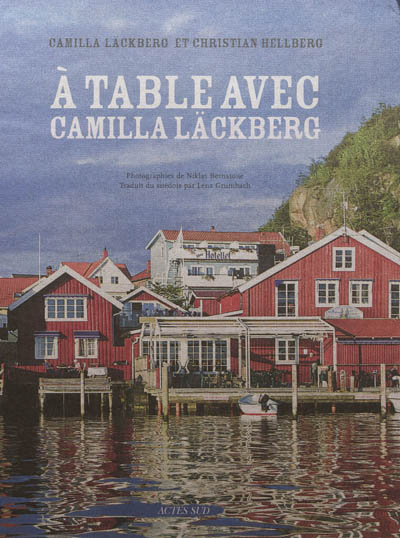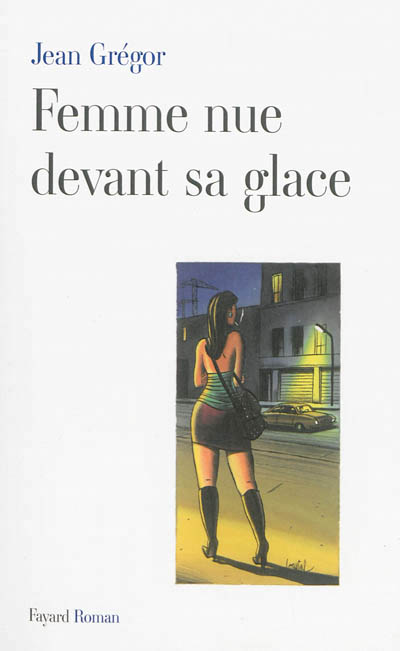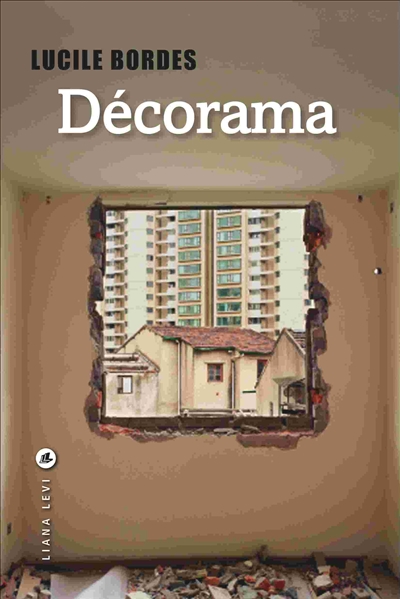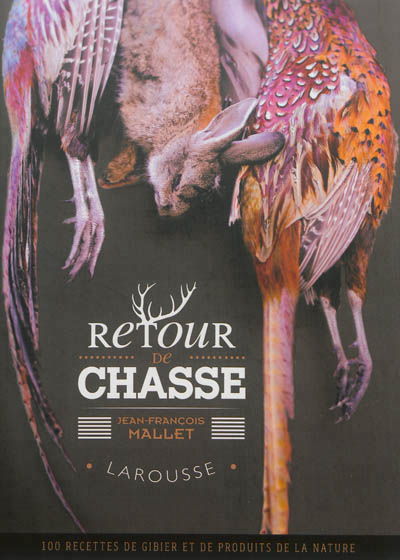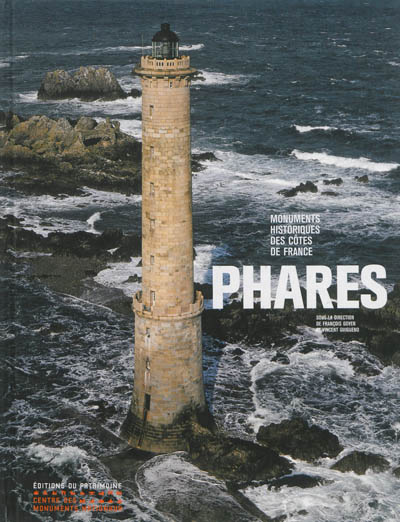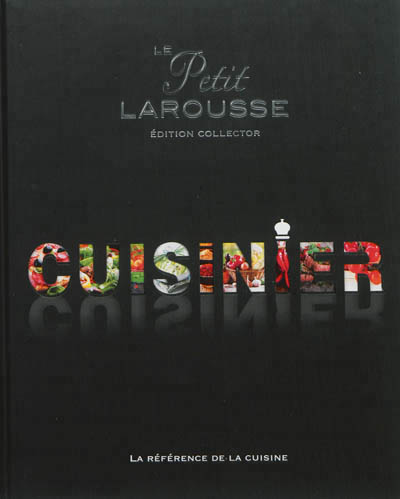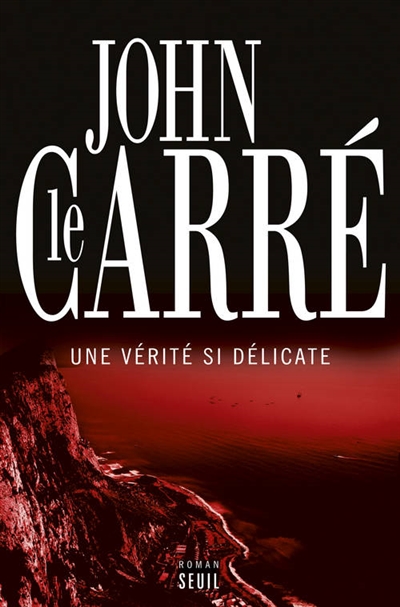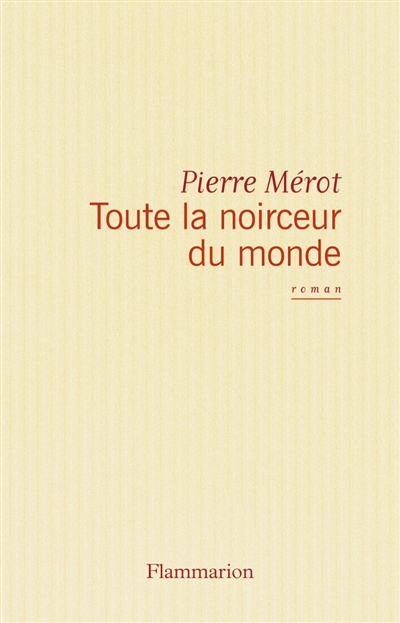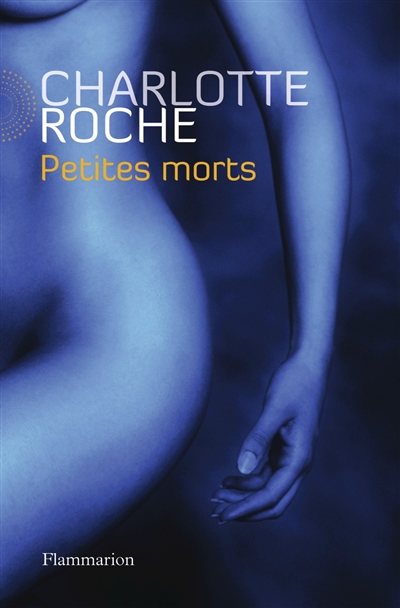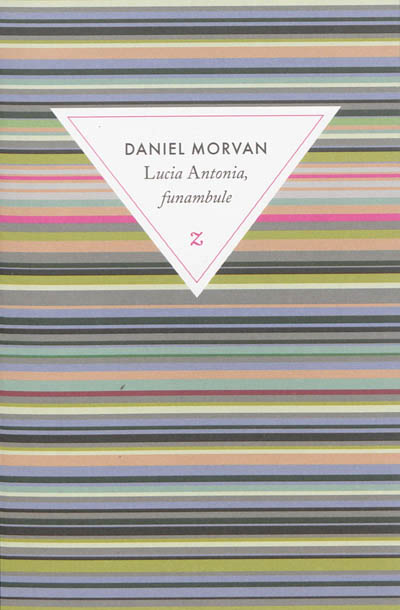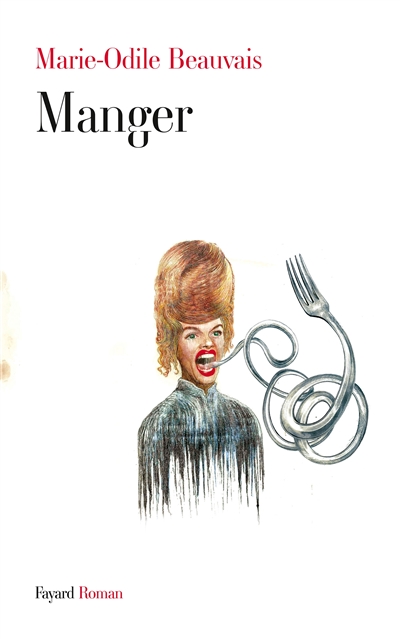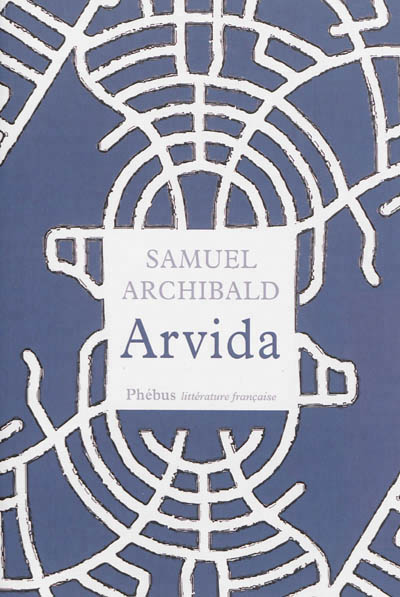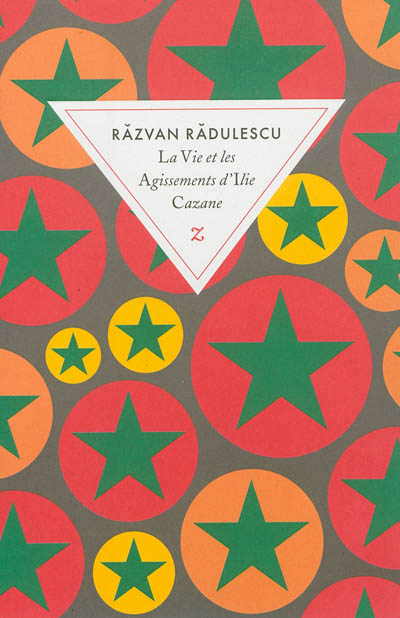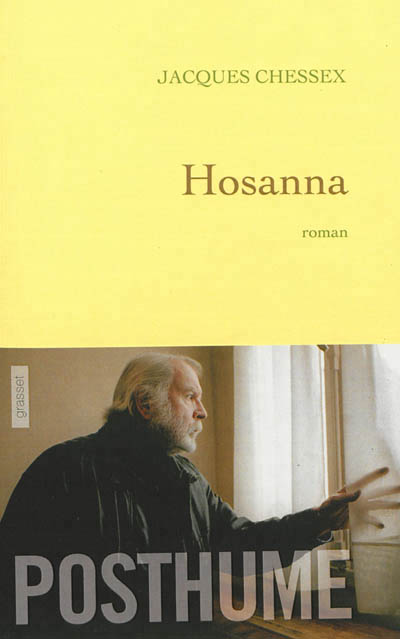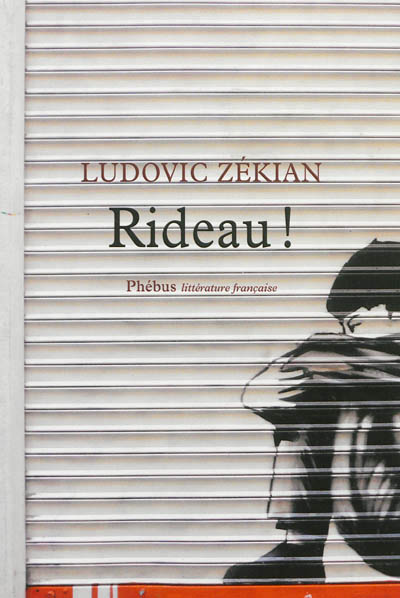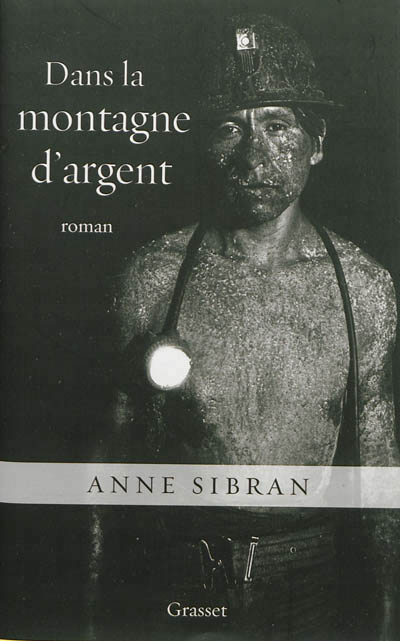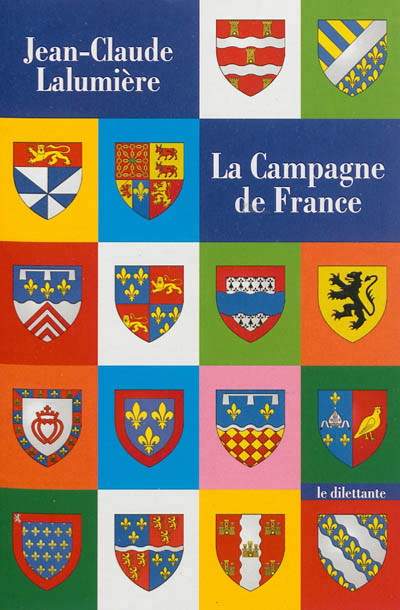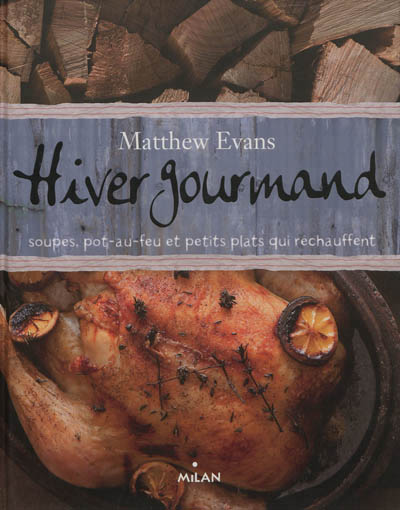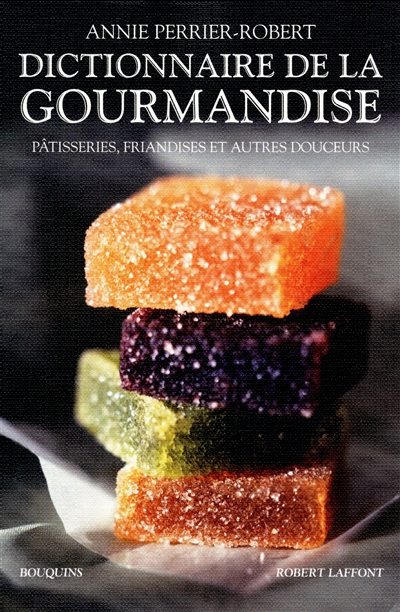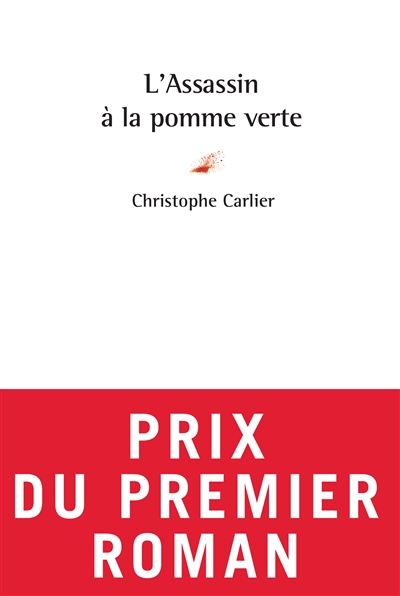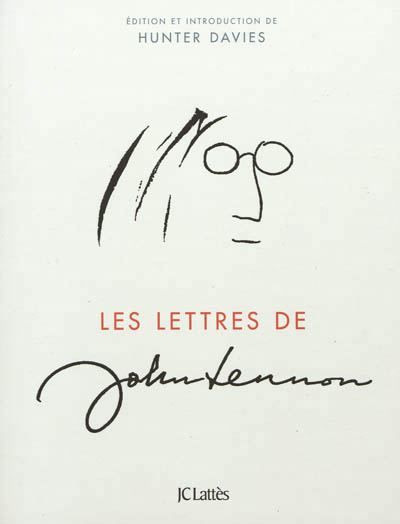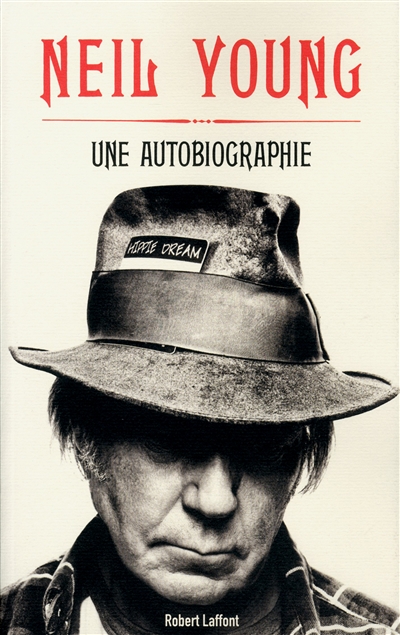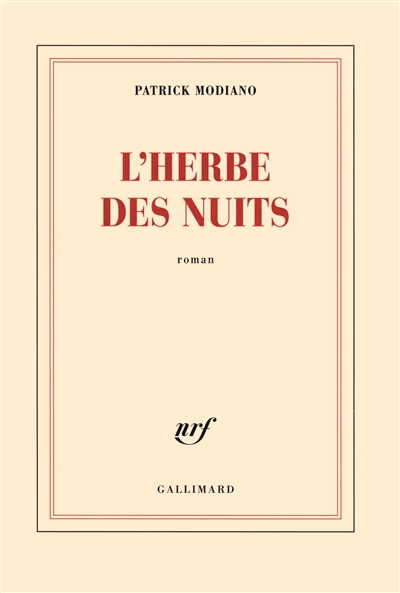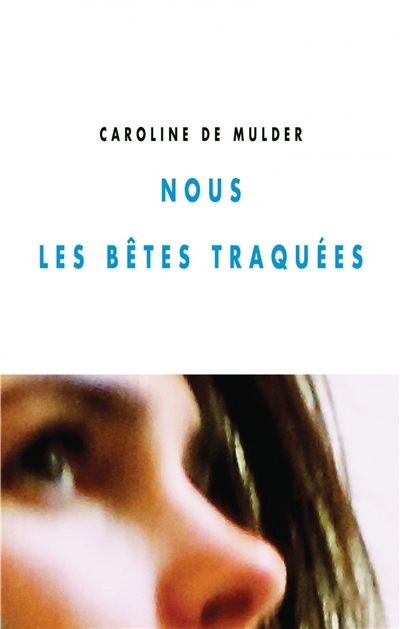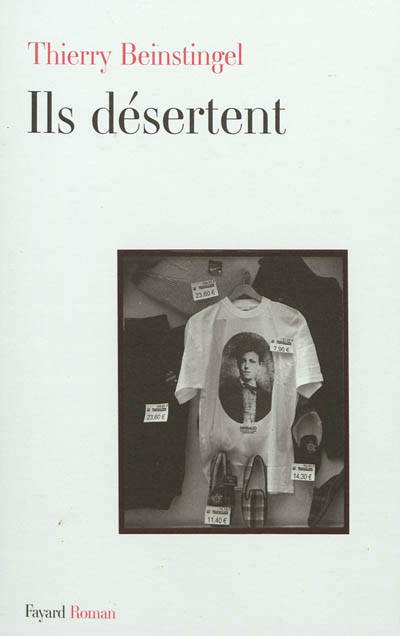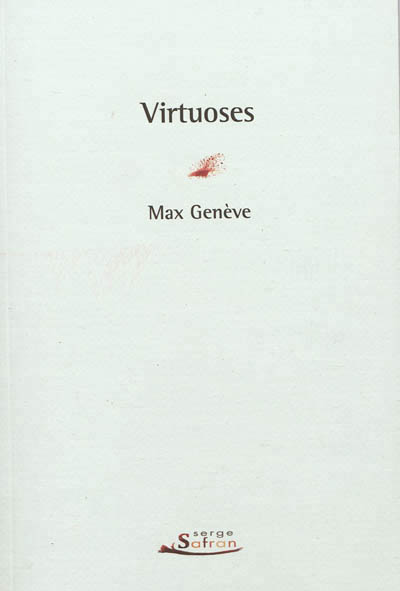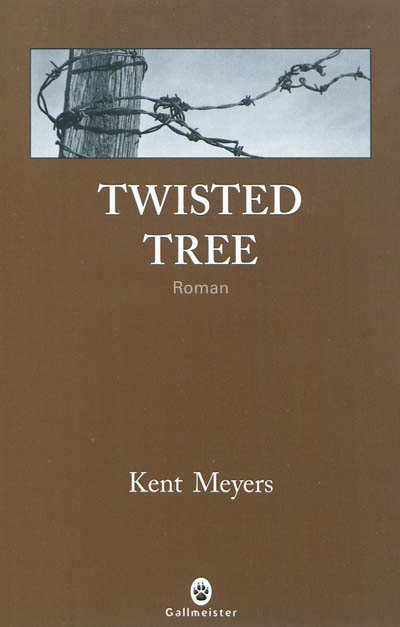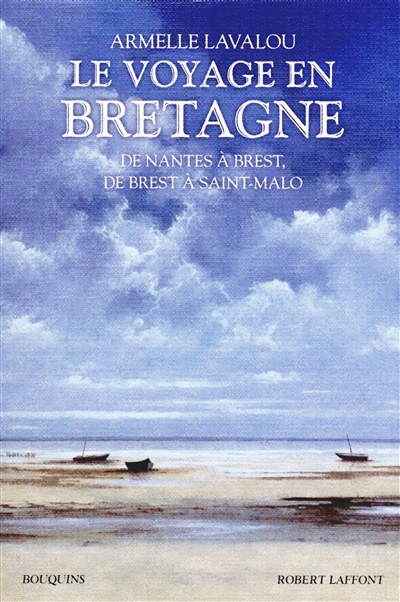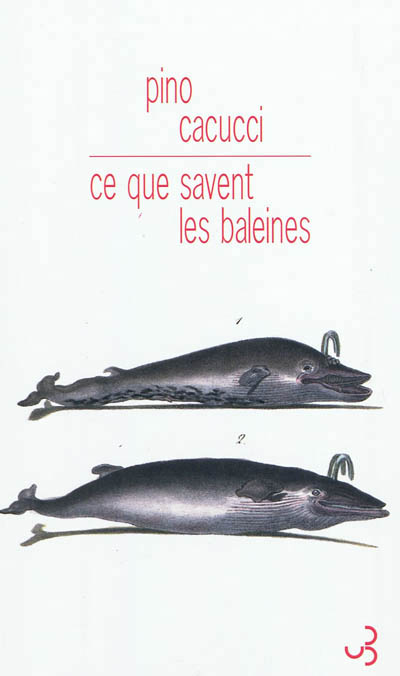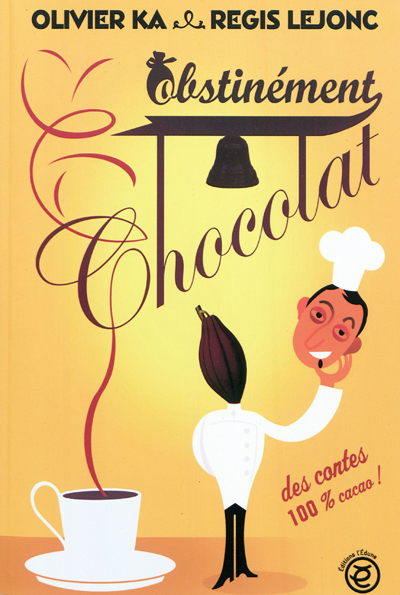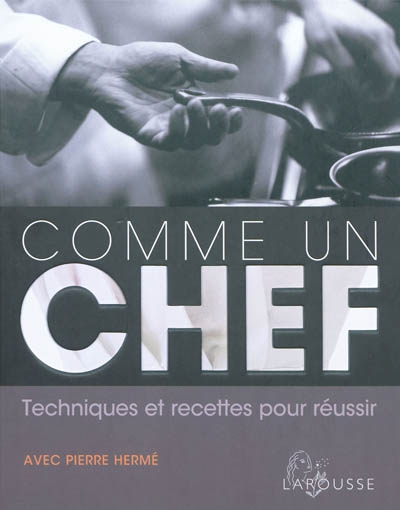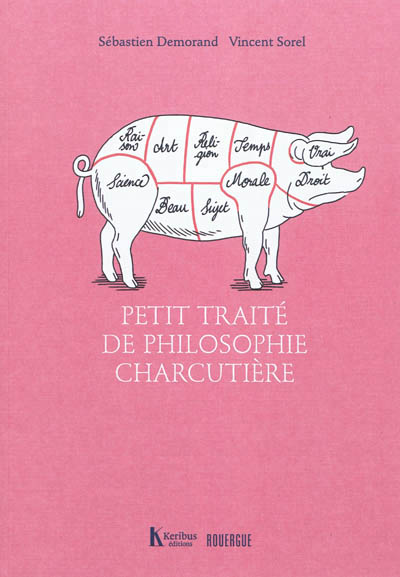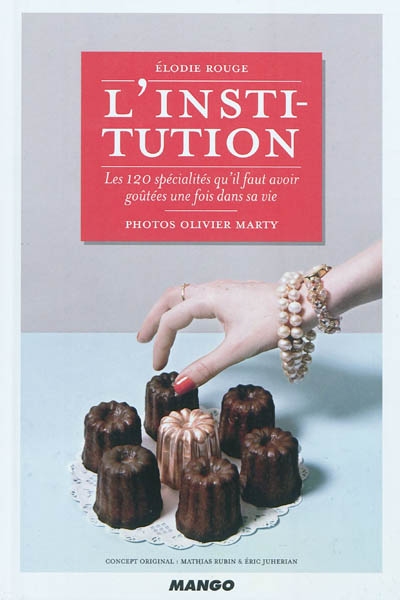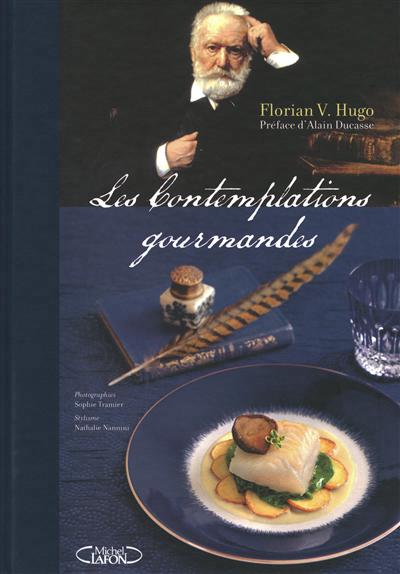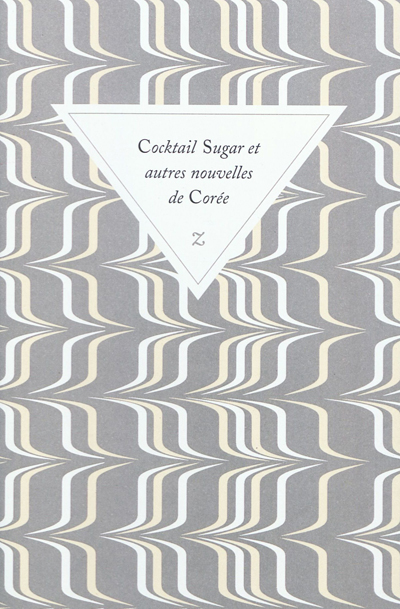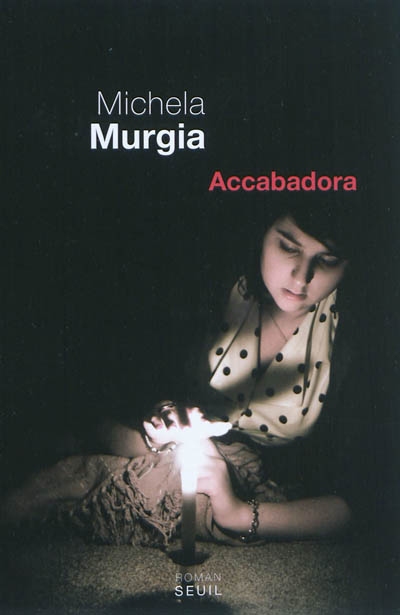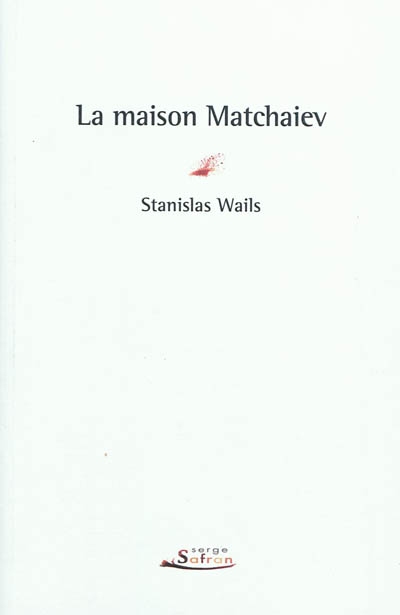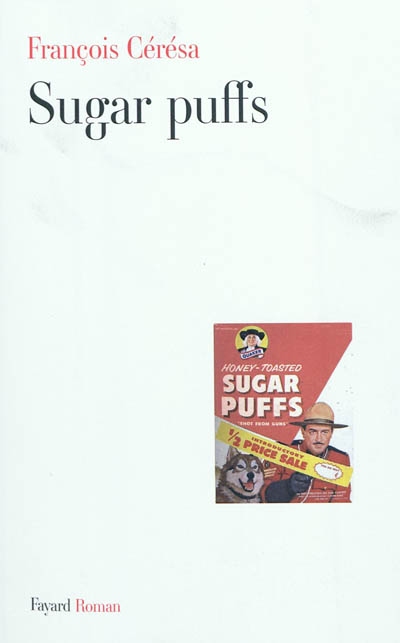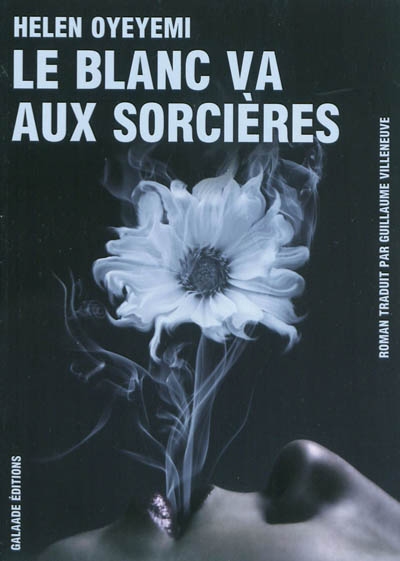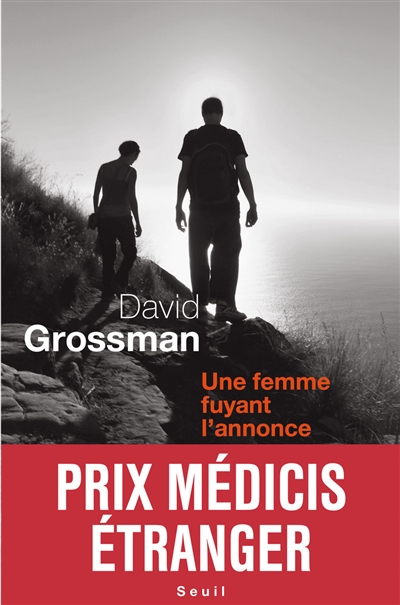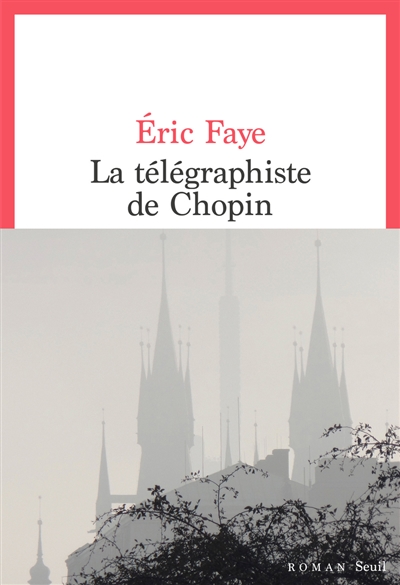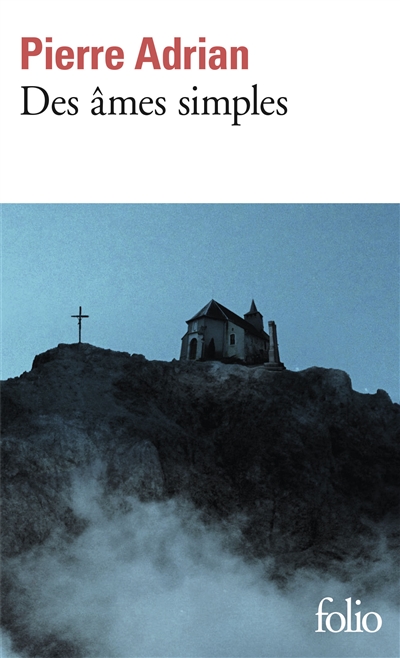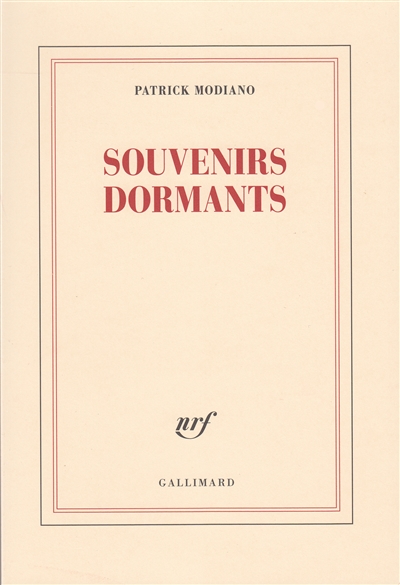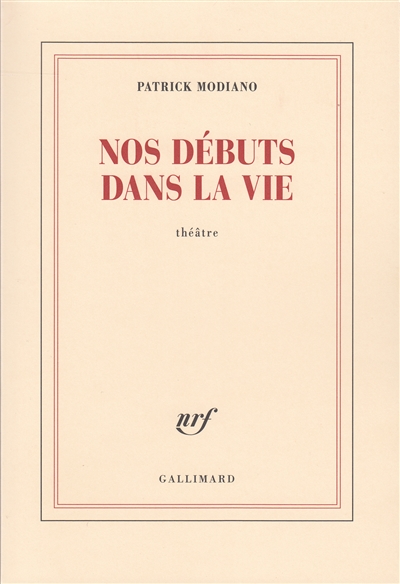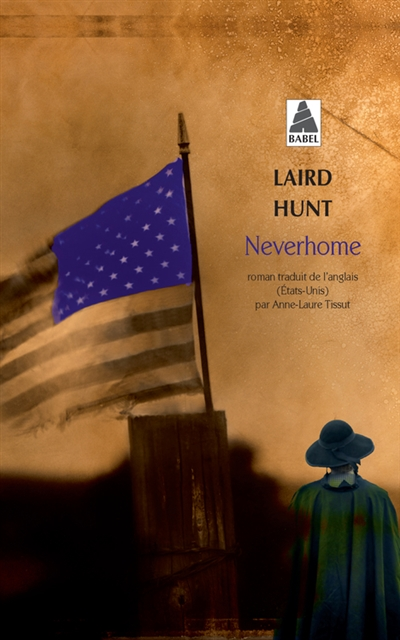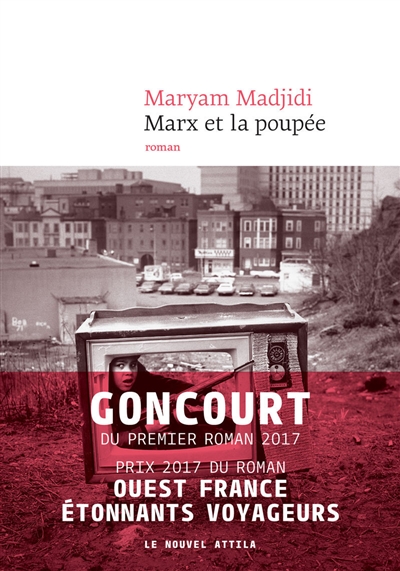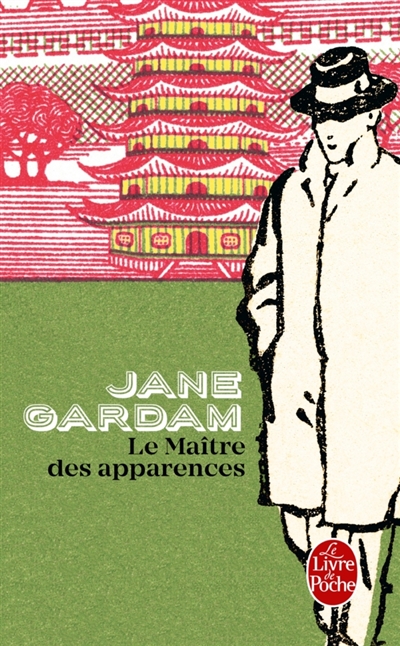Littérature française
Patrick Deville
Taba-Taba
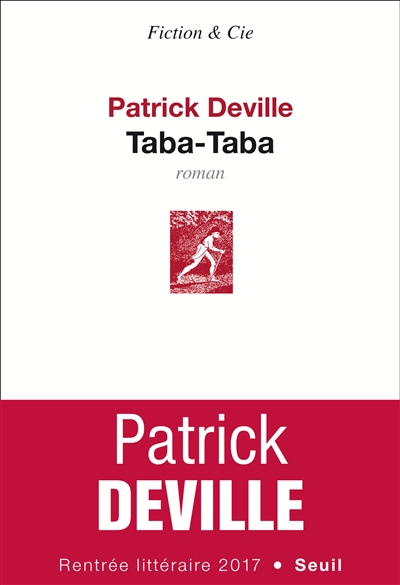
-
Patrick Deville
Taba-Taba
Seuil
17/08/2017
448 pages, 20 €
-
Chronique de
Jean-François Delapré
Librairie Saint-Christophe (Lesneven) - ❤ Lu et conseillé par 14 libraire(s)

✒ Jean-François Delapré
(Librairie Saint-Christophe, Lesneven)
Ici, on entre par effraction, on brise des cadenas rouillés, on pousse des portes fermées à double tour, on manie les souvenirs avec la grâce d’une plume, de peur de les briser, on écoute grincer des planchers trop bien cirés, on ouvre des lettres en pelure aux mots pleins et déliés à l’encre bleue, ici un enfant se souvient.
Première sélection du Prix Goncourt 2017
Il a huit ans et va quitter l’hôpital psychiatrique de Saint-Brévin, le Lazaret disait-on à l’époque, où il a séjourné, l’enfant de traviole qu’on a opéré à quatre ans pour le remettre droit, en le coffrant pour une année dans une coquille de plâtre, les jambes écartelées. C’est dans son sarcophage qu’il apprendra le goût des mots et des livres que Simonne, dite Monne, la sœur de son baryton de père, directeur de l’hôpital, lui apprendra à déchiffrer seul. « Les livres sont des rapaces qui survolent les siècles, changent parfois en chemin de langue et de plumage et fondent sur le crâne des enfants éblouis » écrira l’auteur, se souvenant de l’enfant qu’il était, là-bas, au Lazaret de Saint-Brévin, écoutant l’amnésique patient répéter son unique alexandrin « Taba, Taba, Taba/ Taba, Taba, Taba ». Monne va s’en aller pour de bon en 2013 et laissera derrière elle trois pièces emplies d’archives, plus d’un siècle et demi de souvenirs entassés de la famille, avec au milieu du fatras des munitions de guerre qui auraient pu déchiqueter qui aurait voulu s’en débarrasser. Comme un archéologue, Patrick Deville va ausculter les mémoires familiales, remonter des fleuves, mais tout commencera par une photographie en noir et blanc de 1956, prise par Monne, encore elle, celle du père de l’auteur, fier de poser devant sa motocyclette. De cette photo vont suivre toutes les péripéties d’un siècle cahoteux, la violence des guerres, les fuites à pied à travers la France déchirée, les camps de réfugiés, la Résistance, mais aussi les origines égyptiennes de la famille qui quitta Le Caire en 1862, mais que Monne, toujours elle, ressuscitait en ayant conservé tout ce qui faisait la vie de ces petites gens. C’est par de courts chapitres, comme pour accentuer l’accumulation de sa tante, que Patrick Deville nous détricote tout ce passé, en anthropologue et sociologue de sa propre famille. Et ce qui nous bouleverse dans ce roman gigogne qui nous embarque autant en Amérique du Sud que dans le long exode de 1940, ce sont tous ces fragments qu’on eût dit posés sur le sol en un immense puzzle sépia de photos aux bords dentelés, de lettres et de carnets de guerre, de babioles rapportées des sables du désert. Mais sans doute est-ce aussi les yeux de l’enfant qu’il redevient quand cette manne lui est donnée, car il y a plus d’un roman dans les entrailles des archives de Monne, mille vies qui se succèdent, s’aiment, se fuient et se retrouvent. Il fallait tout le talent de Patrick Deville pour que le désordre devienne kaléidoscope, que les mots viennent soulager, apaiser les déchirures, panser les plaies vives des abandons. « Elle s’était laissée mourir, de rien, de lassitude, de savoir qu’elle ne retrouverait plus ni son bureau ni ses archives, ces “pièces du fond” qui étaient sa mémoire et son monstrueux hippocampe extrême. » C’est à Monne que vous avez écrit, à fleur de peau, ce livre épique et beau, alors chapeau bas Monsieur Deville !