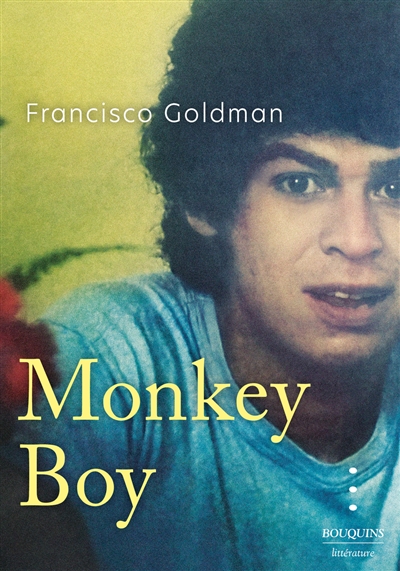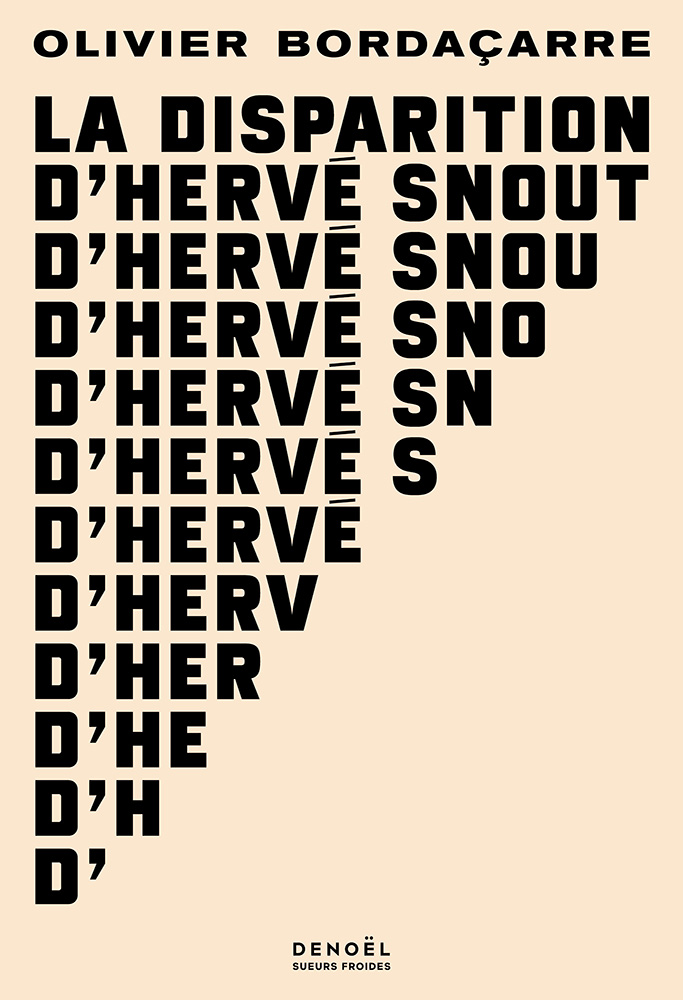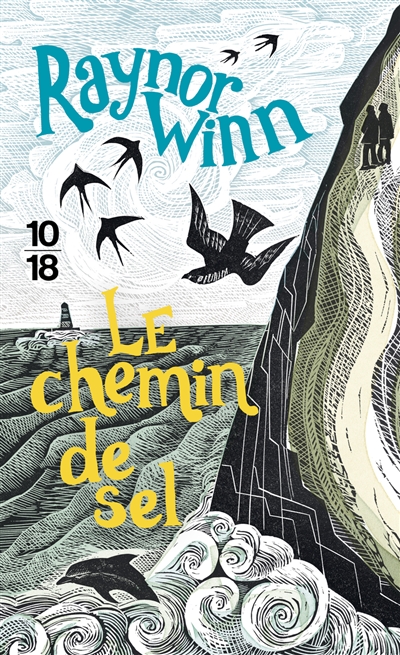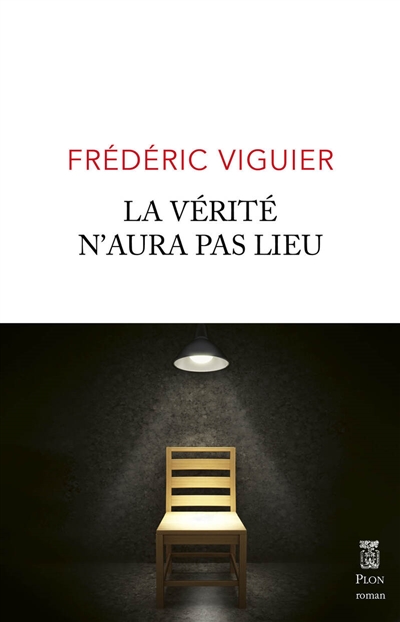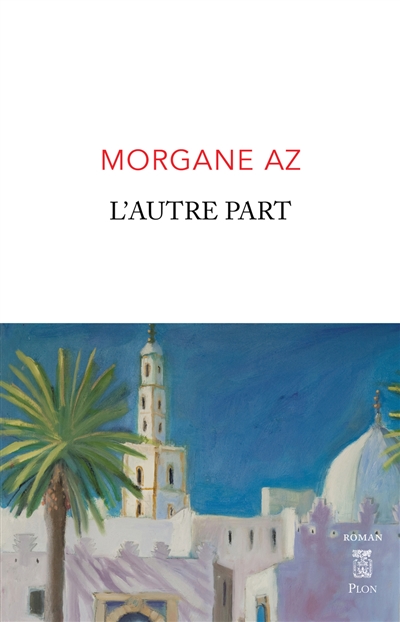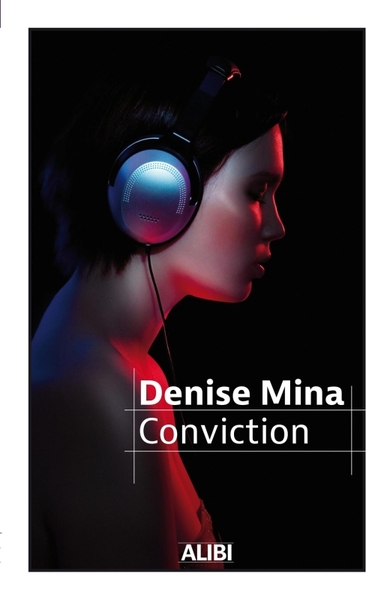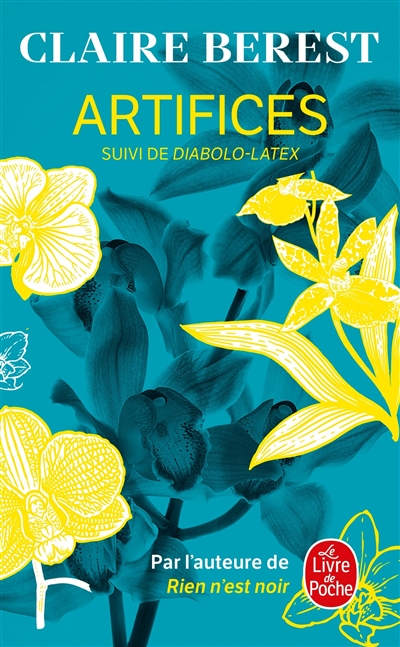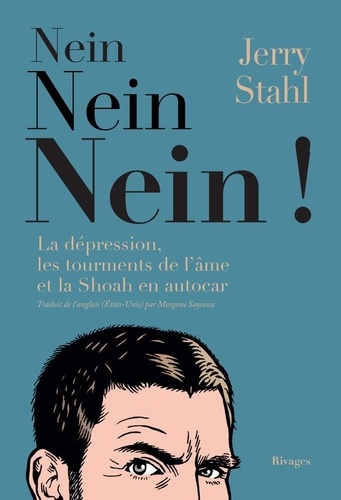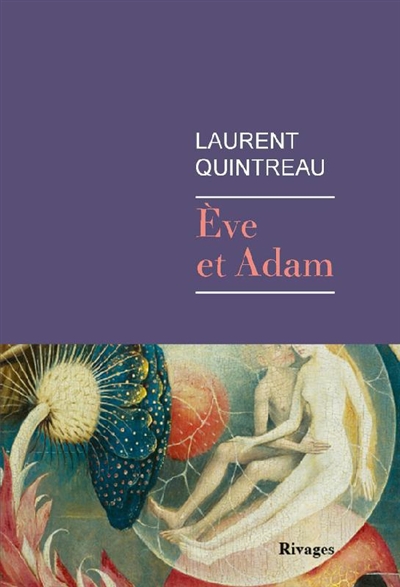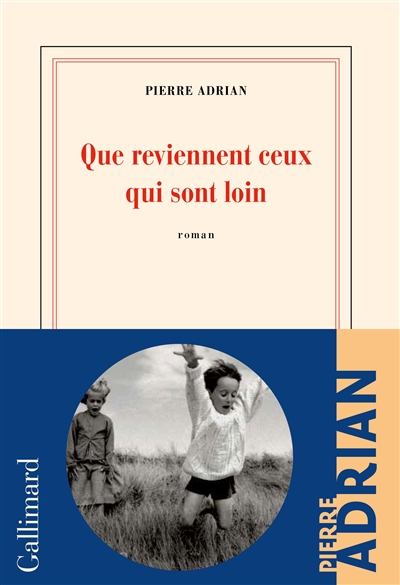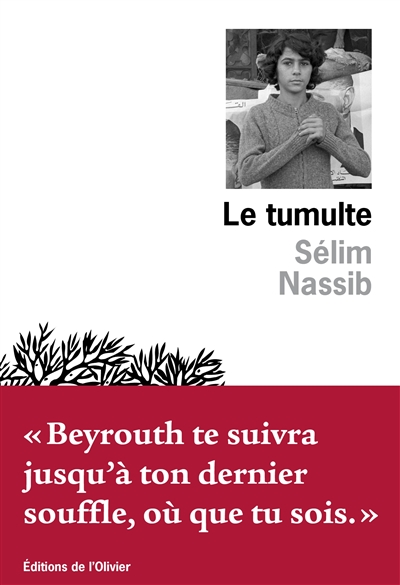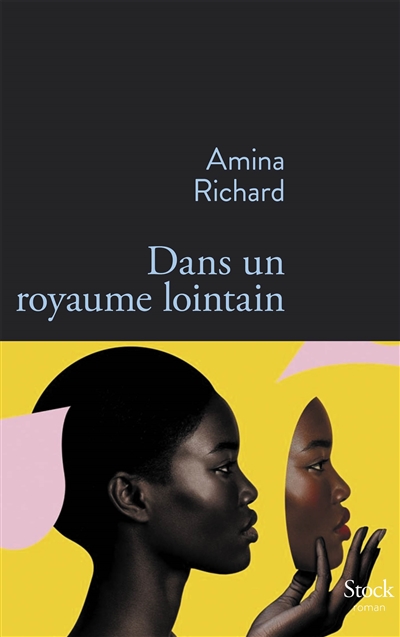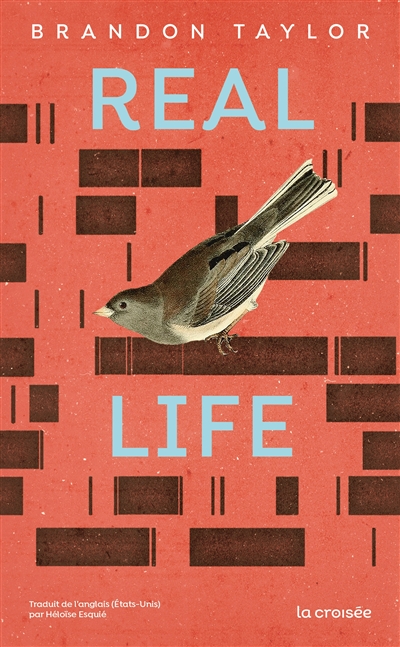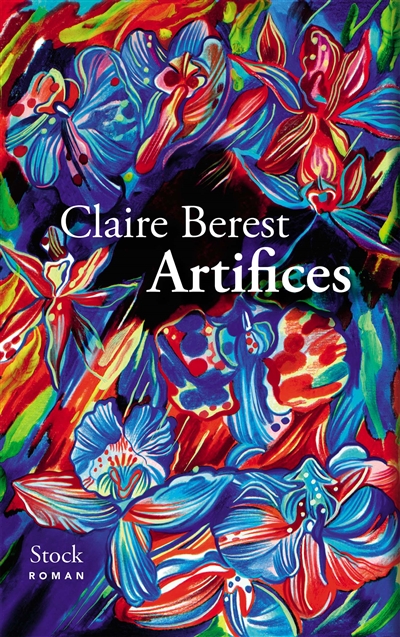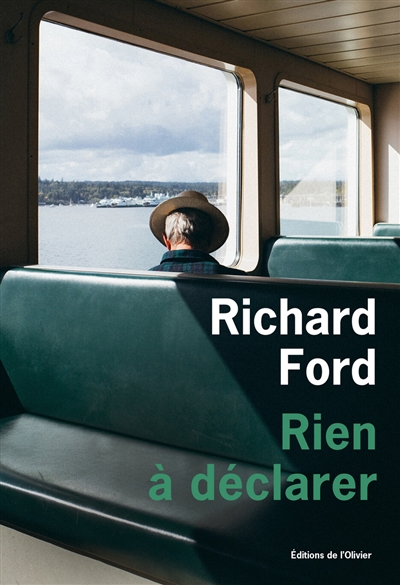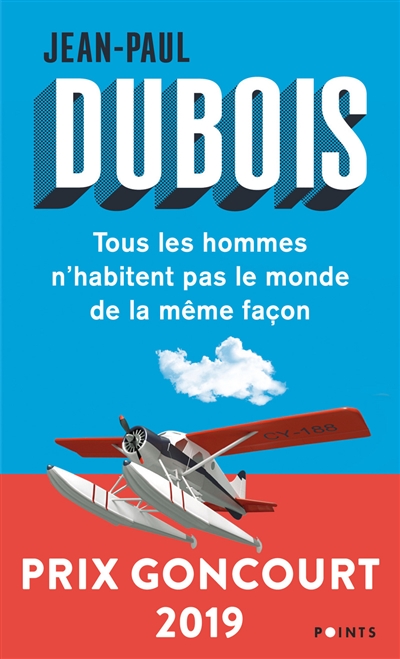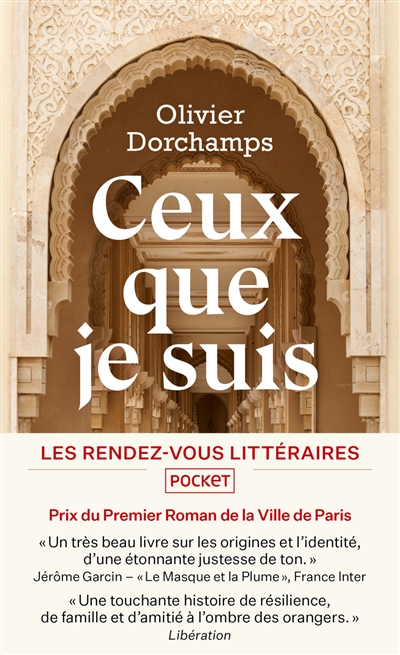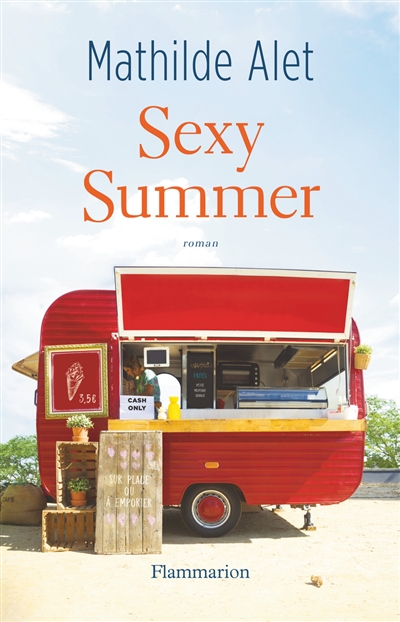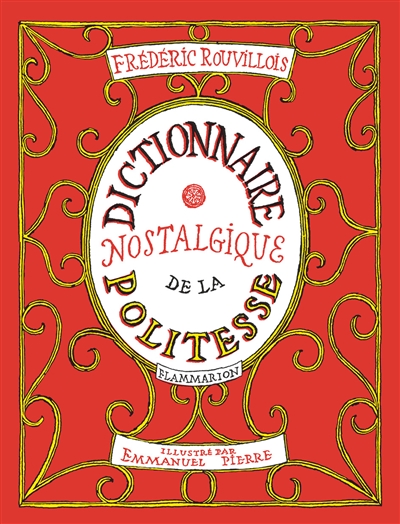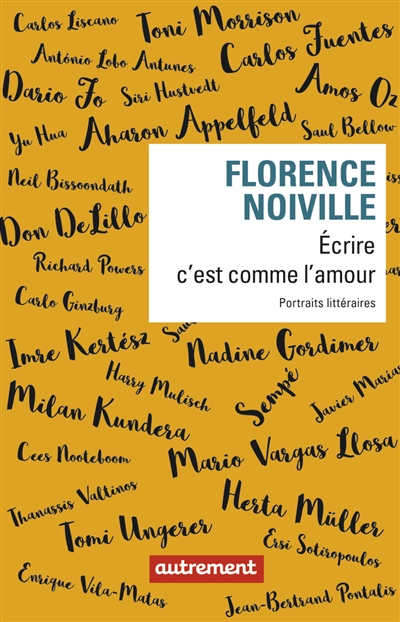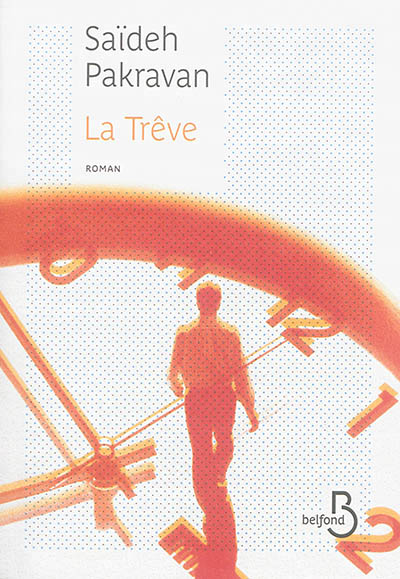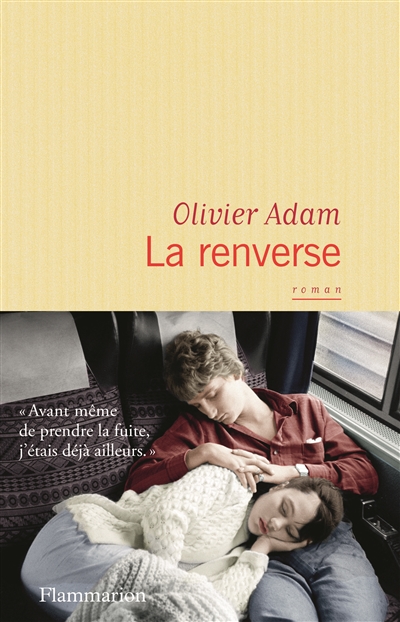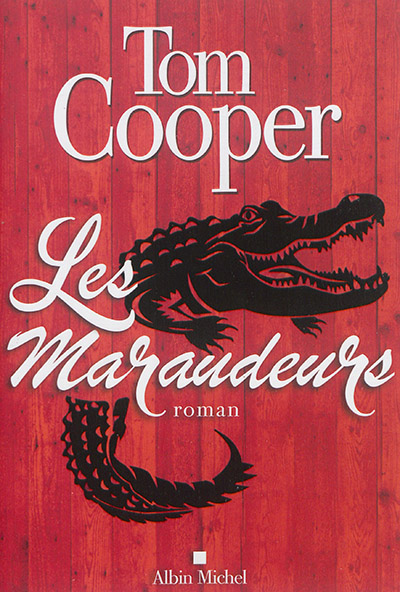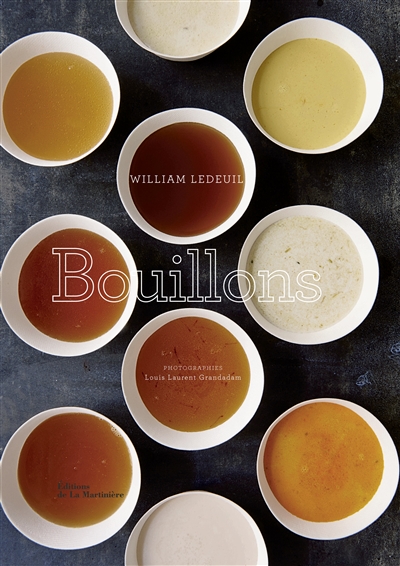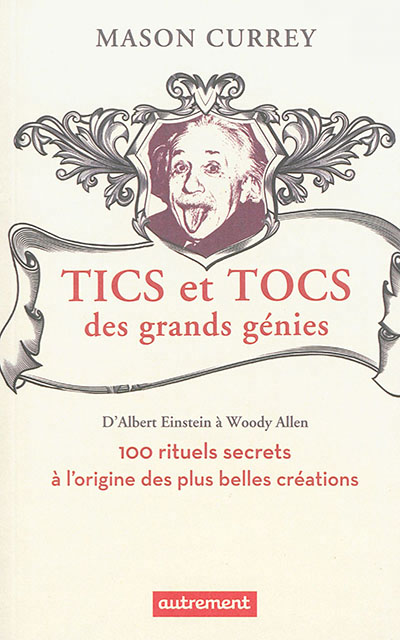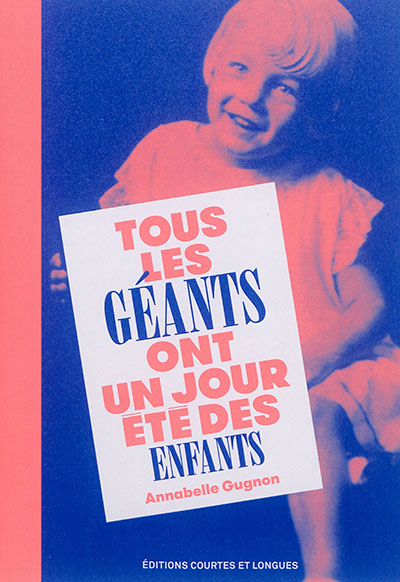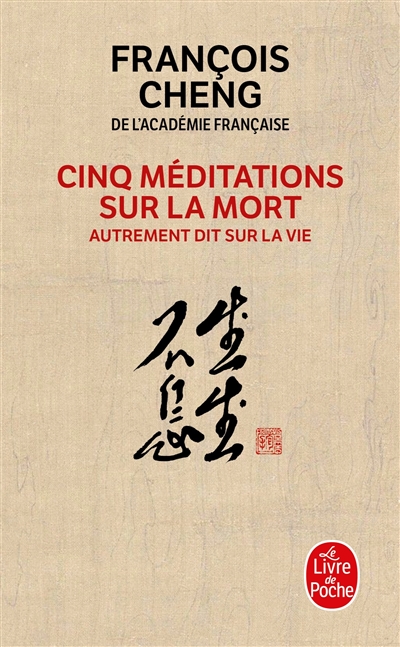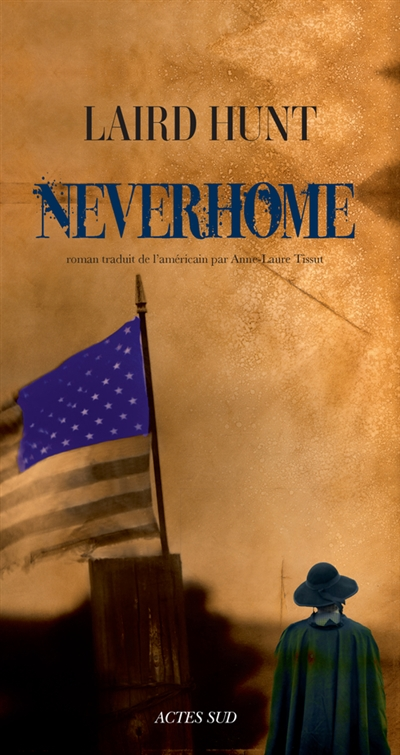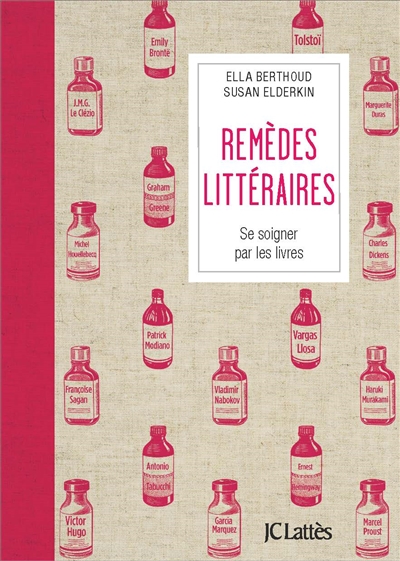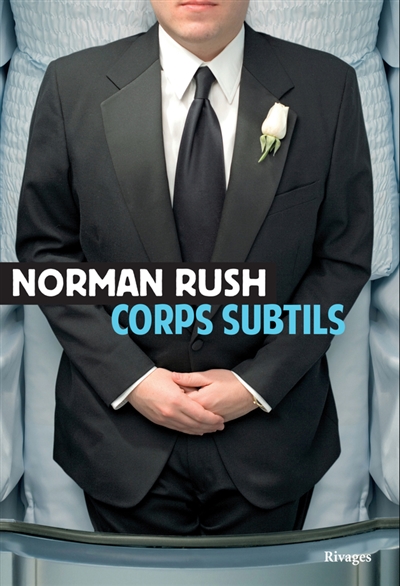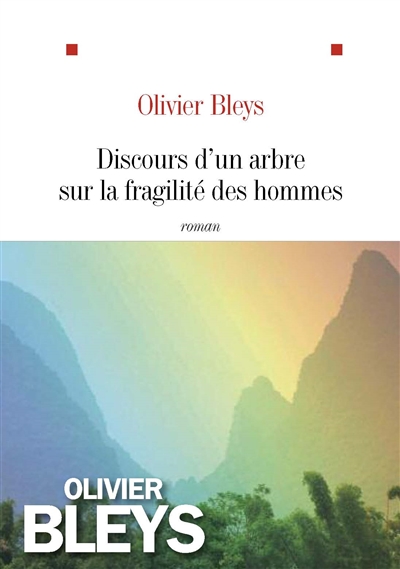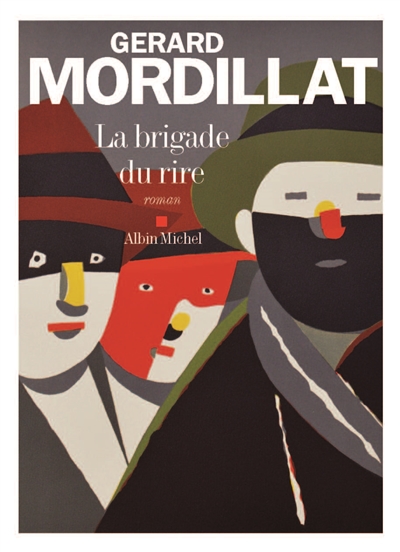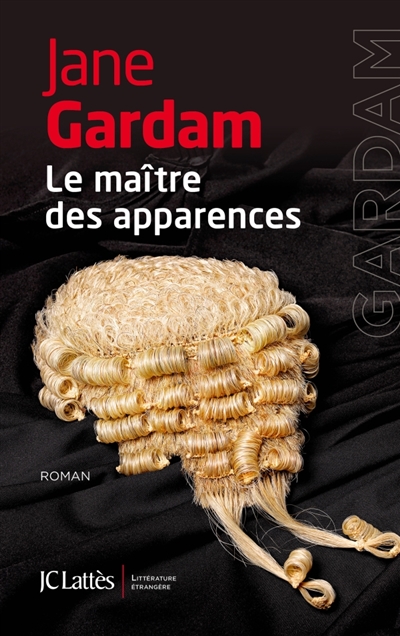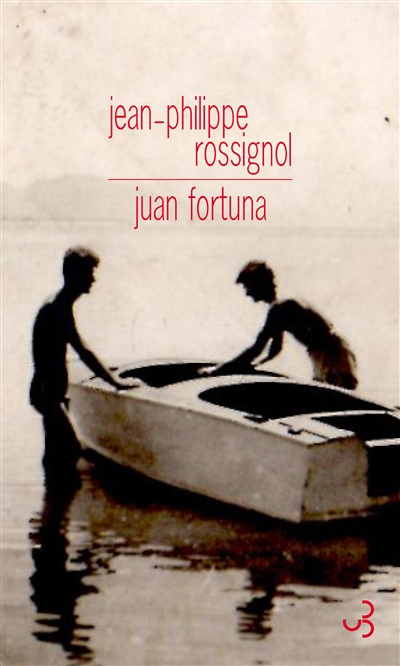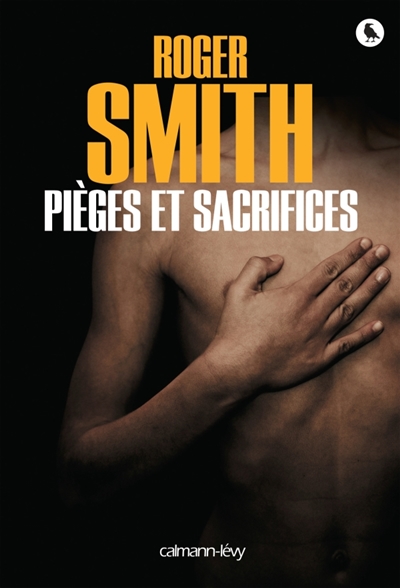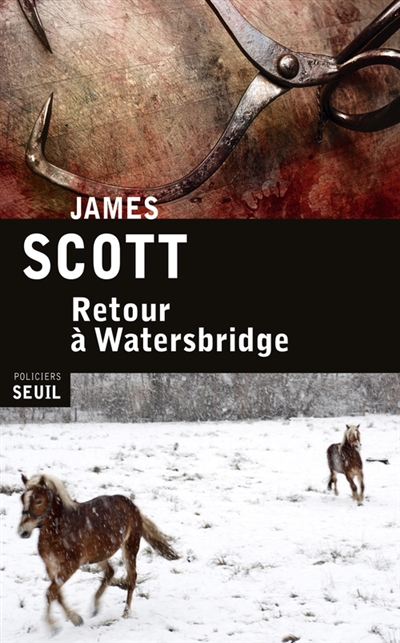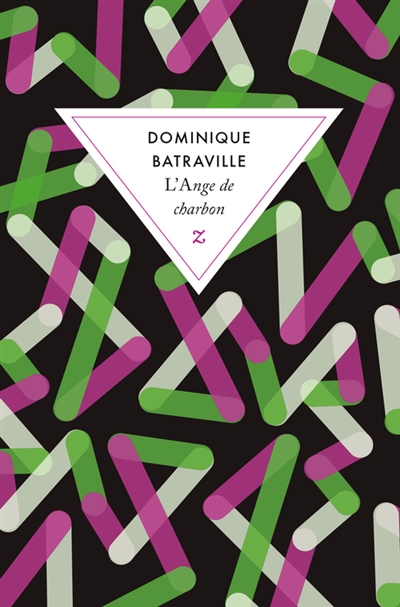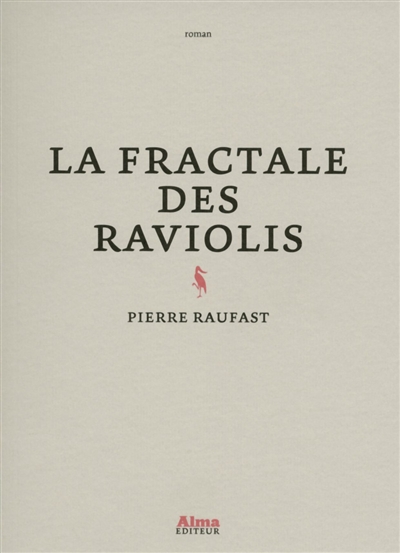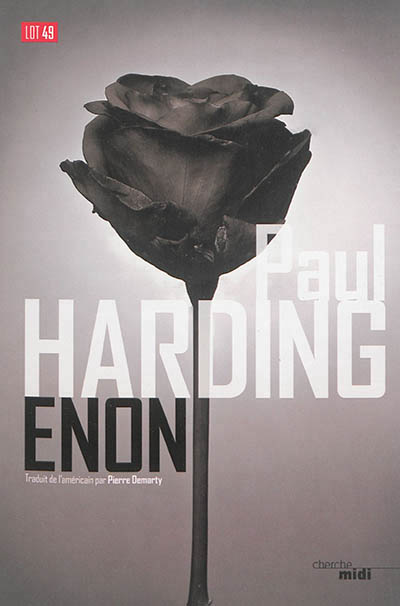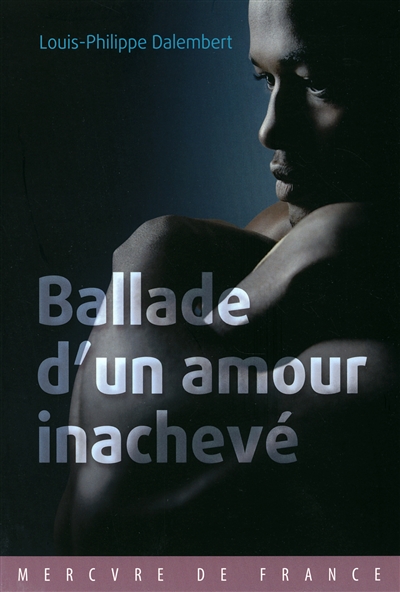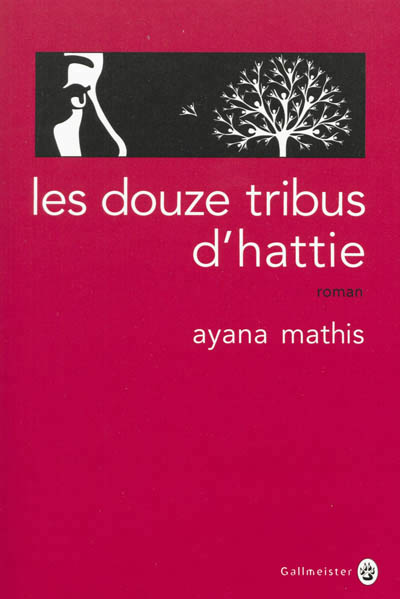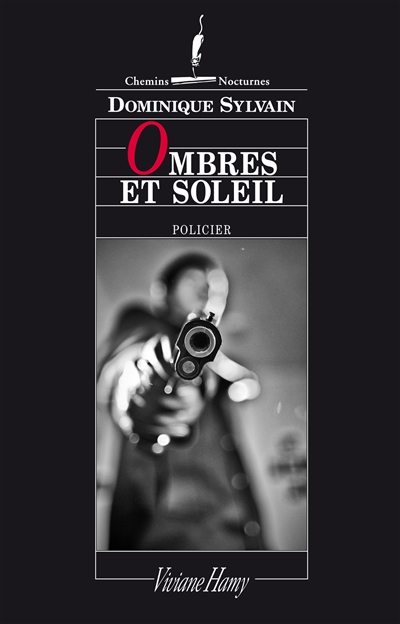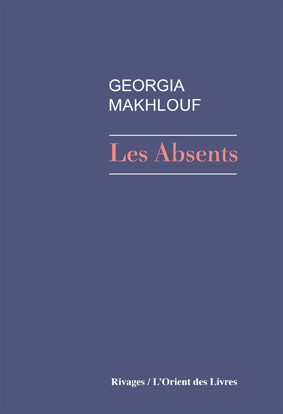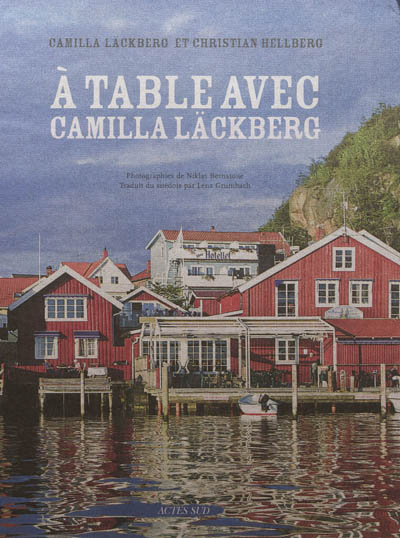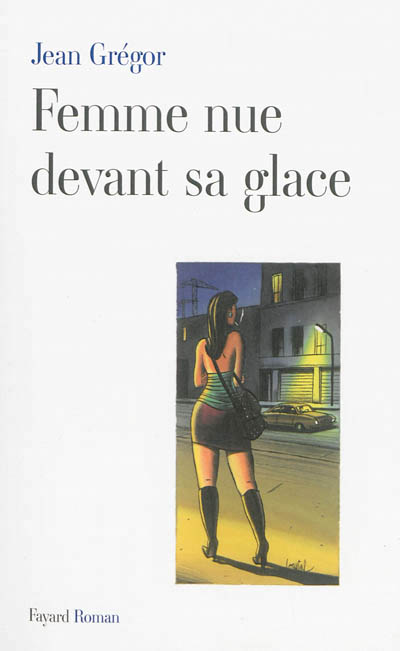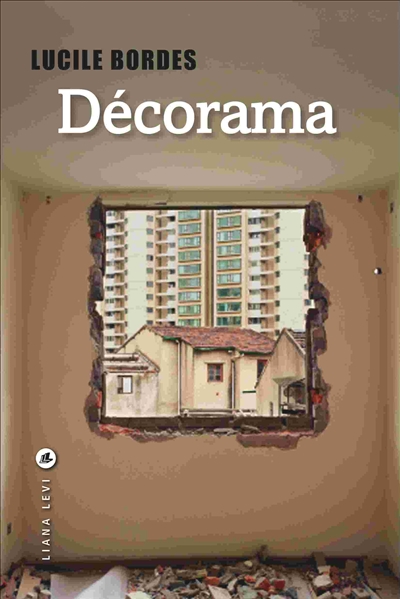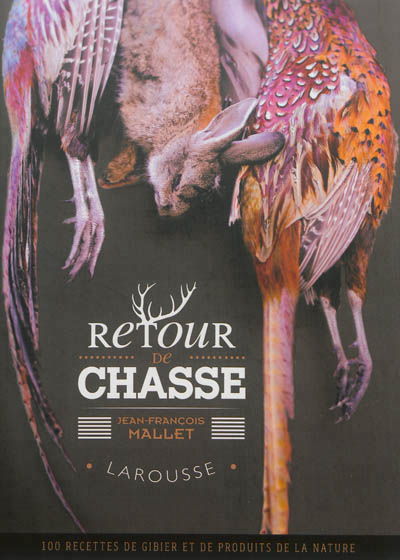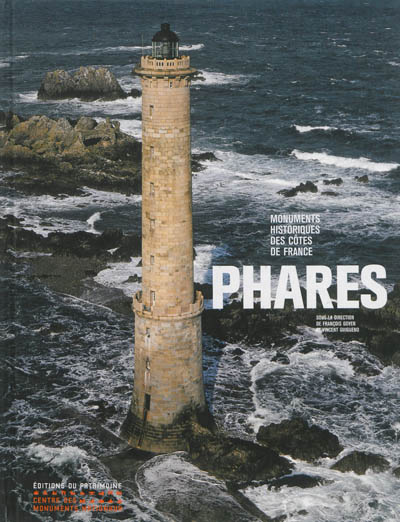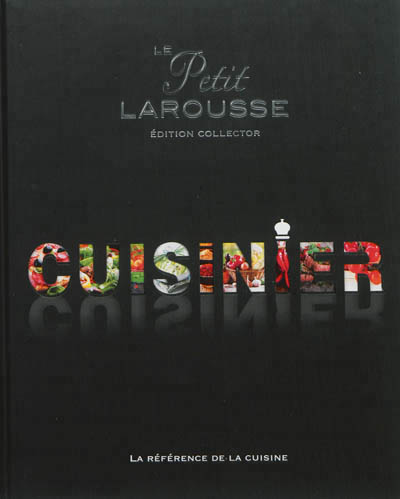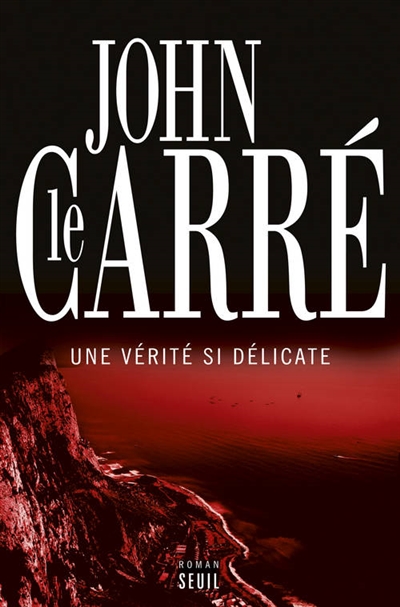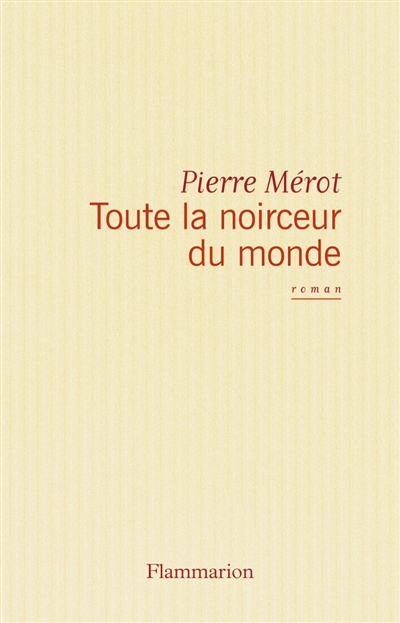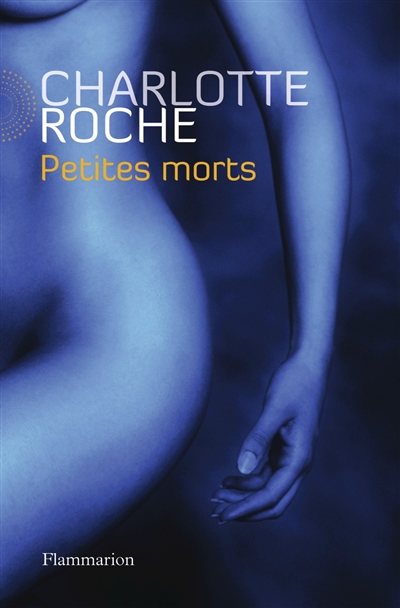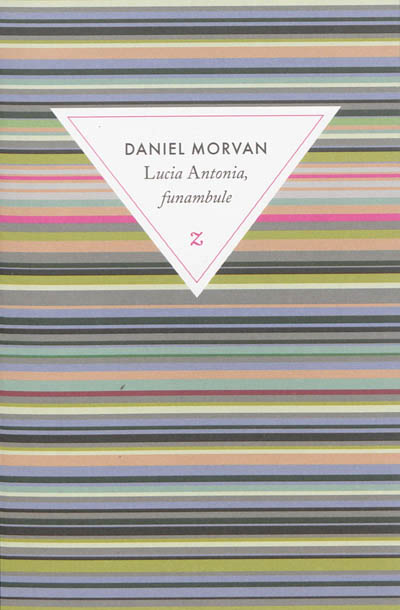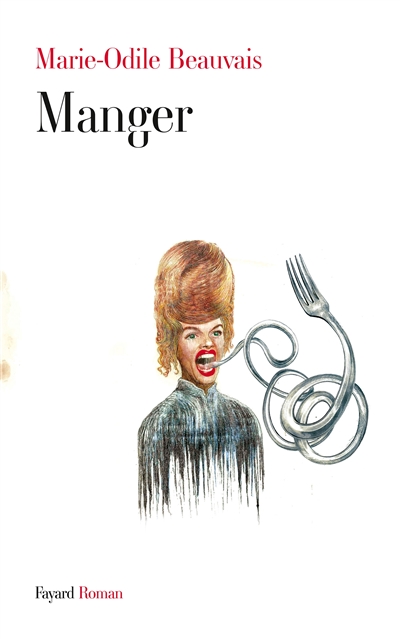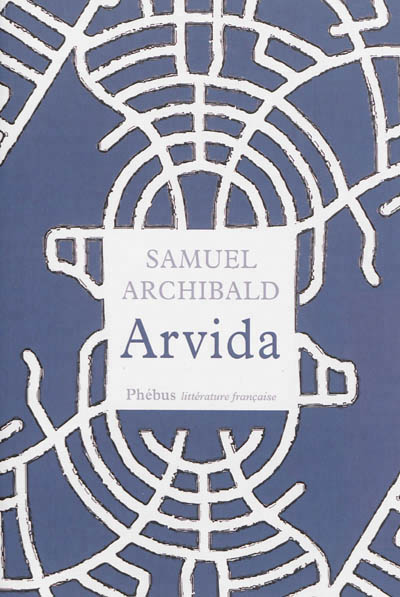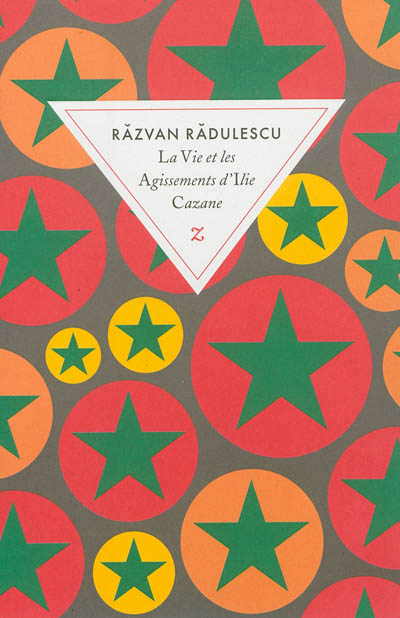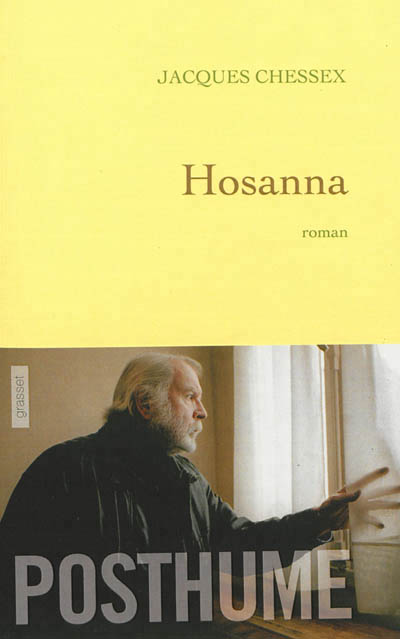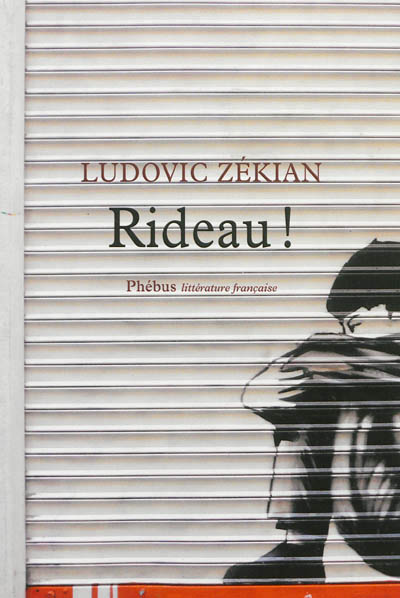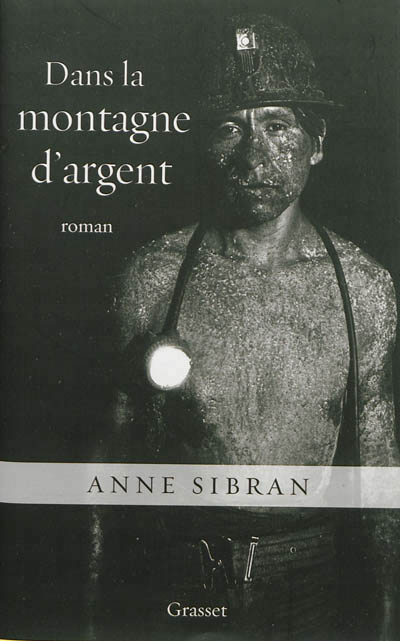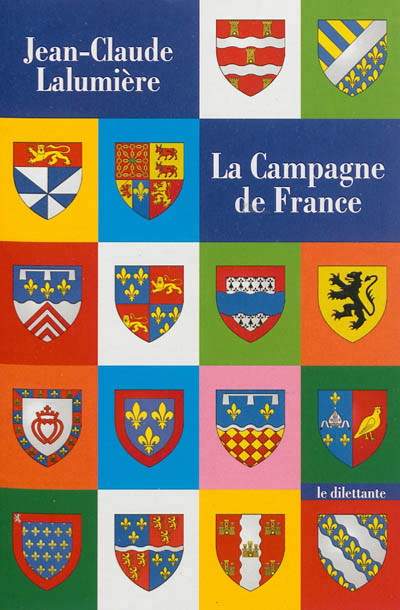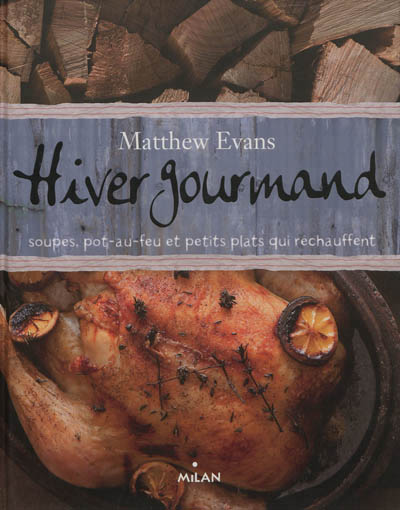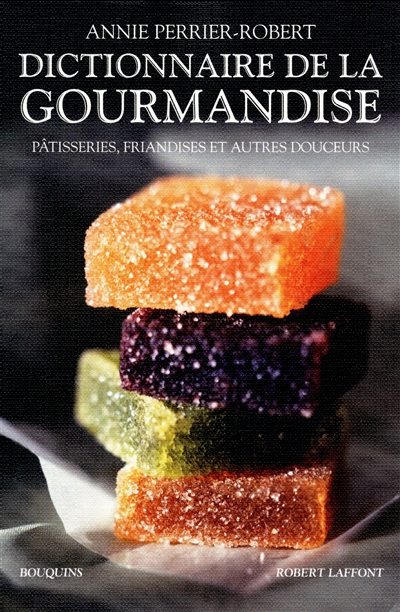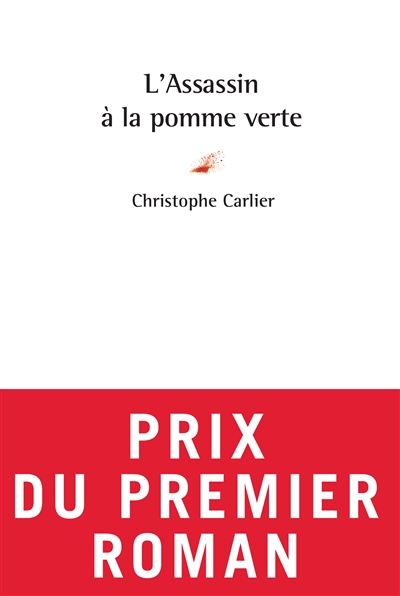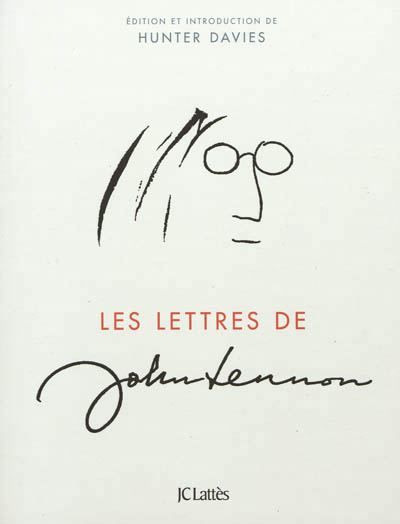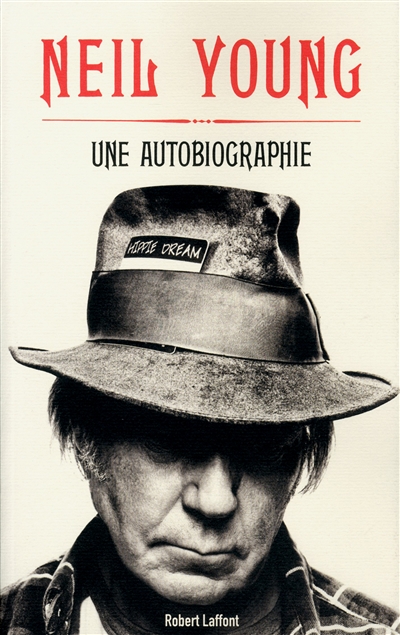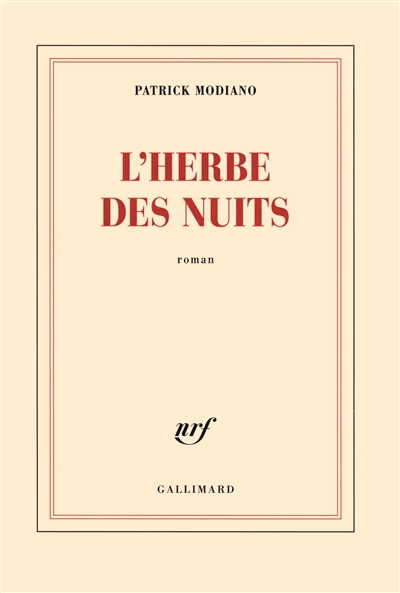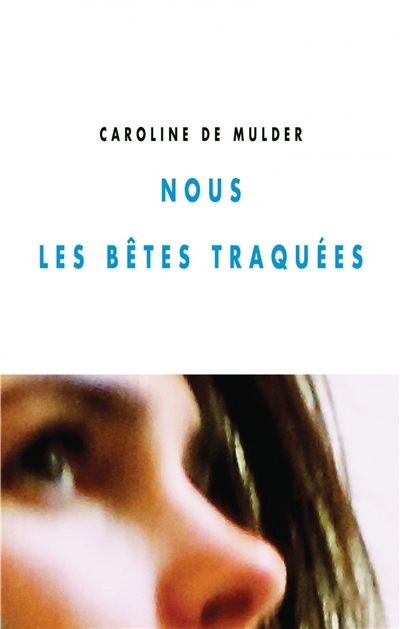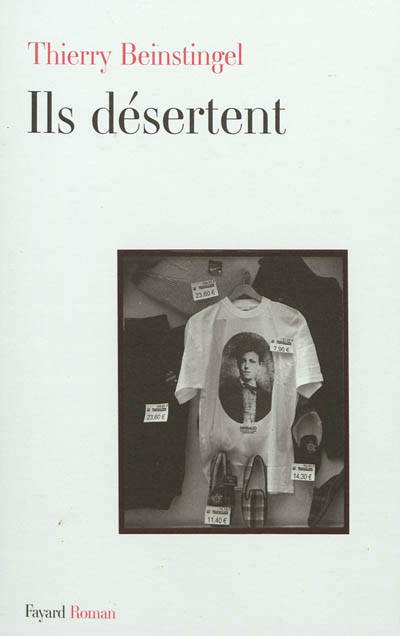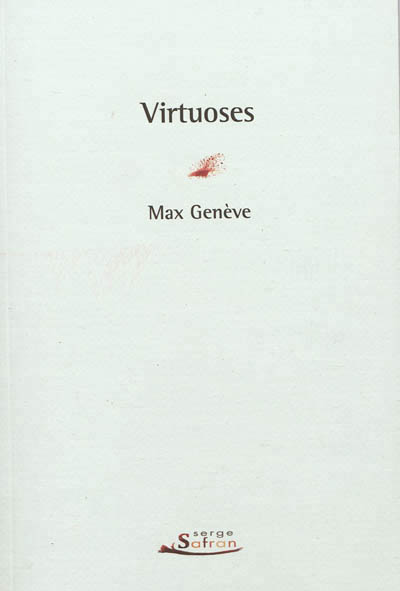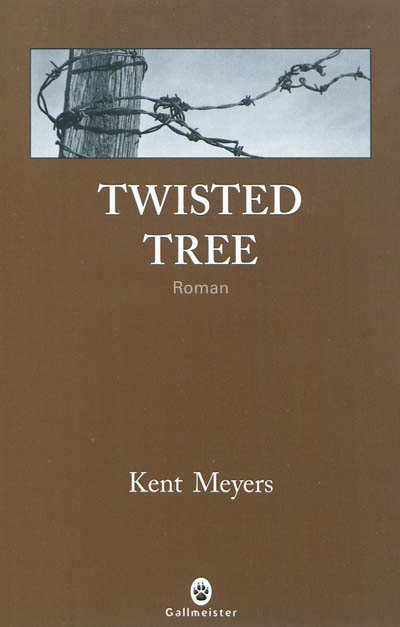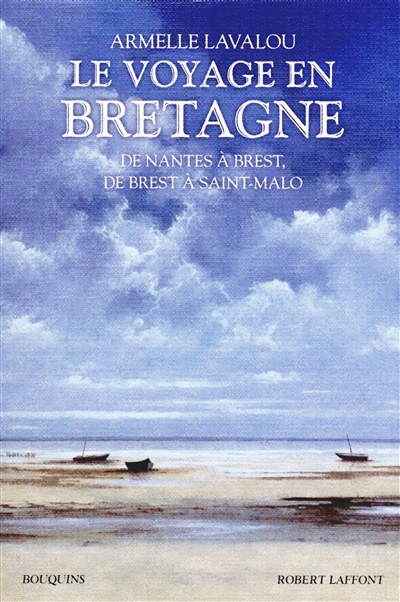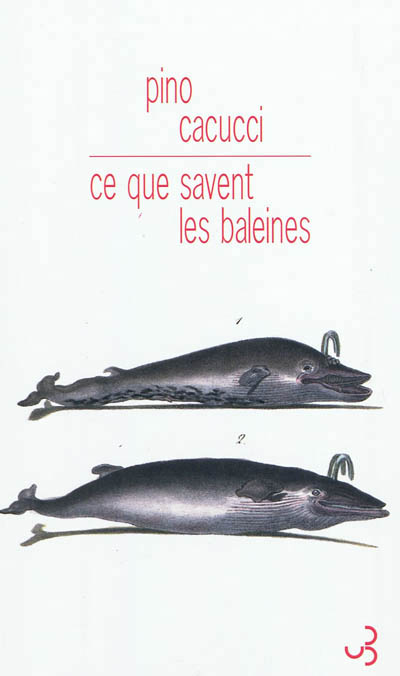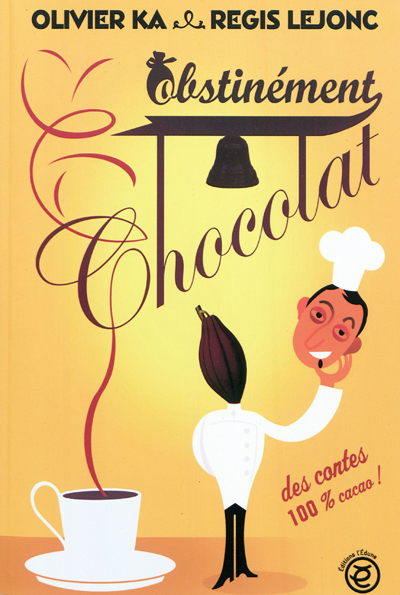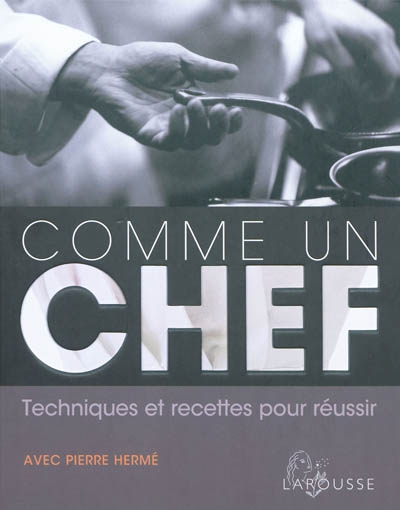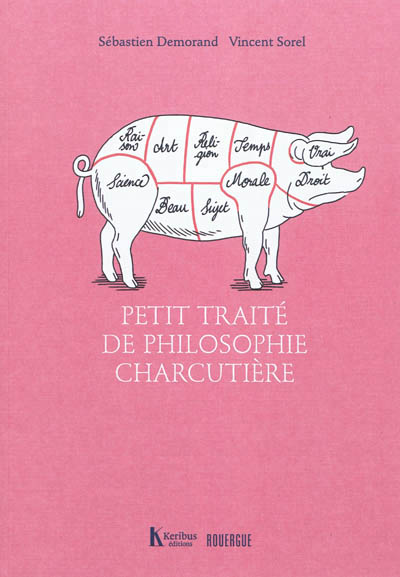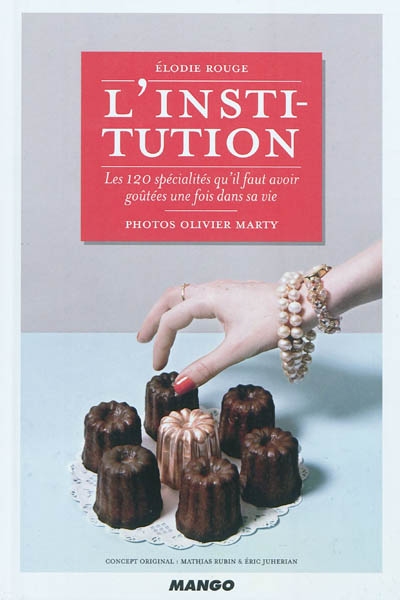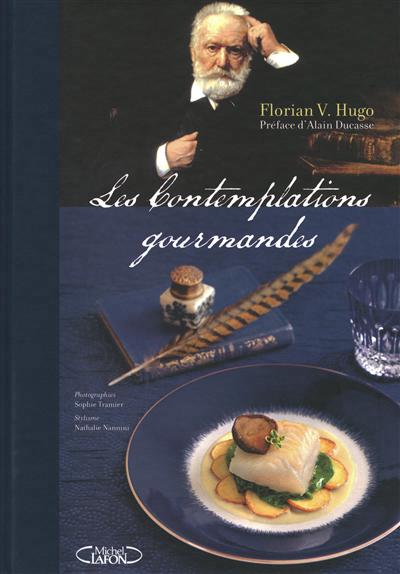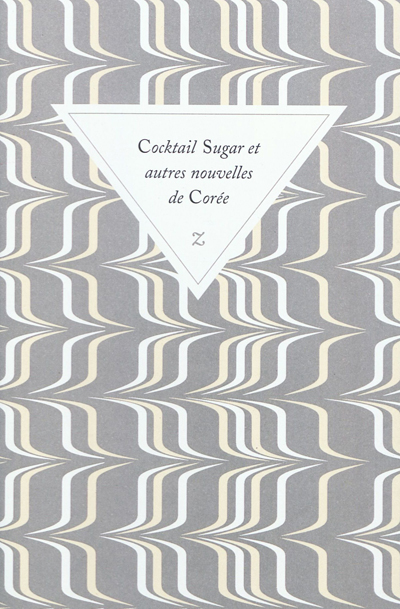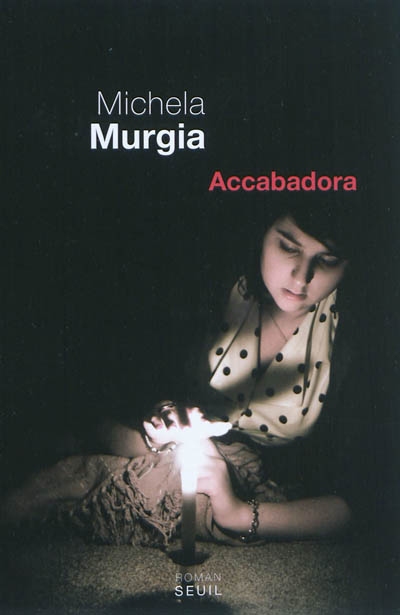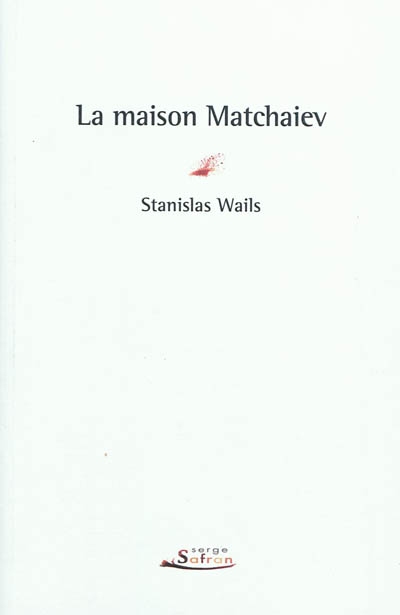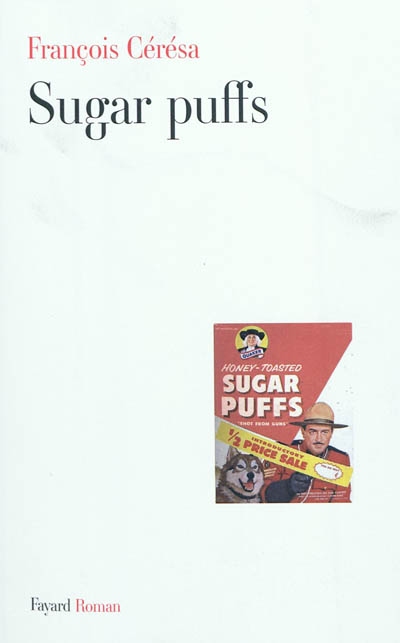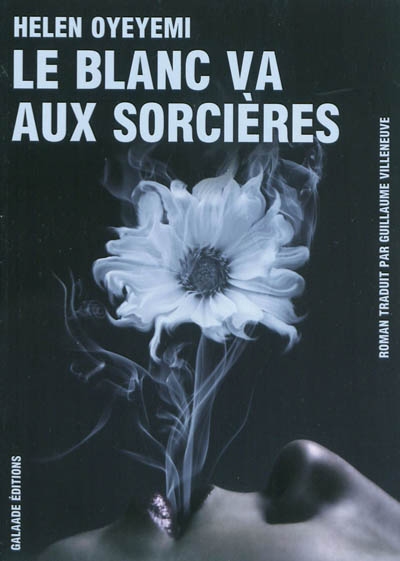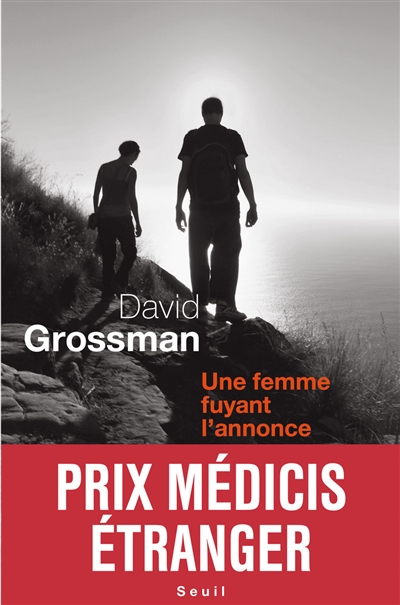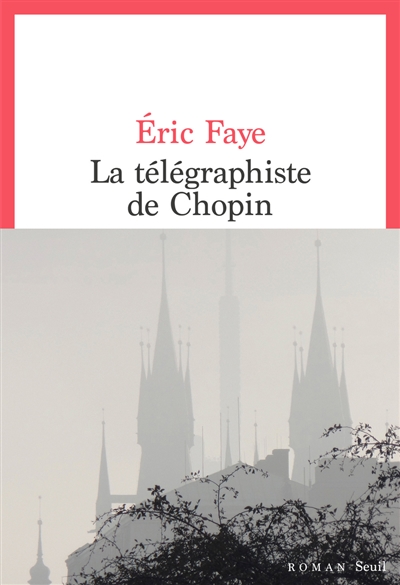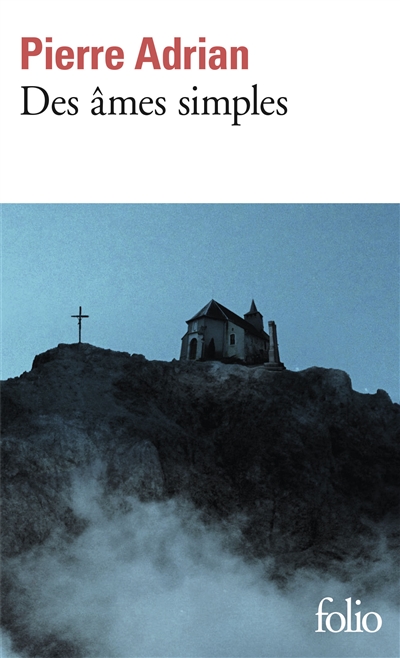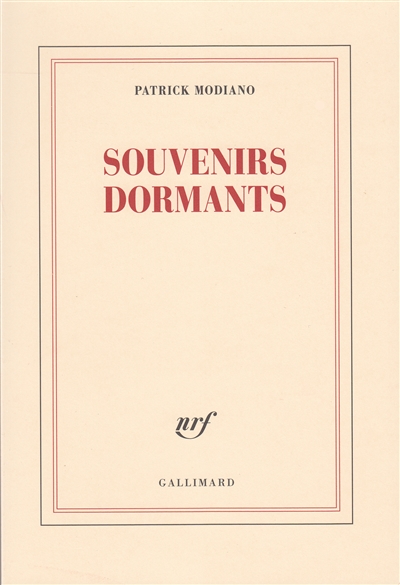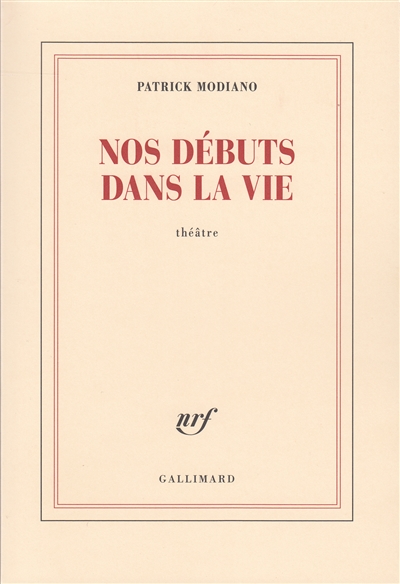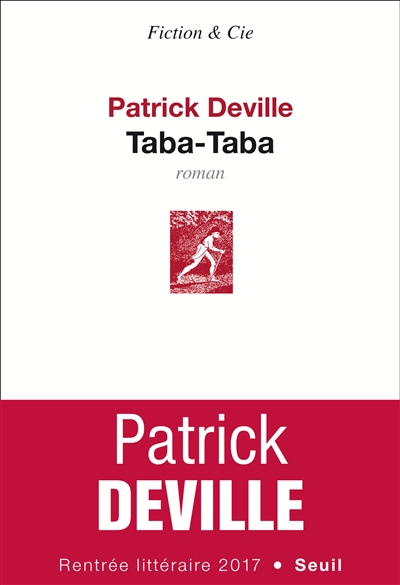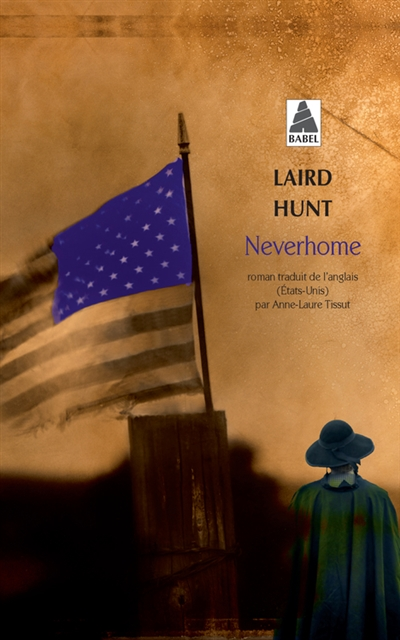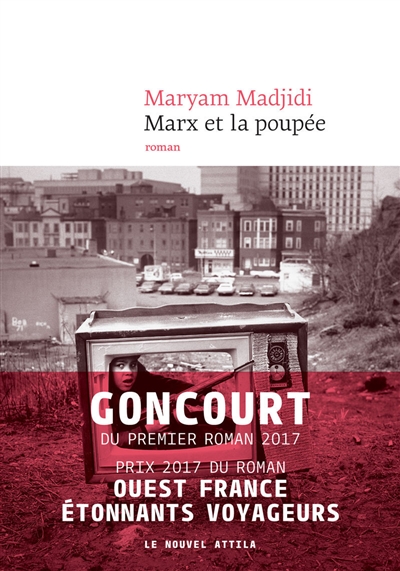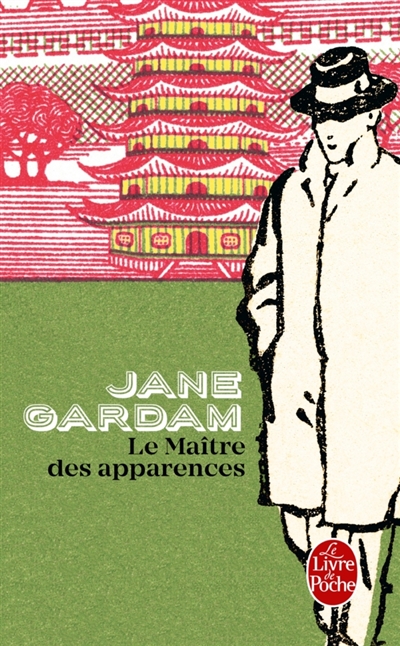Littérature française
Charif Majdalani
Le Dernier Seigneur de Marsad

-
Charif Majdalani
Le Dernier Seigneur de Marsad
Seuil
22/08/2013
256 pages, 19 €
-
Chronique de
Jean-François Delapré
Librairie Saint-Christophe (Lesneven) - ❤ Lu et conseillé par 11 libraire(s)

✒ Jean-François Delapré
(Librairie Saint-Christophe, Lesneven)
C’est un roman de feu et de sable. C’est un roman qui nous entraîne dans ce Beyrouth de l’opulence folle et des milices armées où Charif Majdalani a construit une fresque grandiose, celle de son pays, de ses excès, de ce monde qui n’apprend rien de ses erreurs, mais renaît toujours de ses cendres.
Quand Hamid enlève Simone, la fille de Chakib Khattar, tout le monde se perd en conjectures. Pourquoi Chakib refuse-t-il sa fille au fils de son régisseur ? De ce fait divers anodin, Charif Majdalani va tisser une toile aux multiples fils de couleur, ces couleurs qui sont la trame même du Liban, ce pays phénix qui n’a eu de cesse de mêler les confessions, de faire que juifs, musulmans et chrétiens vivent sur un même sol avec bonheur et simplicité. Le miracle libanais ! Mais toute médaille a son revers et Chakib va voir son monde s’écrouler dans la guerre fratricide des communautés. Il n’acceptera pas le déclin, n’envisagera pas la fuite. Que reste-t-il à l’homme quand son empire s’est écroulé, que reste-t-il à regarder, que reste-t-il à espérer ? C’est à toutes ses questions que nous convie l’auteur dans cet éblouissant roman où se conjuguent à l’envi pouvoirs et trahisons, amours et passions. Ne reste-t-il alors que des larmes à sécher sur le sable ?
Page — Est-ce que je me trompe si je vous dis que vous avez très bien connu ce « dernier seigneur de Marsad » ?
Charif Majdalani — Pour construire ce personnage, je me suis fortement inspiré d’au moins une figure emblématique de ce quartier que j’appelle Marsad dans mes romans et qui est le quartier d’origine de ma famille. Mais le caractère de ce « seigneur » est aussi forcément mâtiné de plusieurs traits venus d’ailleurs. Sa fin, en particulier, a été celle d’un autre membre de cette caste des chefs de famille.
Page — Vous empruntez le chemin de la fiction pour nous raconter l’histoire du Liban des années 1960 aux années 1980, mais n’est-ce pas aussi, pour vous, un livre de rédemption, dire ce que vous avez vécu et tenter de le restituer à vos lecteurs ?
C. M. — Ce que j’ai voulu raconter, c’est l’histoire de ces quartiers de Beyrouth qui, au cours des siècles et des décennies, ont changé de population à cause des migrations, des transformations démographiques et surtout des conflits entre communautés. Ce livre serait ainsi le récit de la fin d’une époque à travers le lent déclin de la présence des chrétiens dans un quartier de l’Ouest de Beyrouth. Mais il s’agit aussi de l’histoire d’une famille, de sa vie entre « côté ville » et « côté campagne », de ses rapports avec sa clientèle et ses partisans, de ses déchirements internes. Tout cela à travers les tourments d’un personnage qui, jusqu’au bout, aura cru que les choses, malgré les bouleversements et les conflits, allaient pouvoir demeurer telles qu’il les avait toujours connues. Quant à savoir s’il y a rédemption, je ne saurais le dire. La fin de Chakib Khattar ne rédime rien, elle est le fruit d’une résistance désespérée et d’un désir du personnage de n’être pas celui sous le règne de qui la fin du clan arrivera.
Page — En France, on parle de plus en plus de résilience. Et l’écrit est la forme la plus évidente de la résilience, car elle permet d’aller au bout de ce qui nous pèse, et aussi de ce qui nous guérit. Entre Chakib et Hamid, j’ai le sentiment que l’un guérit l’autre, mais ni l’un ni l’autre ne s’en rend compte.
C. M. — Votre lecture est très belle. Par-delà la question de la permanence de la présence des Khattar sur leurs terres, le roman est celui d’une quête du fils par le père. Au sein du chaos dont il perçoit l’imminence, Chakib Khattar s’accroche à l’idée de se trouver un successeur. Le fait qu’il charge implicitement Hamid de sauver ce qui peut l’être encore dans le naufrage général n’est pas nécessairement un cadeau pour ce dernier, mais cela reste une forme de reconnaissance considérable, et dont tout fils a besoin – même si en choisissant Hamid comme successeur, Chakib consent à l’emmêlement des lignées, ce qui est aussi une façon pour lui d’admettre en définitive que les choses ne seront plus jamais ce qu’elles ont été. Pour ce qui est de l’écrit, je crois que le roman, et la fiction en particulier, peut souvent servir à relire l’Histoire, à réinterpréter ce que les historiographes officiels ne disent pas. Ou disent autrement, en trafiquant la vérité pour des raisons diverses, souvent liées à la nécessité de forger des légendes nationales. De ce point de vue, la fiction a une grande supériorité sur le discours historique parce qu’elle permet en effet une forme de catharsis que le discours historique n’autorise pas.
Page — Vous avez écrit une magnifique histoire d’amour pour votre pays, pays de la déchirure, pays, parfois, de l’incompréhension, mais surtout pays de la tolérance jusqu’à ce que la guerre vienne détruire tout ce qui tenait debout par on ne sait quel miracle. Quel était ce miracle avant la guerre ?
C. M. — Il y a une anecdote à propos de cette expression : « le miracle libanais ». Un expert économique européen avait été appelé, dans les années 1960, pour étudier le fonctionnement de l’économie libanaise. En ce temps déjà, le pays était au cœur de la tourmente née des conflits israélo-arabes. Il était pris comme dans une tenaille entre les revendications panarabes d’une partie de sa population et le « libanisme » de l’autre partie, et déjà menacé dans ses fragiles équilibres par la présence palestinienne armée. Et ce que cet expert a constaté, c’est que malgré tout ça, le pays vivait dans une opulence qu’aucun des pays environnants ne connaissait, et aussi dans une insouciance et une frénésie de vie accompagnées d’un développement économique et d’une croissance incroyables. Incapable de saisir comment cela pouvait tenir ensemble, l’expert désarmé a parlé de « miracle », c’est-à-dire à ses yeux d’une chose inexplicable. Le plus incroyable, c’est que, d’une certaine façon, nous vivons aujourd’hui exactement le même phénomène. Comme si l’Histoire était faite de cycles sans fin recommencés. En espérant que les hommes savent tirer les leçons du passé. Ce qui n’est pas toujours le cas.
Page — Dans votre livre, tout fait appel à la mémoire. Croyez-vous que le passé est la forge de notre avenir ? Que l’homme est assez fort pour renaître de la folie de ses erreurs, comme vous semblez le sous-entendre en citant saint Augustin : « Rome est tombée, mais ni le ciel ni la terre n’en ont été ébranlé » ?
C. M. — Cette citation, je ne l’ai finalement pas gardée dans la version dernière du livre. Elle m’a semblé redondante par rapport au titre, lorsque, avec mon éditeur, nous avons opté pour ce dernier – après bien des hésitations, d’ailleurs. Elle renvoyait à cette idée de la fin d’un monde dans l’indifférence de l’Histoire. Et aussi, en même temps, au fait que Rome a survécu dans Byzance, comme on peut imaginer que le pouvoir de Chakib Khattar est appelé à survivre dans celui de Hamid Chahine, non plus à Marsad mais à Kfar Issa. Les choses se poursuivent ainsi sans fin, elles recommencent et s’achèvent, puis recommencent à nouveau, toujours semblables à elles-mêmes mais sous des formes différentes.