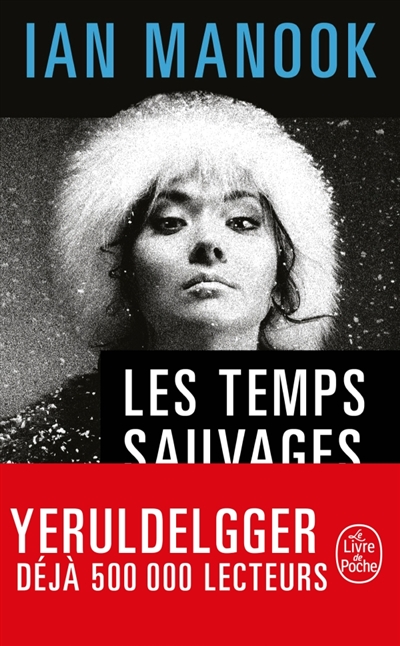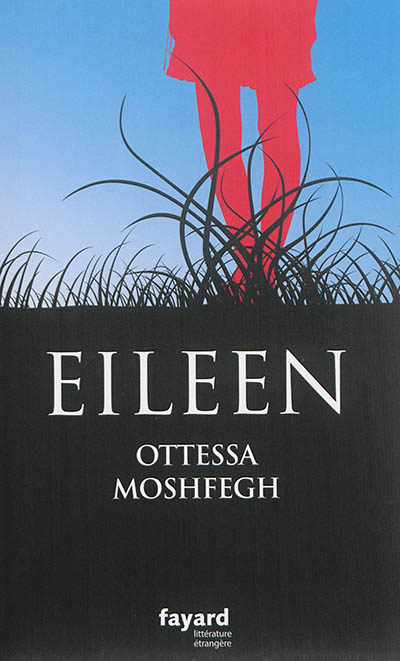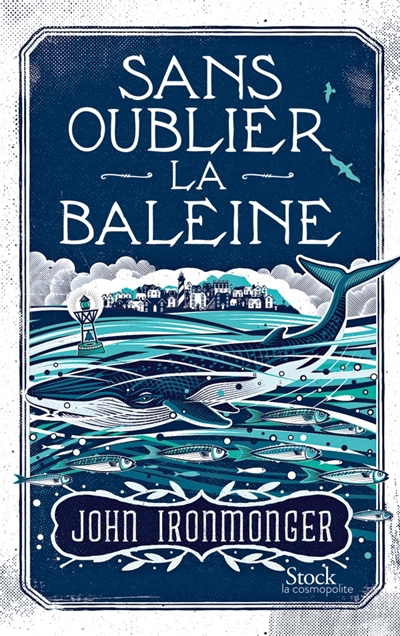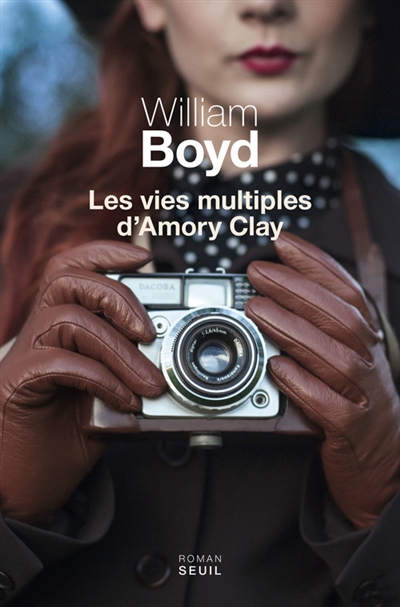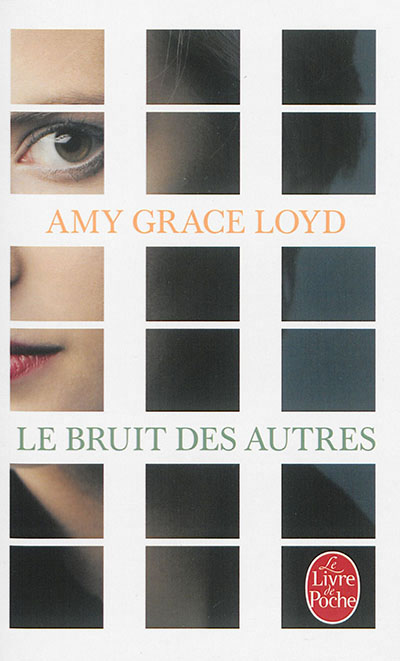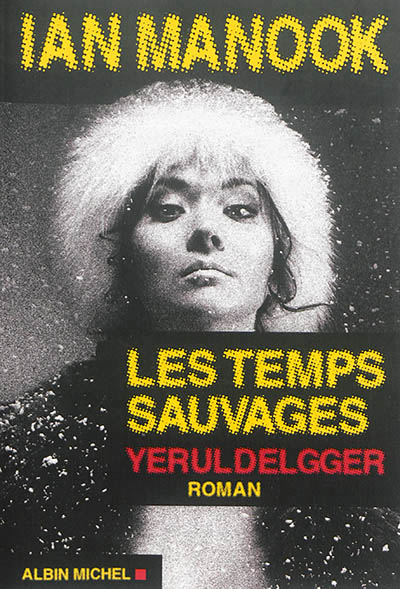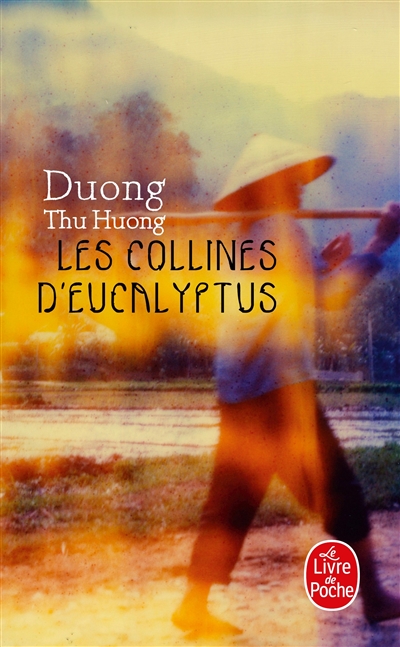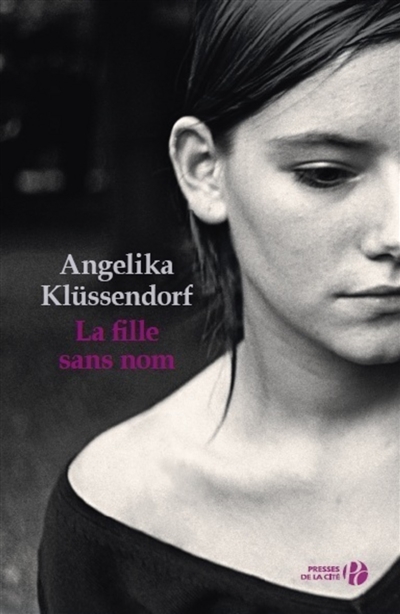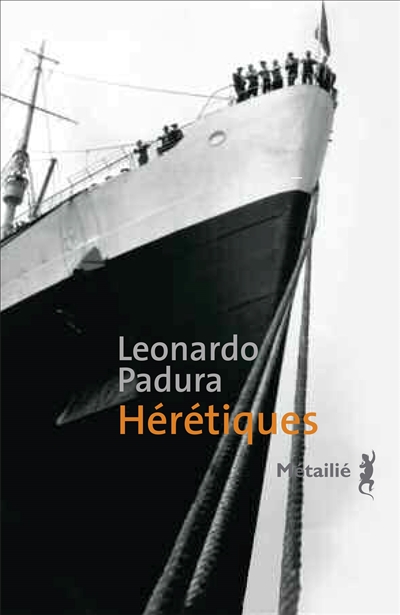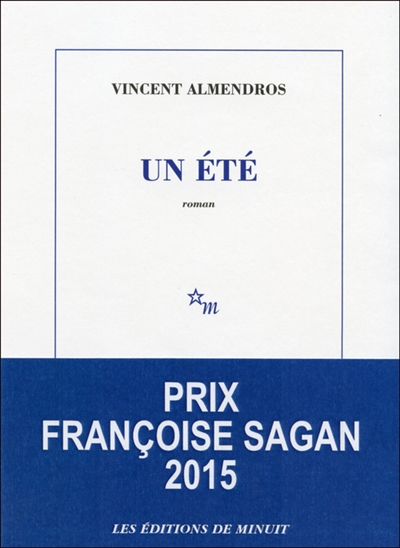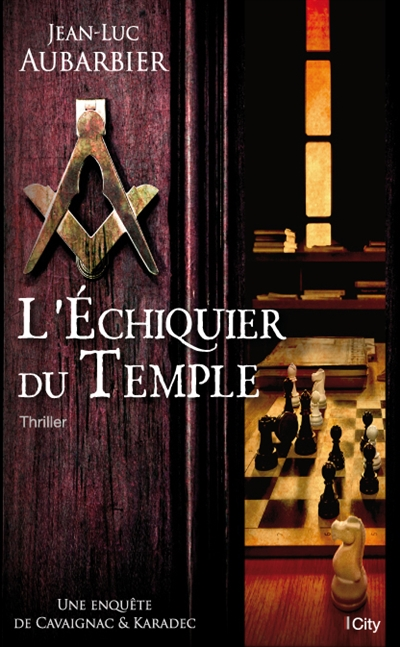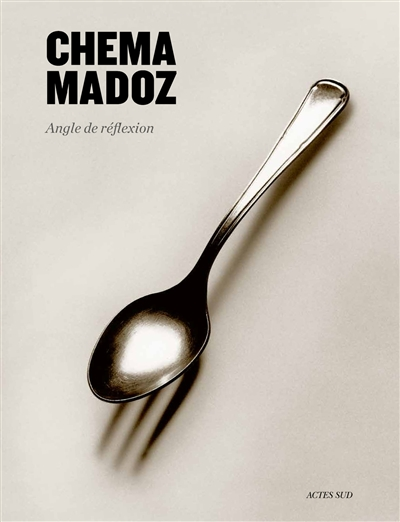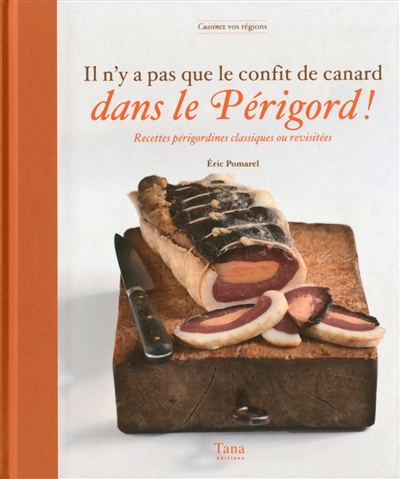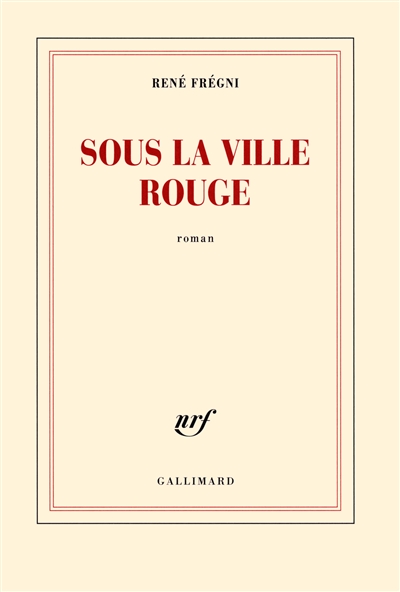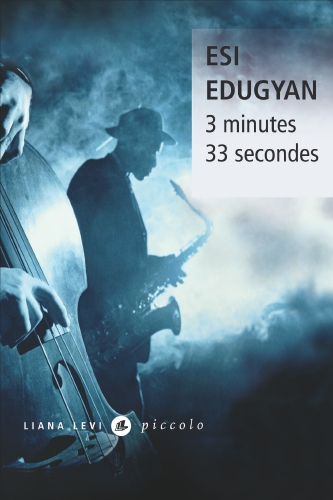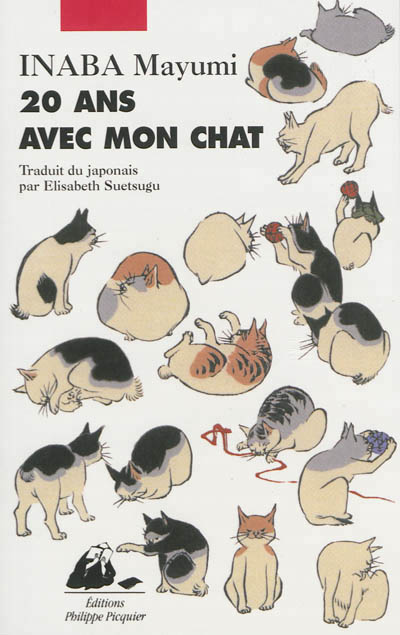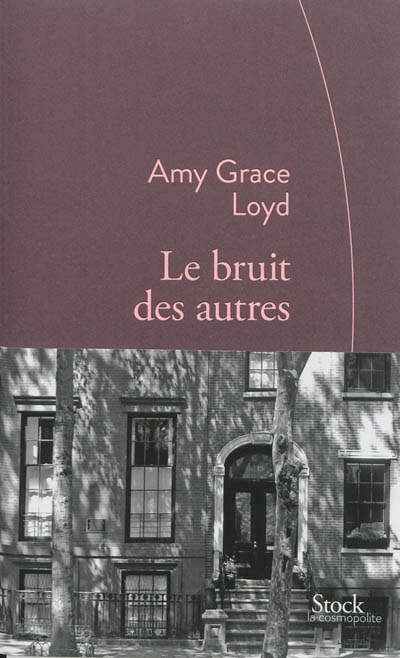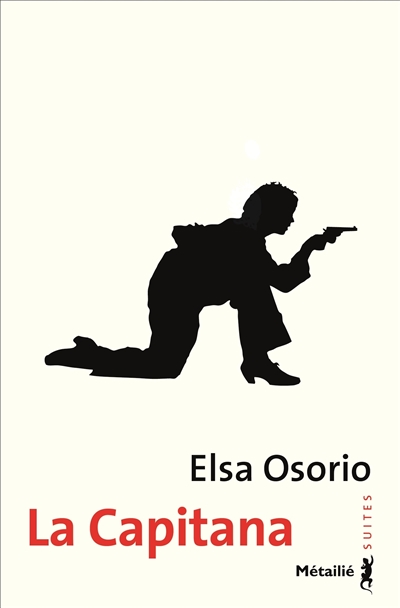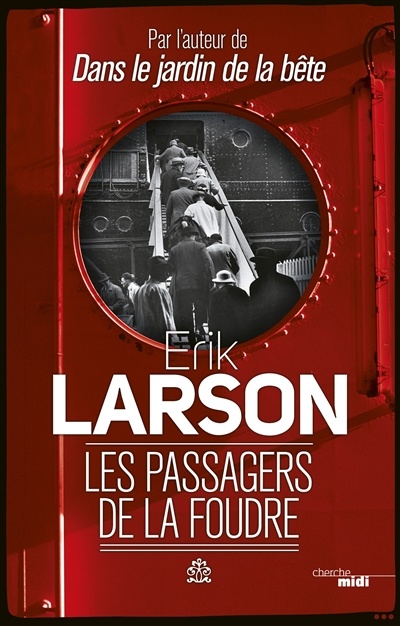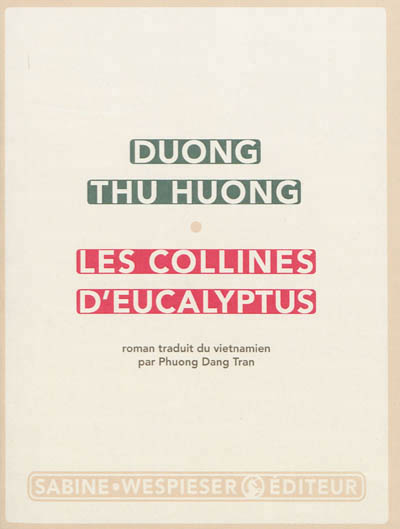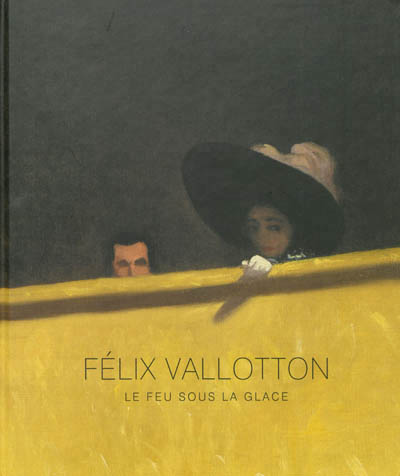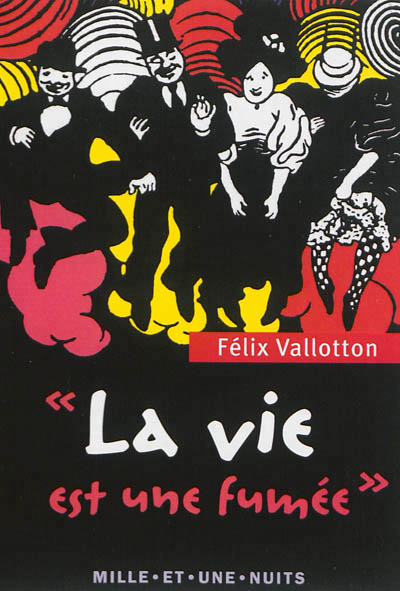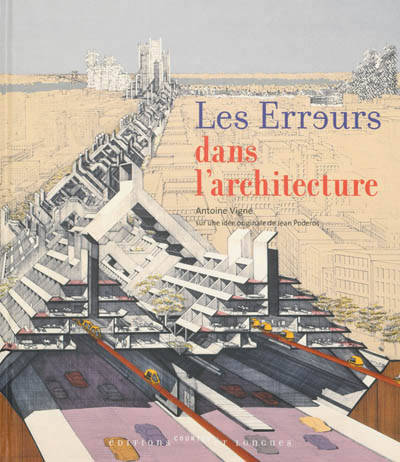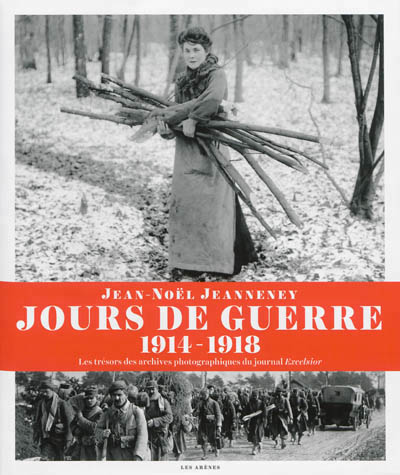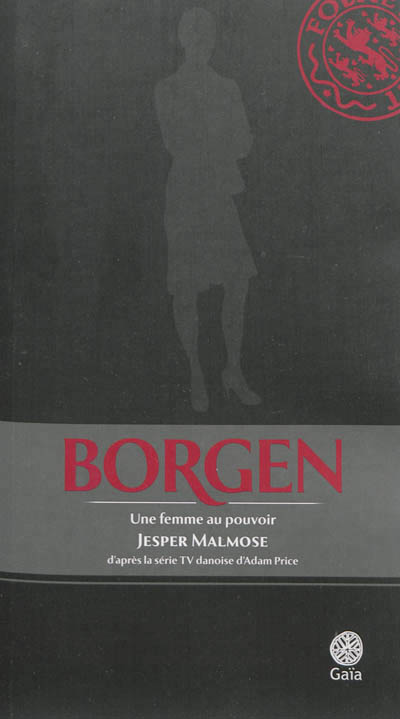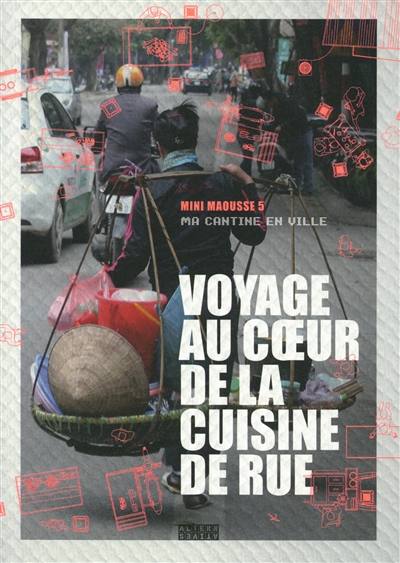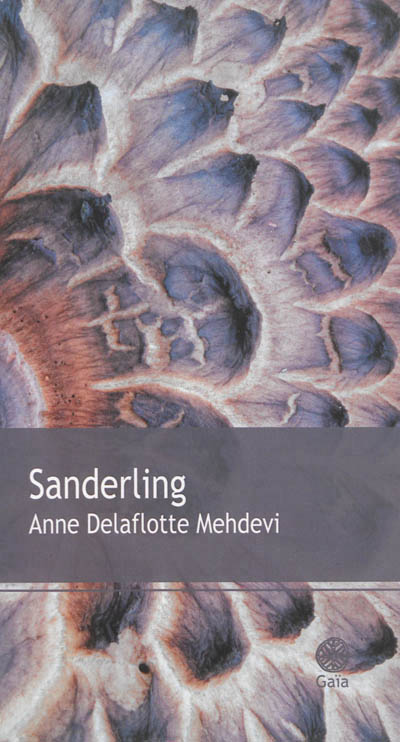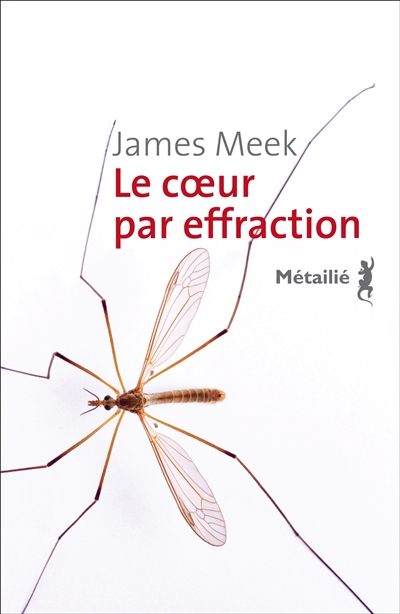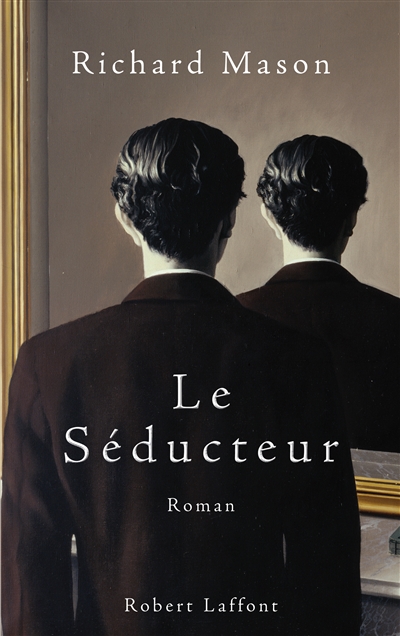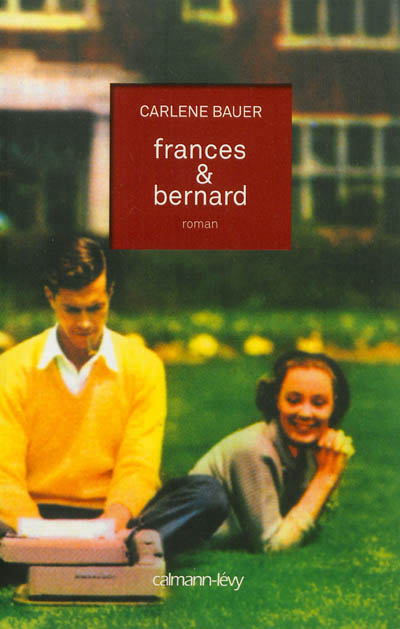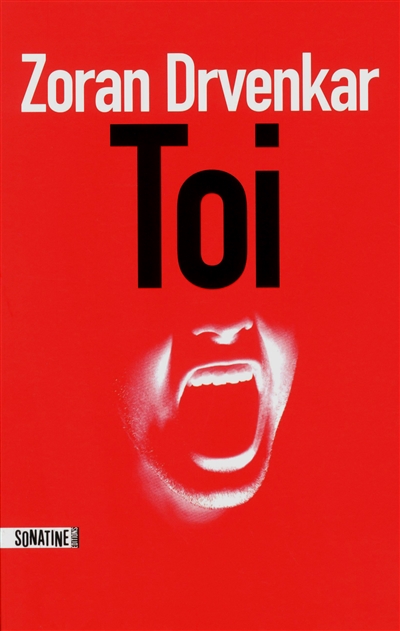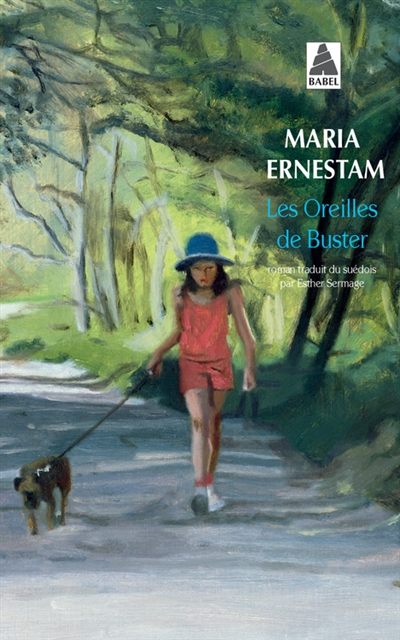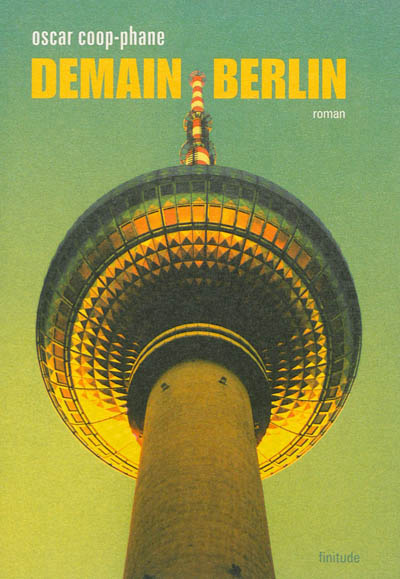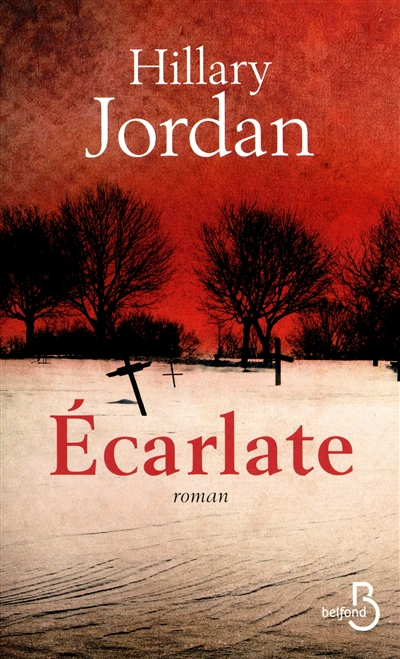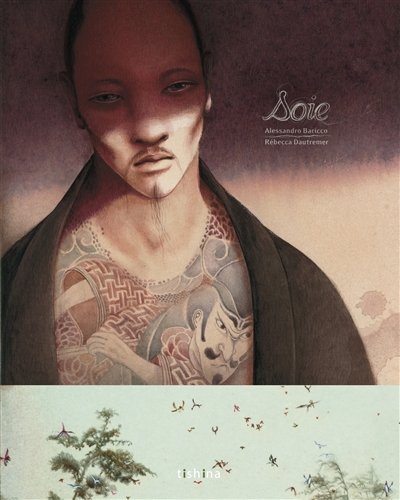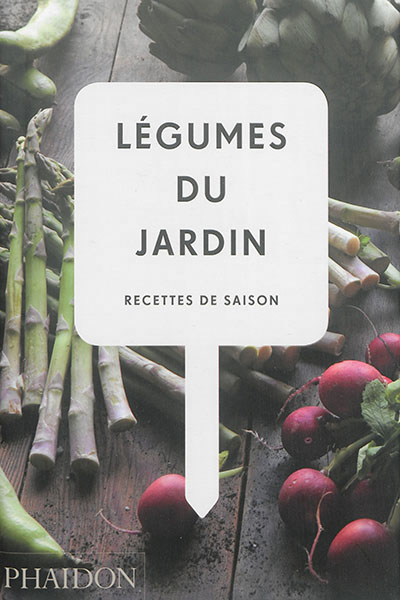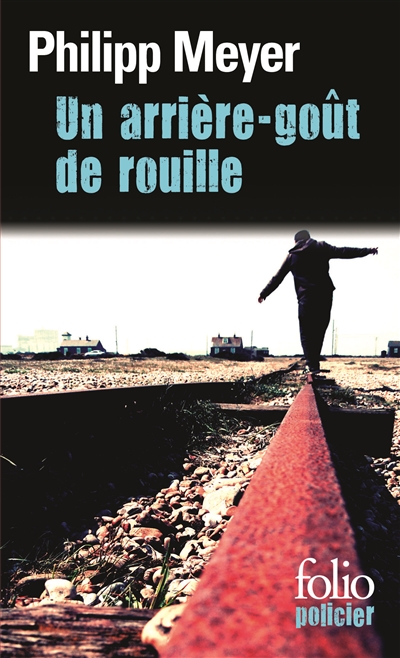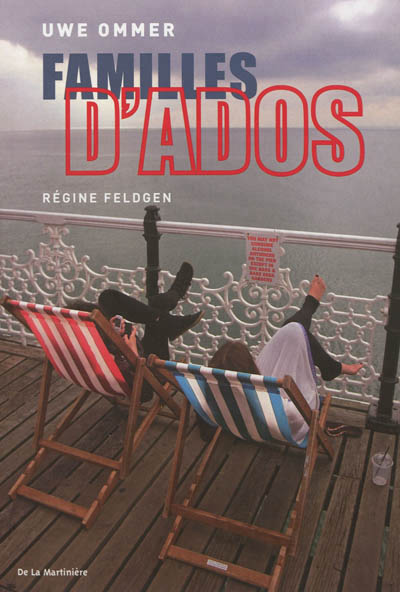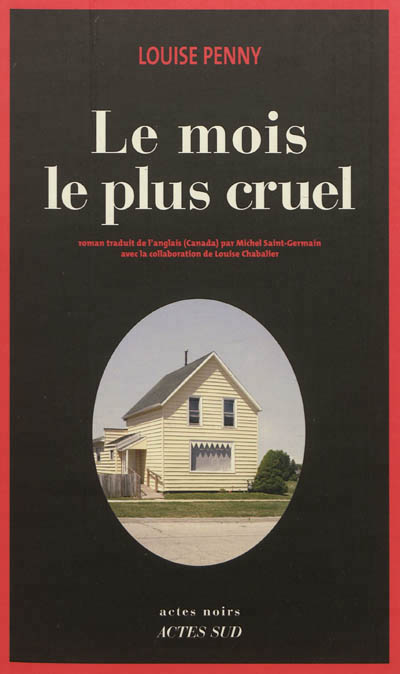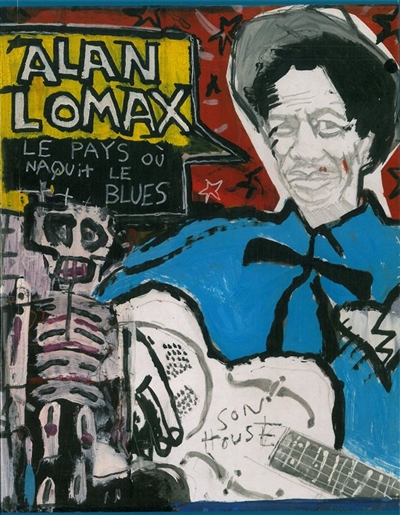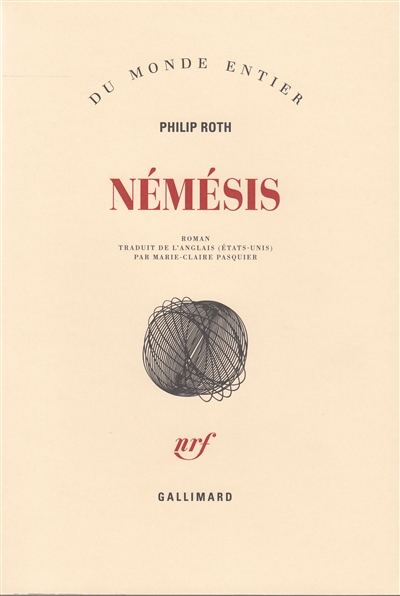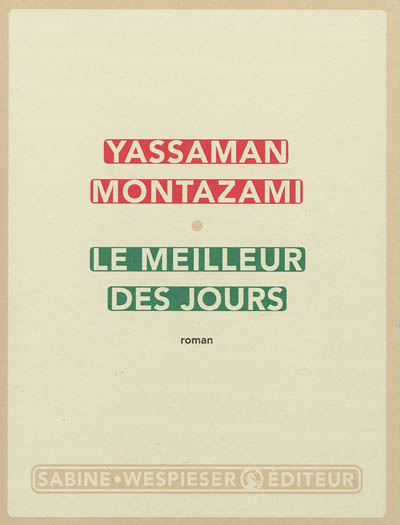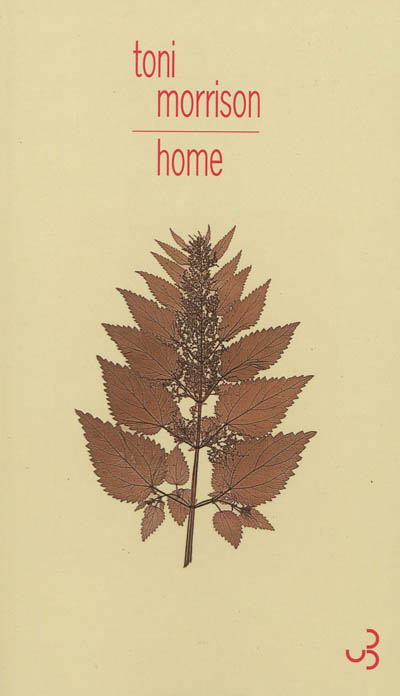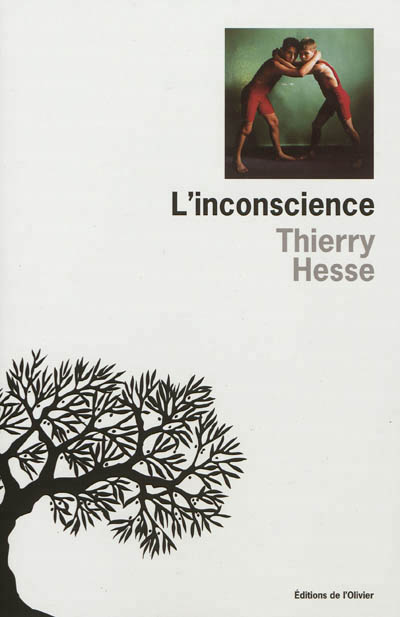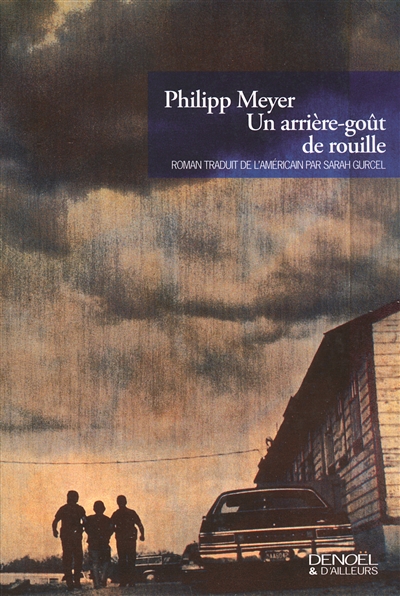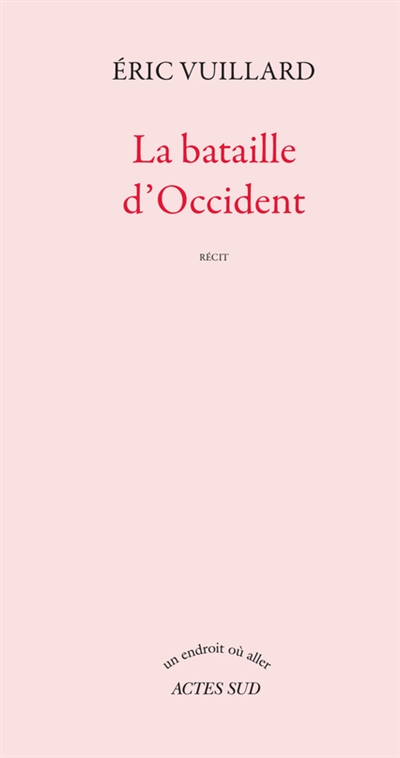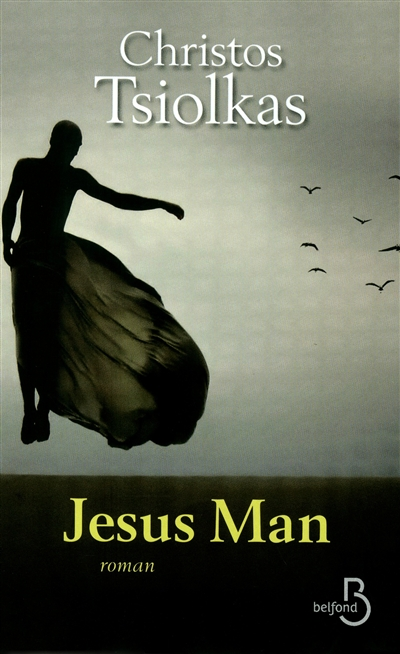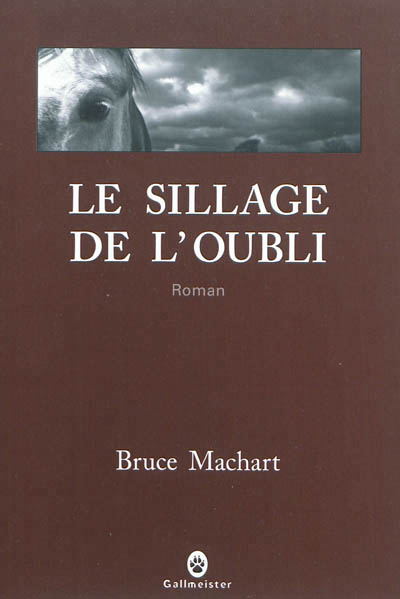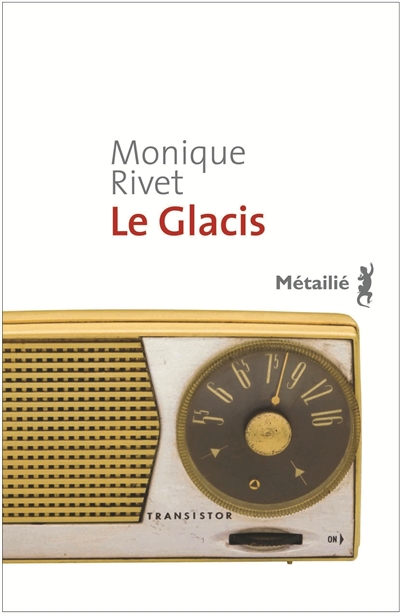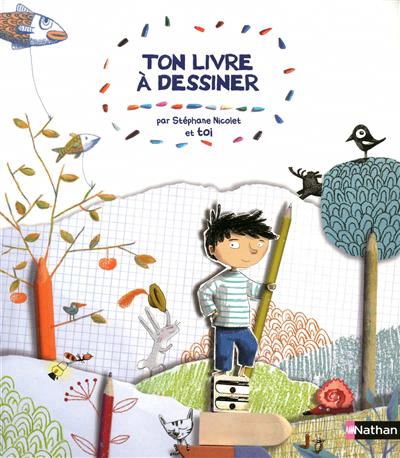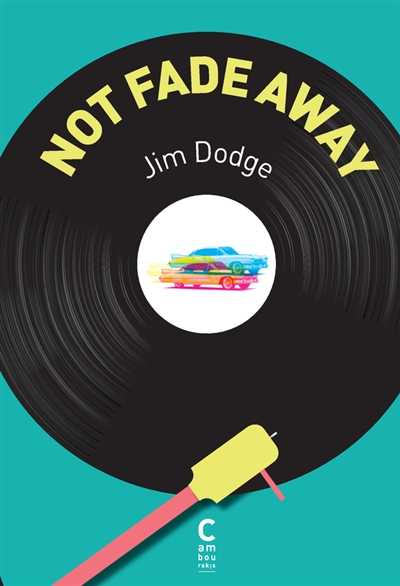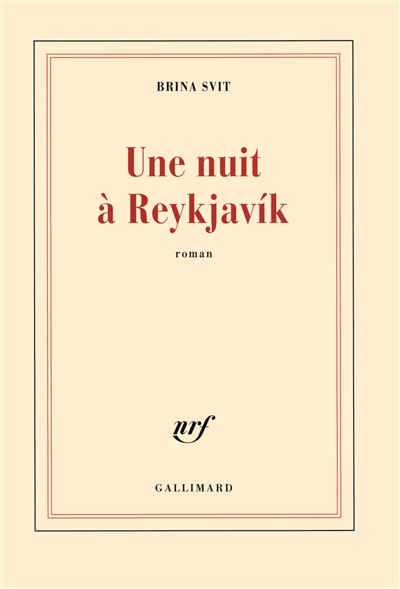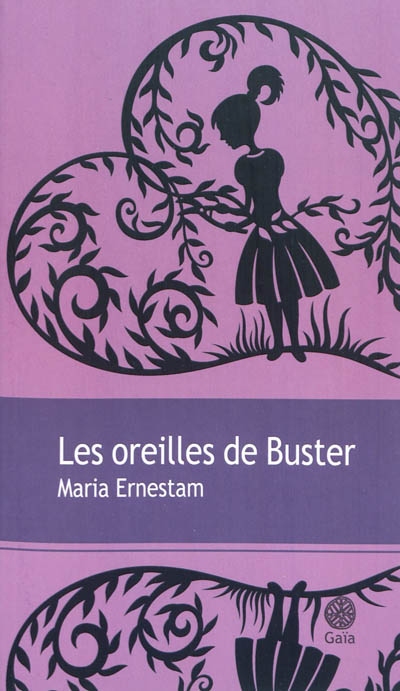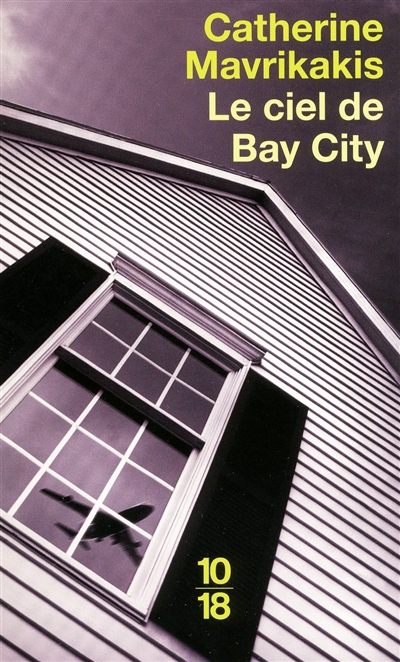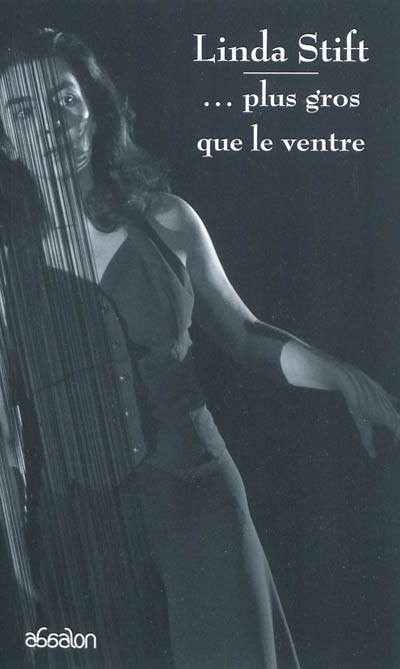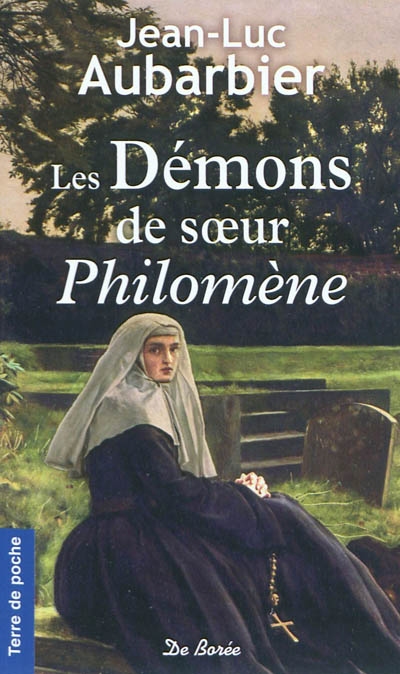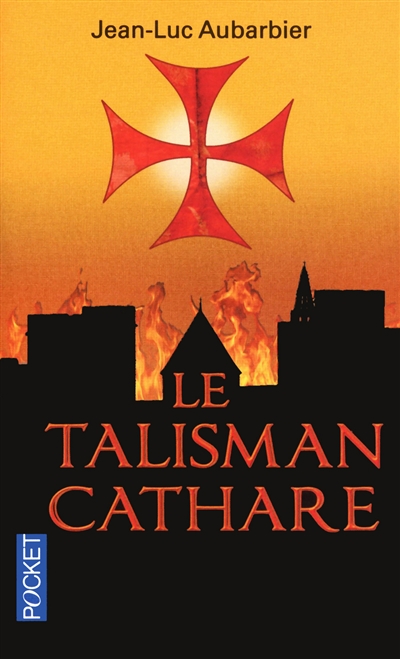Littérature étrangère
Bilal Tanweer
Le Monde n’a pas de fin
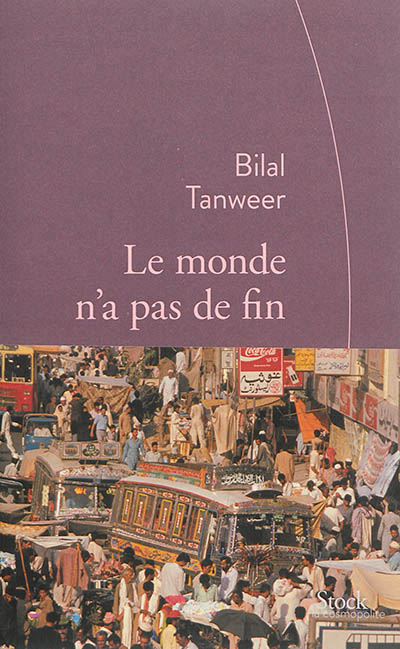
-
Bilal Tanweer
Le Monde n’a pas de fin
Traduit de l’anglais (Pakistan) par Emmanuelle et Philippe Aronson
Stock
20/08/2014
216 pages, 19 €
-
Chronique de
Coline Hugel
-
❤ Lu et conseillé par
3 libraire(s)
- Linda Pommereul de Le Failler (Rennes)
- Anne Baudinet de L'Oiseau Lire (Visé)
- Bérangère Lecussan de Sheila Choisne (Les Essarts-le-Roi)
✒ Coline Hugel
( , )
Roman venant du Pakistan, ce Monde qui n’a pas de fin vibre, brûle, respire dans la ville étonnante et inconnue des Occidentaux qu’est Karachi. Bilal Tanweer nous y guide, sans cacher la violence, mais en sachant mettre en lumière l’humain. Une belle réussite.
Page — Cher Bilal Tanweer, je suis très heureuse d’avoir découvert votre beau livre, j’ai beaucoup aimé votre ton et surtout l’image que vous donnez de Karachi, à la fois loin du terrorisme et de l’abject, et en même temps… en plein dedans. Comment vous est venue l’idée de ce livre ?
Bilal Tanweer — Je suis tout à fait d’accord avec votre lecture : c’est précisément pour montrer que ces deux réalités radicalement opposées – la violence et le quotidien – ne sont jamais très loin en ce lieu, que j’ai voulu écrire ce livre. Les sources d’inspiration sont multiples. En premier lieu, il y a très peu de littérature sur Karachi, même en ourdou ou dans d’autres langues locales. Or Karachi est l’une des plus grandes villes du monde et compte près de 20 millions d’habitants. L’idée de ce livre est aussi liée à mon admiration pour des œuvres qui créent un sentiment d’appartenance en utilisant de nombreuses histoires individuelles – Les Villes invisibles d’Italo Calvino (Folio), Les Boutiques de cannelle de Bruno Schulz (« L’Imaginaire », Gallimard), Jesus’ son de Denis Johnson (Christian Bourgois). Je suis aussi attiré par l’écriture de voix narratives fortes et uniques, et je voulais donner vie à autant de voix singulières de Karachi que possible.
Page — Le roman est construit en étoile, on passe d’un personnage à l’autre avec, comme point central, l’attentat. Est-ce pour vous un moyen de montrer toutes les facettes de cette société ?
B. T. — Cette construction est sans doute le fruit de mes convictions philosophiques. Je pense que nous ne pouvons jamais vraiment approcher la réalité : tout ce que nous avons ce sont des points de vue. Et, selon moi, nous devons prendre au sérieux ces points de vue parce qu’ils déterminent la vie des gens, leurs peines, leurs joies, les décisions importantes de la vie. Je voulais donc partir d’un événement tout à fait banal, tel que l’on peut lire dans les journaux, et le raconter selon différents points de vue. D’autre part, nous vivons dans un monde où nos histoires individuelles et collectives sont définies par certains événements qui sont hors de notre contrôle. Un attentat à la bombe est un événement tellement important qu’il peut devenir, à lui seul, l’histoire d’un lieu et oblitérer son histoire originale, sa mémoire. Karachi est, je crois, l’un de ces lieux. Je voulais que mes lecteurs puissent envisager autrement cette question – qui est aussi une réalité pour beaucoup de personnes : et si, pour les personnages du roman, l’explosion d’une bombe n’était pas l’événement prédominant ? Et s’il y avait d’autres drames plus importants pour eux qu’un attentat à la bombe ?
Page — On passe beaucoup de temps dans des véhicules (bus, voitures...), est-ce un hasard ou un vrai choix ?
B. T. — À l’origine, je voulais que toutes les histoires se déroulent dans les bus publics. J’ai si souvent voyagé dans les bus de Karachi que j’ai été témoin de scènes étonnantes et absurdes, comme des bagarres stupides, des démonstrations d’affection, de tendresse… L’espace en lui-même a un potentiel dramatique fantastique dans la mesure où tant de personnes différentes s’y trouvent rassemblées. J’aime aussi les histoires où l’on voyage. Je les trouve plus fluides et plus intéressantes à écrire.
Page — Avec vous on découvre une ville très peu connue, on l’effleure comme si vous vouliez solliciter notre curiosité de venir la voir par nous-mêmes, qu’avez-vous envie de nous raconter de plus ?
B. T. — Karachi est une ville difficile, pour être honnête. Ce n’est pas l’endroit le plus facile à visiter pour un étranger. Il n’est pas évident de s’y repérer. On ne trouve même pas de cartes, ni les noms des rues. Il faut être initié pour pouvoir aller et venir dans cette ville. Dans notre monde de plus en plus globalisé, on s’emploie à rendre les choses plus faciles pour les étrangers (c’est-à-dire les touristes), parce qu’ils sont sources de profits, mais ce n’est pas le cas à Karachi. C’est aussi une ville difficile à aimer en raison de la criminalité et de l’insécurité croissante de ses rues : les vols à l’arrachée de portables, par exemple, sont courants. Ce sont des faits. Néanmoins c’est aussi un fait que pour 20 millions de personnes, cette ville est leur maison et, indépendamment de ce que le monde voit et pense de cet endroit, ils se lèvent et vont travailler le matin. Leurs destins sont liés à cette ville. Ils n’ont pas le luxe de penser qu’elle est condamnée. Ils continuent à y trouver le bonheur, des sources de plaisir, un sens de l’Histoire et de la communauté. Ils continuent d’élever leurs enfants avec les mêmes espoirs que n’importe quel parent dans le monde, malgré les difficultés et les épreuves. Ma tâche consiste simplement à leur donner voix.
Page — Dans le dernier chapitre de votre livre, vous nous faites rencontrer un curieux personnage, un homme-tronc au regard intensément lumineux, un peu prophète ou peut-être charlatan. Qui est cet homme, que symbolise-t-il ?
B. T. — En fait, ce personnage tient à la fois du saint et du charlatan. Je me suis gardé volontairement de ne pas trancher pour que le lecteur soit confronté à sa présence déroutante et qu’elle se révèle à lui. Selon moi, ce personnage exprime aussi en quelque sorte le thème central du livre que j’ai évoqué plus haut : le caractère insaisissable des choses, notre expérience, notre vision limitées que l’on doit essayer d’explorer et comprendre en construisant des histoires.