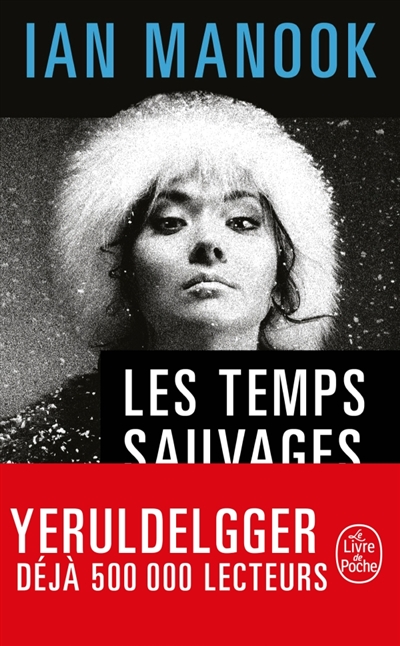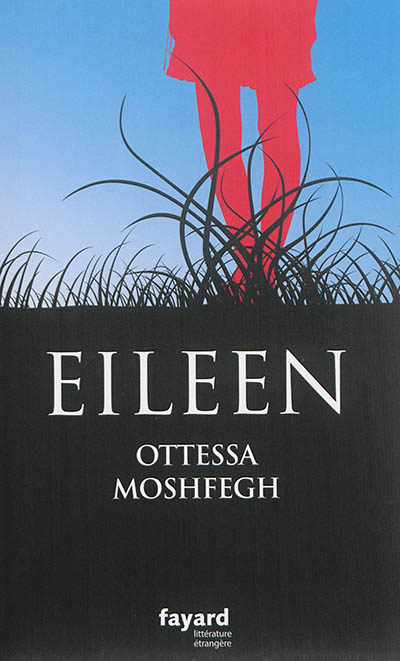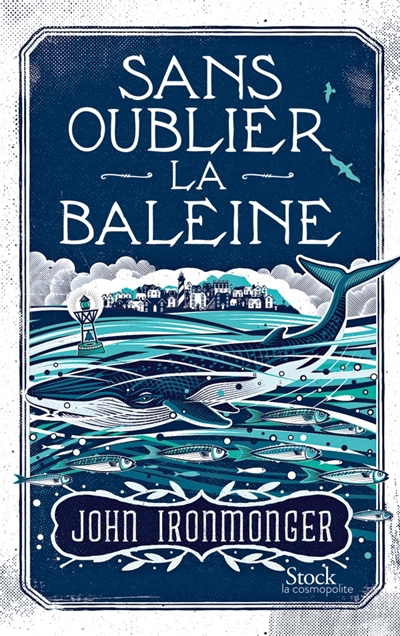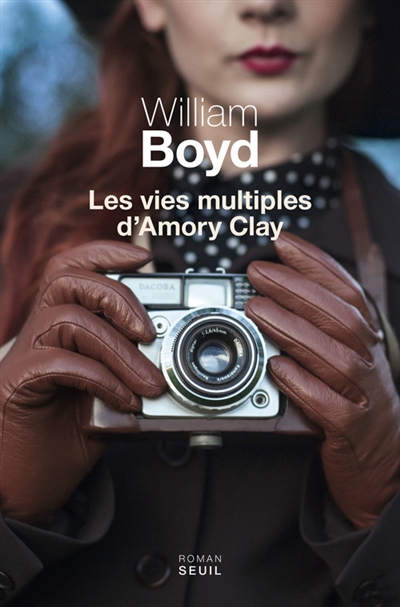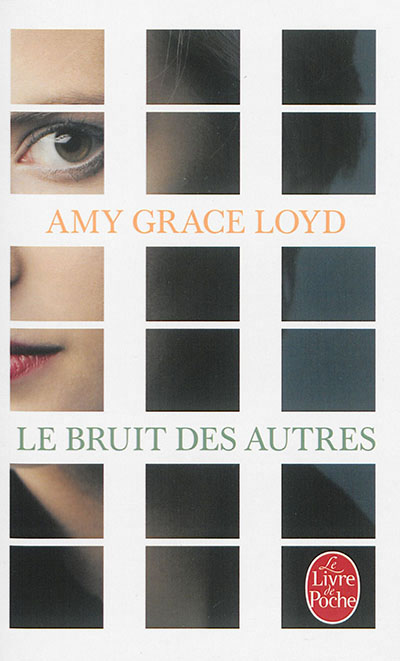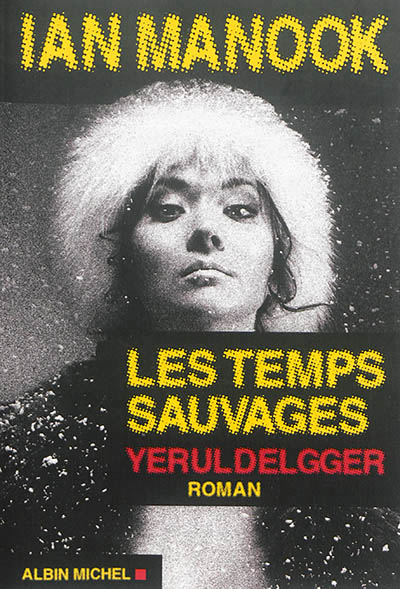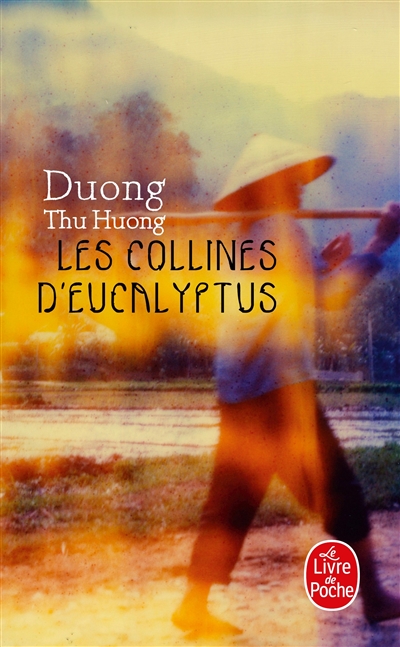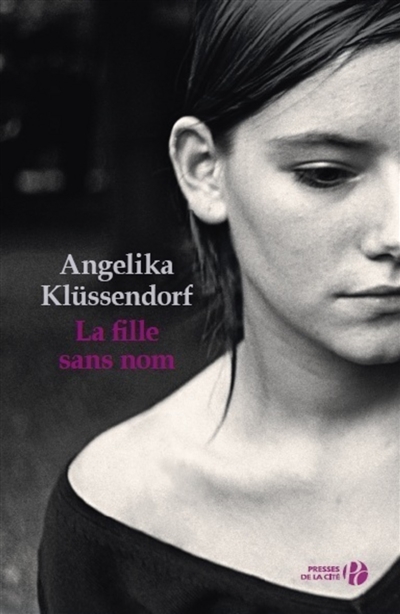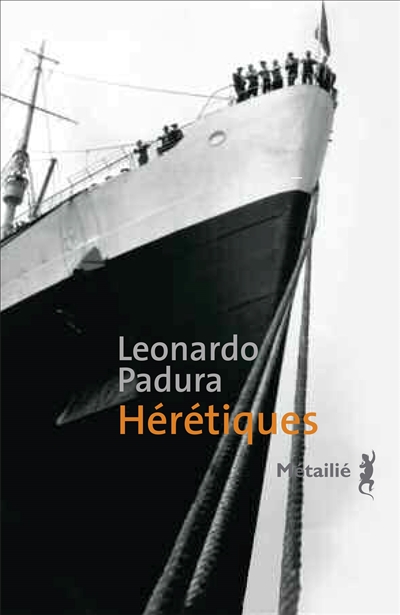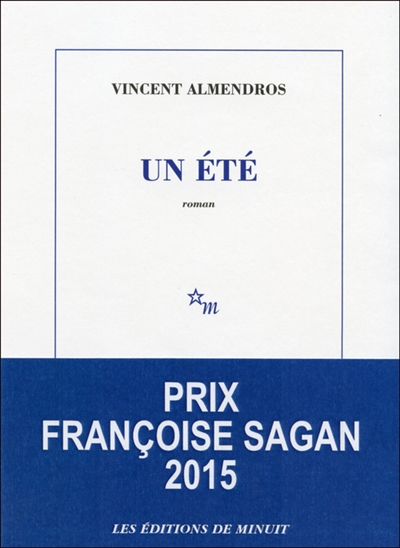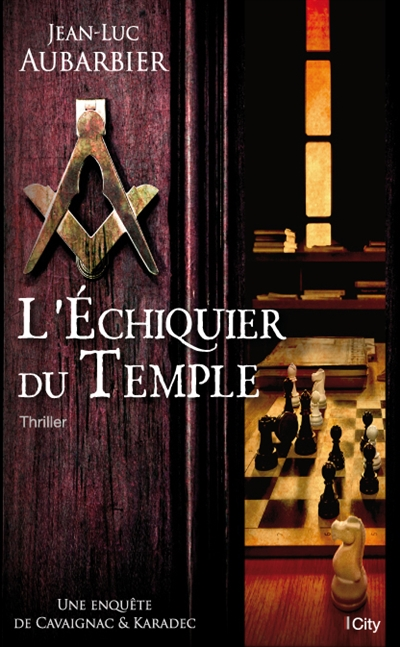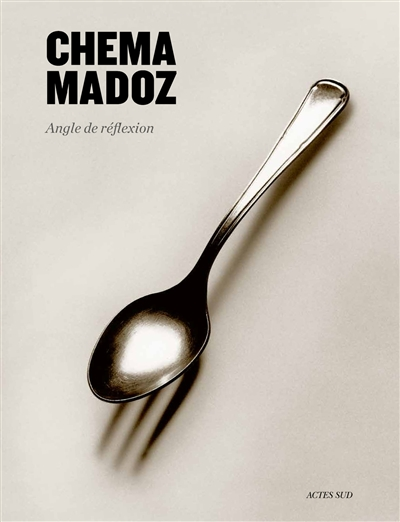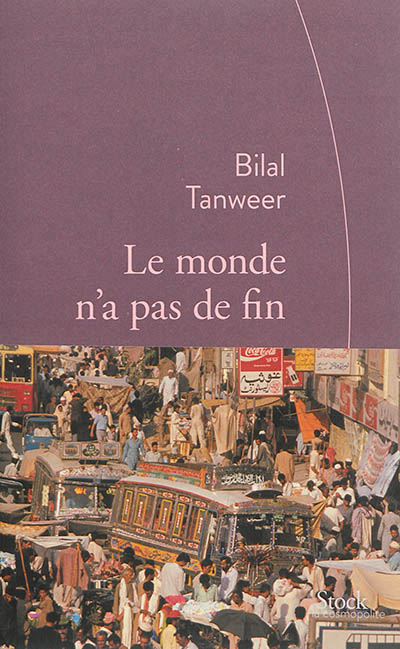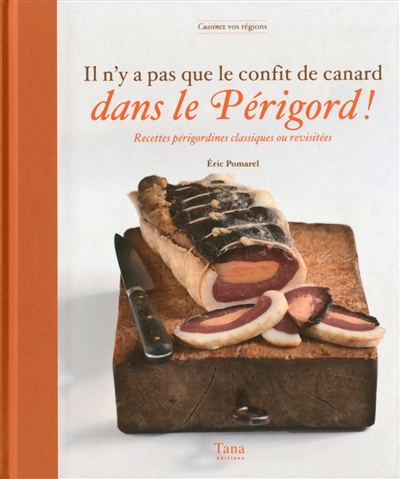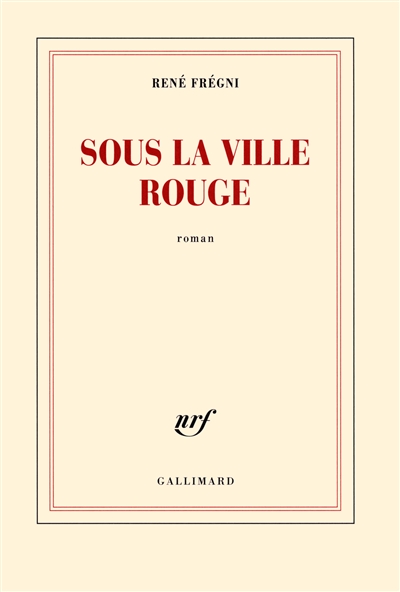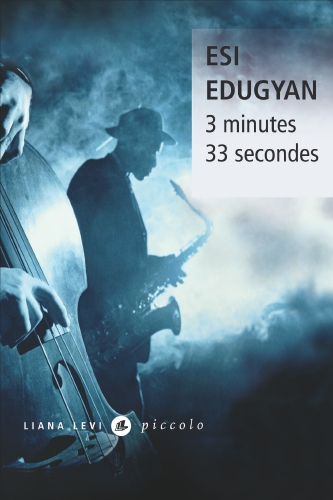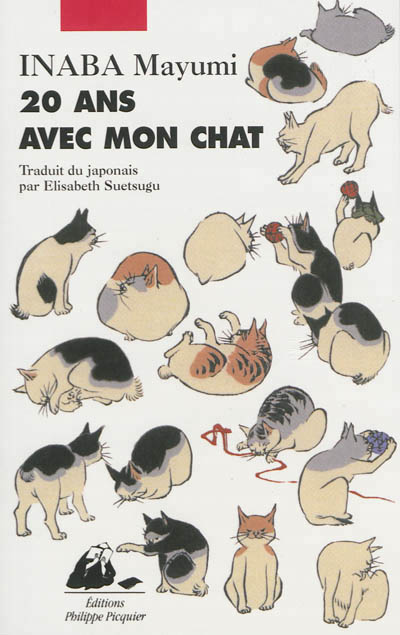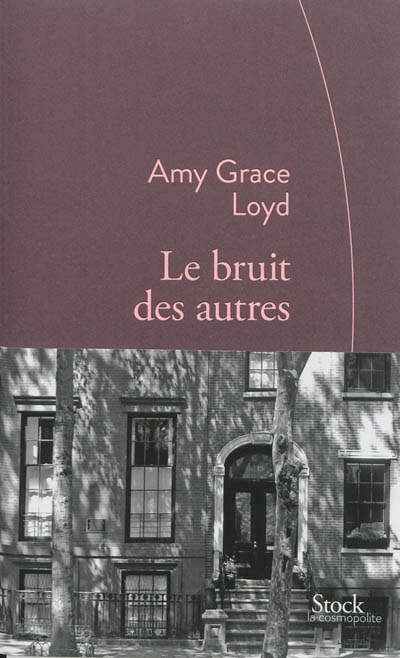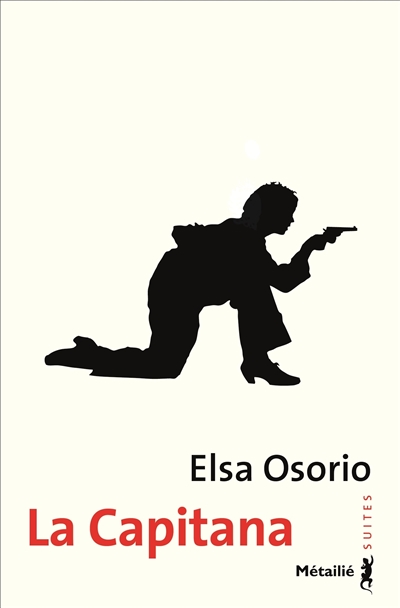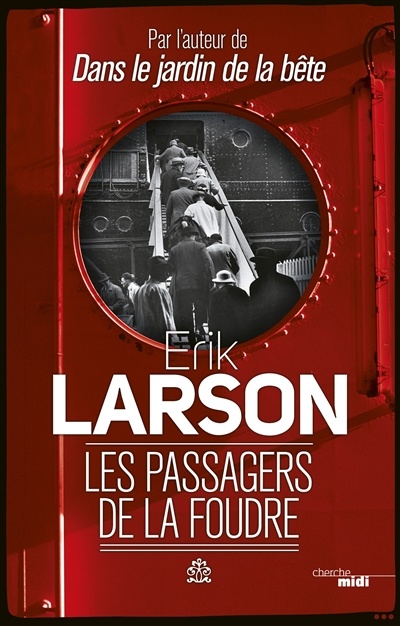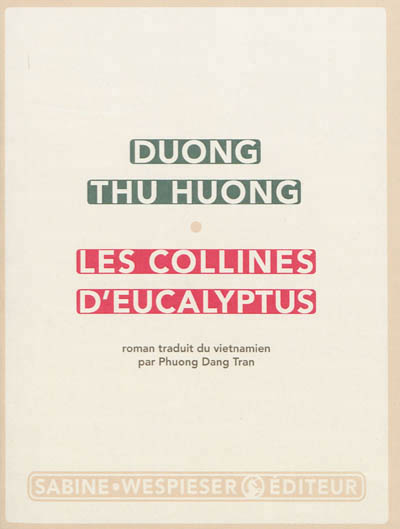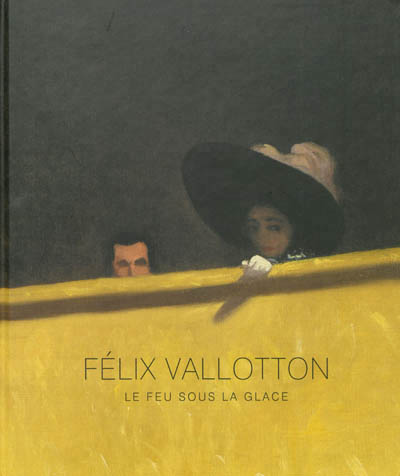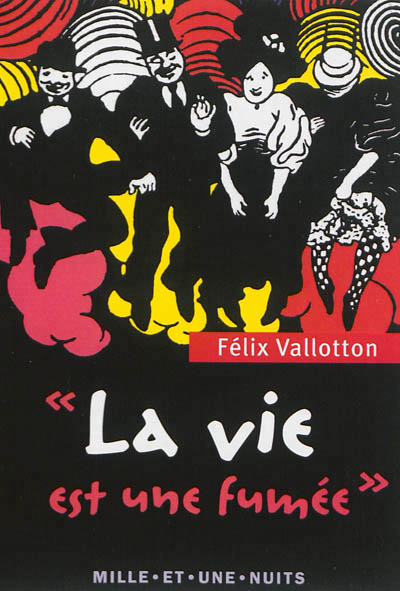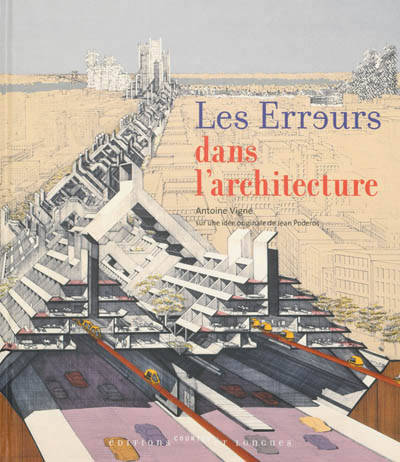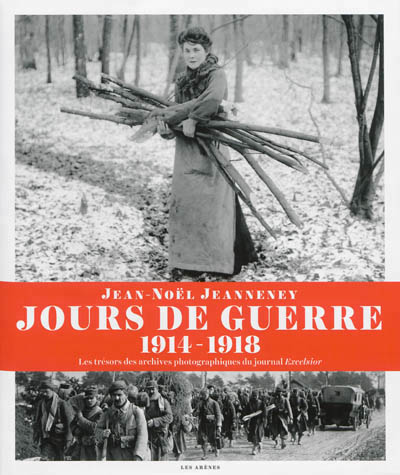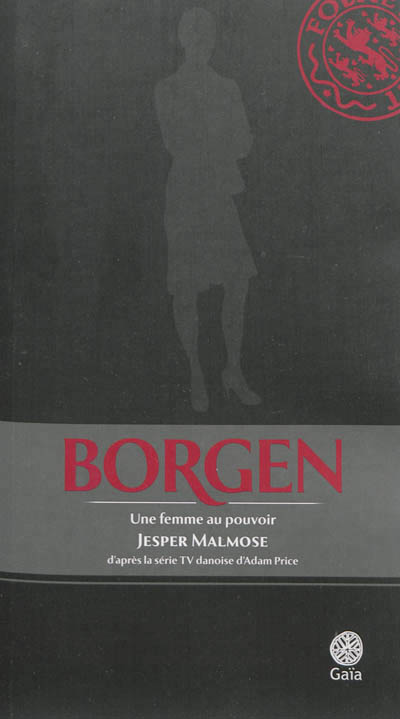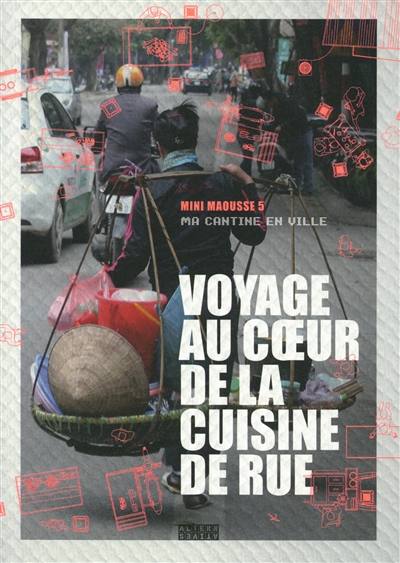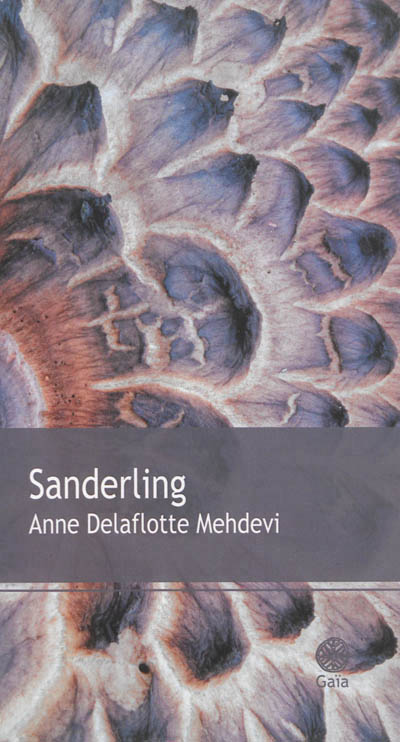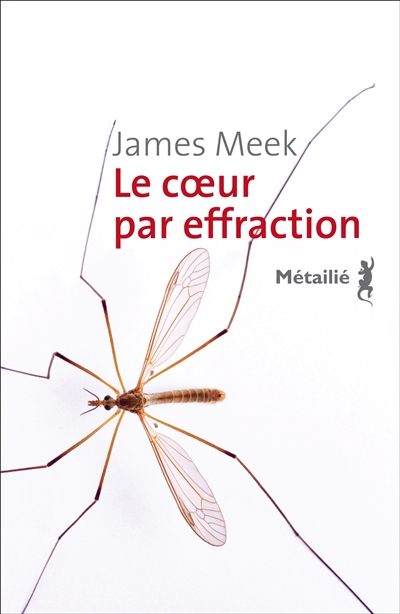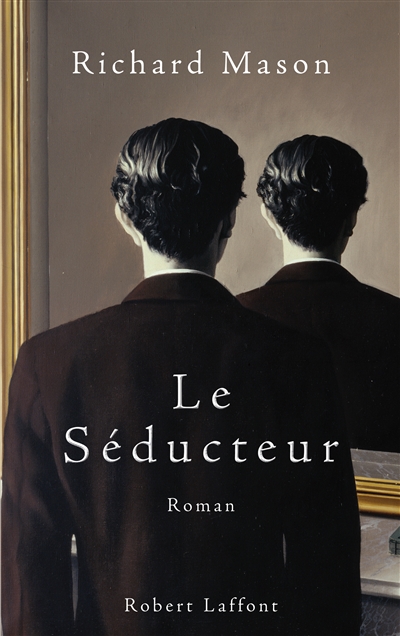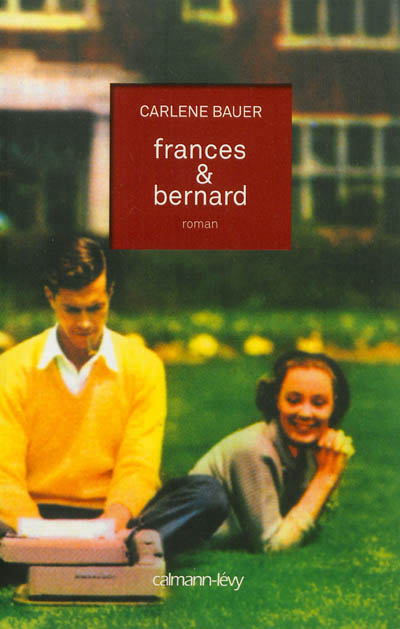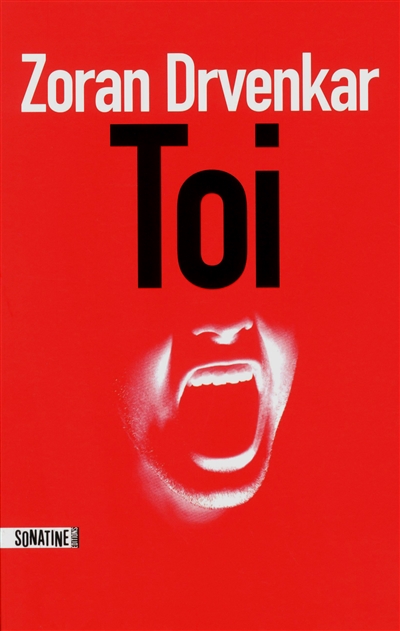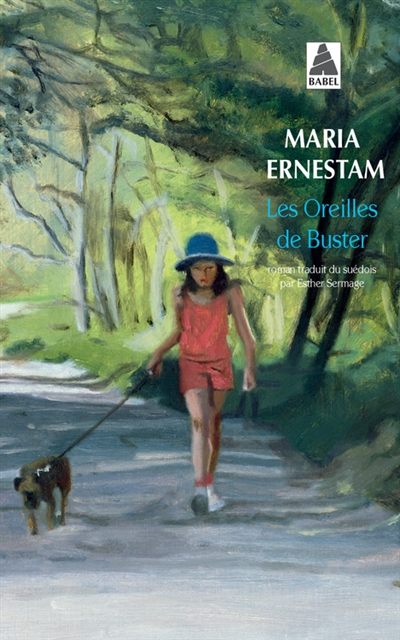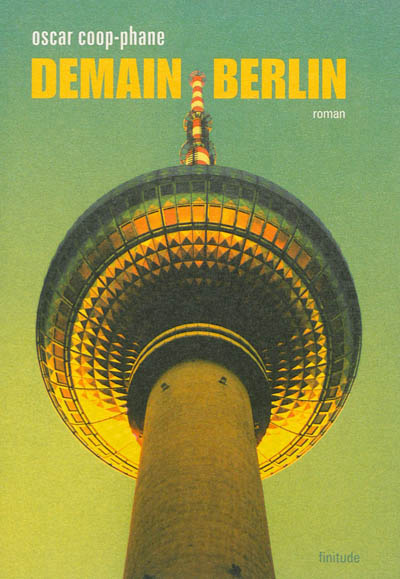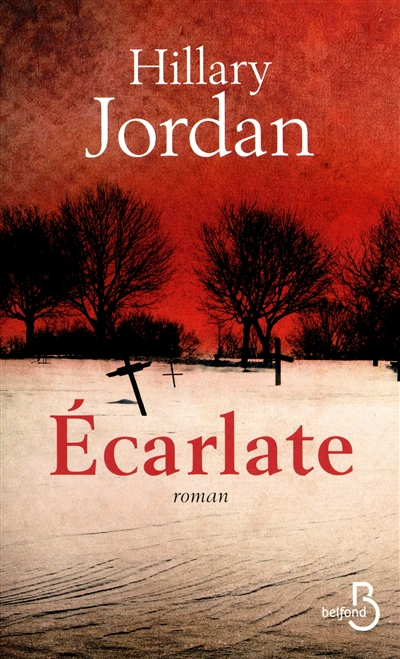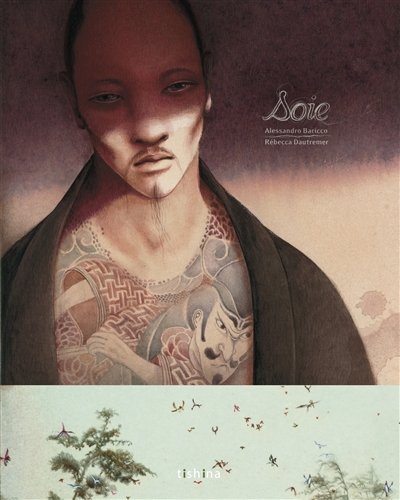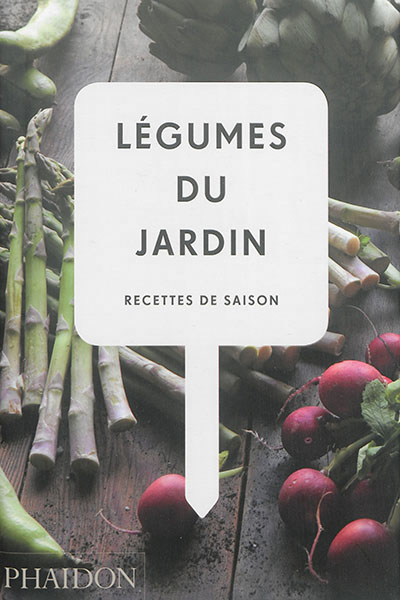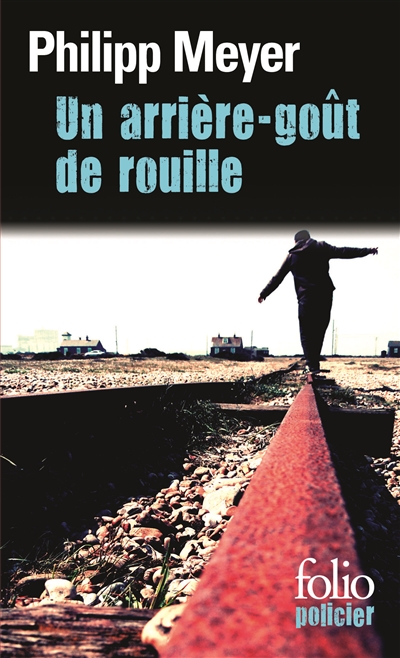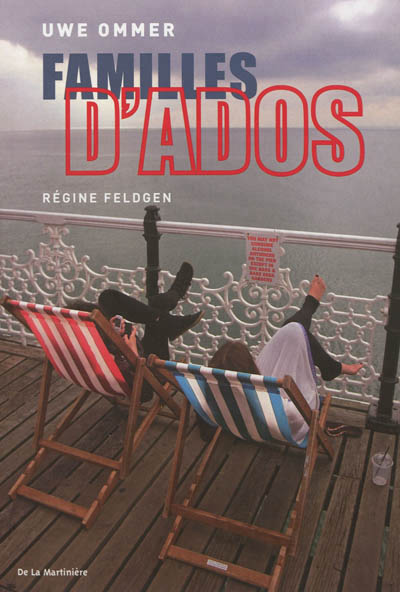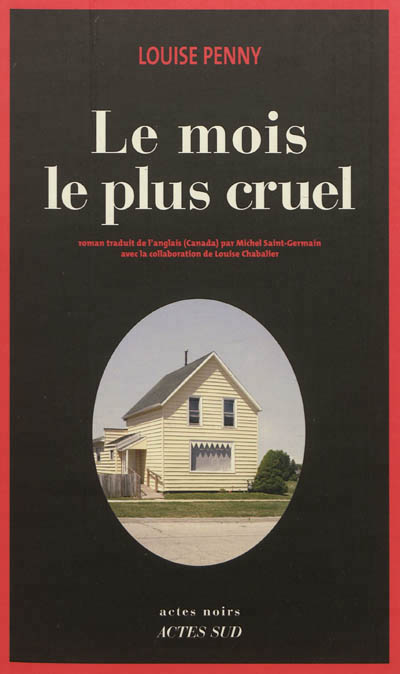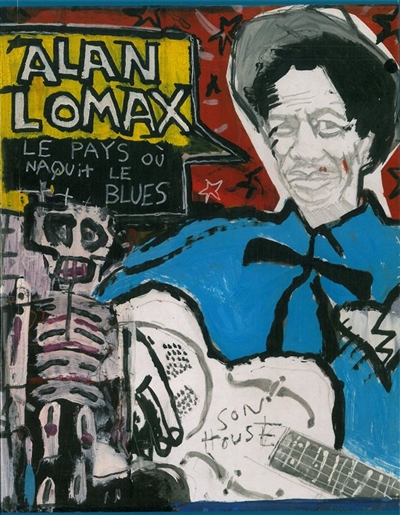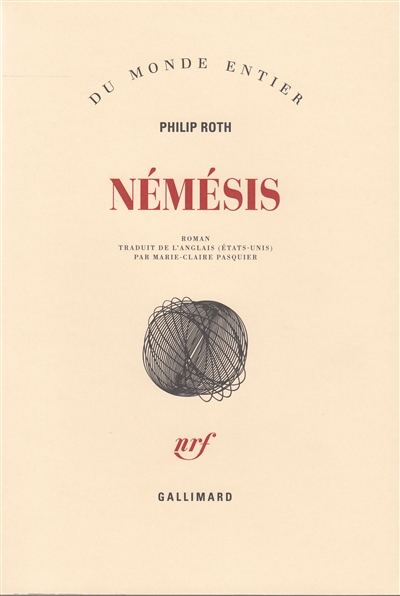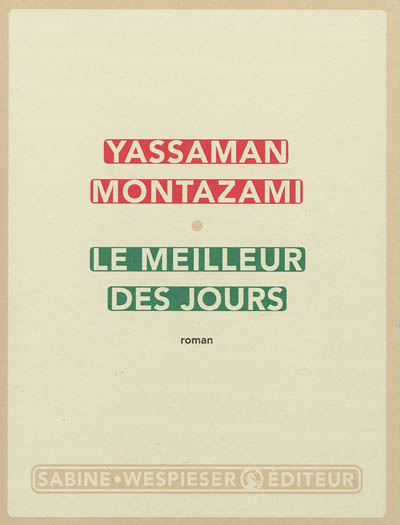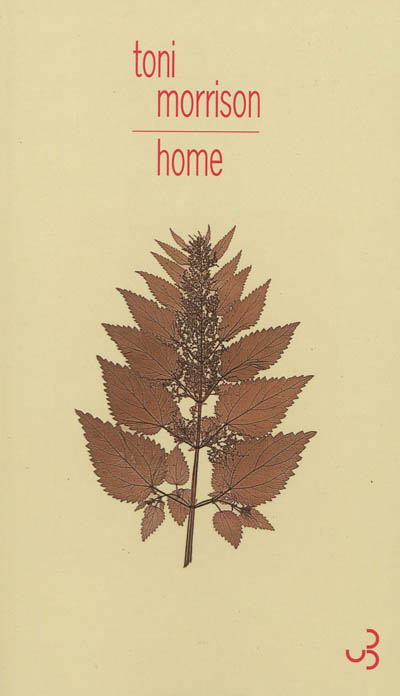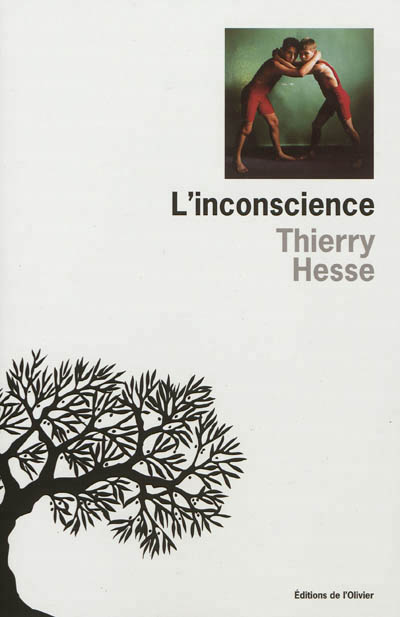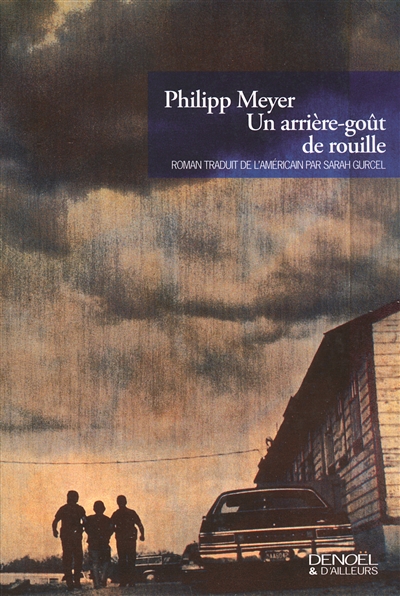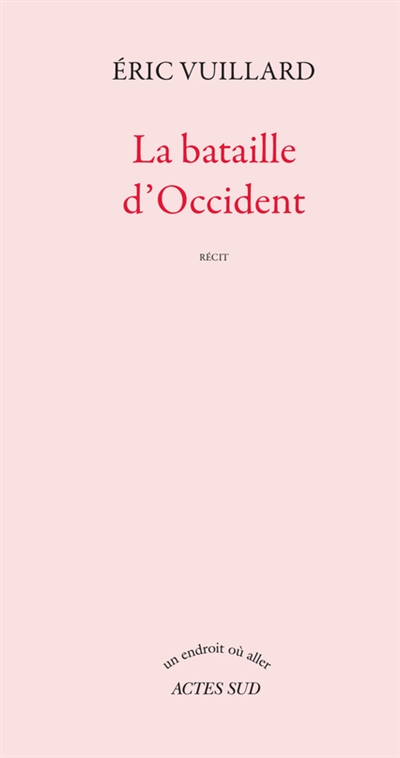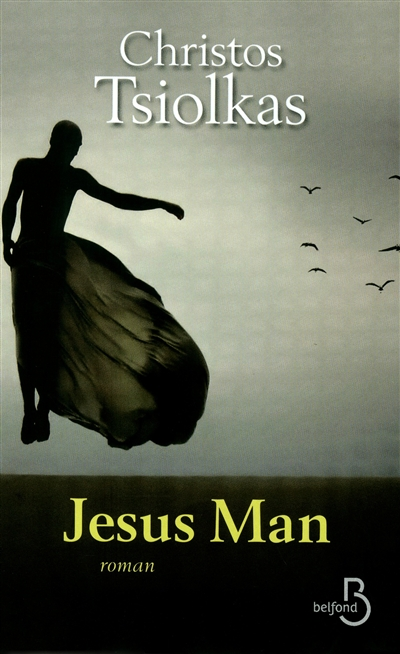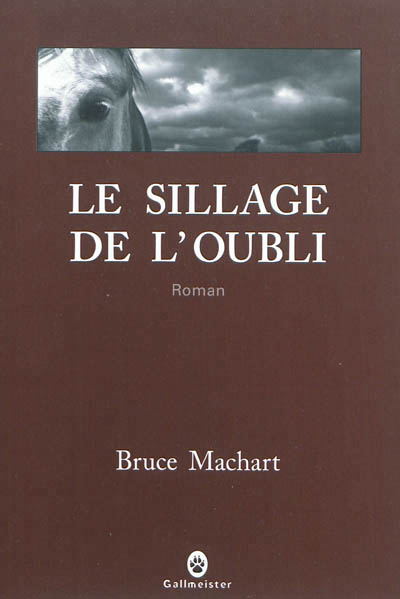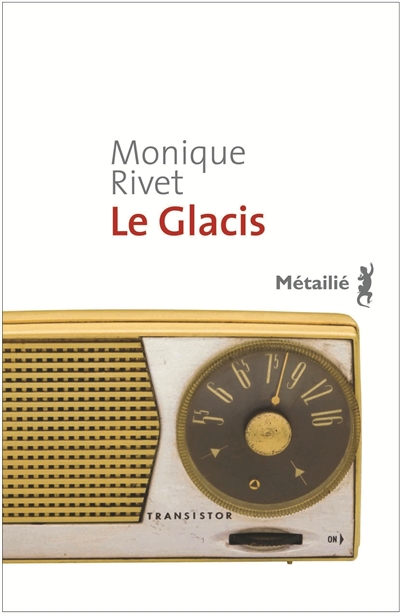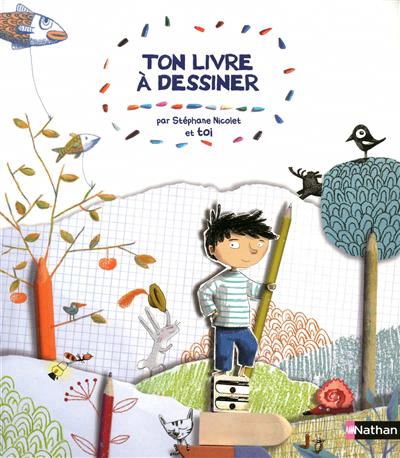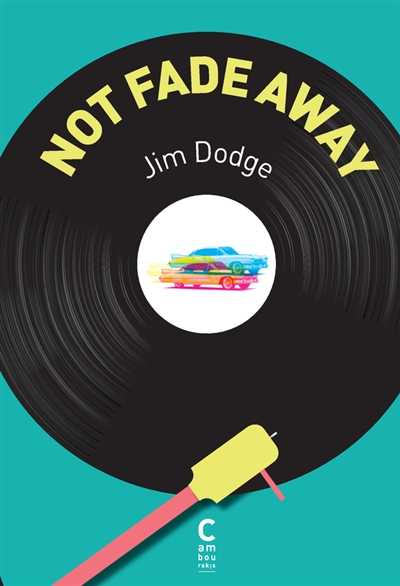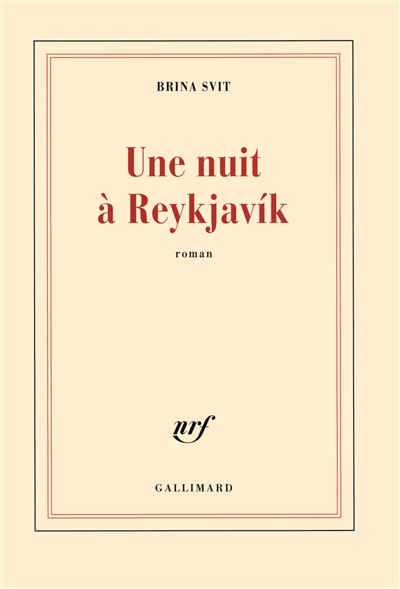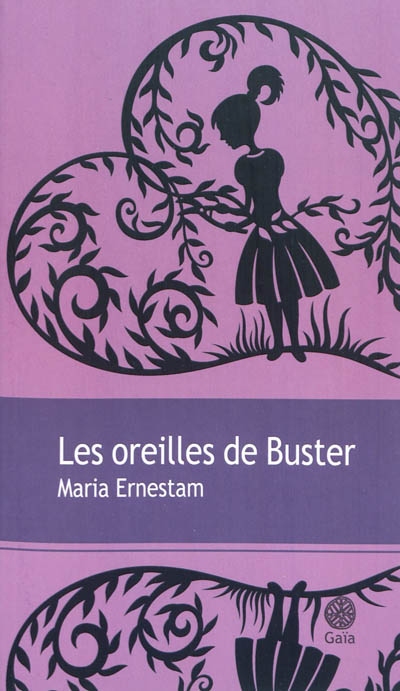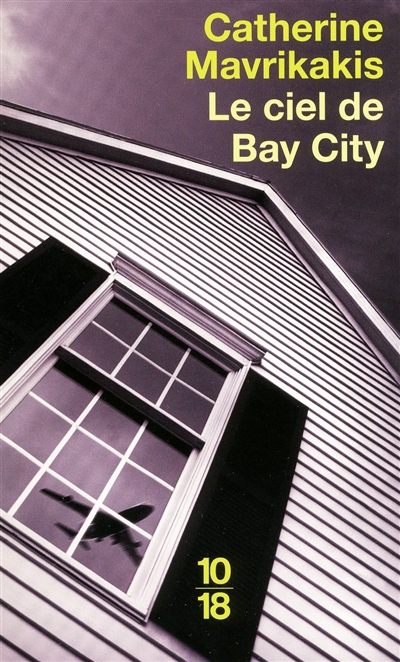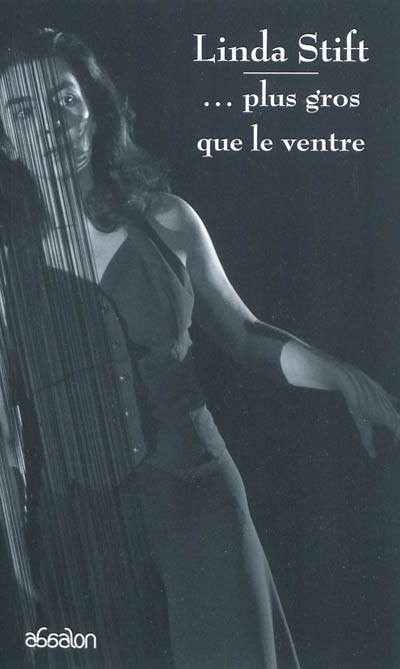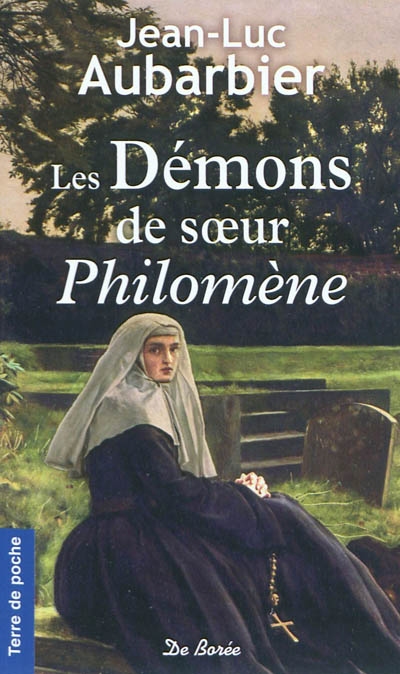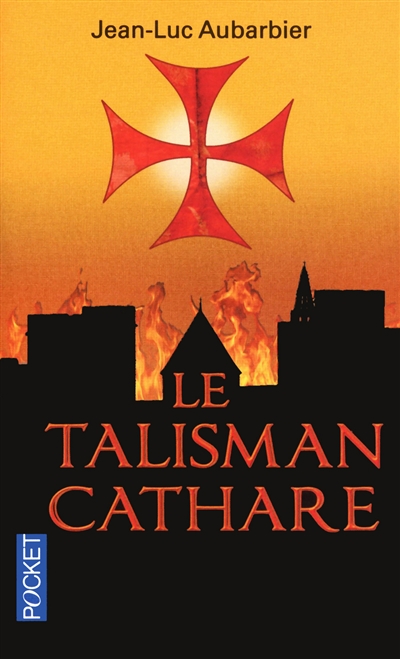Littérature française
Clara Dupont-Monod
Nestor rend les armes

-
Clara Dupont-Monod
Nestor rend les armes
Sabine Wespieser éditeur
25/08/2011
128 pages, 15 €
-
Chronique de
Coline Hugel
-
❤ Lu et conseillé par
4 libraire(s)
- Nathalie Vigne de Le Coin des livres (Davézieux)
- Dominique Paschal
- Guillaume Le Douarin
- Maïté Blatz de Le Roi livre (Paris)
✒ Coline Hugel
( , )
« Regardez comme je suis gros. Je marche voûté. Un pas, c’est une douleur qui grésille jusqu’en haut de ma cuisse. Je ne m’attarde jamais. Je dois laisser un endroit derrière moi, en rejoindre un autre que je n’aurai pas le temps d’apprivoiser. Je dois porter ce paquet énorme qui me ressemble. »
PAGE : « Il s’était levé la nuit pour engloutir du fromage ; il avait acheté les aliments par deux, puis par trois, changé sa garde-robe, ralenti ses pas. Il avait grossi comme on suit une feuille de route, heureux de constater qu’il était arrivé à destination. Il s’était enlaidi. Gros, balafré, ç’aurait été pareil. Sa chair avait obéi aux ordres, portait les stigmates comme autrefois on tatouait les voleurs. » J’ai beaucoup aimé Nestor rend les armes. Je n’avais pas lu votre précédent roman, La Passion selon Juette (Grasset, 2007), je m’y suis précipitée et j’ai retrouvé ces personnages hors du commun que vous semblez aimer. Juette est hors normes par sa grande beauté, par sa force de caractère aussi. Le Nestor de ce roman s’oppose exactement à la Juette du précédent. Quand l’un se distingue par sa monstruosité, l’autre se remarque par sa beauté. Handicapé par son poids, Nestor est un être monstrueux, mais ce qui le rapproche de Juette, c’est sa force de caractère, une force d’autant plus incroyable que, comme le laisse entendre le passage que je viens de lire, il est le démiurge de sa propre monstruosité.
Clara Dupont-Monod : Alors monstruosité… Vous êtes sûre ? Il est gros, je reconnais. Ce qui m’intéresse, je m’en rends compte maintenant au fur et à mesure de mes livres, c’est la marge. Mon premier texte par exemple, Eova Luciole (Grasset, 1998), racontait l’histoire d’une petite fille qui se réveille un matin dotée d’ailes dans le dos. La différence et la marge sont là, immédiatement patentes, car elle est mise au ban de sa communauté villageoise. Dans La Folie du roi Marc (Grasset, 2000), je me penchais sur la marge littéraire. En reprenant le mythe de Tristan et Yseult, en me mettant à la place de celui que tout le monde a soigneusement occulté, le roi Marc, mari bafoué d’Yseult, je voulais faire ressortir une autre marge. Tout le monde connaît Tristan et Yseult, mais le roi Marc, qui lui n’a pas bu de philtre d’amour et aime sa femme de façon spontanée et naturelle, a été condamné aux marges par la postérité. Ensuite, il y a eu Histoire d’une prostituée (Grasset, 2003), qui s’inscrivait dans un réel très ancré et auscultait la marge sociale par le biais d’un texte à mi-chemin du journalisme et du roman. Avec Nestor rend les armes, je n’ai jamais affronté la marge aussi frontalement, car finalement, personne n’affirme plus violemment sa différence qu’un gros. Un gros ne peut faire autrement que d’être remarqué. Il est là, sa présence, ses 130 kilos n’échappent à personne. Je me suis demandée ce que le fait d’être une grosse personne pouvait signifier, ce qu’est un quotidien au sein duquel le corps se rappelle constamment à vous ; qu’est-ce qu’être ramené irrépressiblement à son corps… ? Un sentiment infernal, c’est une prison. En même temps, dans le cas de Nestor, le poids isole dans les deux sens du terme. Car s’il sépare, il protège également, la grosseur rassure et réchauffe. Nestor ne se contente pas d’être gros, il est aussi seul dans un monde où on enjoint en permanence les gens à demeurer bien portant, à rester connecté. Dans ces conditions, c’est sûr, mon Nestor détonne. Il ne possède ni téléphone ni ordinateur, rend chaque jour visite à sa femme alitée dans un hôpital – on comprend pourquoi en avançant dans le récit –, et on apprend qu’il a été frappé par un drame à la suite duquel il a décidé de s’auto-punir. Il accepte son poids, effectivement monstrueux, avec la même résignation que lorsqu’il lui a bien fallu accepter les coups du sort qui l’ont contraint à quitter son pays et ont conduit sa femme dans une chambre d’hôpital. Au-delà de cette expérience de la résignation, je me suis décidément attachée à creuser la notion de marge. Ce matin, j’ai noué sans difficulté les sangles de mes chaussures. Si je pesais 130 kilos, je n’aurais pas pu le faire. Quand vous pesez 130 kilos, monter dans un bus est une entreprise compliquée. D’abord, il est exclu de courir après pour le rattraper si vous êtes pressé, ensuite, s’asseoir, circuler à l’intérieur vous exposera inévitablement aux regards peu amènes des autres passagers, etc. Le regard des autres vous ramène incessamment à votre apparence… Eh bien ces diverses expériences de la solitude et des marges me passionnent. Par ailleurs, je me rends compte qu’il existe deux catégories d’écrivains : ceux qui puisent dans leur vécu pour écrire des livres, et ceux qui recourent à leurs carences. Je crois que j’appartiens à la seconde catégorie. C’est parce que je ne suis pas obèse que je parviens à dresser le portrait d’un obèse. De la même façon – j’en ai parlé tout à l’heure –, si j’ai pu imaginer un personnage qui a détesté être mère, c’est vraisemblablement parce que j’ai, moi, adoré l’être. Je peux dresser un constat similaire au sujet de mon personnage de prostituée. Et c’est parce que je ne suis pas un homme amoureux d’une femme qui ne m’aime pas, que je peux décrire le roi Marc. Du coup, j’ai le sentiment que la littérature ne se conçoit que comme la réversibilité de l’existence. Je m’engouffre systématiquement dans cette possibilité offerte à l’écrivain d’explorer un champ qui, par définition, lui est interdit.
P. : Vous rendez avec beaucoup de réussite le sentiment qu’inspire à ces personnages condamnés aux marges le regard porté sur eux par autrui. On a l’impression que vous comprenez réellement la réception du regard des autres sur ces « monstres ».
C. D.-M. : Merci, c’est un beau compliment. Je trouve très importante l’idée de différence. Il existe à l’intérieur de chacun de nous un double boiteux. Je ne crois pas à l’idée d’intégrité absolue. Au fond de nous se niche une créature, souvent issue de l’enfance, qui doute, boitille, dont la voix intérieure lance des « T’es nul », « Tu y arriveras jamais », « Ça va pas », etc. Quand j’investis un personnage, j’adore me dire que c’est une manière de répondre à cette créature boiteuse cachée dans mes tréfonds. Et je pense que la littérature sert à ça : donner à quelque chose la possibilité de s’exprimer, une chose qui, en temps normal, serait forcée de se dissimuler à cause de sa repoussante laideur, et serait de ce fait contrainte au silence.
P. : Vous avez donc créé un personnage très étonnant qui aurait pu être le dernier des paumés. Or, c’est tout l’inverse. La complexité de Nestor se situe dans son intelligence, son statut d’exilé et son savoir – il est médecin – et aussi dans l’histoire d’amour totalement improbable qu’il va nouer avec le médecin qui tente de soigner son épouse. Je voudrais vous lire un second extrait qui m’a, lui aussi, beaucoup marquée. Elle est en train de passer une espèce de nuit d’amour avec Nestor. « Qu’une telle sécurité puisse émerger avec Nestor, un écart à lui seul, une colossale embardée, relevait du prodige. La normalité rassurante n’était jamais là où on l’attendait. » Est-ce que cette nuit d’amour est réellement une nuit d’amour ? N’est-elle pas le résultat d’une forme d’attirance morbide ?
C. D.-M. : Écoutez non, je ne crois pas. Il s’agit de la rencontre de deux solitudes. On ne sait pas grand-chose de ce médecin. On sait simplement que la détresse de Nestor crée un écho à l’intérieur d’elle-même… Je laisse volontairement dans le flou la nature de cet écho. J’aime l’idée de maintenir les personnages dans leurs mystères et leurs ambiguïtés. Il était tentant de donner à Nestor une enfance et une adolescence, de même que de fournir un passé à Alice, le médecin. Pourtant, les relations du Petit Chaperon rouge avec sa mère, je m’en fous, l’adolescence du Petit Poucet aussi. J’ai adoré cueillir les personnages dans leurs mystères, à la manière d’un conte, et ces instants suspendus dans le temps. Ce que ressent Alice quand elle rencontre Nestor tient de la neutralisation du jugement. Il est tellement encombré par son corps, tellement seul, que lui aussi se situe au-delà de tout jugement à l’égard d’autrui. Si on le juge en permanence sur son apparence, lui ne juge jamais. Alice boite à cause de son passé, et quelqu’un vient qui la prend comme elle est… Alice est terrorisée par les autres. Elle est un brillant médecin, mais les autres l’effraient. Lorsqu’elle sait qu’elle risque de se retrouver seule avec quelqu’un, elle prend son carnet sur lequel elle prépare des sujets de conversations qui lui permettront de ne jamais se trouver démunie ; les pages de son cahier sont couvertes de colonnes aux allures d’aphorismes comme : « Psychiatrie moderne », « Gauche moderne = droite », « Échec de l’Europe »… Après sa rencontre avec Nestor, elle jette son carnet. Au nom de quoi Nestor constituerait-il une menace ? Il est déjà pour lui-même une menace. J’ai appelé mon roman Nestor rend les armes, mais ça aurait tout aussi bien pu être « Alice rend les armes ». À un moment, on décide de rendre les armes – ce qui est aussi la définition de l’amour : vous décidez d’ôter votre armure, d’avancer sans précaution malgré le peu d’attrait que risque de révéler ce que vous décidez de dévoiler. Il me semble que c’est le sel de la vie. Indépendamment du sexe. Mes deux personnages ne couchent pas ensemble. Leur relation amoureuse prend sa source ailleurs, dans la rencontre de deux chagrins. Mais l’amour n’est-il pas aussi cela ? N’est-ce pas une mémoire perforée qui s’adresse à une autre mémoire perforée ? Est-ce que ce ne sont pas deux histoires de chagrins qui se reconnaissent et se répondent ? Il y a également autre chose de plus personnel, qui a trait à mon histoire. La normalité rassurante dont vous parliez me renvoie à mon expérience. J’ai eu un petit frère handicapé et je conserve un souvenir très net, d’abord du regard des autres, ensuite de cette espèce de paix absolue que vous éprouvez vis-à-vis de quelqu’un d’« abîmé », qui ne parle pas, ne bouge pas, dont il faut s’occuper comme d’un bébé. Vous êtes un peu comme Alice avec Nestor, dans une sorte de para-relation, nullement langagière parce que la personne ne parle pas – il grogne –, ni gestuelle parce que Nestor n’est capable d’aucun geste – sauf celui de dresser sa table et de manger jusqu’au bord de l’éclatement… La relation revêt une pureté absolue. Lorsque vous discutez avec des personnes qui s’occupent d’handicapés, cette notion de pureté émerge toujours à un moment ou à un autre de la conversation. Cette pureté du lien absolument débarrassée de l’idée de jugement, du qu’en dira-t-on, de la peur du regard que l’on offre, je trouve ça somptueux. Notre société rejette de plus en plus la différence, elle s’efforce de la cacher, elle voudrait laisser entendre qu’il est inutile de tendre l’oreille, de regarder, d’aimer… Or c’est justement parce que je suis différente, que je me situe en dehors du jugement, que je suis capable d’aimer.