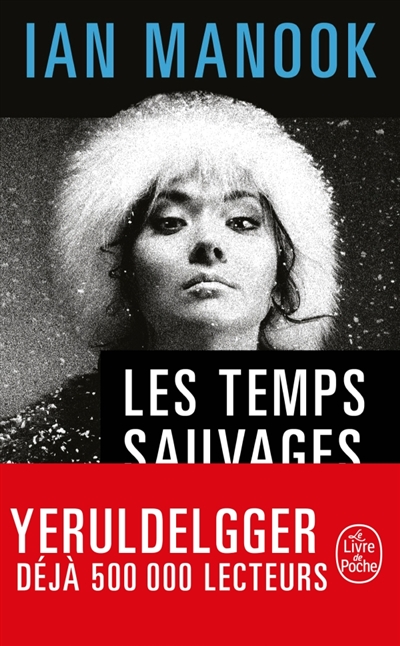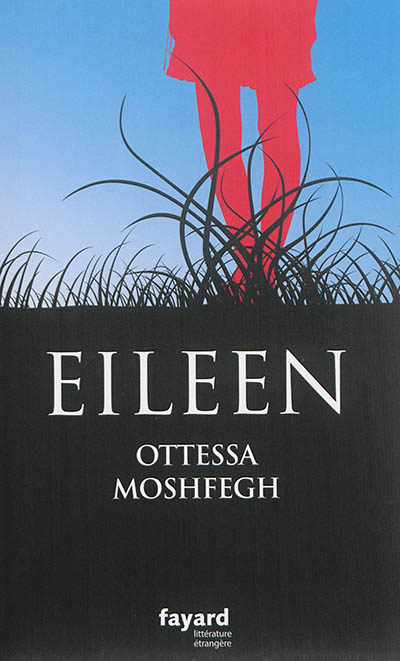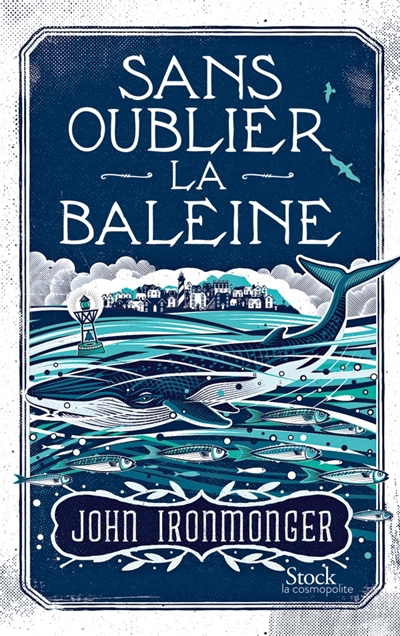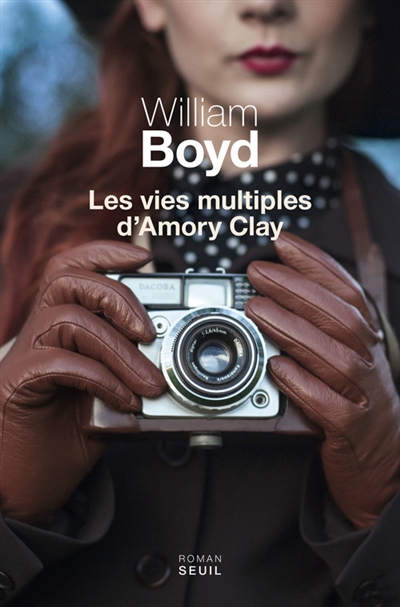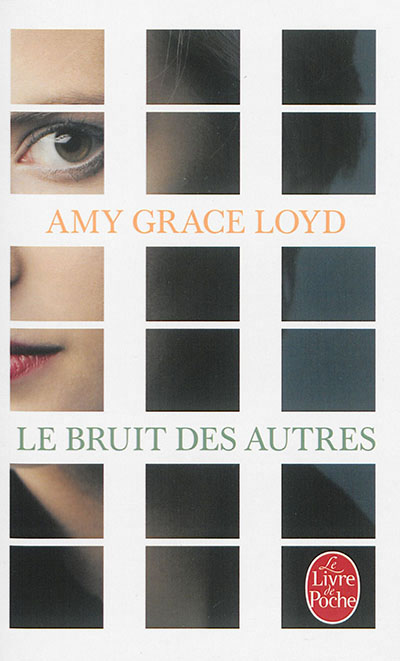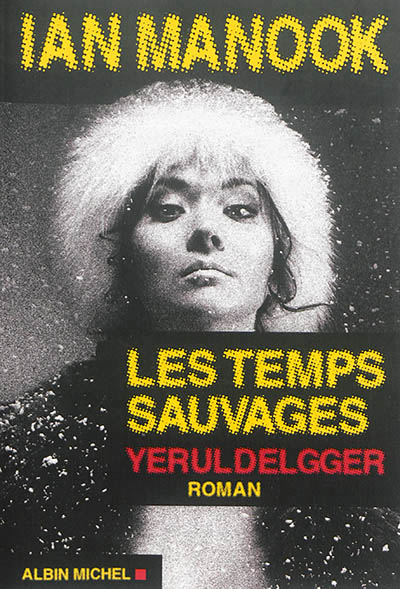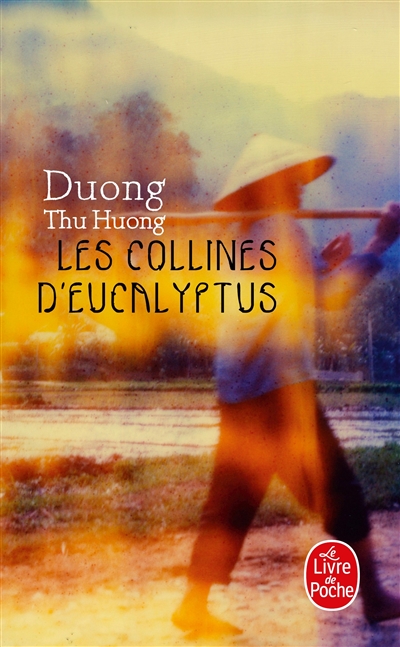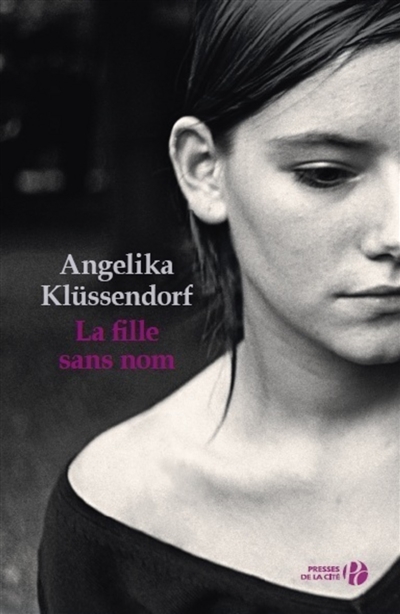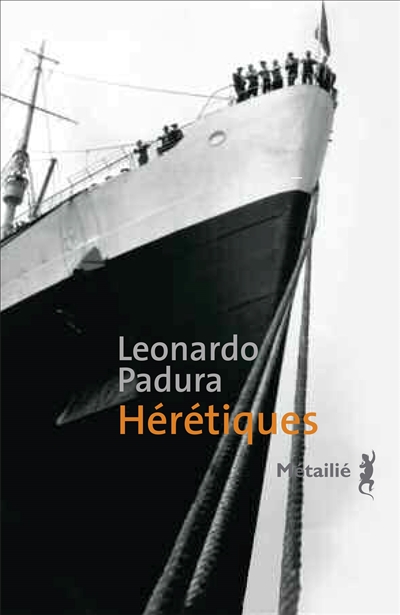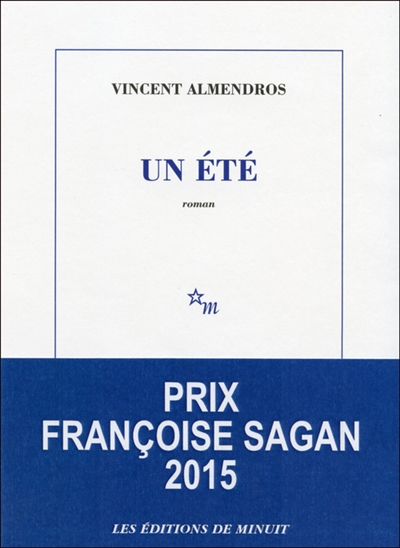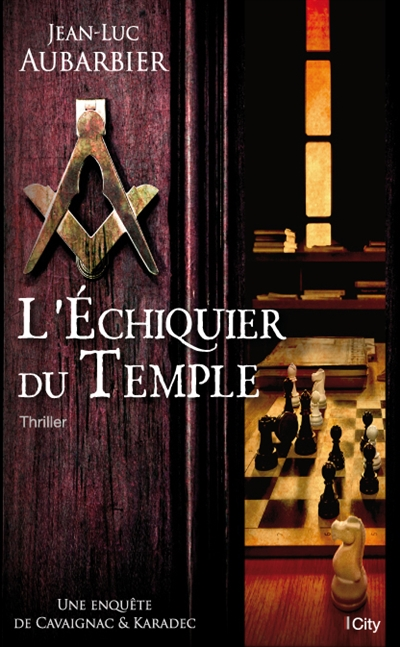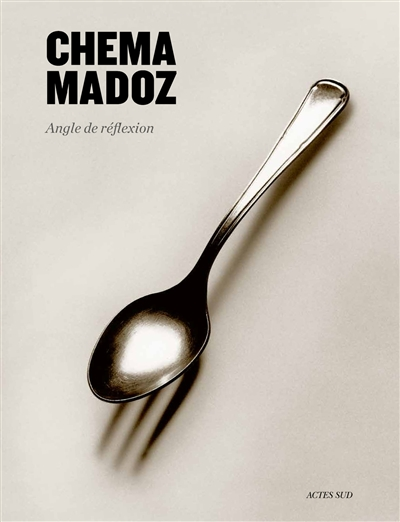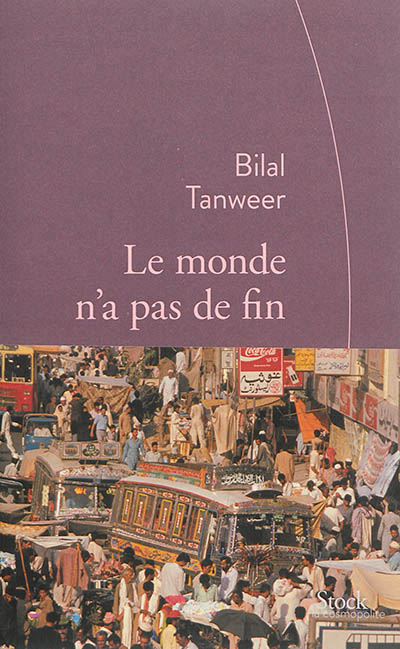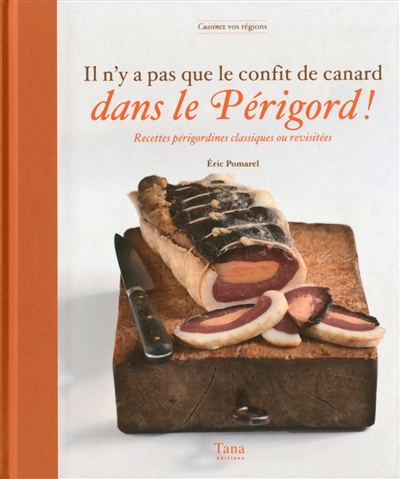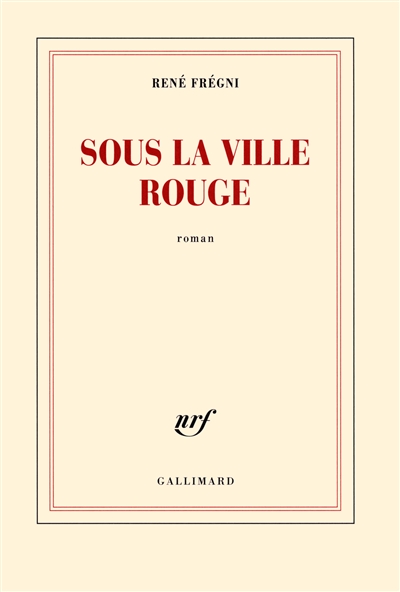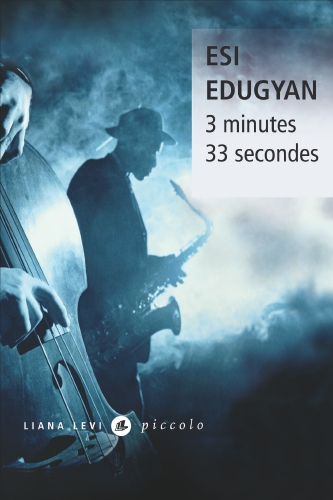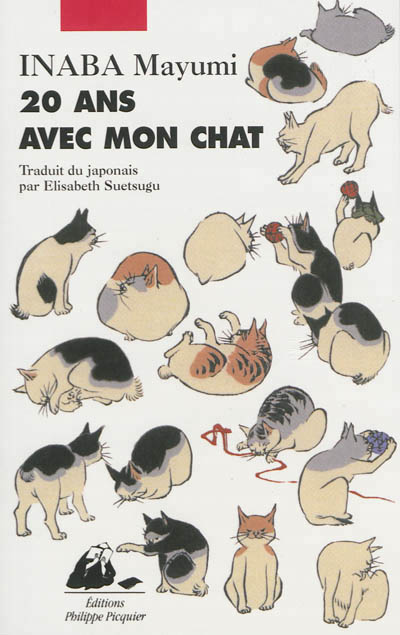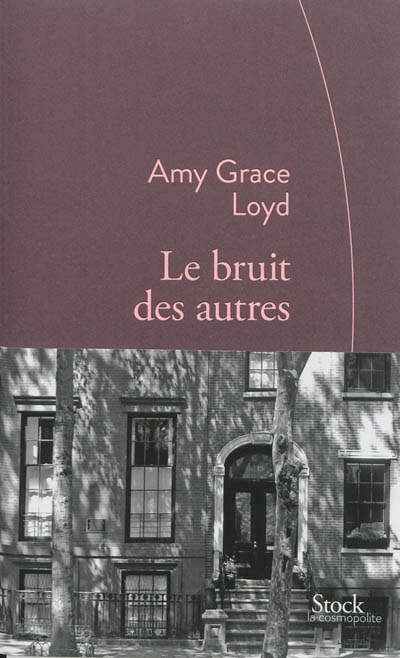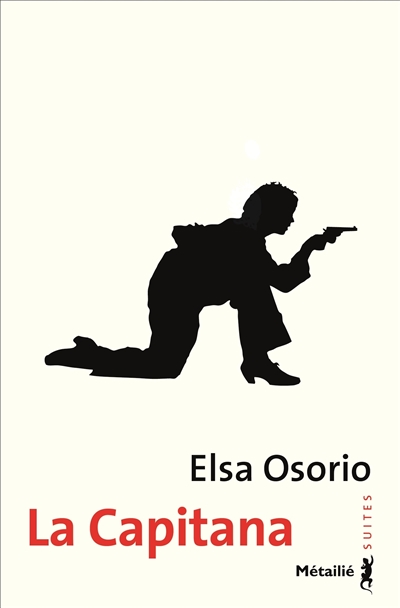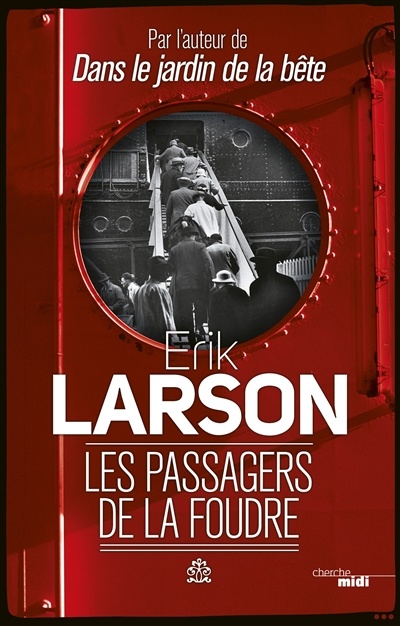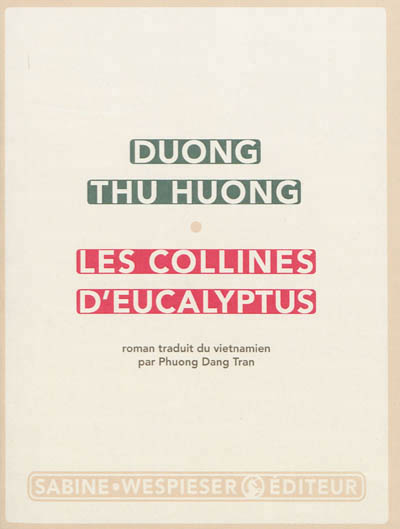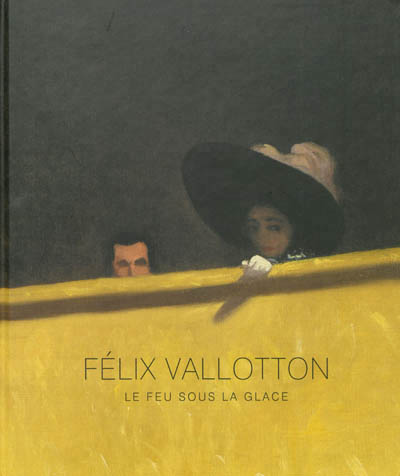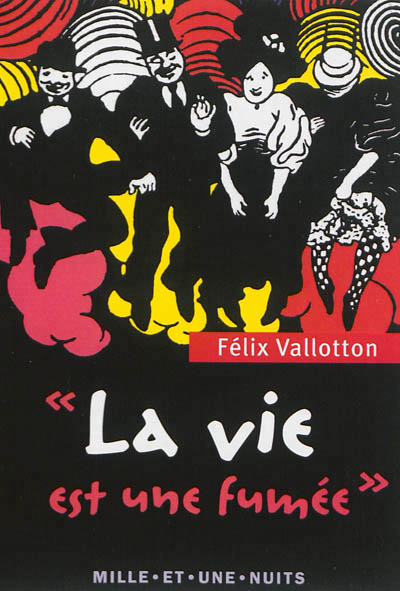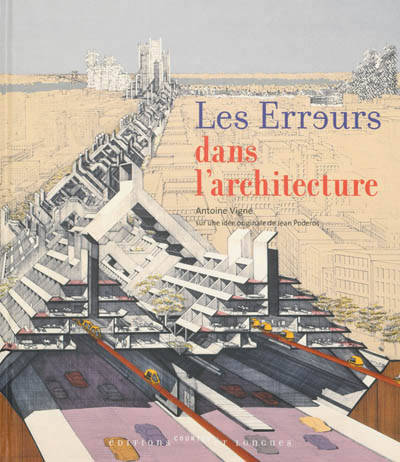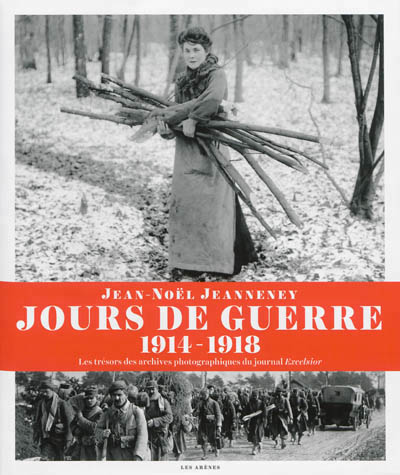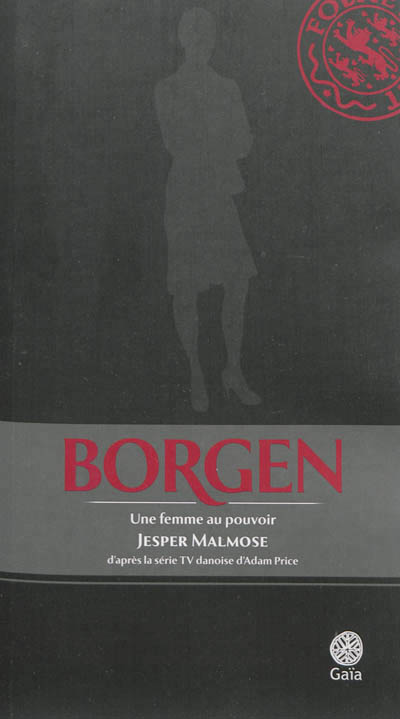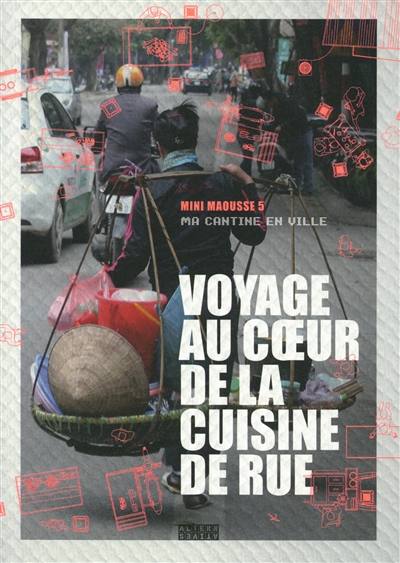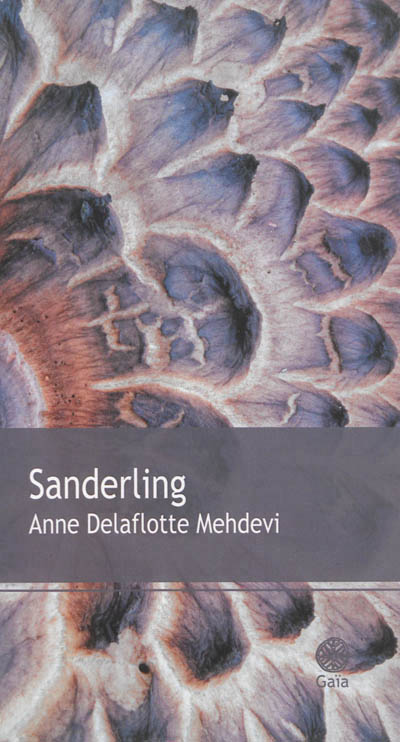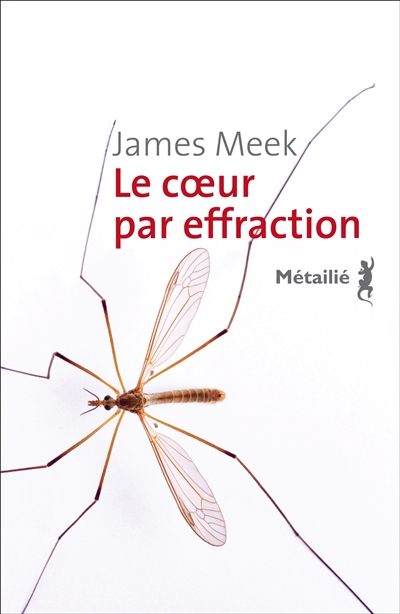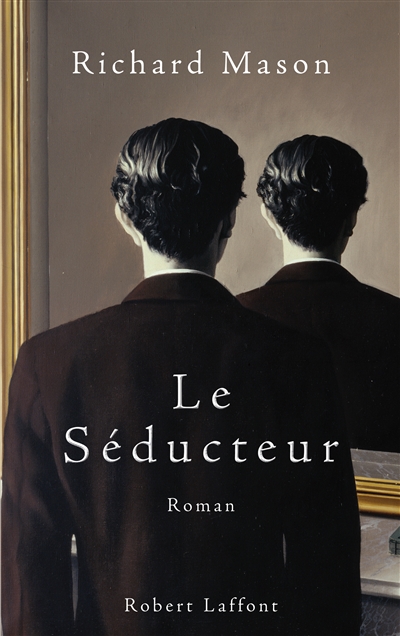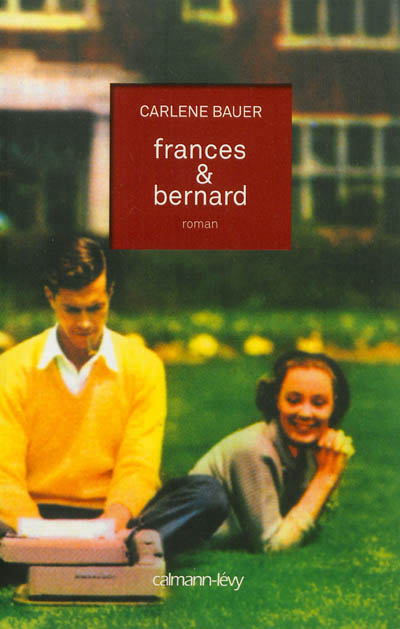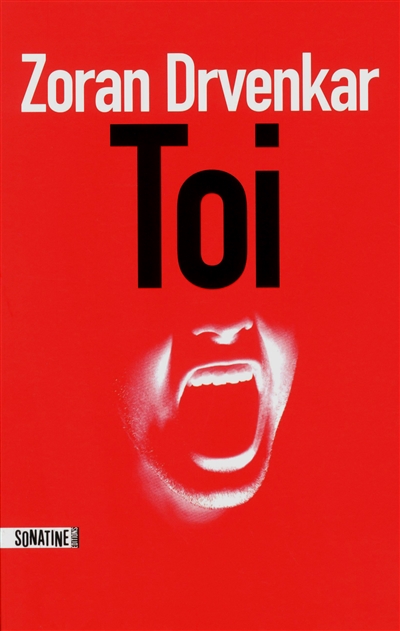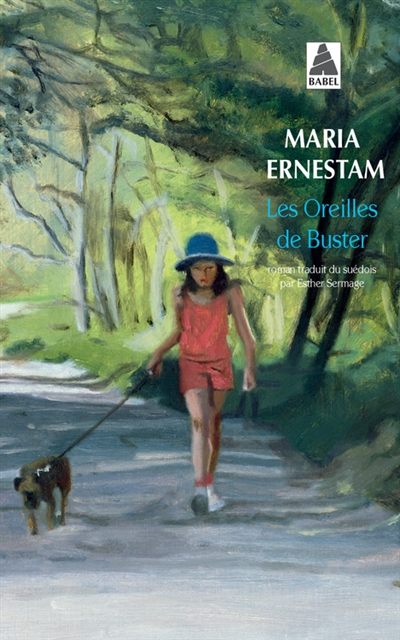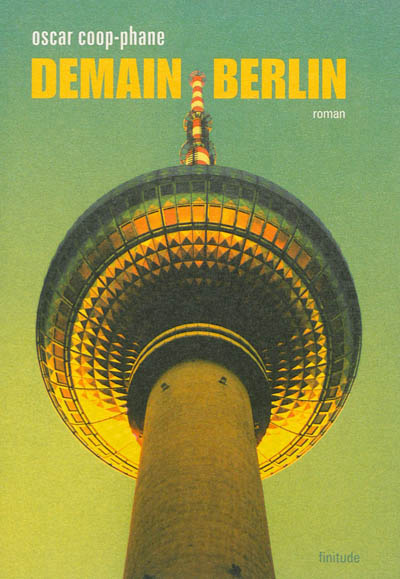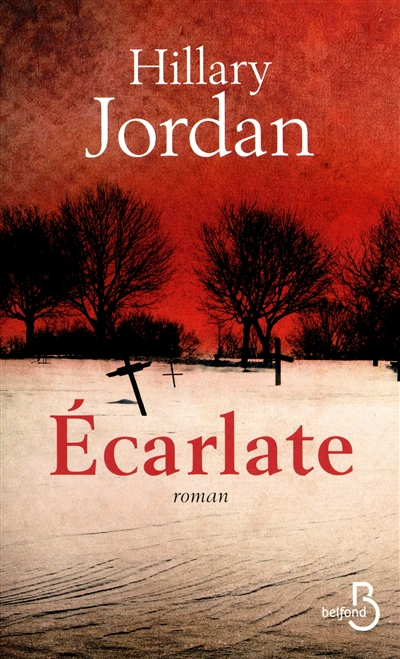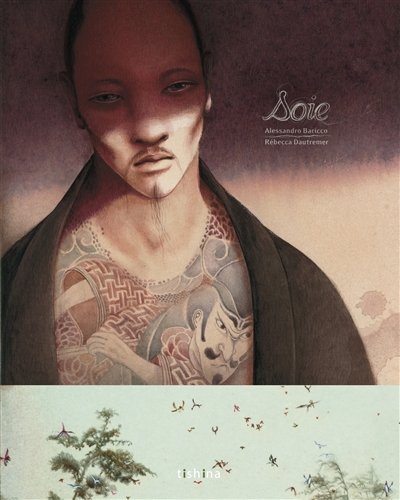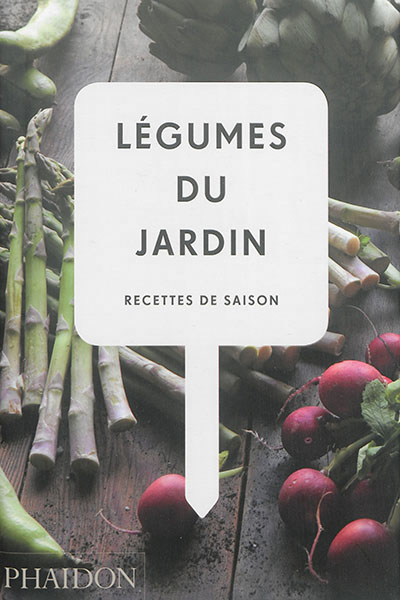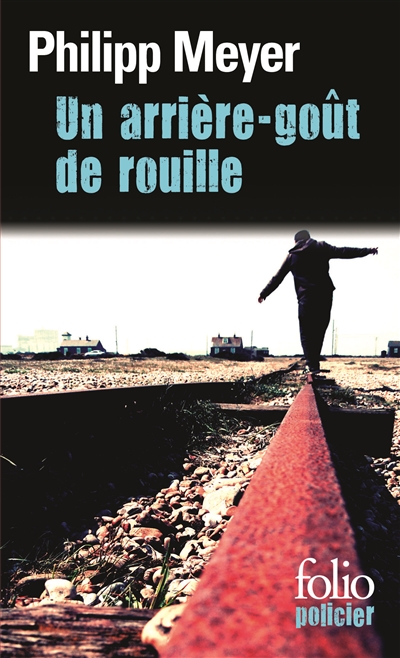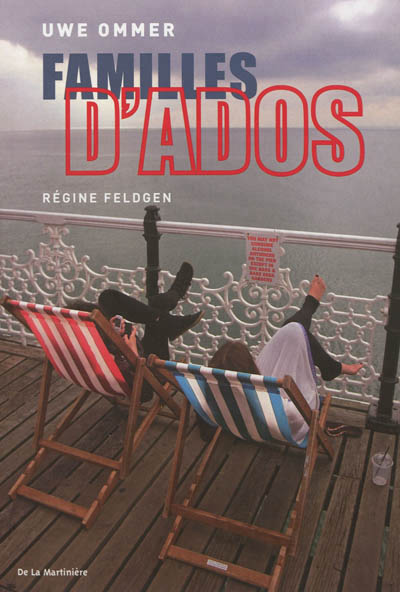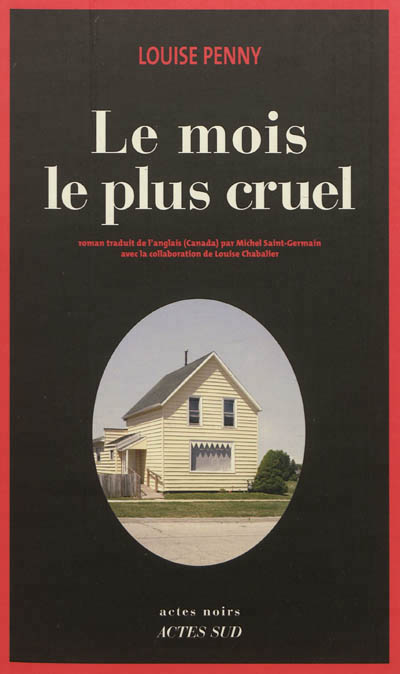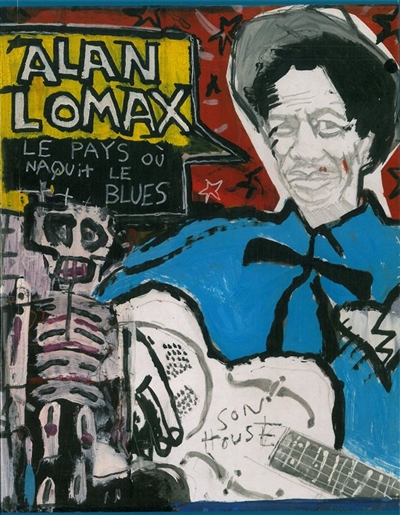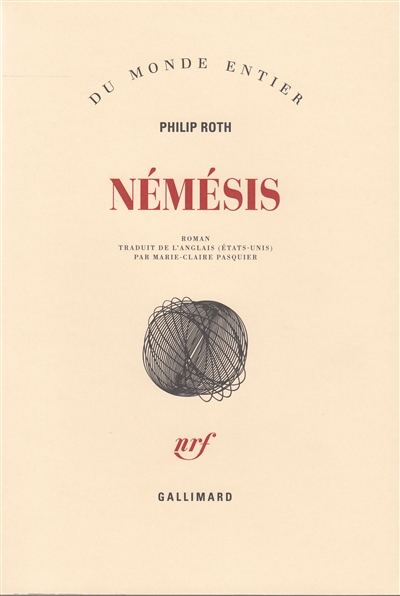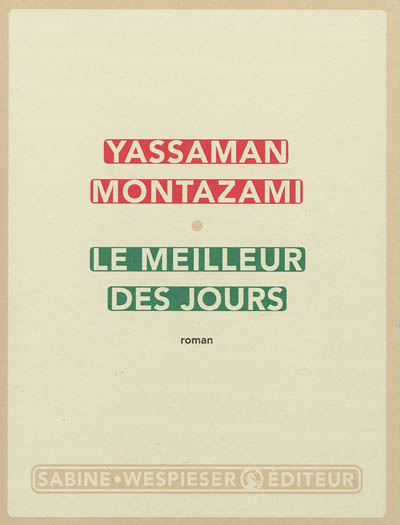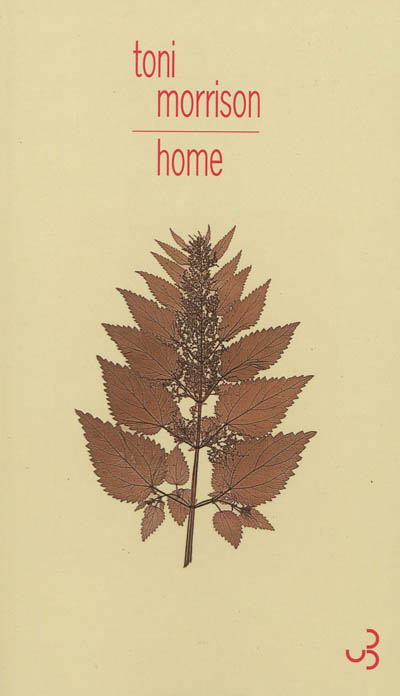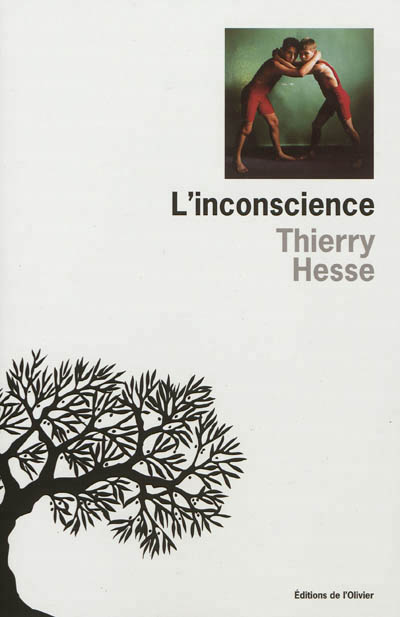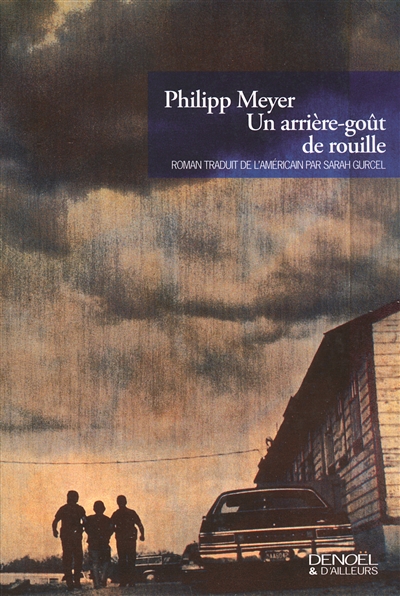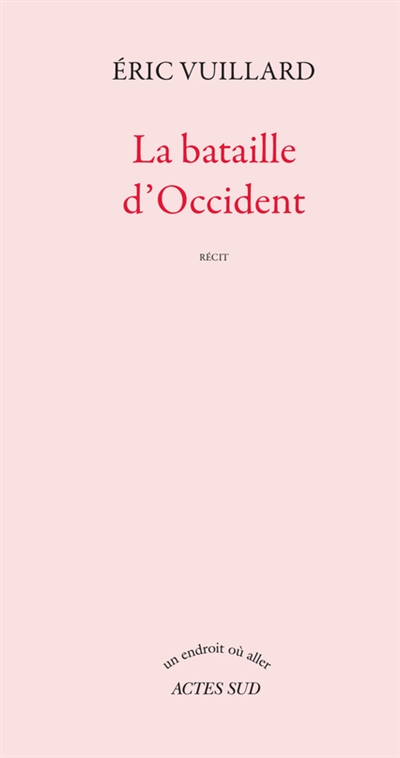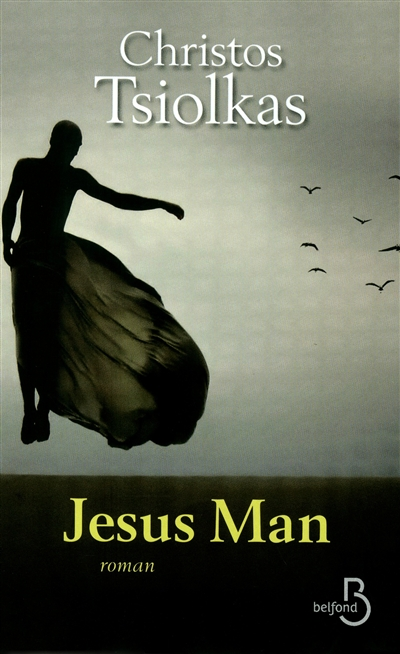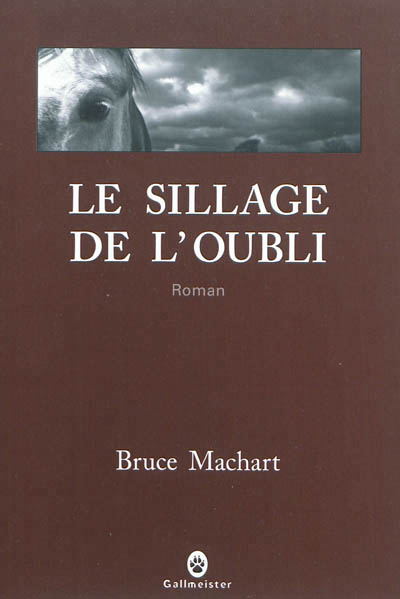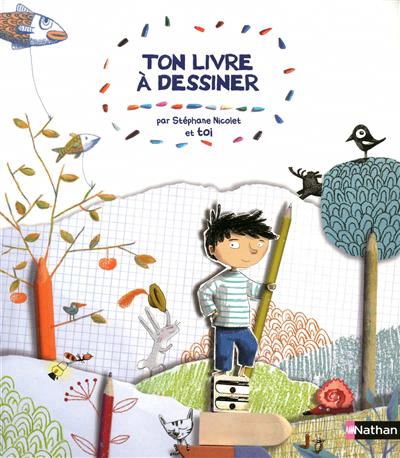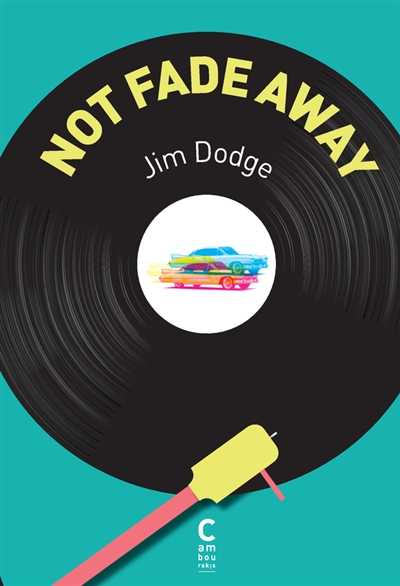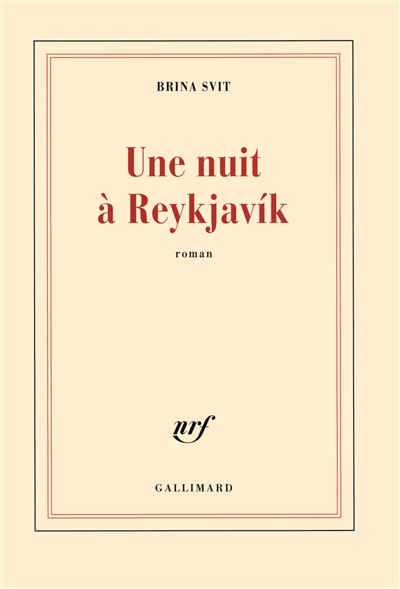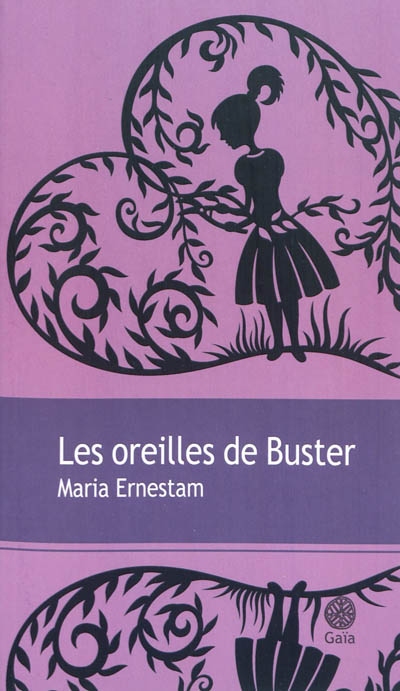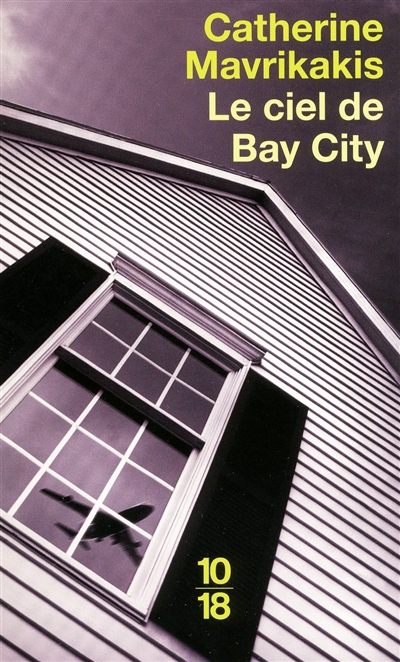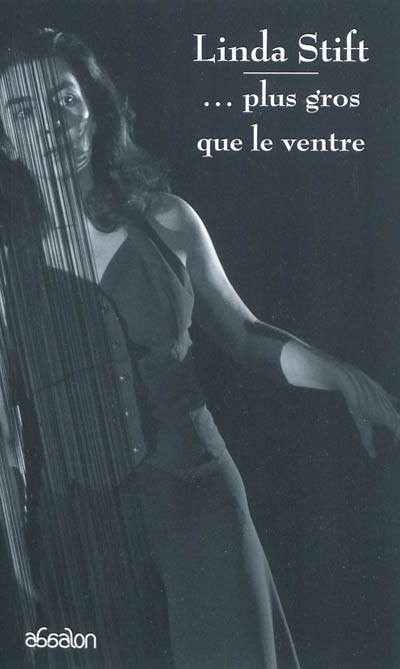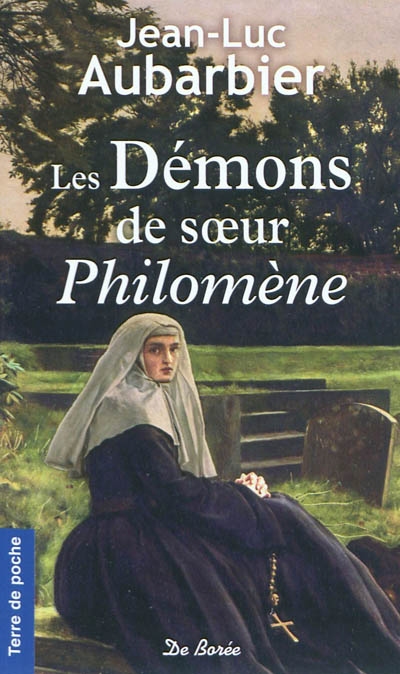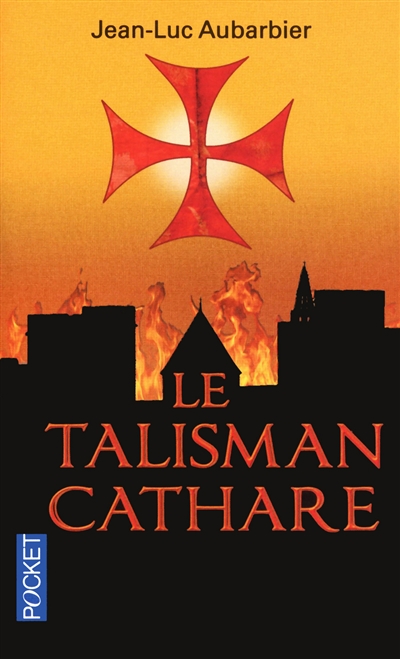Littérature française
Monique Rivet
Le Glacis
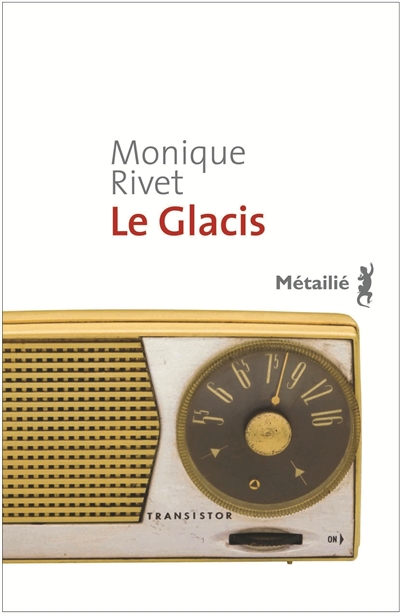
-
Monique Rivet
Le Glacis
Métailié
26/01/2012
144 pages, 14 €
-
Chronique de
Coline Hugel
-
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Coline Hugel
- Christine Jankowski de Tome 19 (Revel)
✒ Coline Hugel
( , )
Une jeune institutrice se retrouve parachutée dans un pays occupé, martyrisé, défiguré ; elle doit faire face aux « événements ». Comment trouver sa place entre un peuple qu’elle apprécie et son pays qu’elle ne peut critiquer ? À qui donner sa confiance ? Un récit brûlant et efficace.
PAGE : Vous avez écrit ce livre il y a cinquante ans, sans toutefois jamais le publier. Est-ce parce que vous n’aviez pas trouvé d’éditeur à l’époque, ou parce que vous pensiez qu’il était trop tôt ? L’avez-vous retravaillé depuis ?
Monique Rivet : J’étais à cette époque liée par un contrat de dix ans aux éditions Flammarion pour un premier roman publié en 1957. Ils ont refusé ce deuxième manuscrit, je l’ai rangé, j’ai fait d’autres choses, publié ailleurs (dix ans après...) et j’ai oublié ce livre. Je l’ai retrouvé en janvier dernier, je l’ai retravaillé en essayant de combiner le punch que je trouvais à ce livre de jeunesse et le savoir-faire acquis depuis ; le résultat m’a plu et il a plu aussi à Anne-Marie Métailié qui l’a édité.
P. : Quelle est la part autobiographique dans ce texte ?
M. R. : Ce qui n’est pas autobiographique, c’est le passé personnel de ma narratrice : un père mort en déportation, un avocat juif dont elle a été (est toujours ?) amoureuse. Cela m’est venu, je crois, spontanément parce que je soulignais ainsi quelque chose de très important pour moi : la guerre de 1939-1945 était toute proche. Nous avions été, Dieu sait !, patriotes pendant l’occupation allemande, et voilà que nous menions en Algérie une guerre coloniale, injuste, raciste, cruelle, qu’il m’était impossible d’approuver. Je n’avais pas d’amie susceptible de trahir, je n’ai pas été expulsée d’Algérie, et j’ai quitté Sidi-bel-Abbès à la fin de l’année scolaire. Mais je suis restée en Algérie, à Oran, où j’ai passé trois ans, professeur au lycée Stéphane Gsell, devenu depuis El Hayat. Ce qui est autobiographique, c’est d’une part la situation, puisque j’ai été nommée « d’office » dans ce qui était à l’époque un département français, et d’autre part, les réactions de la narratrice aux « événements ». Je me reconnais complètement dans les indignations et les refus que je lui ai prêtés. Et mon récit et les personnages qui l’habitent sont largement inspirés de ce que j’ai vu et vécu à El-Djond-Sidi-bel-Abbès.
P. : On sent que vous aimez ce pays et ses habitants. Pourtant, comme vous le dites, vous y étiez « de guingois avec tout, choses et gens, frappée d’une frilosité à fleur de peau, incapable d’adhérer à aucun des mouvements qui s’y affrontaient ». Comment avez-vous réussi à vous situer dans le contexte ?
M. R. : Je n’ai pas réussi à me situer dans ce pays, dans cette guerre. Pas plus que ma narratrice, je n’ai résolu les contradictions dans lesquelles je me suis trouvée piégée. Pour moi la France, c’était une civilisation : une langue, une littérature, des paysages, mais aussi les idées et idéaux qu’avait portés la Révolution et qui étaient pour moi comme une évidence, quelque chose qu’on n’avait même pas besoin de formuler ; et cela, je crois que mon personnage l’exprime. J’appartenais à tout cela. Je n’appartenais à l’Algérie que dans la mesure où elle reflétait ces choses, cette culture, ces idéaux. Or l’Algérie coloniale en constituait, c’est le moins qu’on puisse dire, un reflet fort appauvri, quand ce n’était pas un reflet complètement inversé puisque la colonisation consacrait la ségrégation des communautés et l’infériorisation de ceux qu’on appelait les indigènes. Mais si je ne me retrouvais pas dans la France coloniale, je ne me retrouvais pas non plus dans une révolte dont je comprenais les raisons sans vouloir y participer. Le combat du FLN n’était pas le mien. D’une part parce que la démocratie n’avait pas disparu en France, où l’on votait, où l’on pouvait écrire, manifester (choses impossibles en Algérie d’ailleurs, bien que ce fût officiellement une terre française), et il me semblait qu’en tant que citoyenne de la République mon rôle était d’agir, dans la mesure du possible, pour que nos hommes politiques négocient avec le FLN. D’autre part… il y avait quelque chose d’autre, qui est plus difficile à exprimer et que ma narratrice résume en disant qu’elle ne peut pas aider le FLN. Je l’ai dit, nous sortions de la Seconde Guerre mondiale, notre pays avait été envahi, notre identité nationale s’était trouvée menacée par l’occupation allemande. À la fois cela me sensibilisait aux aspirations des rebelles à une nation libre dans laquelle ils seraient citoyens à part entière – et en même temps je ne pouvais pas, en eût-il été question, m’armer contre mon propre pays en aidant activement ceux qui combattaient notre armée. Ainsi, comme mon personnage, je n’ai pu résoudre ces contradictions et je suis restée « de guingois » avec cet autre pays qu’était l’Algérie, même dite « française ». Et ce qui n’était pas le moins paradoxal et le moins dérangeant, c’est qu’en un sens, elle l’était. Mais la vie n’est-elle pas en toute chose, en tout domaine, un équilibre entre des contradictions ? Équilibre essentiellement fragile, constamment remis en cause, perdu et retrouvé, jamais acquis, parfois complètement impossible. Alors le « guingois » se termine sur le sol, les quatre fers en l’air. Et c’est ce qui arrive à mon héroïne.