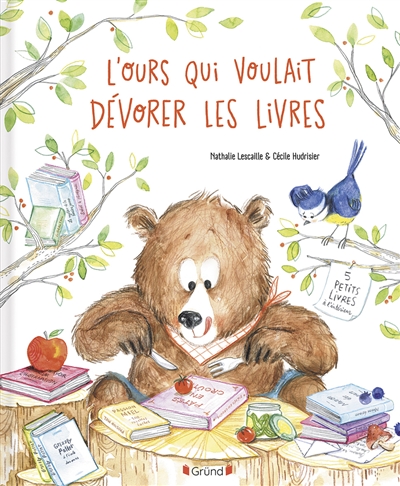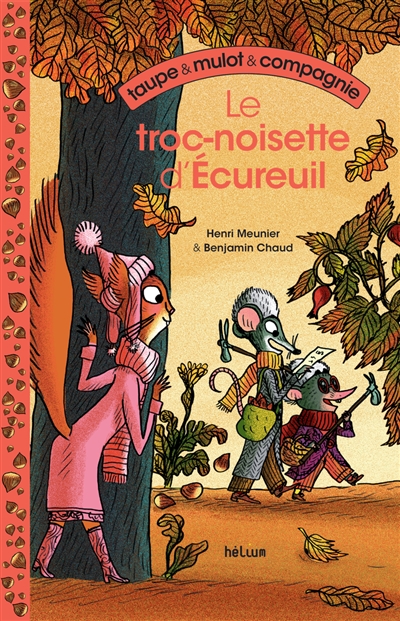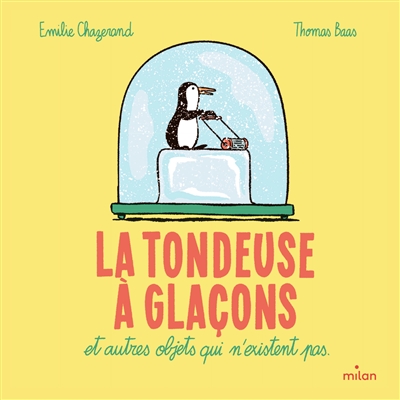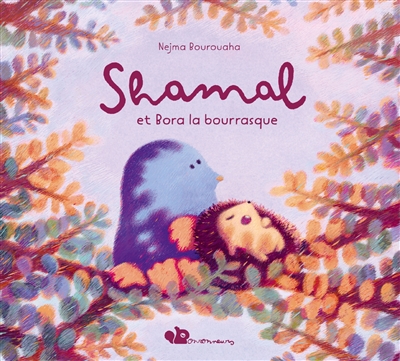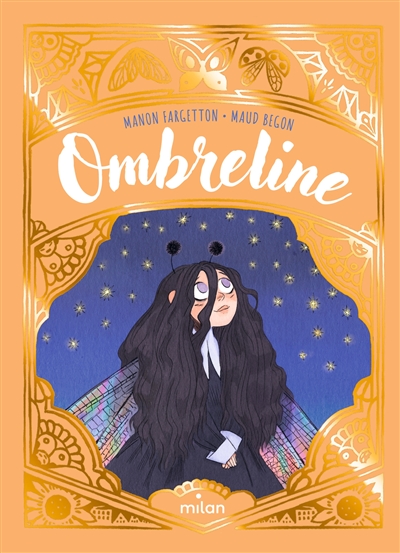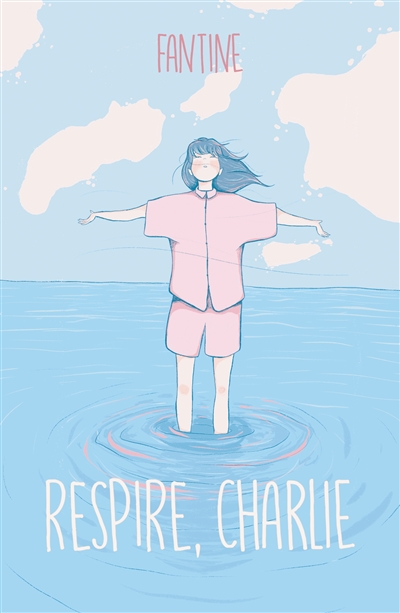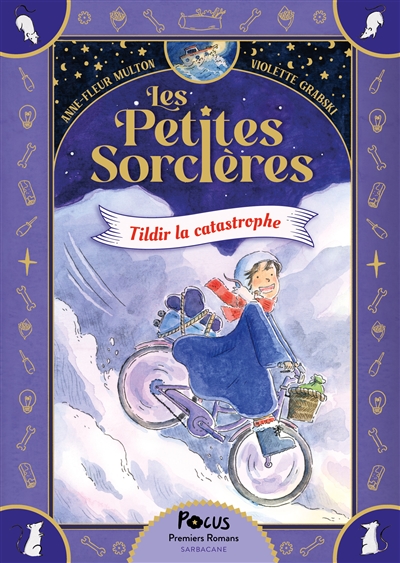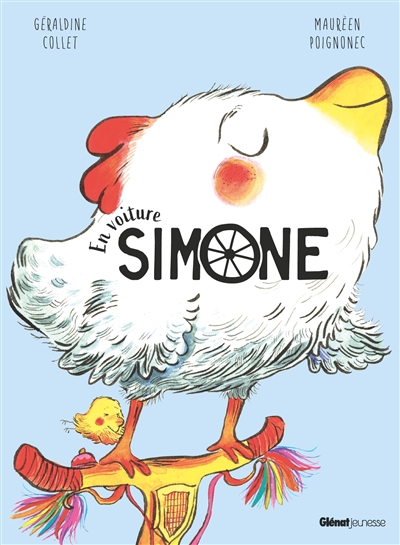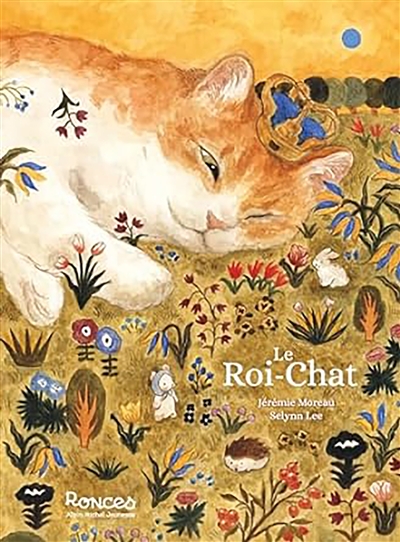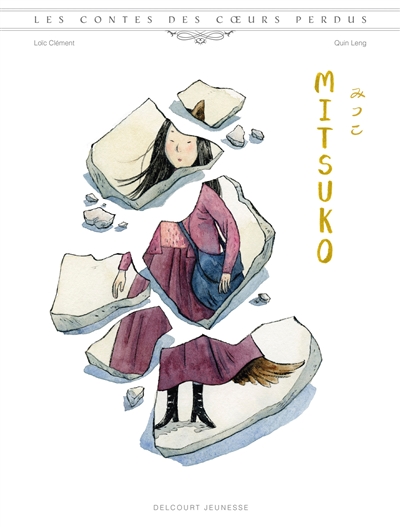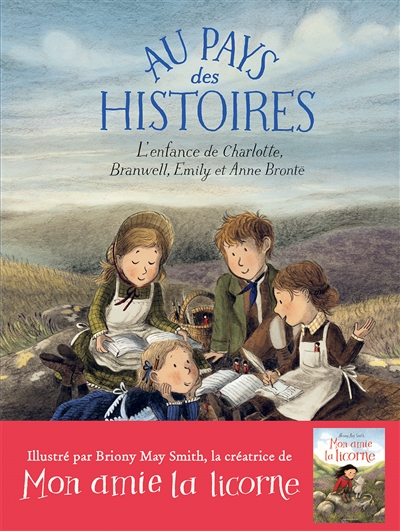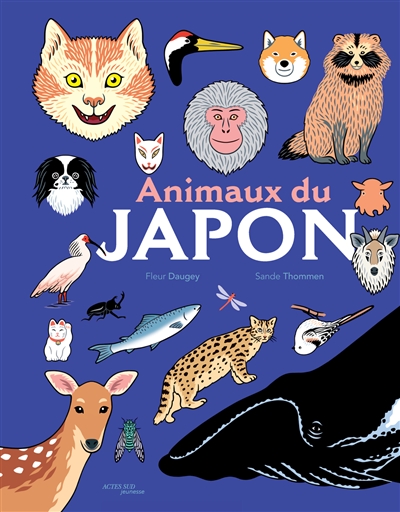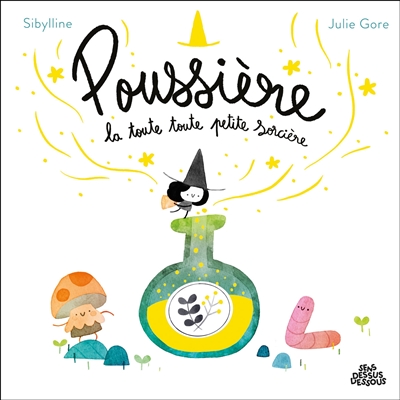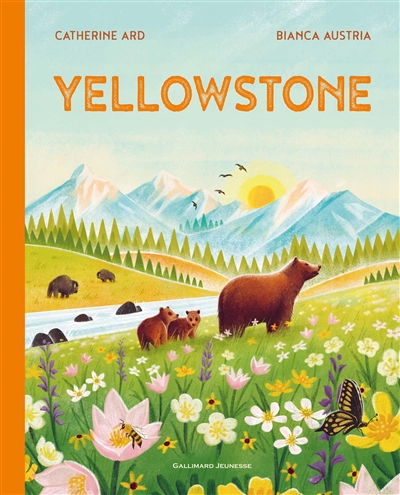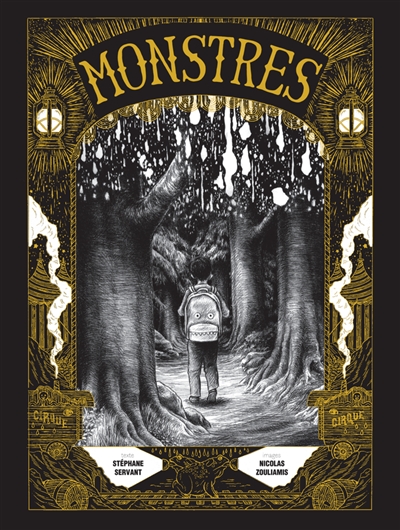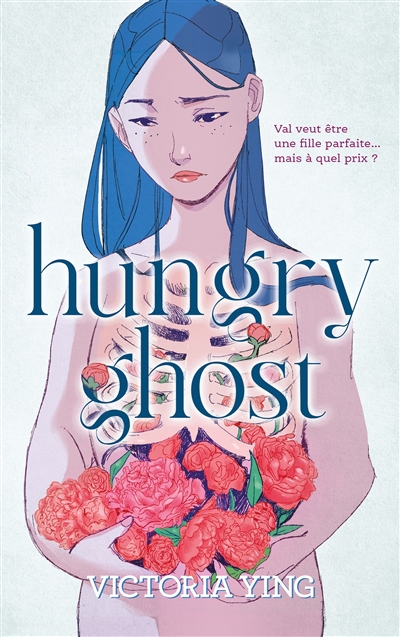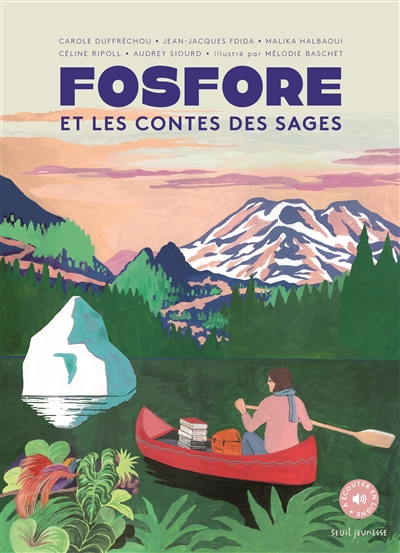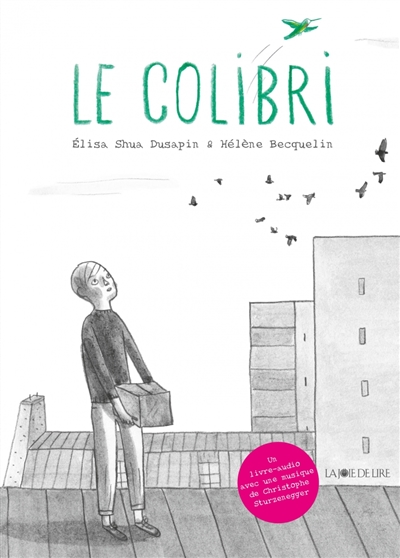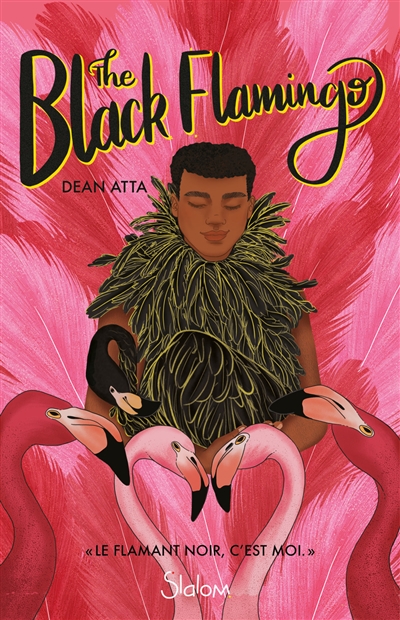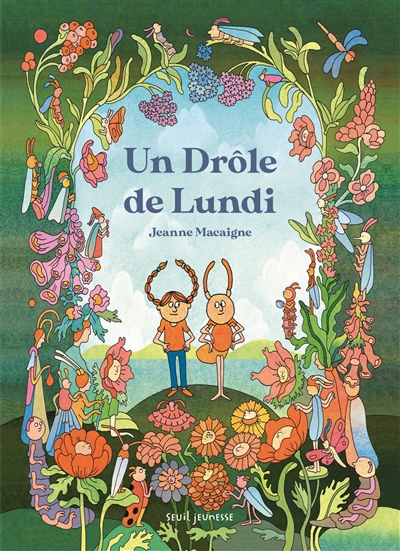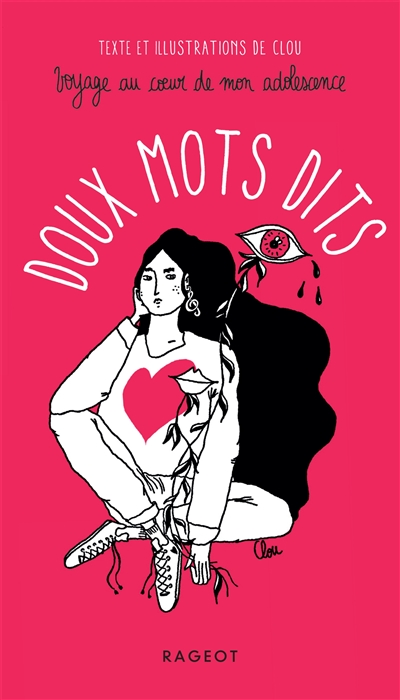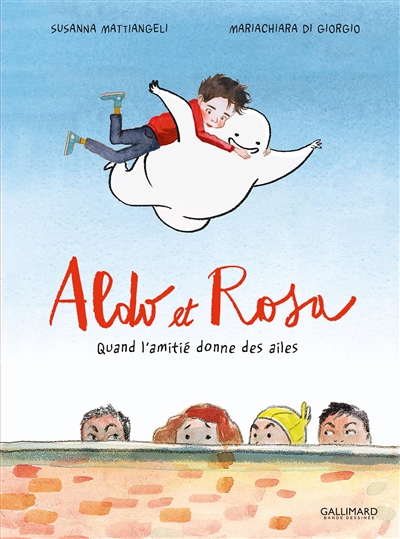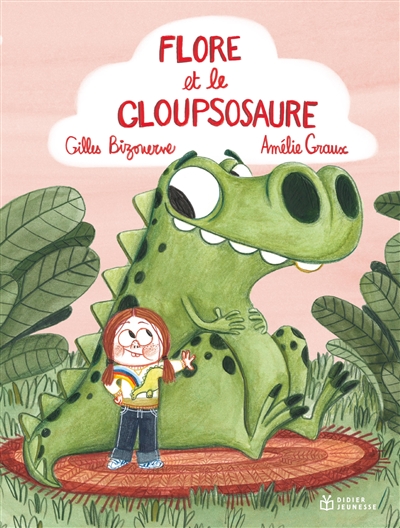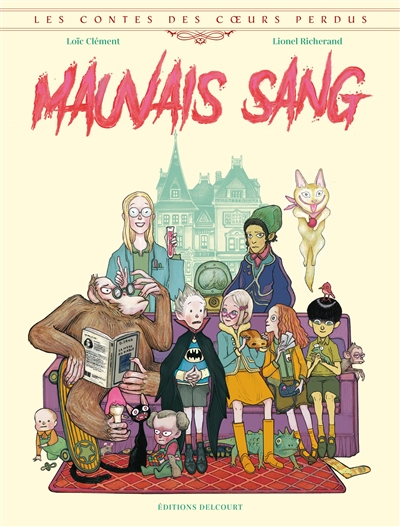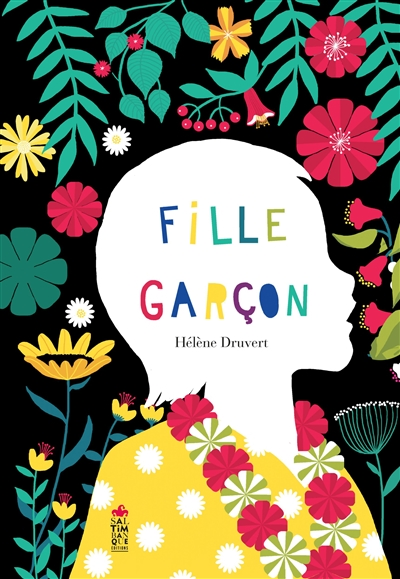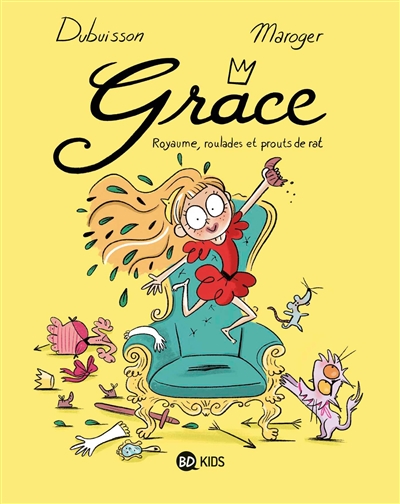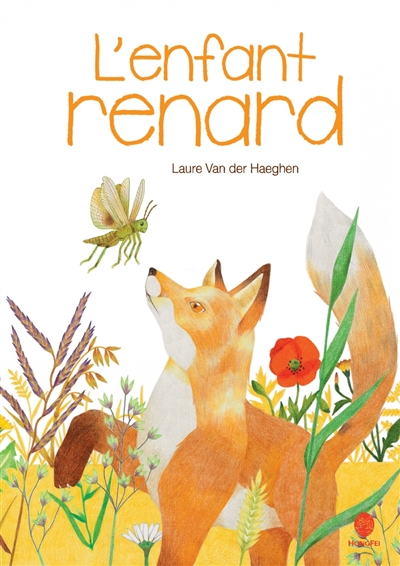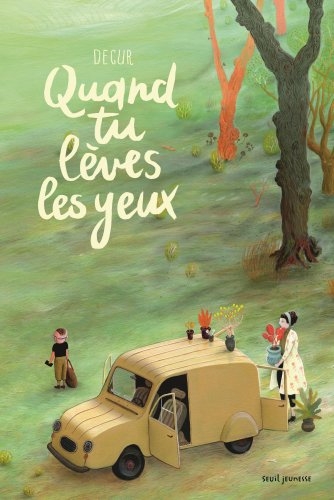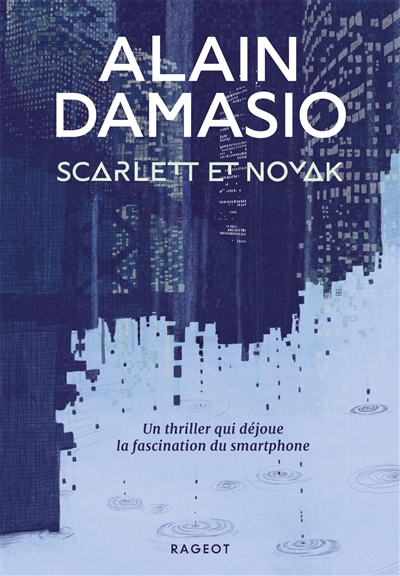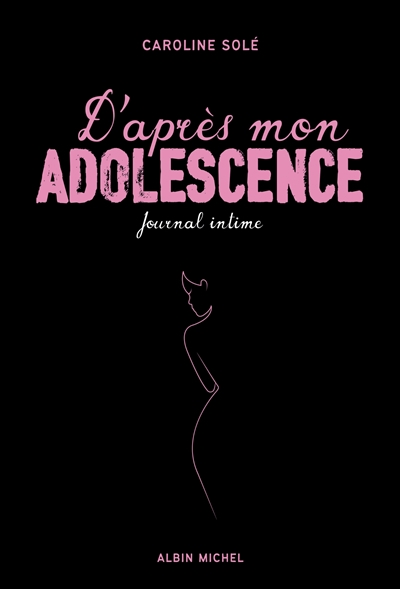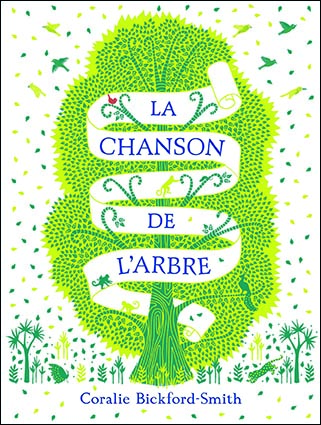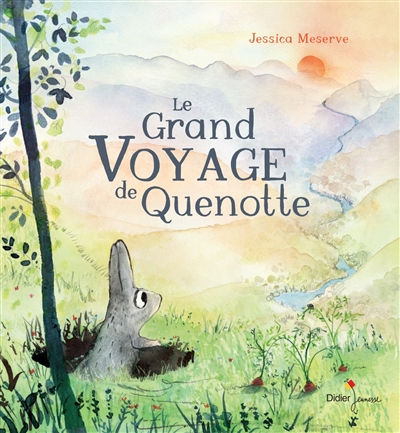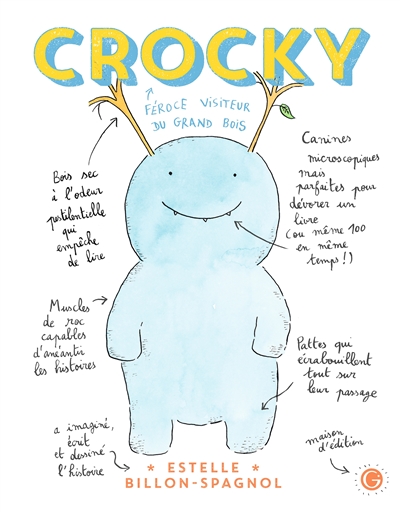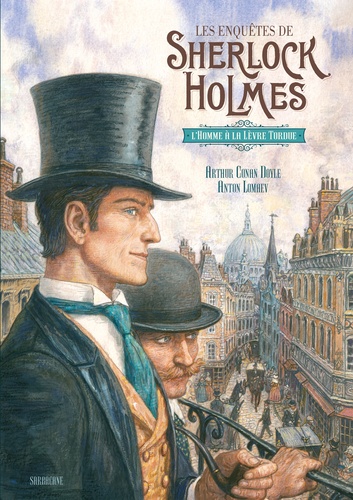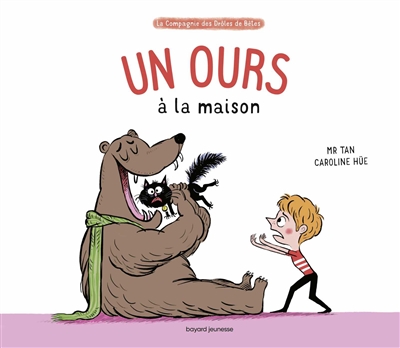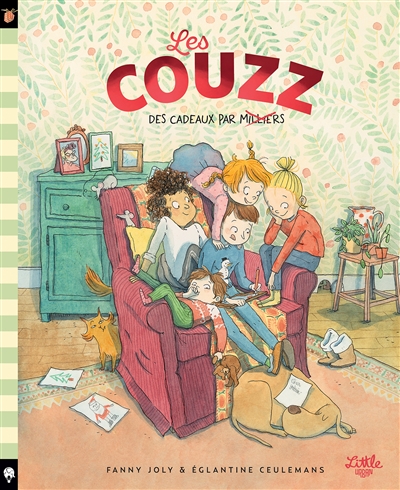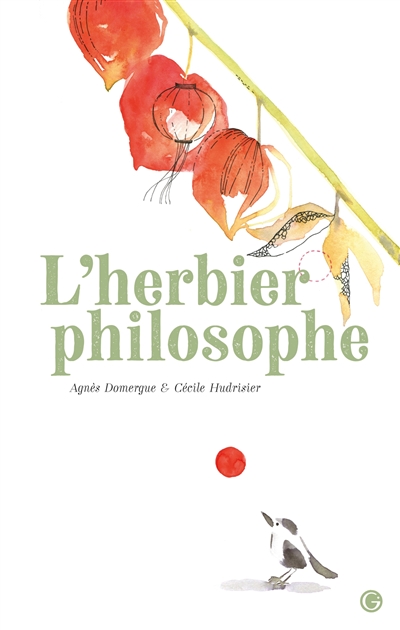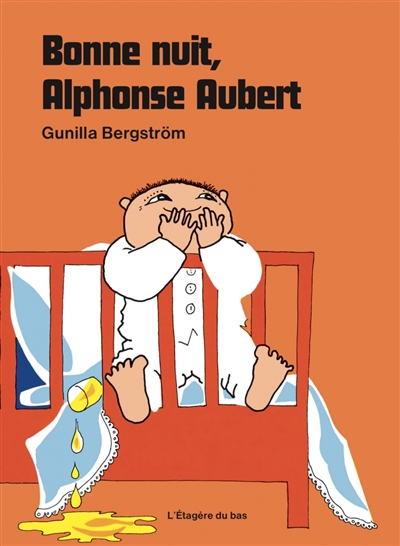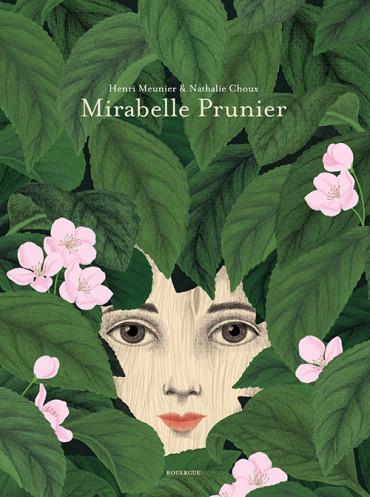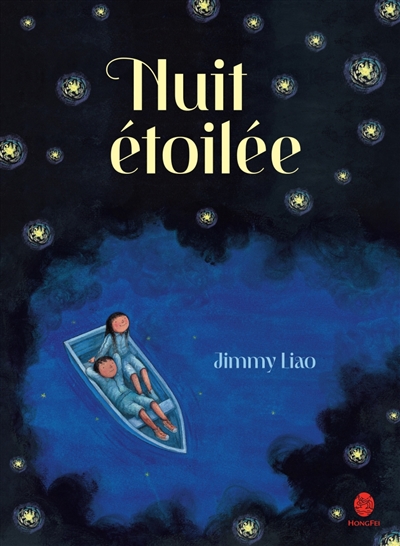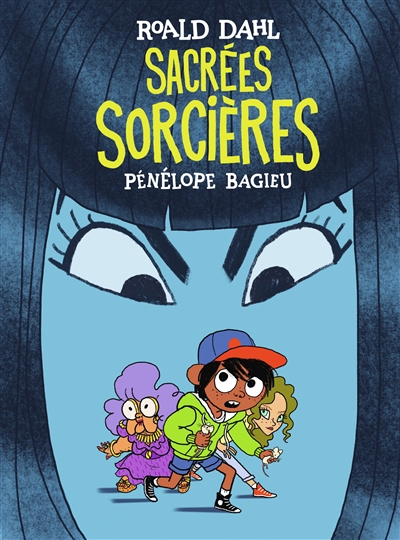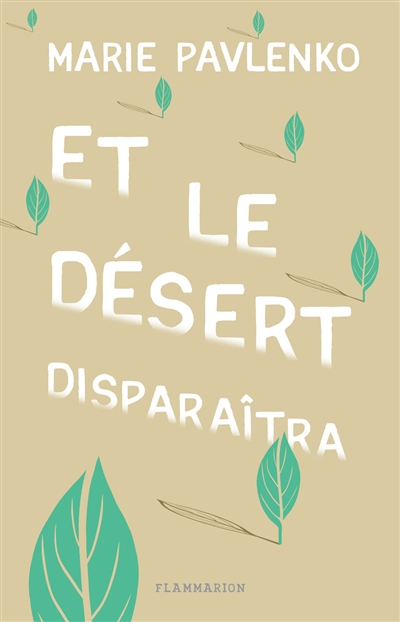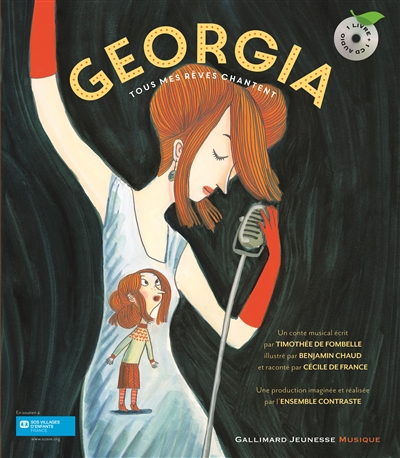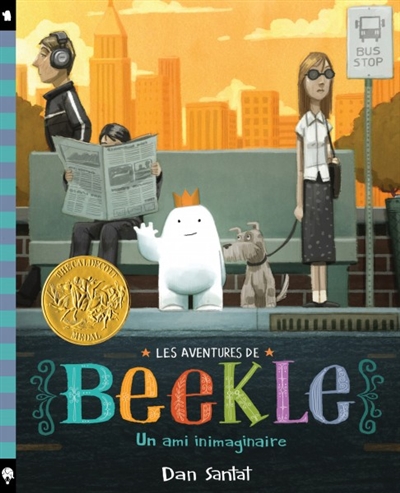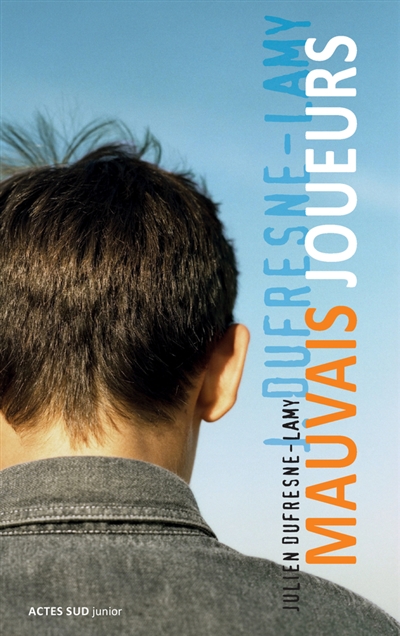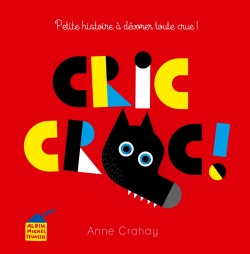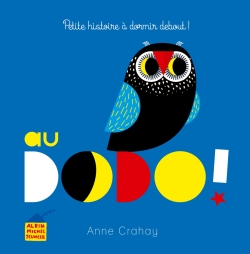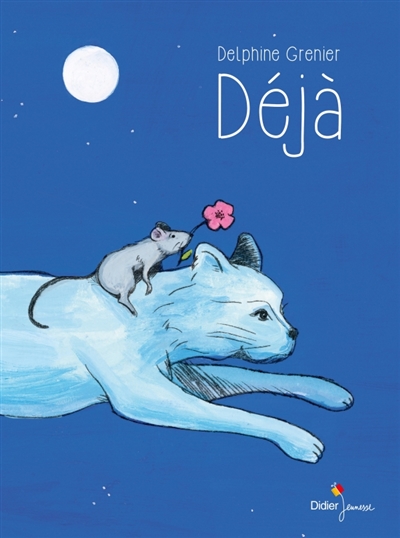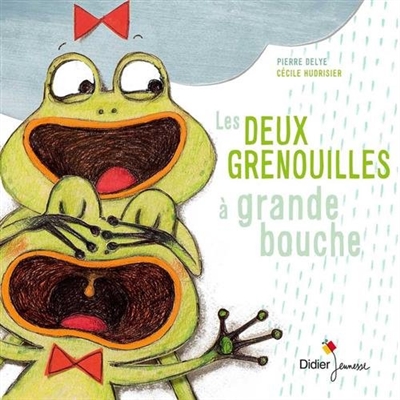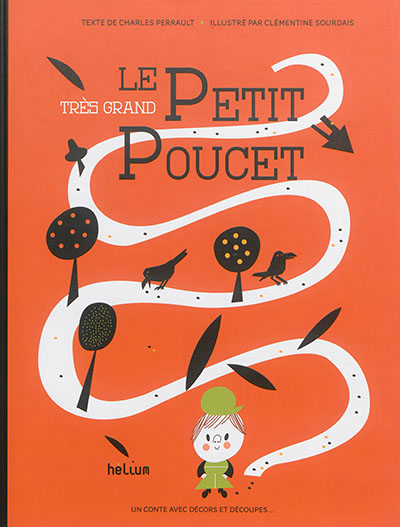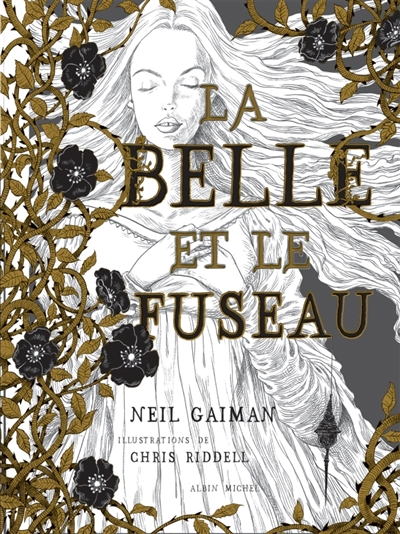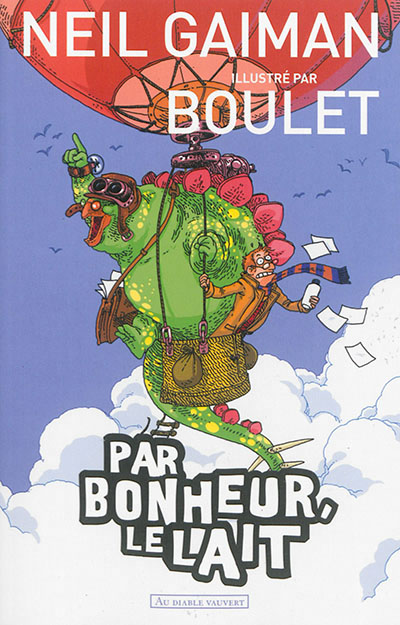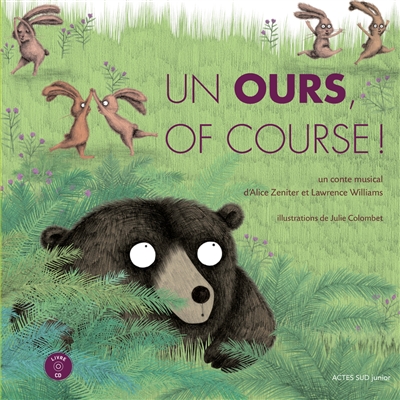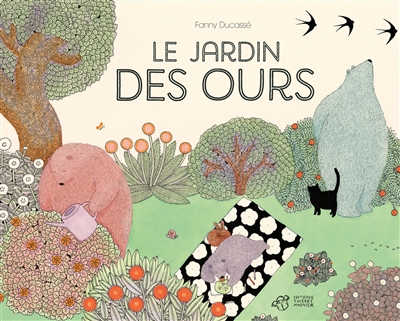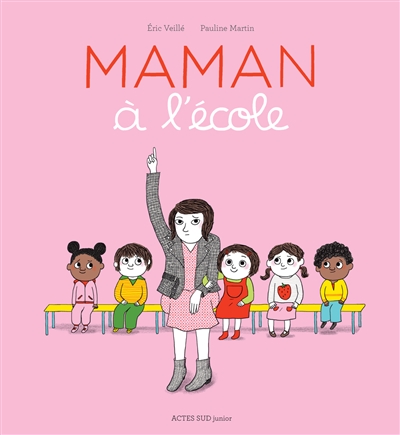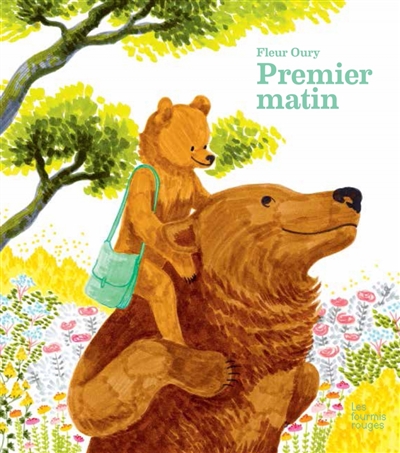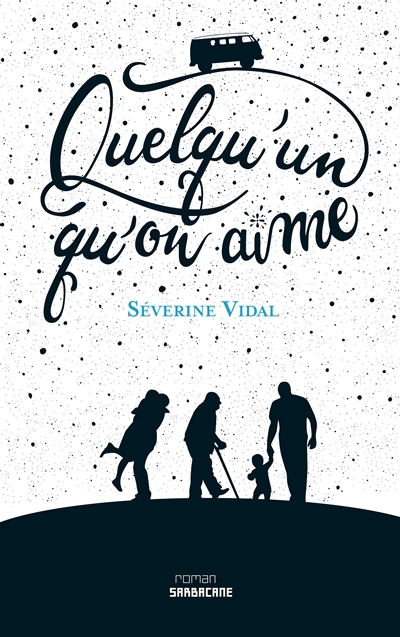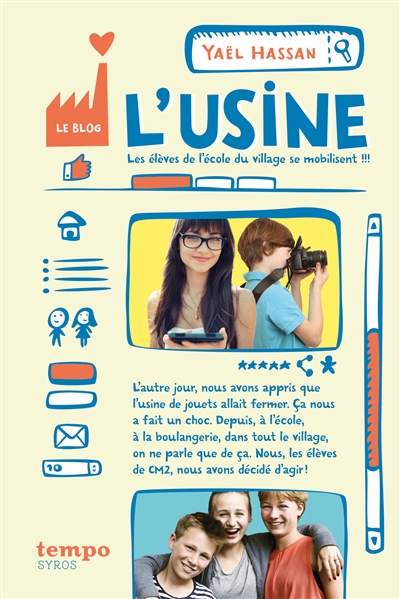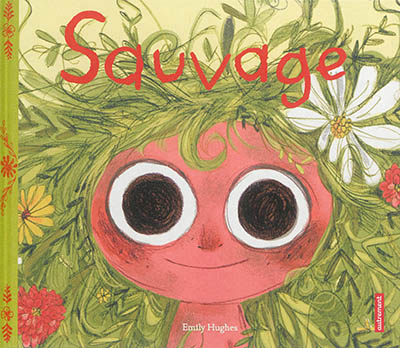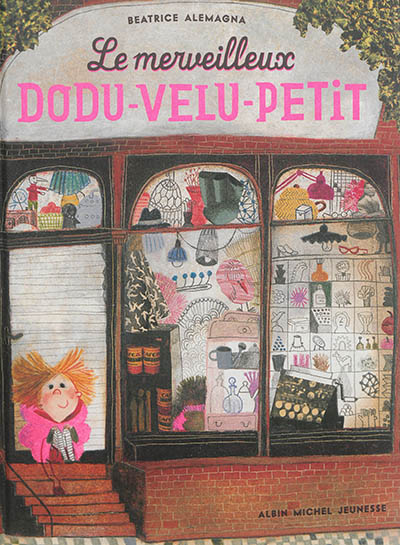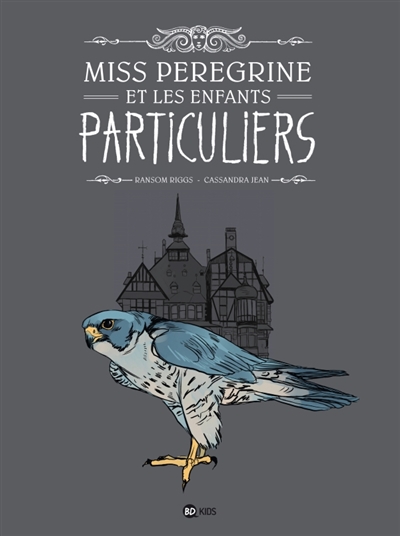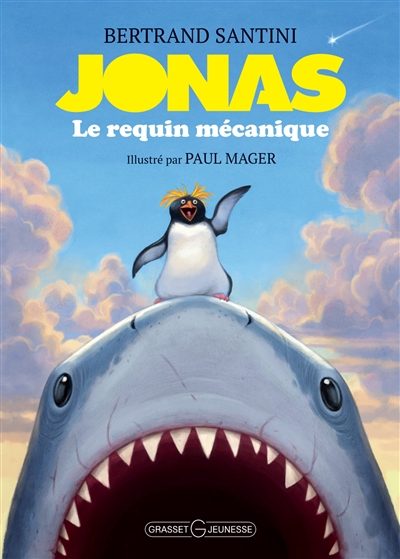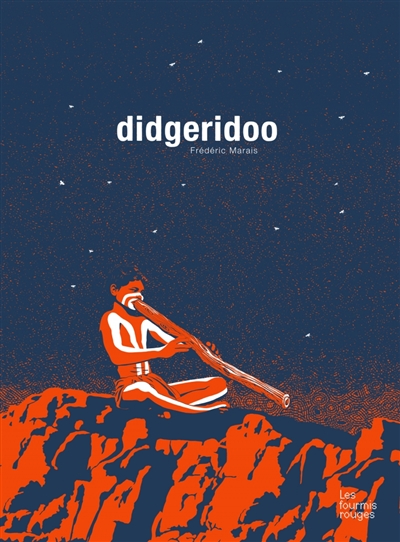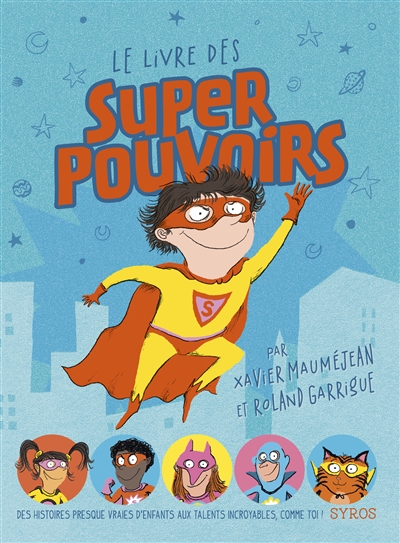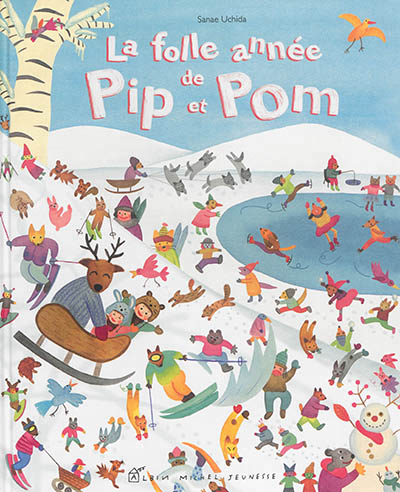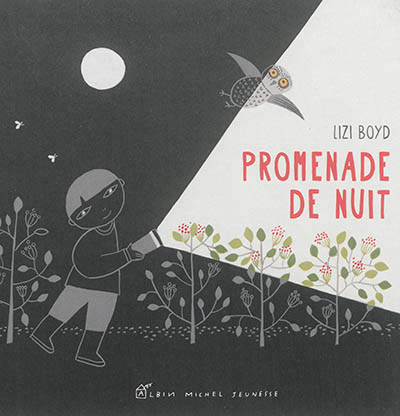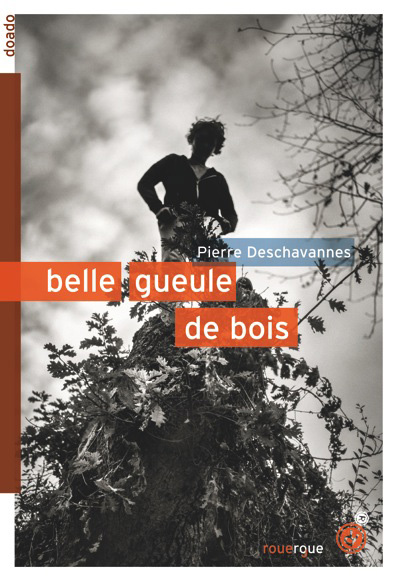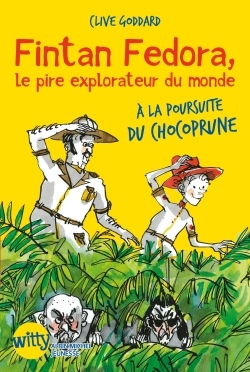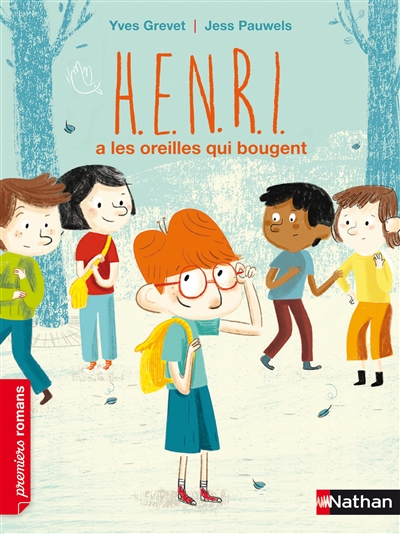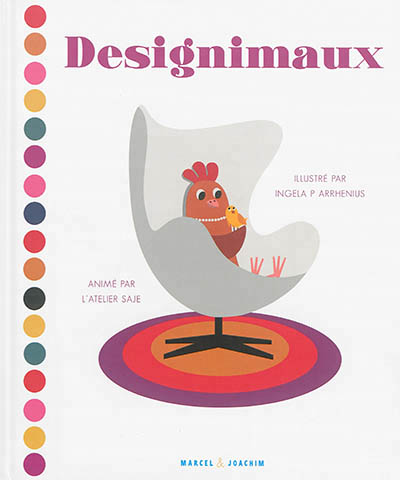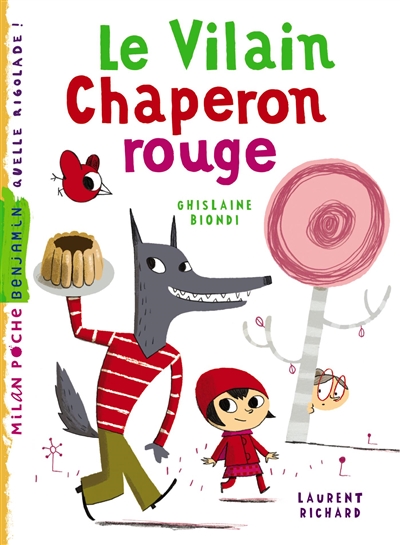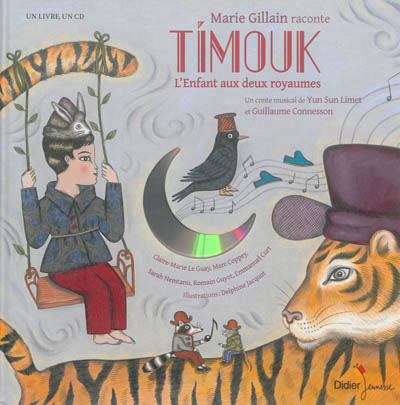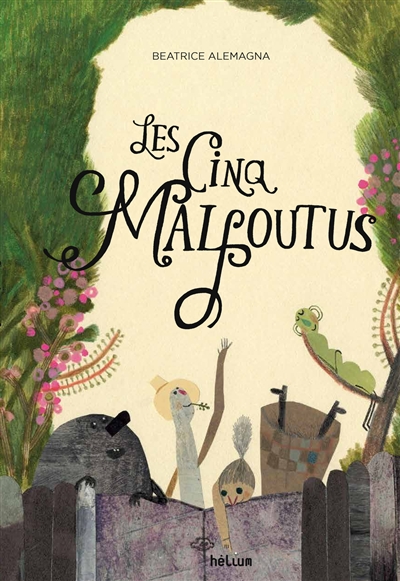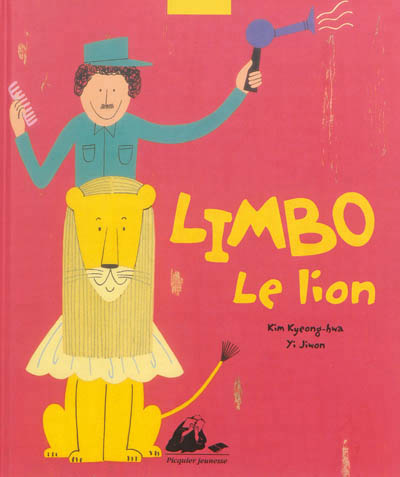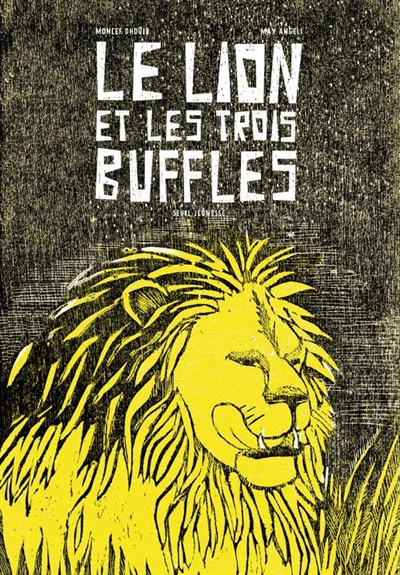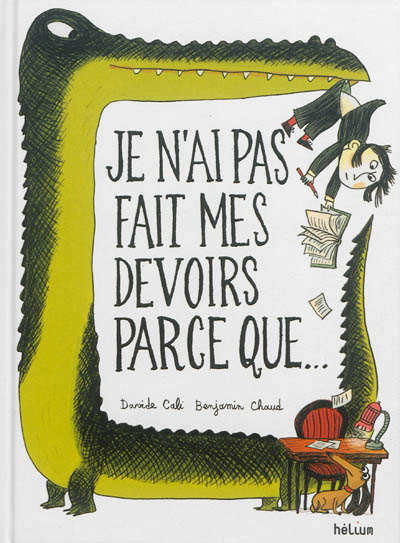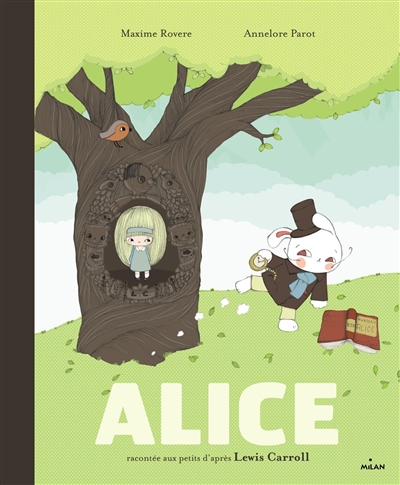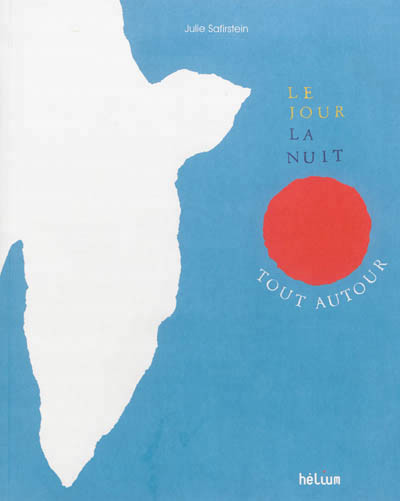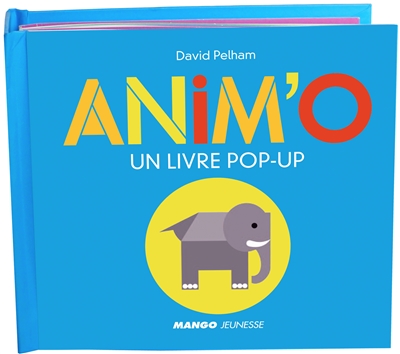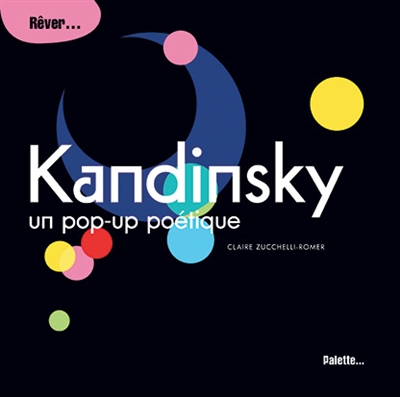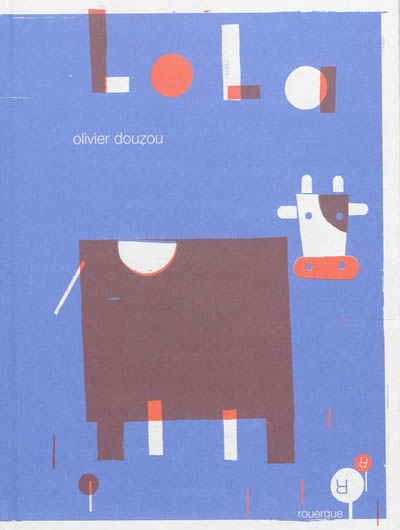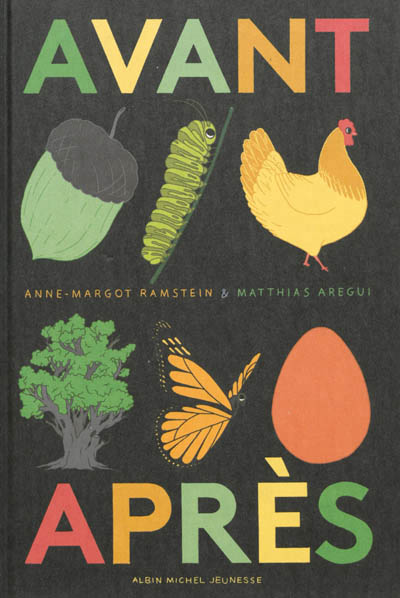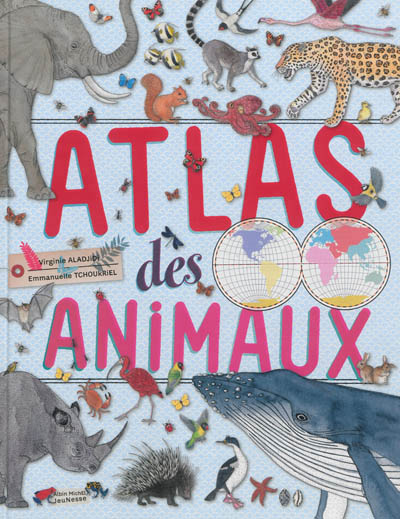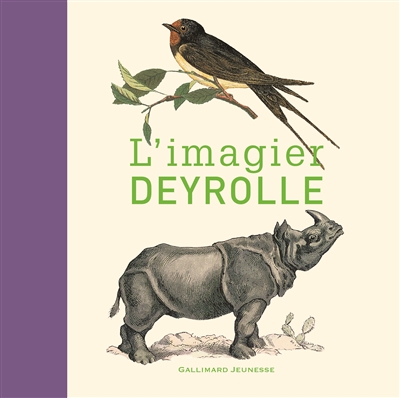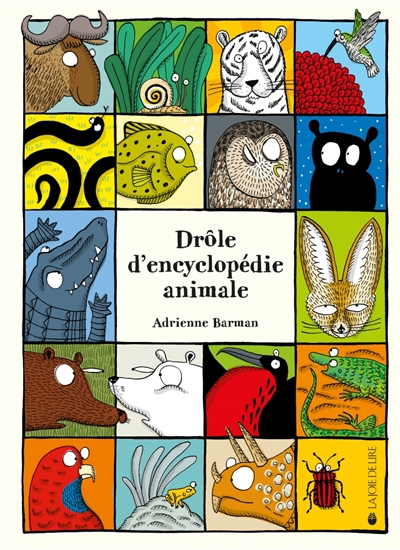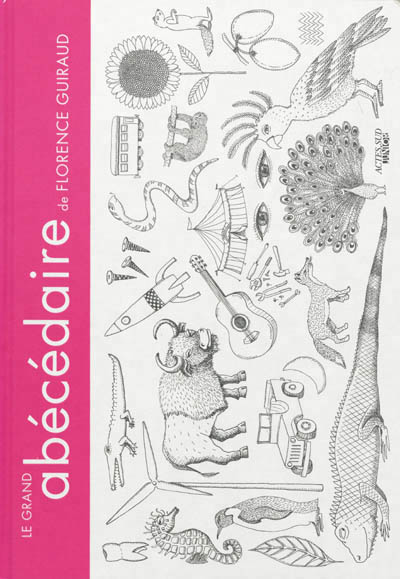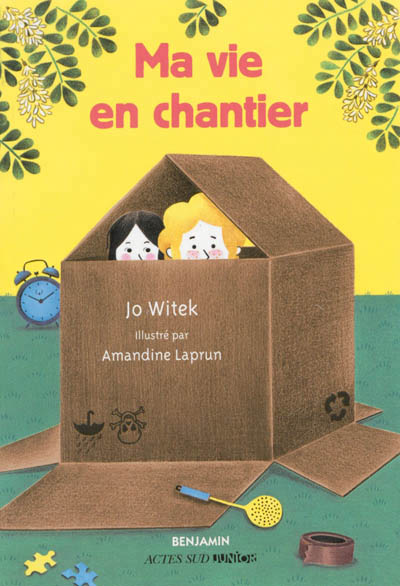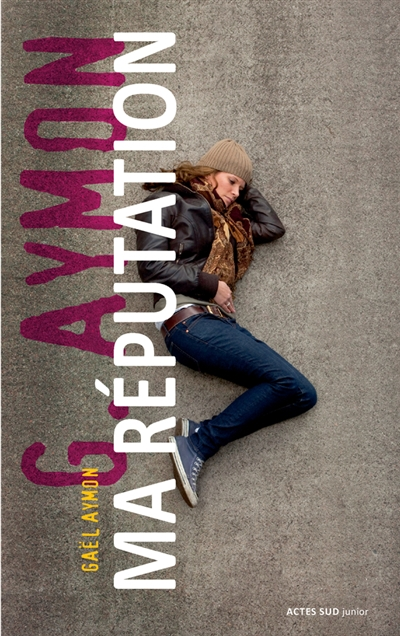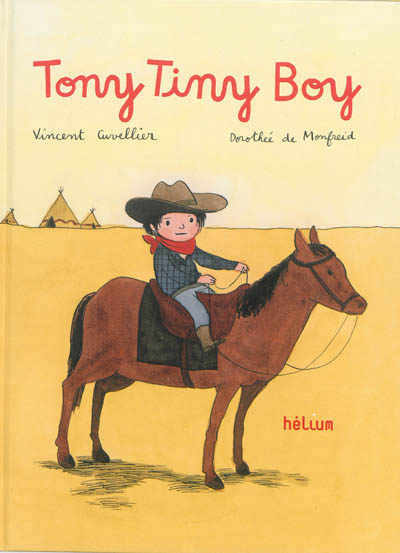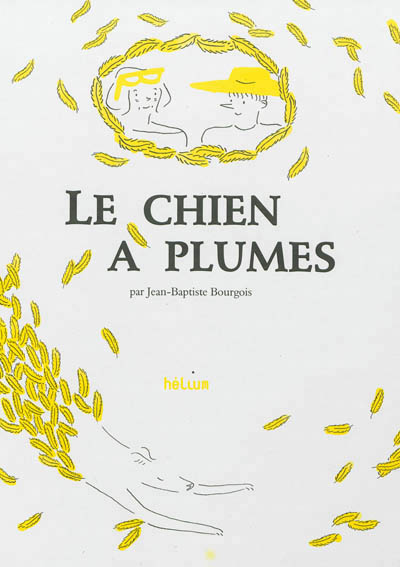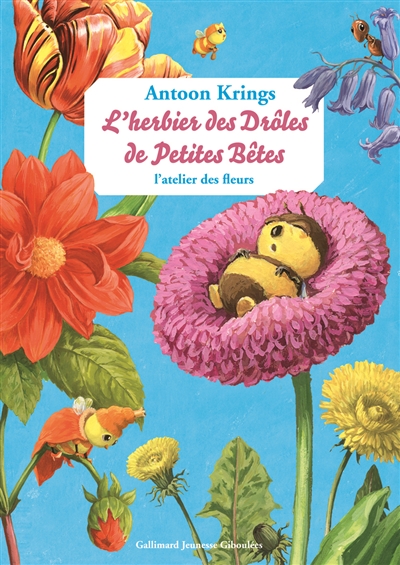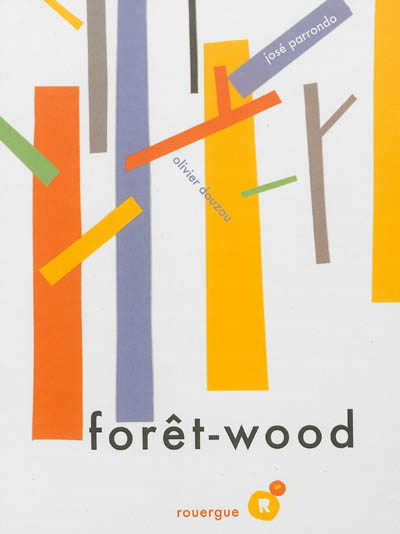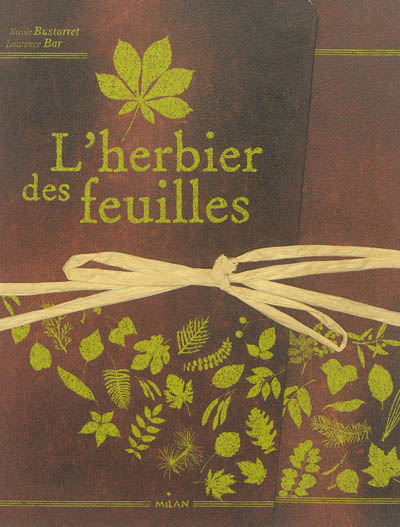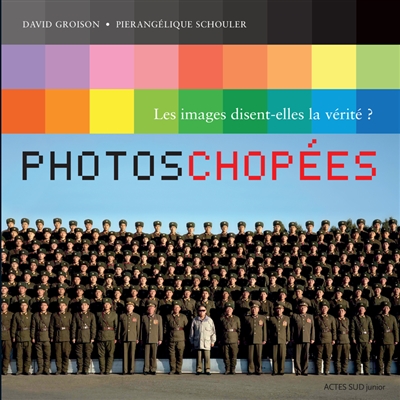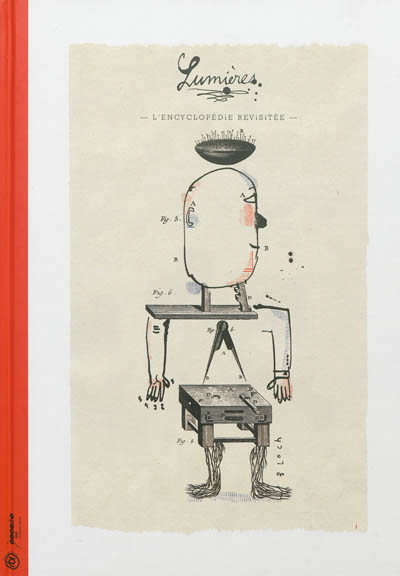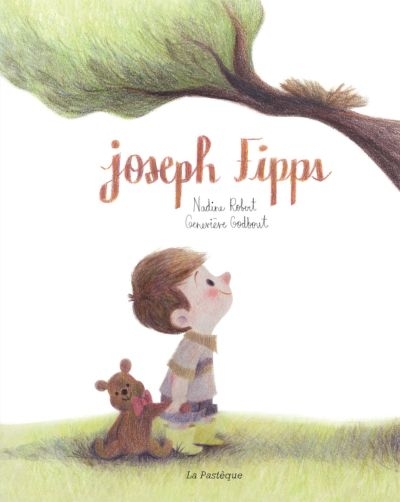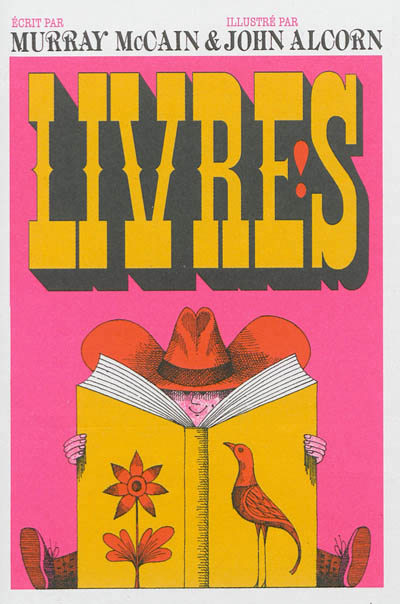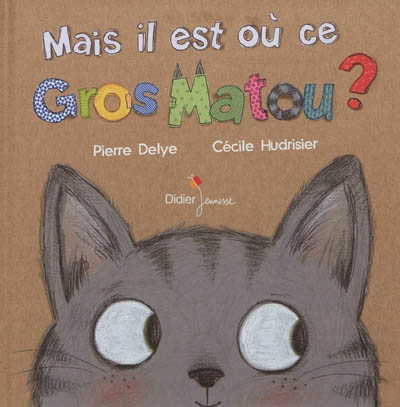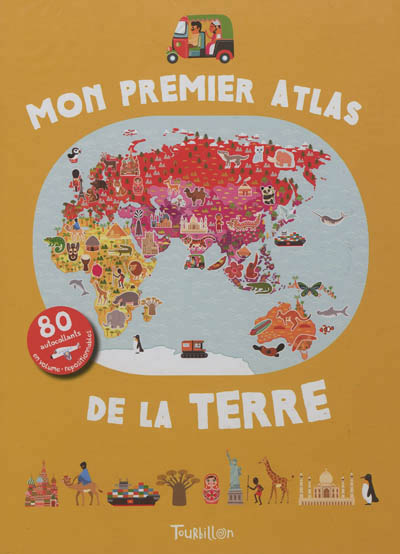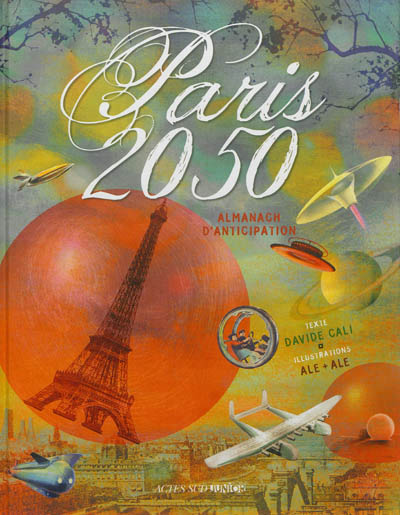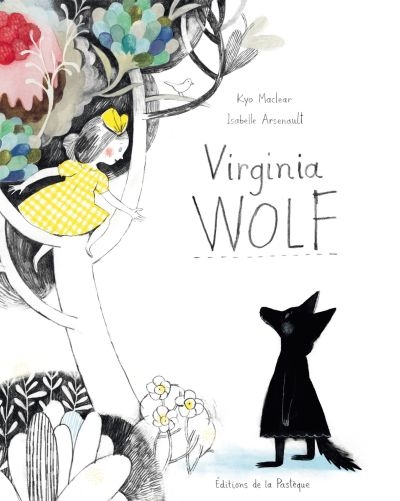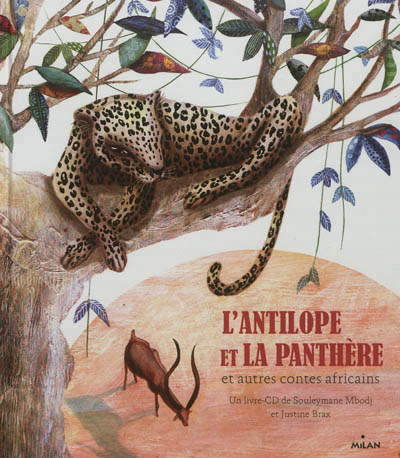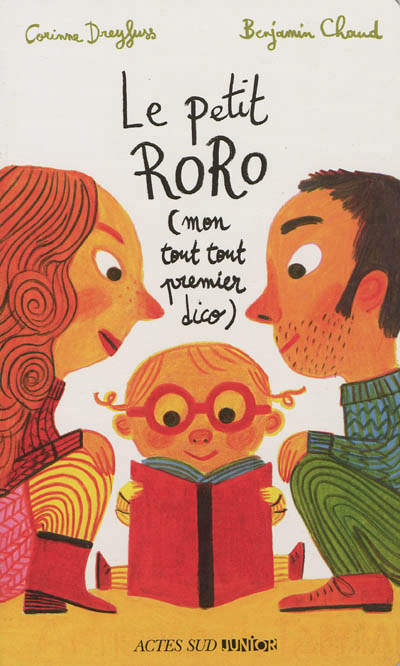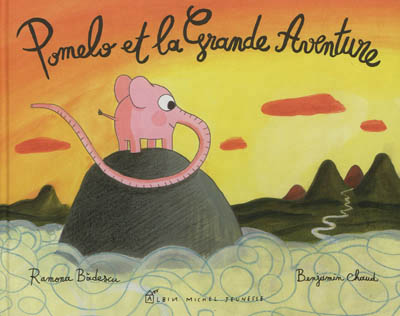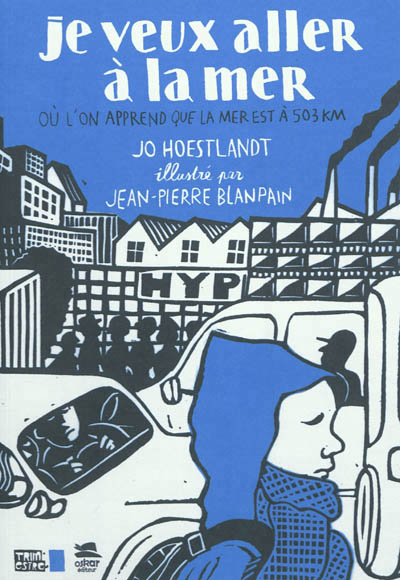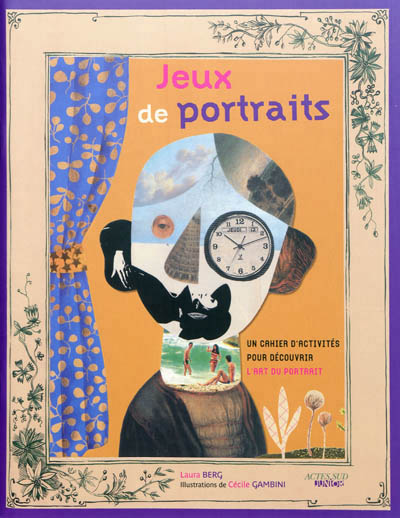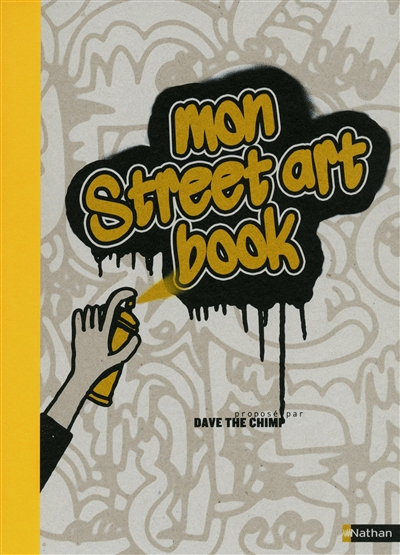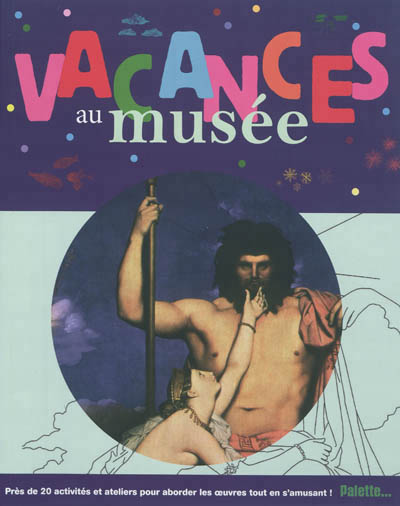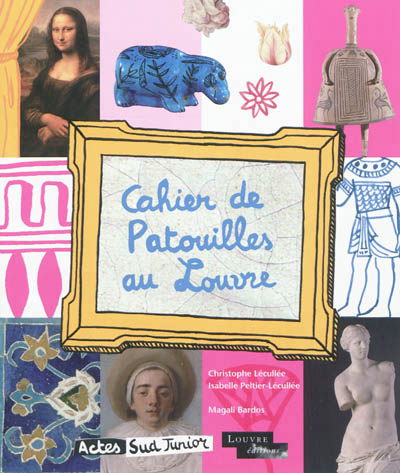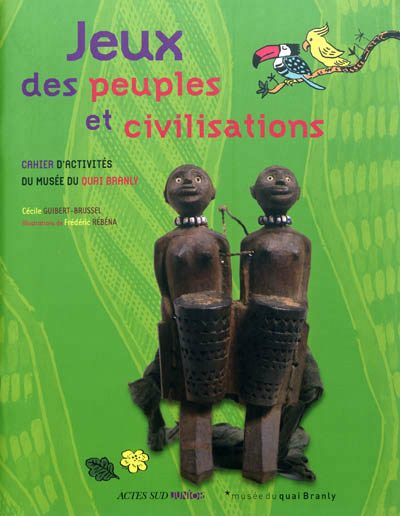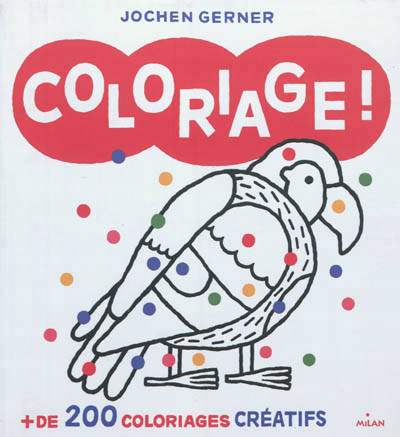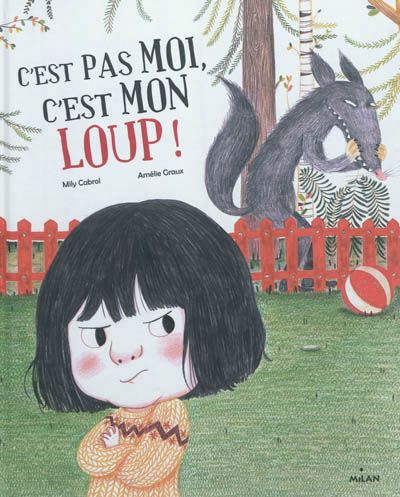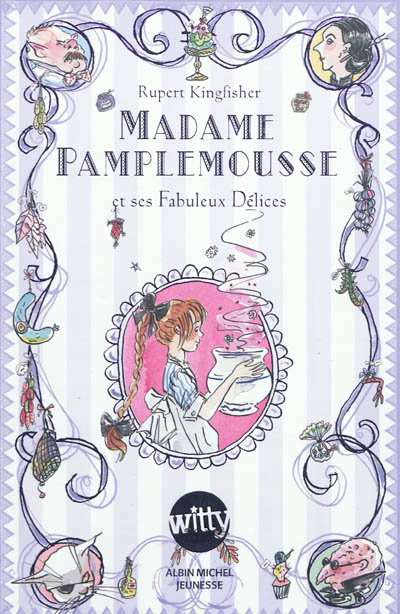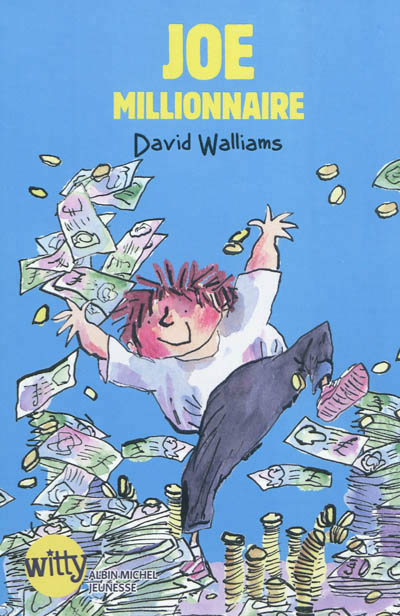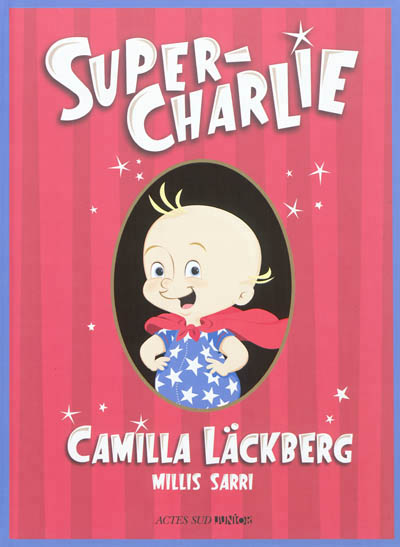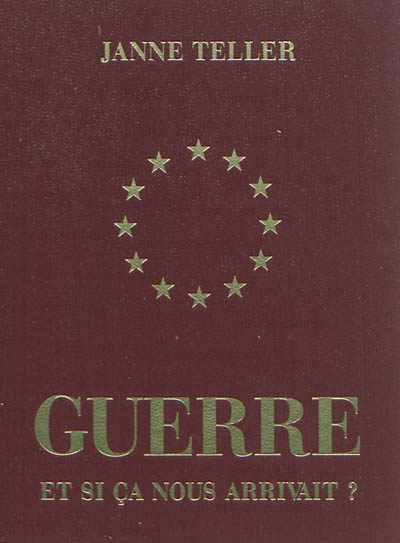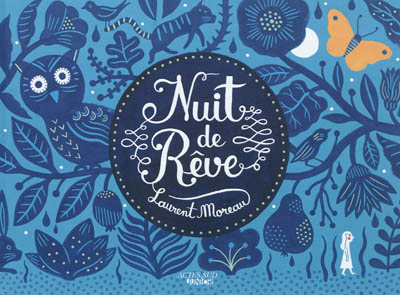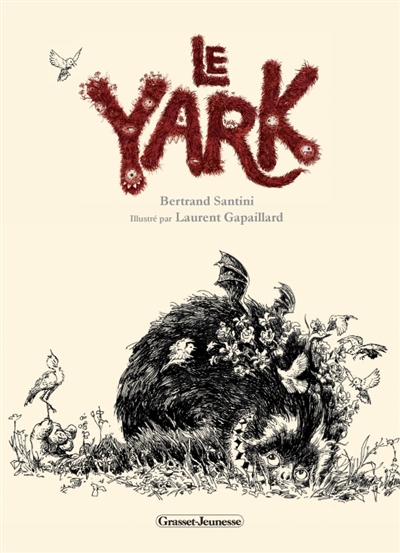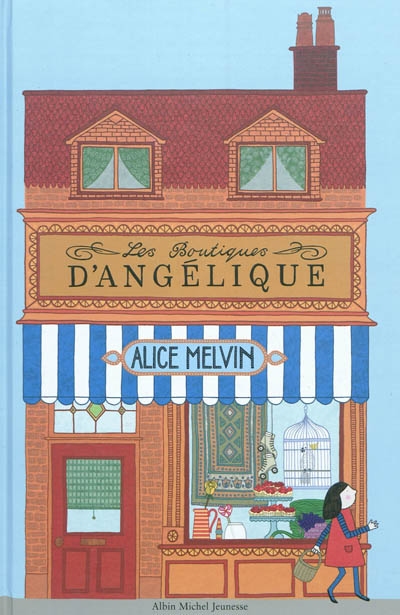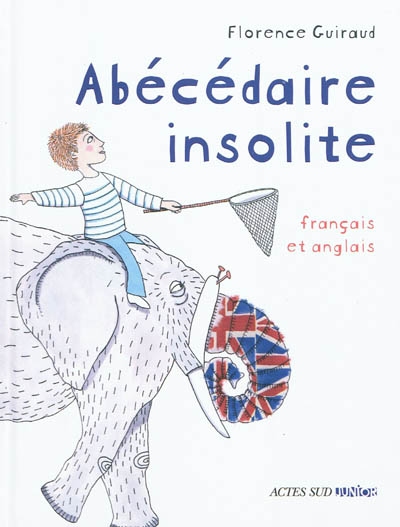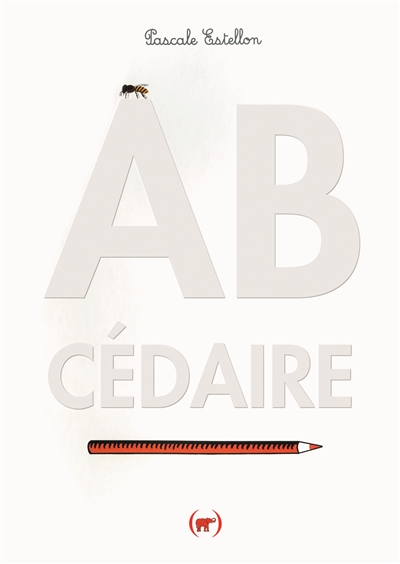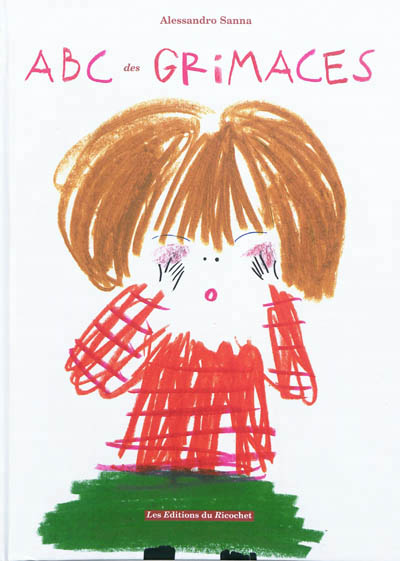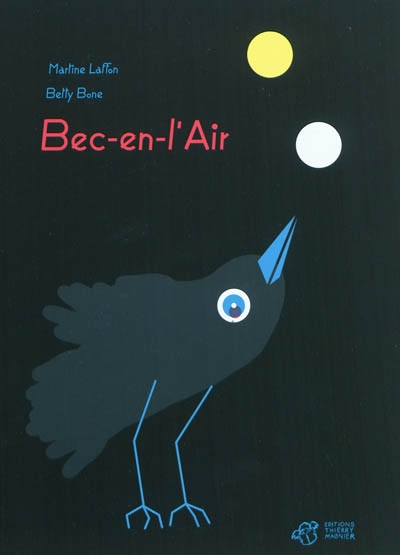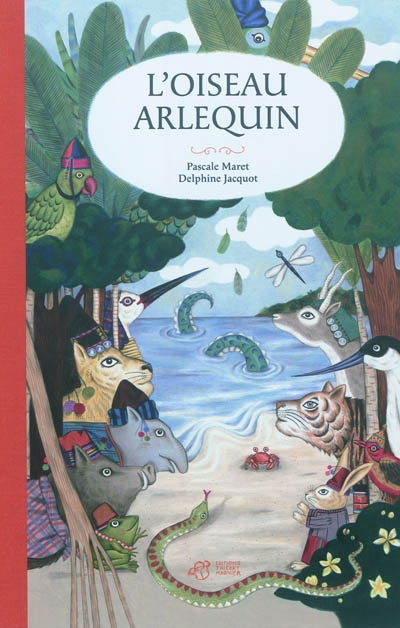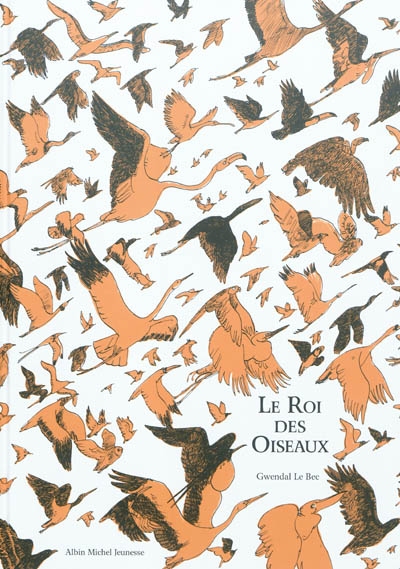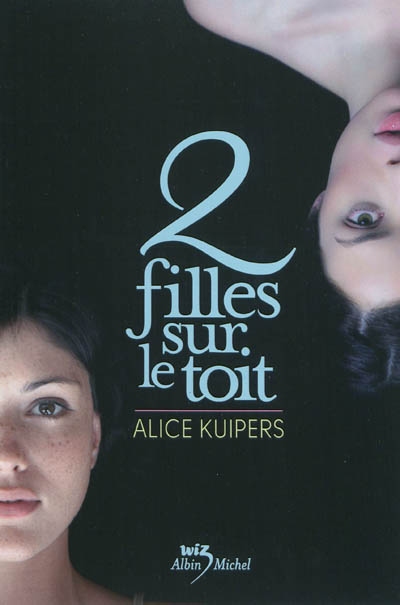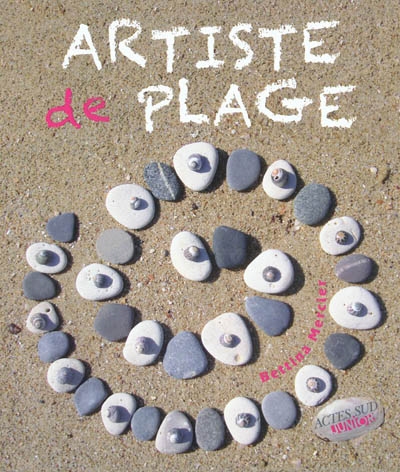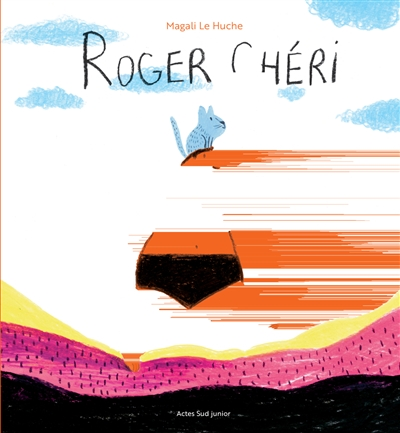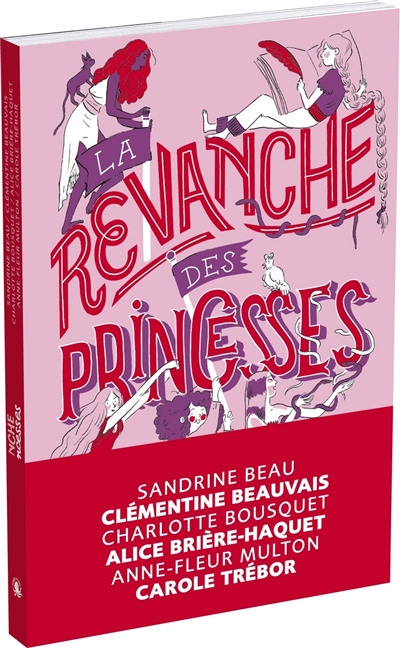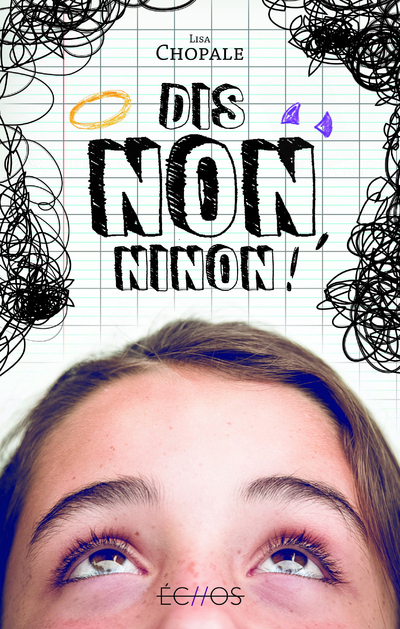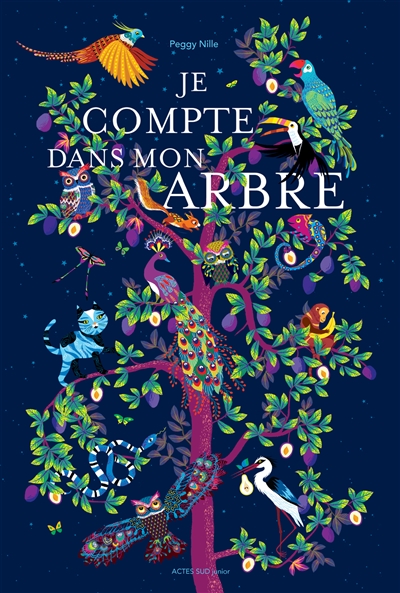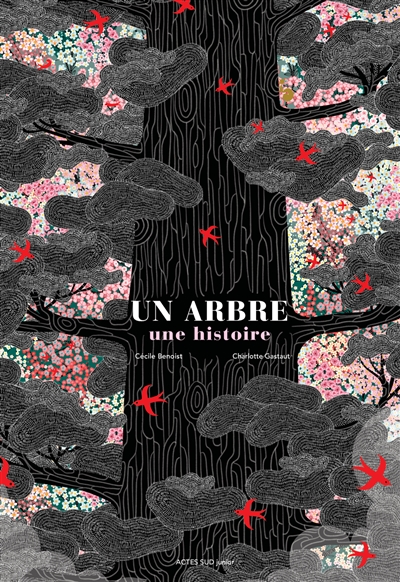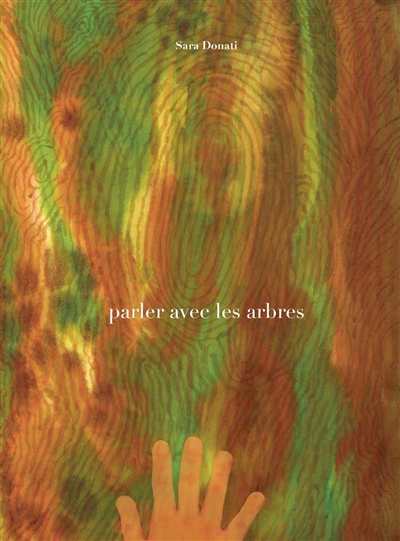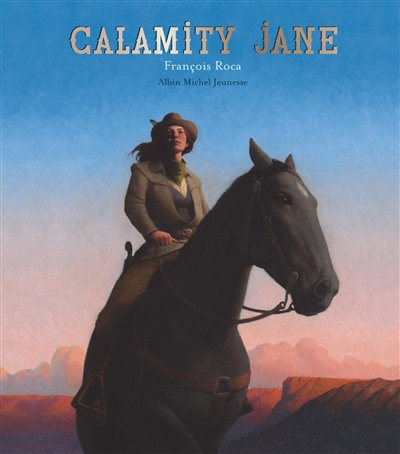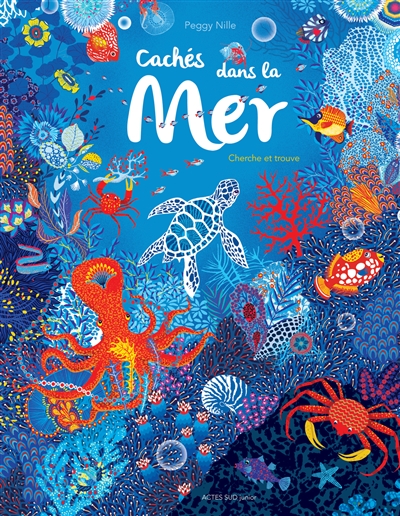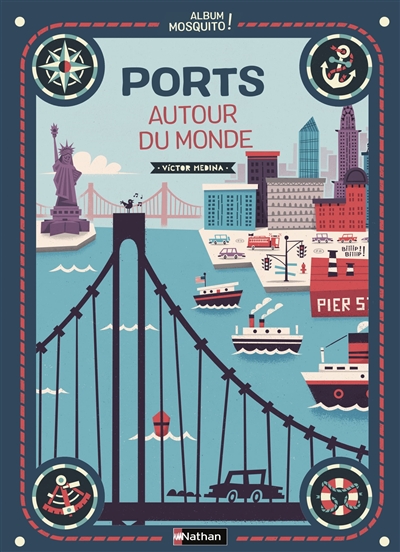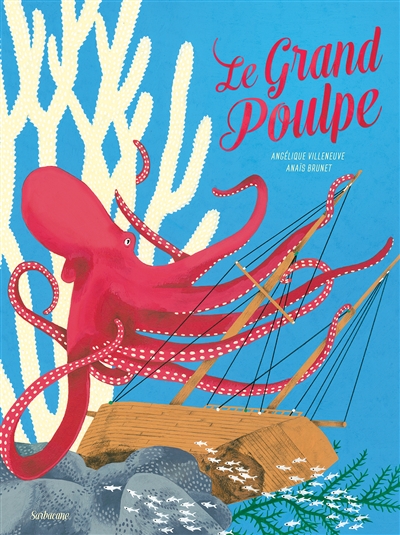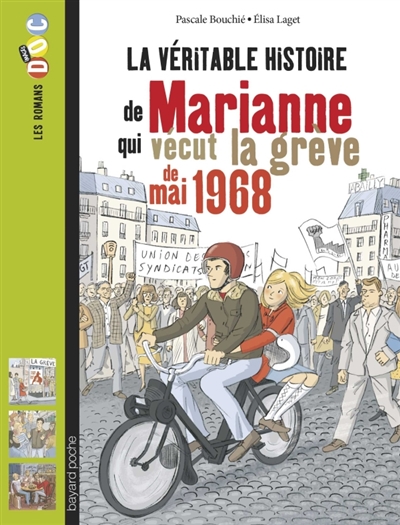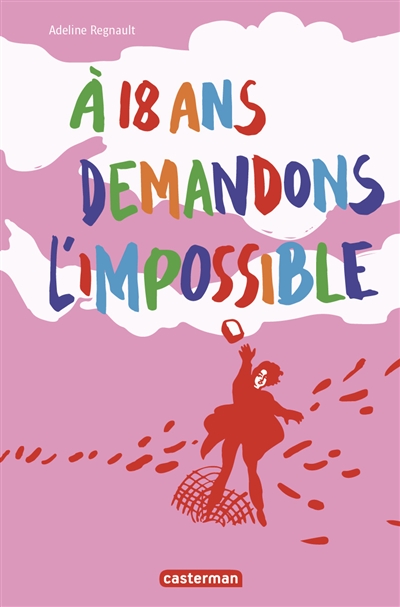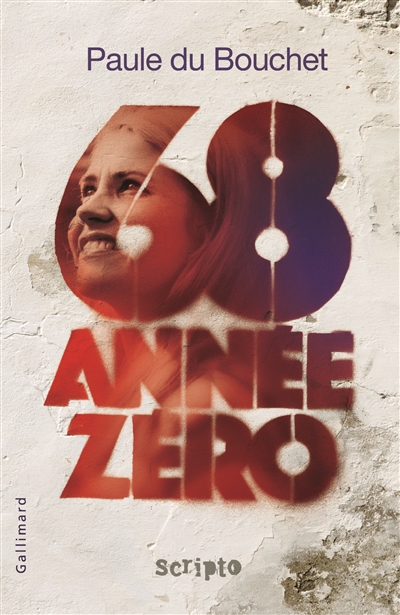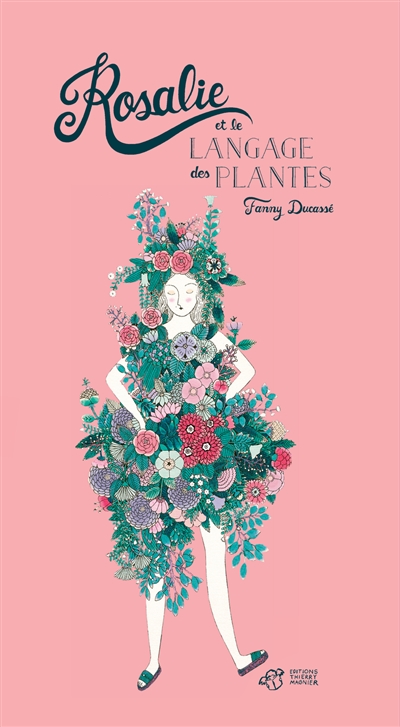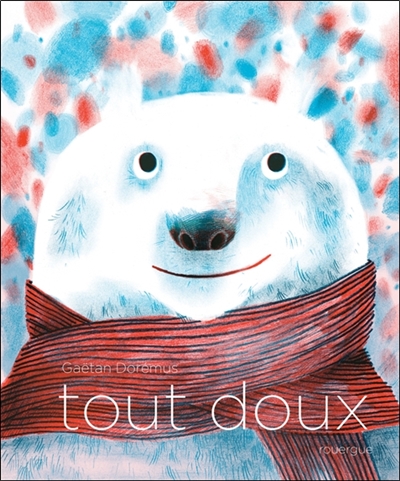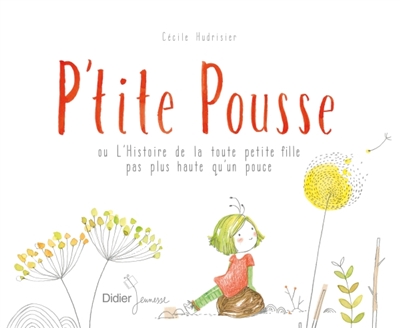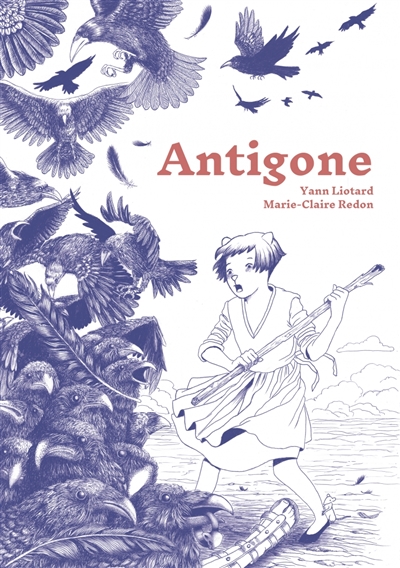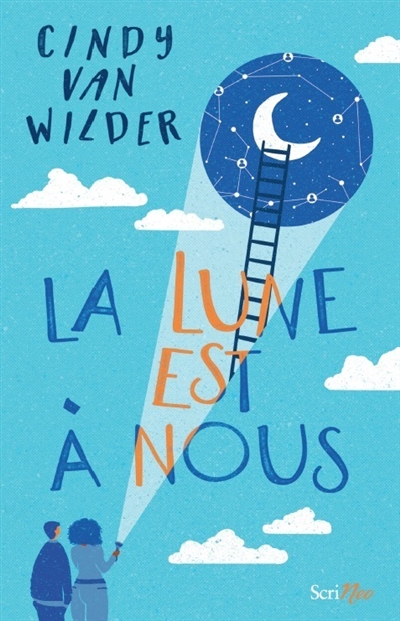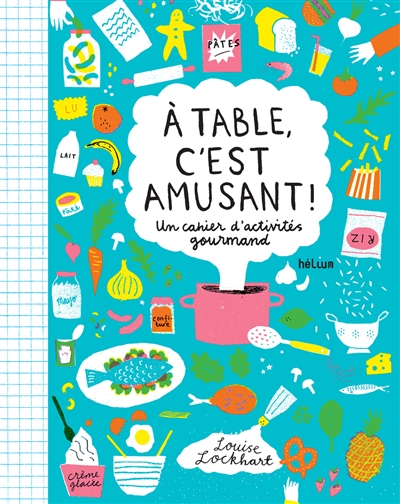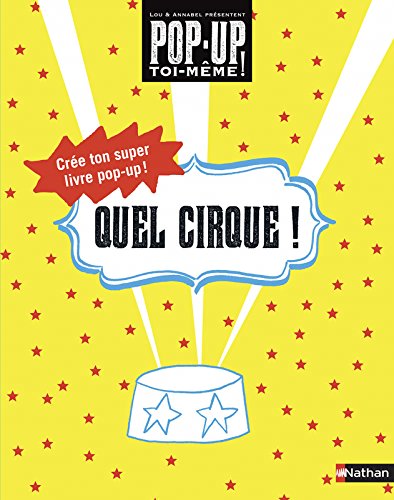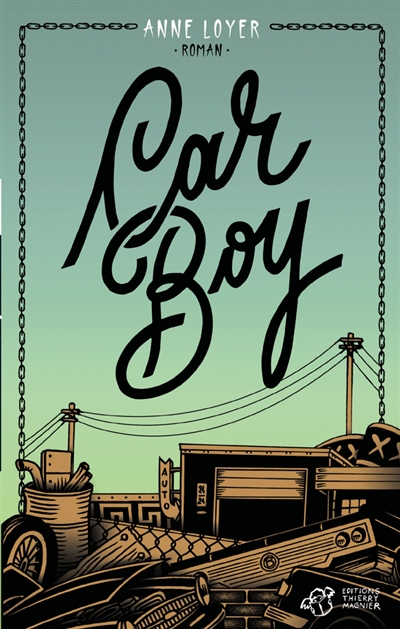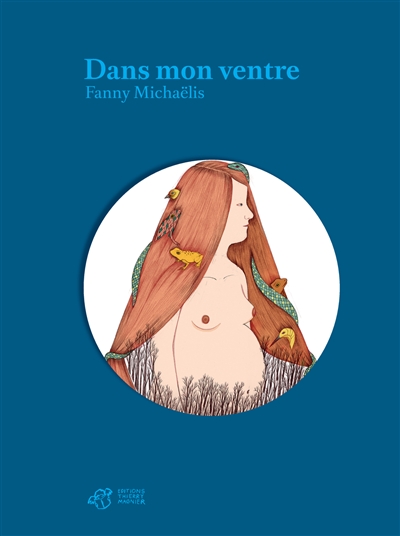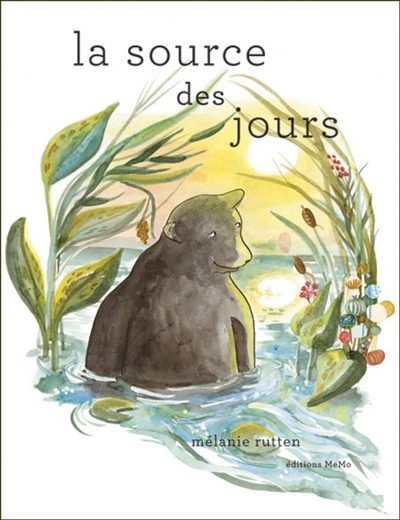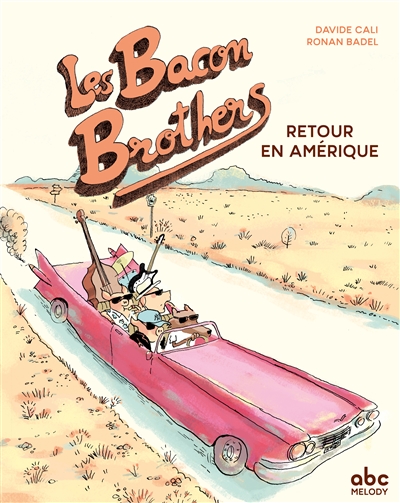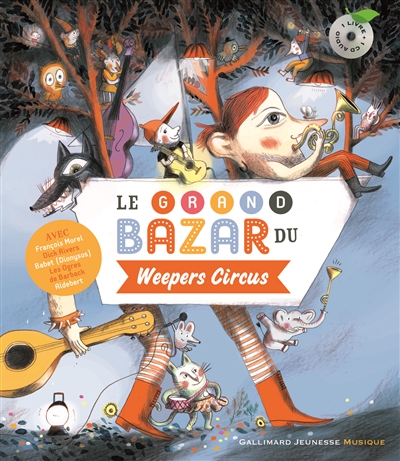Jeunesse
Susin Nielsen
Les optimistes meurent en premier

-
Susin Nielsen
Les optimistes meurent en premier
Traduit de l’anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec
Hélium
30/08/2017
192 pages, 14,90 €
-
Chronique de
Gaëlle Farre
Librairie Maupetit (Marseille) - ❤ Lu et conseillé par 19 libraire(s)

✒ Gaëlle Farre
(Librairie Maupetit, Marseille)
Comment revivre après avoir connu un drame ? C’est ce qui est au cœur du cinquième roman de Susin Nielsen, Les optimistes meurent en premier. Cette auteure, qui se distingue par son écriture pleine d’humour, nous offre un nouveau roman bouleversant, souvent drôle et toujours parfaitement juste.
PAGE — Vous avez d’abord écrit pour la télévision. Les optimistes meurent en premier est votre cinquième roman et j’ai découvert dans une interview que vous étiez en train d’écrire le sixième. Avez-vous toujours voulu écrire ? Pourquoi écrire pour les adolescents ?
Susin Nielsen — Visiblement, j’ai en effet toujours voulu être écrivain et j’en ai la preuve : il y a environ dix ans, j’ai retrouvé le tout premier journal intime que j’ai tenu ! J’avais 11 ans quand je l’ai commencé. Le premier paragraphe – et je ne n’invente rien – dit : « C’est le premier jour où j’écris vraiment dans un journal intime. La raison pour laquelle je fais ça, c’est parce que J’AIME écrire des histoires et si, en grandissant, je deviens une auteure célèbre et que je meurs ensuite, et qu’on veut connaître l’histoire de ma vie, je suppose que je devrais tenir un journal intime. » Je ne suis honnêtement pas sûre de savoir pourquoi, précisément, je suis attirée par l’écriture pour les adolescents. Je pense que cela a trait au fait que j’ai commencé à écrire très jeune pour la série télé canadienne Les Années collège, que j’ai continué à beaucoup écrire pour les séries TV ados et « tweens » (jeunes adolescents). Mais je considère aussi que l’adolescence est un moment tumultueux et fascinant de la vie où l’on expérimente beaucoup de choses pour la première fois, où l’on essaie de comprendre qui on va devenir. Enfin, je pense vraiment qu’une partie de mon cerveau a cessé de grandir quand j’avais 13 ans !
P. — J’aime la variété des thèmes que vous traitez. Vos romans sont comme la vie. Vous n’hésitez pas à aborder des sujets délicats, notamment le deuil, les familles monoparentales ou recomposées. Y a-t-il des thèmes que vous n’avez pas encore traités que vous voudriez explorer ?
S. N. — J’ai remarqué que dans tous mes livres, il y a des familles non traditionnelles, et je suis certaine que c’est parce que, moi aussi, j’avais une famille non traditionnelle (une mère célibataire, un père que je n’ai pas rencontré avant d’avoir 15 ans, tout comme mon demi-frère et ma demi-sœur ; plus tard, j’ai aussi gagné un beau-père et quatre demi-frères et sœurs). Je constate aussi que dans certains de mes livres, je me retrouve à parler de choses, de gens ou d’événements à propos desquels j’ai été très critique dans le passé ; de choses que j’ai eu tendance à voir en noir et blanc. Par exemple, dans Le Journal malgré lui de Henry K. Larsen (Hélium, 2013), je parle d’un garçon dont le frère est l’auteur d’une fusillade dans une école. Je n’avais eu de la compassion que pour les familles des victimes, jamais pour celles des responsables, jusqu’à ce que je commence à écrire ce roman. Quelque chose de similaire s’est produit concernant ce que l’on découvre à propos de Jacob, plus tard, dans Les optimistes meurent en premier. J’aime me forcer à regarder au-delà de mes réactions hâtives. Donc, qui sait sur quoi j’écrirai par la suite ?
P. — L’humour est intrinsèque à votre écriture. Pourriez-vous nous dire pourquoi avoir le sens de l’humour et rire semblent si importants ?
S. N. — Cela a toujours fait partie de mon écriture, même dans la plupart de mes scénarios pour la télévision. C’est juste une partie de ce que je suis et de la façon dont j’essaie de voir le monde. J’ai l’impression que si nous ne riions pas, tout ce que nous ferions serait pleurer ! J’adore insérer de l’humour dans mes histoires.
P. — Dans ce roman, vos personnages sont plus âgés que dans vos textes précédents et vous parlez en particulier du premier amour, de la première expérience sexuelle aussi. Qu’est-ce qui vous plaît dans cet âge ?
S. N. — J’ai écrit sur des personnages plus âgés et le premier amour car j’ai assez récemment observé mon fils vivre lui-même son premier amour. C’est une expérience tellement enivrante, vraiment exceptionnelle et souvent déchirante. Et je souhaitais réellement décrire une expérience positive de la première fois pour mon personnage principal féminin : une première fois dont elle est partie prenante, où elle est aux commandes. J’ai l’impression que cela manque dans beaucoup de romans pour jeunes adultes. Je voulais que les jeunes femmes voient que ce n’est pas nécessairement misérable, contraint ou uniquement plaisant pour le garçon.
P. — Avez-vous des souvenirs de vos lectures à cet âge ?
S. N. — La littérature jeune adulte n’était pas un genre important quand j’étais ado mais elle commençait à émerger. Mon roman préféré quand j’avais environ 9-12 ans était Harriet l’espionne de Louise Fitzhugh et c’est toujours un grand favori. Dans les romans « jeunes adultes », je me souviens de My Darling, my Hamburger de Paul Zindel – le roman parle de l’avortement – et j’ai dévoré de nombreux romans de Judy Blume. Ils m’ont fait sentir que je n’étais pas seule et j’espère que c’est ce que je fais avec mes romans également.
P. — Quelle est votre relation avec l’art et l’art-thérapie en particulier, un sujet fascinant mais peu abordé en littérature ? Est-ce que ce roman vous a obligée à faire beaucoup de recherches ?
S. N. — Je n’ai jamais pratiqué l’art-thérapie, mais je connais des gens qui en ont fait. Je pense que c’est un outil incroyablement précieux. La pauvre Betty n’est pas nécessairement le bon professeur pour ces étudiants plus âgés, mais je pense qu’ils apprennent d’elle, qu’ils se l’avouent ou non. J’ai fait beaucoup de recherches en ligne, j’ai aussi des amis qui sont thérapeutes. En réalité, je savais que j’avais besoin d’un endroit où ces enfants blessés seraient obligés d’aller et j’ai choisi l’art-thérapie car je voulais à tout prix une scène de marionnettes faites à partir de chaussettes.
P. — « Il s’est accroché à moi et je me suis accrochée à lui. Ensemble, nous avons réussi à ne pas tomber. » Cet extrait représente pour moi très bien votre roman.
S. N. — Je suis tellement contente d’entendre cela ! J’adore ce passage aussi ! J’ai beaucoup tourné autour de ce moment. Je ne voulais pas que l’on croie une seconde que seul Jacob avait « guéri » Pétula, mais que s’ils restaient amis, ils pourraient s’entraider. J’aime assez bien aussi, plus tôt dans le livre, sa liste des transgressions qu’elle voit quand elle marche dans la rue ; après sa liste, elle dit : « Soit ils étaient idiots, soit c’étaient des optimistes. Probablement les deux. “Je vous enterrerai tous”, ai-je grommelé entre mes dents. »
À propos du livre
Pétula a 16 ans et c’est la culpabilité qui dirige sa vie depuis le drame qui a touché sa famille trois ans plus tôt, un drame dont elle pense être l’unique responsable. Persuadée que le pire la guette à tout instant, elle ne laisse rien au hasard. Elle a ainsi développé nombre de tocs pour se rassurer et se punir tout à la fois, mais également éviter que ses parents ne soient en conflit. Au lycée, elle est contrainte de suivre les cours d’ARTPSY, des cours d’art-thérapie qui réunissent les adolescents à problèmes de l’établissement. C’est lors de l’arrivée d’un nouvel élève à ces cours, Jacob – Pétula le surnomme « l’Homme Bionique » en raison de sa main en titane –, que le quotidien parfaitement balisé de l’héroïne va se retrouver chamboulé. Très vite, les fragilités de Pétula et Jacob se reconnaissent, ils vont laisser tomber leurs masques et se confier l’un à l’autre. Peu à peu, ils vont s’autoriser à nouveau à vivre, à sourire et surtout à le faire sans (trop) culpabiliser.