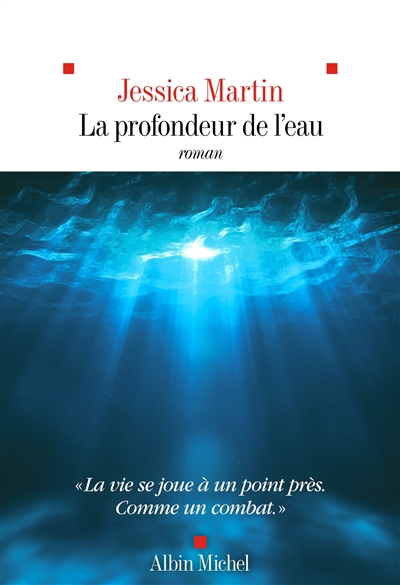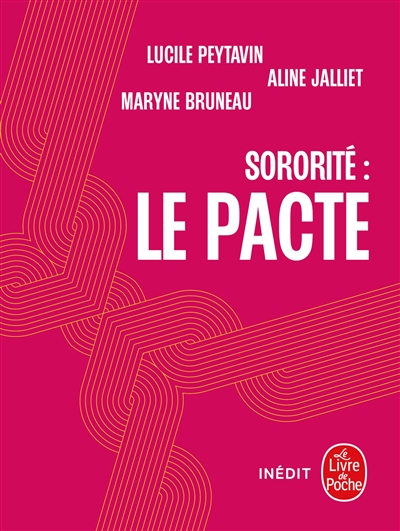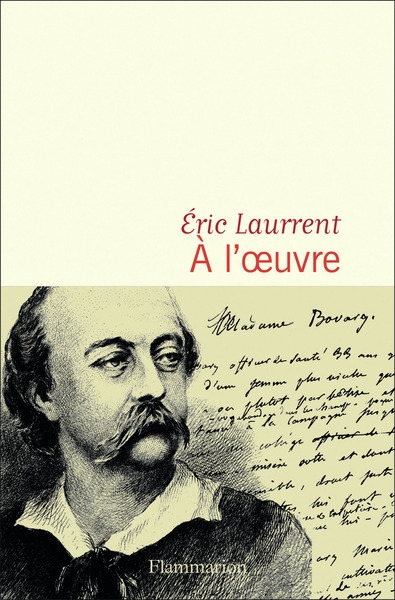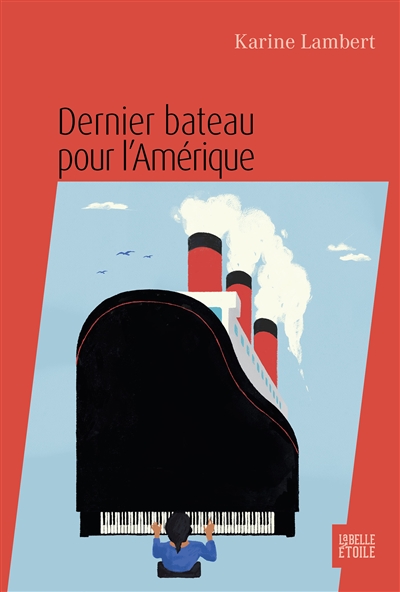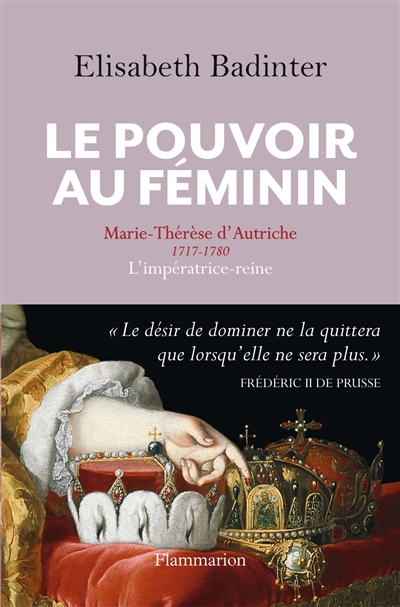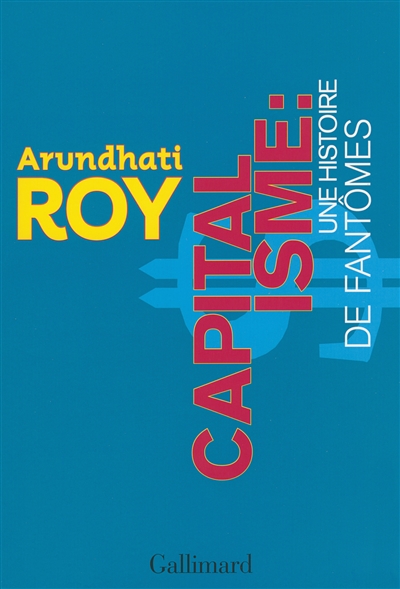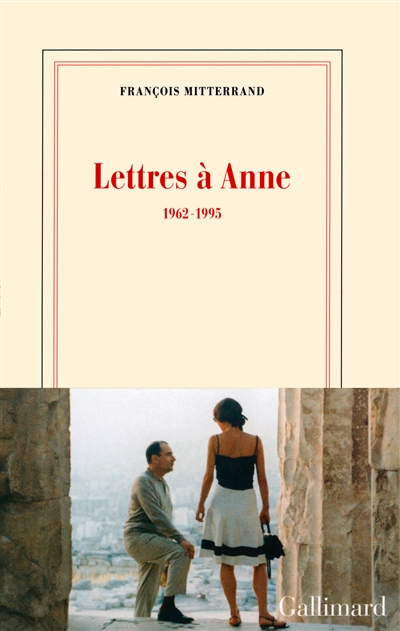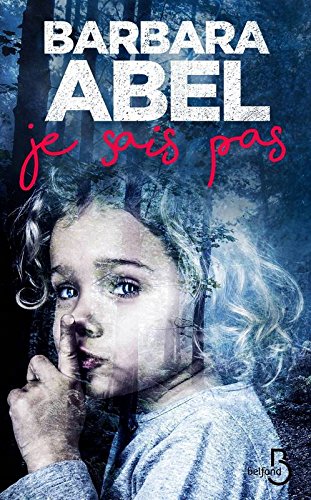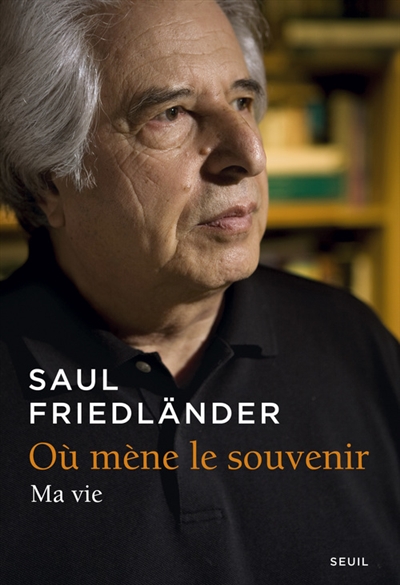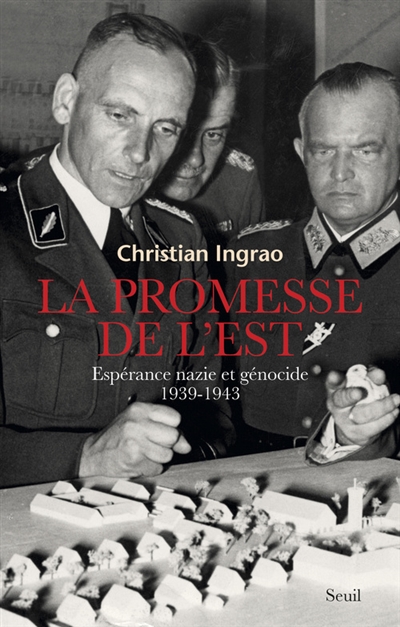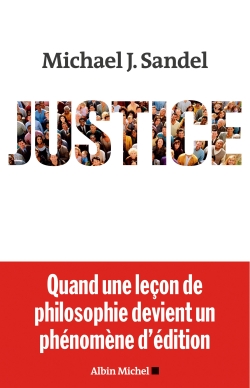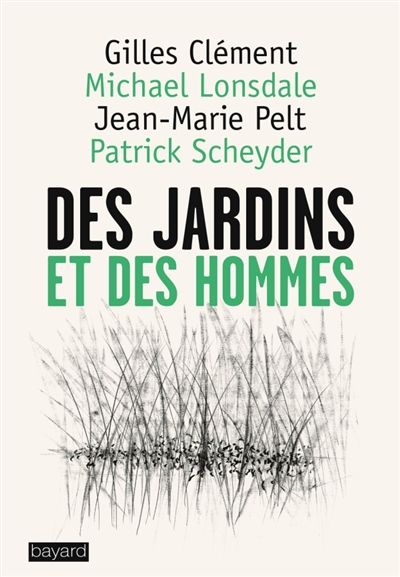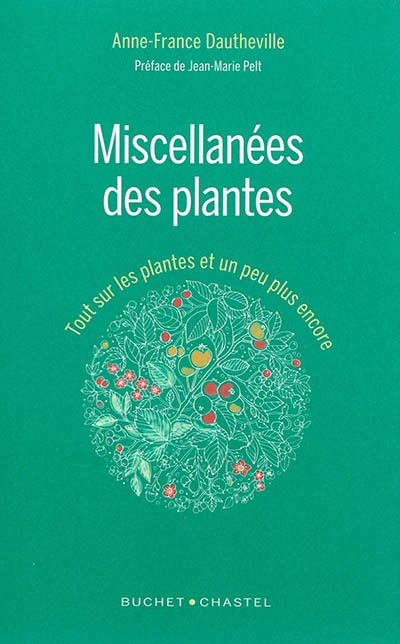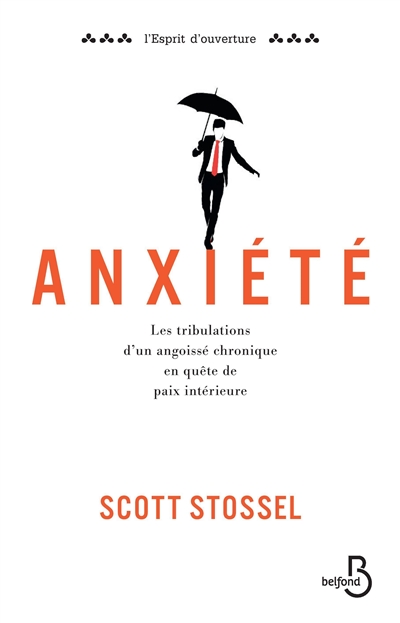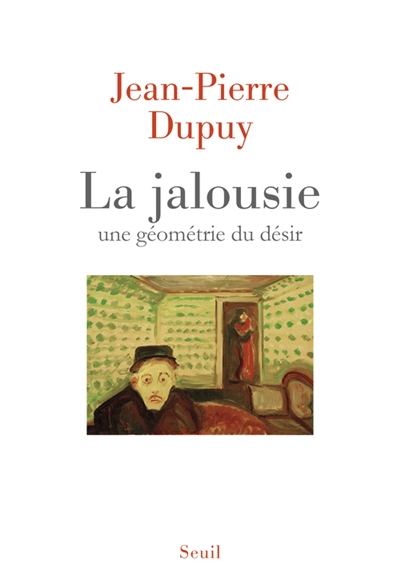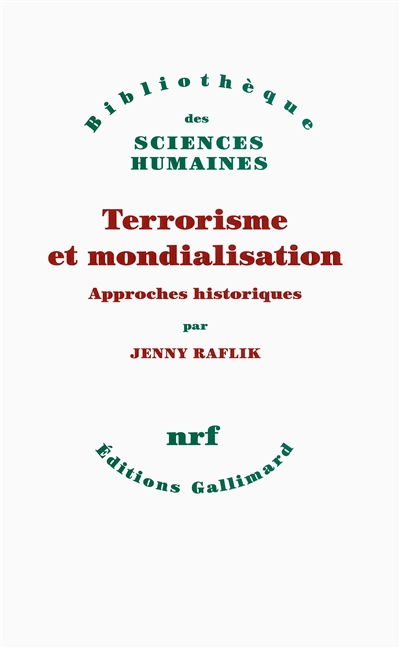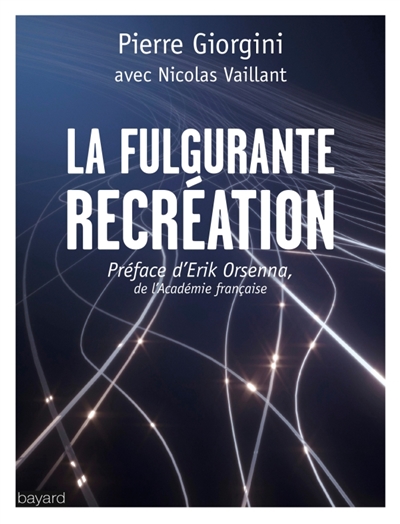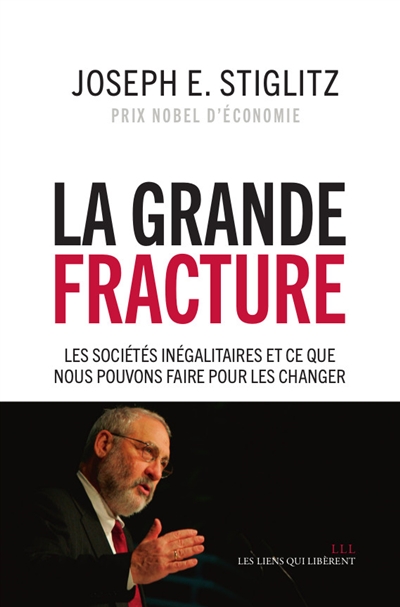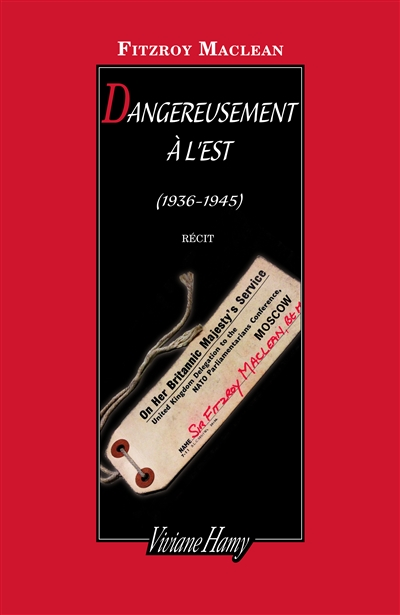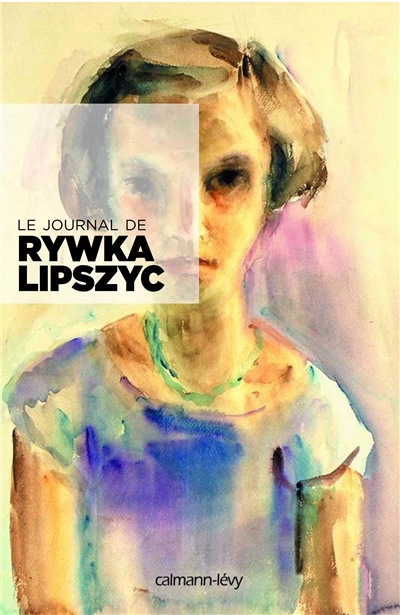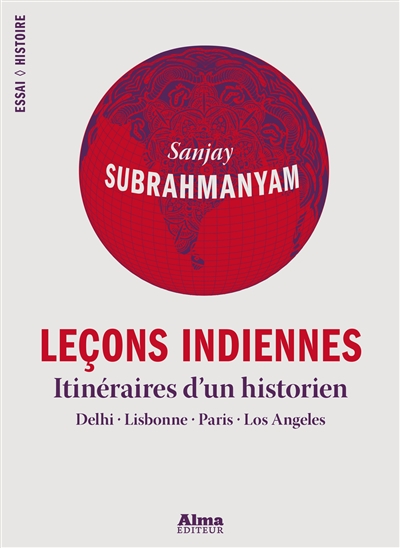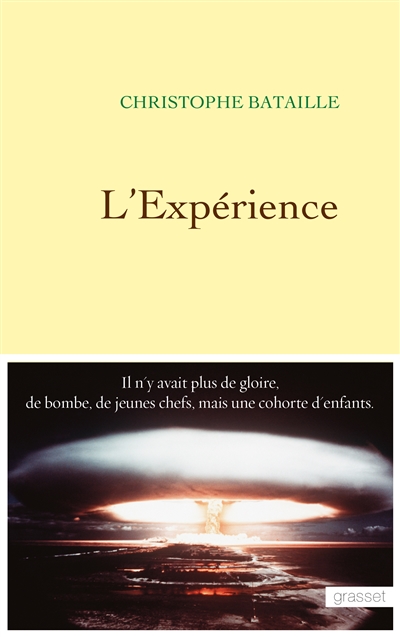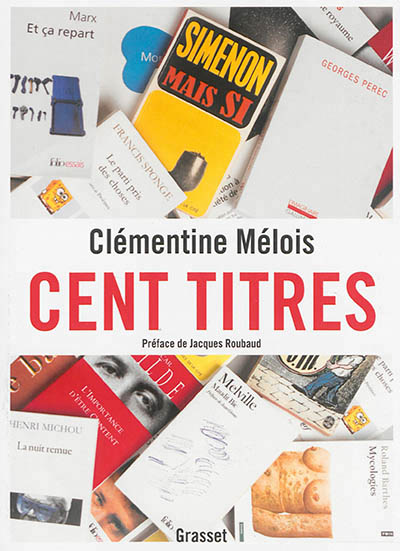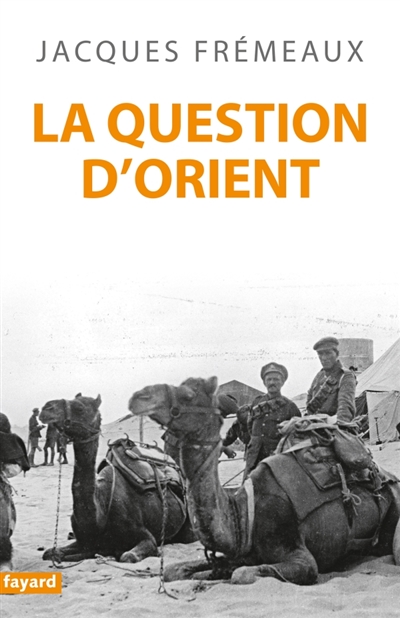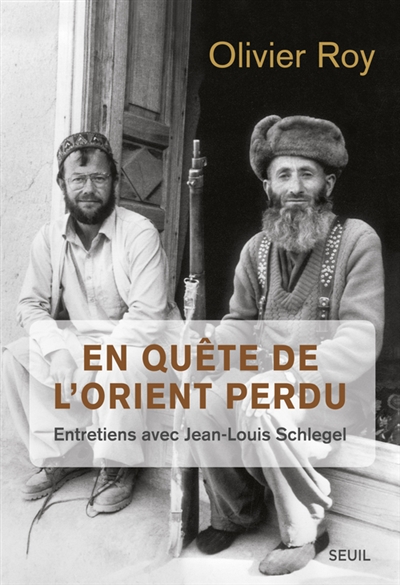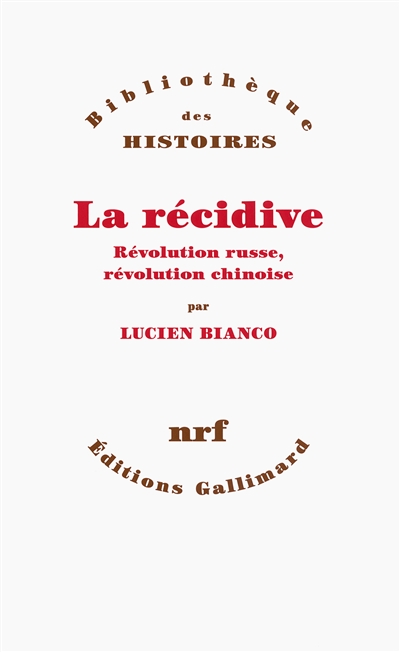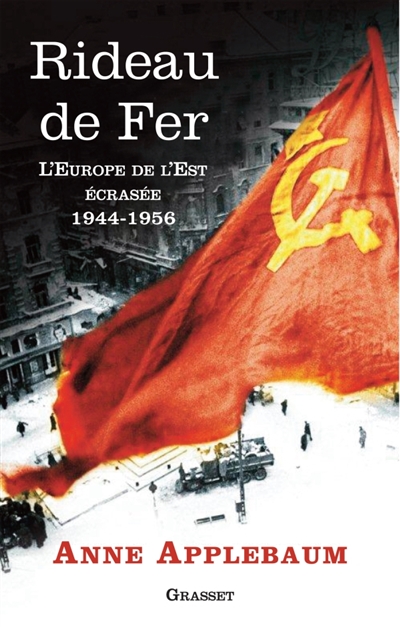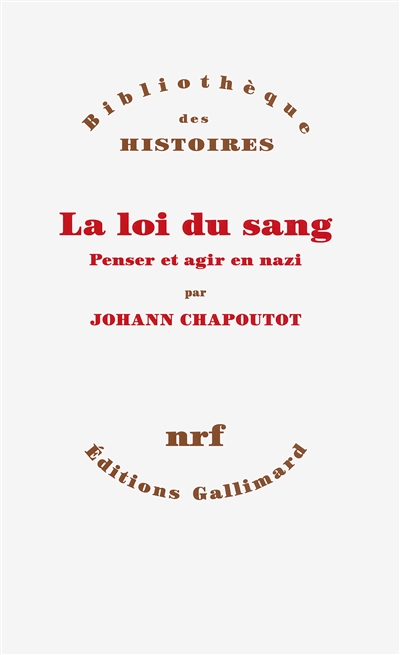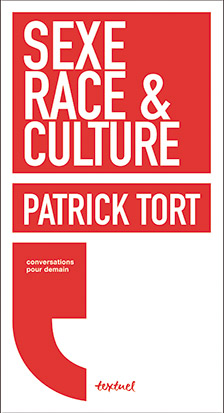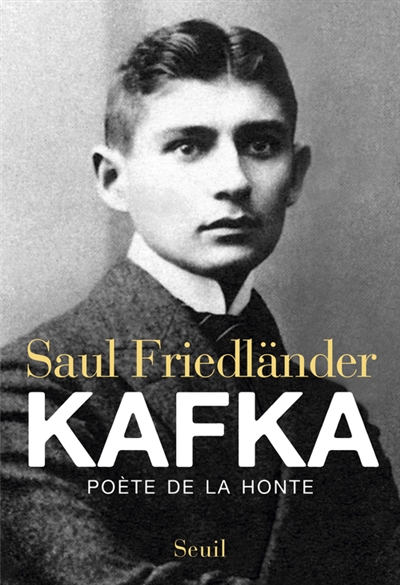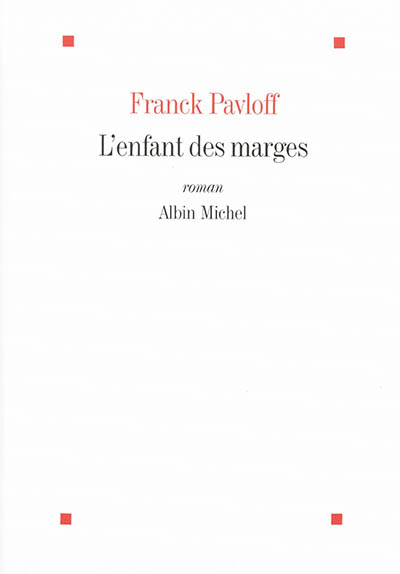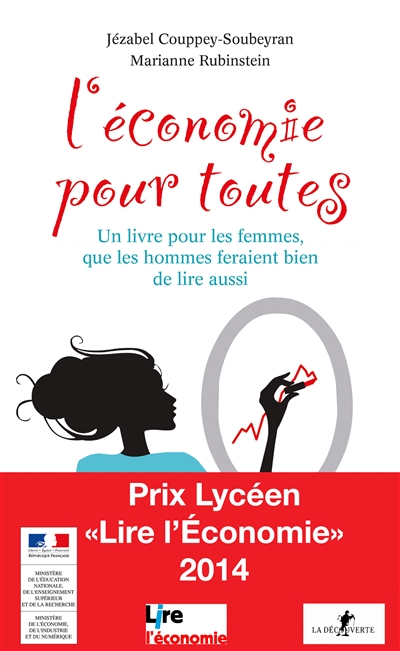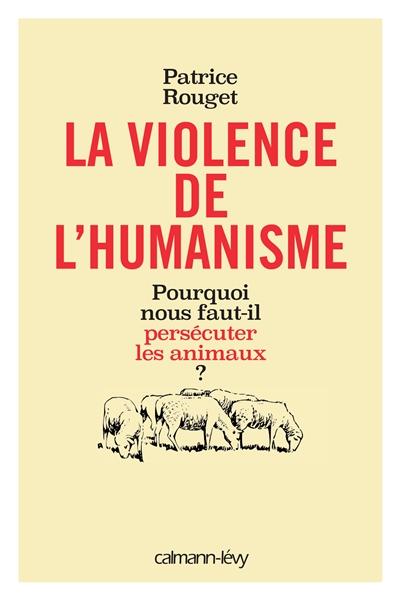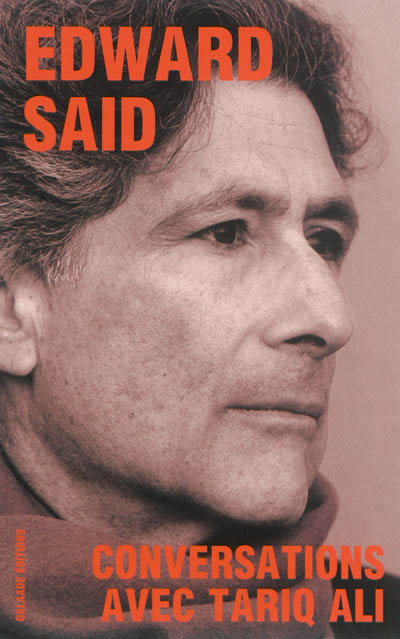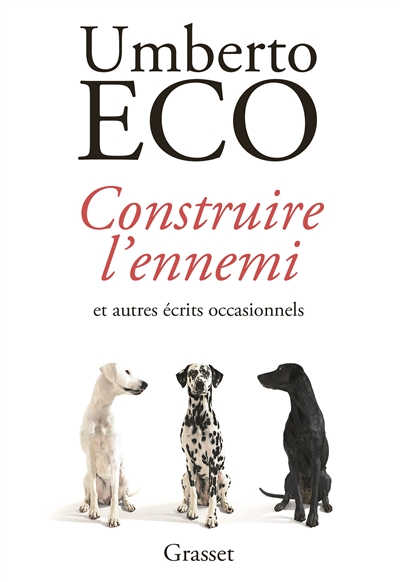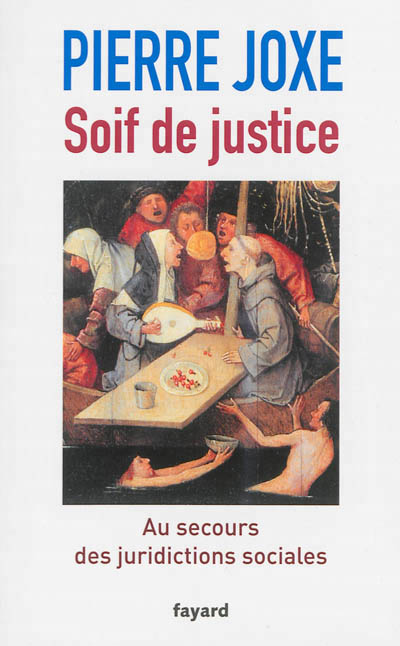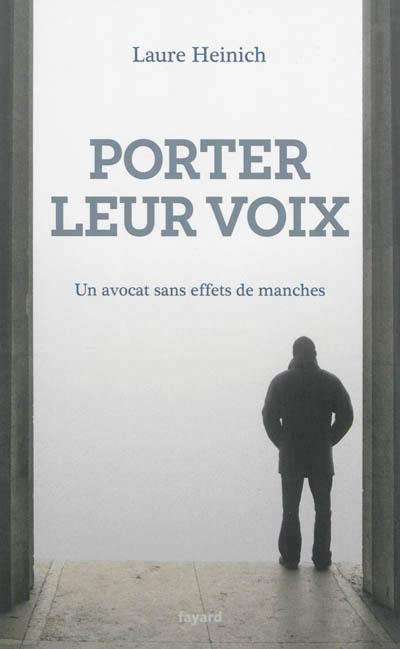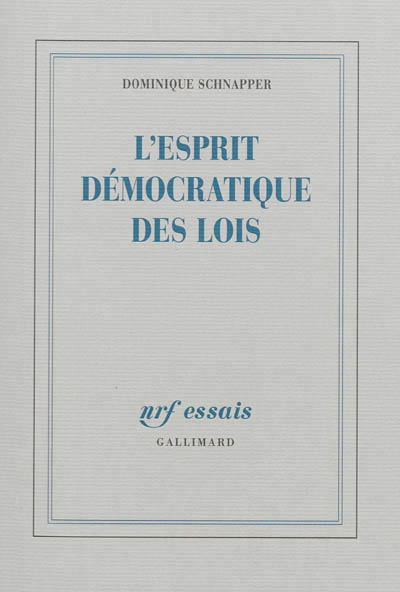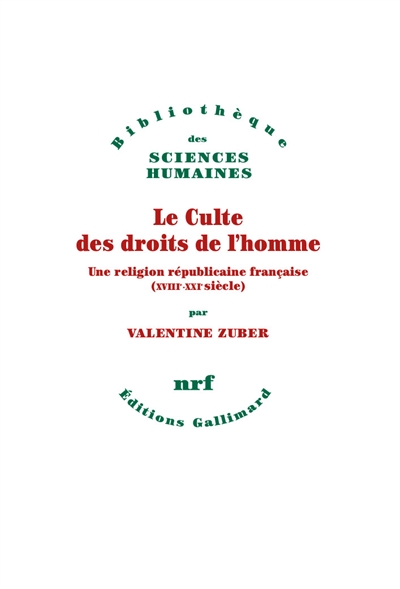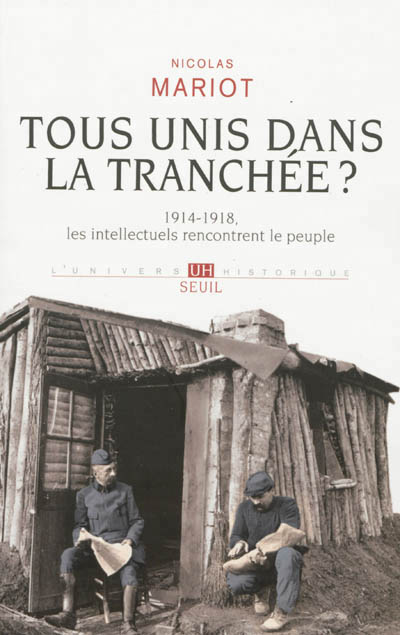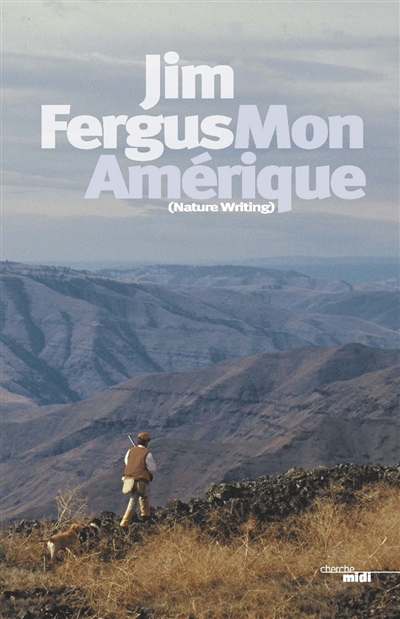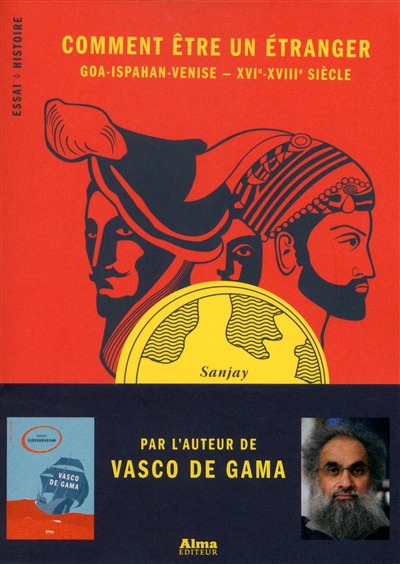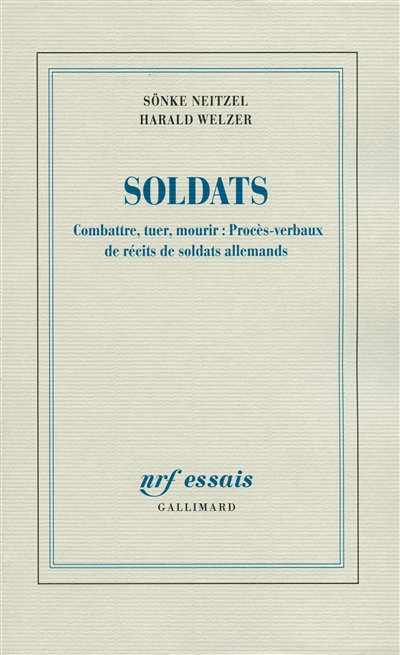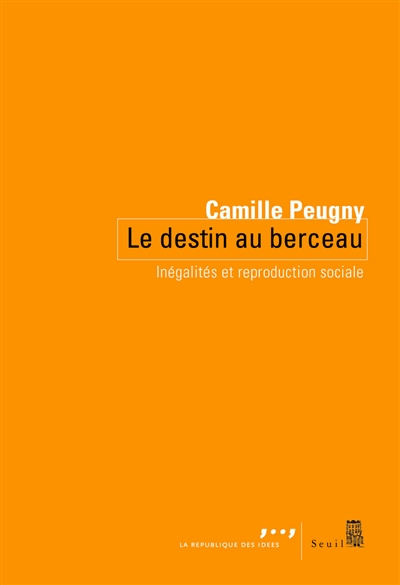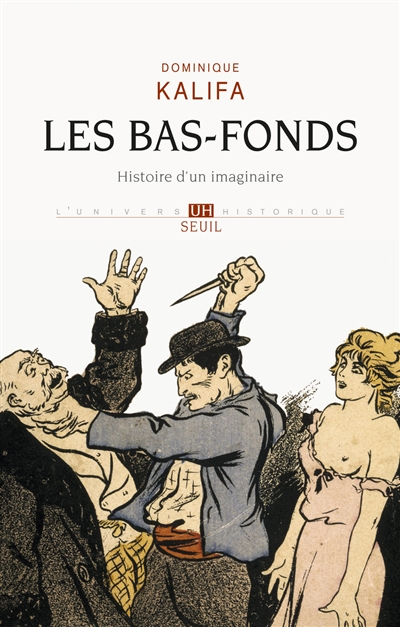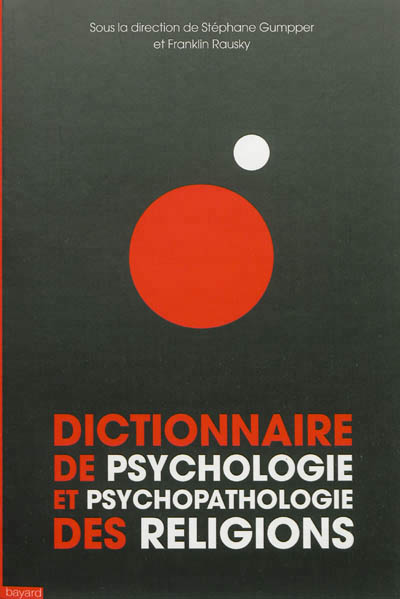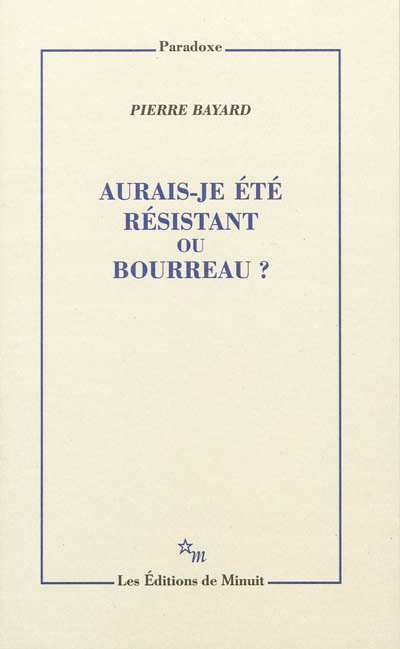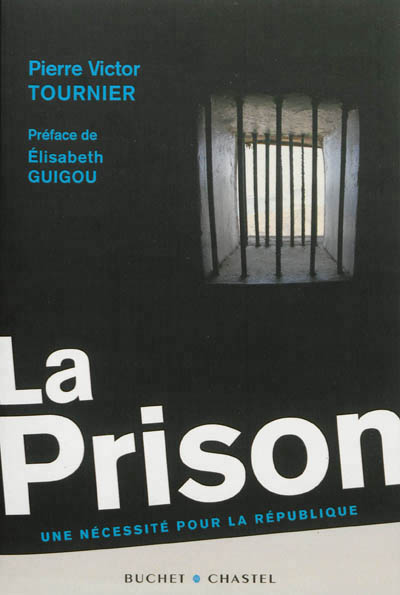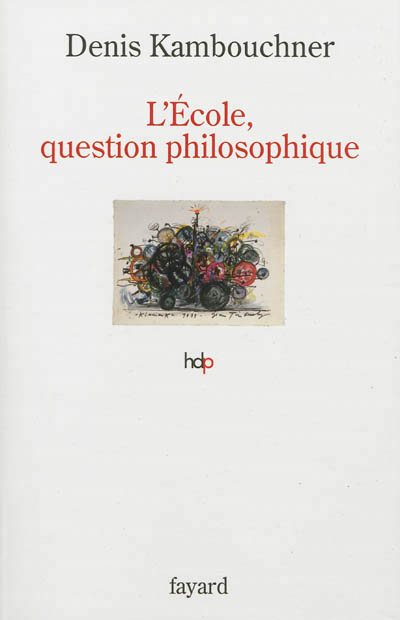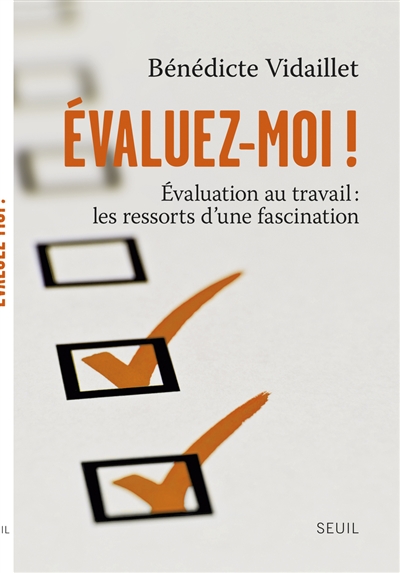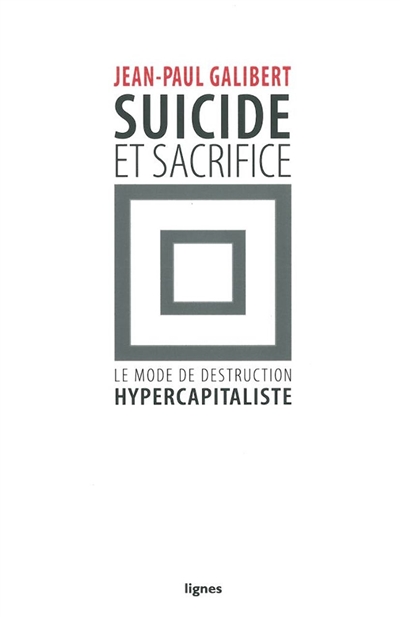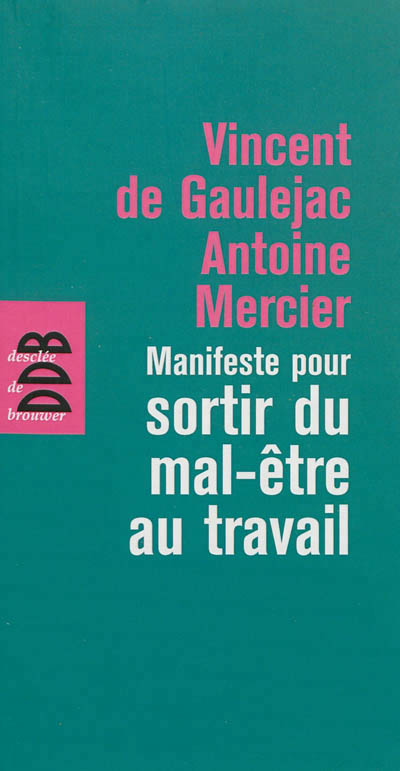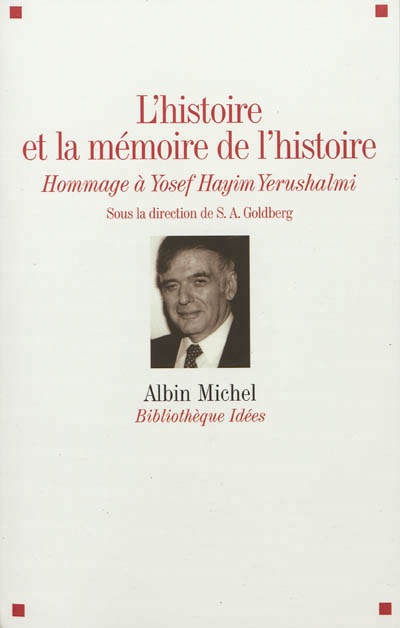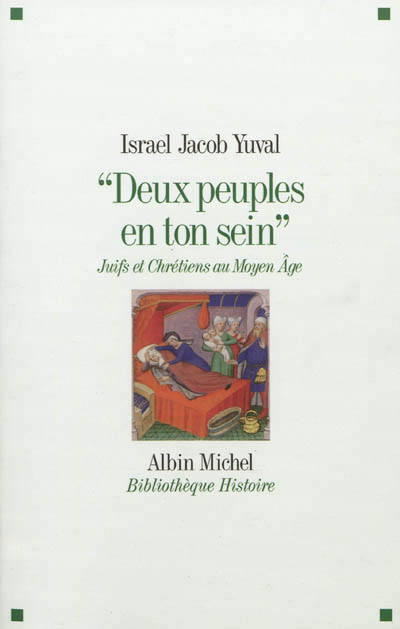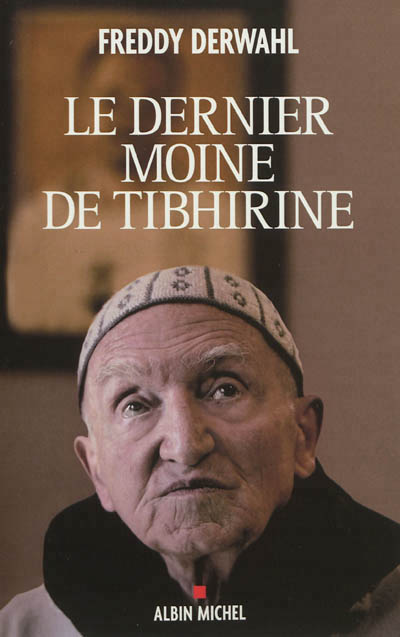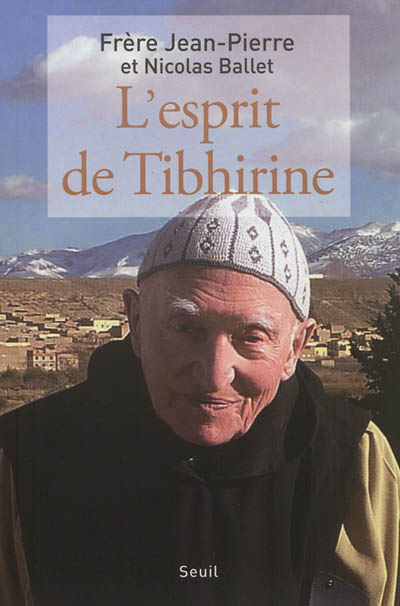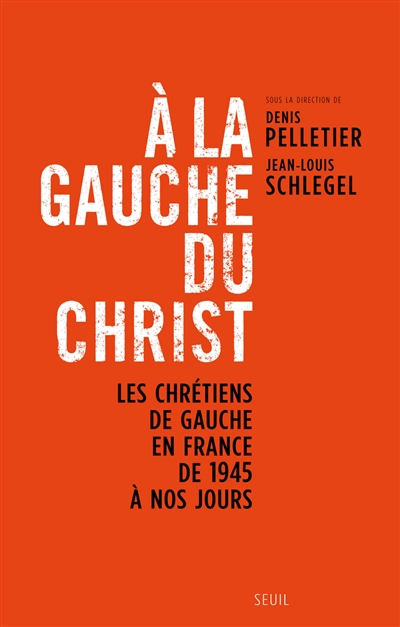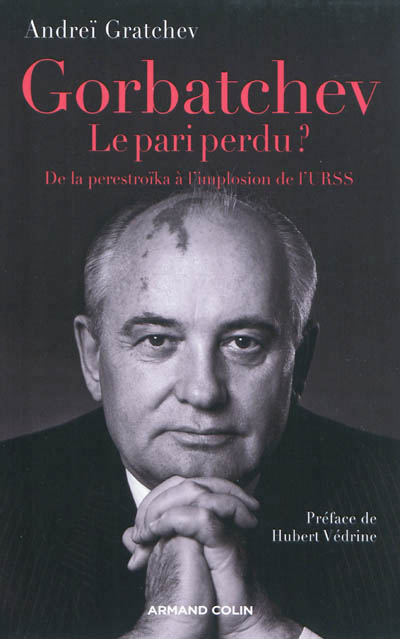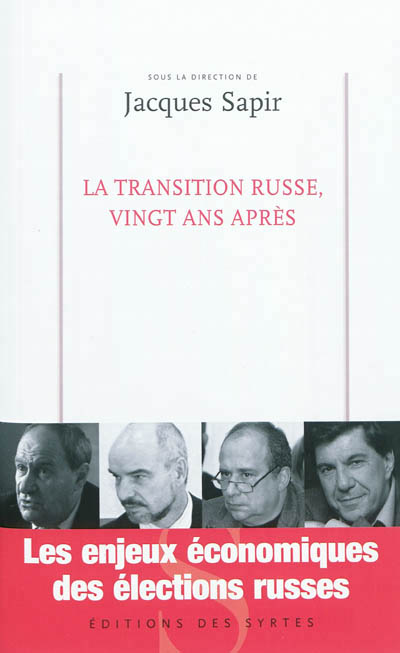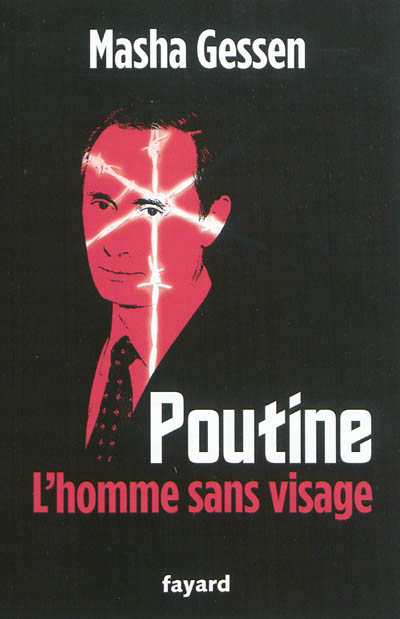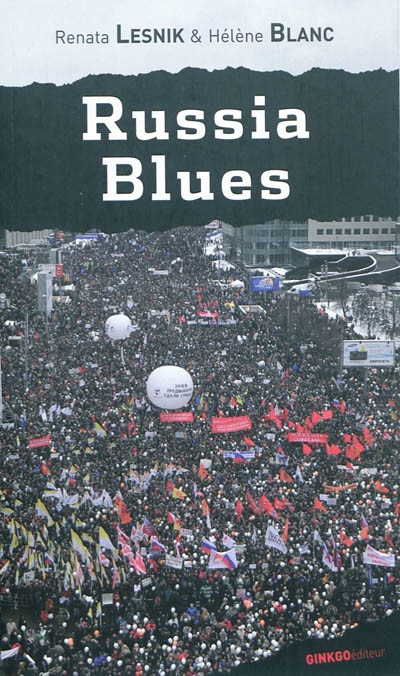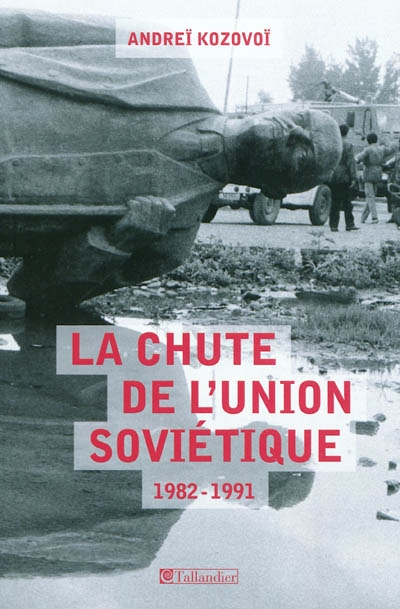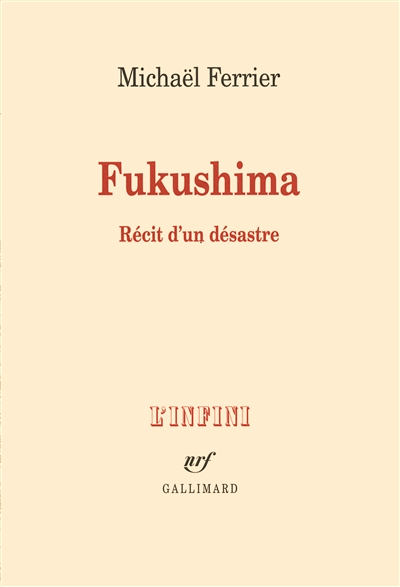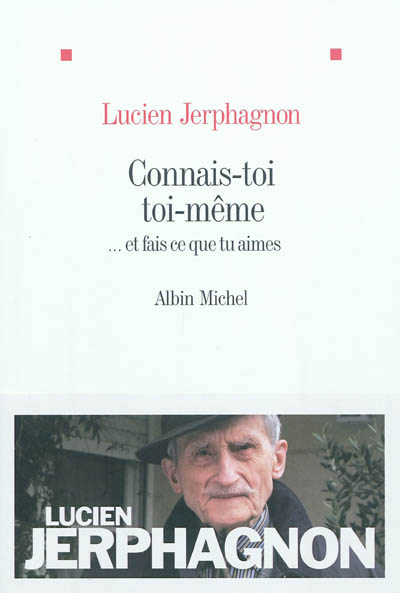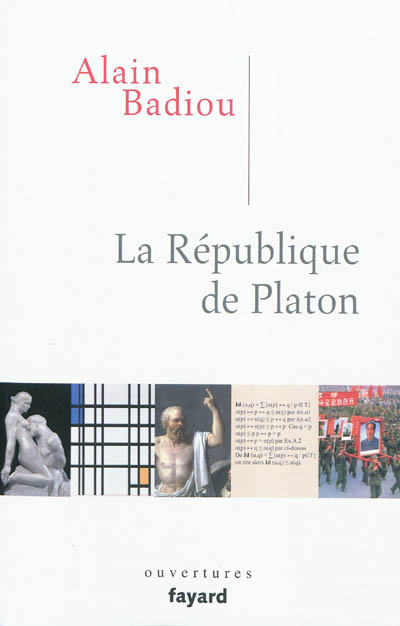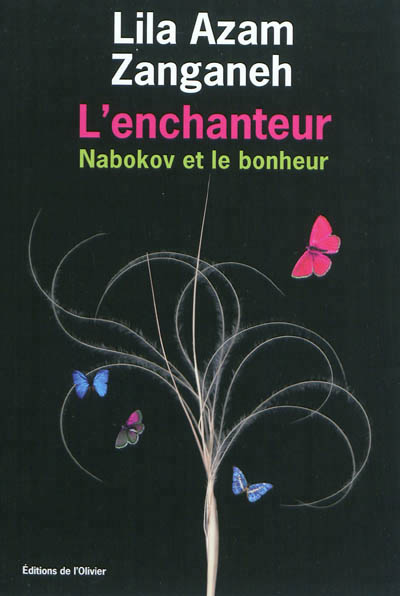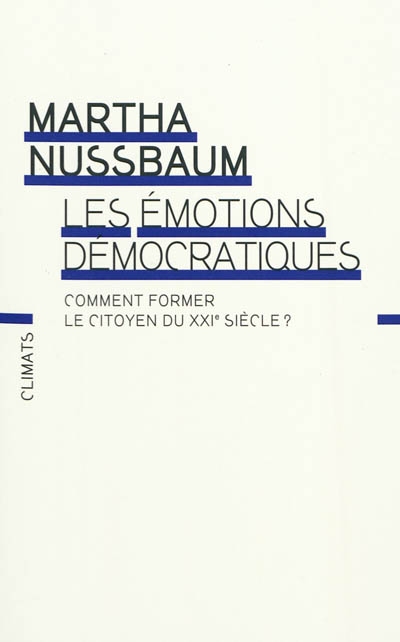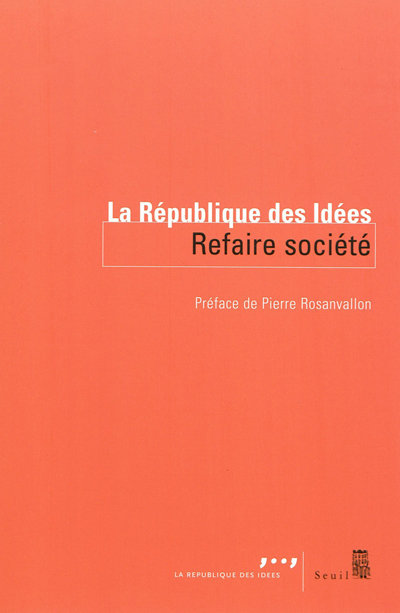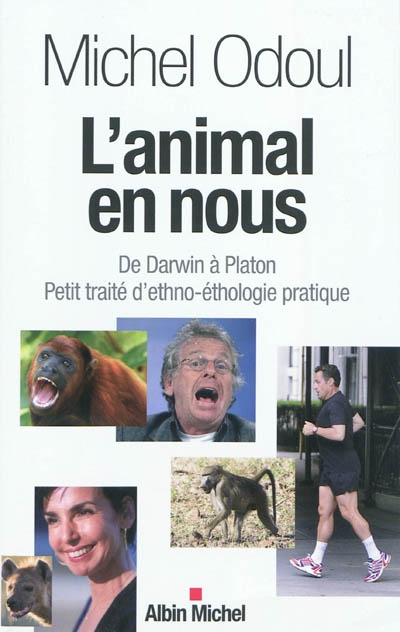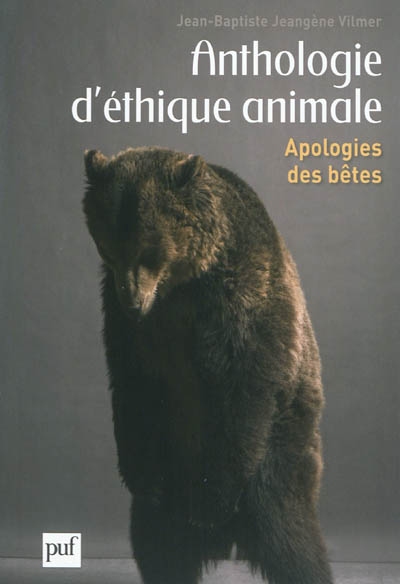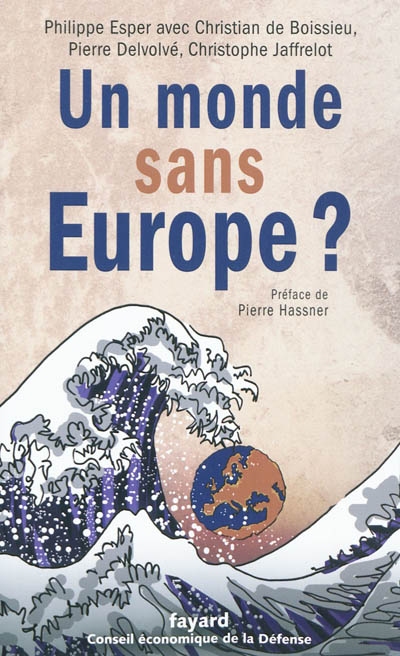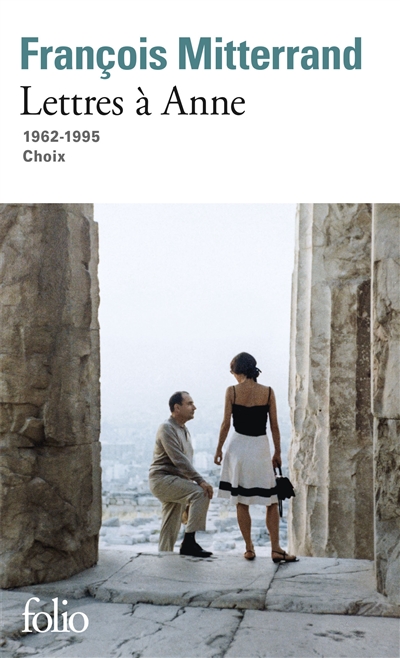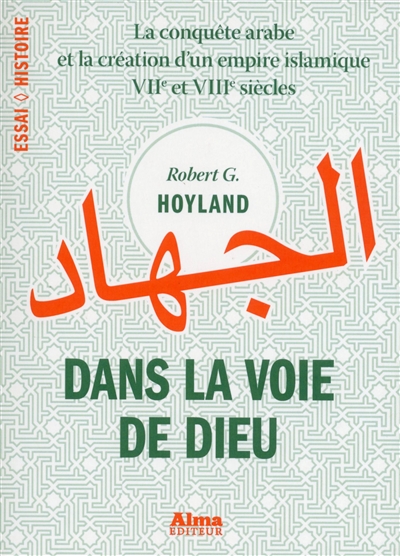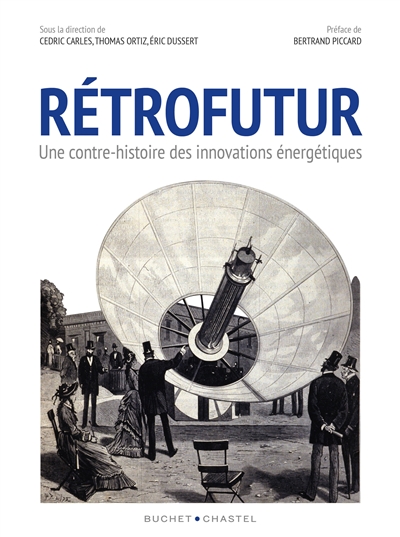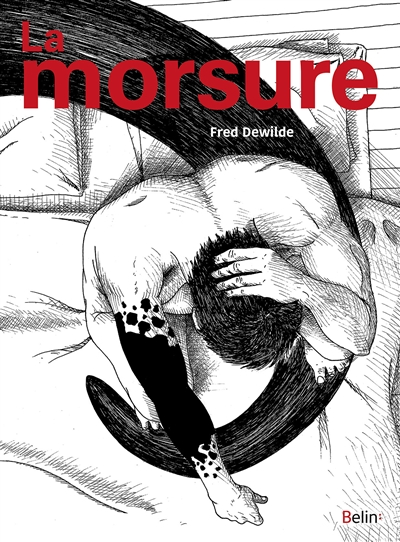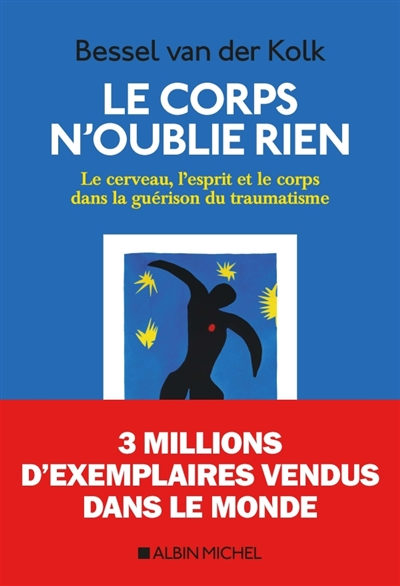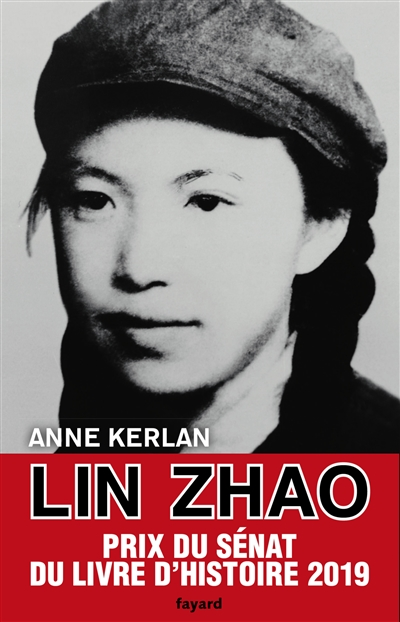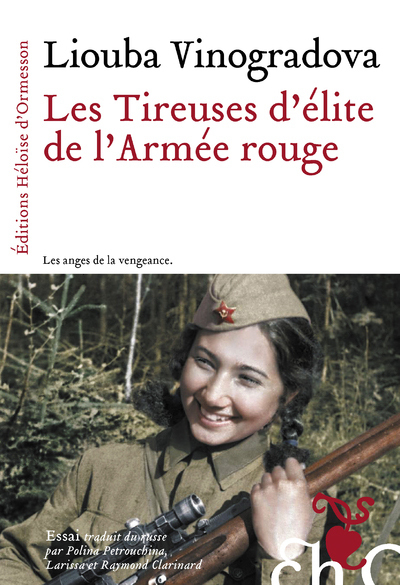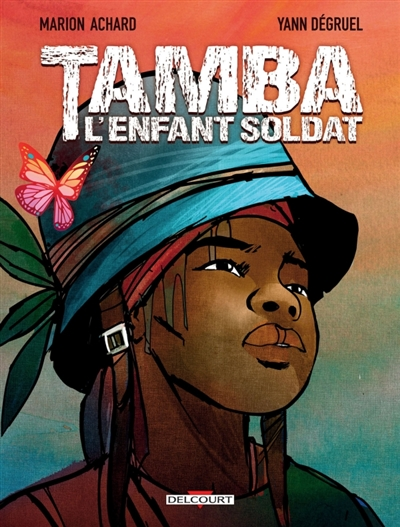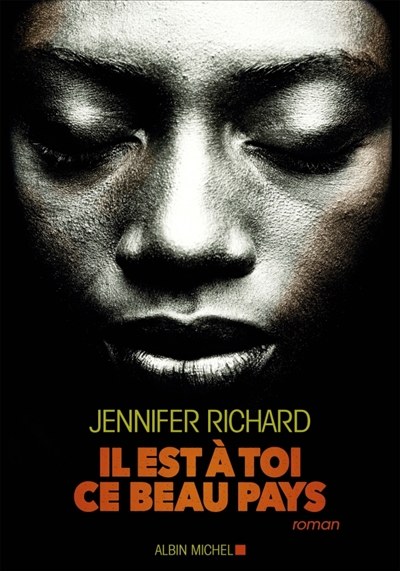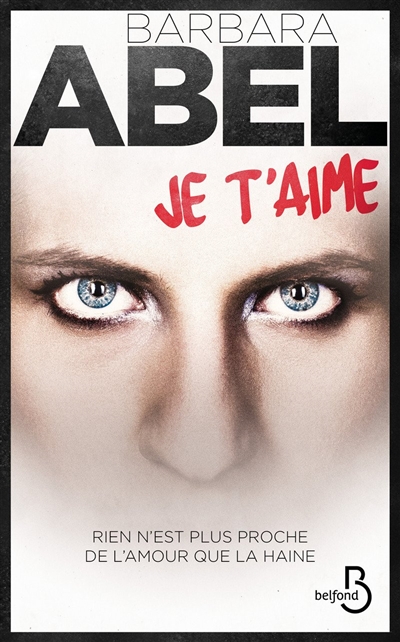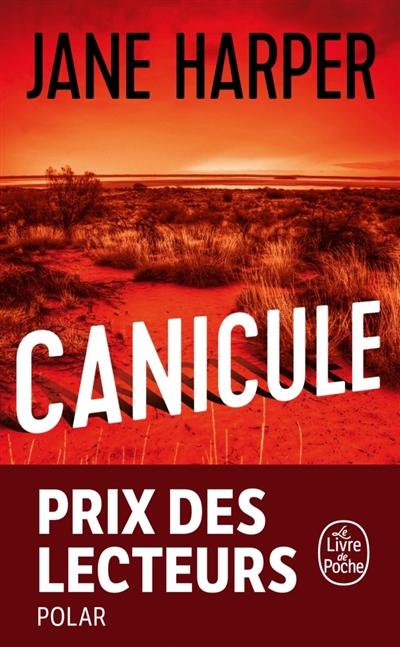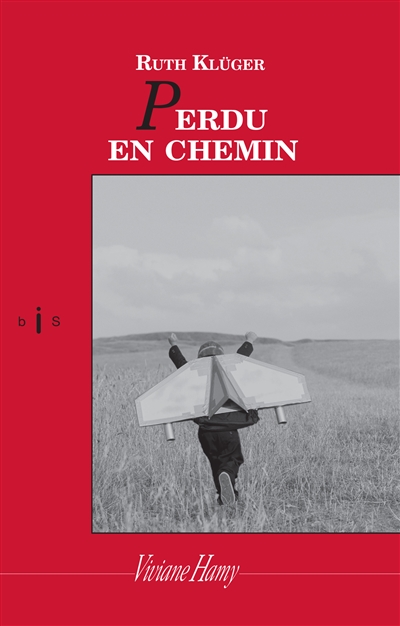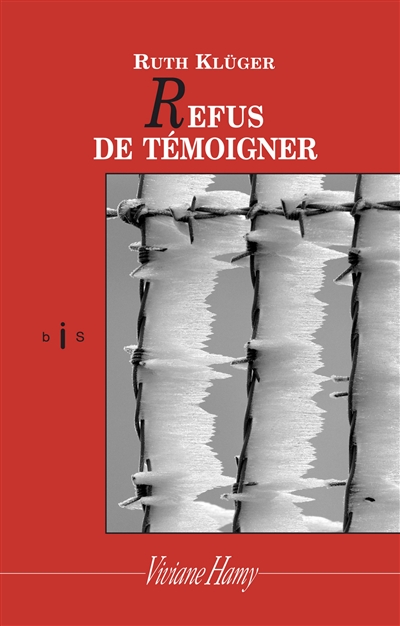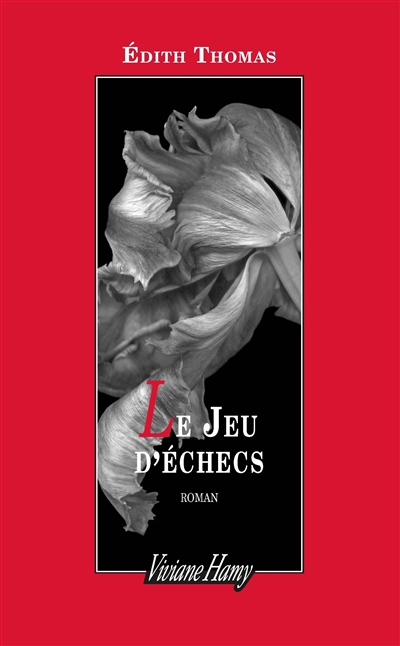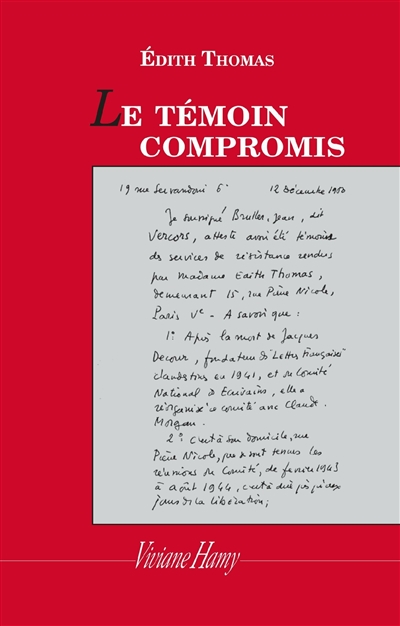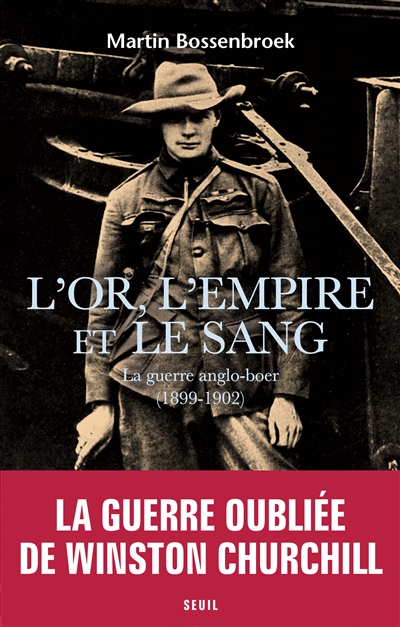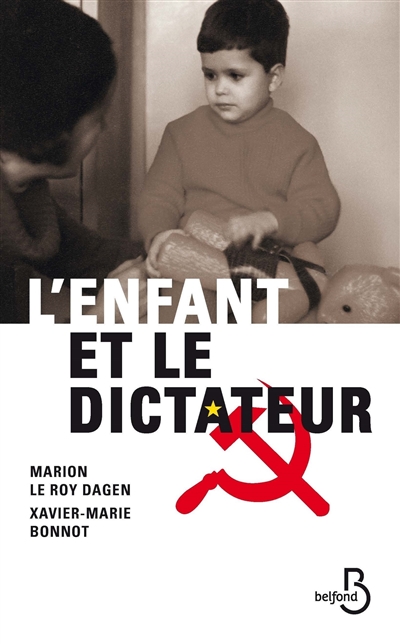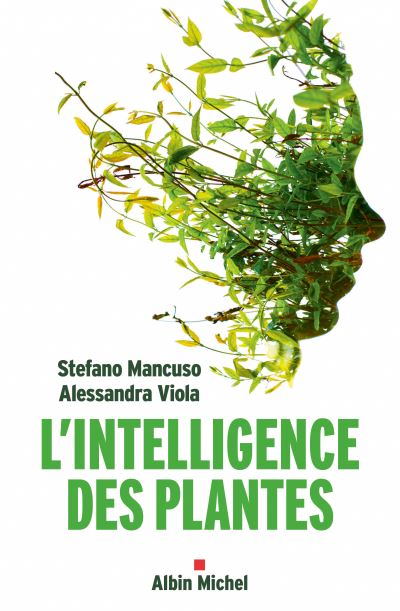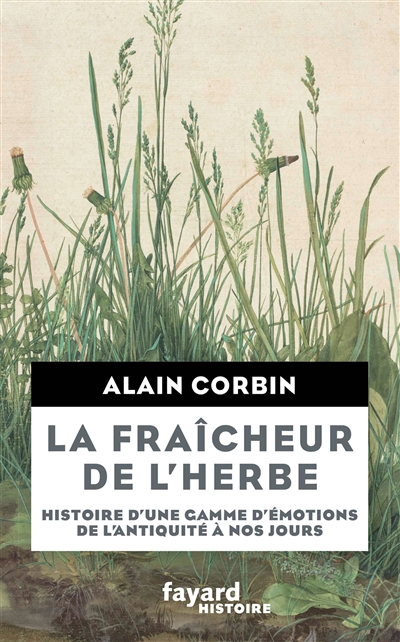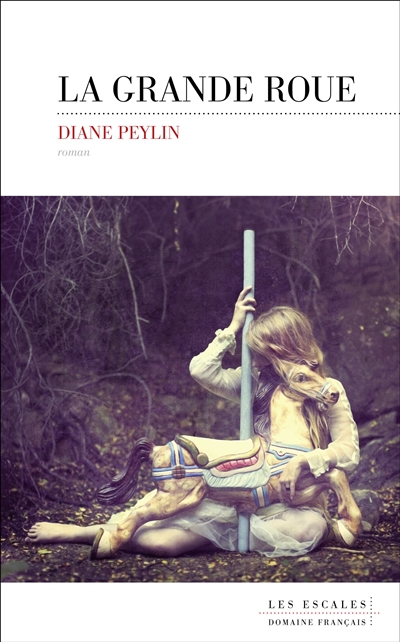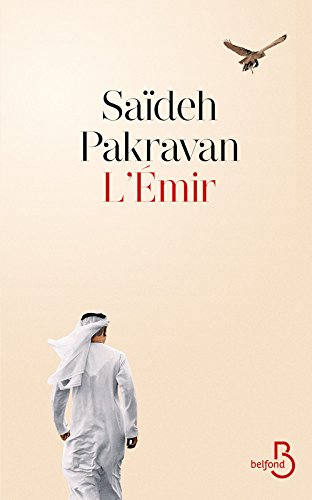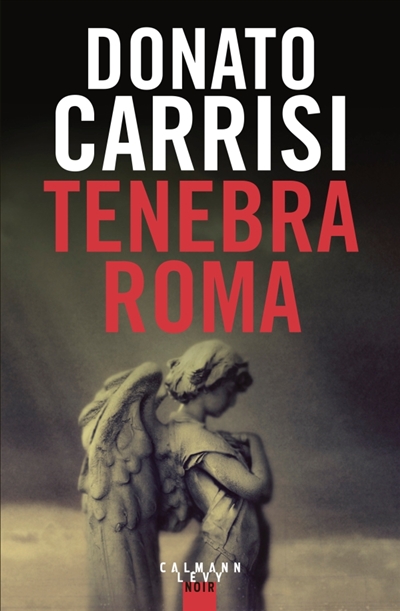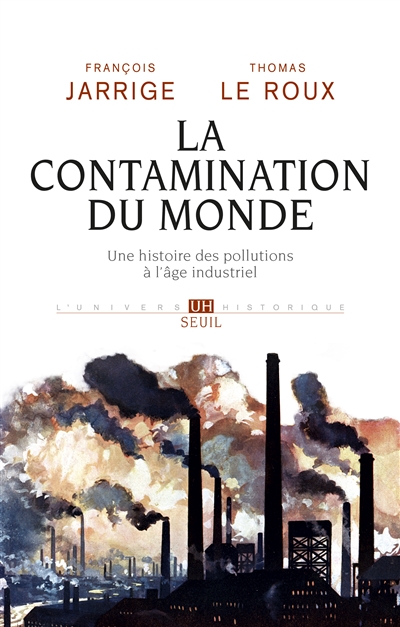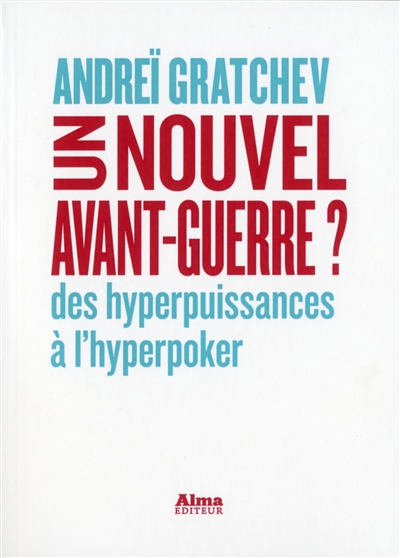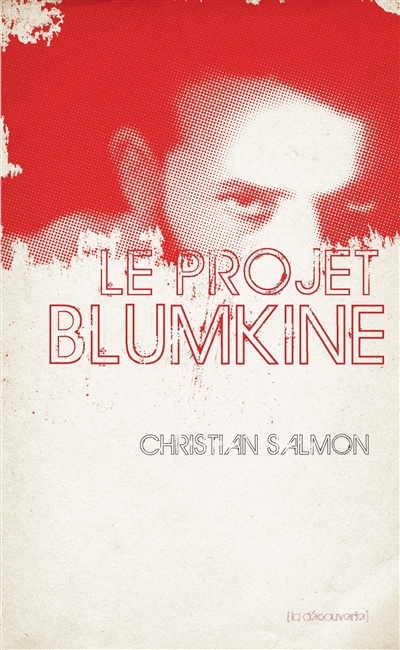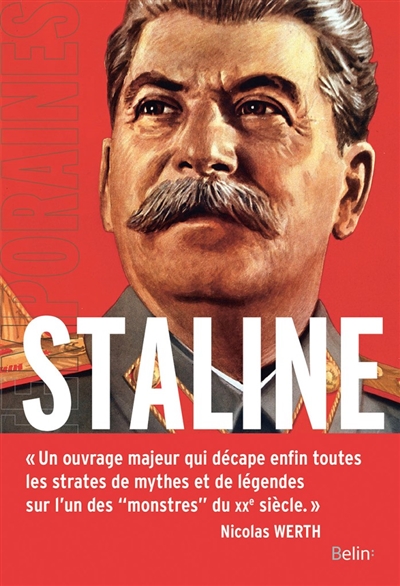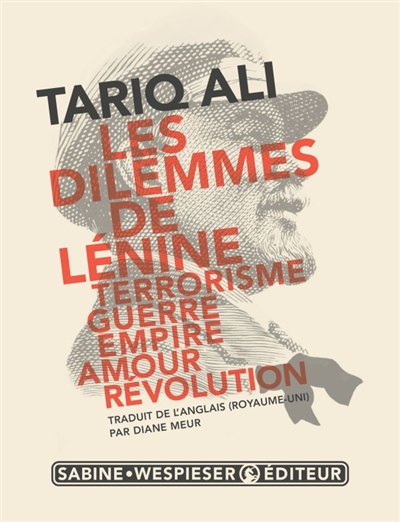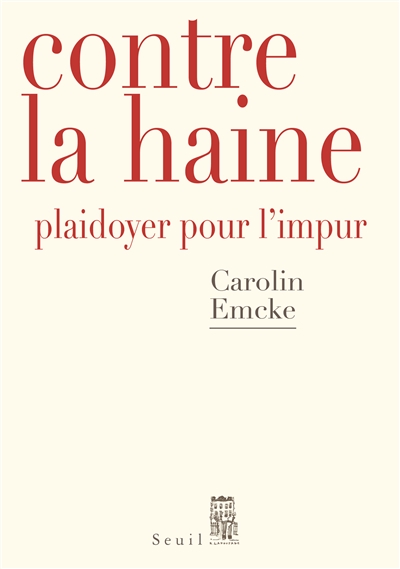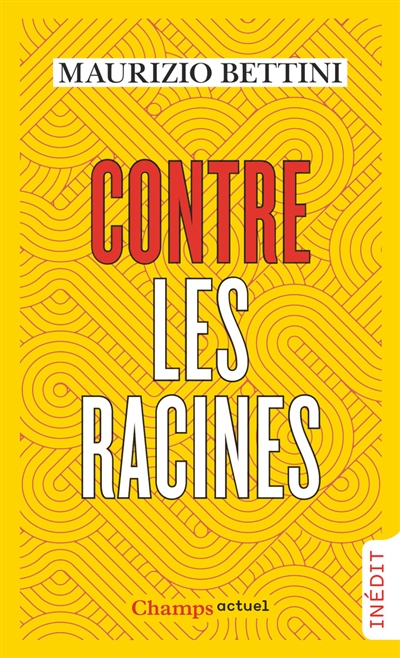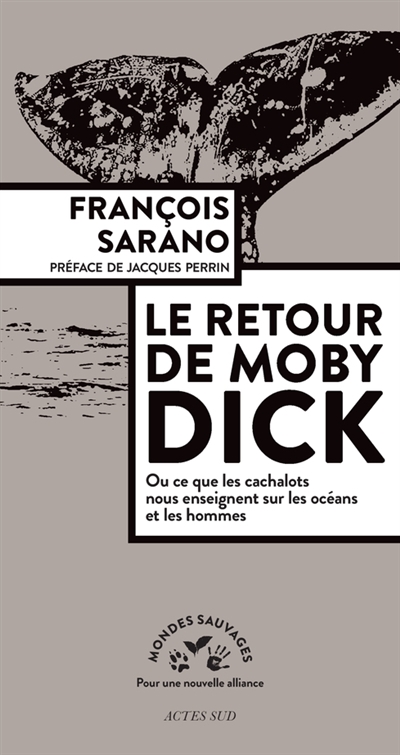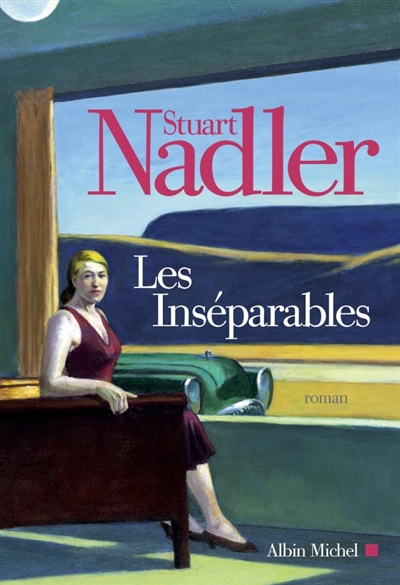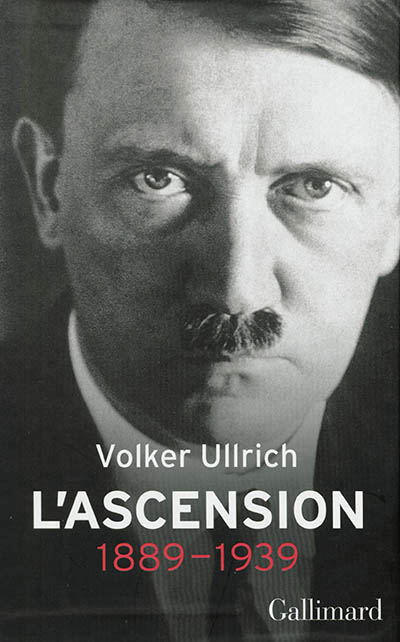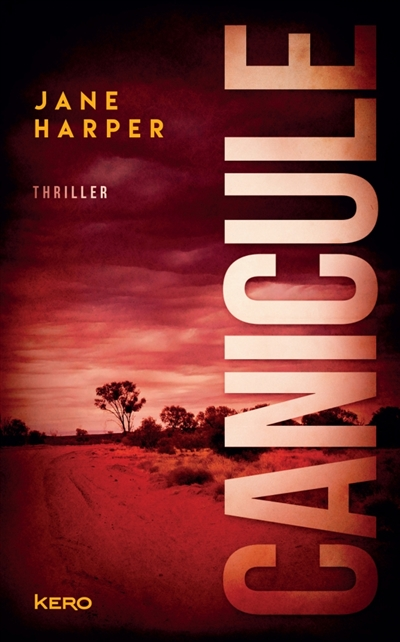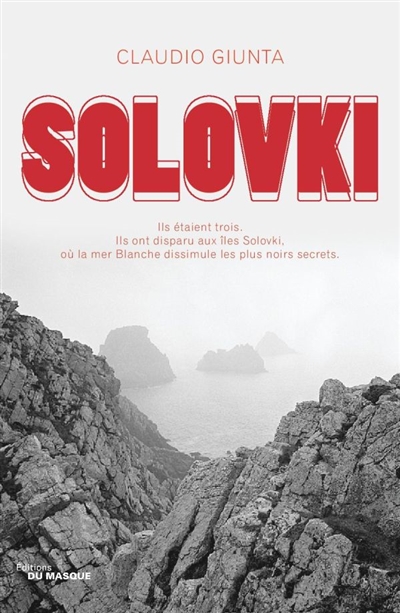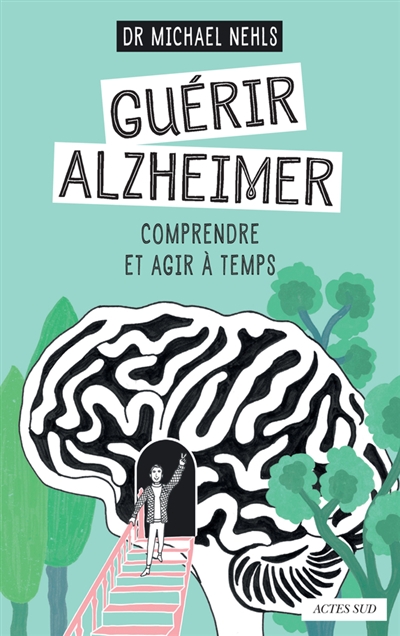Sciences humaines
Hervé Guillemain , Stéphane Tison
Du front à l’asile
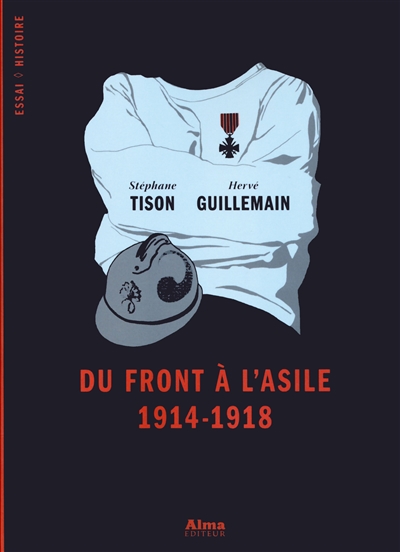
-
Hervé Guillemain , Stéphane Tison
Du front à l’asile
Alma
12/09/2013
500 pages, 25 €
-
Chronique de
Christine Lechapt
Librairie Maison du livre (Rodez) -
❤ Lu et conseillé par
3 libraire(s)
- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales, Université (Tours)
- Jonathan Burgun de Maison du livre (Rodez)
- Delphine Bouillo de M'Lire (Laval)
✒ Christine Lechapt
(Librairie Maison du livre, Rodez)
En mars 2008 s’éteignait la voix du dernier poilu, Lazare Ponticelli, mort à l’âge de 110 ans. Il ne nous reste donc plus à ce jour, à l’approche des nombreuses commémorations qui marqueront 2014, que les écrits de ceux qui ont connu l’horreur de la Grande Guerre.
Le 21 février 1916, à 7 heures du matin, après quelques tirs isolés durant la nuit, les Allemands commencèrent à pilonner la ville de Verdun : durant une seule journée, un million d’obus furent tirés. Ainsi commença la première journée d’une bataille qui dura plus de dix mois et qui fit dans chaque camp près de 375 000 morts, blessés ou portés disparus. Cette offensive allemande ne revêtait pas au départ un caractère stratégique primordial pour l’issue de la guerre. Il s’agissait surtout, pour Erich von Falkenhayn, chef suprême de l’armée allemande, de faire pression sur l’armée française afin de l’affaiblir et d’inciter l’armée britannique, qu’il ne jugeait pas prête pour un affrontement, à s’investir davantage dans la guerre. Les événements lui donnèrent tort puisque la résistance française fut héroïque, malgré le peu de moyens accordés par le maréchal Joffre à ses généraux. C’est dans la célèbre collection « Les journées qui ont fait la France » de Gallimard, que Paul Jankowski nous révèle les causes de la durée de cette terrible bataille et de sa bien triste notoriété. Au-delà des millions de morts que dut enregistrer la France durant la Grande Guerre, il est un autre phénomène qui marqua tristement cet affrontement, c’est la folie qui s’empara de certains soldats ayant survécu aux combats. Stéphane Tison et Hervé Guillemain notent que les premiers symptômes de déséquilibres mentaux apparurent dès la mobilisation, en raison de la pression psychologique, mais également des terribles semaines d’attente avant l’entrée en guerre définitive de la France. Puis vinrent les premiers combats et de nombreux « cas » arrivèrent dans les hôpitaux psychiatriques, peu habitués à ce genre de maladies. Devant l’ampleur du phénomène, les médecins militaires commencèrent à s’organiser malgré leurs faibles connaissances du sujet et le manque de structures adaptées, ce qui ne manqua malheureusement pas de donner lieu à des pratiques peu orthodoxes et parfaitement inhumaines. On peut donc considérer que la Première Guerre mondiale coïncide avec le début des traitements du syndrome post-traumatique que l’on connaît encore de nos jours. Face à la violence des combats, aux conditions de vie difficiles, à la peur et à l’angoisse de la séparation des êtres chers, une seule chose pouvait permettre aux soldats de « tenir le coup » au quotidien, les compagnons de tranchées. Il fut répété à l’envi que cette guerre fut l’occasion pour la société française de mettre sur un pied d’égalité toutes les classes sociales et qu’un simple paysan valait autant qu’un fils de bonne famille dans l’enfer des tranchées. Or, ce n’est pas tout à fait l’analyse de Nicolas Mariot. Après avoir sélectionné les écrits et correspondances rédigés au jour le jour sur les lignes du front de quarante-deux intellectuels, il a observé que même si tous les protagonistes étaient amenés au début de la guerre à effectuer les mêmes tâches et les mêmes devoirs, très progressivement, le fossé se creusa de part et d’autre pour recréer les écarts qui pouvaient exister dans la vie civile. Il n’en reste pas moins que ces différentes classes sociales furent amenées à se côtoyer au quotidien, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. À côté de l’étude des écrits intimes de ces soldats, Nicolas Beaupré s’est intéressé aux livres publiés pendant la guerre. Après avoir analysé 1287 noms d’écrivains, il en a retenu 181 allemands et 230 français. Pour ce faire, il a estimé qu’au moins une des caractéristiques suivantes était requise : avoir écrit sur la guerre, porté l’uniforme et combattu, avoir été tué au combat, avoir été officier, avoir été engagé volontaire, avoir publié entre 1914 et 1918. On y retrouve donc les textes d’auteurs méconnus, mais également de ceux restés célèbres tels Guillaume Apollinaire, Henri Barbusse, Maurice Genevoix ou Ernst Jünger. On y découvre comment ceux-ci ont su nommer l’innommable, que ce soit les terribles combats, le quotidien, la peur ou la mort qui frappait à chaque instant. Mais on comprend également comment ces écrits étaient précieux pour faire le lien entre les lignes du front et l’arrière, et ce, malgré la censure nécessaire à maintenir le moral de la nation.