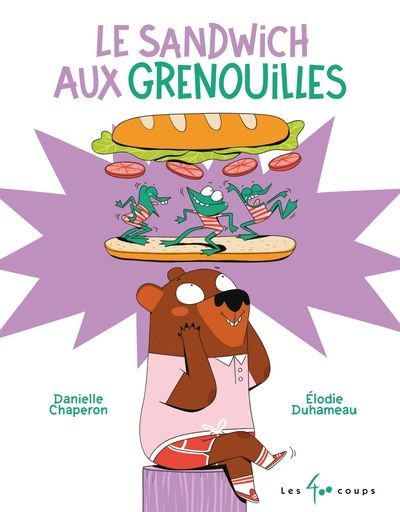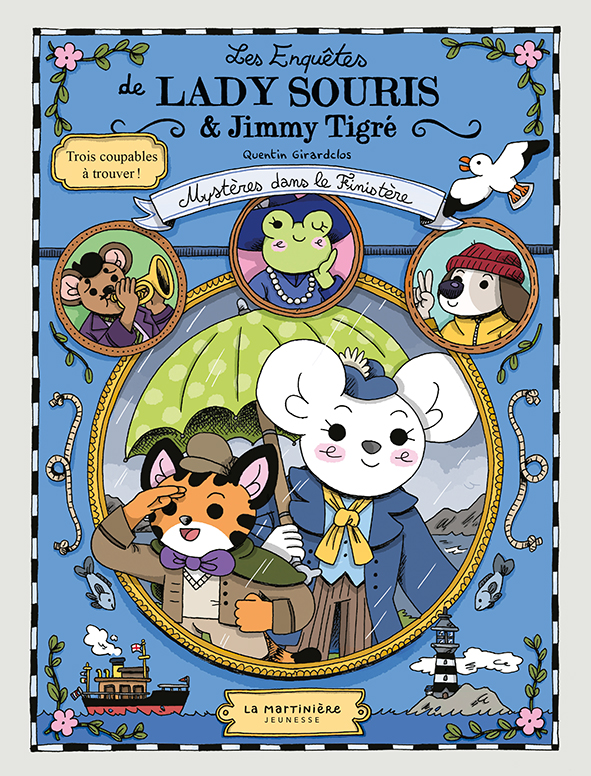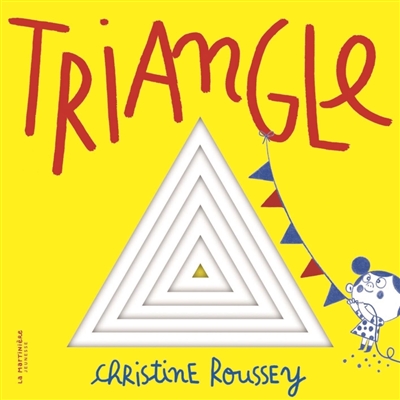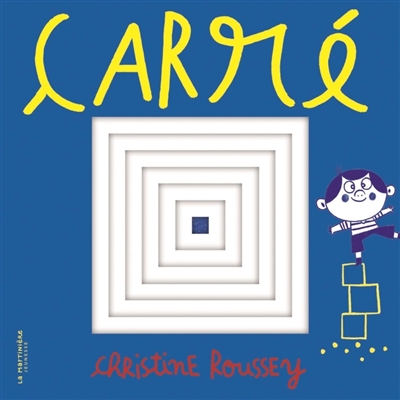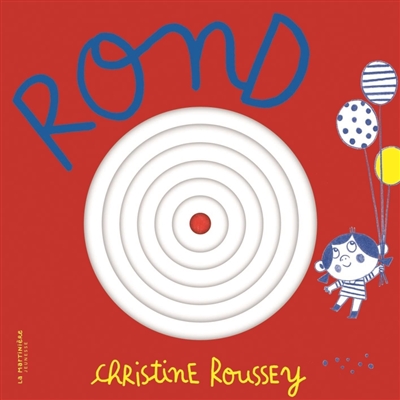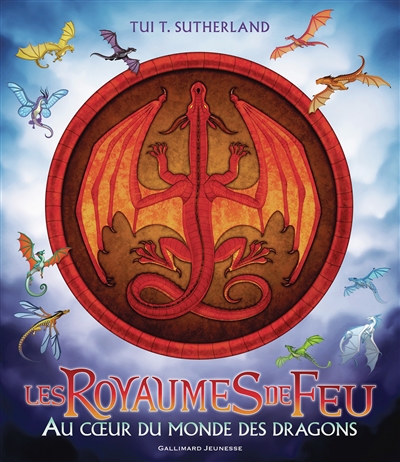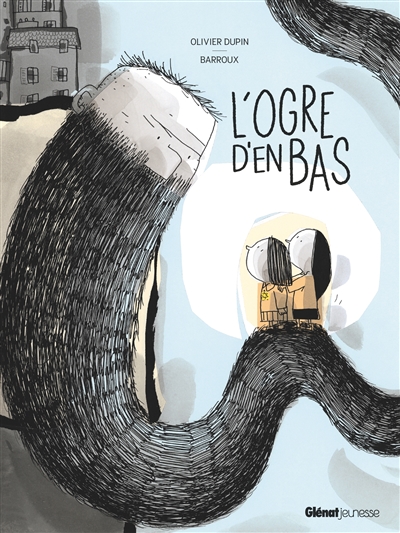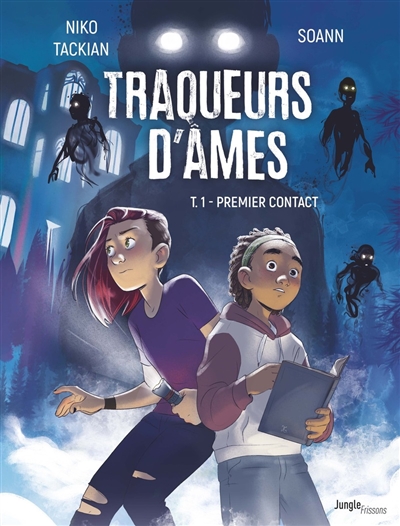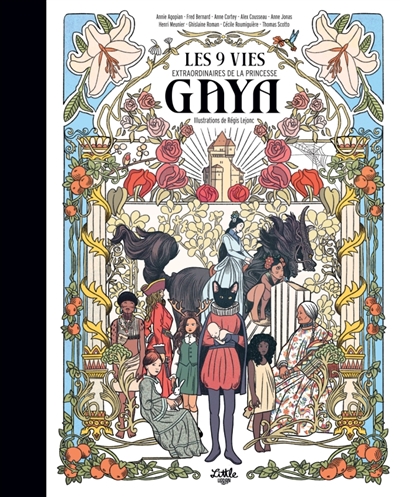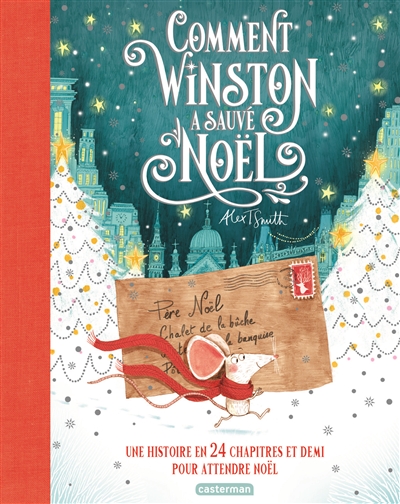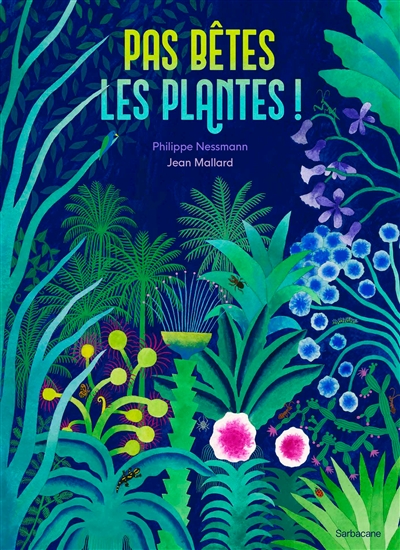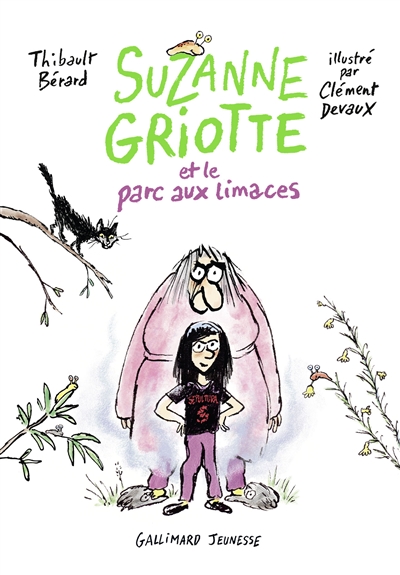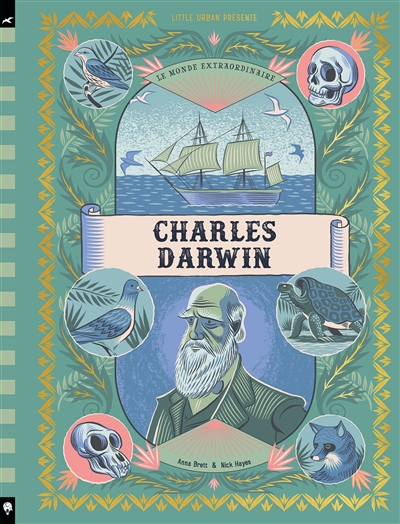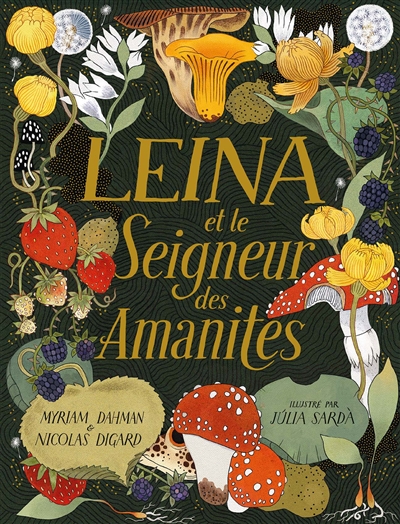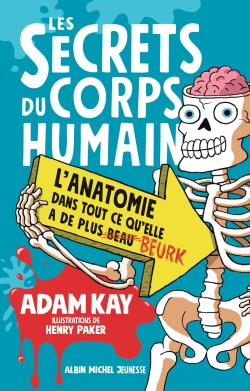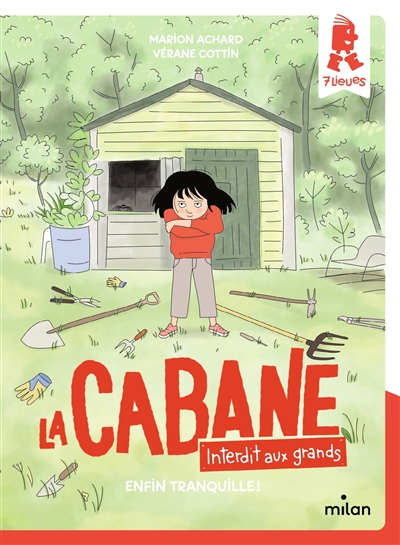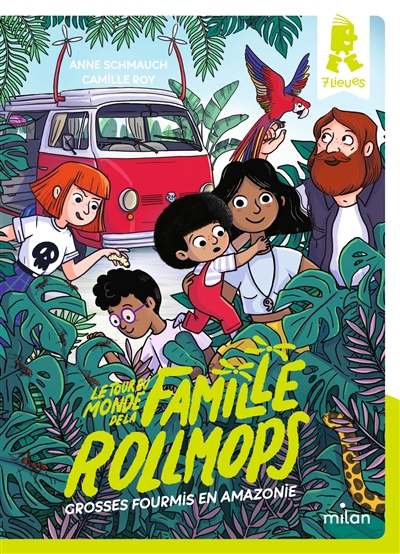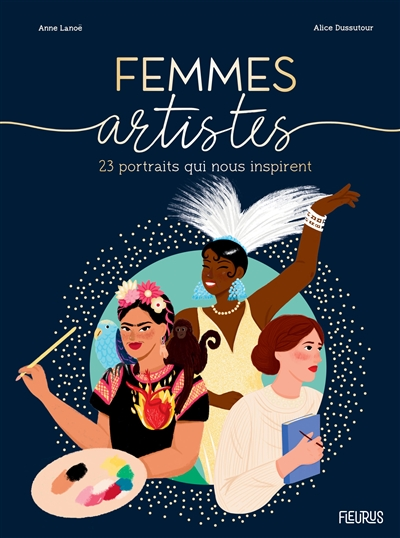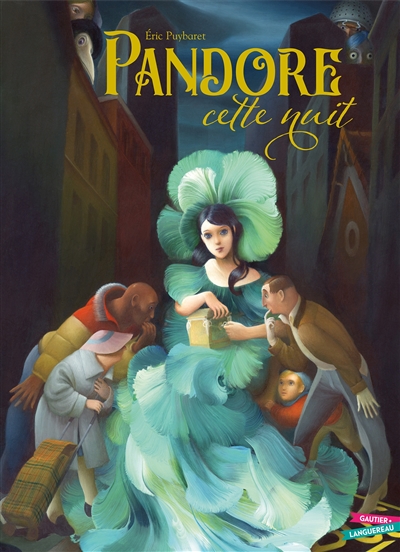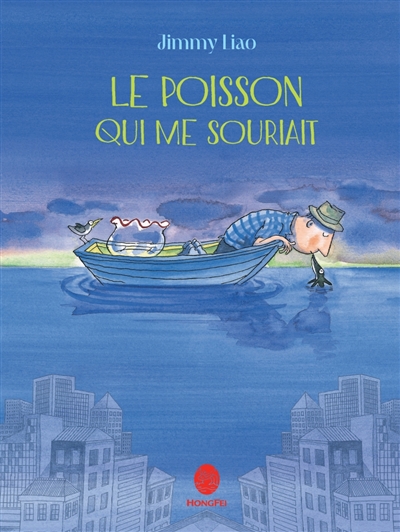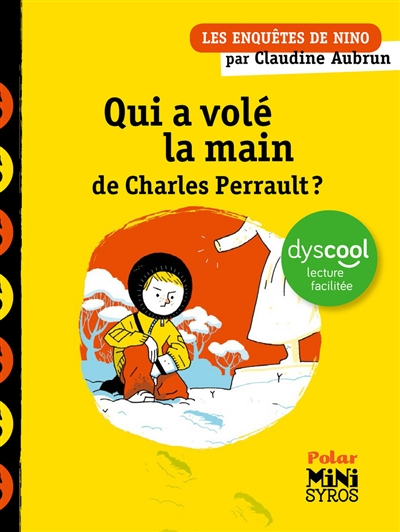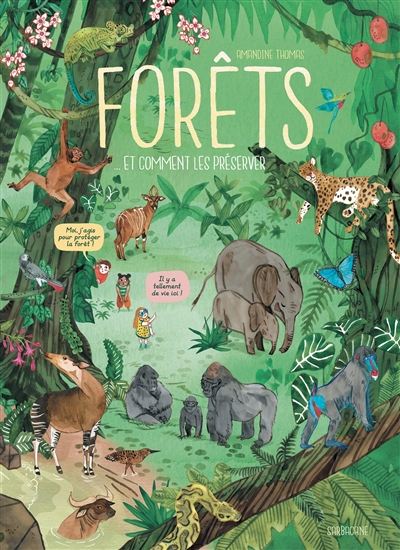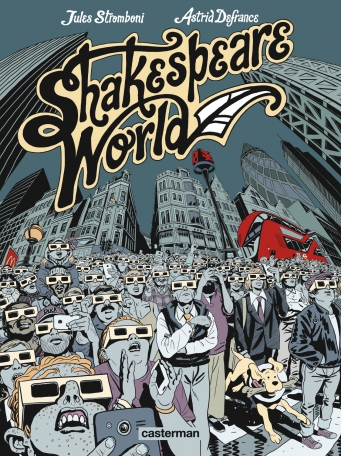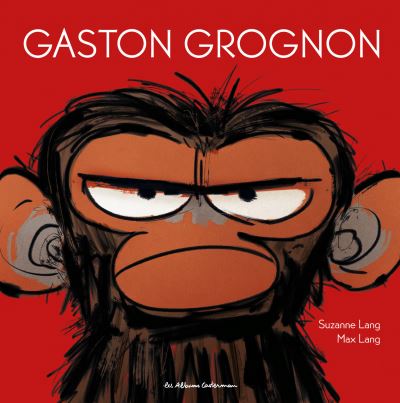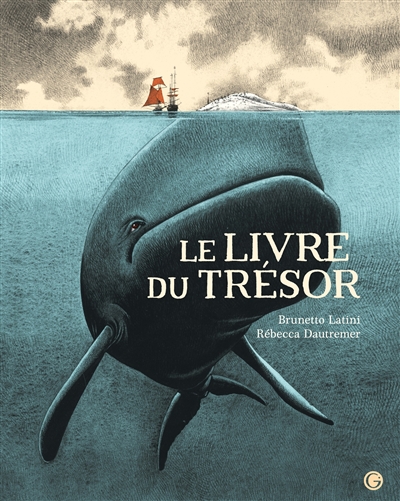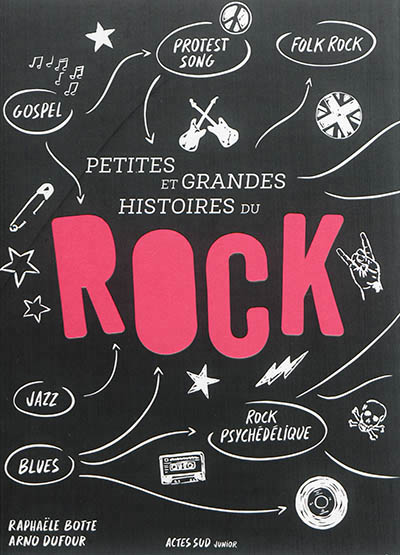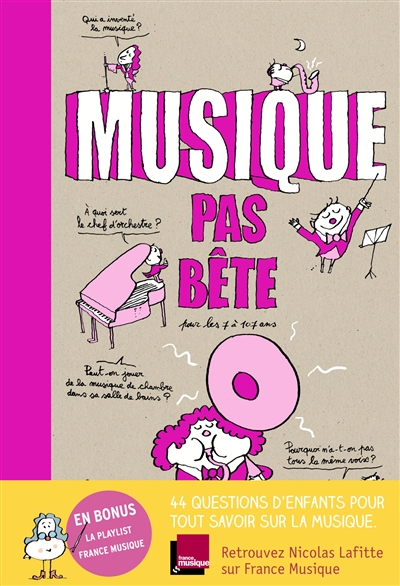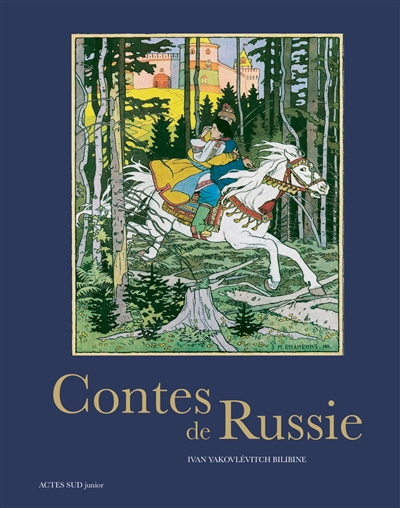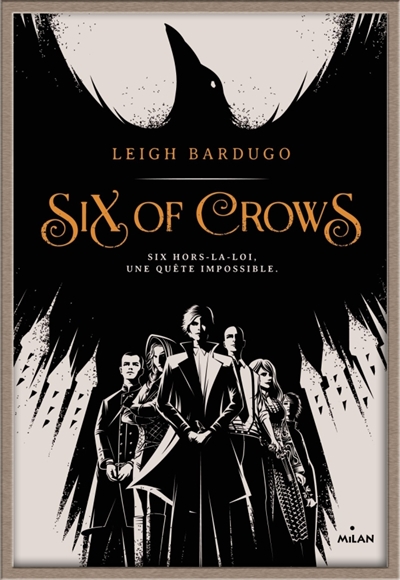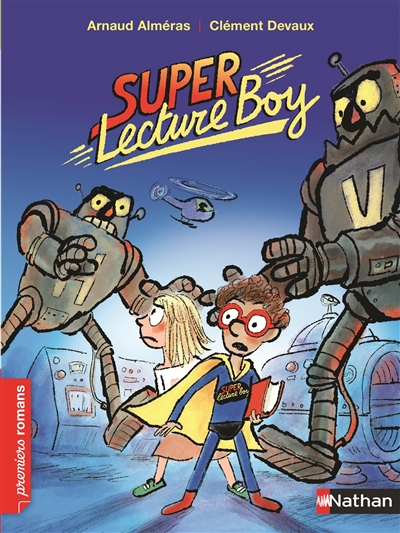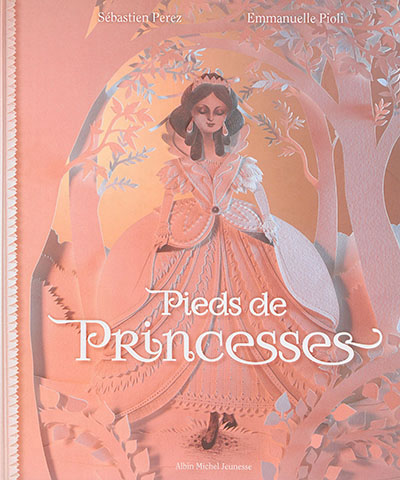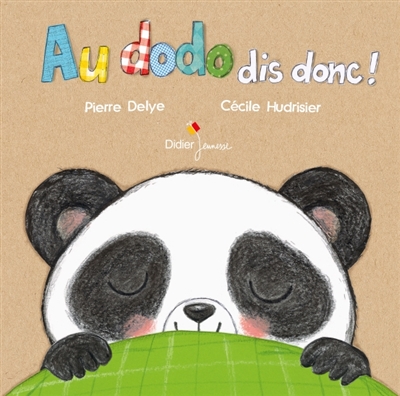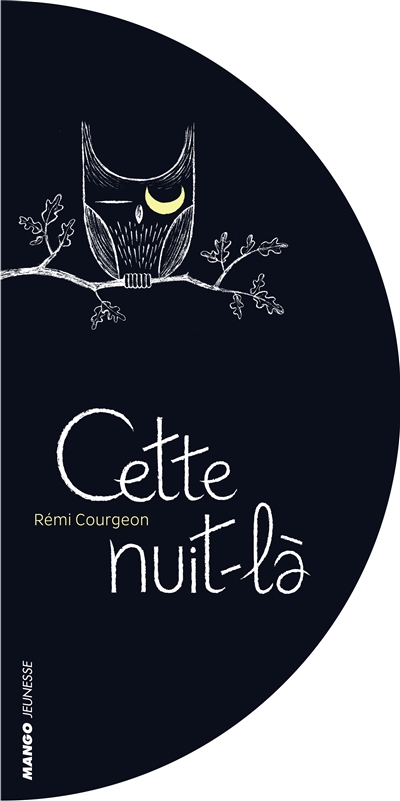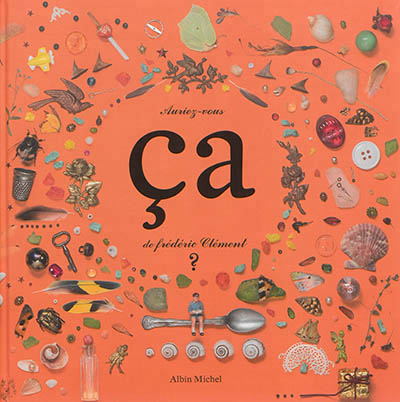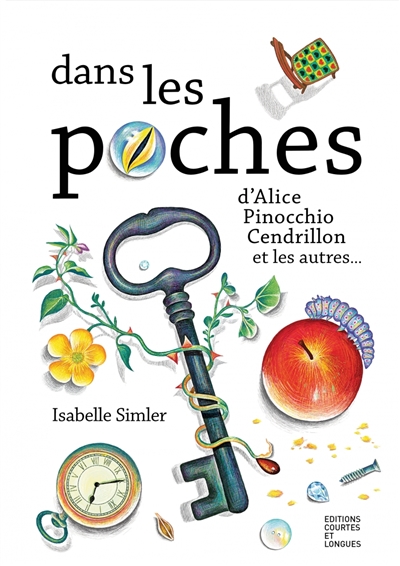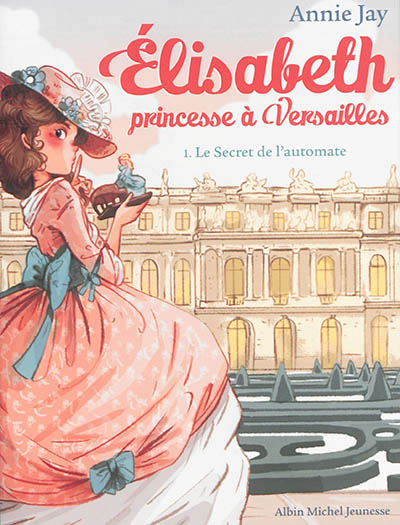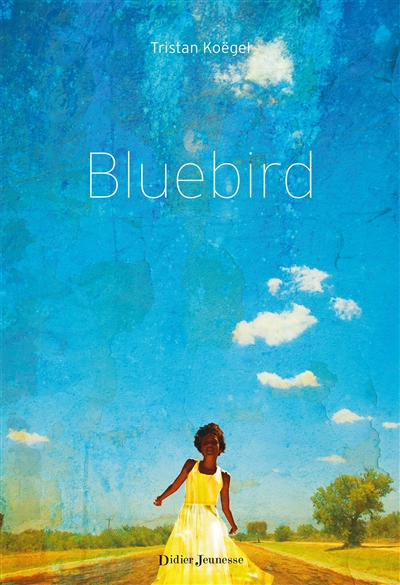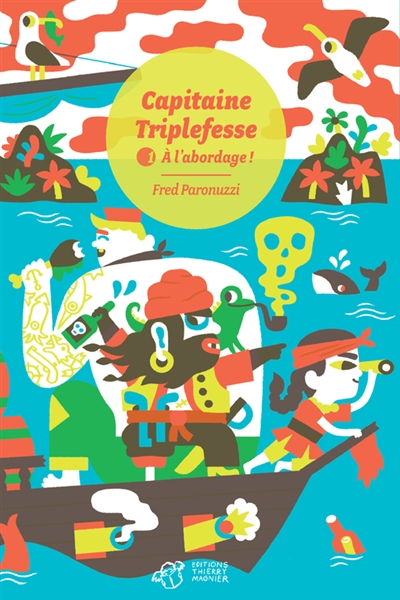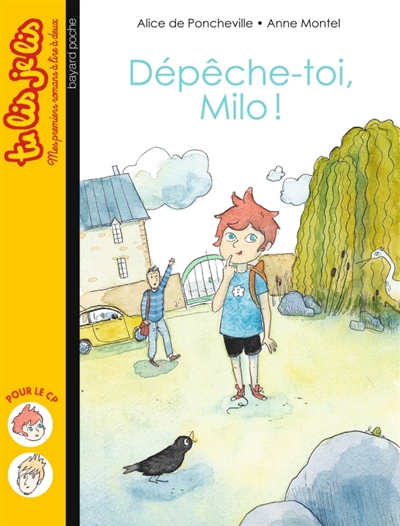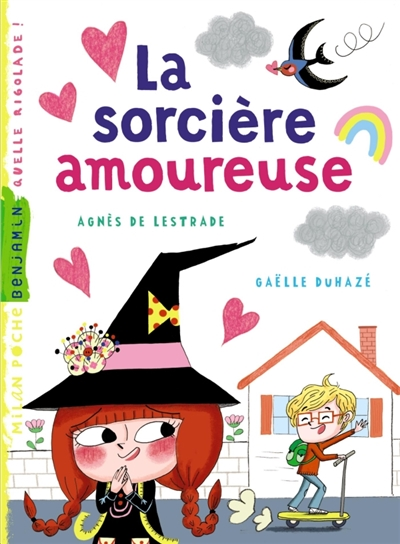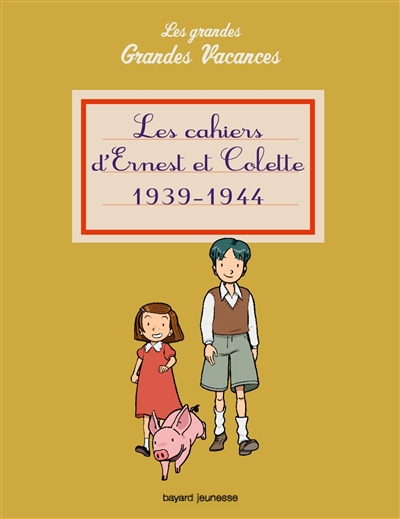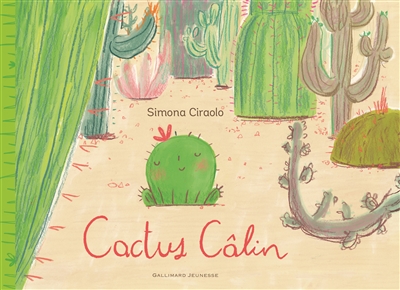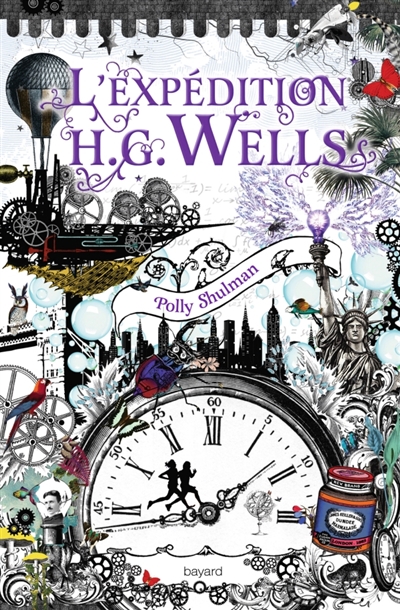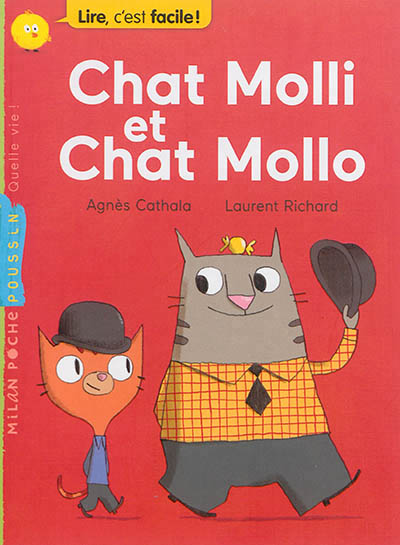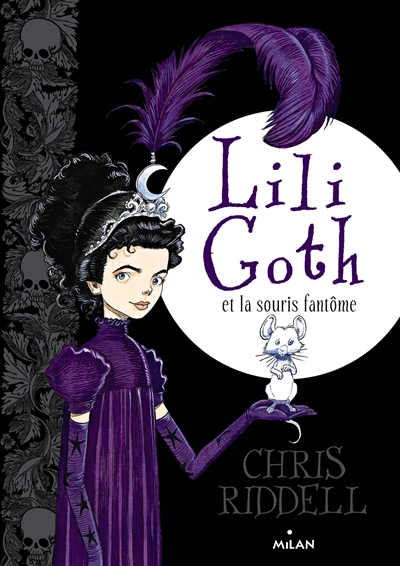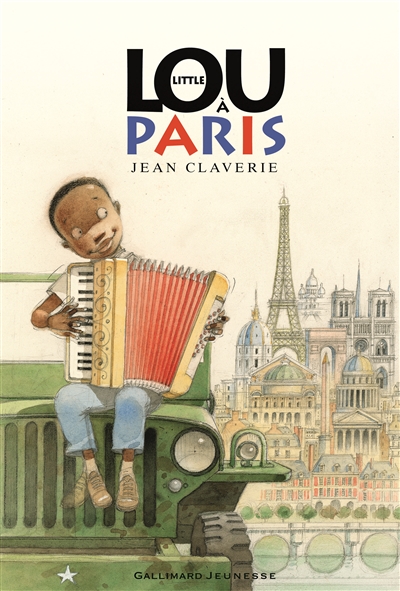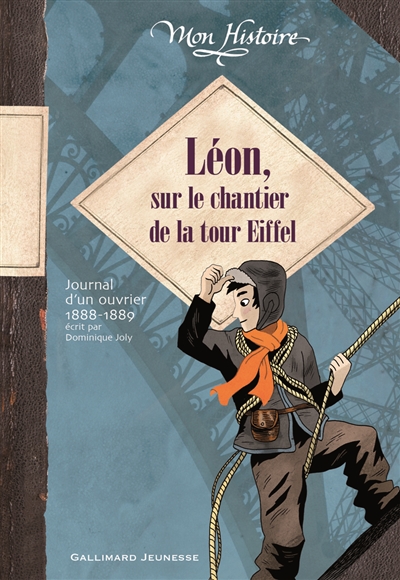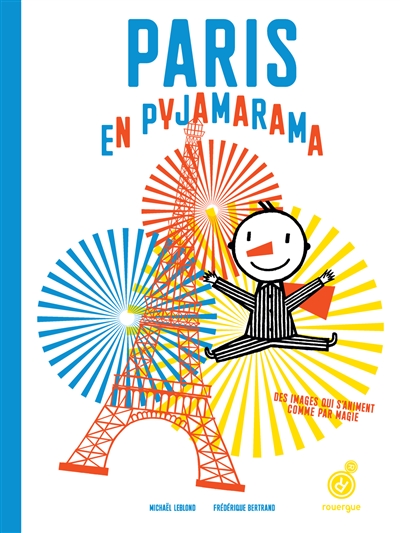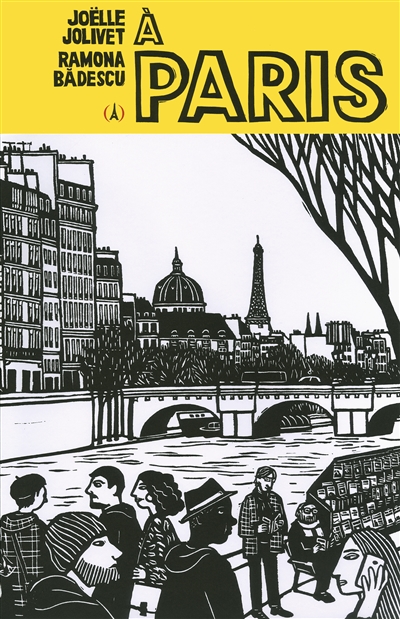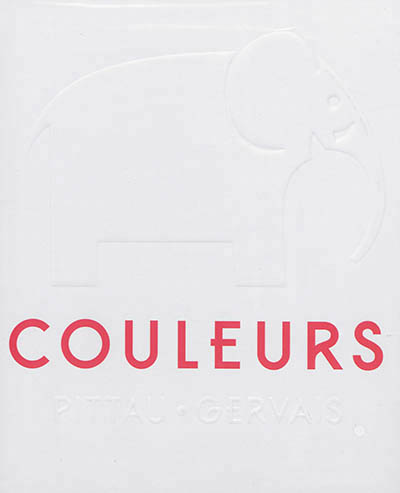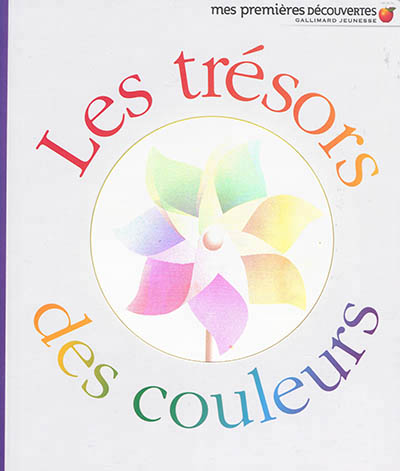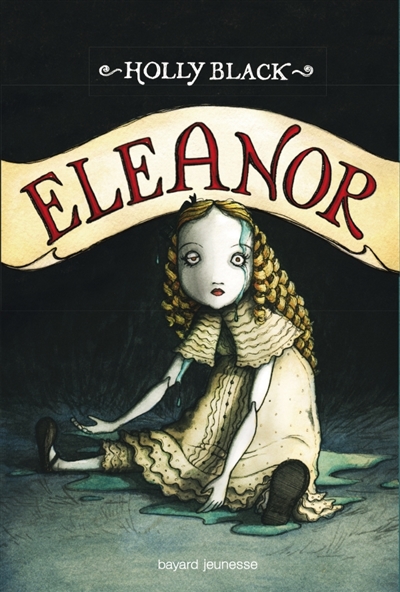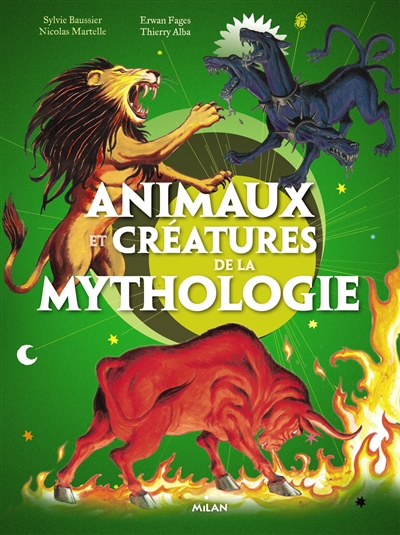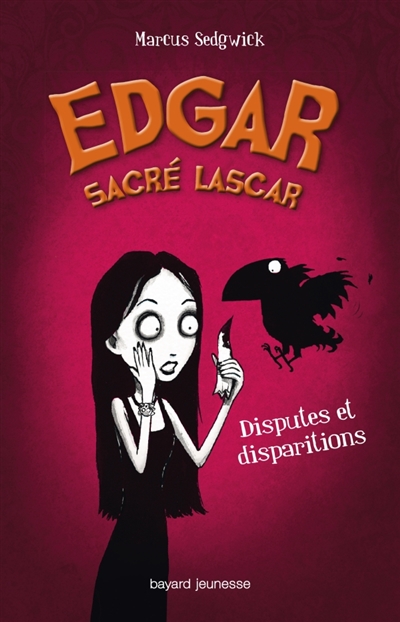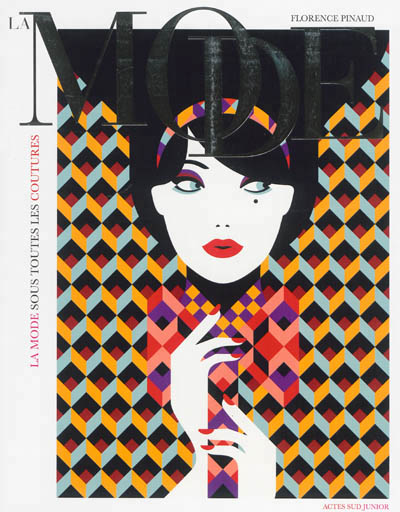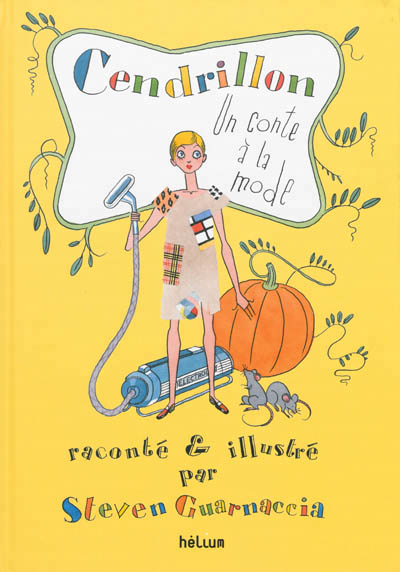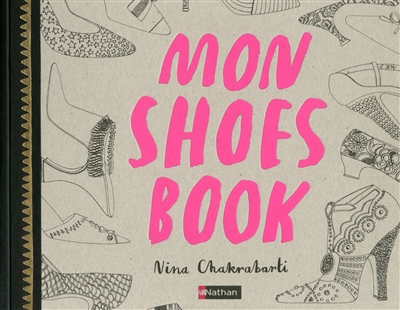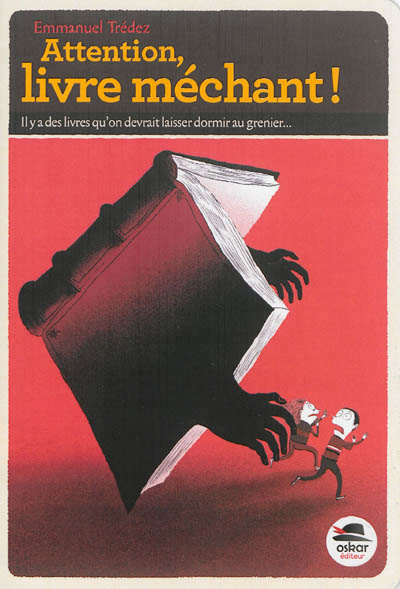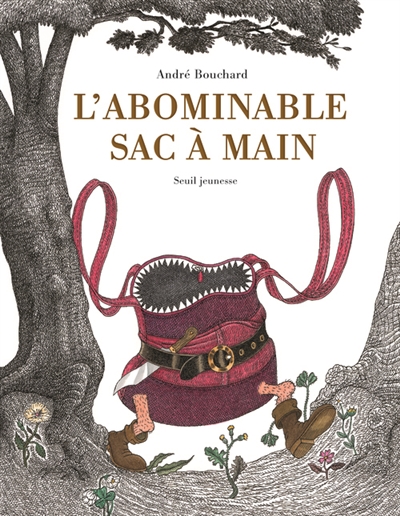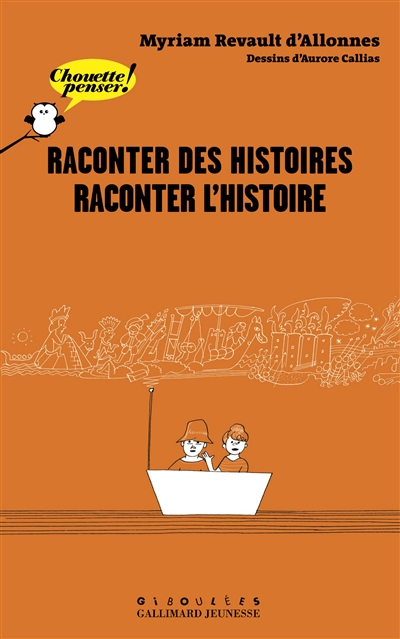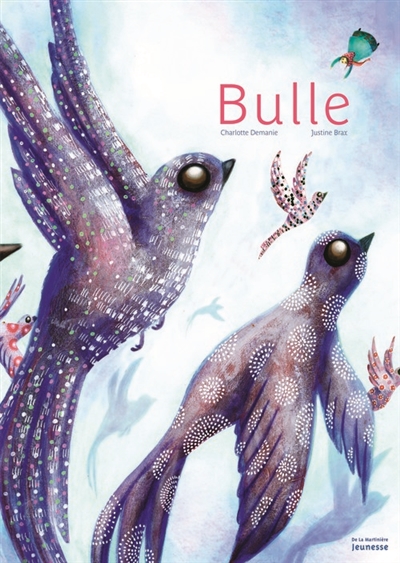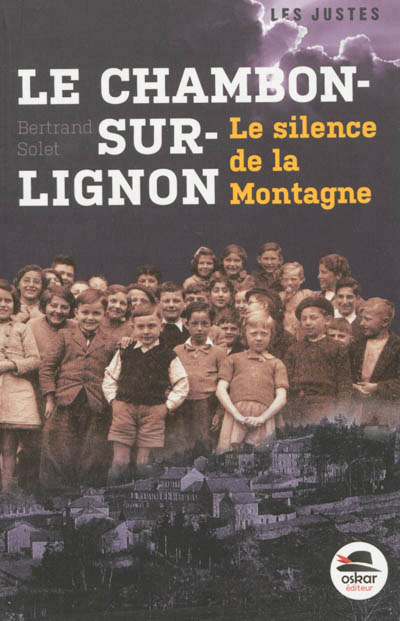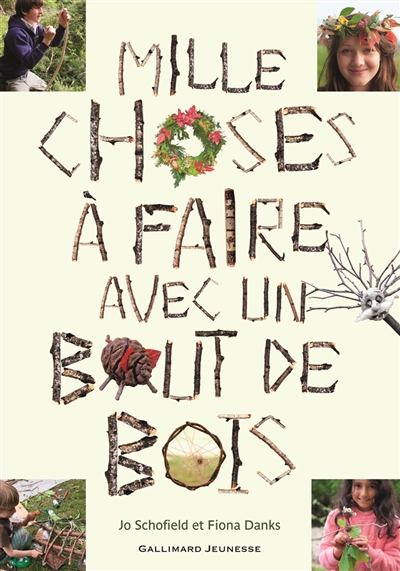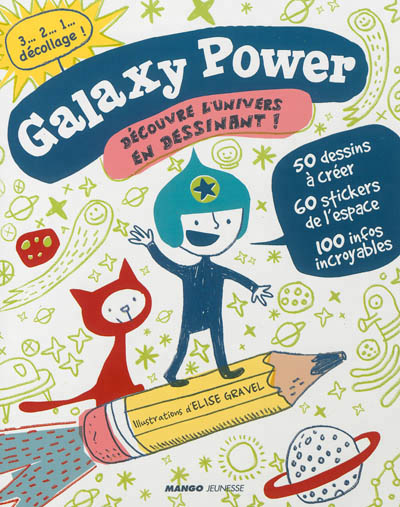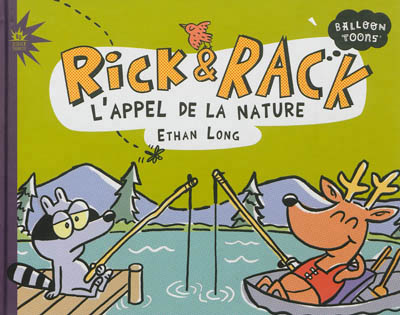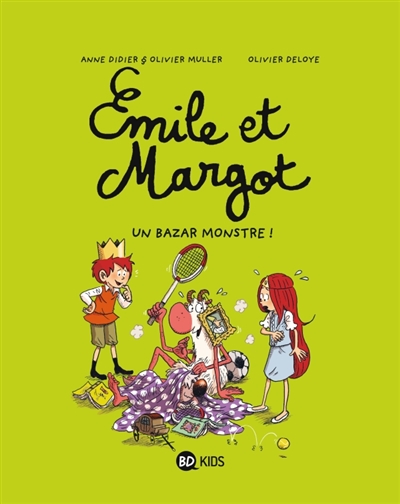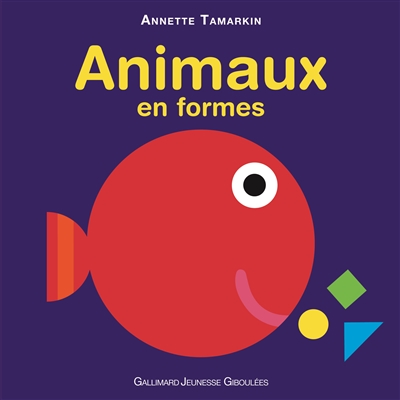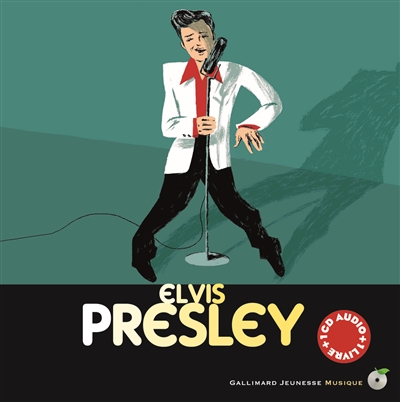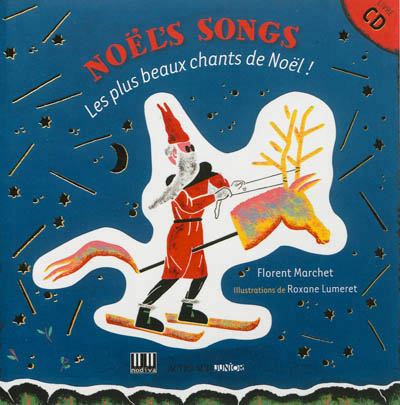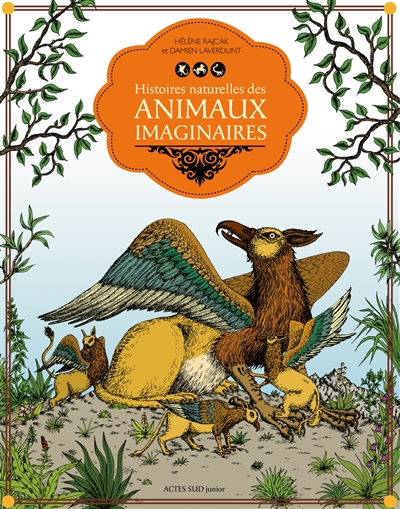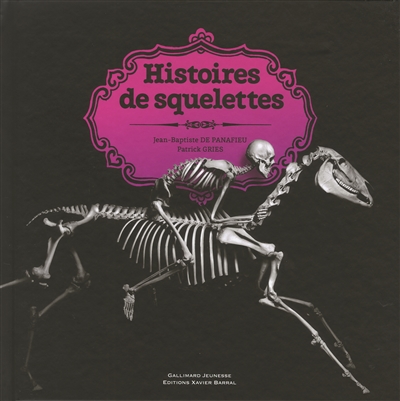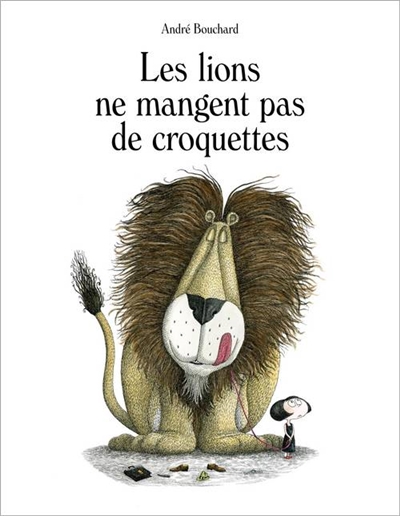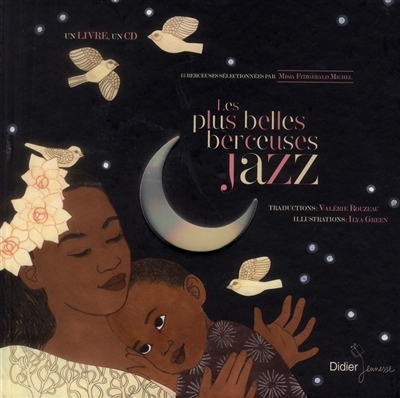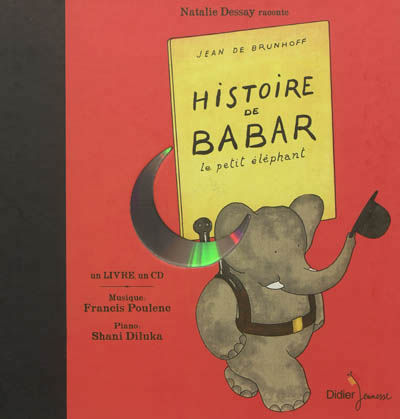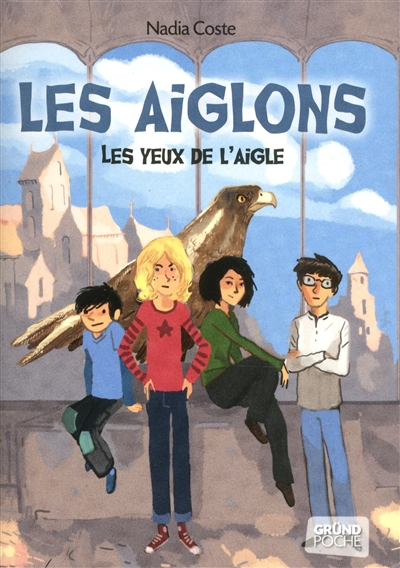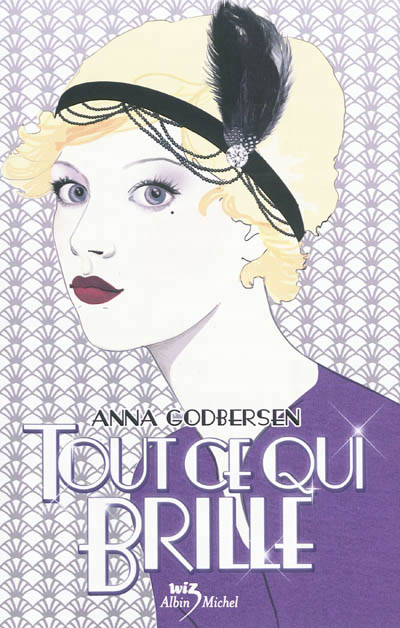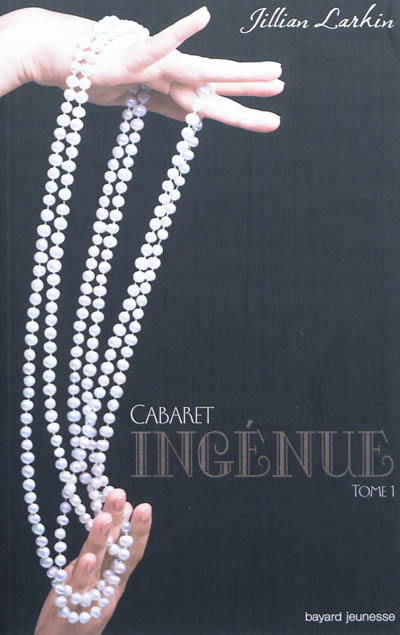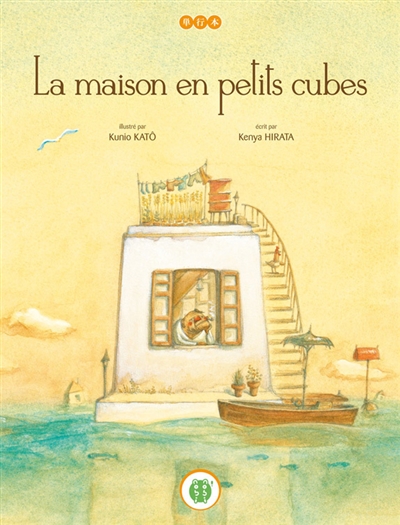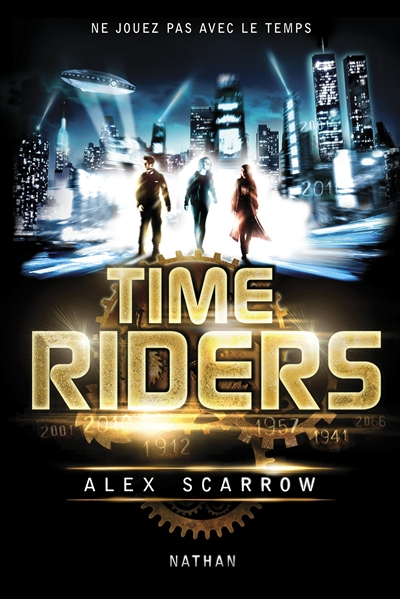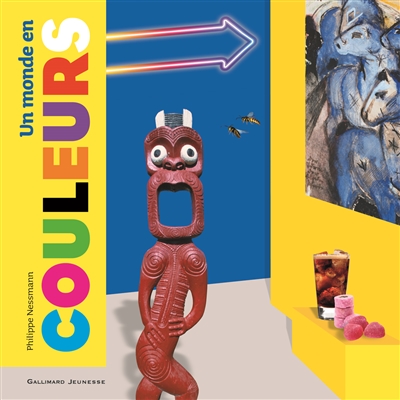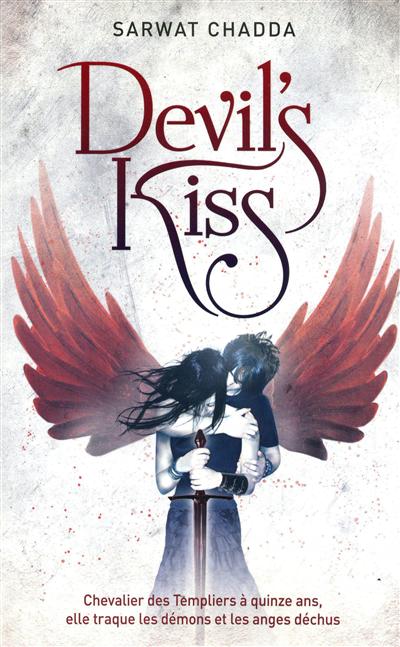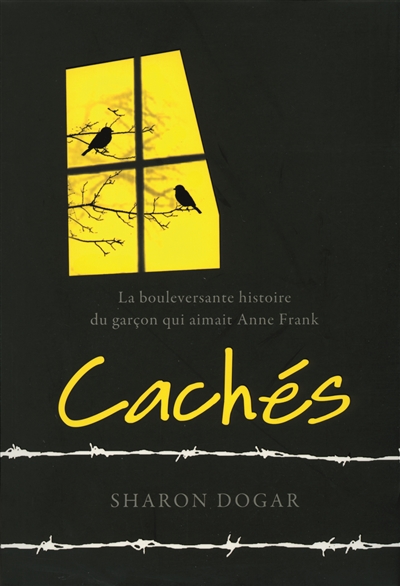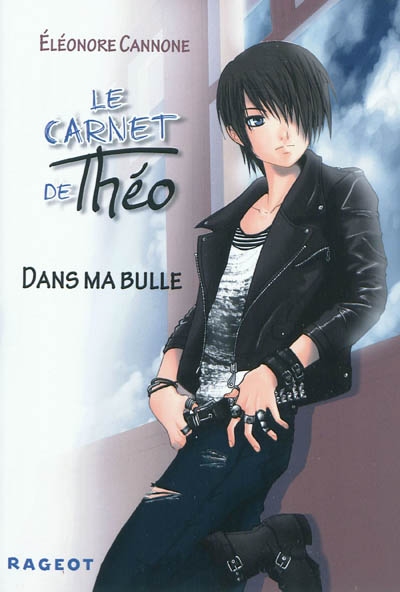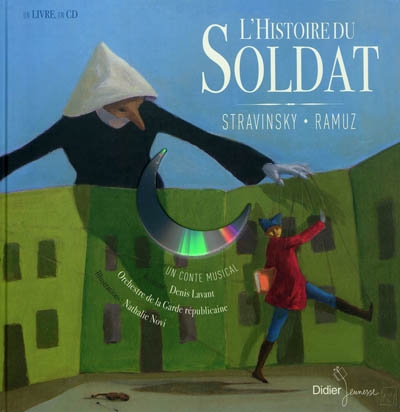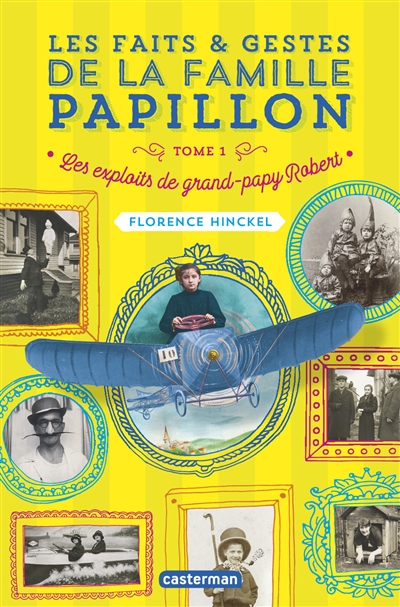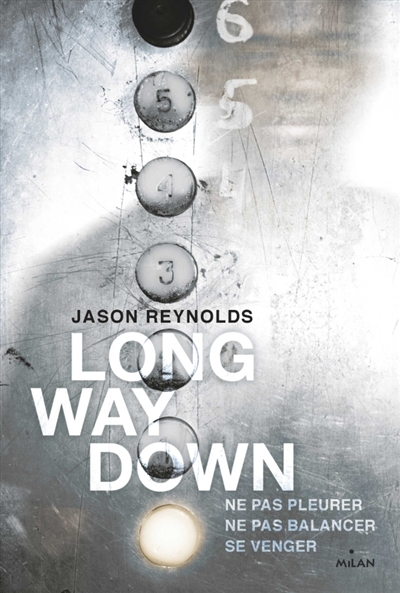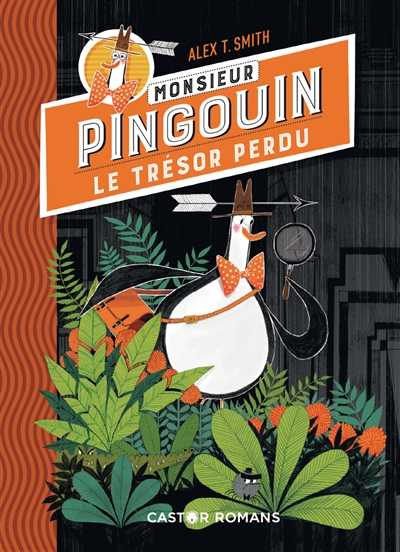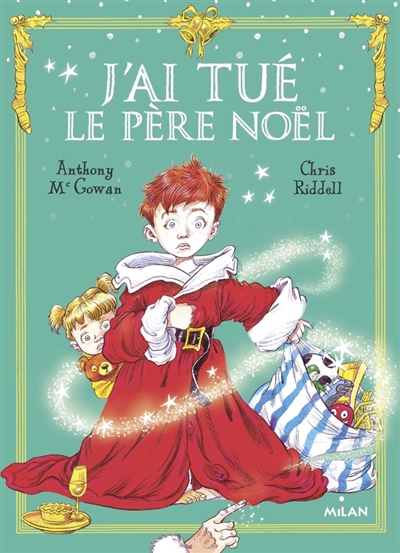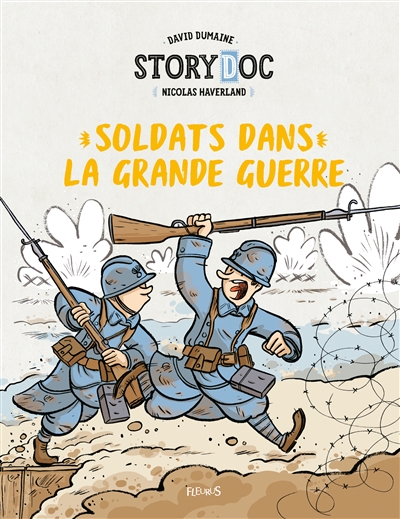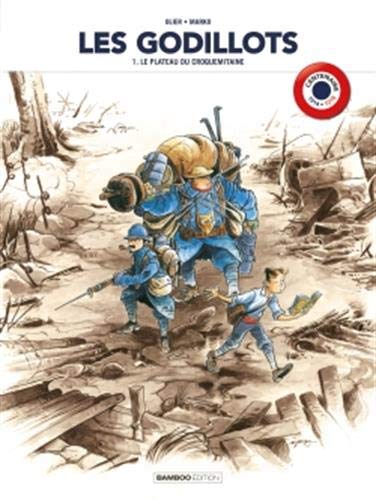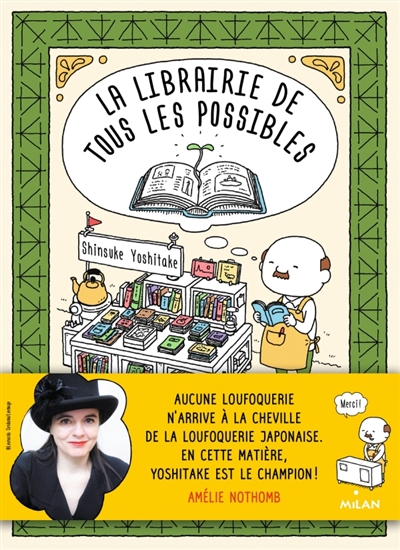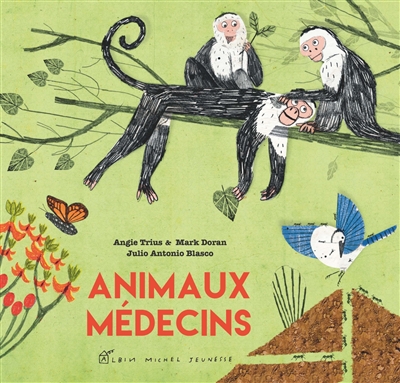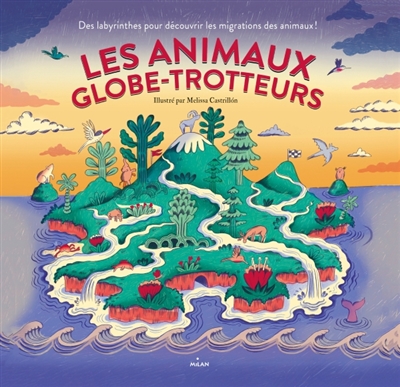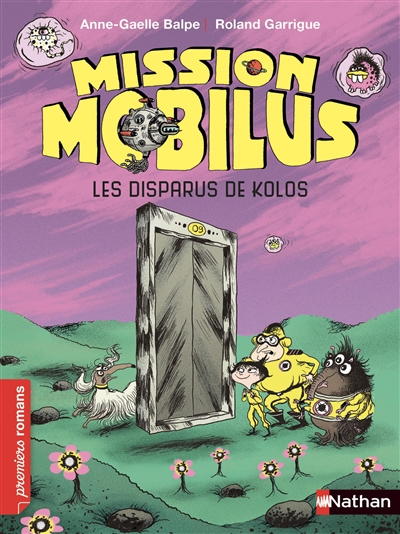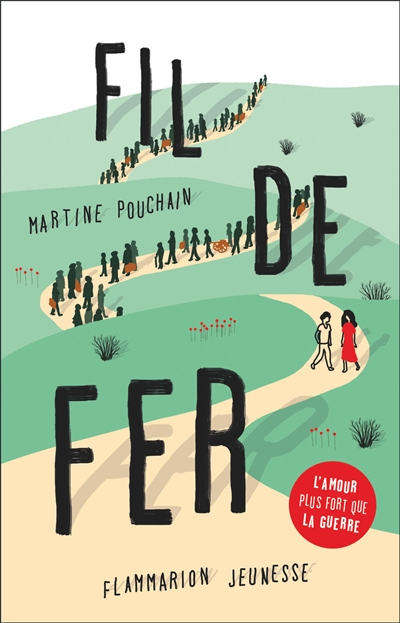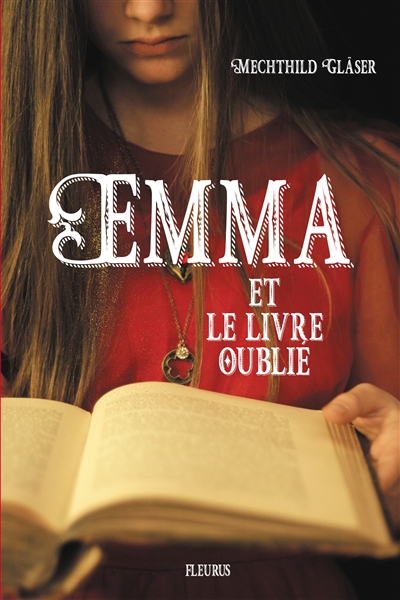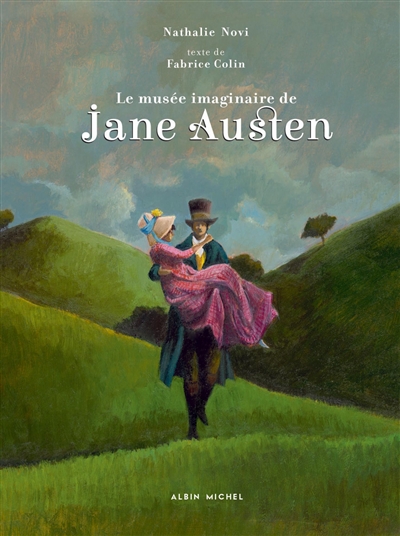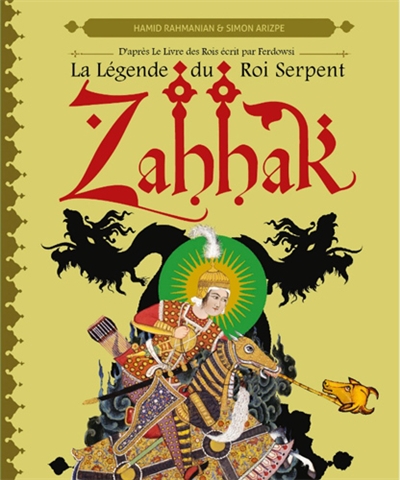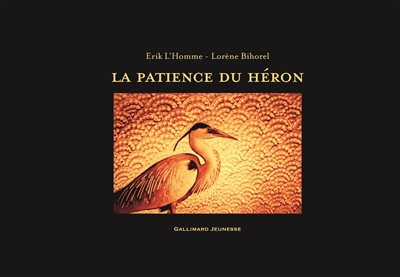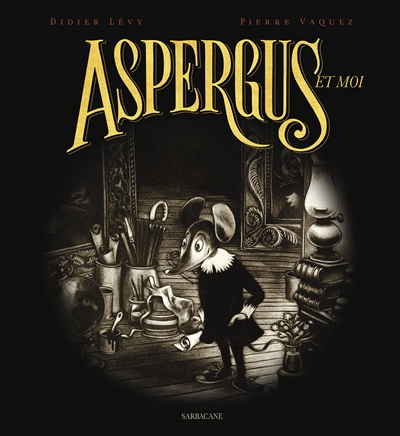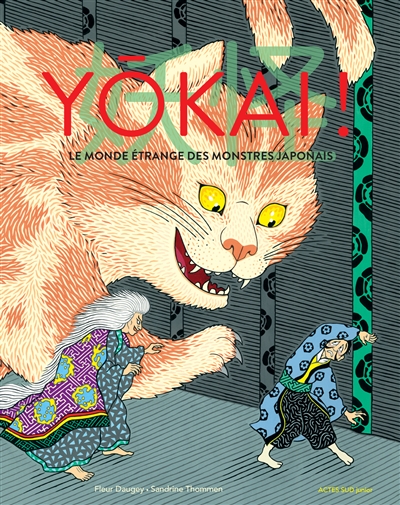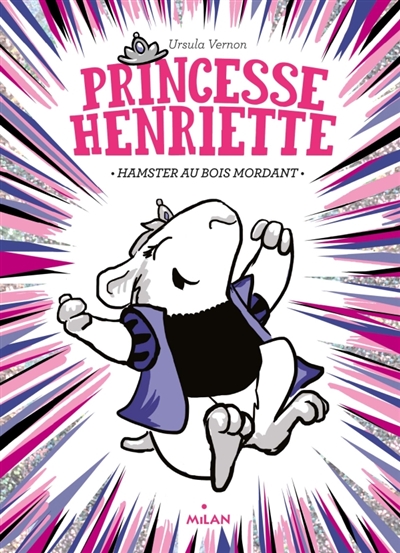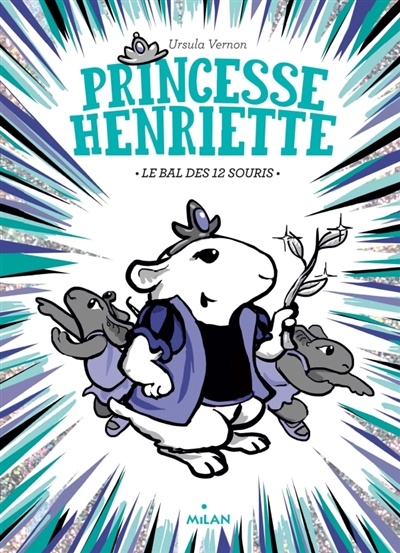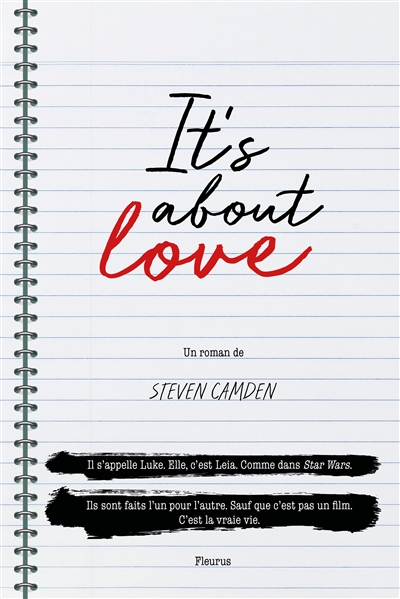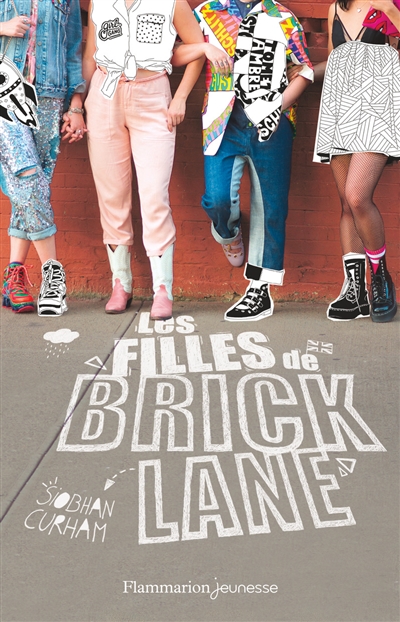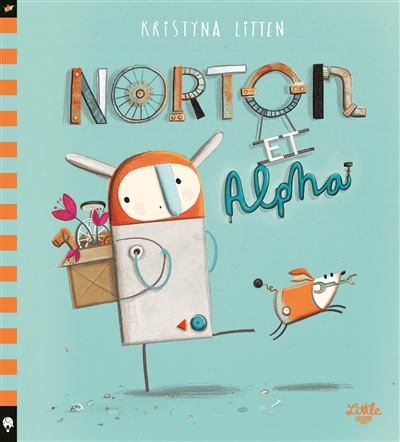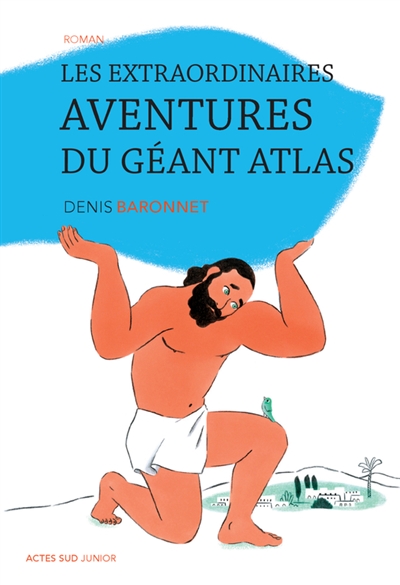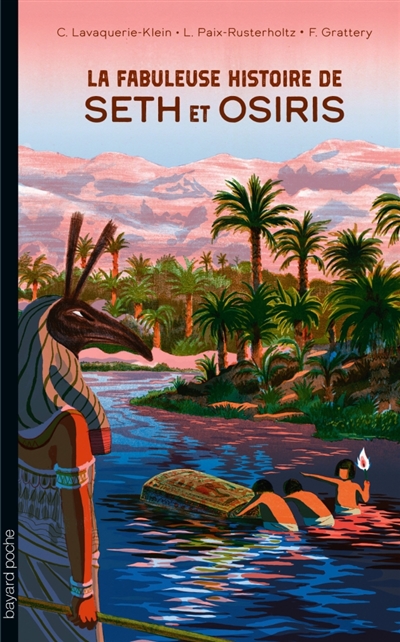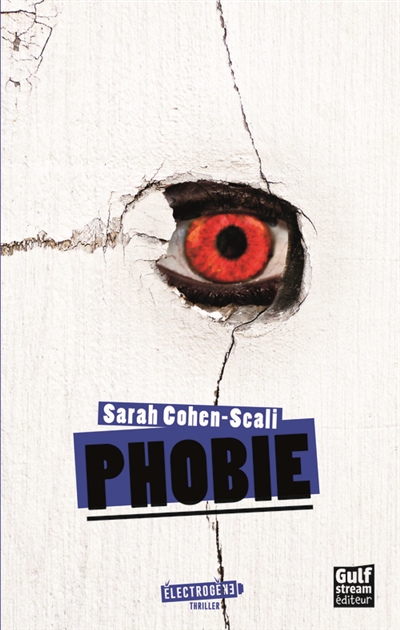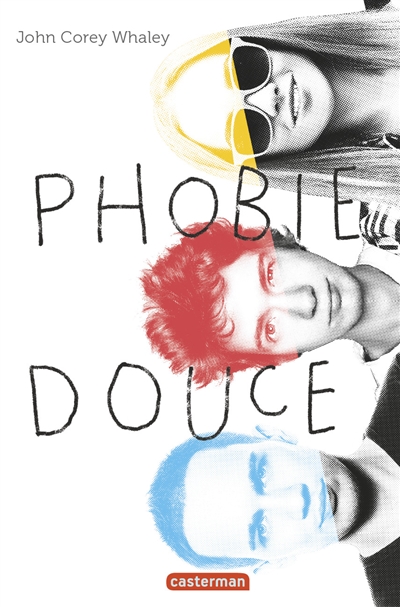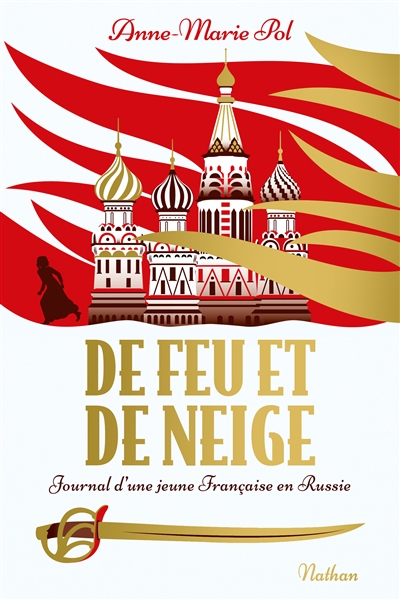Jeunesse
Pascal Vatinel
La Dernière Course

-
Pascal Vatinel
La Dernière Course
Actes Sud Junior
01/03/2026
0 €
-
Chronique de
Mélanie Mignot
Librairie Le Grand Cercle (Éragny-sur-Oise) -
❤ Lu et conseillé par
5 libraire(s)
- Françoise Dupuis-Marsal de Le Neuf (Saint-Dié-des-Vosges)
- Mélanie Mignot de Le Grand Cercle (Éragny-sur-Oise)
- David Piovesan
- Cécile Babois
- Ellen Brezellec de Auréole (Auray)

✒ Mélanie Mignot
(Librairie Le Grand Cercle, Éragny-sur-Oise)
La Première Guerre mondiale, sujet omniprésent chez les auteurs en cette année de centenaire, est au cœur du nouveau roman de Pascal Vatinel. Cependant, il nous offre un récit passionnant et nous fait découvrir un aspect méconnu de la Grande Guerre : l’utilisation des chiens de traîneaux sur le front.
Comme beaucoup d’auteurs avant lui, Pascal Vatinel nous propose un roman sur la Première Guerre mondiale. Encore, me direz-vous ! Mais je vous répondrai : non, car le sujet abordé par cet auteur est rarement connu du public. En effet, ce récit nous raconte comment des chiens de traîneaux d’Alaska et leurs mushers ont sauvé tant de soldats dans l’Est de la France au cours de cette sinistre période de notre Histoire. Ils ont même sûrement contribué à la victoire des Alliés. La Dernière Course, c’est la vie d’Elisabeth, fille de mushers canadiens qui part de son Alaska aux côtés de son ami Darren Lindsay pour rejoindre le front français. Arrivés au Havre, ils vont entraîner des soldats pour qu’ils deviennent mushers sur le front des Vosges. Un roman teinté de sensibilité et d’une extrême poésie.
Page — Votre roman La Dernière Course nous emmène en Alaska à la rencontre de mushers* et de leurs chiens. Comment vous est venue l’idée de nous faire voyager dans cet univers ?
Pascal Vatinel — Avec un documentaire diffusé sur Arte racontant l’aventure de deux officiers français partis en Alaska chercher des chiens destinés à servir sur le front des Vosges. J’ai tout de suite été passionné par cet épisode aussi incroyable que peu connu de la Grande Guerre et pensé qu’il méritait davantage de mise en relief. En plus de la formidable traversée des 440 molosses depuis le fin fond de l’Alaska jusque dans l’Est de la France, j’ai voulu retranscrire l’univers insolite qu’était cette Amérique profonde du début du xxe siècle. Les trente premières années de ce siècle ont témoigné d’une profonde mutation de nos sociétés : la profusion de découvertes, l’industrialisation, l’urbanisation et, bien sûr, la tragédie de 14-18 et ses millions de morts, victimes de l’utilisation d’armes de plus en plus sophistiquées et meurtrières. Je tenais donc aussi à décrire dans quel contexte les équipages canins et leurs mushers ont exécuté leurs missions, et avec quel courage ils ont tenu bon. Je rappelle que cela fut tout de même la première fois que des chiens étaient décorés de la Croix de guerre par l’armée française ! Ces recherches historiques auxquelles j’ai consacré beaucoup de temps ont nourri mon écriture.
Page — Contrairement à l’histoire originale, votre personnage principal est une femme. Pourquoi avoir choisi de mettre à l’honneur une figure féminine pour illustrer votre roman ?
P. V. — Vous avez raison : l’histoire originale était intégralement masculine ! Et il en va ainsi de la plupart des récits sur cette période, et en particulier sur la guerre. Mais, en plongeant dans la réalité historique de l’époque, j’ai pris conscience que n’évoquer que des hommes, c’est, comme on dit en Chine, oublier la moitié du Ciel ! Moins présentes au combat, les femmes n’en ont pas moins joué un rôle déterminant sur un plan plus général. Mères, compagnes, ouvrières, espionnes, aviatrices, mushers… elles brisaient peu à peu les limites imposées par le vieux carcan social. En Amérique, elles avaient acquis le droit de vote dans plusieurs États et ce depuis quelques décennies. Les suffragettes européennes tentaient de leur emboîter le pas sur bien des plans, affirmant une volonté réelle d’émancipation. Elisabeth, mon héroïne, est en quelque sorte la représentante de toutes ces femmes souvent oubliées, mais dont le courage n’était pas moins grand que celui des militaires. Je pense aussi que c’est un personnage très attachant et qui crée un lien essentiel entre tous les autres protagonistes, ajoutant sa propre vision sur les événements en question.
Page — Pourquoi s’intéresser à ce sujet ? Est-ce pour rendre hommage à ces héros canins et leurs maîtres ?
P. V. — La première raison est que pour faire un bon roman, il faut surtout une belle histoire. Or, l’histoire de ces aventuriers et de leurs compagnons à quatre pattes est magnifique ! Il est malgré tout exact qu’une certaine forme de « devoir de mémoire » s’est imposée à moi au fil de mon écriture. Ces hommes et leurs compagnons ont réellement existé et accompli les exploits que je décris. Qui en a entendu parler ? Je me suis adressé à plusieurs historiens : un seul avait un vague souvenir d’un pareil épisode. Sans l’aide précieuse des officiers en charge des archives au château de Vincennes, j’aurais fini par croire que tout cela n’avait peut-être pas existé. Ce que ces sections canines ont accompli mérite, à mon sens, d’être davantage su.
Page — Comment avez-vous pu rendre aussi bien cette complicité entre les hommes et leurs compagnons ?
P. V. — Dans le Grand Nord, dire que la complicité entre le musher et son chien de tête, et même tout son équipage, est essentielle, n’est pas un vain mot. Leur survie en dépend à chaque instant. La piste rendue invisible par la neige, le blizzard capable de congeler un individu en quelques minutes, la glace d’un lac qui peut se briser à tout moment… Les chiens, leur maître, la nature, doivent être en parfaite osmose. Cela suppose de la modestie, de l’observation, de l’écoute et, surtout, du respect. Je suis heureux si cela transparaît dans la lecture de ce roman. Pour l’écrire, j’ai dû étudier l’univers et les techniques des mushers. Mais je n’oublie pas que Jack London a longtemps été un de mes auteurs favoris. J’ai également séjourné à plusieurs reprises au Canada où j’ai pu observer des équipages de mes propres yeux. Le travail fantastique que certains hommes accomplissent au contact du monde animal, améliorant ainsi leur compréhension de celui-ci, me fascine. Scotty Allan, qui « murmurait aux oreilles des chiens » et qu’a connu Jack London, est réellement quelqu’un que j’aurais aimé rencontrer.
Page — Vos personnages sont attachants, sensibles, héroïques. Avez-vous aisément réussi à vous en détacher ?
P. V. — Eh bien non, je n’y suis toujours pas arrivé ! Leur stature exceptionnelle ne peut s’effacer d’un coup. En outre, le fait d’avoir travaillé sur des archives, d’avoir retrouvé des photos, des papiers militaires, etc., n’a fait qu’ancrer davantage leurs visages dans mon esprit. C’est également vrai pour les rares personnages fictifs, comme Elisabeth. À force de vouloir les rendre attachants, j’ai été pris à mon propre piège. Cela a au moins un avantage : jusqu’ici, lorsque des lecteurs me demandaient si un de mes romans avait ma préférence, pour « botter en touche », je répondais : le dernier. Avec ce roman, c’est une vérité absolue !
* conducteurs de traîneaux à neige tiré par un attelage de chiens.