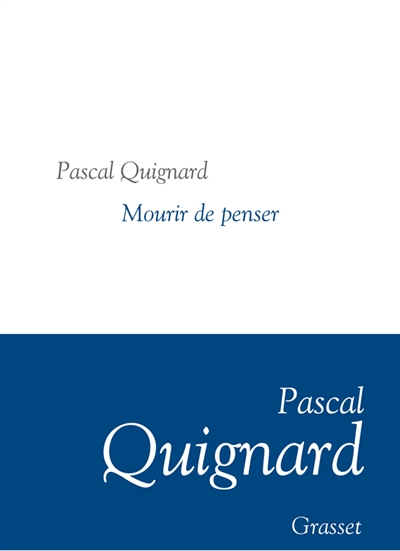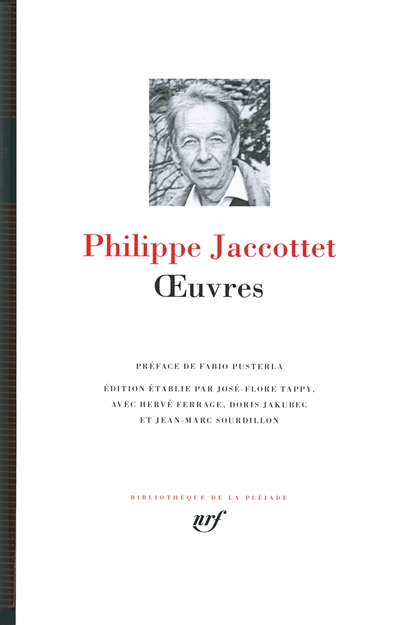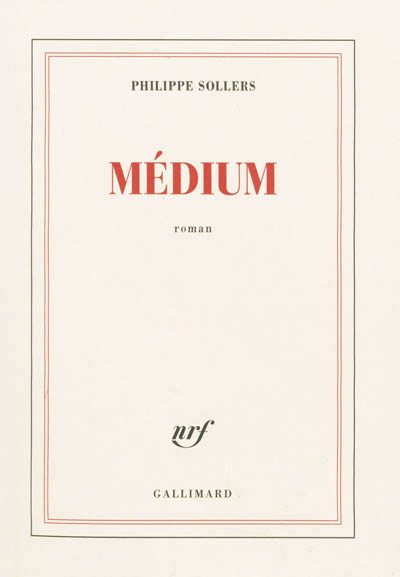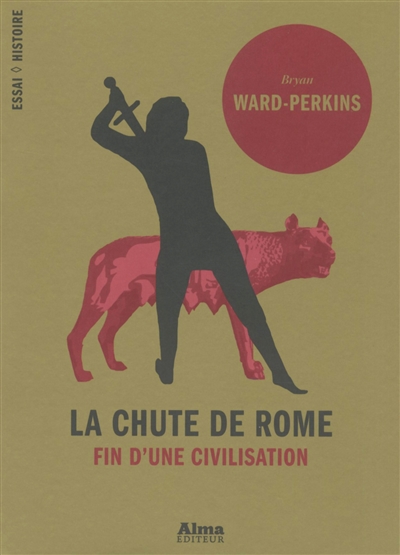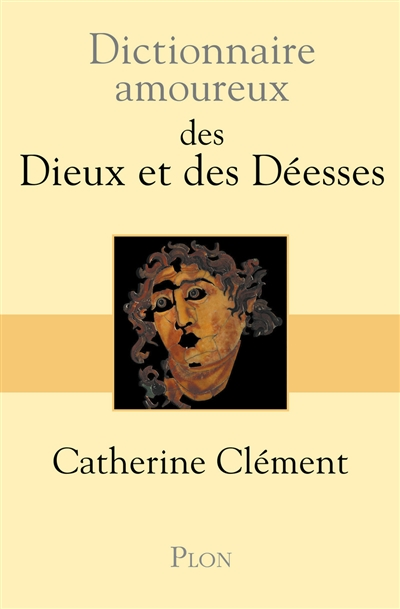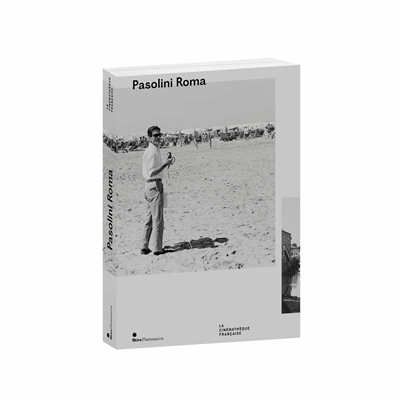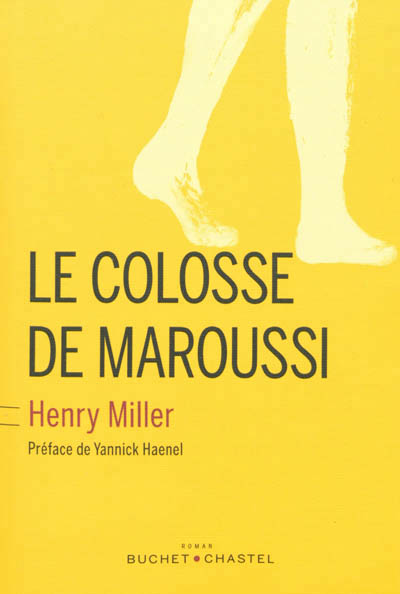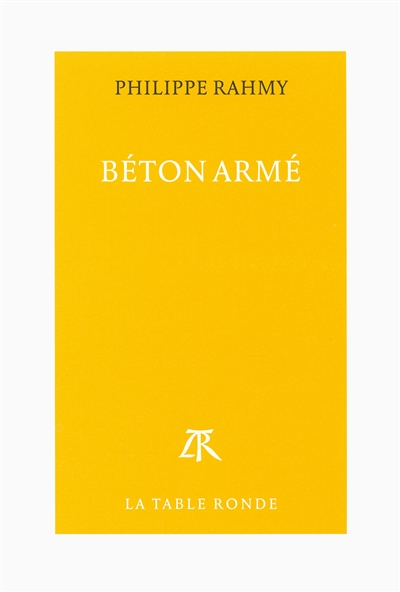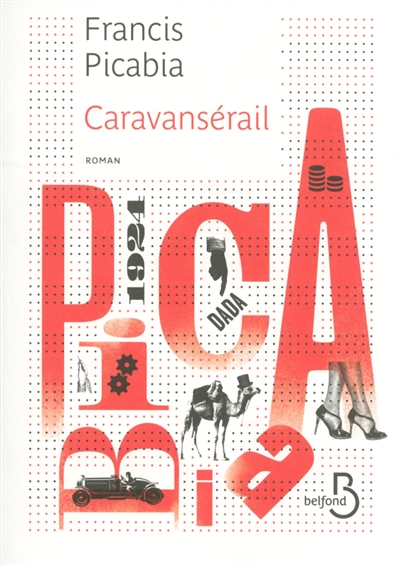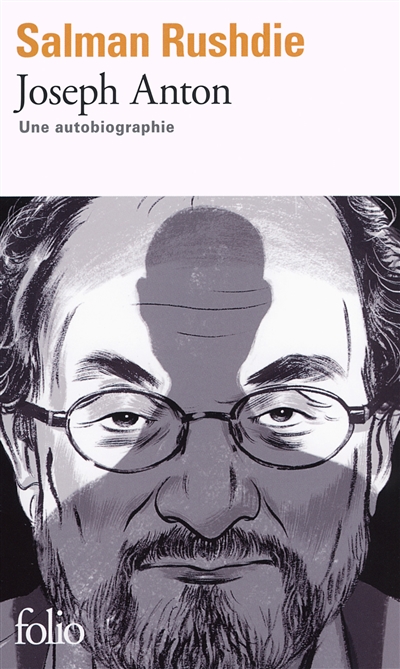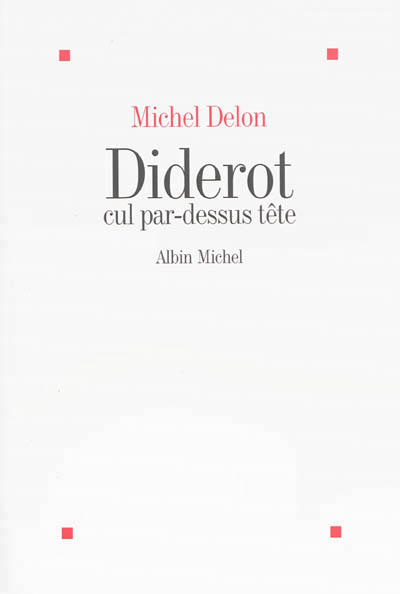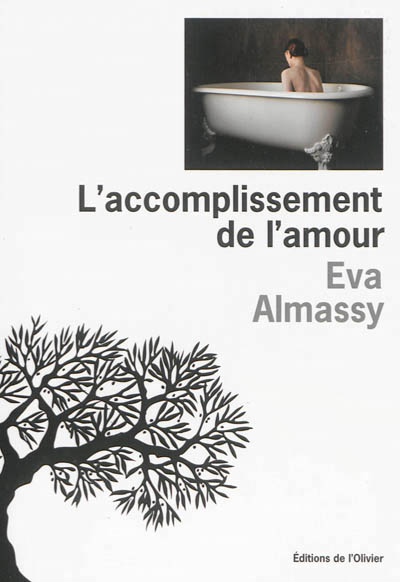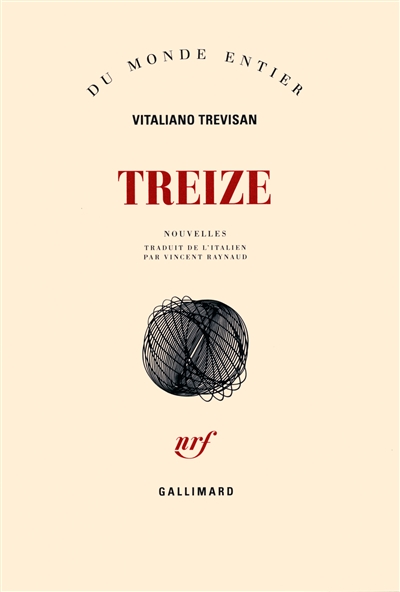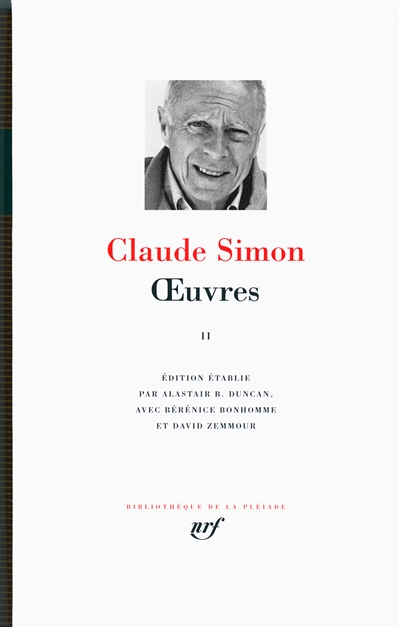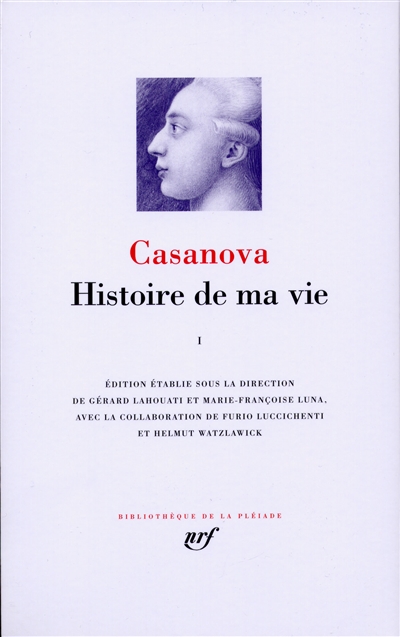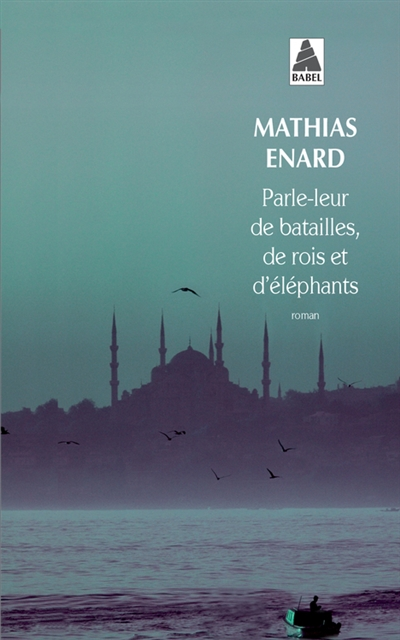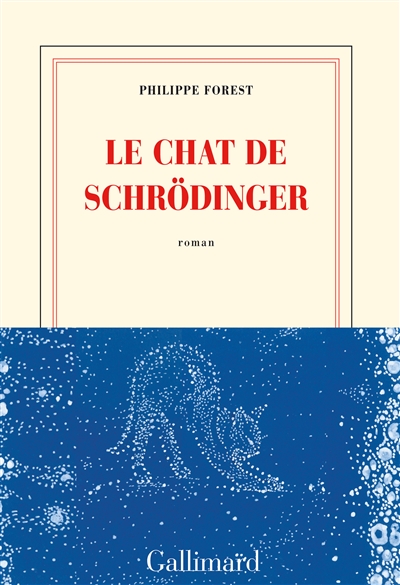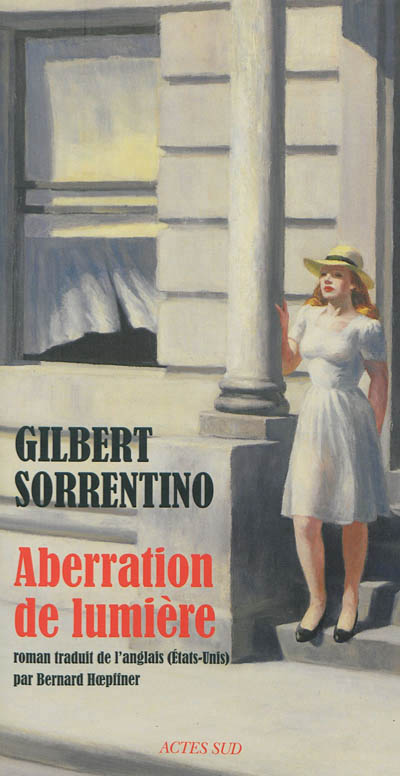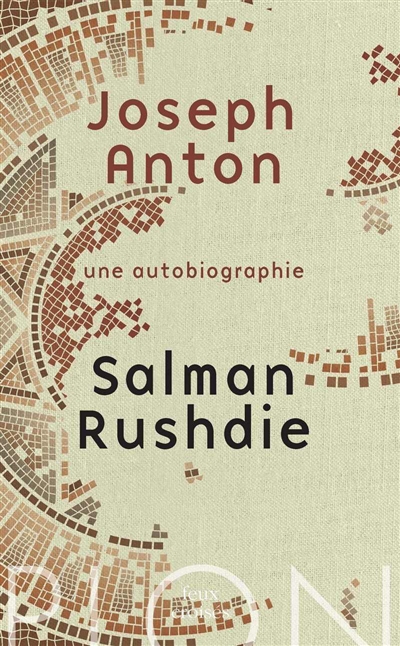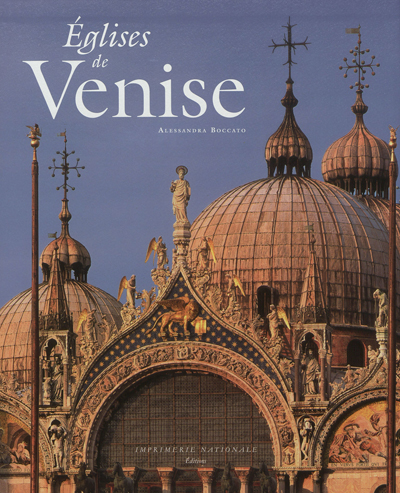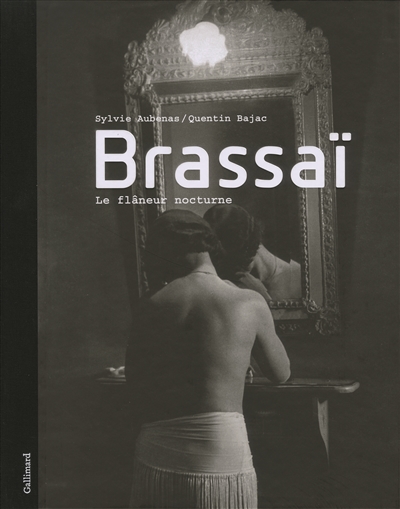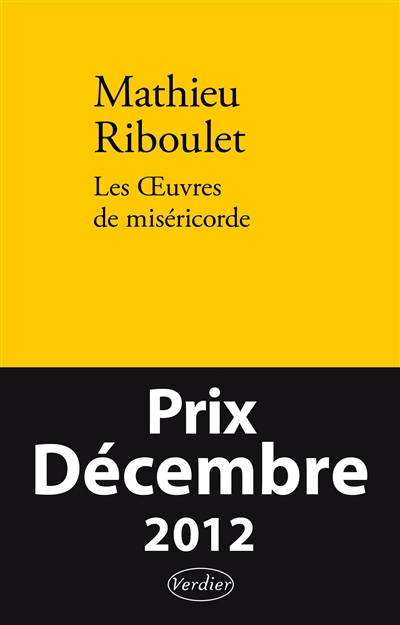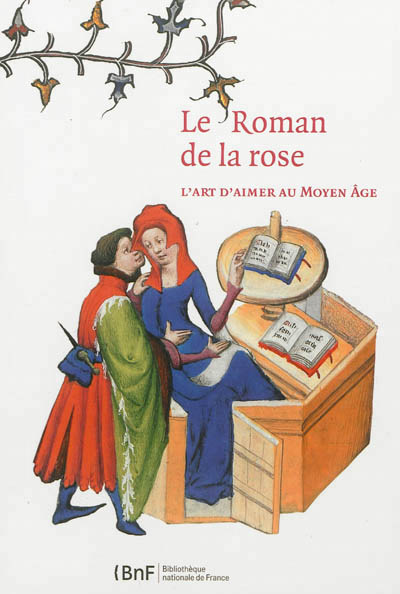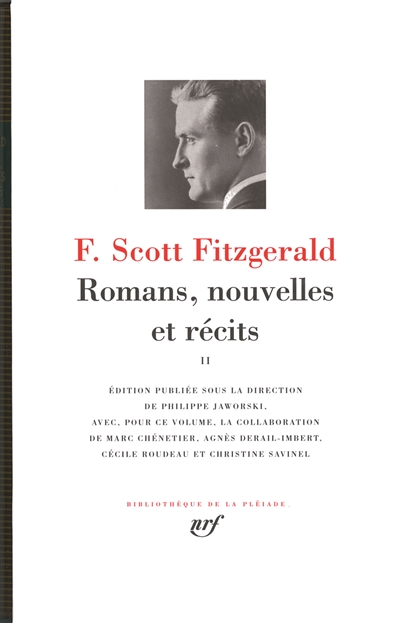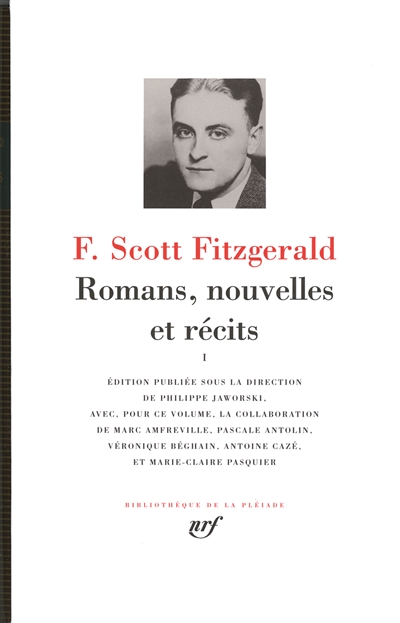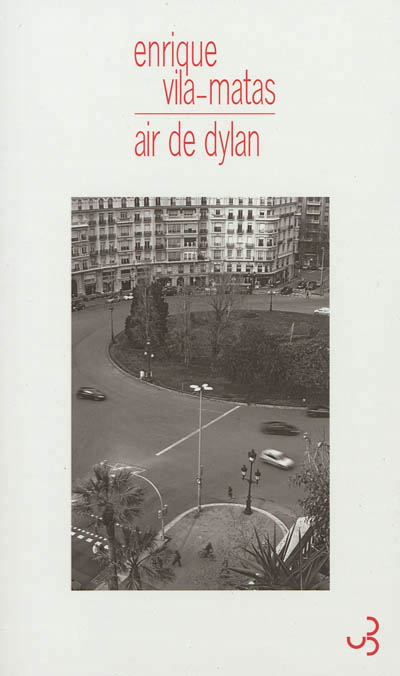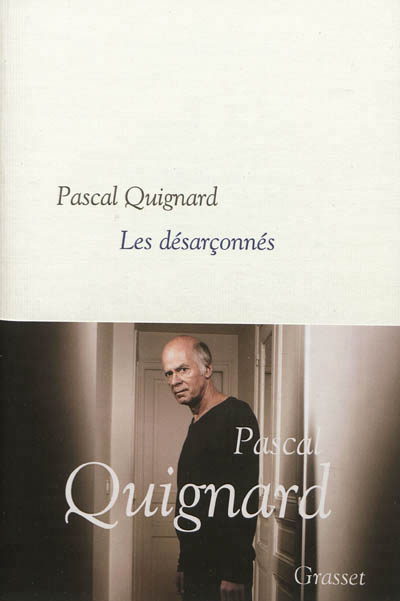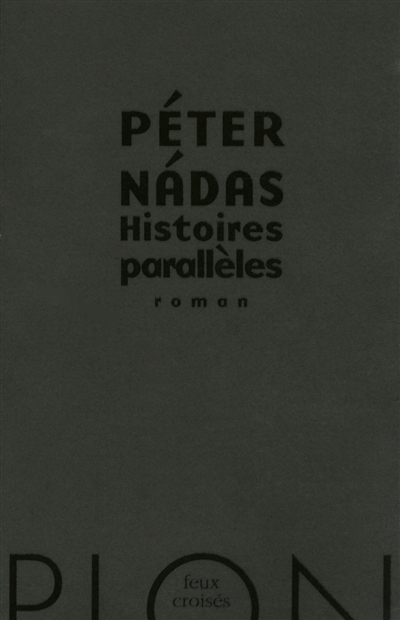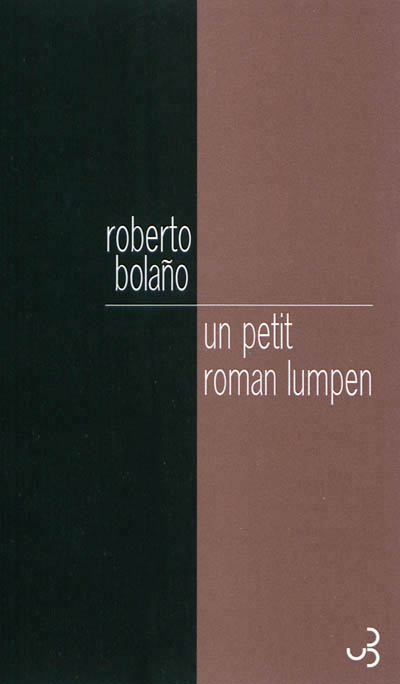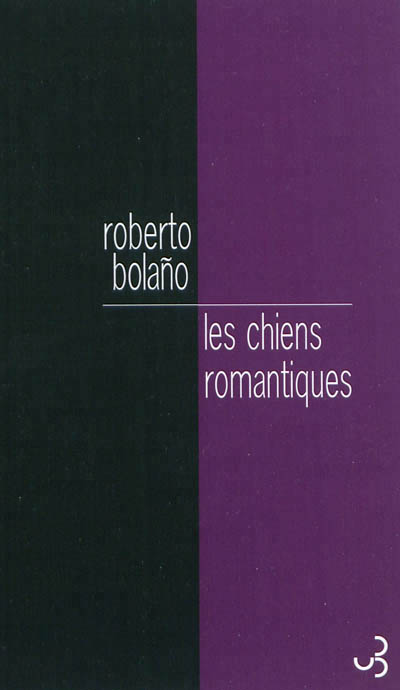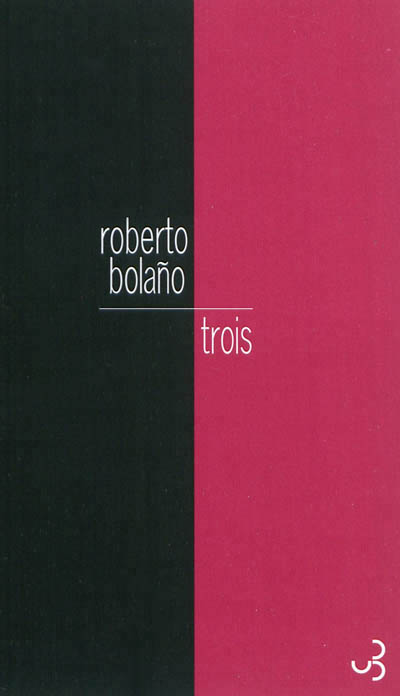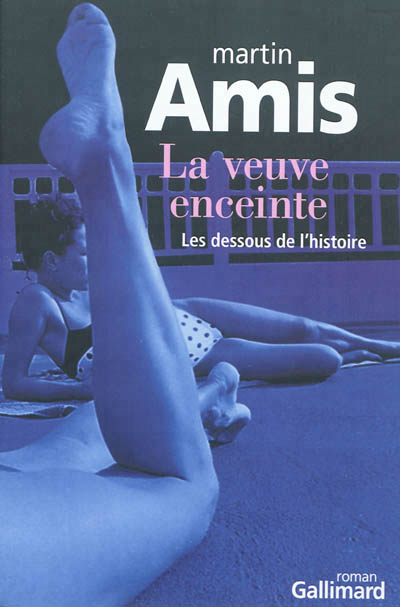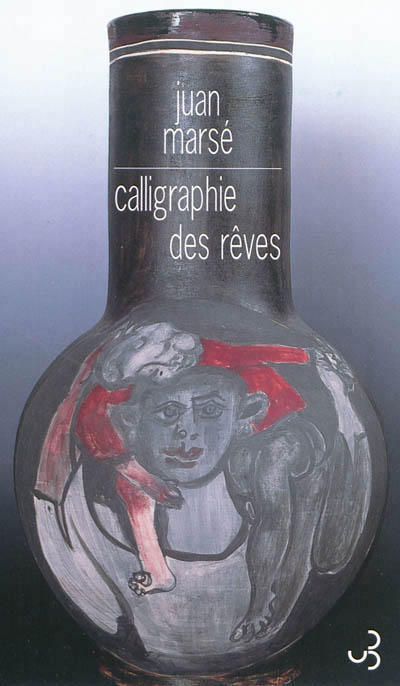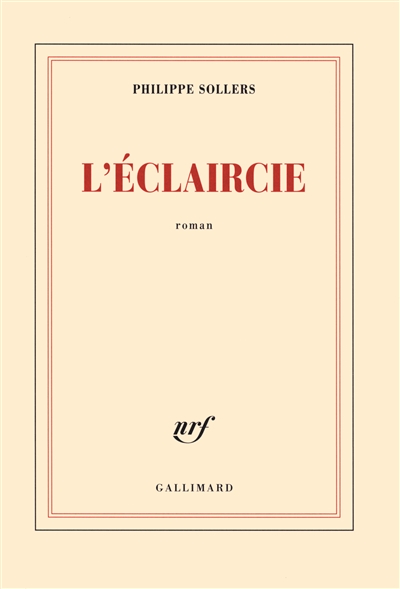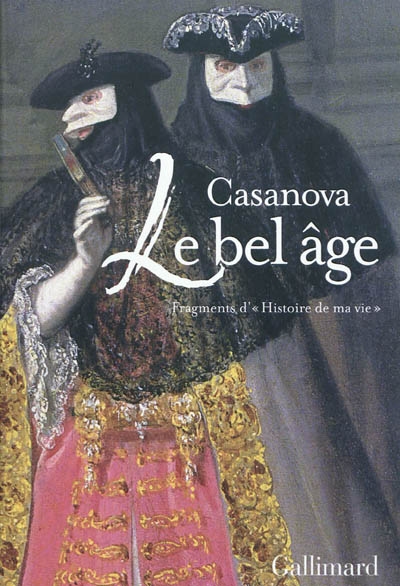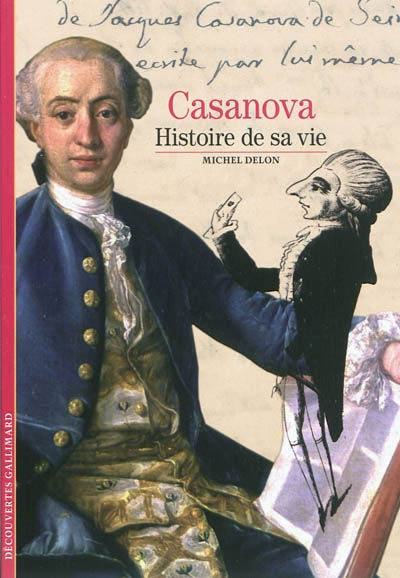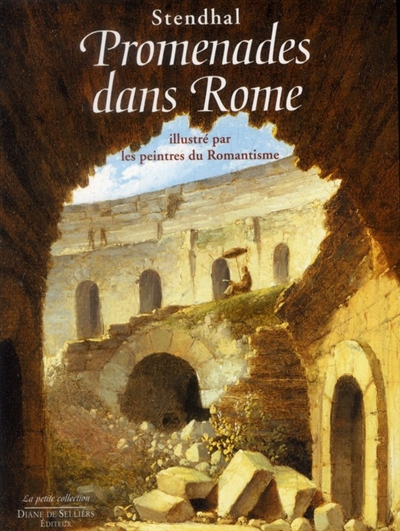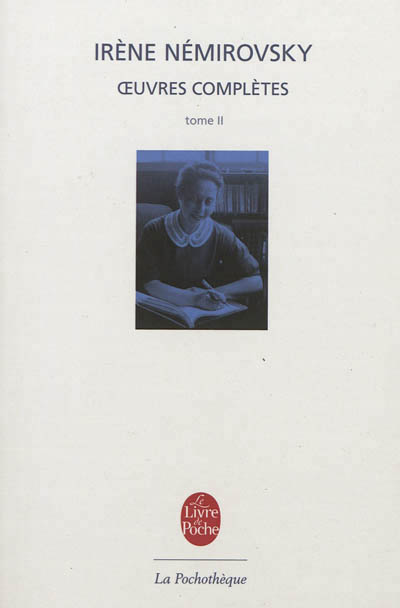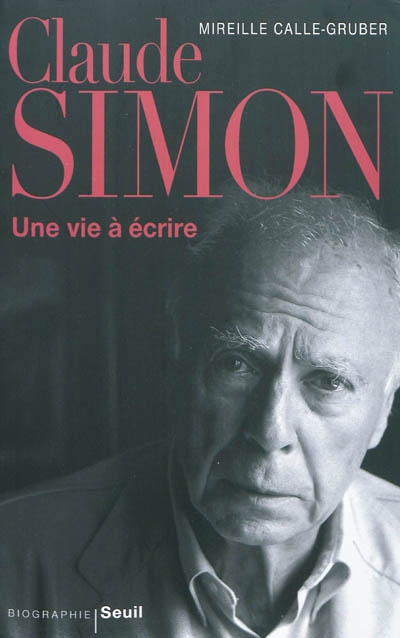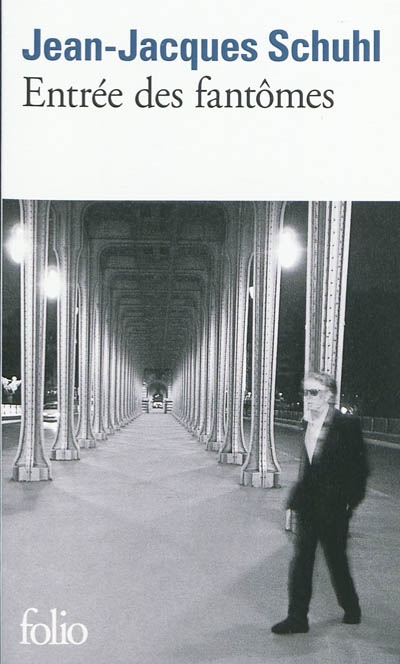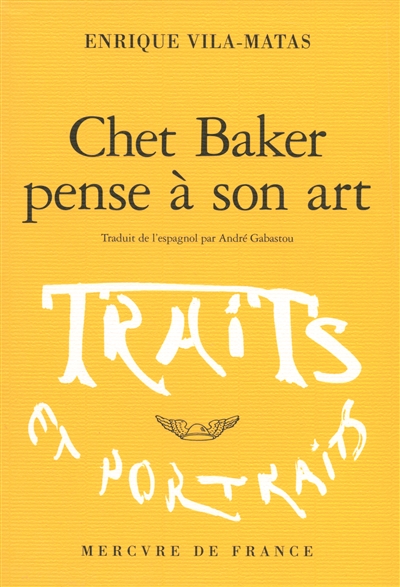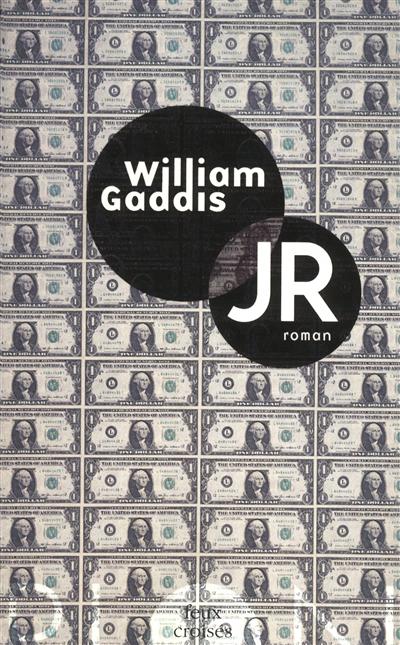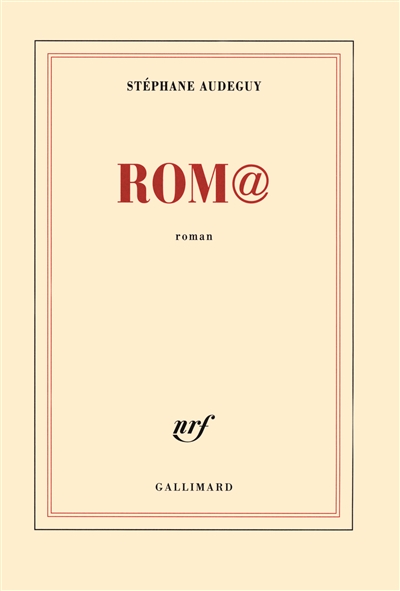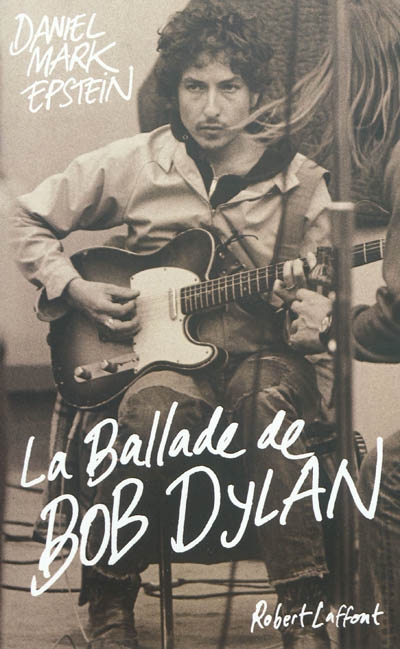Littérature étrangère
Enrique Vila-Matas
Impressions de Kassel

-
Enrique Vila-Matas
Impressions de Kassel
Traduit de l’espagnol par André Gabastou
Christian Bourgois éditeur
25/12/2025
364 pages, 22 €
-
Chronique de
Olivier Renault
Librairie La Petite lumière (Paris) -
❤ Lu et conseillé par
5 libraire(s)
- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales, Université (Tours)
- Camille Hacquard de Aux vieux livres (Châteaugiron)
- Claudia De Bonis de Fondation Louis Vuitton (Paris)
- Alexandra Romaniw de L'Atelier (Paris)
- Emilie Pautus de La Manœuvre (Paris)
✒ Olivier Renault
(Librairie La Petite lumière, Paris)
Bonne nouvelle pour les amoureux de la littérature : le dernier roman d’Enrique Vila-Matas est un petit joyau. Un livre d’une étonnante acuité sur l’art contemporain et le nouveau pacte qu’il propose entre l’humain et le monde. Une clé, lucide et ironique, sur l’art de notre temps.
Dans le prolongement de Perdre des théories et de « Parce qu’elle ne l’a pas demandé », une nouvelle commandée par Sophie Calle (présente dans le recueil Explorateurs de l’abîme, Christian Bourgois), ce nouveau roman de Vila-Matas (au titre rousselien d’Impressions de Kassel) est une merveilleuse plongée dans l’univers de l’art contemporain. Le narrateur n’a pas peur de se perdre, ni dans cette ville de Kassel (celle des frères Grimm qui ont écrit Le Petit Poucet), ni dans ses réflexions et ses sensations. Le livre recèle d’analyses d’une grande finesse sur l’art contemporain, du moins sur les œuvres que le narrateur a su « éprouver », physiquement et intellectuellement, avec une curiosité gourmande, sans perdre pour autant son sens critique, ni son humour. Du grand Vila-Matas, un grand livre. Le jour de l’entretien, Enrique Vila-Matas a appris qu’il était l’heureux récipiendaire du prix Premio Formentor donné notamment à Beckett, Gombrowicz ou Gadda. Les derniers récipiendaires étaient Fuentes, Goytisolo, Javier Marías…
Page — Le roman se situe à la Documenta de Kassel ; c’est l’événement qui, tous les cinq ans, réunit ce qui est considéré comme le summum de l’art contemporain. Vous avez été invité à la Documenta 13, de 2012. Ce qui suppose que l’on vous considère comme un artiste…
Enrique Vila-Matas — Pour moi, cette invitation était complètement inespérée parce que je ne suis pas un artiste plasticien. J’adore la Documenta qui, dès 1972, a joué un grand rôle pour les avant-gardes en Europe et dans le monde. Je n’aurais jamais pensé y être invité pour y participer comme artiste. J’ai reçu cette proposition avec bonne humeur et stupeur. Je ne m’attendais pas à cela. Après, il s’est passé une année, pendant laquelle on ne m’a rien dit. Aucune nouvelle de la commissaire de la Documenta. Lorsque j’ai demandé ce que je devais y faire, on m’a répondu par courriel que je devrais écrire en public dans un restaurant chinois situé dans la banlieue de Kassel. J’ai pensé à cette situation : moi, en Allemagne, dans un restaurant chinois, à écrire devant tout le monde ! Pour moi, c’était horrible, parce que je n’aime pas montrer ce que j’écris, lorsque je suis en train d’écrire. Alors, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour éviter cette situation. Aussi, j’ai décidé d’écrire comme si j’étais un écrivain différent de moi. Comme si j’étais un monsieur Simenon, un Simenon deux, écrivant sur un thème qui ne me passionne pas, moi ; un thème différent. Alors j’y suis allé avec une enveloppe, pour l’écriture ; s’ils voulaient que j’écrive un roman, qu’au moins, il ne soit pas de moi. Mais le public pouvait penser qu’il s’agissait de moi. Donc, j’ai décidé de m’appeler « Autre ». En français. Autre, je suis Autre dans le roman. Mais voilà, il n’y avait pas de public, personne ne venait me voir ! (Rires.) Il faut dire que c’était en banlieue et que ça n’était pas annoncé. La situation était absurde, ce qui me va bien, et m’a permis de me promener. Une longue promenade de cinq jours dans tout Kassel, voyant tout ce qu’il y avait à voir. C’était comme un jardin des merveilles. Un endroit extraordinaire.
Page — On peut se demander si la commissaire ne vous a pas invité uniquement pour découvrir Kassel ! Y seriez-vous allé dans cette unique perspective ?
E. V.-M. — Un écrivain allemand discute avec la commissaire l’autre jour et lui dit : « Je pense que vous avez invité Vila-Matas pour qu’il écrive un roman. Vous l’avez fait exprès. » Mais non ! Les conditions étaient très bonnes pour moi parce que le voyage est comme la vie, un peu étrange, absurde. Il me permet de penser beaucoup parce que je suis un promeneur solitaire. Ça me permettait de réfléchir sur ce quoi j’avais envie de méditer, et je décide que c’est sur l’art. Le sens de l’art et le sens de la vie.
En définitive, ce sont cinq jours intéressants pour moi sur cette question. Le roman parle du sens de l’art, mais surtout du sens de l’avant-garde. L’avant-garde existe, ou n’existe pas ? La réponse est que je ne sais pas. Je me promène pendant cinq jours, je réfléchis, mais je ne sais toujours pas si l’avant-garde existe ou non. Si l’avant-garde existe, c’est parce que quelqu’un le manifeste… La toute première phrase du livre est : « Plus un auteur est d’avant-garde, moins il peut se permettre de se présenter comme tel ». En Espagne, il y a de jeunes écrivains qui décrètent qu’ils sont d’avant-garde. Mais pour être d’avant-garde, il faut le démontrer. Et pour le démontrer, il manque cinquante ans pour voir s’ils ont créé une rupture. Dickens, par exemple, ne dit jamais qu’il est d’avant-garde. Et pourtant il l’est, puisqu’il a modifié le cours de l’histoire de la littérature. Il ne suffit pas de s’autoproclammer d’avant-garde. Il faut du temps, du recul.
Page — Dans votre dédoublement romanesque, votre narrateur devient « Autre » (en hommage à Rimbaud), mais aussi Piniowsky, ce personnage d’un roman de Joseph Roth.
E. V.-M. — Piniowsky est ce personnage qui pense que l’Europe est finie, qu’elle s’est effondrée. Le monde est mort parce que l’Europe est morte depuis cent ans. Tout cela, je peux le dire dans un roman. Mais je ne peux pas le dire dans un entretien pour un journal. Je passerais pour un peu fou si je disais que l’Europe est morte il y a cent ans ! Mais en littérature, on peut le dire. Dans la littérature, on peut dire la vérité. Quand je parle pour un journal, je dois modifier mon discours et ne pas dire la vérité de fond. Je dois dire que j’aime l’Europe et que je crois en l’Union européenne. Et c’est vrai, je crois en l’Union européenne. J’y crois très peu, mais je vais voter pour les élections européennes. Mais je suis conscient que l’Europe est finie, qu’elle est une nécropole depuis longtemps, depuis les deux Guerres mondiales. Cette sensation a surgi à Kassel, au cœur de l’Allemagne, dans cette ville qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est la différence entre ce que l’on peut dire en littérature et ce que l’on peut dire dans la vie publique. Ce qui veut aussi dire que la littérature est le seul lieu de la vérité. C’est un discours différent de tous les discours – ceux de la radio, la télévision, la presse, Internet. La littérature peut dire, avec les mots exacts, ce que l’on pense en vérité. Notre vérité. La littérature n’est pas morte, mais c’est un endroit étrange. En Espagne, il est difficile de trouver de la littérature, elle est souvent cachée. Mais je suis optimiste, je crois qu’elle existe.