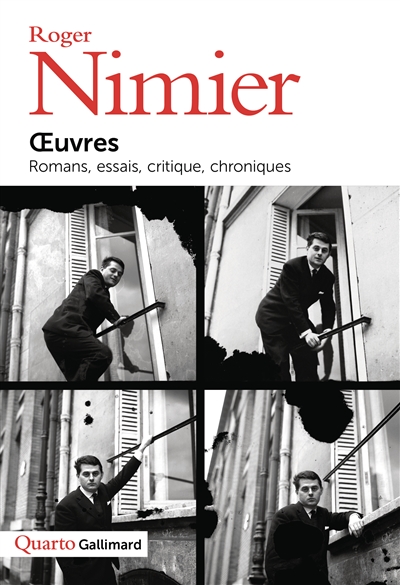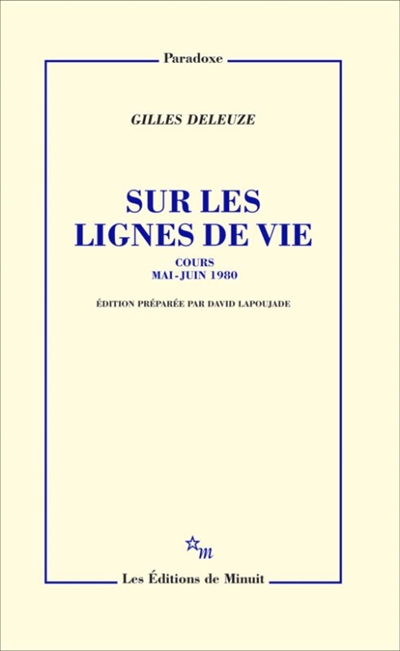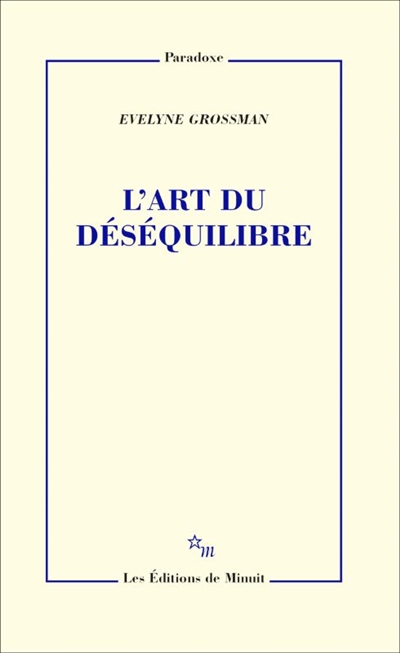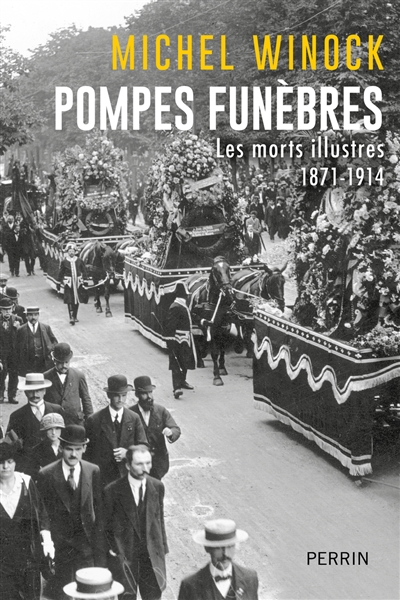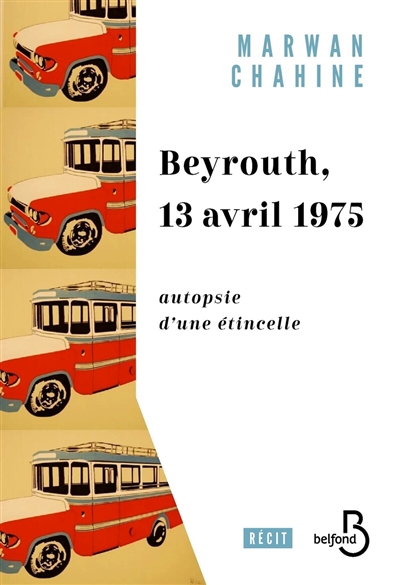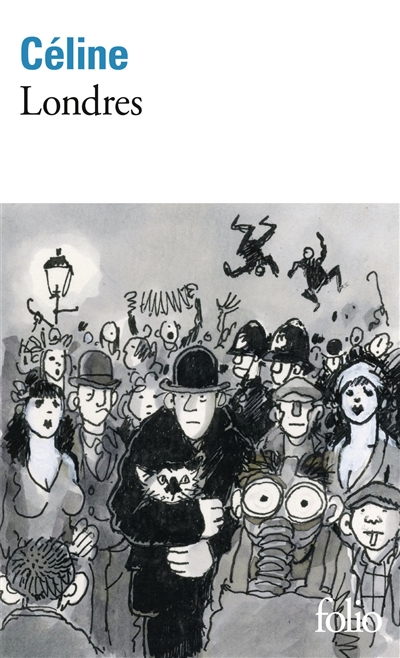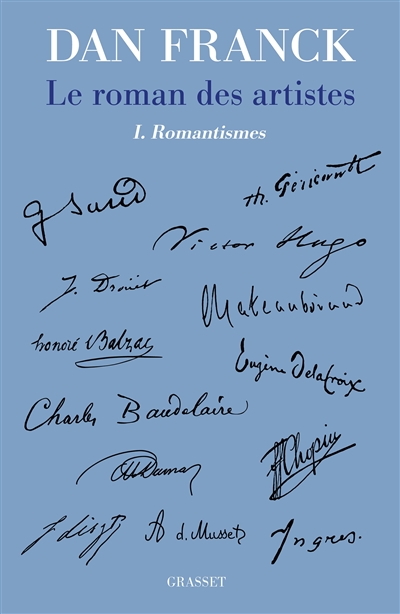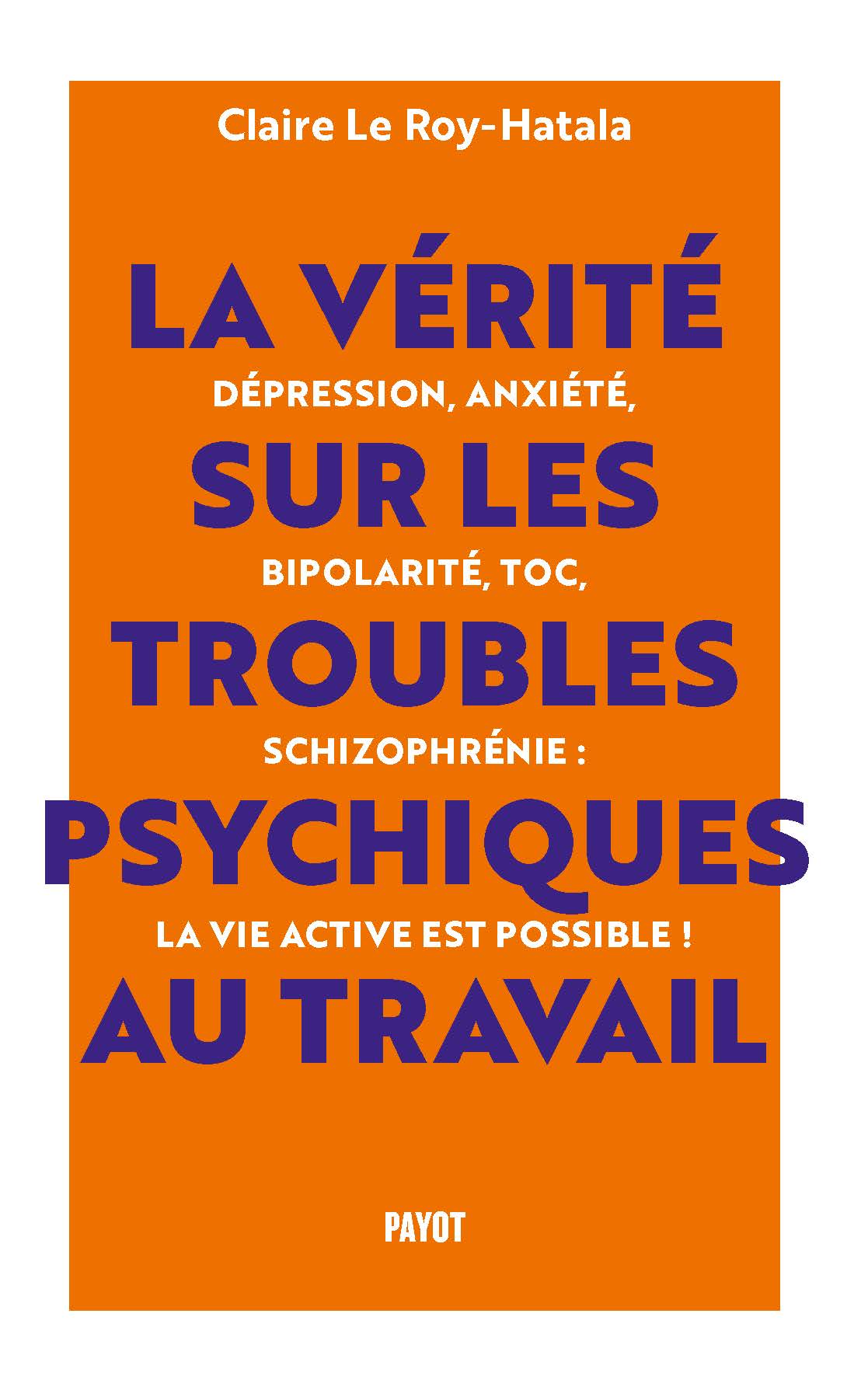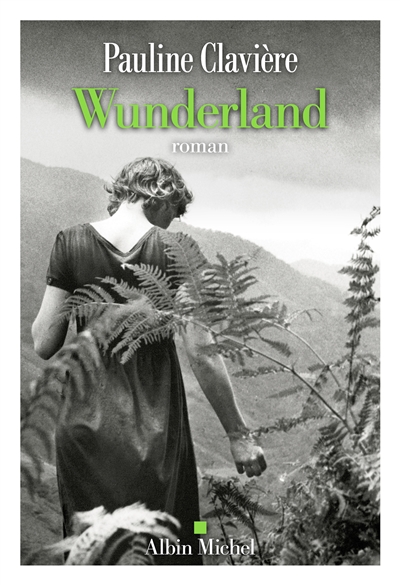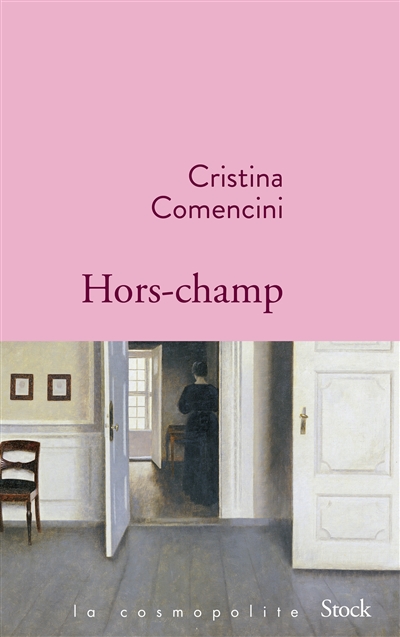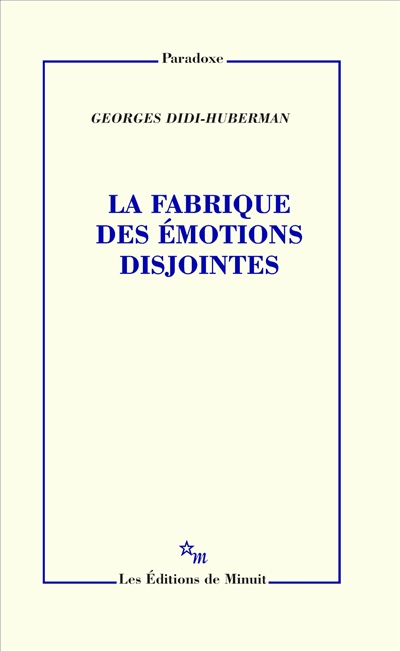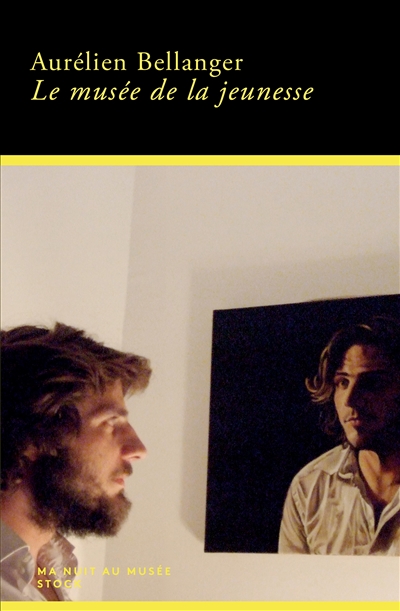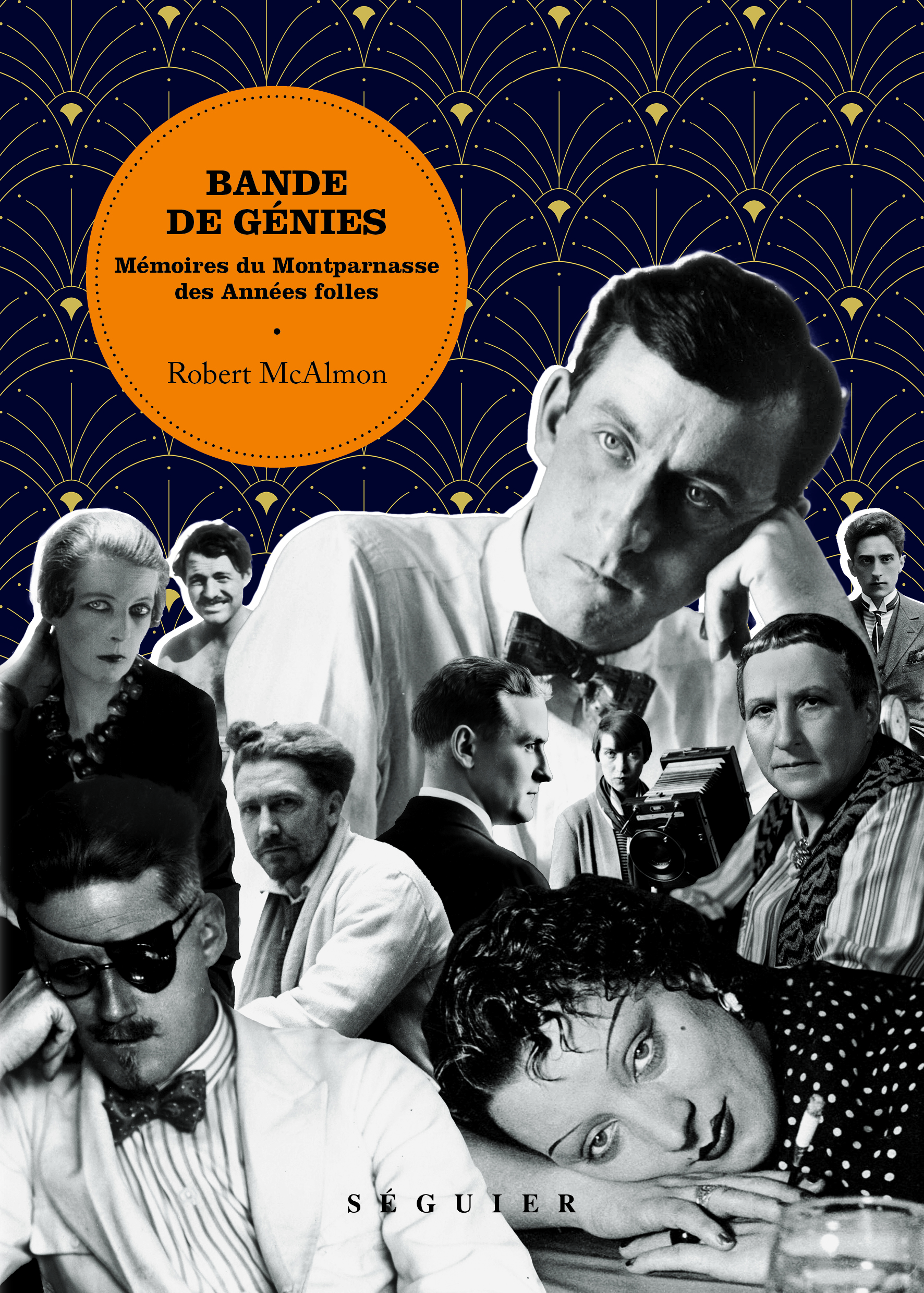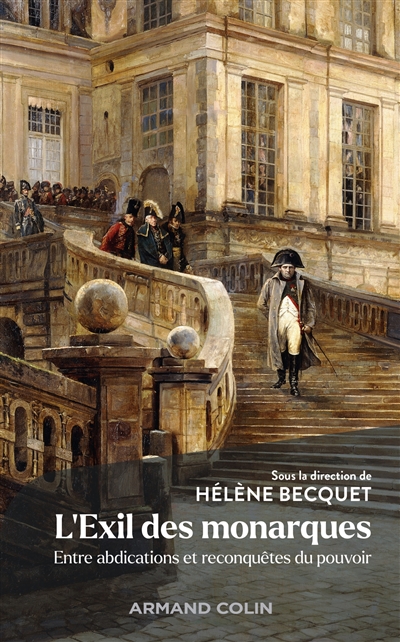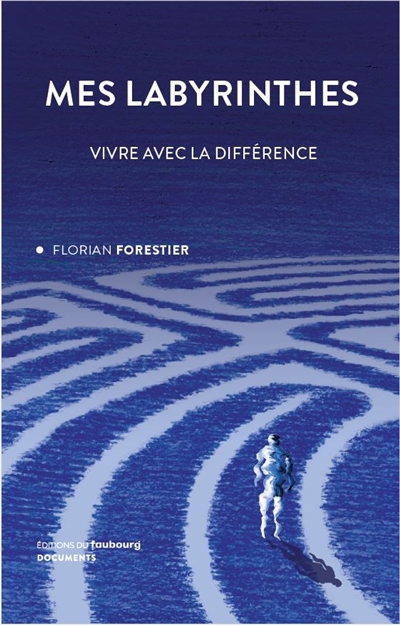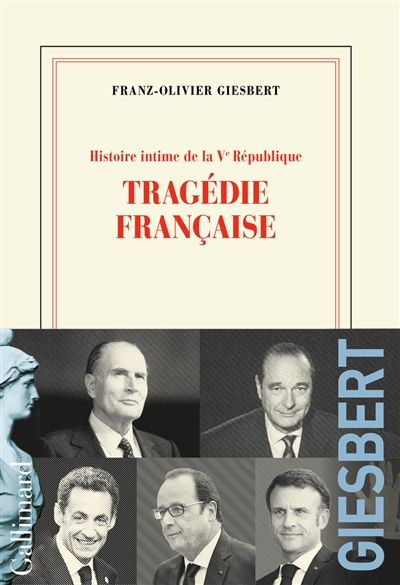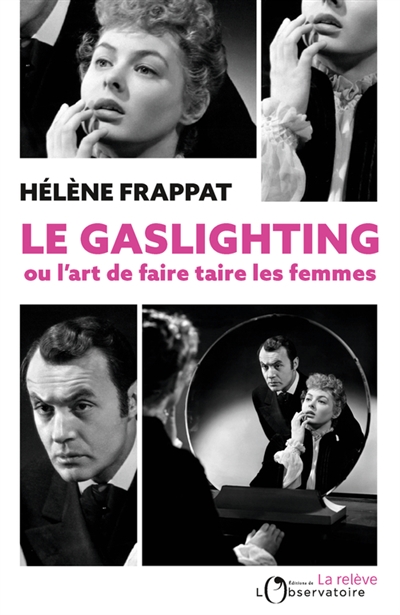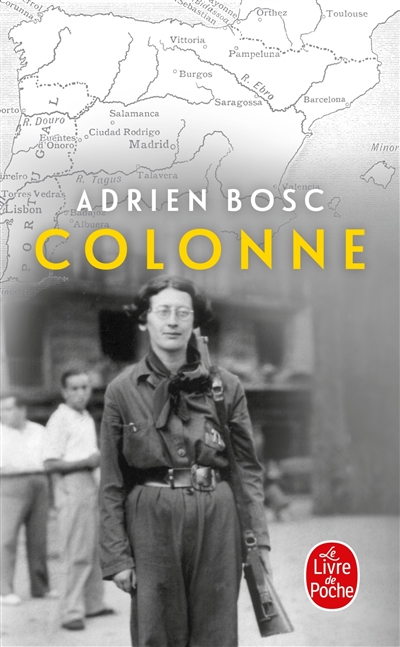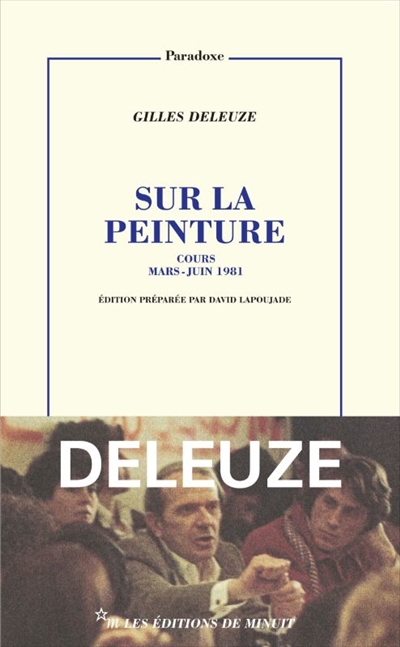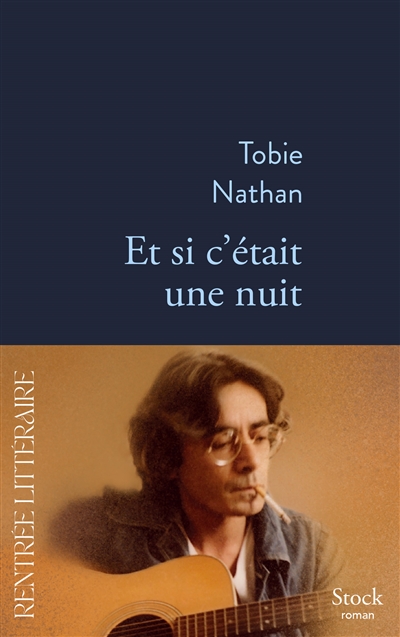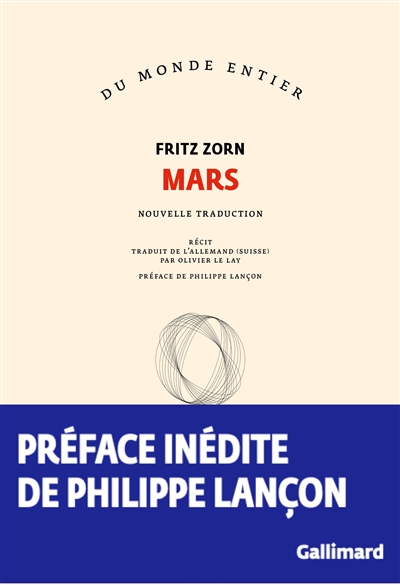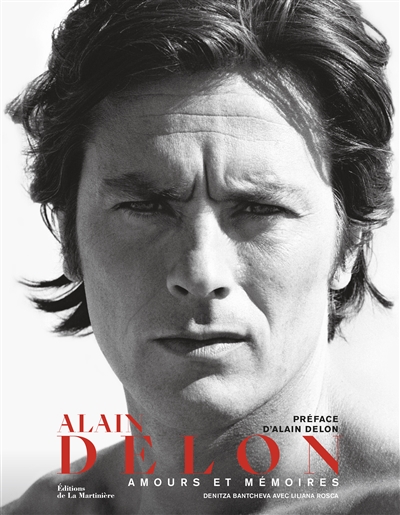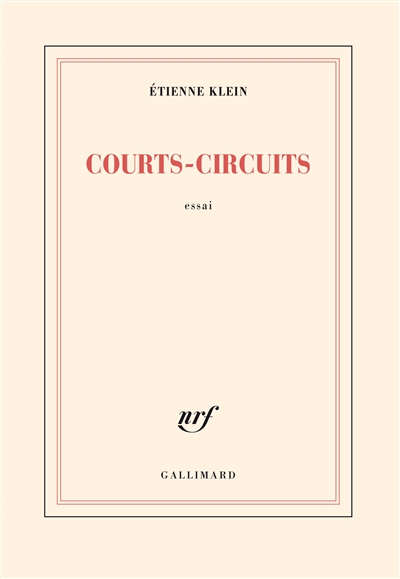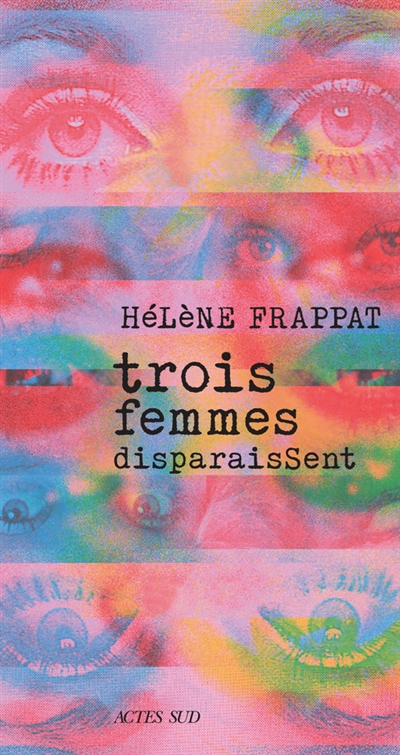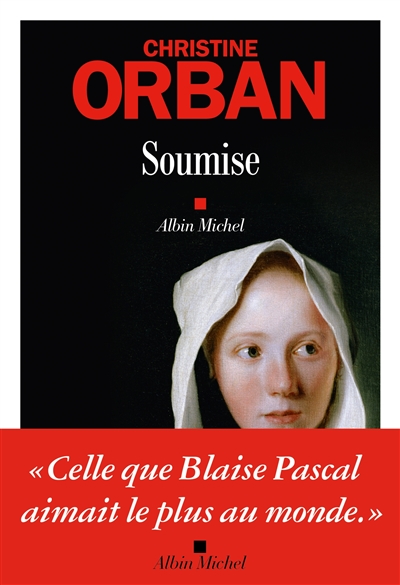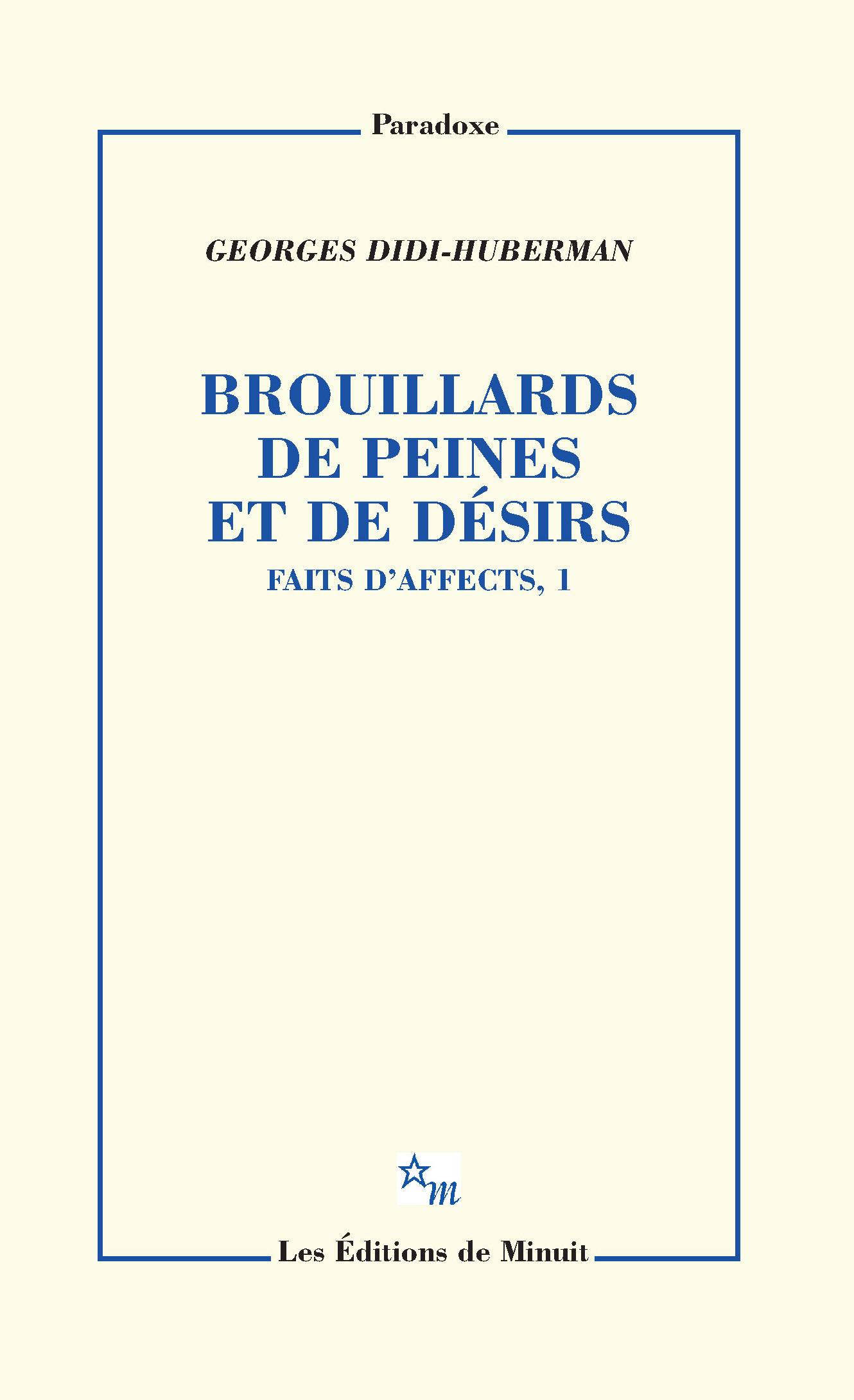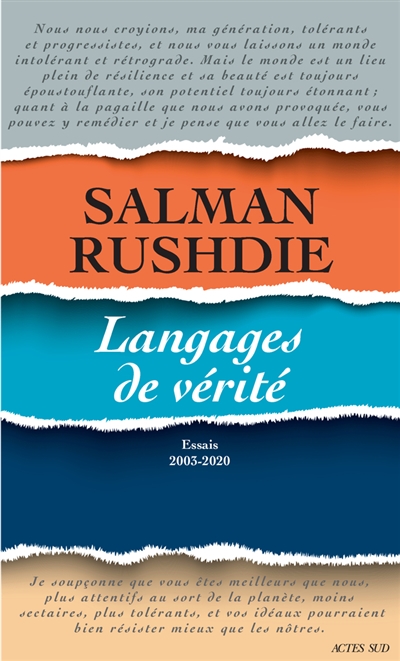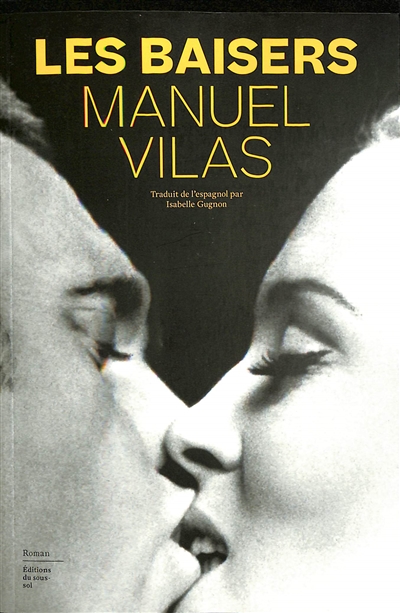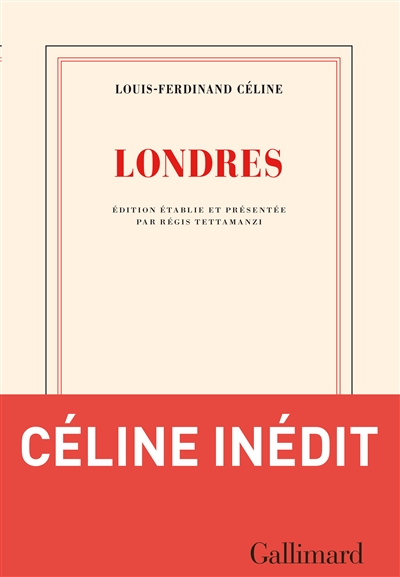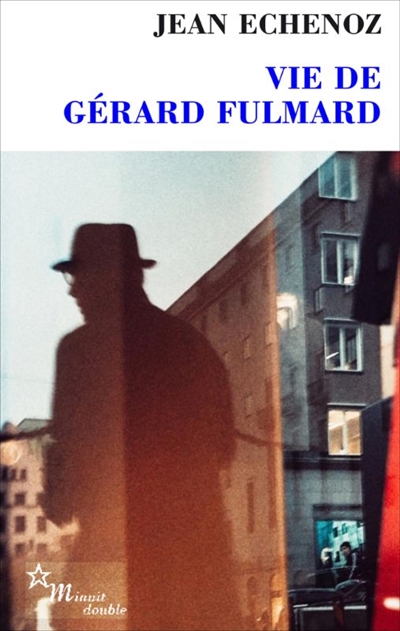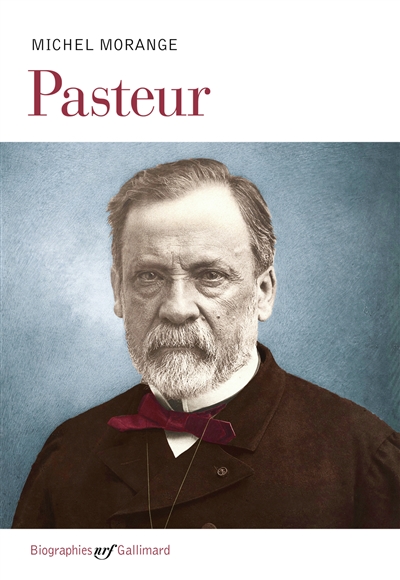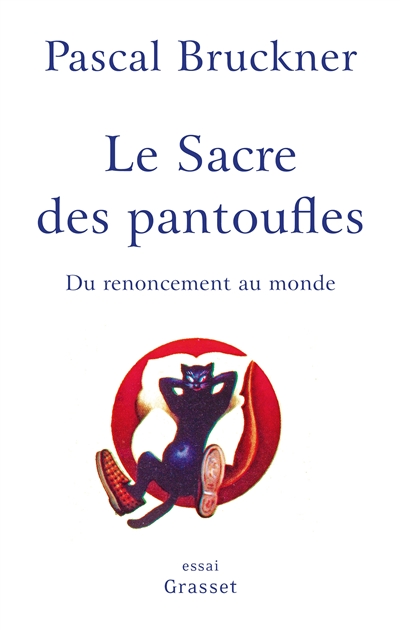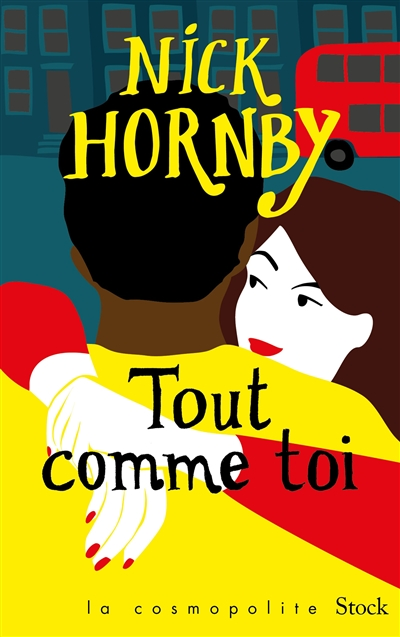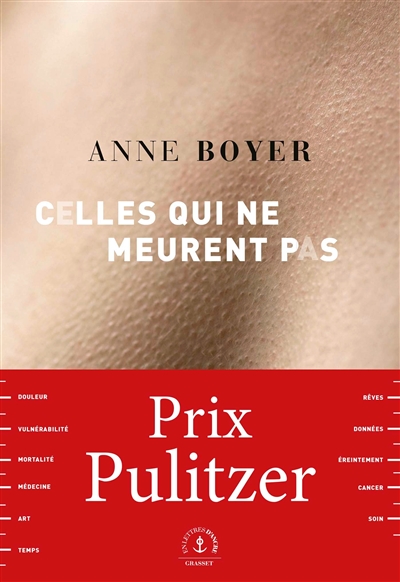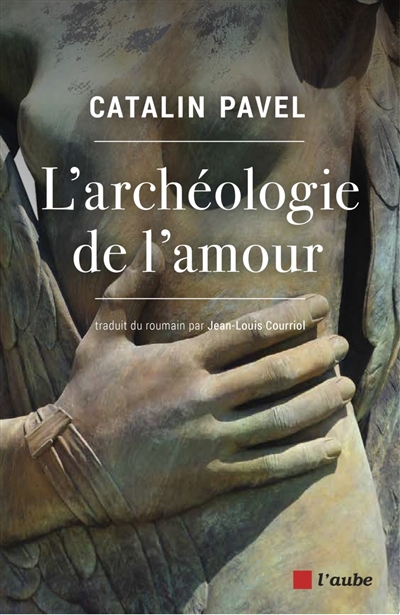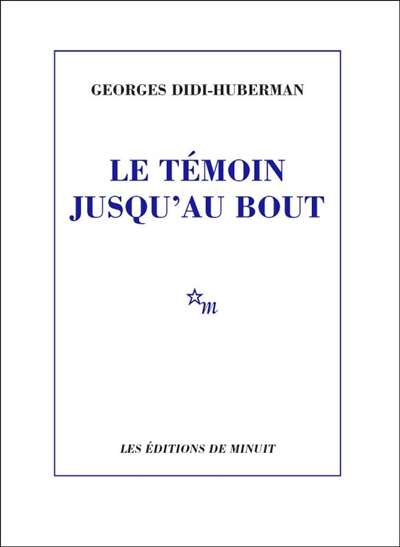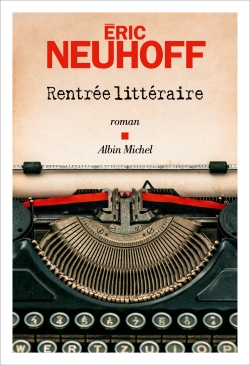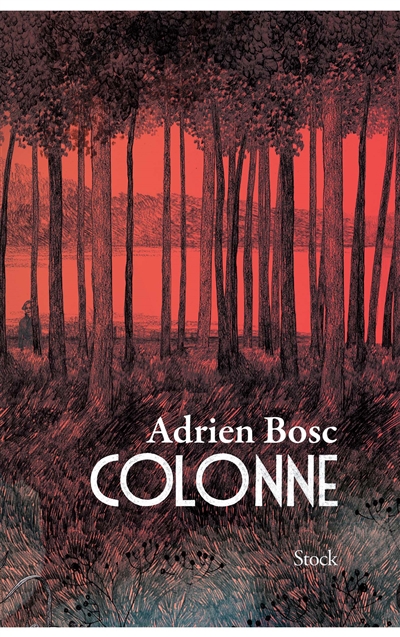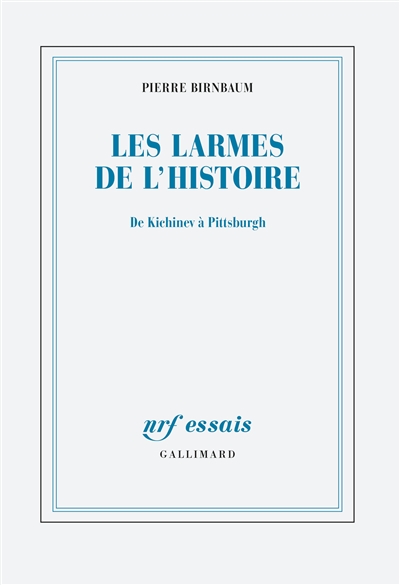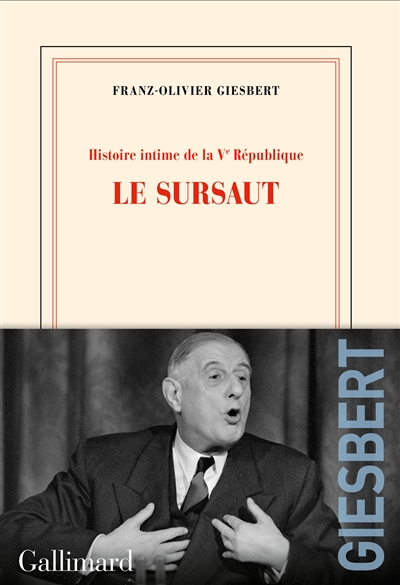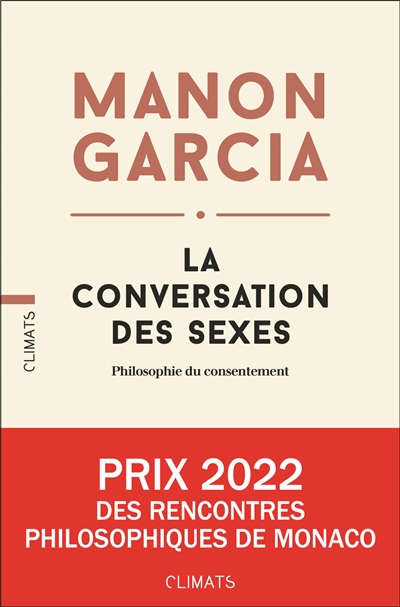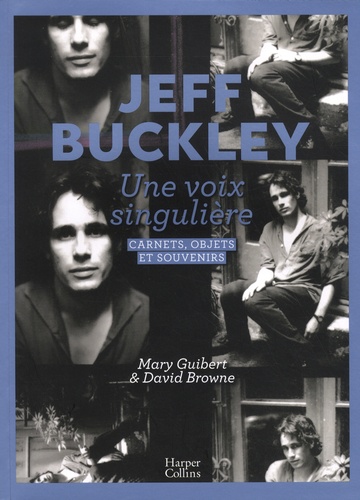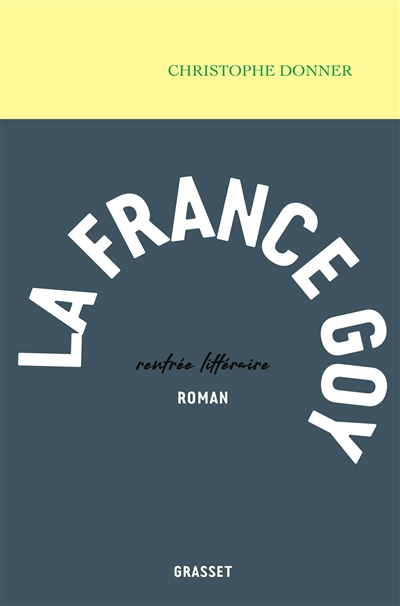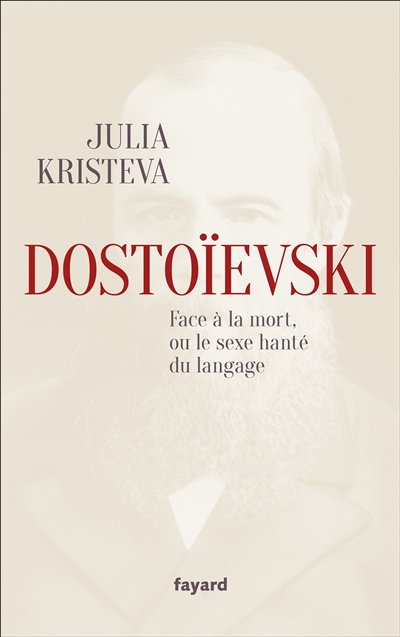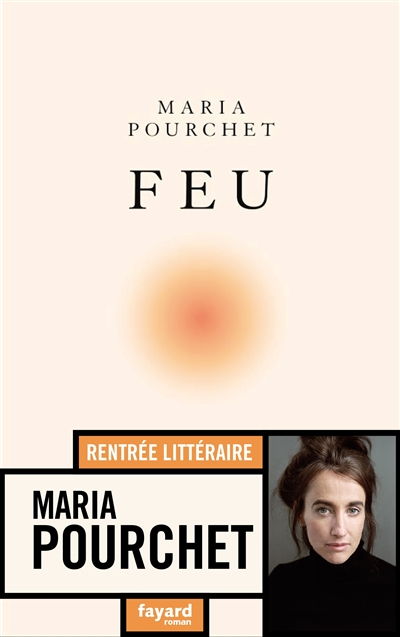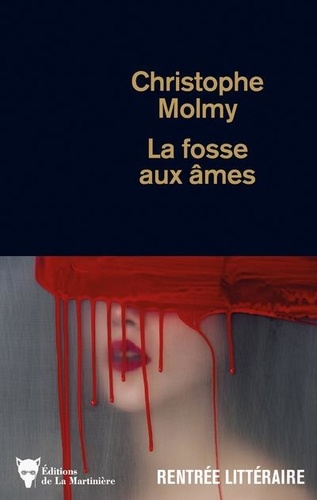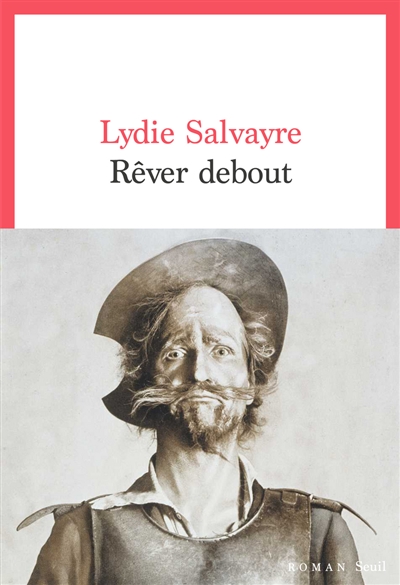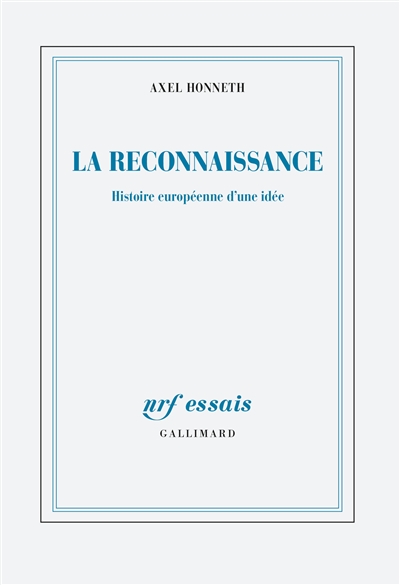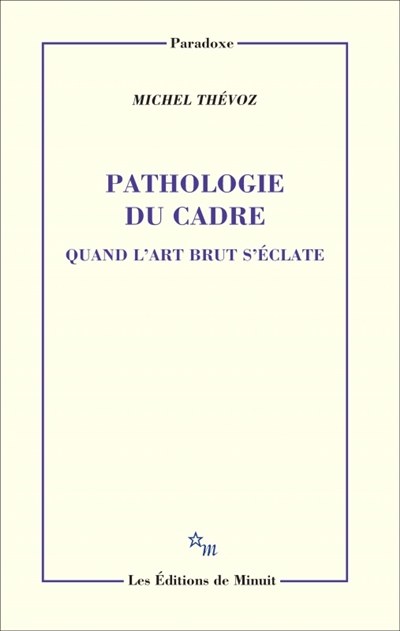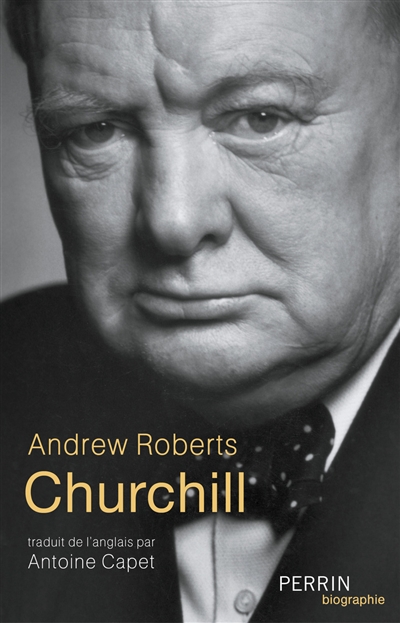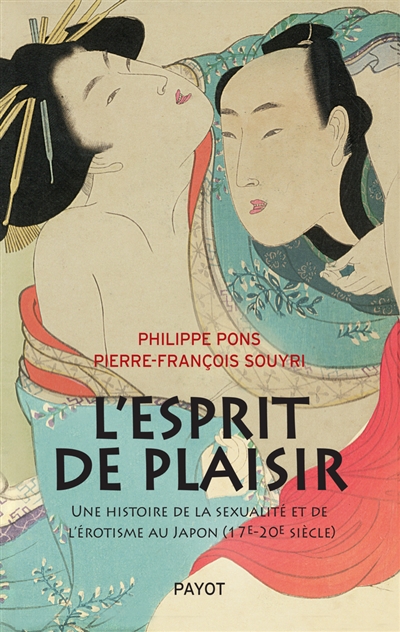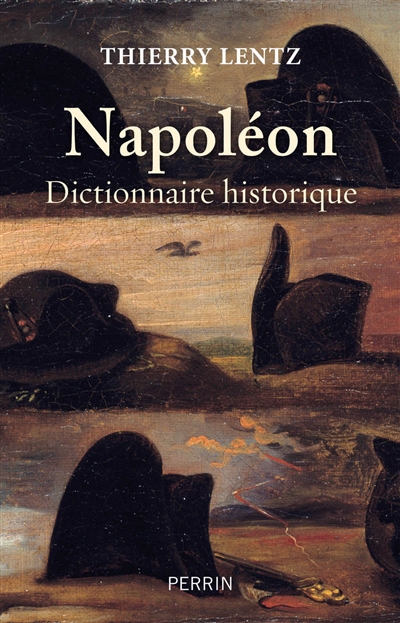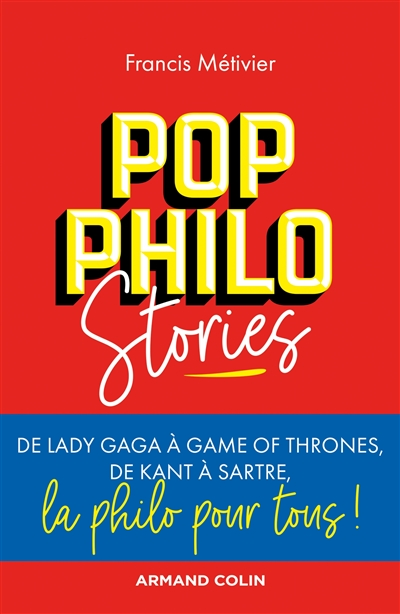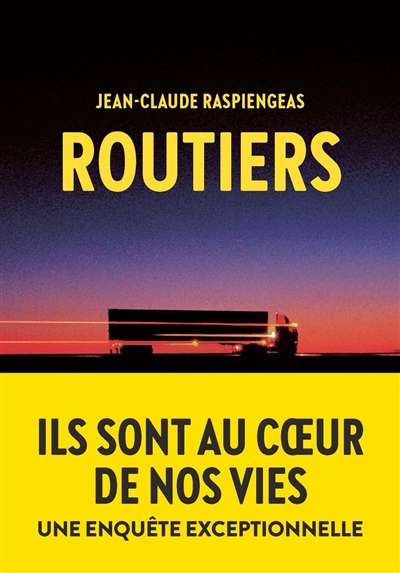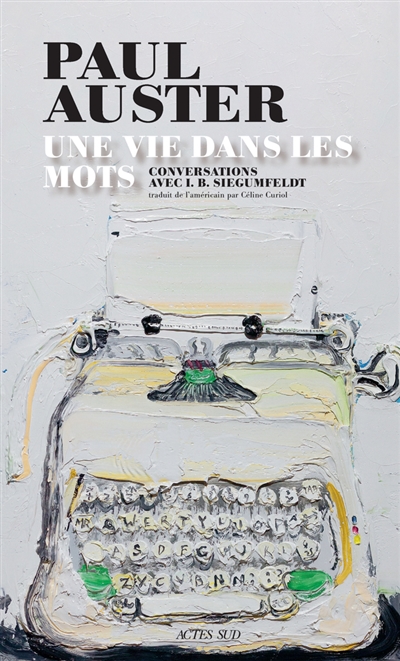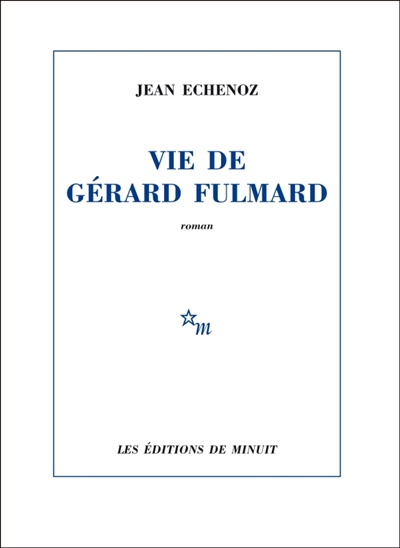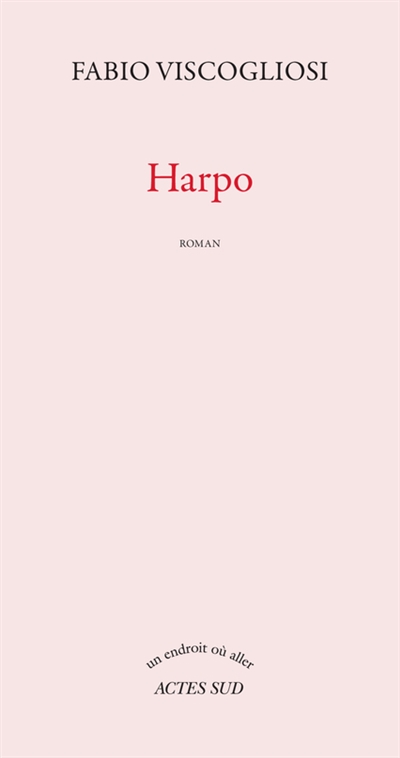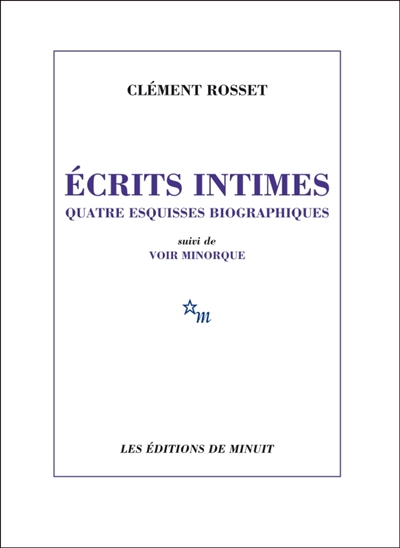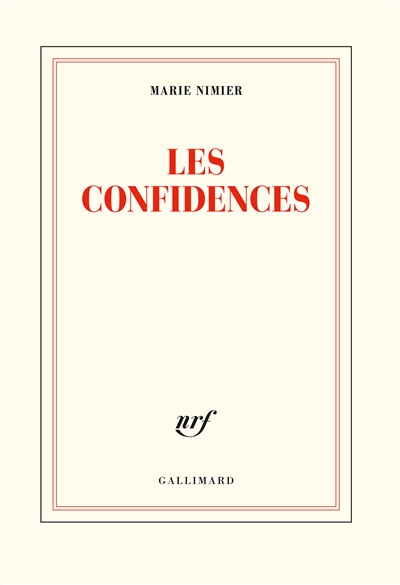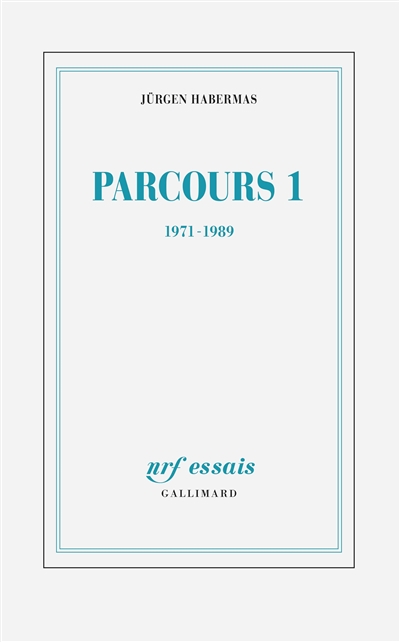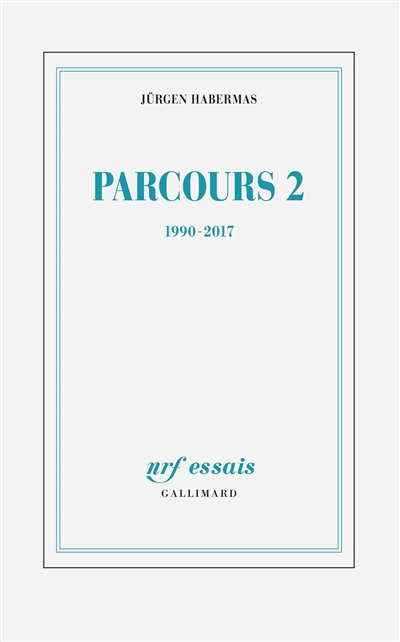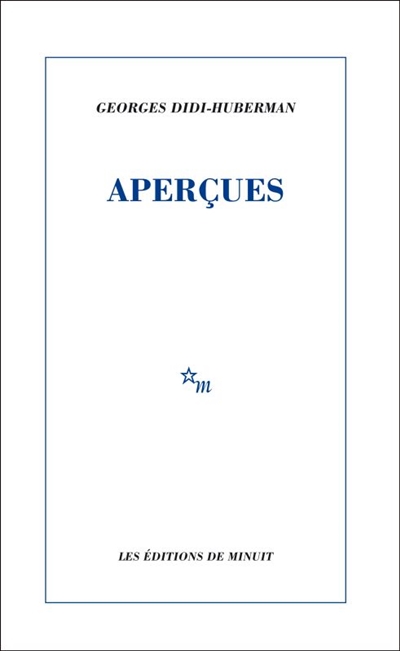Sciences humaines
Giulia Fabbiano , Camille Faucourt
Revenir

-
Giulia Fabbiano , Camille Faucourt
Revenir
Anamosa
17/10/2024
144 pages, 28 €
-
Chronique de
Lyonel Sasso
-
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Juliet Romeo de La Madeleine (Lyon)
- Charles-Henri Bradier de L'Écritoire (Semur-en-Auxois)

✒ Lyonel Sasso
( , )
L’exil et l’impossible retour sur une terre ne cessent de questionner la mémoire. Un vieux débat qui renaît de ses cendres à chaque guerre déclarée. Les livres ici présentés interrogent, de manière différente, notre rapport au mémoriel. Comment envisager sa vie sans croire au destin ? L’exil est-il une éternelle tragédie ? Et qu’en disent nos morts ? On saura tout à la lecture de ces ouvrages.
Bouleversante ritournelle, celle qui contraint une personne à raconter la vie de ce parent qui ne reverra jamais sa terre natale. C’est un récit qui s’offre toujours avec cette passion forgée aux tisons et aux quelques grâces de la nostalgie. Dirigé par Giulia Fabbiano et Camille Faucourt, Revenir, Expériences du retour en Méditerranée se compose comme un discours d’un fragment de l’exil. Bassin bouillonnant d’histoires de non-retour et ce depuis Homère, la Méditerranée se révèle bien être ce lieu de frontières fatales. Les enquêtes-collectes qui parsèment l’ouvrage sont autant d’archipels qu’il nous faut parcourir. Il y a la parole des exilés, des victimes et des revenants mais aussi leurs objets, leurs photos ou leurs lettres. On y voit une clef à l’épaisse rouille, comme autant d’années passées loin du pays. Sabyl Ghoussoub signe un superbe texte sur sa mère et la terre maternelle ‒ c’est un rocher en l’occurrence. Dans « L’Impensé du retour », Dunia Al Dahan et Adélaïde Chevée dressent le portrait saisissant d’artistes syriens résolus à vivre et à créer l’impensable. Résistances, prolongement de la vie dans les lieux les plus hostiles : la dignité n’aura donc jamais de prix. Les témoignages impressionnent de tragédies et de sagesses aussi. Le prolongement des gestes, des cultes et des mémoires ne cesse de traverser tous les documents mis à disposition. On y voit bien que le Liban crépite et que la Syrie répand ses pleurs dans la mer Méditerranée. Et ce, sans limite. N’oublions pas alors que chaque noyé emporte avec lui une terre, une histoire et un visage que nous ne reverrons jamais. Exposition jusqu'au 16 mars 2025 au Mucem à Marseille et livre ‒ au passage, encore un superbe objet composé par les éditions Anamosa ‒, Revenir est une belle présence, à consulter encore et encore. On aura, le même désir, celui de revenir à lecture du superbe livre de Marwan Chahine. Avec Beyrouth, 13 avril 1975, l’auteur vient à bout d’un travail harassant d’une décennie. Chahine a ainsi développé un sens de la minutie proche d’un Philippe Jaenada. Car il faut bien une certaine ténacité pour lutter contre cette forme d’amnésie structurelle qui scinde le pays en une myriade de parties différentes. Le Liban se déleste d’une mémoire des faits et multiplie les interprétations et théories divergentes. C’est l’enjeu du livre de Chahine et c’est ce qui fait de lui un excellent journaliste. Tenir un fait, le transmettre le plus humblement possible, voilà pour l’adage. Il y a, aussi, une verve et un humour chez l’auteur, notamment, dans cet aphorisme : « Il n’y a pas de mémoire de la guerre au Liban, mais une guerre des mémoires. » Chahine revient sur l’origine de la tragédie libanaise, ce bus de fédayins palestiniens recevant ces terribles premières balles qui marqueront le début, de ce que l’auteur appellera, l’autopsie d’une étincelle. L’étincelle annonçant le brasier à venir. Roman picaresque, louvoyant entre l’autobiographie et le vagabondage, le Beyrouth de Chahine se déclare polymorphe. On mesure que la multiplication des voix et des amours pour cette terre crée le fossé. Mais aussi la fosse commune et l’horreur de la guerre civile. Chahine diversifie les documents, les témoignages et signe de superbes pages sur ce sentiment d’exil, de déraciné. C’est que les racines du Cèdre sont profondes et l’emblème national est mis à rude épreuve. L’écorce prend feu. L’eau manque pour calmer l’incendie. Le style et le talent de Chahine sont, déjà, les premiers assauts de la résistance. Il lutte contre la fatalité, évitant la grande hache de l’Histoire. Cette question d’une fatalité quasi racinienne, Marianne Chaillan l’éprouve tout au long de son savoureux Écrire sa vie. Elle part d’une photo de classe ‒ celle de son père, enfant ‒ et imagine les vies de chacun des protagonistes. Comme à son habitude, Marianne Chaillan se montre volontiers pédagogue. Elle puise dans la pop culture de quoi expliquer simplement des concepts philosophiques parfois ardus. Elle nous propose, suivant l’exemple de son mentor Vladimir Jankélévitch, ce je-ne-sais-quoi de léger et grave à la fois. On y trouvera point d’injonction au bonheur ni de méthode issue du développement personnel. Sans doute, cueillera-t-on, une éthique telle que la concevait Baruch Spinoza. L’écriture des faits, comme la romancière Annie Ernaux la conçoit, tient de valeur d’exemple. Alors comment vivre sa vie et lutter contre tous types de déterminisme ? Marianne Chaillan prend les belles pages de Simone de Beauvoir afin d’éviter les écueils et la lourdeur théorique. Dans certains de ses propres souvenirs, l’autrice devient magnifiquement proustienne et décortique les volutes du temps avec style et humour. Il faut être sacrément drôle pour ne pas trop prendre au tragique l’éphémère de la vie. « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard », annonçait Aragon. Pas engageant cette histoire mais Marianne Chaillan déborde de ressources et propose un texte vivifiant où l’on saisit que notre propre recherche de liberté se fait dans le commun, dans le même sillon que les autres. Cette idée de bien commun, certaines funérailles y ont répondu. Grandement, fastueusement. D’autres, au contraire, n’auront fait que confirmer, la vacuité des existences. Dans Pompes funèbres, Michel Winock questionne la mémoire d’une nation. C’est un texte brillant de mémorialiste où l’on croise une galerie incroyable de personnages. Bien sûr, il y a le cas Hugo. Ce pays tout entier endeuillé, célébrant sa propre âme. C’est vertigineux. Mais il y aussi les affreuses contingences et le trafic autour de la dépouille du grand Jules Michelet. C’est que ces cérémonies racontent beaucoup du pouls d’un pays. Parfois, de manière surprenante d’ailleurs. Un homme politique détesté comme Adolphe Thiers fera écrire à un Flaubert les lignes suivantes : « J’ai vu les funérailles du père Thiers! Et je vous assure que c’était sublime ! » Sa correspondante, Edma de Genettes, en fut la première surprise. Il y a encore les morceaux de Gambetta, ce corps politique dépecé par une autopsie à la hussarde. On notera les belles évocations de Louise Colet et George Sand, les deux reins solides de la scène littéraire du XlXe siècle. Michel Winock dresse un portrait contrasté de Charles Péguy, ailleurs brille sa fascination pour un Louis Rossel. C’est écrit remarquablement.