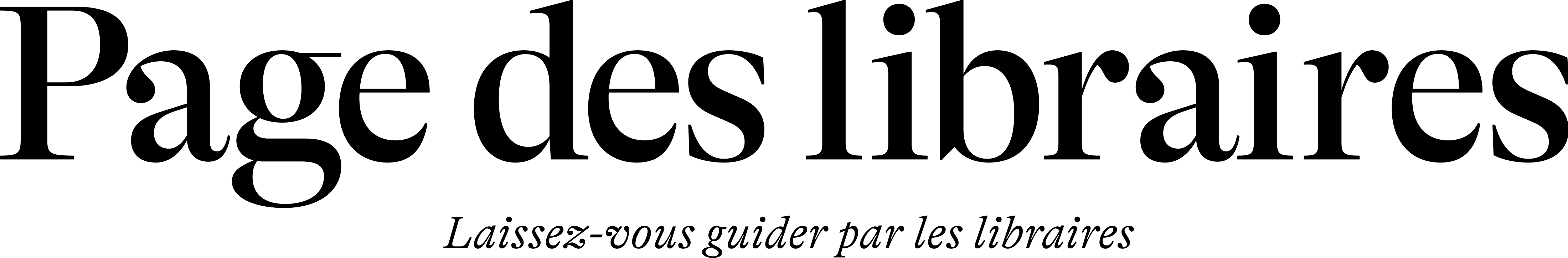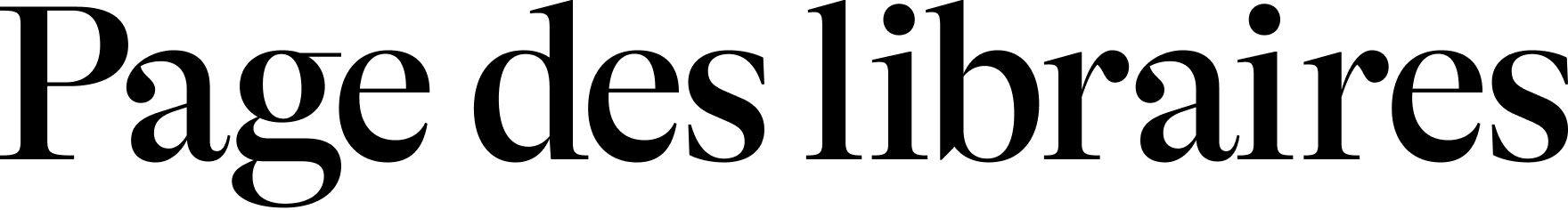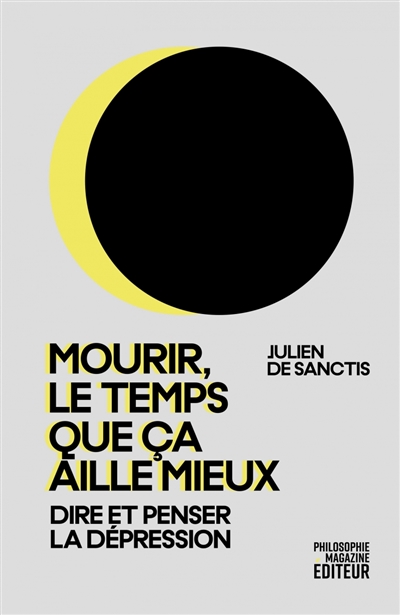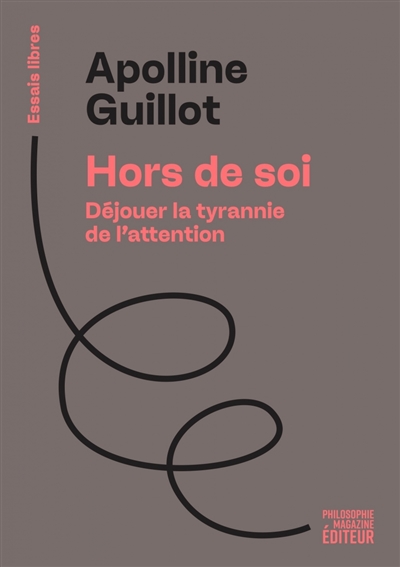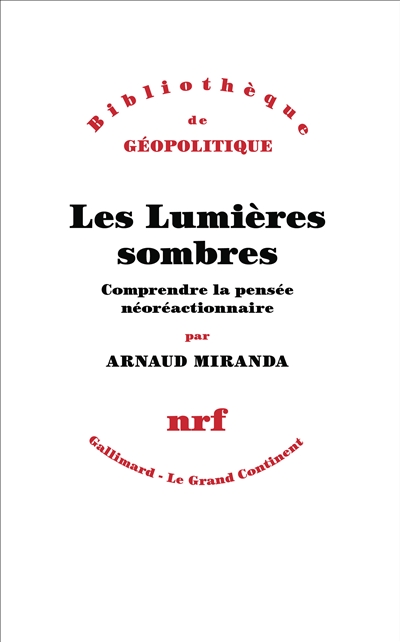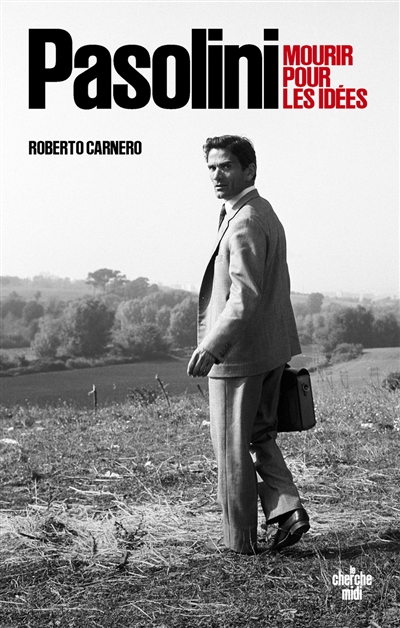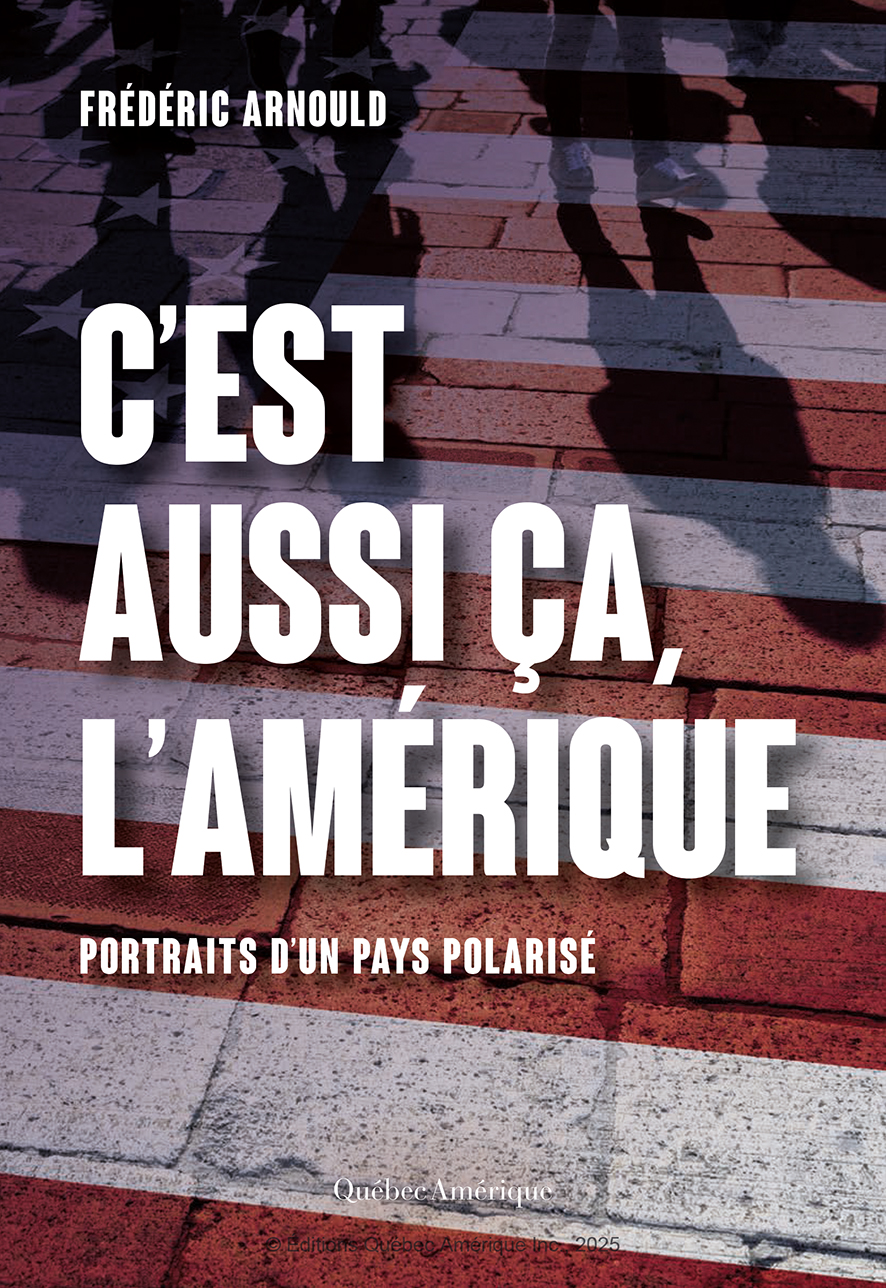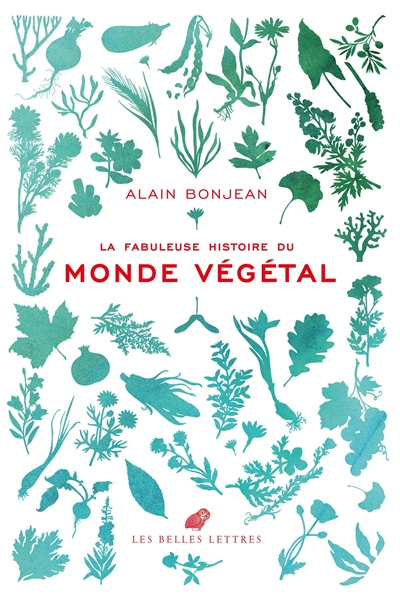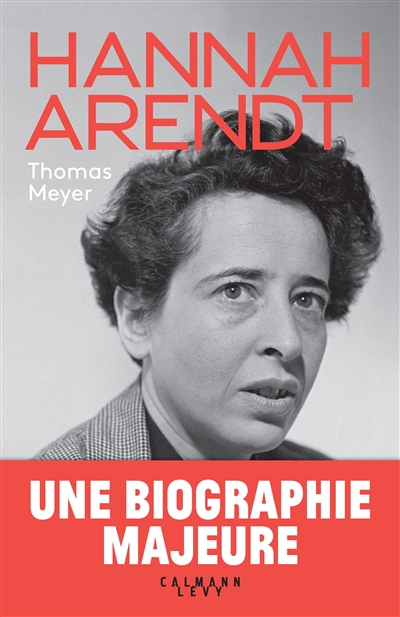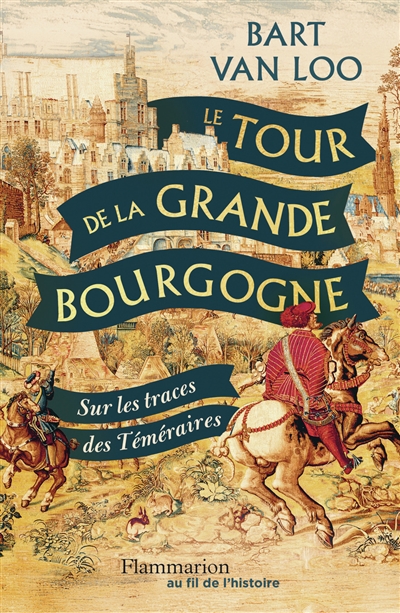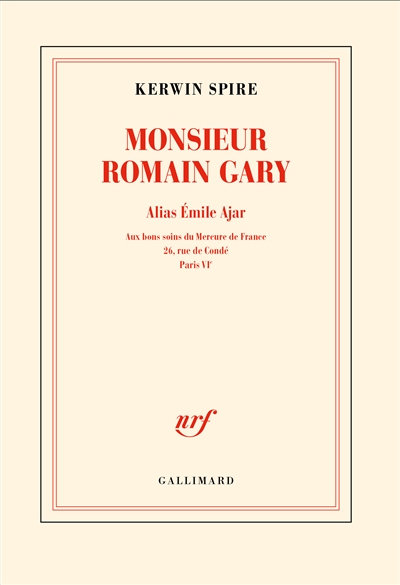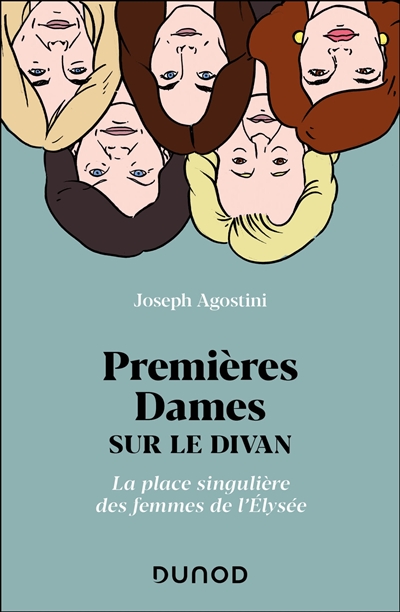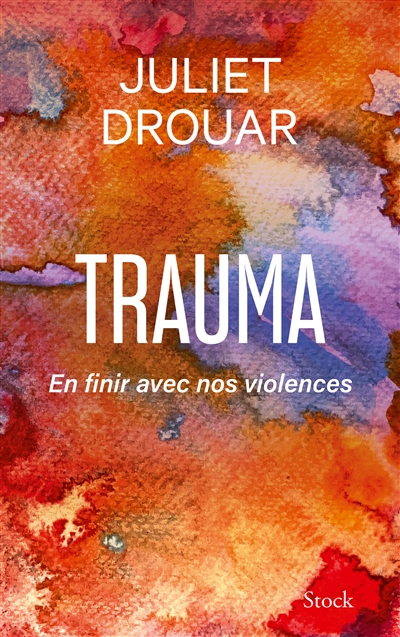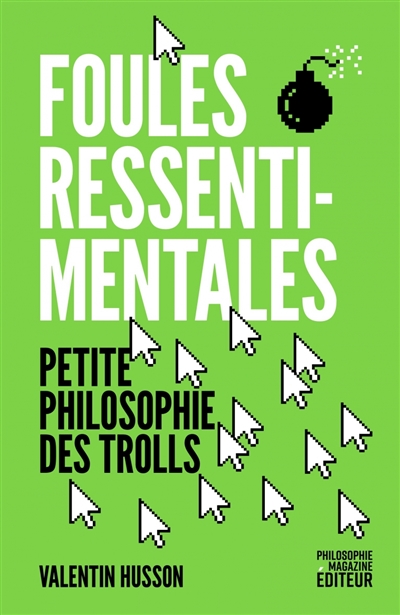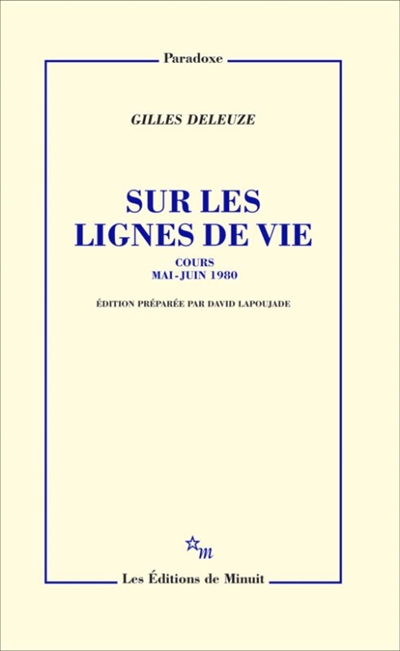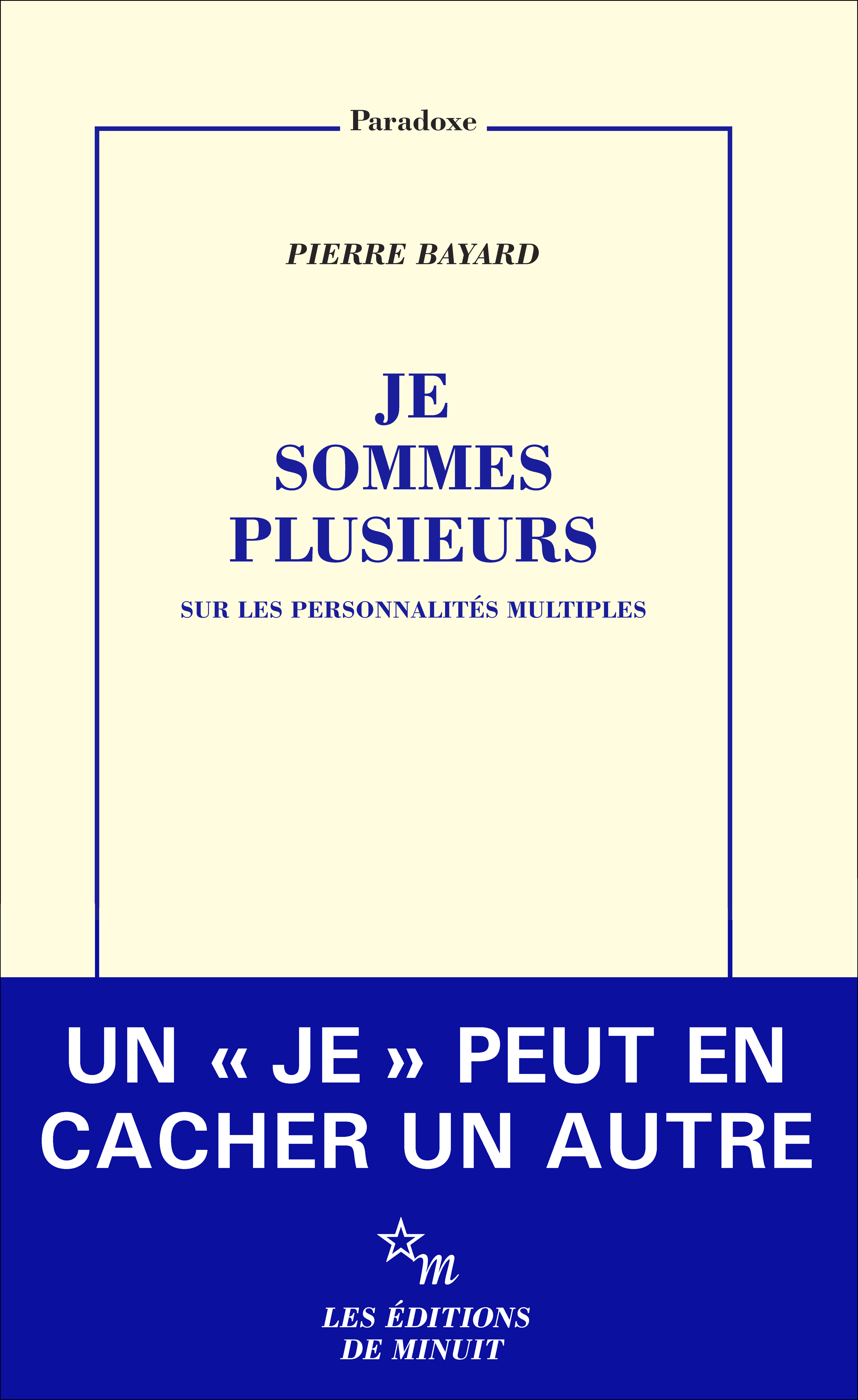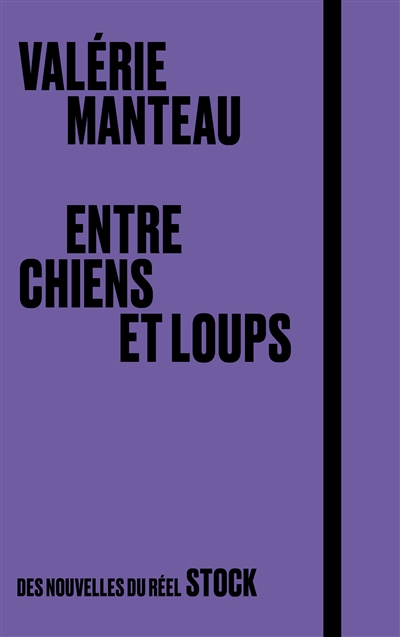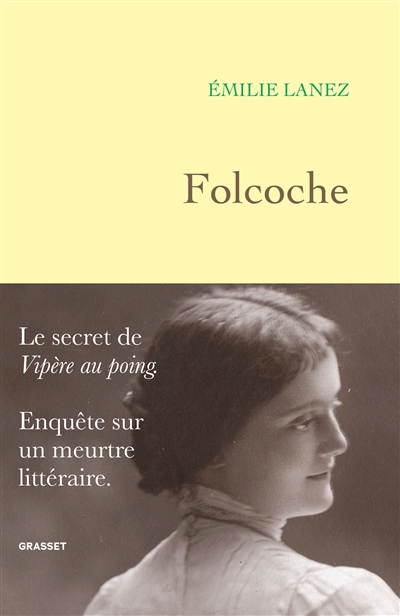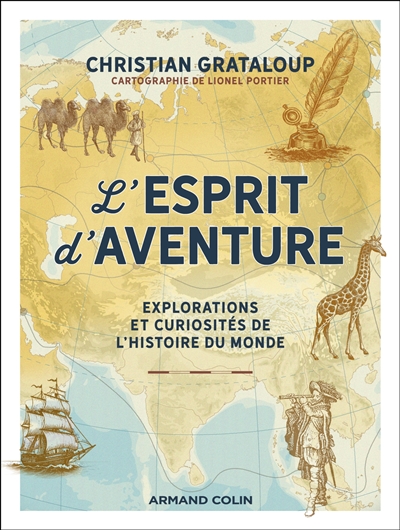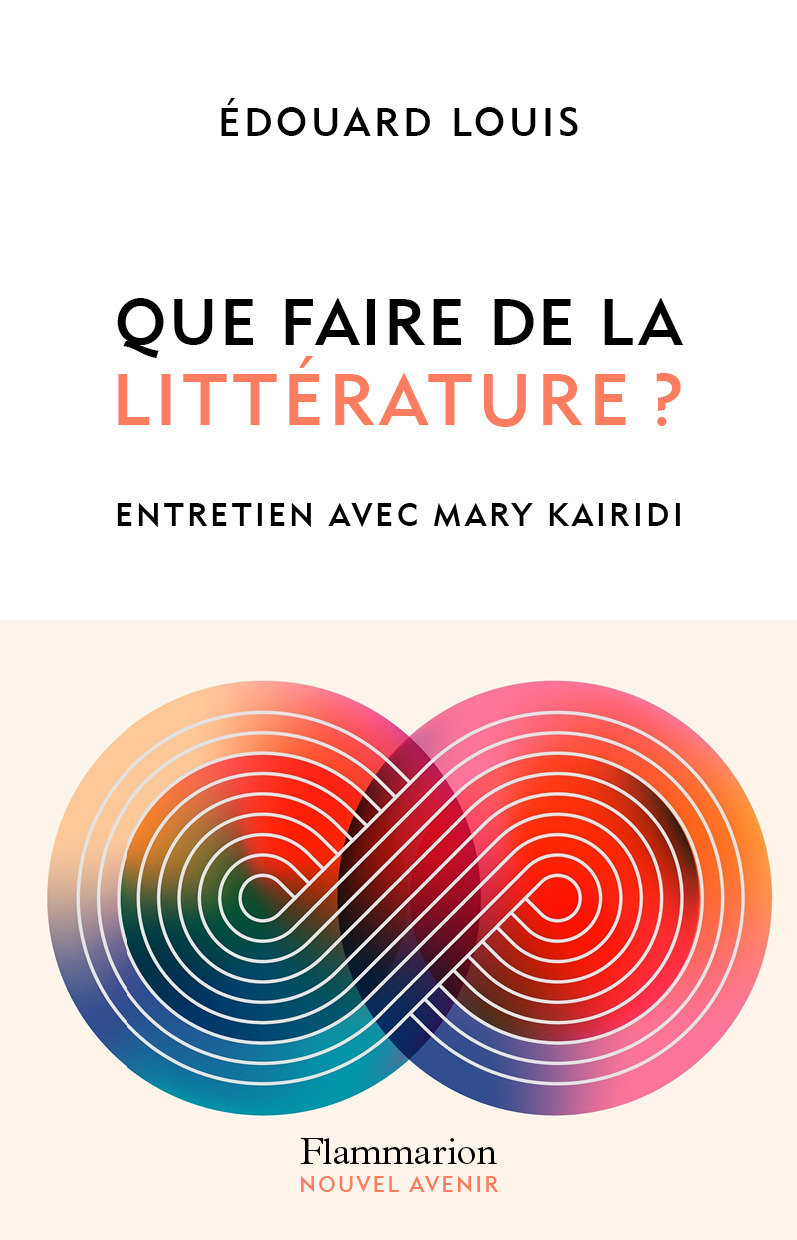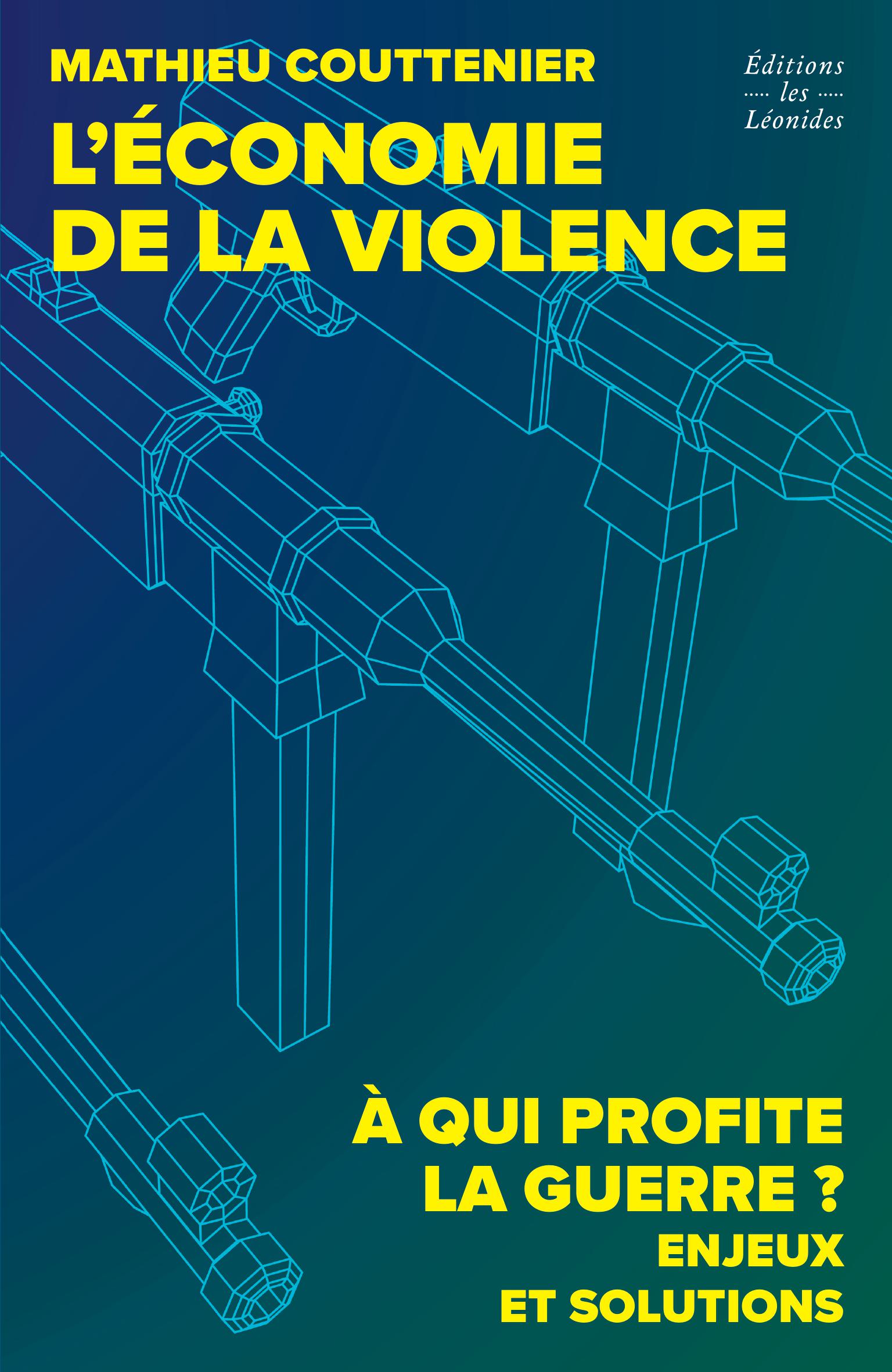Julien De Sanctis éclaire son intérieur nuit pour illuminer nos jours. Il nous offre un essai lucide et accessible sur la dépression, en convoquant ses propres expériences et les grands textes de la philosophie.
Commençons par le début et votre titre.
Julien De Sanctis – C’est une fulgurance qui m’est venue alors que je cherchais le titre d’un petit article. Elle donna naissance au livre. Ce titre ne définit pas tant la dépression que l’aspiration impossible qu’elle avait fait naître en moi : cesser d’exister temporairement. Une idée aussi absurde que l’intensité du mal que j’éprouvais. Ce titre est aussi une allusion au seuil sur lequel je me tenais. Lorsque la souffrance donne à la mort une dimension désirable, c’est que vous n’avez pas totalement cessé d’aimer la vie, votre vie. Ce fragment vital peut faire toute la différence et aider à supporter l’insupportable. Je ne peux m’empêcher de transcrire ce point métaphysique en question sociale : sommes-nous égaux face à cet attachement et face à l’irréversibilité d’un geste comme le suicide ?
L’idée de vous saisir de votre expérience, pour parler de cette maladie, s’est-elle tout de suite imposée à vous ?
J. De S. – Au moment de ma guérison, je n’ai pas le souvenir de m’être beaucoup interrogé sur ce que j’avais vécu pendant la phase critique de la dépression. Il était probablement trop tôt pour le faire et il me fallait rapidement revenir à mon travail de thèse pour ne pas accumuler trop de retard. Ce n’est que deux ans plus tard, en découvrant la phénoménologie du vivre de Levinas, qu’une idée m’est venue : l’expérience de la dépression m’est apparue comme l’exacte inverse de ce que dit Levinas sur le vivre et sa transitivité. Si vivre, c’est toujours vivre de quelque chose, « de « bonne soupe », d’air, de lumière, de spectacles, de travail, d’idées, de sommeil » dit le philosophe, être en dépression, c’est vivre de rien, c’est vivre tout court. Plus rien ne nous nourrit. Le projet d’écriture a donc vu le jour sous l’angle du témoignage et de l’analyse incarnée à la première personne.
Vous vous appuyez en partie sur la notion de désir, dans la philosophie de Baruch Spinoza, pour saisir un aspect fondamental dans la dépression : l’absence de désir.
J. De S. – Oui, la disparition du désir est pour moi le symptôme cardinal de la dépression. Il constitue en quelque sorte le cœur du phénomène dépressif. Chez Spinoza, le désir désigne l’élan, c’est-à-dire « le passage d’une moindre à une plus grande perfection ». Désirer, c’est persévérer dans l’être à travers notre capacité d’agir. Le désir est motivation au sens étymologique du terme : il met en mouvement et il engendre notre devenir. Être privé de désir revient donc à perdre la dimension du devenir. L’anépithumie – la disparition du désir –nous fait être au sens le plus monolithique du terme : elle est comme un regard de Gorgone qui fige notre individuation. En ce sens, la dépression est une maladie de la liberté puisqu’elle conspire à l’anéantissement de nos possibilités d’être.
Nous sommes souvent nos propres bourreaux durant un épisode dépressif. La philosophie vous a-t-elle enseigné à être plus doux avec vous-même ?
J. De S. – Mon rapport à la philosophie a longtemps constitué une partie du problème, l’ayant tant sacralisée ! J’ai toujours douté de mes capacités à être un « bon » philosophe. Ce n’est donc pas la philo qui m’a aidé à faire preuve d’une plus grande douceur envers moi-même mais le nouveau rapport que j’essaie d’entretenir avec elle. L’écriture du livre et son assomption m’y ont beaucoup aidé. C’est un ouvrage hybride. Il emprunte à certains codes académiques sans être universitaire pour autant. Il a une vocation grand public assumée sans rompre avec l’exigence nécessaire à certaines analyses. Malgré toutes ses imperfections, je suis satisfait du résultat, ce qui n’est pas une petite victoire. Depuis mon adolescence, j’ai l’idée qu’il me faudrait écrire au moins un livre dans ma vie pour me sentir accompli ‒ une croyance naïve ! Cette première expérience d’auteur m’a surtout permis de travailler en profondeur la confiance et l’estime de moi-même. À cet égard, je ne remercierai jamais assez mon éditrice, Julie Davidoux, de m’avoir proposé la rédaction de ce livre. Je pense que la douceur envers soi-même émerge du soin dont nous faisons preuve à l’égard de nos valeurs car elles nous façonnent. Un simple exemple : lorsque la dépression s’est dissipée, je suis devenu végétarien. Avant cela, mes idées en matière d’éthique animale et d’écologie n’étaient pas mises en pratique. Il s’agissait d’idées et non de vertus puisqu’elles restaient abstraites. La dépression m’a donc permis d’être plus en accord avec moi-même, à une plus grande « présence à soi » comme dit le philosophe Michel Terestchenko. Si je suis plus doux envers moi-même aujourd’hui, c’est parce que je m’attelle quotidiennement à cet exercice de relativisation de certaines normes au profit de ce qui compte réellement pour moi.
Longtemps espéré, le voyage au Japon effectué par Julien De Sanctis ne se déroulera pas comme prévu. Il sera le déclencheur d’un épisode dépressif majeur. On pense, d’ailleurs, au Poisson-scorpion, cet autre grand livre sur la dépression écrit par Nicolas Bouvier. Plutôt qu’un quatuor de Debussy, qui sauva la santé mentale de Bouvier, Julien de Sanctis se tourne vers la philosophie. L’objectif est de traverser la terre aride et sans envies de la phase dépressive et de retrouver le chemin de la joie comme le propose le philosophe Baruch Spinoza, l’une des grandes boussoles de ce livre. Il s’agit donc de questionner ce territoire insaisissable qu’est la dépression.