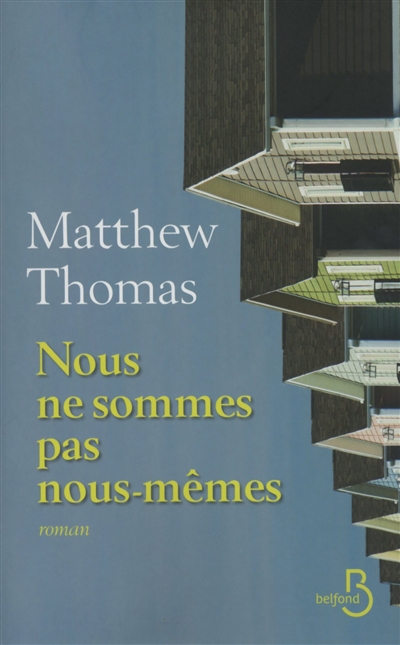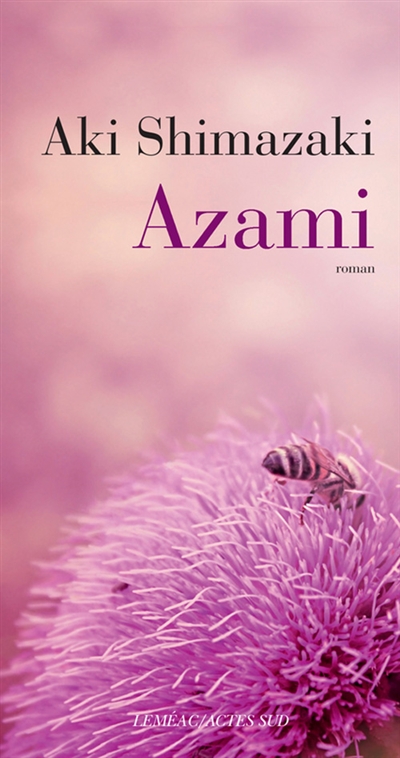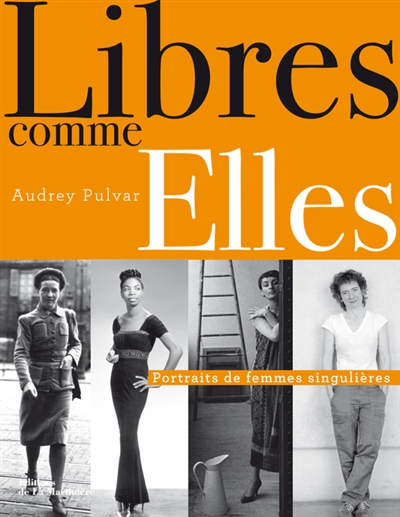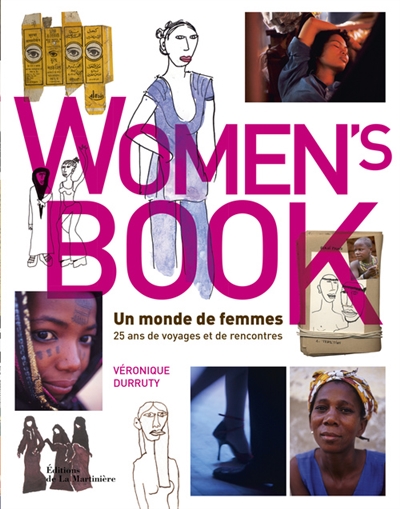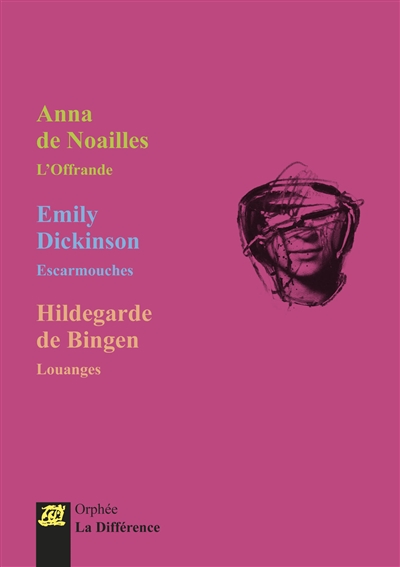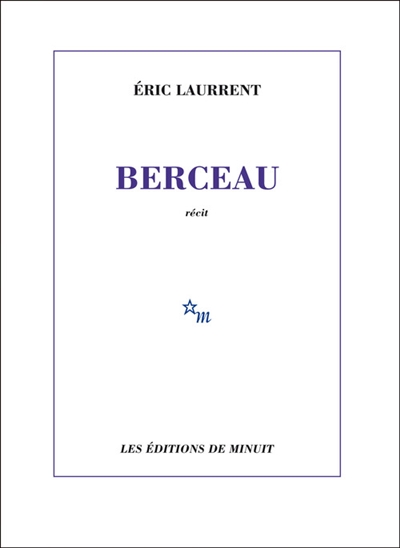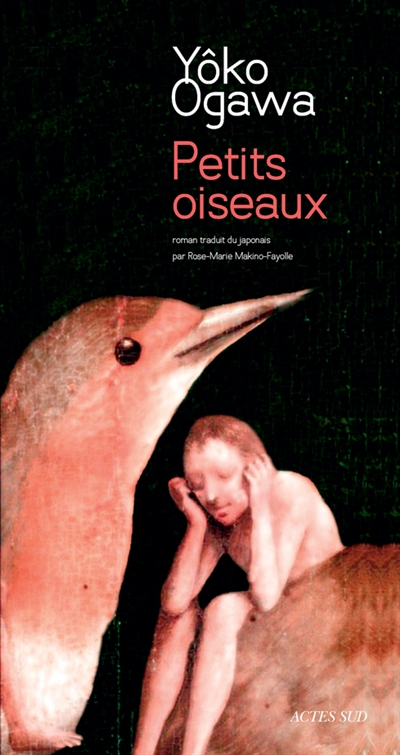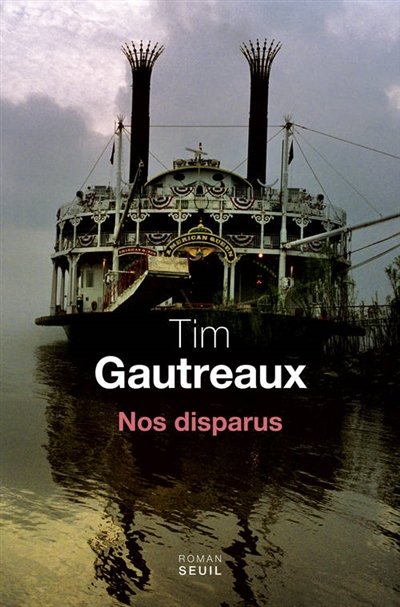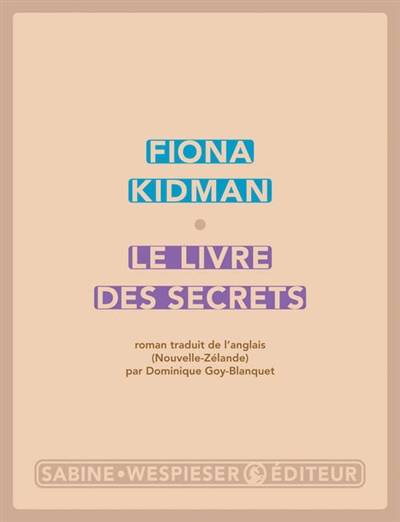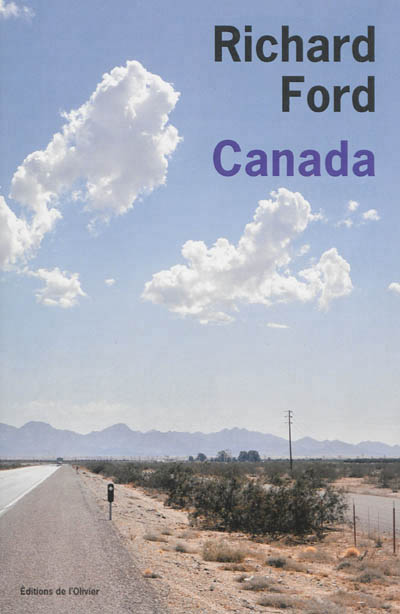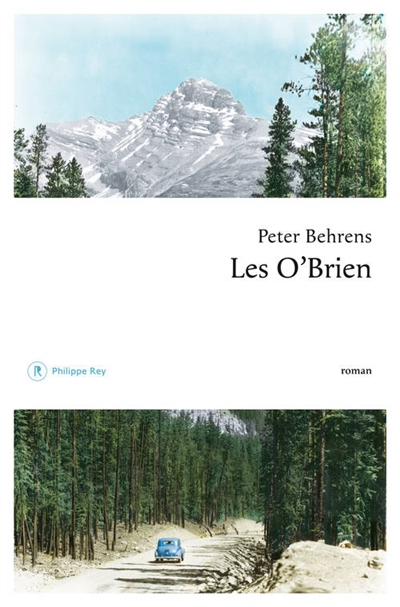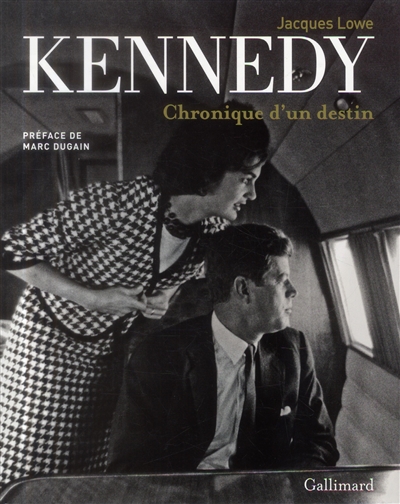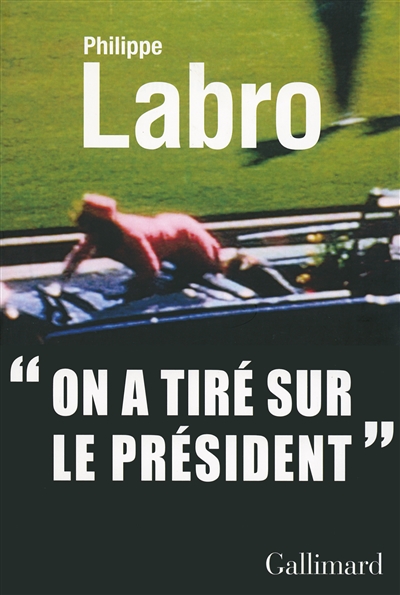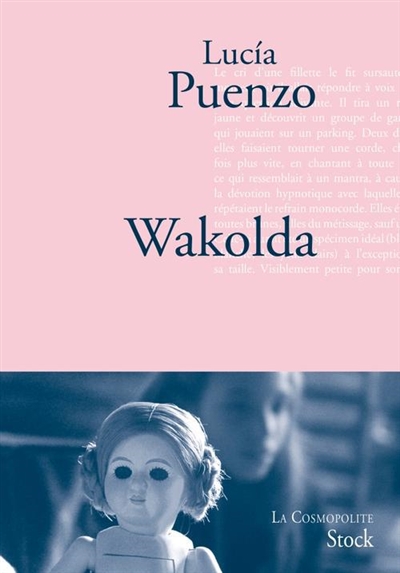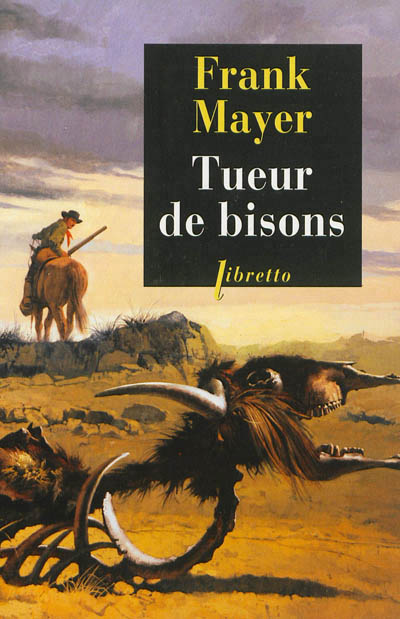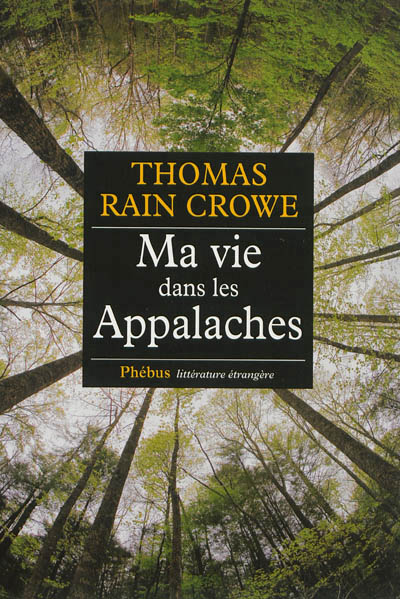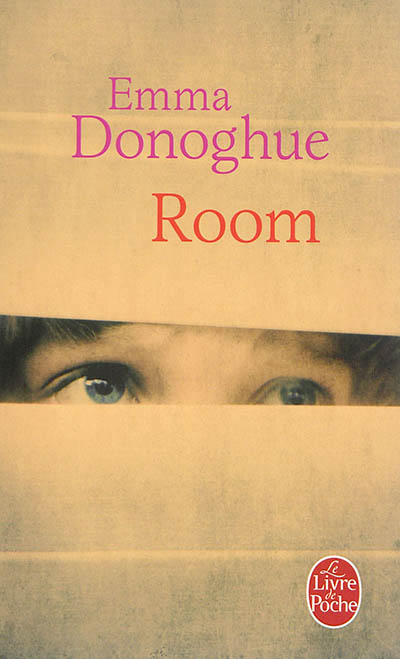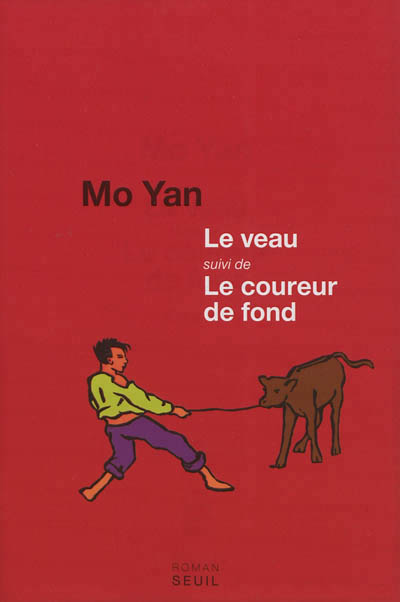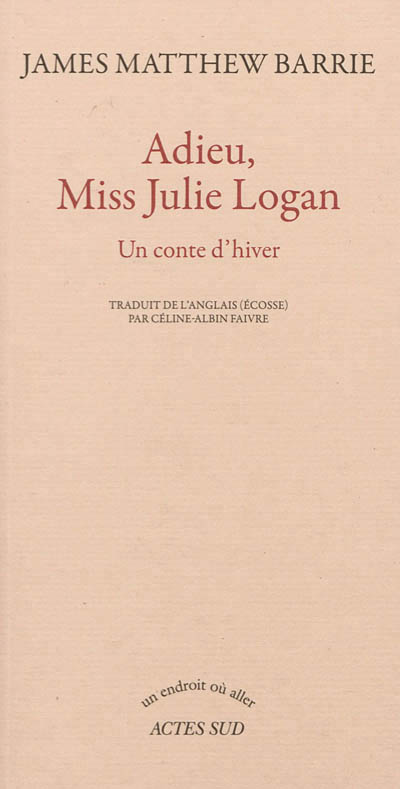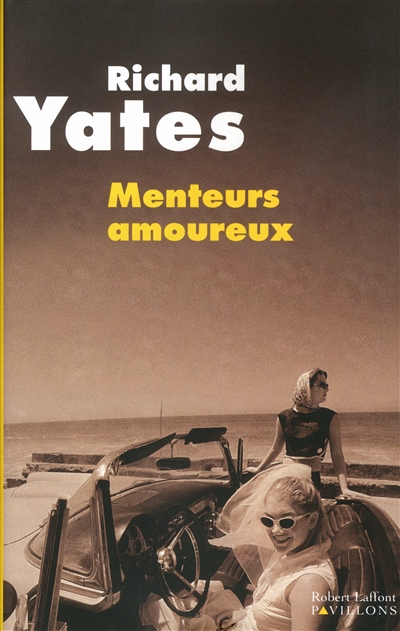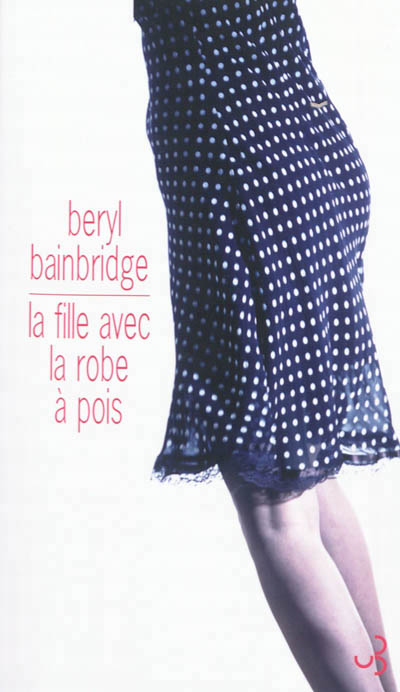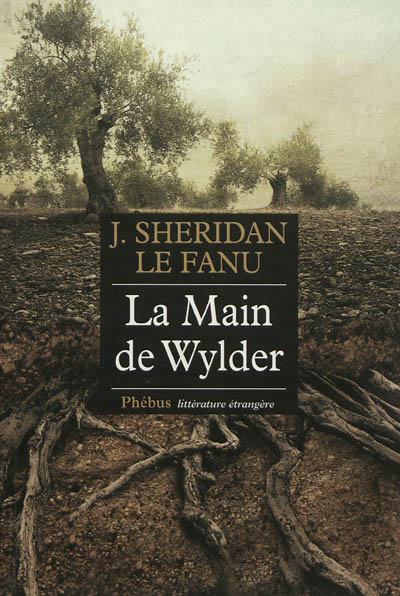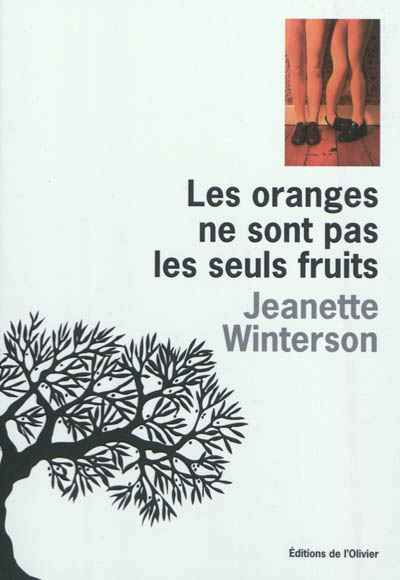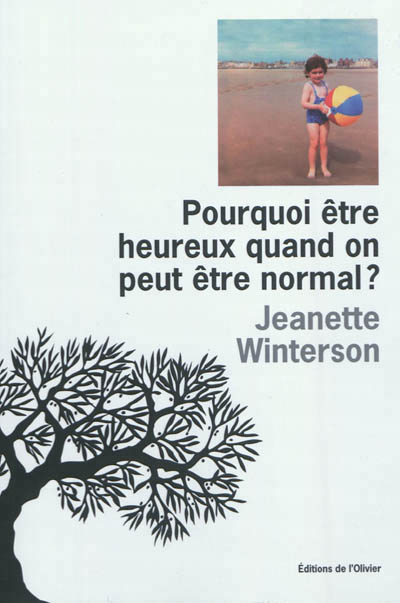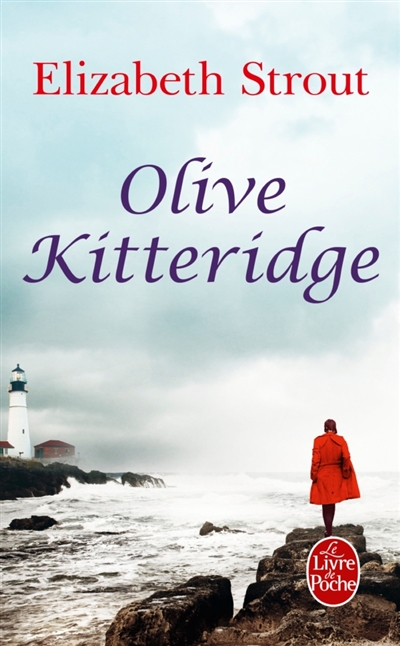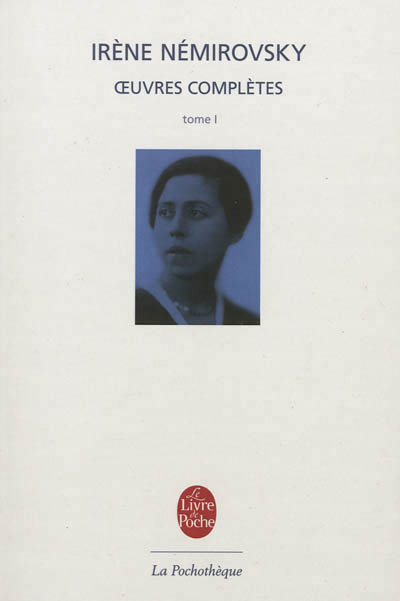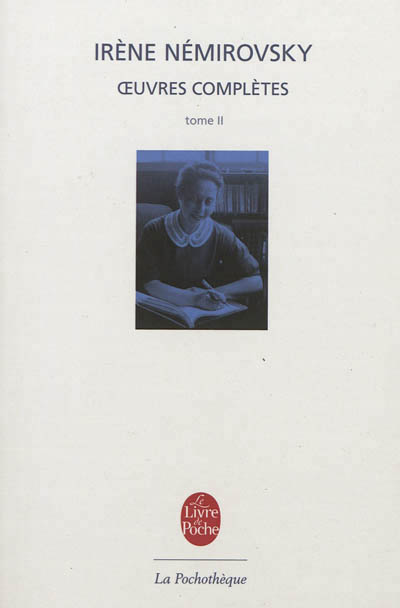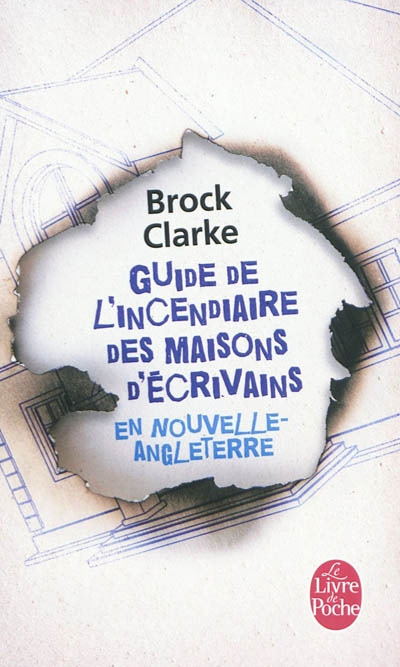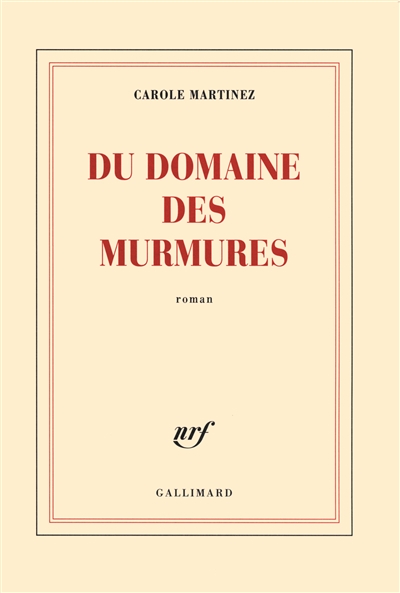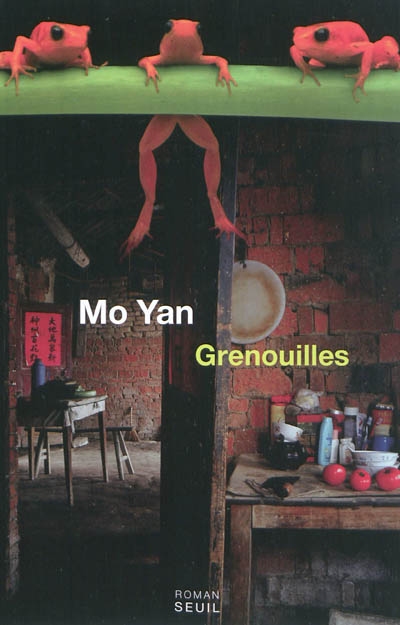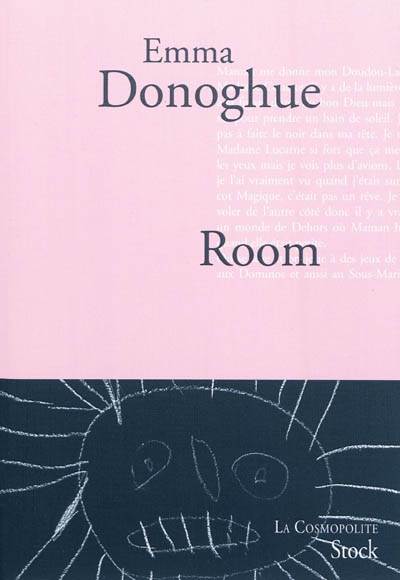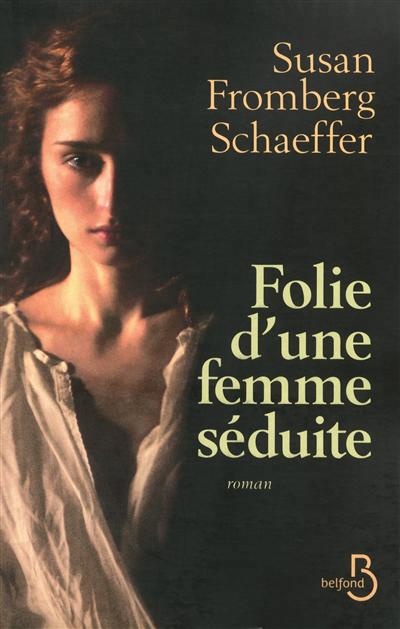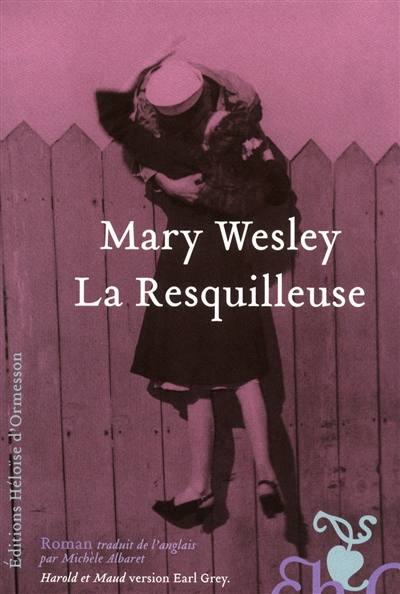Littérature étrangère
Arno Geiger
Le Vieux Roi en son exil
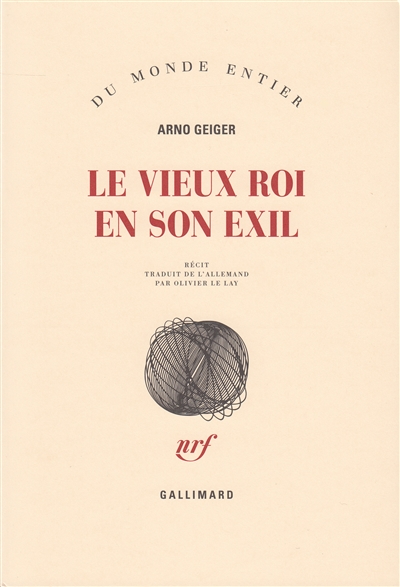
-
Arno Geiger
Le Vieux Roi en son exil
Traduit de l’allemand par Olivier Le Lay
Gallimard
18/10/2012
192 pages, 17,50 €
-
Chronique de
Sandrine Maliver-Perrin
-
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Yann Granjon de Sauramps Comédie (Montpellier)
- Guillaume Le Douarin
✒ Sandrine Maliver-Perrin
( , )
« Je ne voulais pas écrire sur lui après sa mort, je voulais écrire sur une personne vivante, je trouvais que mon père, comme tout être humain, méritait un destin qui reste ouvert ». Ainsi Arno Geiger parle-t-il de son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, dans ce récit sensible et profond, hommage d’un fils et d’un écrivain à son père disparu.
Que penser lorsque votre père vieillissant, quitté par sa femme après trente années de mariage, se met à agir de manière étrange ? Comment réagir, sinon en mettant ses bizarreries sur le compte de l’âge ? Comme nombre d’entre nous confrontés à la vieillesse de leurs proches, le romancier autrichien Arno Geiger et sa famille ont d’abord cru que les tocades de leur père n’étaient que les effets de la retraite et de l’oisiveté, sur le caractère déjà difficile du vieil homme. Des mois durant, l’aveuglement et le déni de l’entourage ont donc côtoyé la solitude et le désarroi du père, terrifié par les difficultés croissantes qu’il rencontrait au quotidien. Un jour pourtant, le diagnostic est tombé : il s’agit de la maladie d’Alzheimer, non des caprices d’un vieil homme. Étrangement, ou paradoxalement devrais-je dire, la maladie va rapprocher le père et le fils. L’oubli fait en quelque sorte œuvre de seconde chance dans la relation entre les deux hommes, créant une sphère intime où les conflits sont apaisés. Tandis que la mémoire du père se délite jusqu’à tout oublier, le fils, de son côté, oublie leurs mésententes passées. Il redécouvre son père dans cet être nouveau, à la fois si loin et si proche, qui, au fil du temps, apparaît presque comme un inconnu. Et si ce dernier ne retient plus rien, qu’à cela ne tienne : l’auteur, lui, s’emploiera à tout mettre par écrit. Pour ne rien oublier. Le père devient alors un matériau littéraire, une source d’inspiration, et la littérature un refuge. Kafka, Ovide, Proust et Thomas Bernhard cheminent aux côtés du père et du fils. Serait-ce la façon la moins douloureuse de parvenir à la compréhension et à l’acceptation ? Le récit est habilement construit autour de discussions entre le père et le fils, dialogues courts et percutants, à la fois drôles, tendres et émouvantes, qui précèdent chaque chapitre. Les déclarations du vieil homme, parfois d’une extrême lucidité, laissent entrevoir une vraie personnalité, survivant au-delà de la perte de mémoire et de la folie. « Mon père avait oublié tout cela, et cela ne le faisait plus souffrir. Il avait comme gravé ses souvenirs dans son caractère, et le caractère était resté. Les expériences qui l’avaient façonné continuaient de faire leurs effets ». Puisque rien ne saurait arrêter la progression de la maladie et l’effacement de la mémoire, il faut mettre en place un nouvel environnement, une nouvelle vie autour du père. S’efforcer de tisser des fils et de tracer de nouveaux chemins vers sa réalité. Faire preuve de patience, d’imagination et de tendresse pour apaiser ses inquiétudes. Il faut construire un pont jusqu’au vieil homme, jeter un pont entre deux rives : la démence et le souvenir, le passé et le présent… Car le père erre désormais en terres inconnues dans un quotidien sans mémoire, sans souvenirs et sans repères, apatride « comme un vieux roi en son exil », incapable de retrouver ce chez-soi à jamais perdu. Une double tragédie pour un homme qui n’a aspiré toute sa vie qu’à trouver ce chez-soi, à rentrer chez lui. Quand l’auteur lui demande : « qu’est-ce que tu as aimé ? », il répond : « rentrer à la maison ». Le seul roman qu’il a jamais lu s’intitule Robinson Crusoé. Pour témoin, la photo le représentant à sa libération des camps soviétiques, une image qu’il a toujours gardée sur lui comme on porte une photo de ses enfants ou de celle que l’on aime. Une photo qui symbolise le long et difficile chemin que l’homme a parcouru et qu’il finit par perdre, la maladie détruisant progressivement sa personnalité. À cet exil mental s’ajoutent une perte et un isolement progressif de la langue. Mais, aussi tragique soit-elle, la confusion dans laquelle se trouve le père engendre des fulgurances littéraires et philosophiques qui enthousiasment et nourrissent l’écrivain. « Les mots lui glissaient progressivement de sa bouche, clac, clac. Il était détendu, il disait ce qui lui passait par la tête et ce qui lui passait par la tête, souvent, n’était pas seulement original mais avait aussi une profondeur qui me faisait penser : pourquoi est-ce que cela ne me vient pas à l’esprit, à moi ! ». Ne vous y trompez pas, ce récit n’a rien de sombre malgré son sujet délicat. Arno Geiger réalise un véritable tour de force en racontant cette expérience difficile avec intelligence, tendresse et humour. Loin de se cantonner à décrire la déchéance progressive du malade, il évoque les changements qui touchent tous les protagonistes et parle autant de l’évolution de son père que de la sienne. Il s’attache à sauver ces morceaux de vie balayés par le temps, faisant de ce récit une expérience intime, loin de toute vérité universelle. Le lecteur y puisera mille choses, dont une merveilleuse leçon de vie, d’espoir et de littérature. Il retiendra aussi que l’amour qui unit un enfant à ses parents, un père à ses enfants, est plus fort que l’oubli. « Papa, quelle était la période la plus heureuse de ta vie ? — Quand les enfants étaient petits. — Toi et tes frères et sœurs ? — Non, mes enfants. »