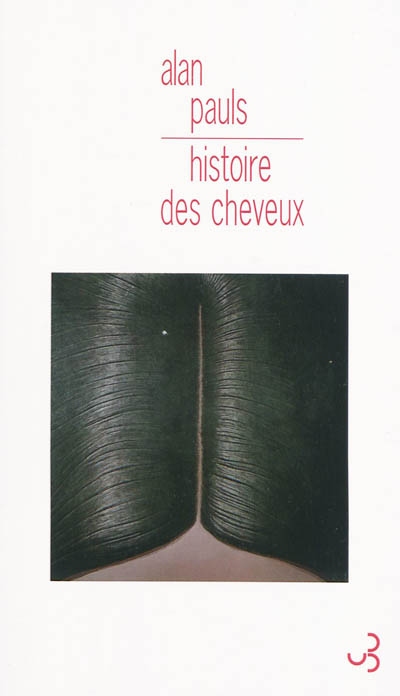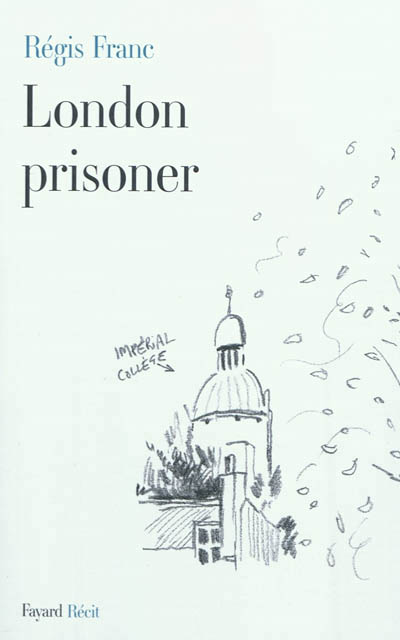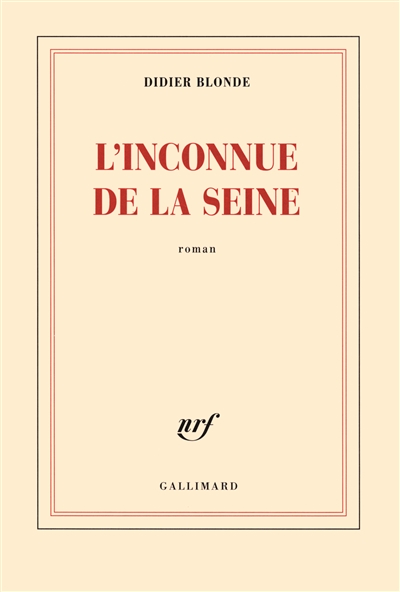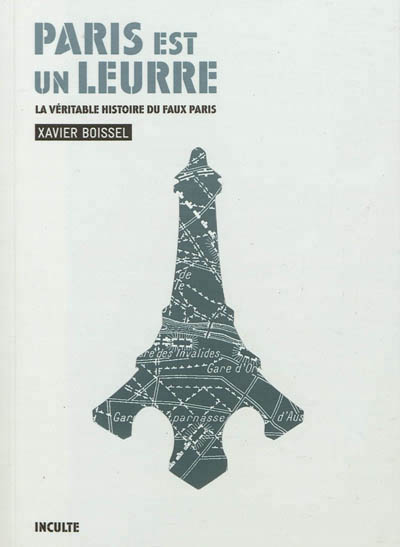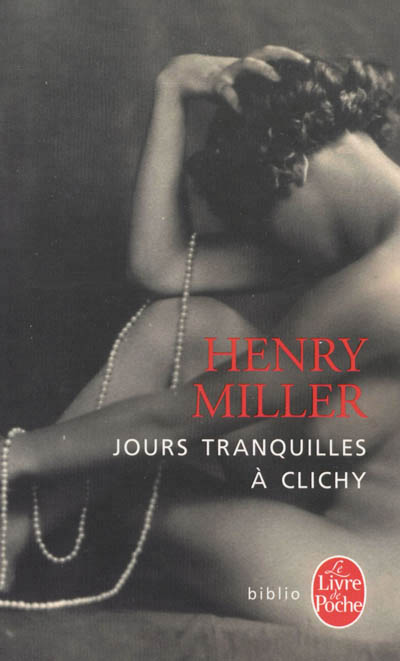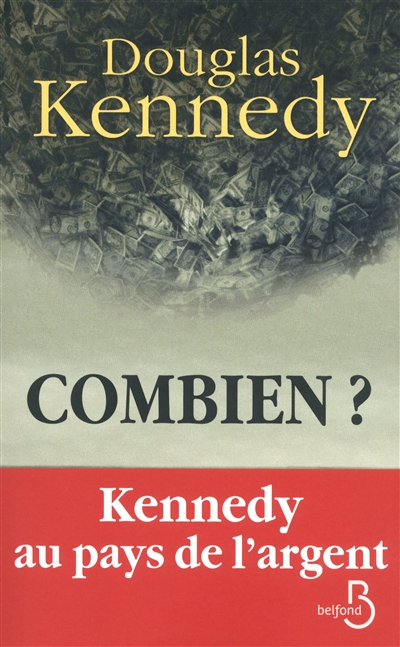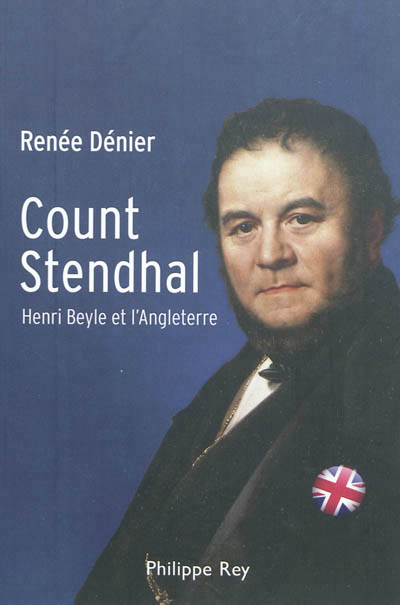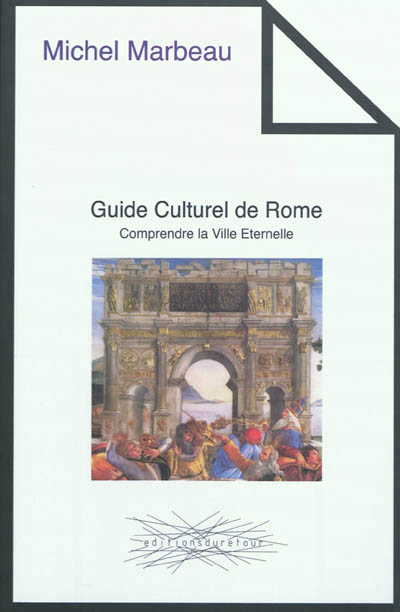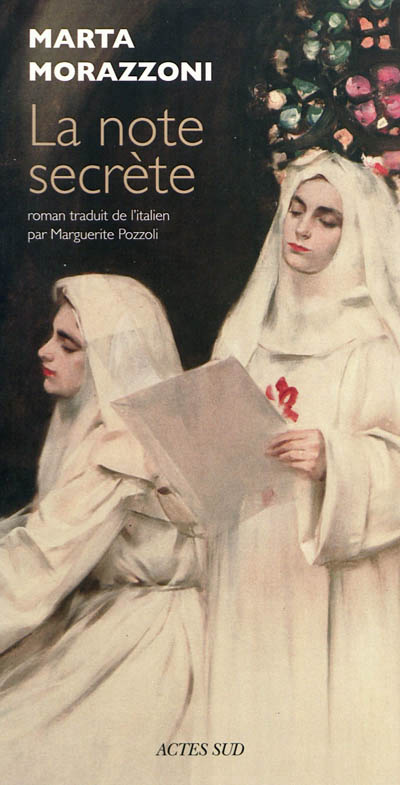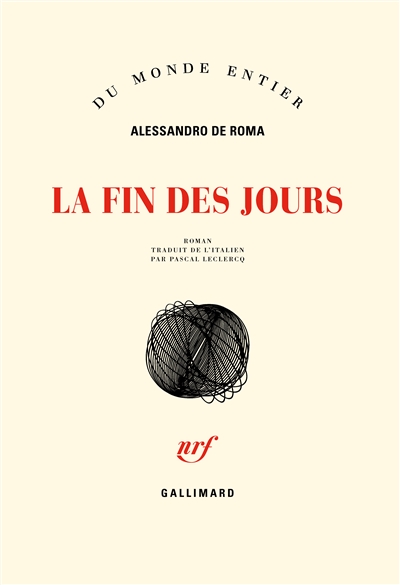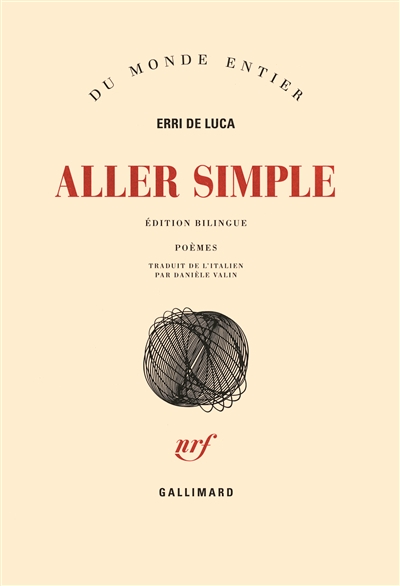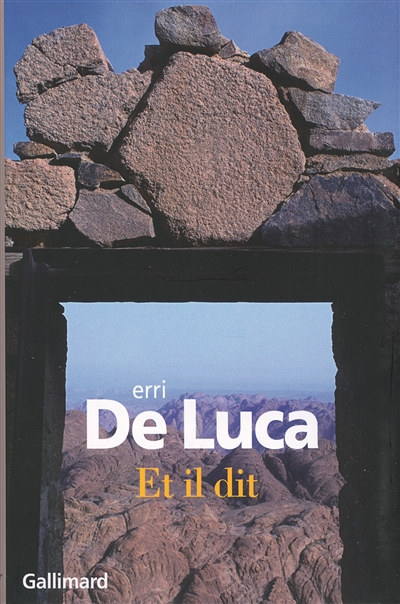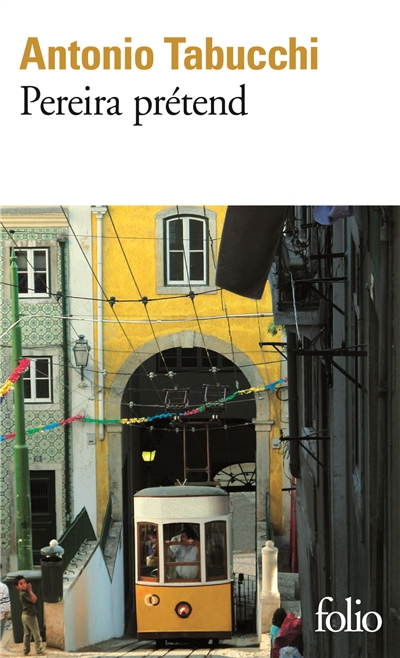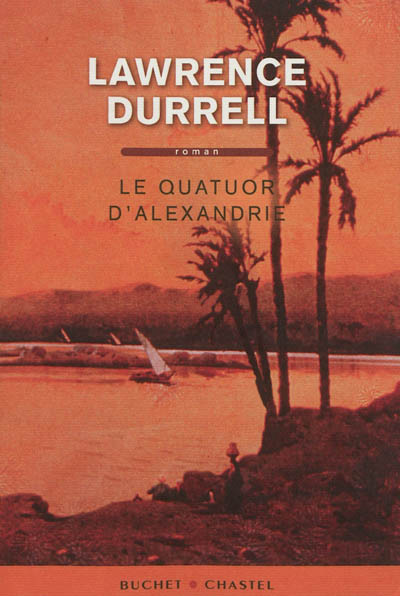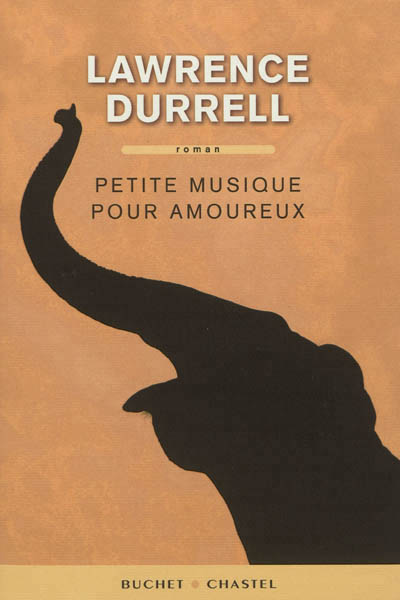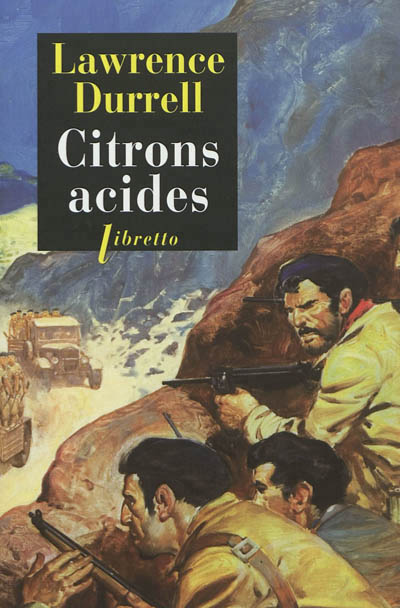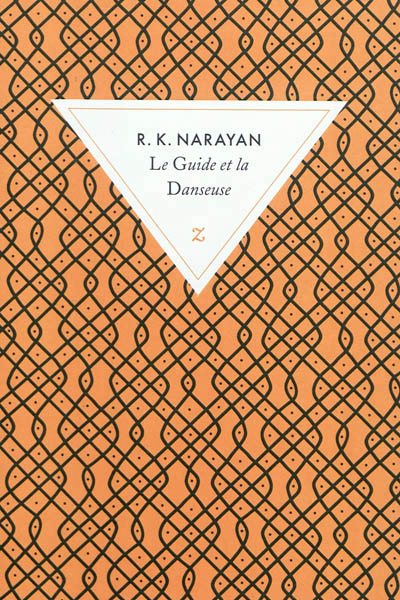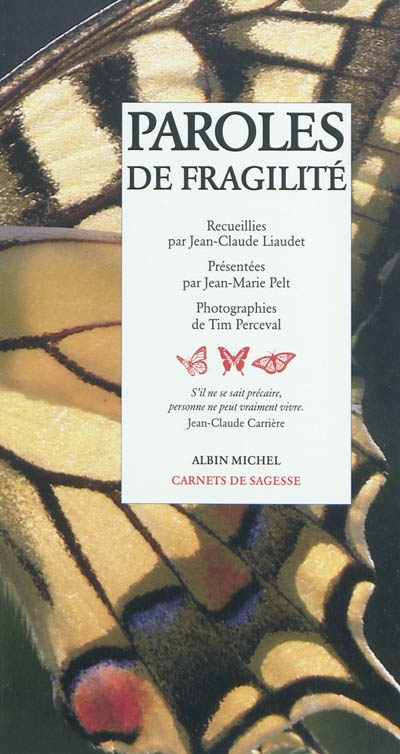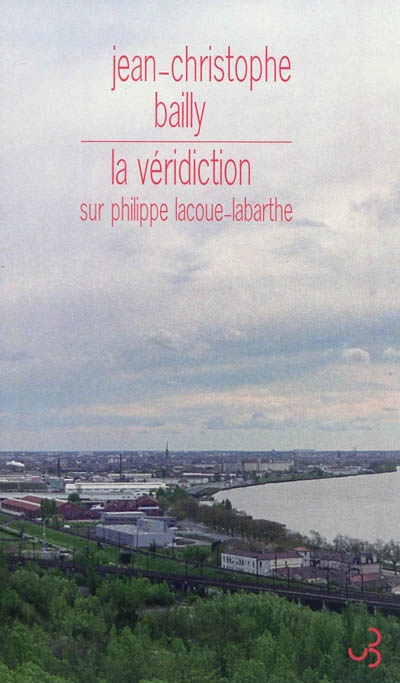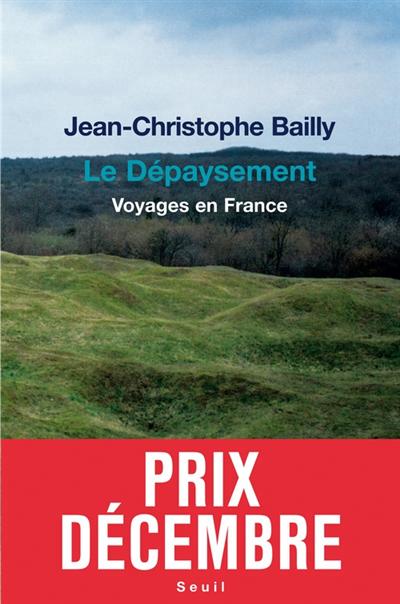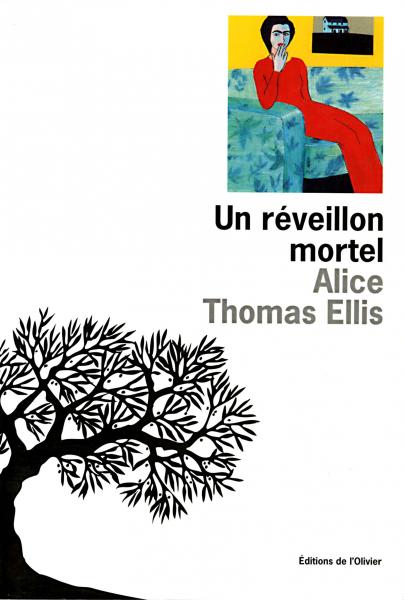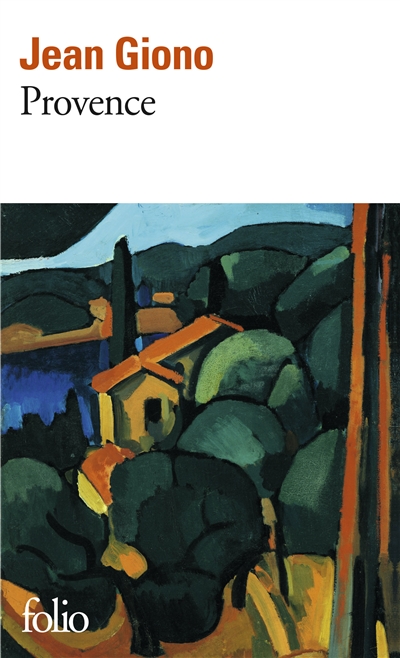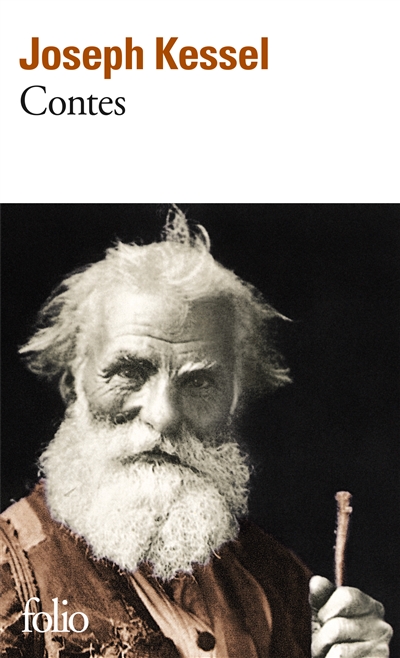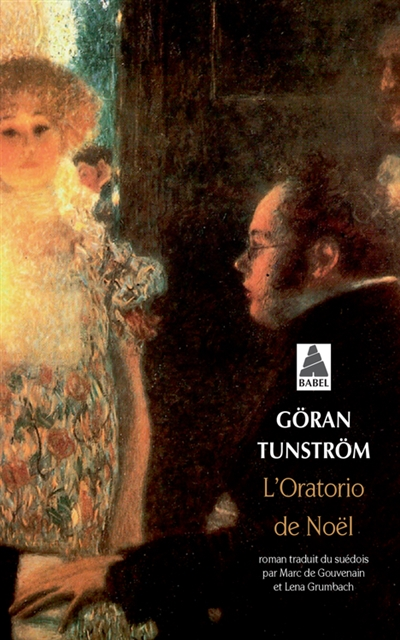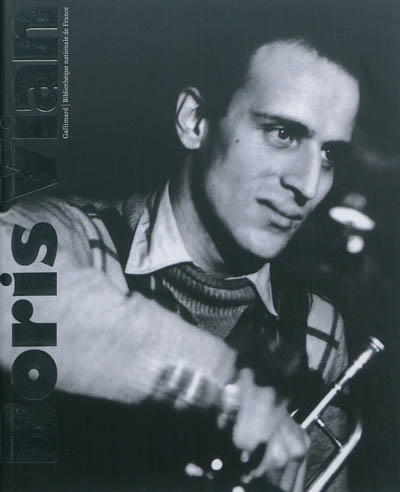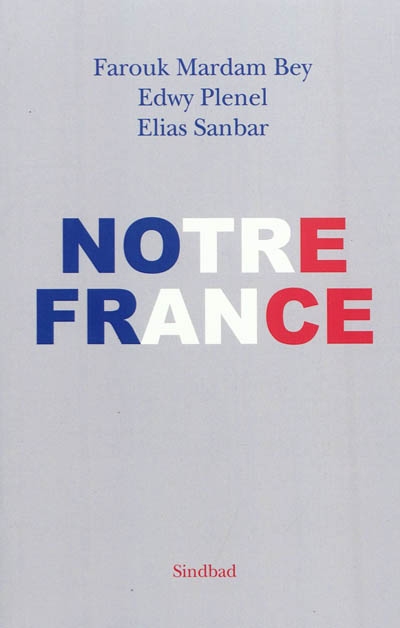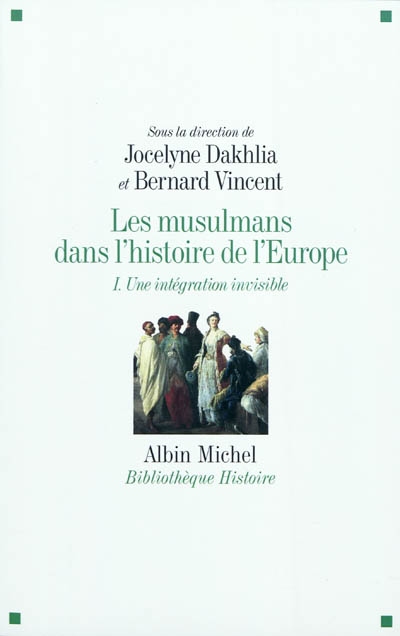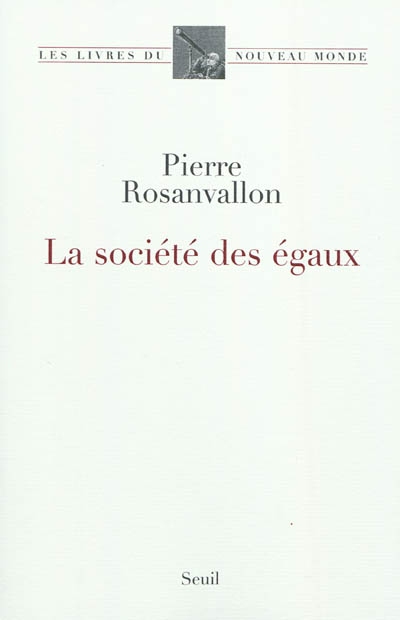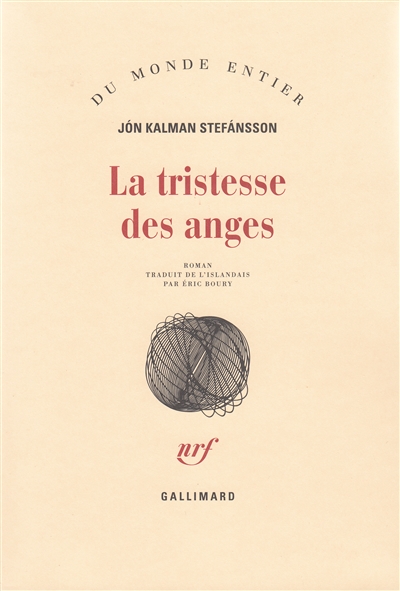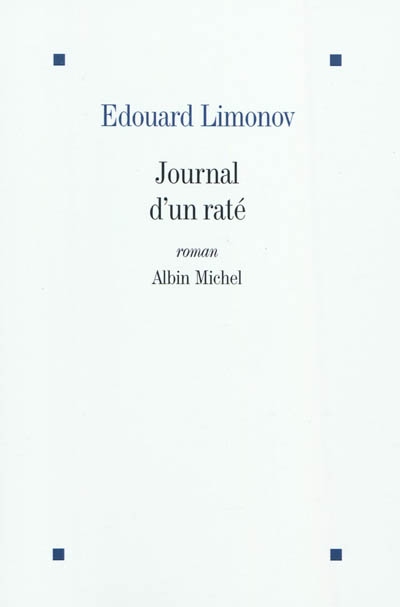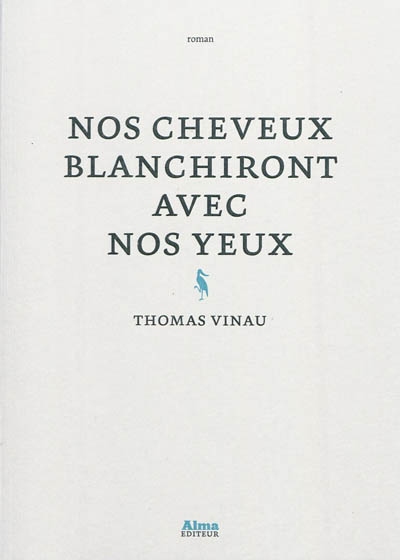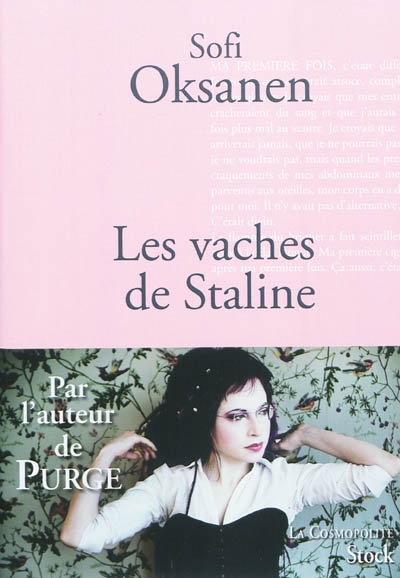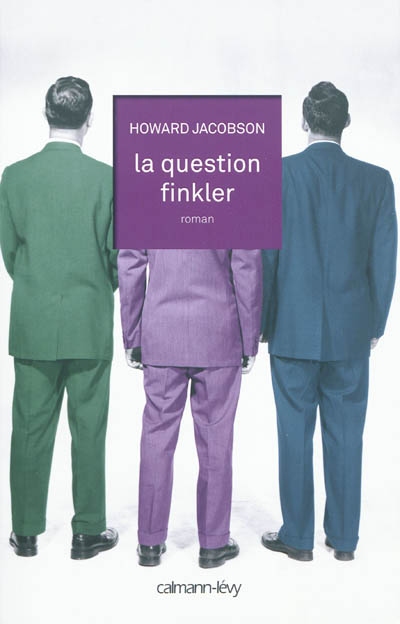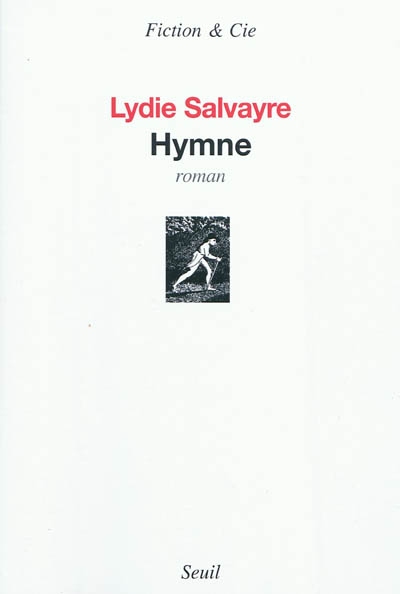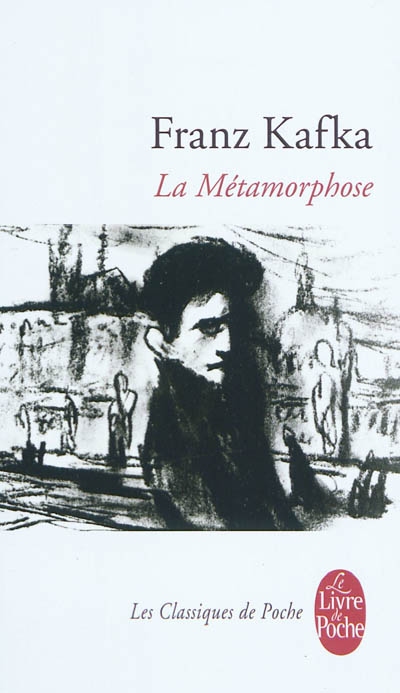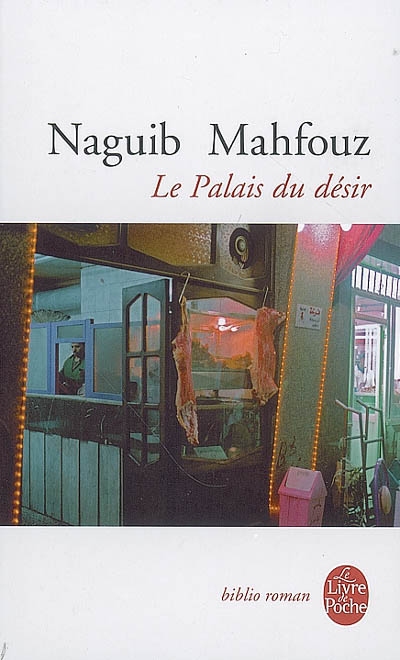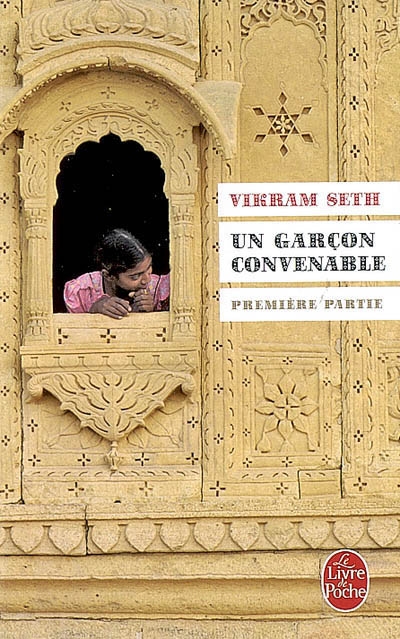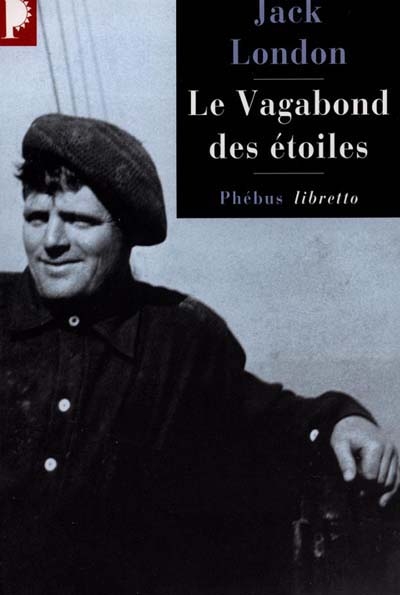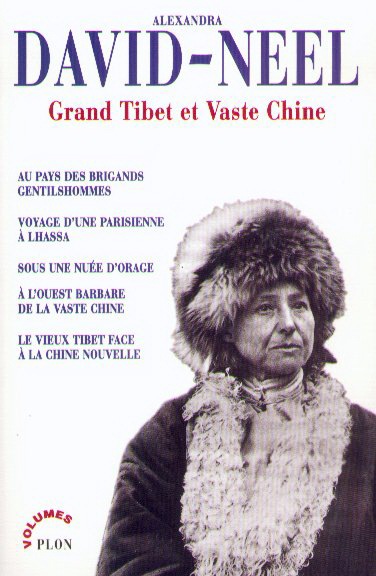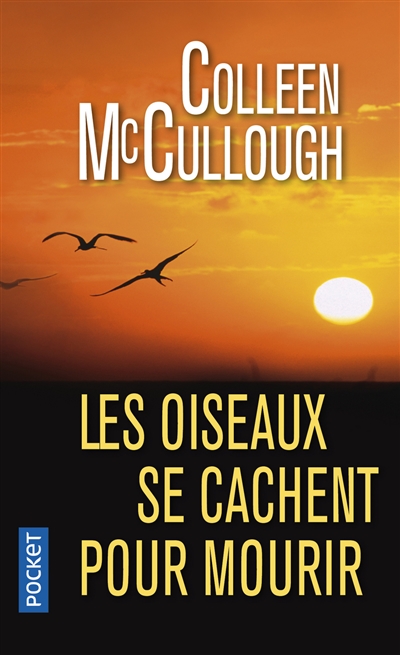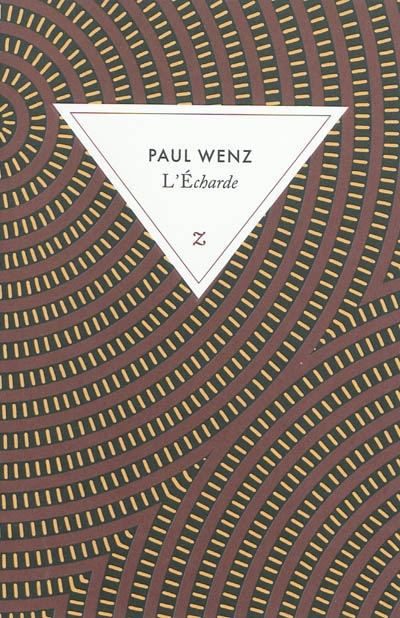Littérature étrangère
Sandor Marai
La Sœur
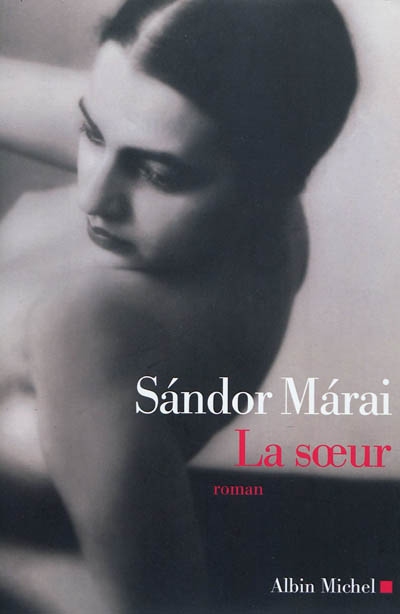
-
Sandor Marai
La Sœur
Traduit du hongrois par Catherine Fay
Albin Michel
03/11/2011
320 pages, 20 €
-
Chronique de
Daniel Berland
Pigiste () -
❤ Lu et conseillé par
8 libraire(s)
- Caroline Sauvage de La Grande Librairie (Vichy)
- Elyne Bonnet de Maison du livre (Rodez)
- Emmanuelle George de Gwalarn (Lannion)
- Christine De Kermadec de Ravy (Quimper)
- Marie Boisgontier
- Michel Lanore de La Boîte à lettres (Asnières-sur-Seine)
- Joëlle Huleux de Éveils FERMEE ()
- Carine Bastié de Privat (Toulouse)
✒ Daniel Berland
(Pigiste , )
Dernier roman publié en 1946 en Hongrie par Sándor Márai, La Sœur nous plonge au cœur d’une enveloppante et néanmoins bien étrange confession post-mortem. Un testament contemplatif et plein d’espoir sur la vie, la maladie, la mort, l’amour et l’humanité.
En poursuivant la publication de l’œuvre de l’écrivain hongrois Sándor Márai, les éditions Albin Michel réparent l’injuste oubli auquel avait été condamné l’auteur après son exil en 1948. Dans ce roman tout en finesse et en profondeur, l’auteur nous entraîne sur les sentiers psychologiques empruntés par un narrateur isolé par la neige et contraint de trouver refuge dans la chaleur d’une auberge de Transylvanie.
« Ce que j’ai appris alors n’avait pas trait à des peuples ou des pays mais seulement au sort d’un homme. Toutefois, la même fatalité peut s’acharner aussi implacablement sur la vie d’un homme que sur l’existence des nations ». Le ton est donné. On devine dès les premières lignes que la rencontre à venir entre le narrateur et Z, un musicien au succès enfui et qui n’est pas remonté sur scène depuis trois années, résonnera bien au-delà de leurs deux destins individuels. Z pourrait être le dernier homme d’un monde implosé (notons que le roman se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale) et s’accorde bien à l’huis clos d’une auberge isolée, laquelle pourrait s’assimiler à une arche proche du naufrage et dont le mince équipage se préparerait au cataclysme. Peu de temps après avoir quitté le lieu de leur échange, le narrateur apprendra le décès de son interlocuteur, puis en recevra les confessions post-mortem. Dans ces mémoires d’outre-tombe, le musicien décrit le mal fulgurant et mystérieux qui s’abattit sur lui à l’issue d’un concert à Florence quelques années auparavant. Revenant sur son hospitalisation et son traitement à la morphine, il dépeint son détachement d’un monde en plein chaos, fruit de l’oubli procuré par les épreuves et la drogue. Écartelé en son for intérieur par des tensions contradictoires liées à la guerre, à sa maladie ainsi qu’à son impossible amour platonique pour une femme mariée, le musicien semble chercher, par sa confession, la voie d’une guérison psychique et physique qui s’apparente à une rédemption.
Entre contemplation(s) et illusion(s), ce roman abyssal et mystique nous entraîne, avec la maestria des nocturnes de Mozart, dans les profondeurs insondables de l’âme humaine. « L’intelligence n’est rien. La passion est tout. Peut-être ce que Goethe appelle l’idée, ainsi que Platon et ceux qui savent que la signification de la réalité est la passion qui éclaire les formes par derrière. La passion est davantage que la volupté. Mais ça, je ne peux le dire à personne. Peut-être si encore une fois, la musique… »
À l’écoute des cris de son corps, du silence de sa musique et des palpitations de son cœur transi, l’homme réfléchit aux sens des mots vie et mort, ainsi qu’à l’altruisme et à la générosité salvatrices de l’humanité. Ce grand roman, admirablement traduit par Catherine Fay, est sans conteste l’un des textes incontournables de cet automne. Après la lecture de Márai, le silence qui suit, tout comme en musique, est encore plus puissant et plus fort que les mots.