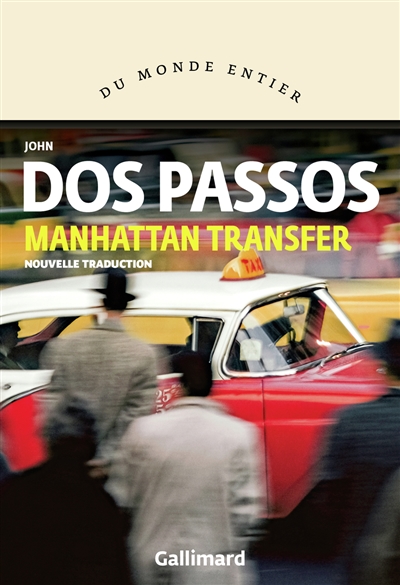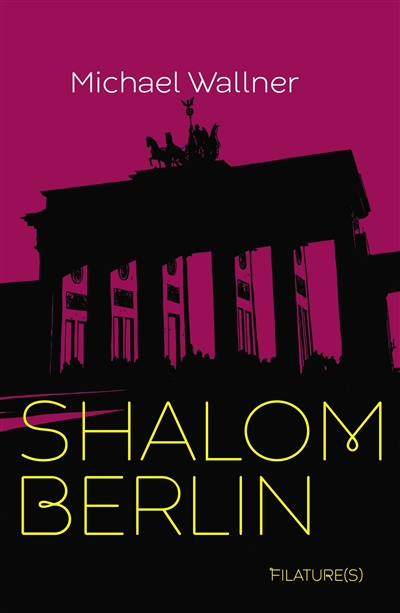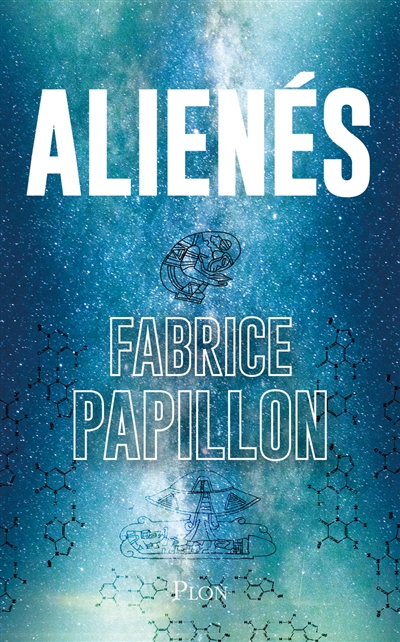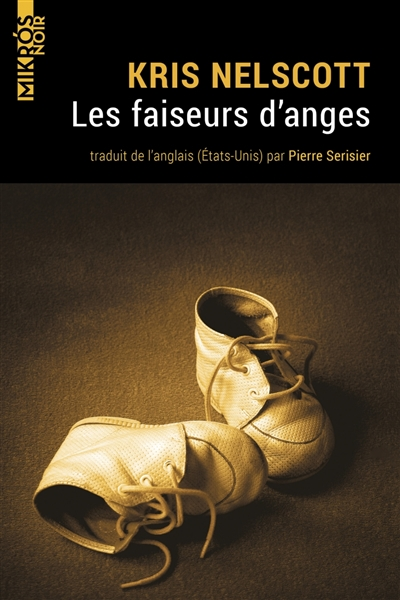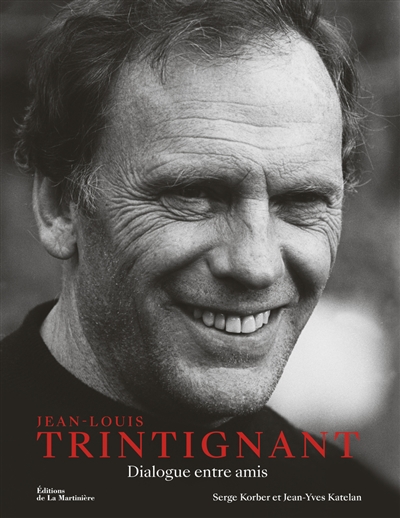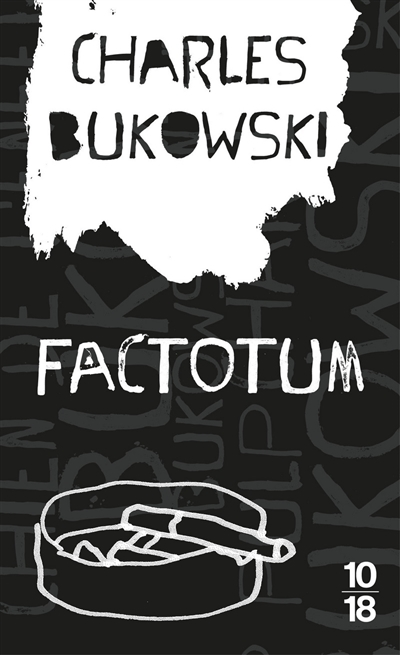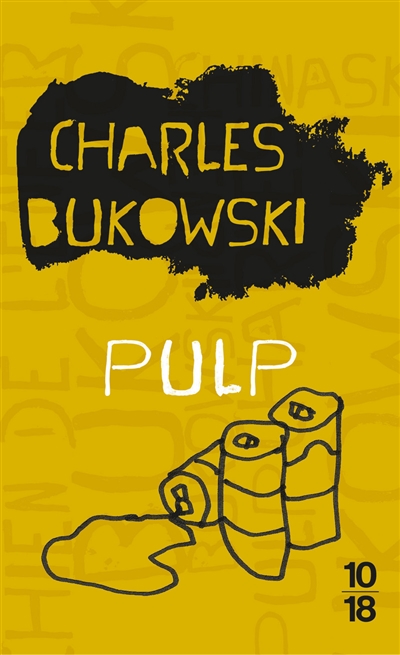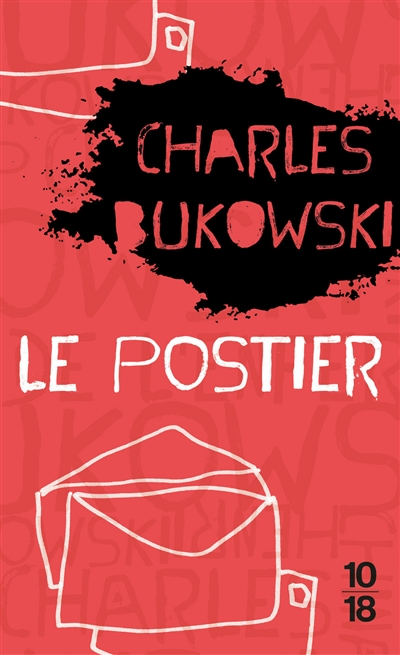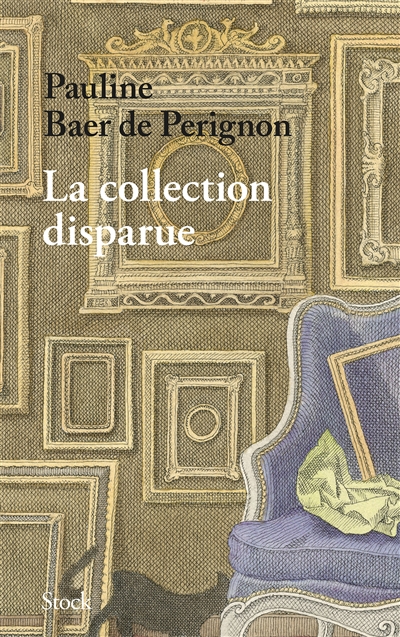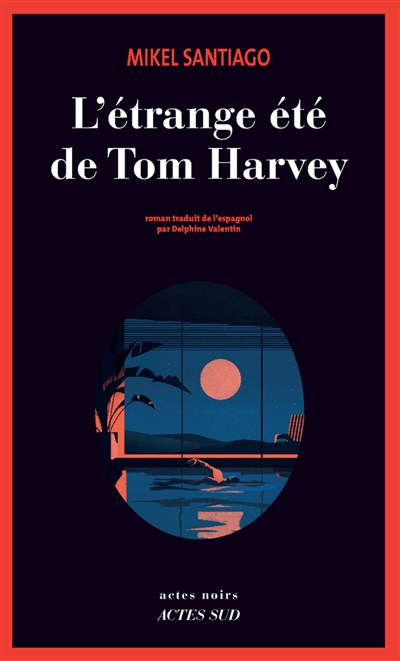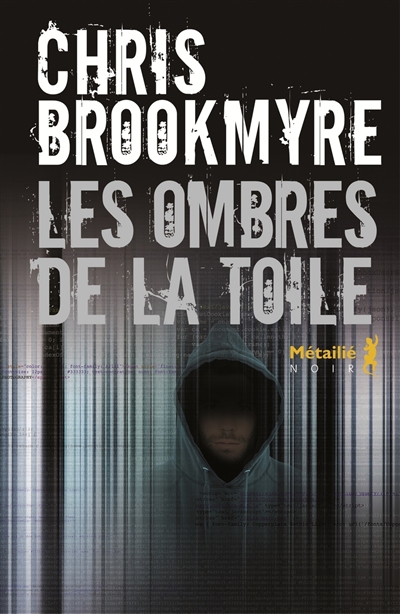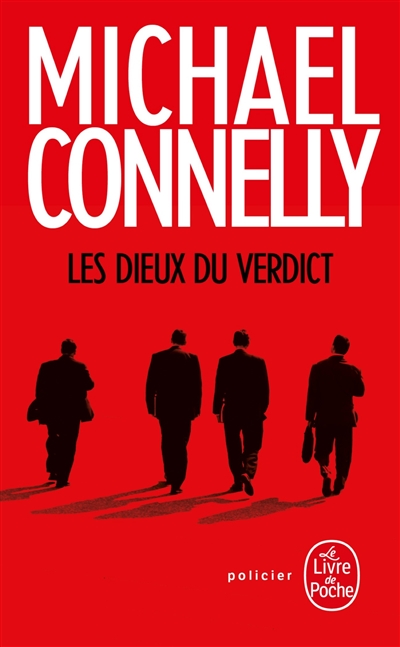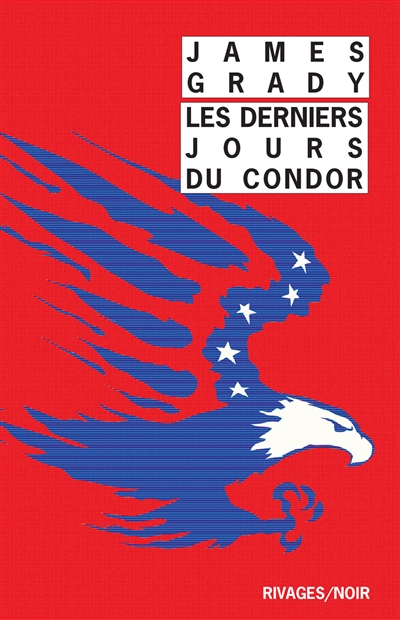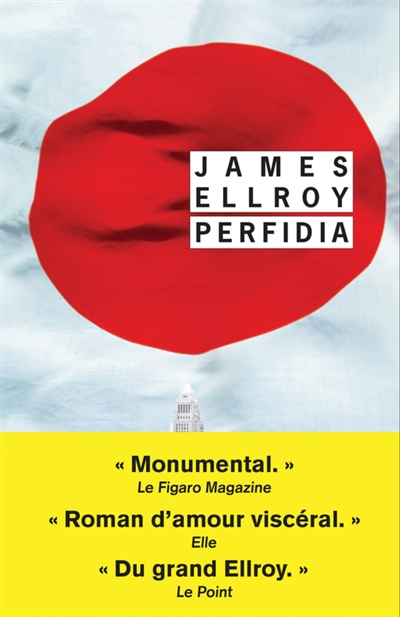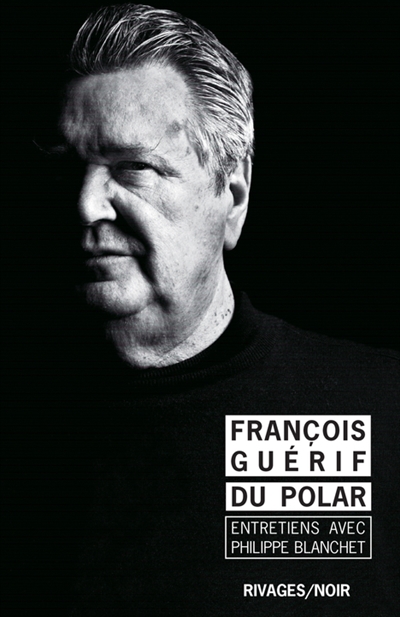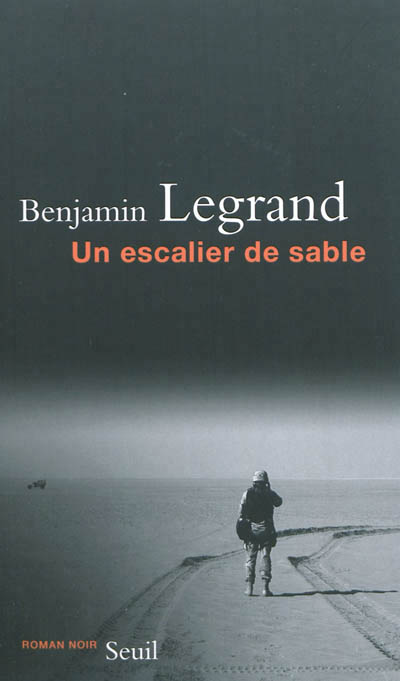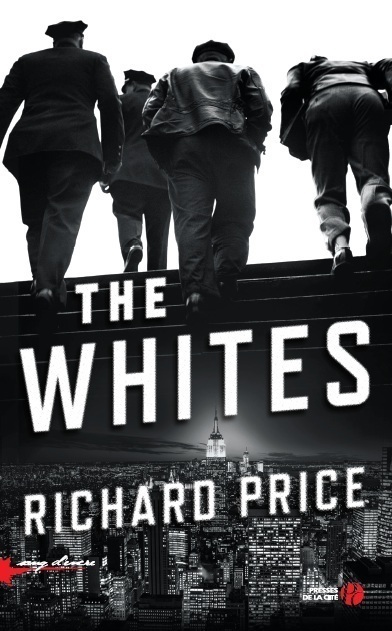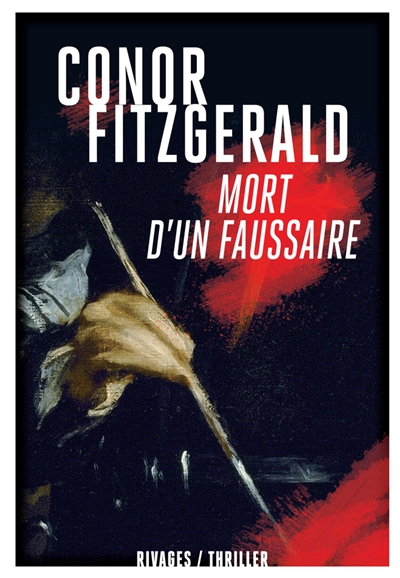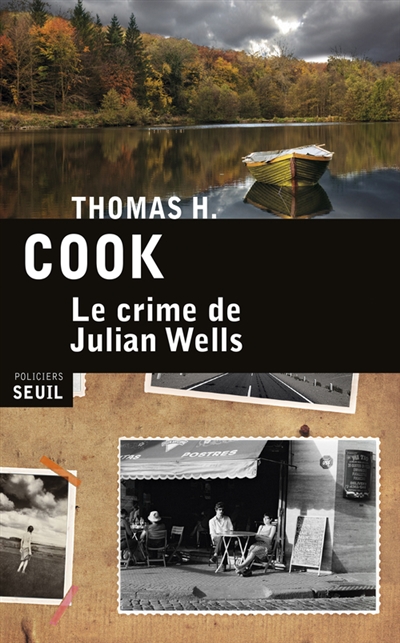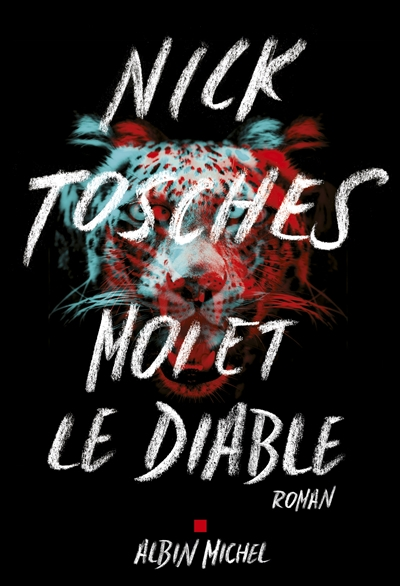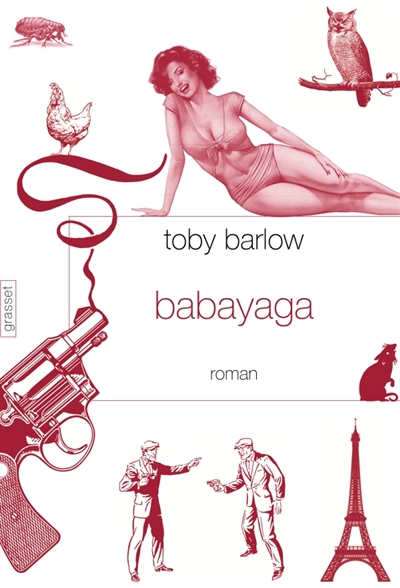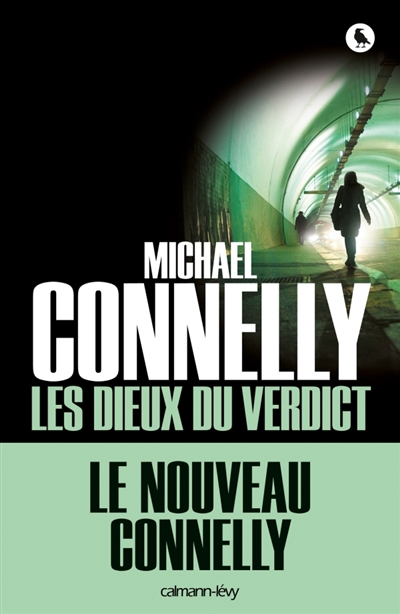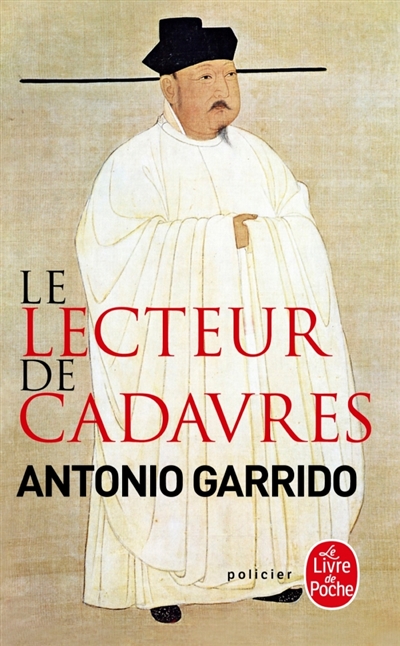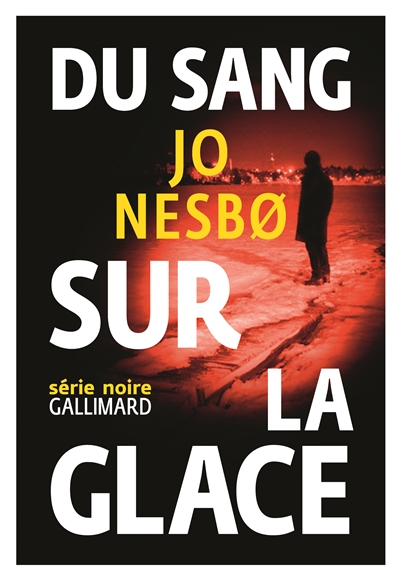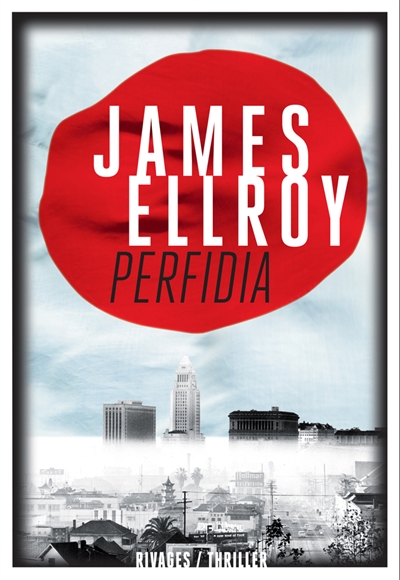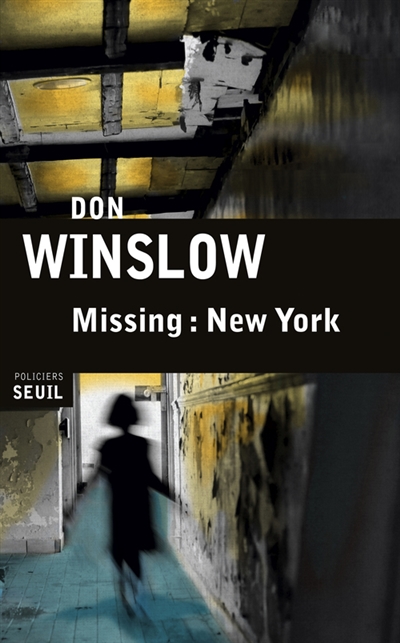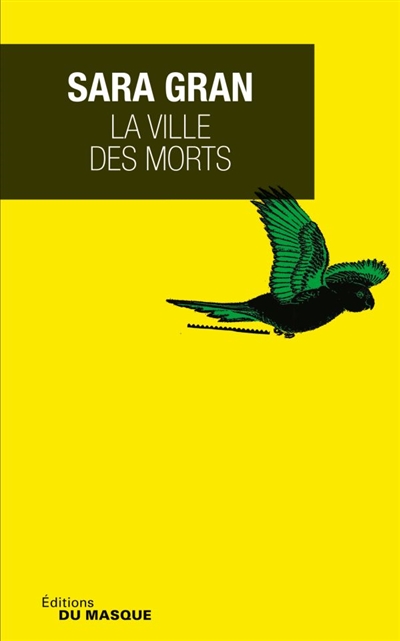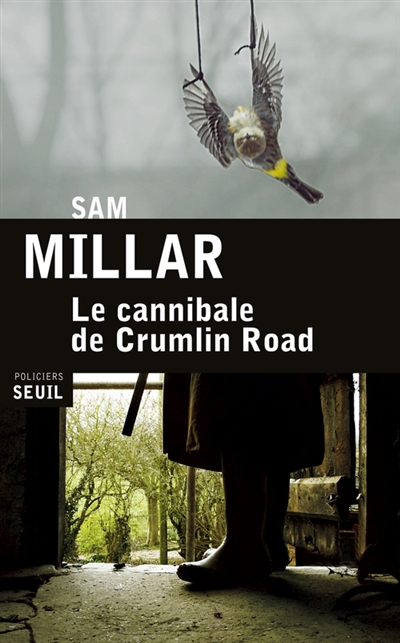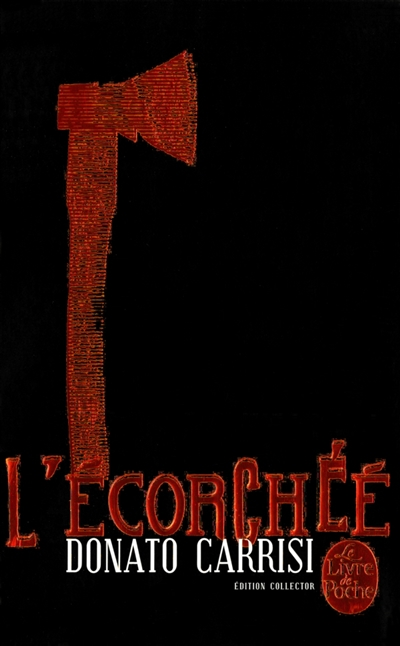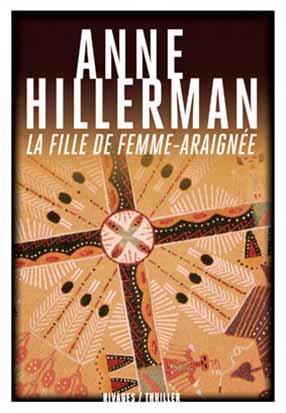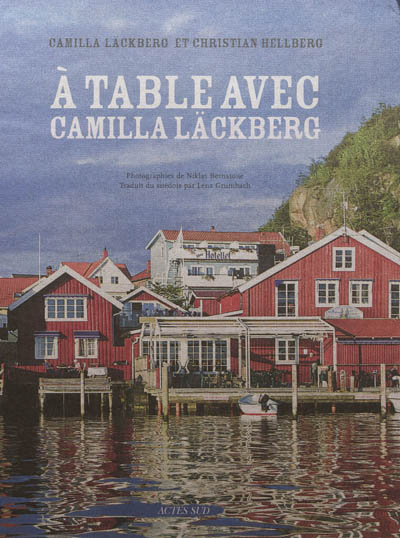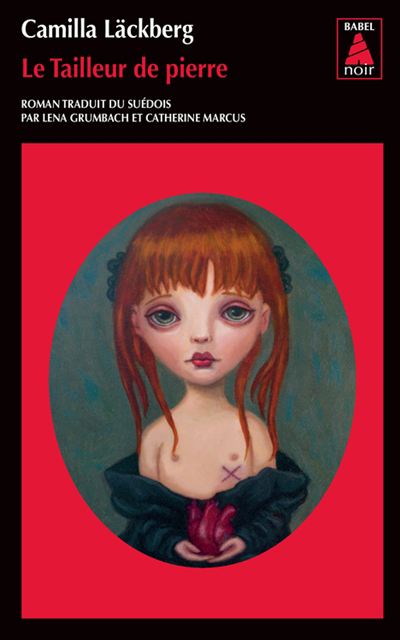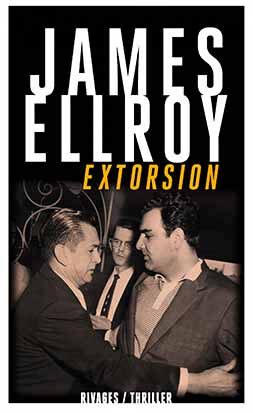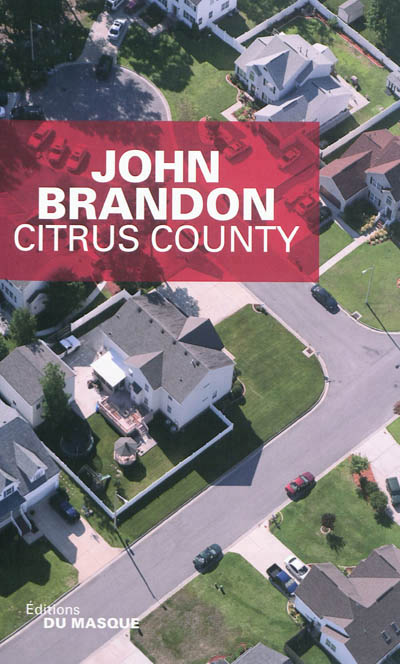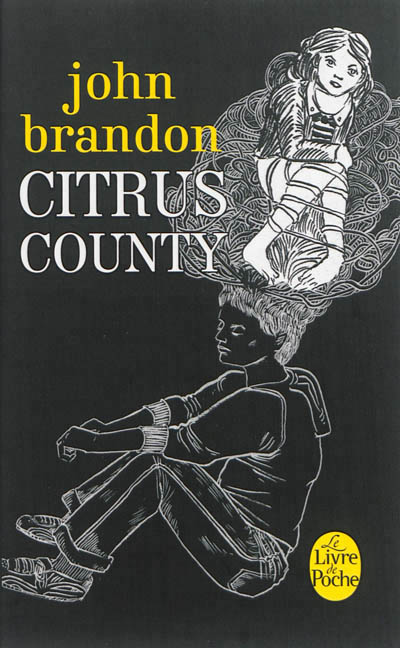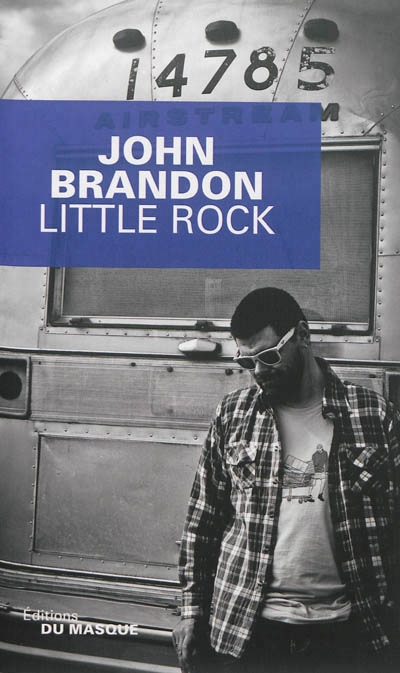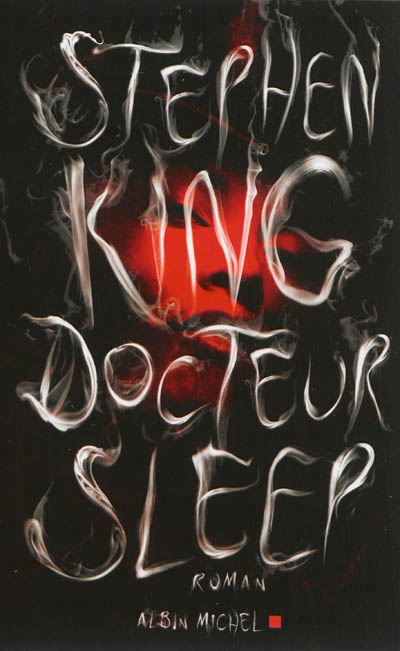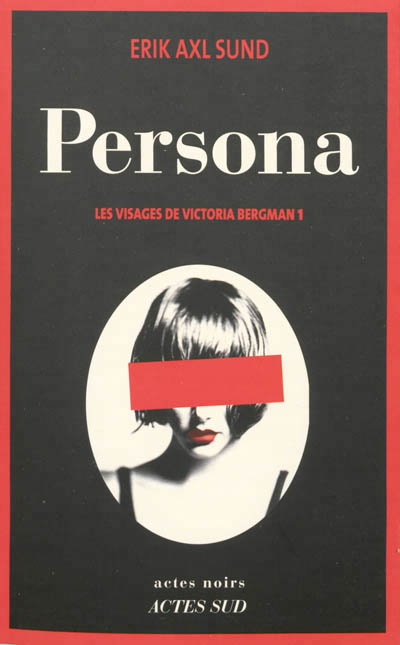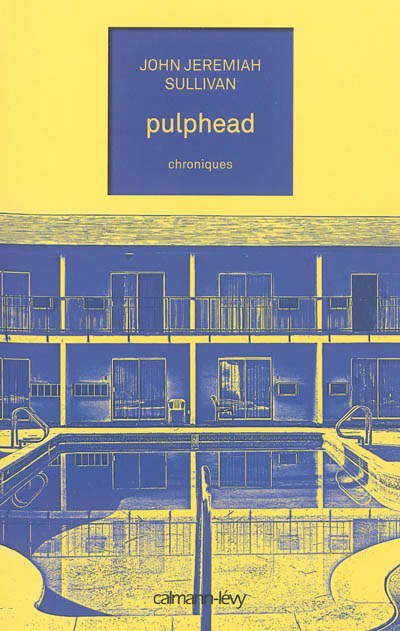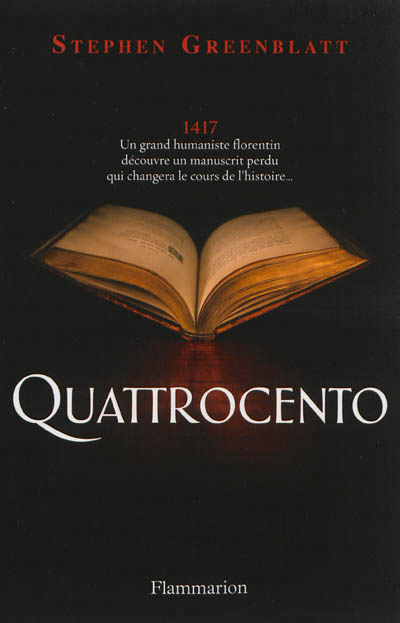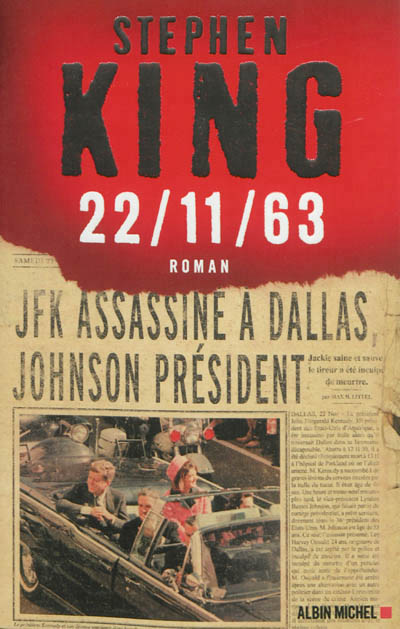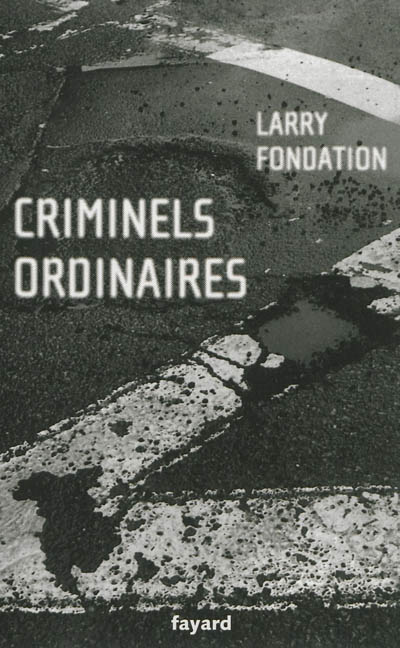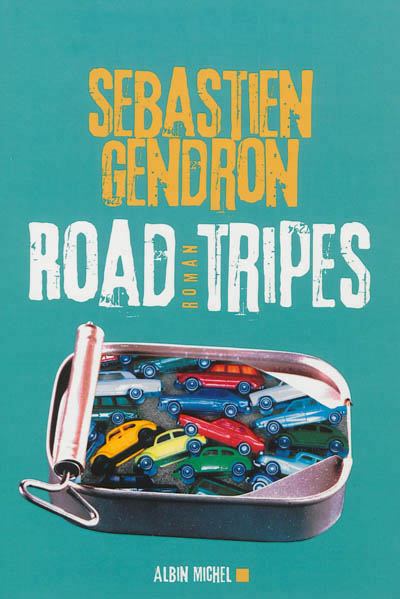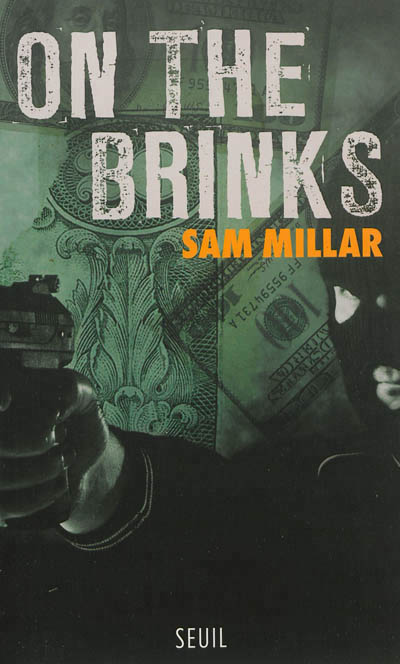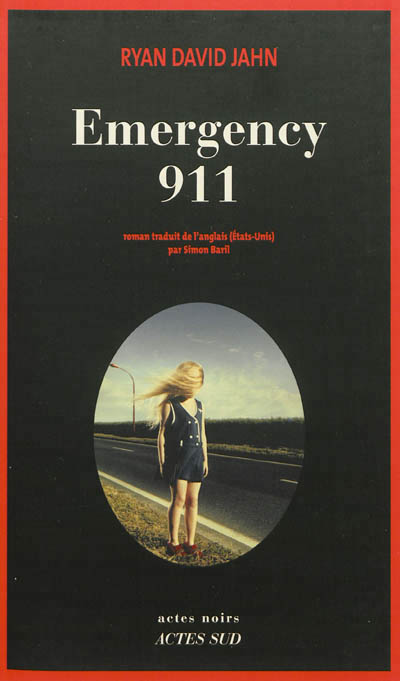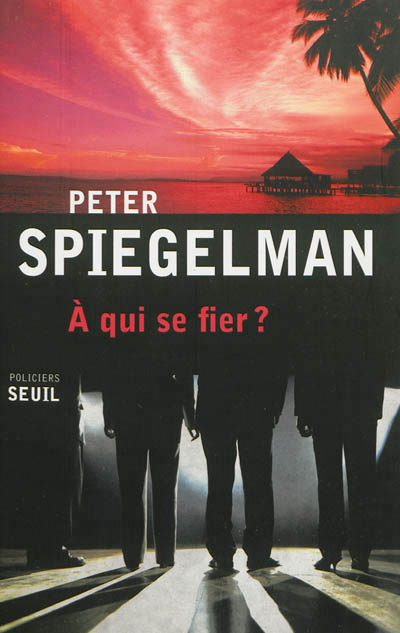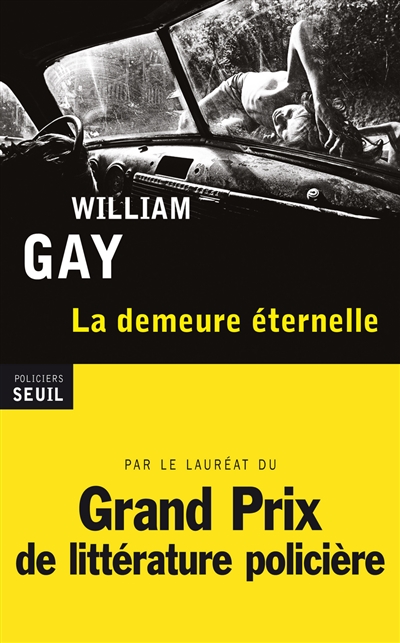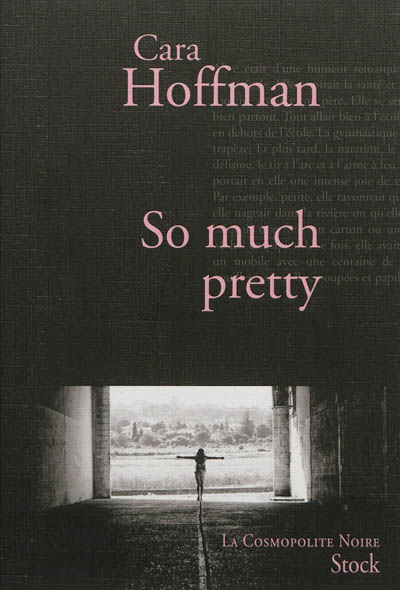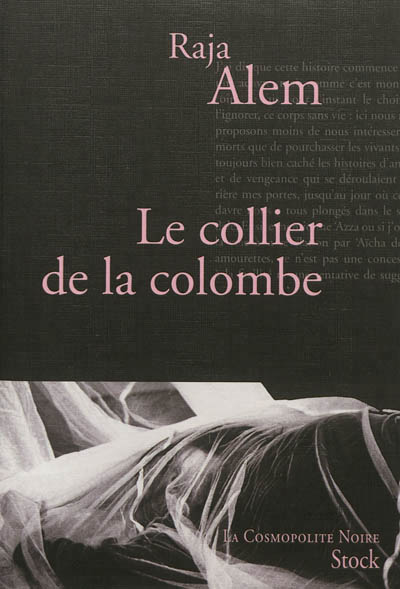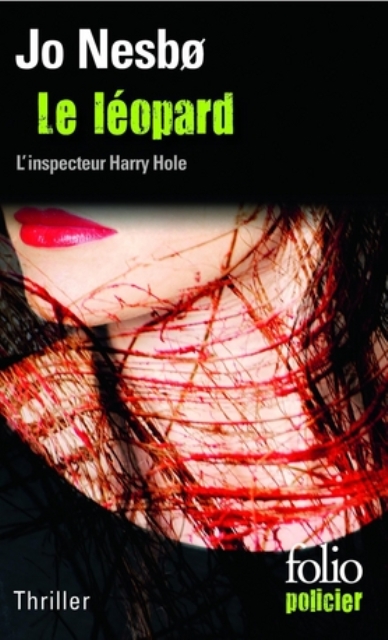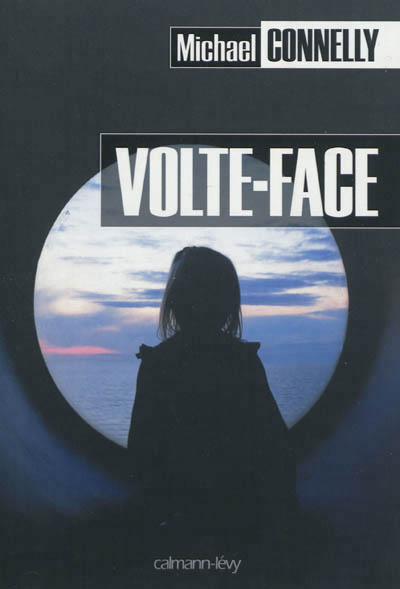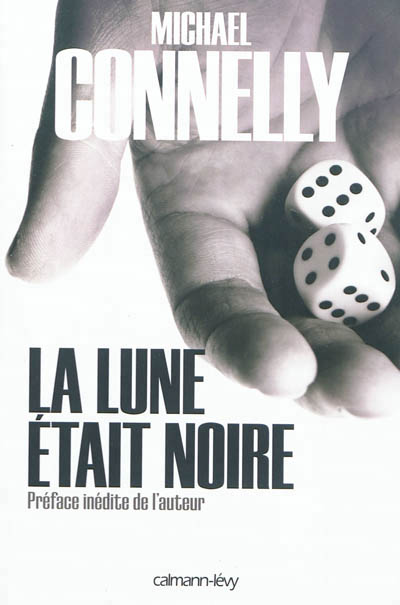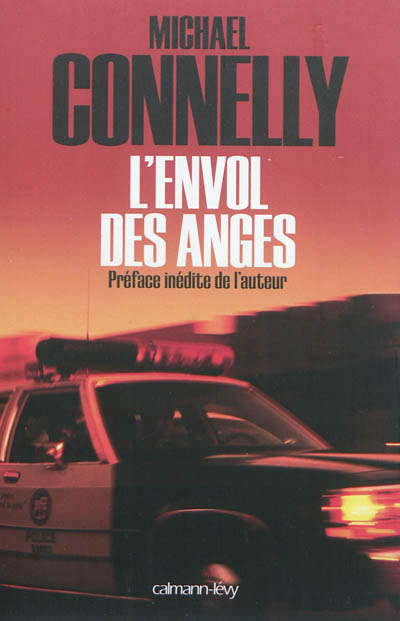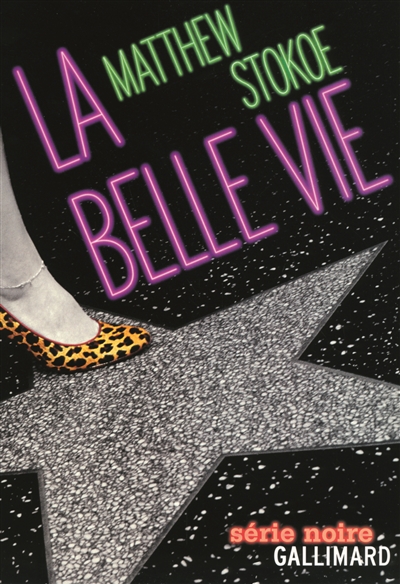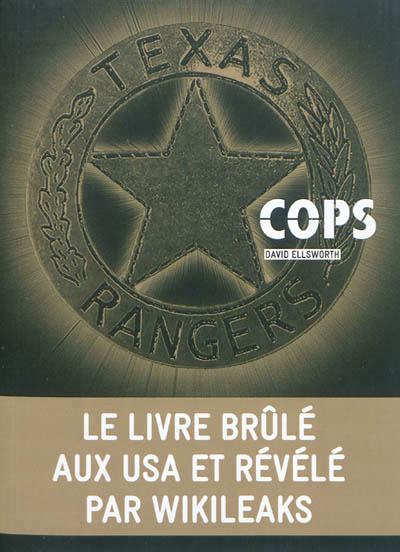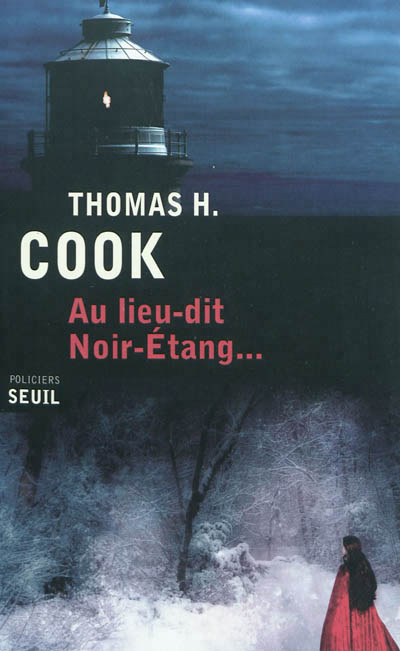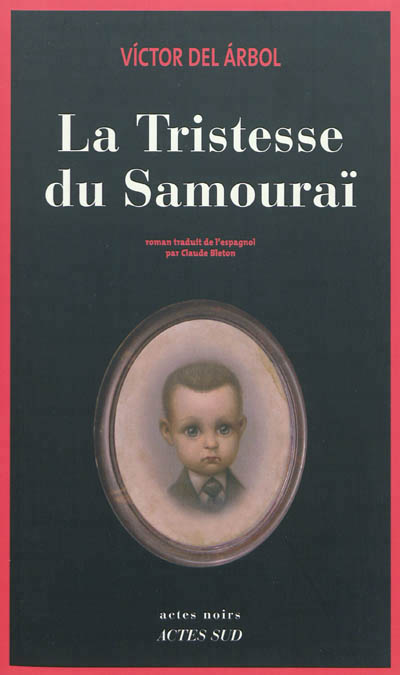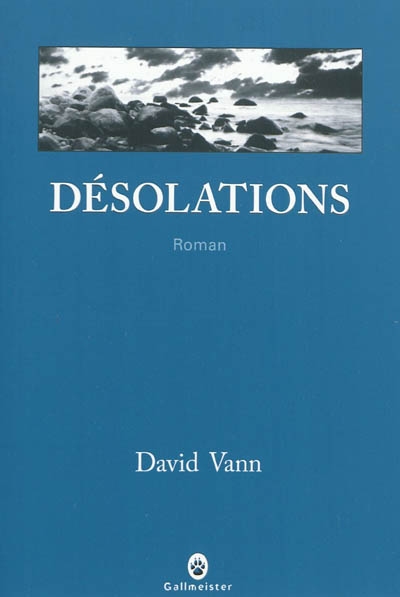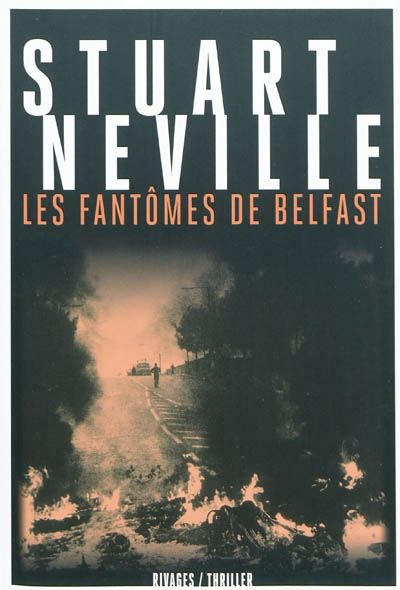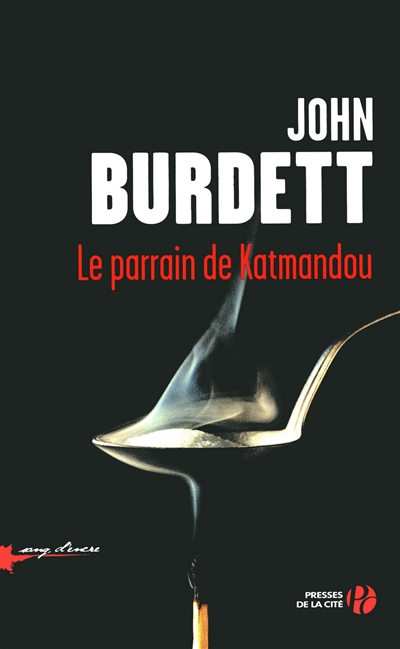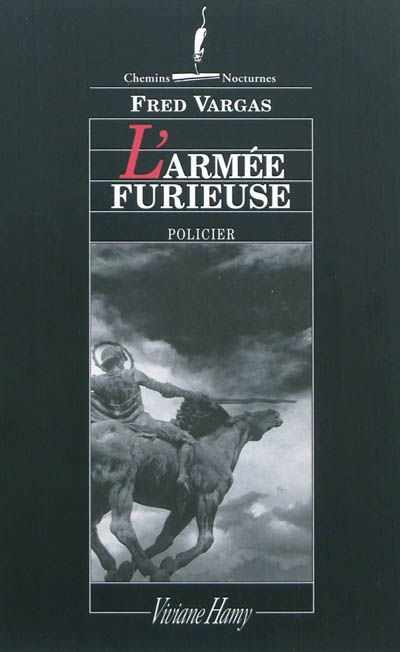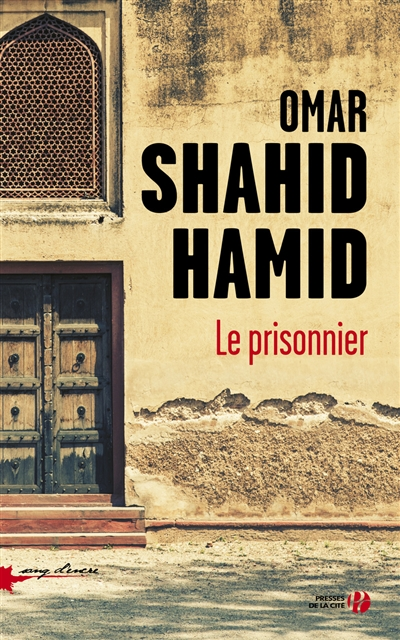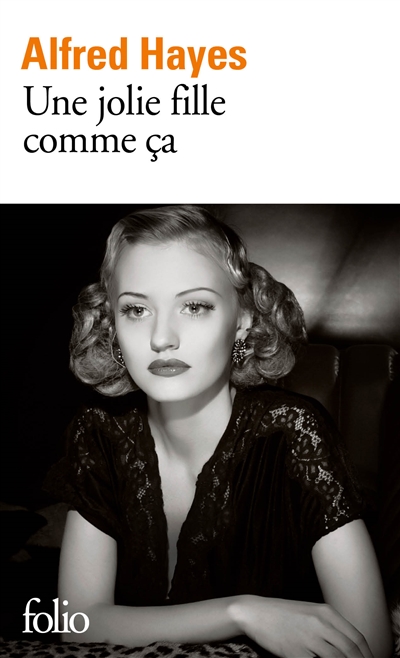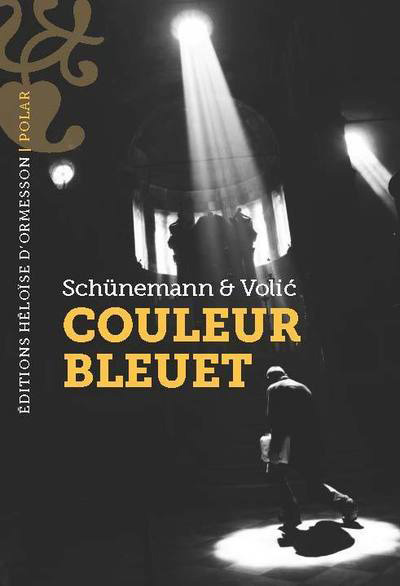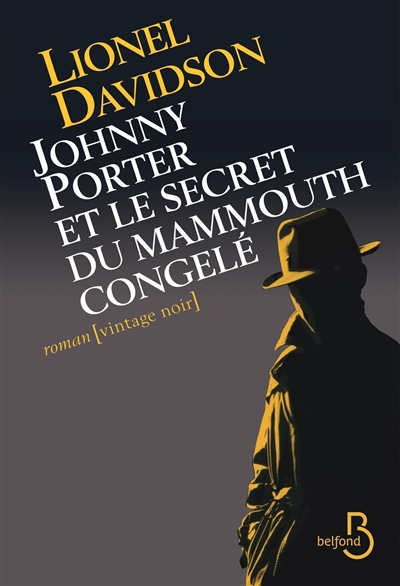Polar
Deon Meyer
La Proie

-
Deon Meyer
La Proie
Traduit de l'afrikaans par Georges Marie Lory
Gallimard
13/08/2020
576 pages, 18 €
-
Chronique de
Jérôme Dejean
-
❤ Lu et conseillé par
7 libraire(s)
- Jérôme Dejean
- Martine Coussy de Entre les lignes (Chantilly)
- Emmanuelle Barbier-Maître de du Cours (Lyon)
- Nadia Sendin de BDP de la Gironde (St Medard en Jalles)
- Laurence Tutello de Le Chat Pitre (Paris)
- Sarah Mossman de Le Bel Aujourd'hui (Tréguier)
- Christel Rafstedt de Le livre dans la théière (Rocheservière)
✒ Jérôme Dejean
( , )
Le nouveau Deon Meyer est un formidable thriller doublé d’un jeu du chat et de la souris. Mais pas qu’une simple version de Tom et Jerry sur-vitaminée. Plutôt celle avec un fou, un cavalier, des pions et soixante-quatre cases noires et blanches. Le fin stratège de ce polar à cent à l’heure a répondu à nos questions.
Le Cap, Bordeaux, Paris et Amsterdam, le lecteur est entraîné dans une course poursuite folle et parfaitement orchestrée. Comment travaillez-vous le rythme d’une histoire ?
Deon Meyer - Pour moi, le rythme et la tension sont d’une importance cruciale dans un roman de suspense. Mon objectif est de maintenir le lecteur assis au bord de sa chaise, à tourner compulsivement les pages. L’autre méthode, pour faire monter le suspense, est d’imposer aux personnages une date butoir. Démarrer avec deux intrigues séparées sert ce propos : on peut utiliser le rythme et le suspense de l’une pour développer l’histoire, alors que l’autre a besoin de plus de dramatisation ou d’un moment de répit. Je vous avouerai que je ne me conforme pas à un plan spécifique pour mettre cette structure en route. C’est plus une affaire d’intuition, de sensation globale. Je suis complètement d’accord avec cette célèbre citation du romancier américain E. L. Doctorow : « Écrire, c’est comme conduire de nuit dans le brouillard. Vous n’avez pas de visibilité au-delà de la portée de vos phares, mais ça ne vous empêche pas de rouler jusqu’à votre destination ». Ainsi, je me concentre sur ce que je vois à la lumière de mes phares (le chapitre suivant, parfois les deux d’après) et je fais en sorte qu’ils fonctionnent pour ce qui est de faire avancer l’histoire sur la route. Bien entendu, je connais plus ou moins ma destination, mais ce qui compte vraiment, c’est que ces deux ou trois chapitres sur lesquels je me concentre fonctionnent.
Un sentiment de colère semble habiter vos personnages et je pense en particulier à Daniel Darret, Umzingeli, « le chasseur » en Zulu.
D. M - Umzingeli a fait sa première apparition dans Les Soldats de l’aube. Mais il est devenu un personnage majeur dans Le Pic du diable (Points), le roman où Benny Griessel apparaît pour la première fois. À dire vrai, j’étais en colère quand j’ai écrit La Proie. J’étais furieux que notre président d’alors, Jacob Zuma, et sa clique soient en train de dépouiller notre pays, détruisant tout ce que nous avions essayé de construire depuis la fin de l’Apartheid, détruisant le rêve de Mandela, construire la nation arc-en-ciel. J’étais furieux que tous les efforts de tant d’individus soient réduits à néant. Je me suis senti trahi personnellement parce que j’avais toujours essayé d’être un ambassadeur loyal et positif pour notre pays. Parce que je me suis toujours efforcé de jouer un rôle dans l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et la réduction des souffrances des enfants dans les communautés défavorisées. Évidemment, je n’étais pas le seul à être en colère. Des millions de Sud-Africains pensaient comme moi. Des milliers de policiers, hommes et femmes, pensaient comme moi. J’ai voulu que cette colère soit présente chez mes personnages.
Une grande partie du roman se situe en France, pourquoi ce choix ?
D. M - Mon amour pour la France ne date pas d’hier. Je me suis passionné pour votre langue et votre culture dès l’âge de 14 ans et j’ai étudié le français pendant deux ans à l’école. Je me rappelle encore ma fierté quand j’ai été capable de prononcer ma première phrase en français : « Le chat est sur le mur » ! Ce fut, en grande partie, grâce à mon professeur, un excentrique passionné, excellent pédagogue. Cela remonte à longtemps, vingt-cinq ans pour être précis, bien avant que j’aie la chance de faire mon premier voyage en France. Avant ça, je n’avais tout simplement pas assez d’argent. Et là, je suis de nouveau tombé amoureux de Paris. Mais l’amour est quelque chose d’étrange. On peut être amoureux, certes, mais l’amour véritable ne s’épanouit vraiment que lorsqu’il est payé de retour. Et cela s’est produit lorsque j’ai été publié pour la première fois en France, en 2001, et que les lecteurs ont commencé à s’intéresser à mes livres. Je ne saurais vous dire pourquoi j’aime la France. Je l’aime, c’est tout. Comme écrivain autant que comme personne. Mais je ne peux pas nier que la cuisine française y est pour quelque chose ! Pourquoi situer un livre en France ? J’ai tendance à écrire sur ce qui me passionne. Je crois que l’on écrit mieux quand on écrit par passion, que l’on est émotionnellement impliqué.
En parlant de cuisine, quelle est votre recette pour écrire un livre ?
D. M - Sincèrement, au départ, je ne me demande pas quel genre de livre je vais écrire. Je n’ai qu’une idée en tête, raconter une histoire qui va (du moins je l’espère) être captivante et gratifiante. En réalité, j’essaie d’écrire le genre d’histoire que j’aimerais lire. Et je soupçonne fortement la plupart des écrivains d’être comme moi. À mon avis, la seule « recette » pour un livre quel qu’il soit, est d’écrire l’histoire avec autant d’honnêteté et de passion qu’il est possible, et de croiser les doigts pour que ça marche !
Votre précédent roman, L’Année du lion (Points), se déroule alors qu’une pandémie a tué 95% de la population mondiale. Qu’avez-vous ressenti ?
D. M - Je suis passé par toute une gamme d’émotions quand la Covid-19 a frappé. De l’effarement de voir ma fiction devenir réalité, à l’horreur de constater que des êtres humains souffraient et mouraient pour de vrai, que des économies étaient détruites et que la réalité était d’une dureté et d’une cruauté que vous ne trouverez jamais dans une œuvre de fiction. Oui, la fiction est souvent le miroir de la réalité — en particulier dans le polar —, mais c’est surtout parce que de nombreux auteurs s’inspirent de la réalité pour écrire. Si vous voulez que le livre soit proche de l’actualité, qu’il reflète la réalité, vous enquêtez auprès de la police, vous lisez les gros titres des journaux et il est presque inévitable que d’une manière ou d’une autre, il finisse par être le miroir de la réalité. Mais ce n’est pas forcément intentionnel.
À bord du train le plus luxueux du monde, le Rovos, entre Le Cap et Pretoria, un passager assurant la protection privée d’une vieille dame richissime est tué et jeté par la portière. Benny Griessel et son collègue Vaughn Cupido, de la brigade des « Hawks », se retrouvent en charge de l’enquête. Rapidement, ils se heurtent à des intérêts qui vont les dépasser. Très très loin de là, à Bordeaux, Daniel Darret, ancien de l’ANC, la cinquantaine bien avancée, a refait sa vie et travaille dans l’atelier d’un vieil ébéniste. Le passé va venir le rattraper. Sur des rails ou dans le vignoble bordelais et jusqu’à la Place de l’Étoile à Paris, l’auteur sait mener sa barque et nous entraîne dans un polar à trois cents à l’heure, sur fond de corruption, d’idéaux trahis et d’une enquête tortueuse à souhait. Le crime de l’African-Express pour le Meyer (trop facile) et pour le pire ! Une lecture nécessaire, humaine et politique, purement addictive !