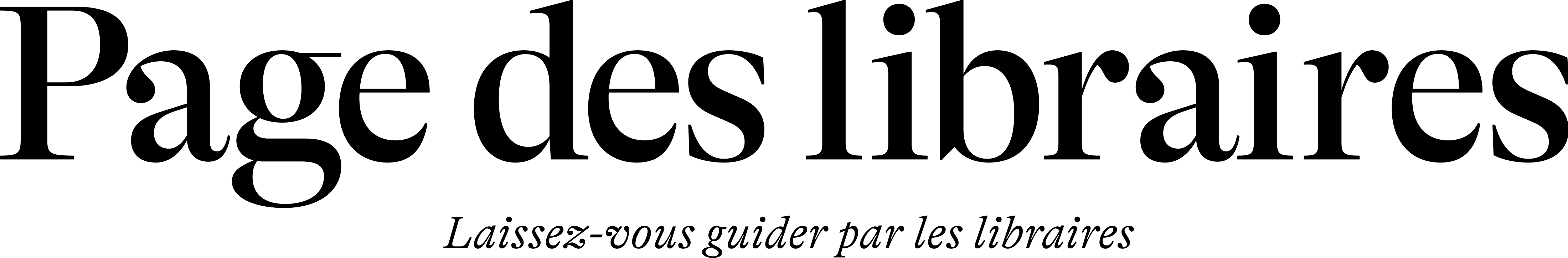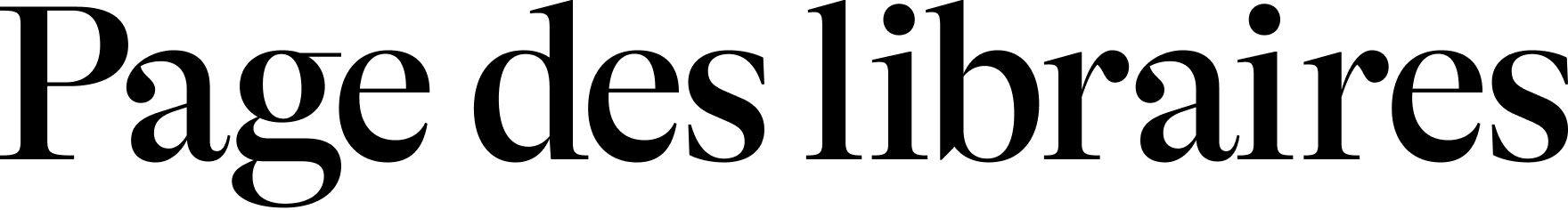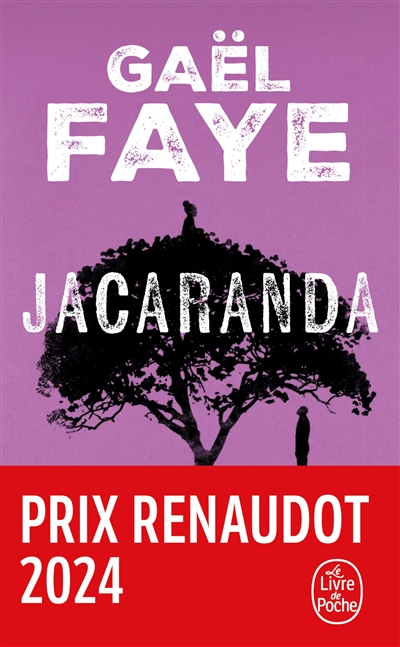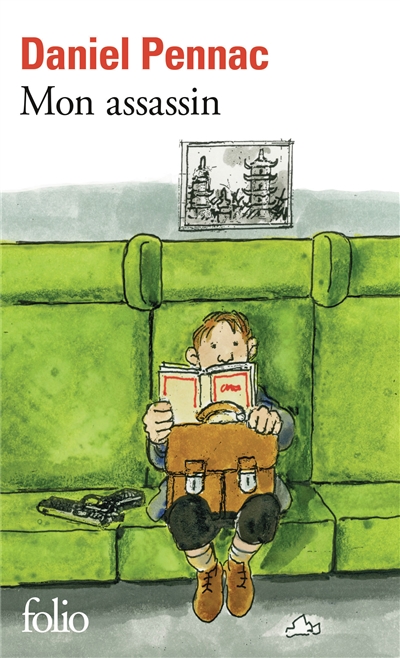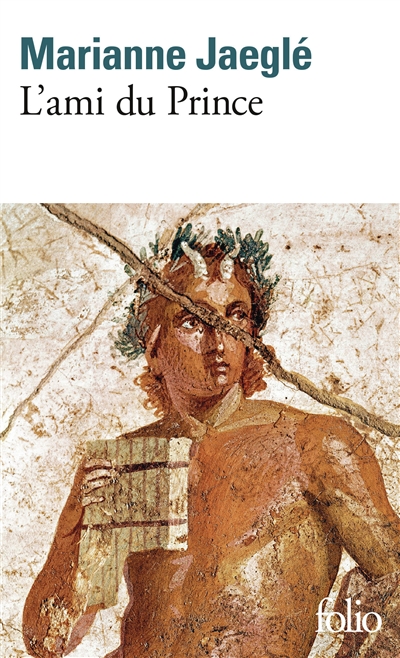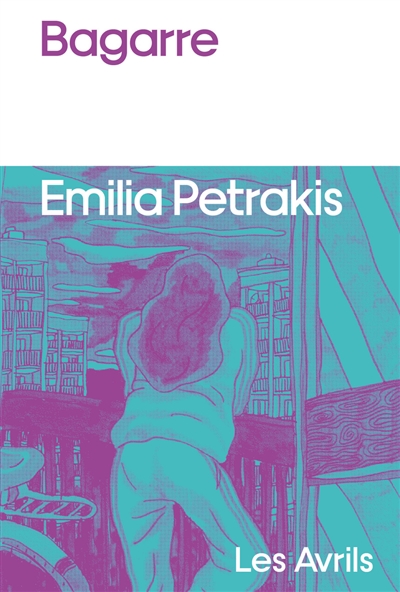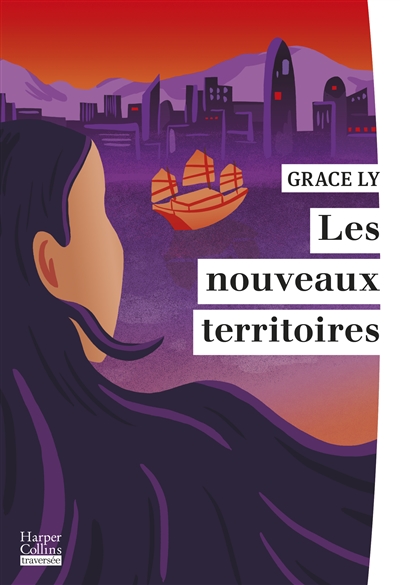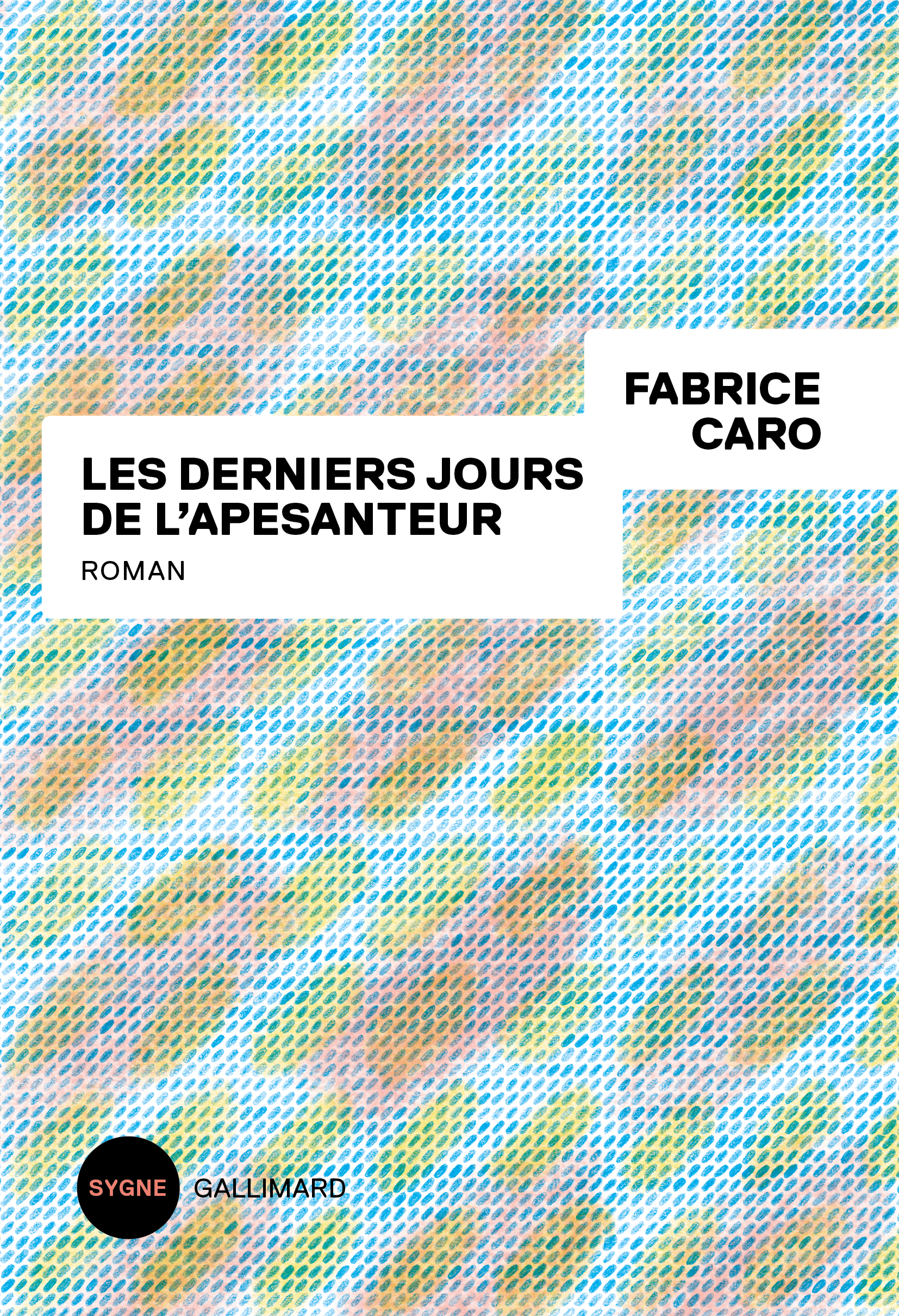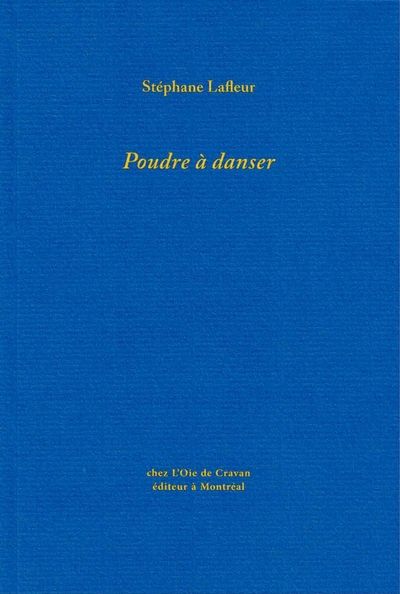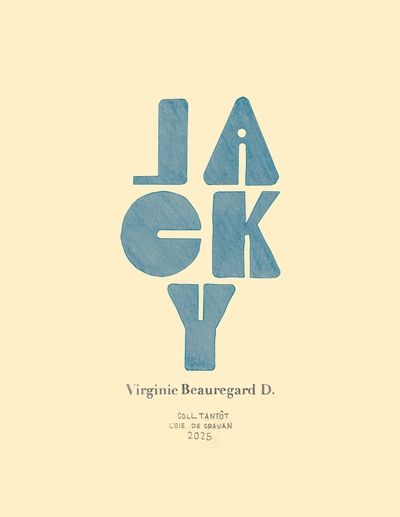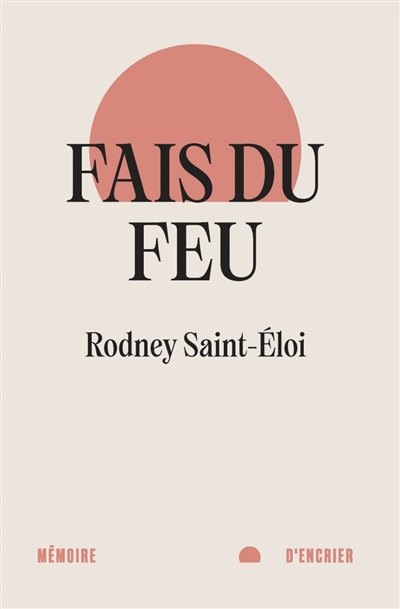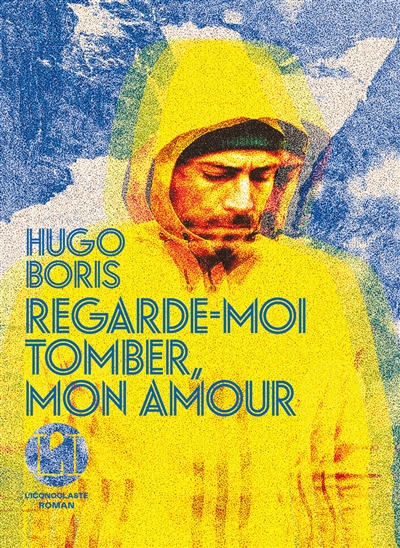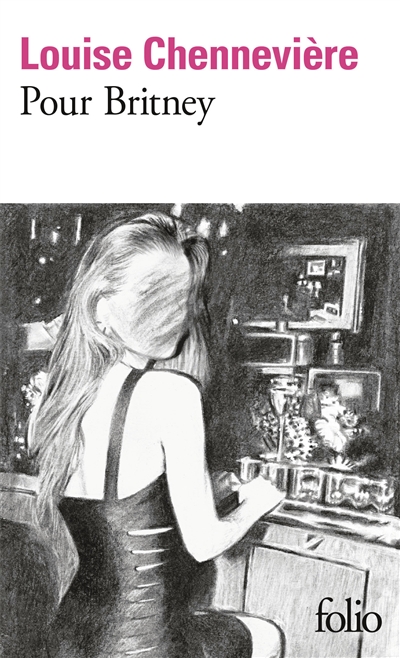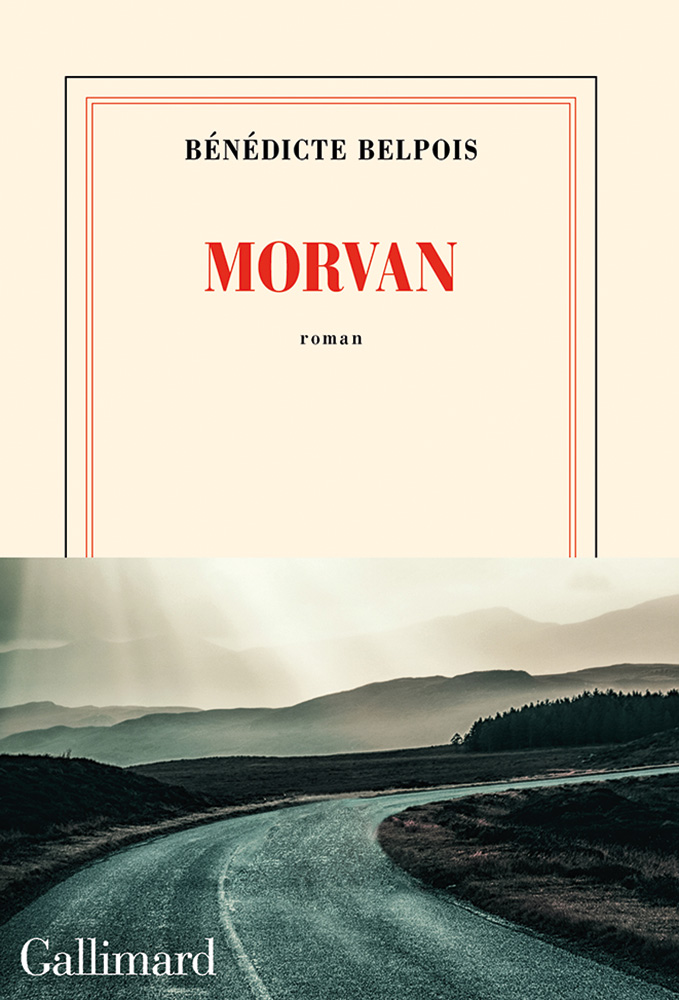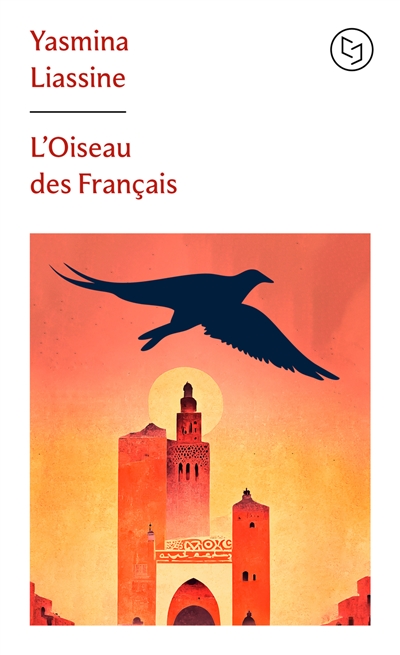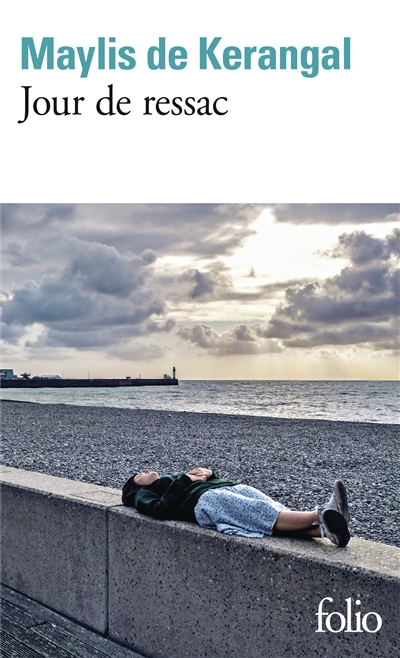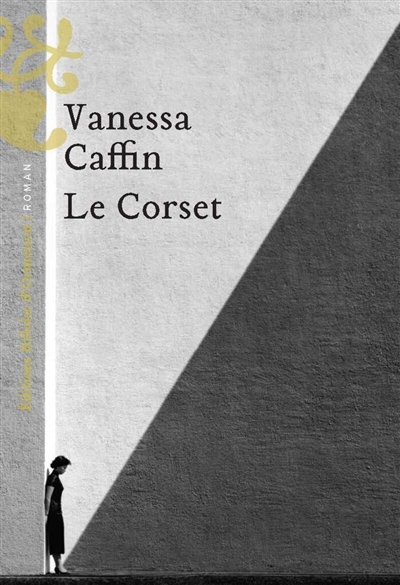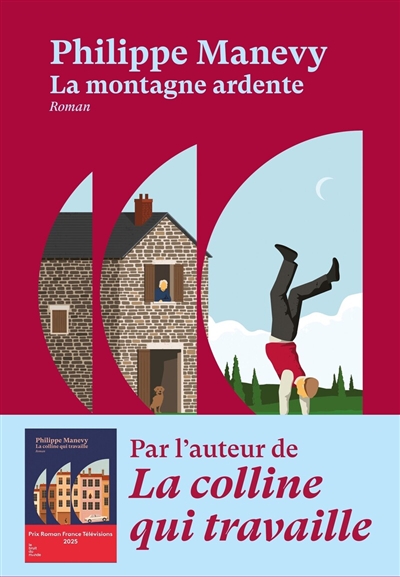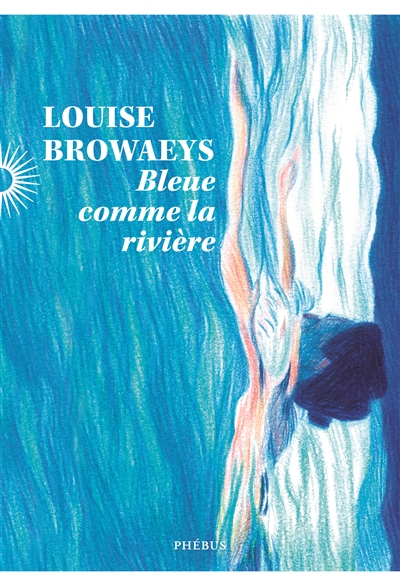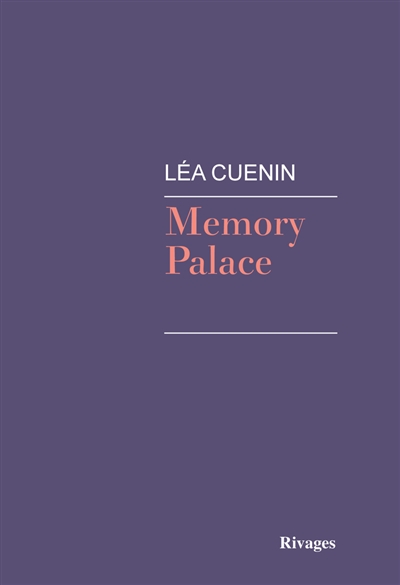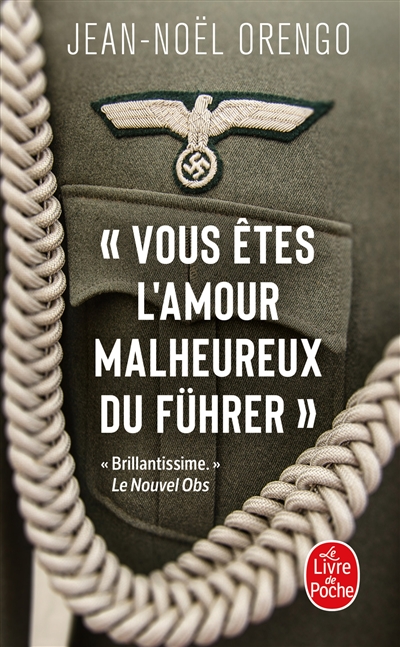Après le succès de Petit Pays, comment Jacaranda s'est-il imposé à vous ?
Gaël Faye – Dans tous les sujets, il y a toujours une forme de malentendu. Et Petit Pays n'a pas dérogé à la règle : on a beaucoup ramené ce roman au Rwanda alors que ce n'était pas mon sujet, je voulais parler du Burundi. Dans Petit Pays, le génocide des Tutsis au Rwanda arrivait comme une déflagration dans une famille du Burundi mais le propos central était d’évoquer ce qui s'était passé avant la violence, donc le paradis perdu, l'enfance. Jacaranda interroge plutôt ce qui se passe après la violence.
Est-ce justement pour cela que vous avez choisi de dérouler l'histoire sur un temps long, entre 1994 et 2020 ?
G. F. – Le temps long s'est imposé pour une raison qui me paraît centrale dans une société post-génocide. Il faut comprendre qu'un génocide n'est jamais une explosion subite de haine, c'est d'abord la construction d'une idéologie. Ça se fait progressivement, chaque génération portant des traumas liés à de la déshumanisation, de la discrimination, des persécutions, des exils forcés. Il m’importait beaucoup de faire comprendre ces mécanismes de façon organique. (Pour moi, un roman ne doit pas être didactique mais organique.) Jacaranda est un peu une discussion entre Rosalie, l’arrière-grand-mère issue d'une société pré-ethnique – l'ethnie a été importée au Rwanda – et la jeunesse d'aujourd'hui, les 60 % de Rwandais qui ont moins de 20 ans et qui constituent une société qui se veut post-ethnique. Leur discussion porte sur ce qui s'est passé entre ces deux générations.
Et comment avez-vous envisagé cette construction par ellipses temporelles, de cinq ans en cinq ans, qui donne à comprendre l'évolution des personnages en parallèle de l'évolution du pays ?
G. F. – Ces ellipses sont surtout liées à des périodes de l’histoire du Rwanda que je ne souligne pas dans le roman mais qui sont des marqueurs forts pour le pays : la dernière condamnation à mort, par exemple, mais aussi l'arrivée des premières gacaca – les juridictions populaires –, la réélection du président Kagame ou encore la dernière fois que des témoignages de survivants ont eu lieu au stade Amahoro, provoquant des crises de trauma collectives. Ces quelques repères temporels me semblaient très importants.
Peut-on dire que Jacaranda est un roman initiatique autour de la construction de l’identité complexe de Milan ?
G. F. – Effectivement, le narrateur est d’abord un enfant qui va grandir dans cette Histoire, essayer de la comprendre. Finalement, ce que le livre raconte, c'est le lien : le lien par le sang à l'intérieur d'une famille, le lien par l'amitié, le lien aussi par le sang entre les bourreaux et les victimes, dans cette société où on est obligé de côtoyer son voisin parce que le Rwanda est un espace minuscule. Les anciens bourreaux et les anciennes victimes ont dû faire avec cette contrainte-là : refonder une société à l'endroit même où s'était déroulé ce « génocide de proximité » (le bourreau et la victime se connaissant). Je crois que seul un roman peut tenter d'approcher la complexité d’une telle tragédie. C'est bien entendu un roman de mémoire. La mémoire, c'est la garantie de laisser une trace dans notre histoire collective permettant de rapidement reconnaître la résurgence d'idéologies dévastatrices.
Que représente le jacaranda qui est devenu le titre du roman ?
G. F. – C'est la question de la nature niée. Lorsque je suis arrivé au Rwanda, après le génocide, le pays était très silencieux, ce qui était assez troublant. Il restait la nature, l'odeur de la mort et les quelques survivants qui ressemblaient à des êtres humains égarés. Le jacaranda, c'est le témoin silencieux, invisible de l'Histoire. Mais ce sont aussi ses fleurs mauves qui renaissent très souvent dans l'année. Il y a un lien entre les racines et les fleurs. Et ce qui est là, dans la terre, ce sont aussi les disparus des familles. L'arbre, dans les cultures africaines, représente symboliquement une figure tutélaire, protectrice, qui porte la mémoire des anciens. C’est un lien entre le visible et l'invisible. Le jacaranda est aussi un prisme au travers duquel raconter le Rwanda d'aujourd'hui : ces grands arbres qui ont vécu toute l’histoire d’un peuple sont tronçonnés, découpés au nom du profit, pour construire un nouvel immeuble ou un parking. Quand les anciens ne sont plus là, un arbre, c'est parfois tout ce qu’il reste de ce passé englouti. Leur destruction est une violence terrible pour les vivants mais on n’en parle jamais dans la société rwandaise. Jacaranda, c'est une adresse à la jeunesse, celle du monde, mais aussi, bien sûr, à la jeunesse rwandaise, qui a la charge de devoir vivre dans une société qui se reconstruit sur un tel événement.
Milan a 12 ans quand, en 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda fait irruption sur l’écran de la télévision familiale. Le Rwanda, pays de sa mère, dont il ne sait rien. Il n’en saura pas plus quand un jeune Rwandais, Claude, débarque dans sa vie et lui devient presque un frère. Il faudra la blessure de l’arrachement, toujours dans le silence, pour que Milan affirme son désir de savoir et de comprendre. Au fil de ses séjours au Rwanda, il découvre et s’immerge dans une culture et une histoire qu’il fait siennes et tente de contourner les silences pour apaiser les blessures. En seulement deux romans, à travers des histoires brossées avec sensibilité et intelligence, Gaël Faye s’est installé sur les tables des librairies et dans le cœur des lecteurs.