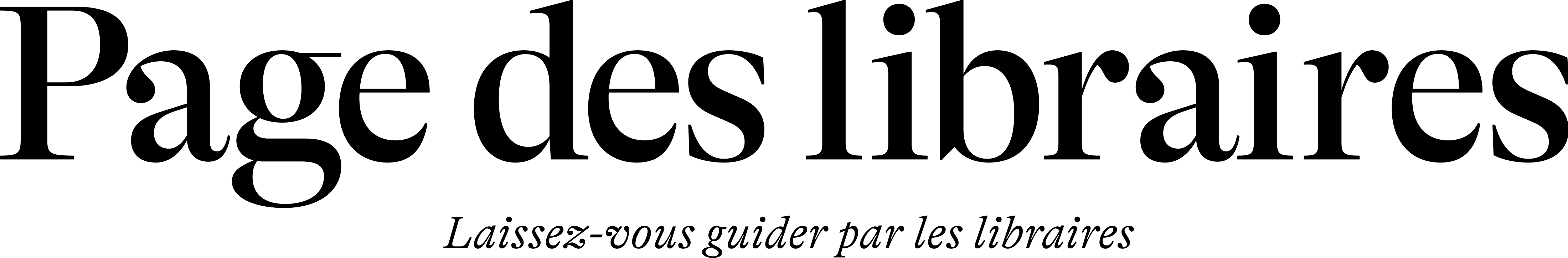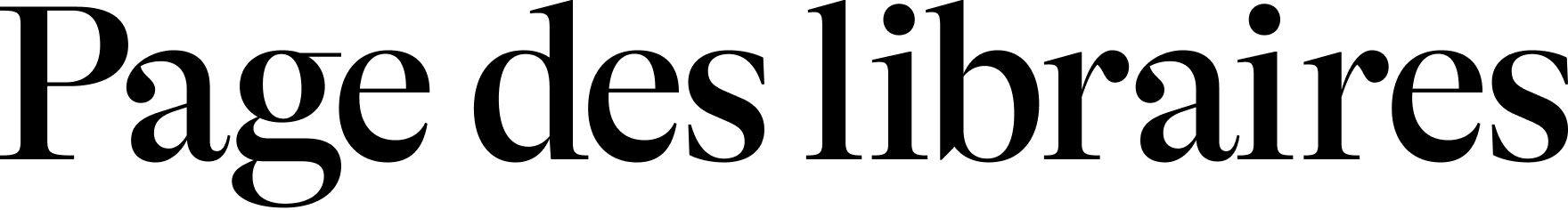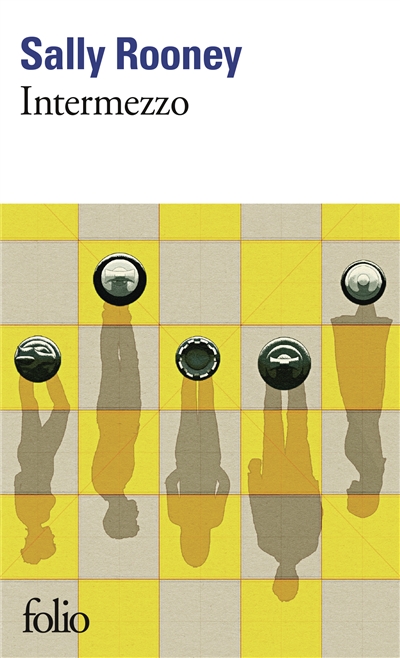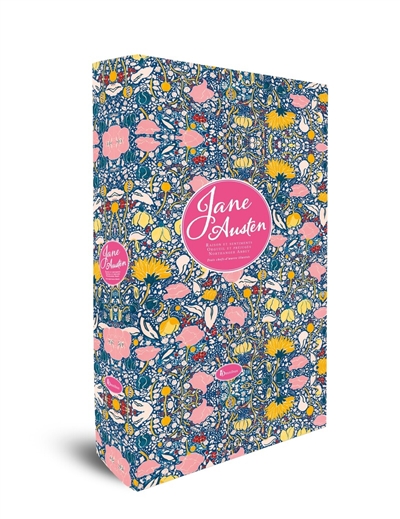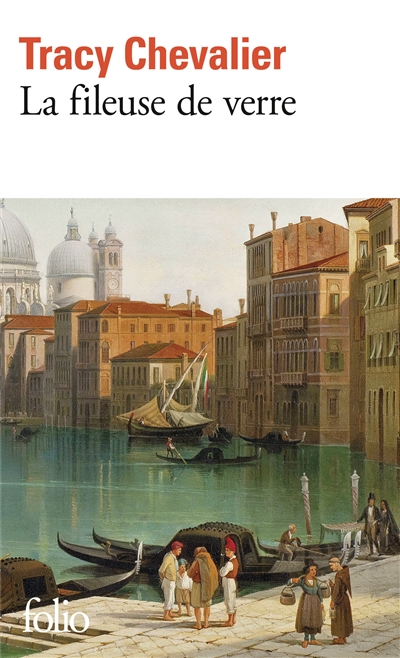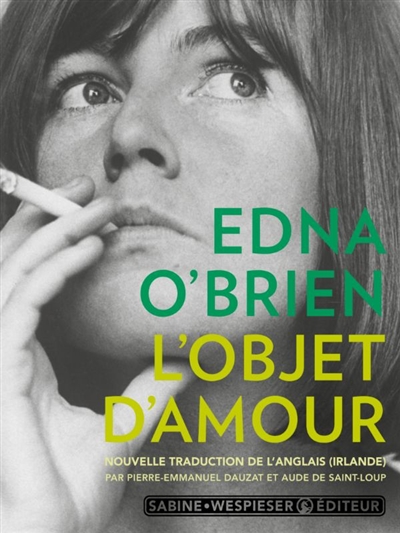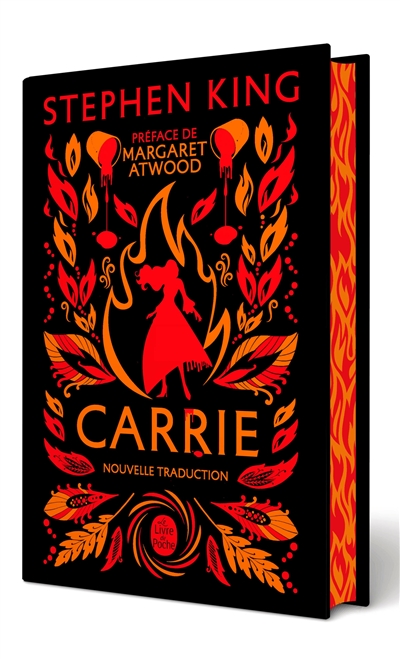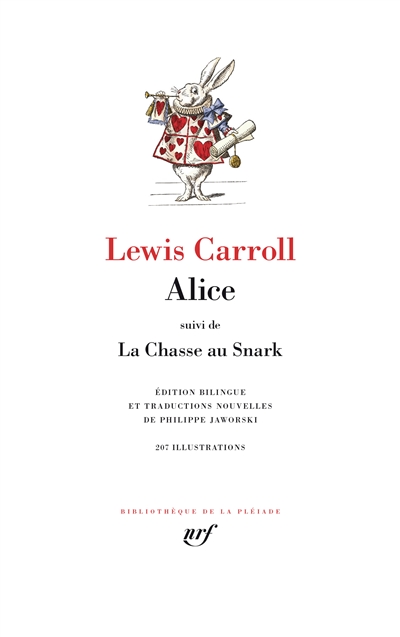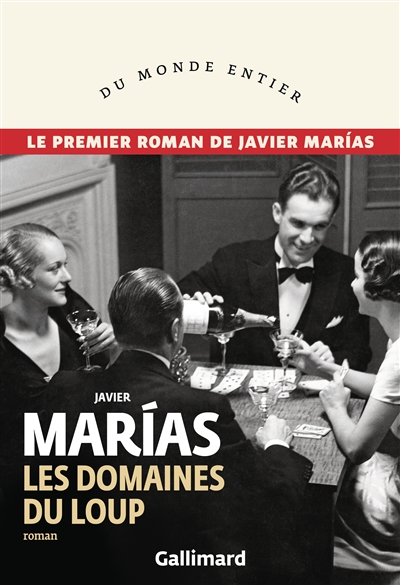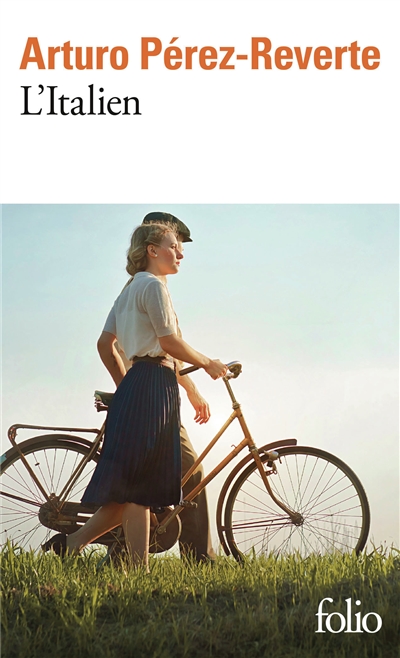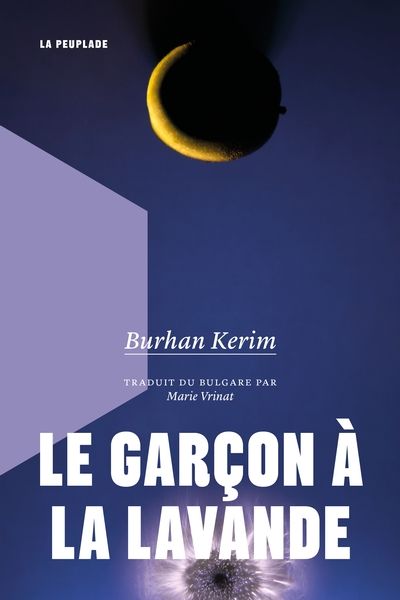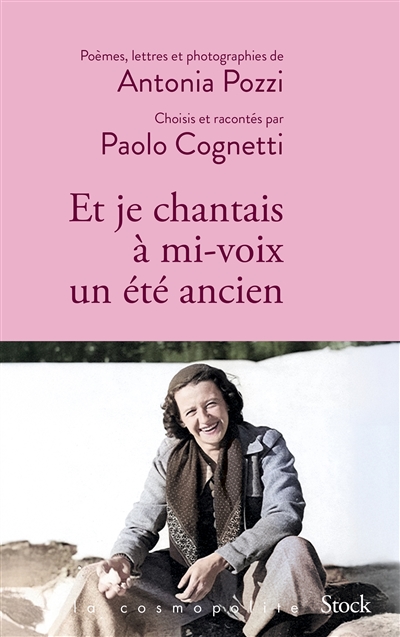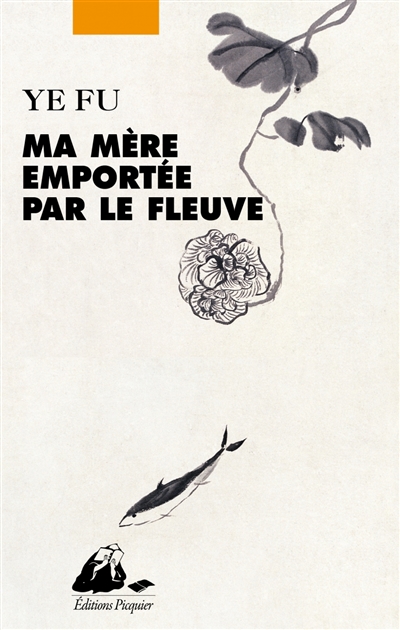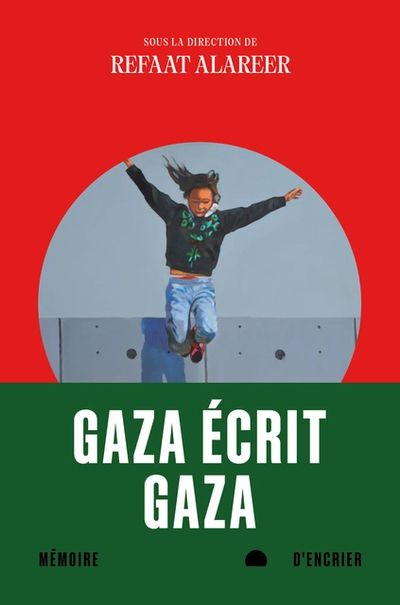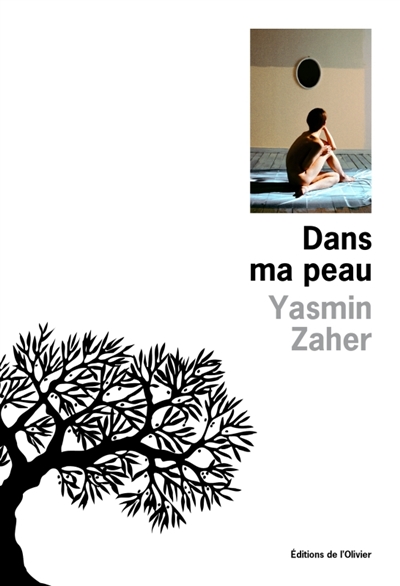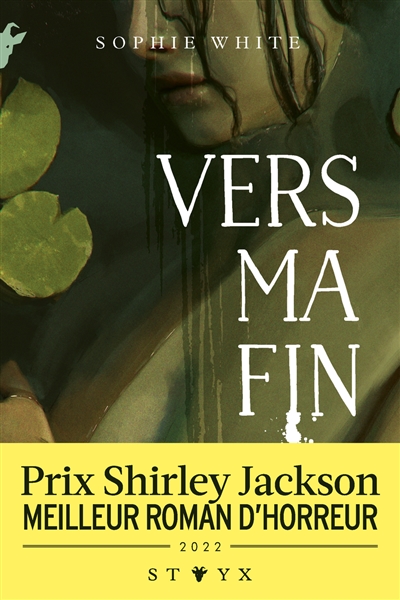Comment choisissez-vous vos personnages ? Comment les construisez-vous ? Et dans Intermezzo, comment sont nés Peter et Ivan ?
Sally Rooney Une chose est certaine, je ne m’inspire jamais de mon entourage pour créer mes personnages – je ne saurais même pas comment procéder ! Et je ne m’inspire jamais non plus sciemment de moi-même, même s’il me paraît assez inévitable qu’ils aient tous quelques points communs avec leur créatrice. Je n’ai pas l’impression de passer par un processus conscient de « choix » de mes personnages. Si j’ai de la chance, ils arrivent entièrement constitués dans ma tête, déjà liés les uns aux autres par des petits scénarios. Une fois que j’ai le germe d’un personnage et d’une scène, je prends le temps de réfléchir à ce qui définit leurs dynamiques propres et ils se clarifient alors dans mon esprit. J’ai toujours beaucoup d’affection pour mes personnages. Dans le processus d’écriture d’un roman, ils finissent par devenir comme des amis, des proches. Bien sûr, j’ai conscience que c’est une illusion – mes personnages ne sont pas réels mais bien fictionnels. J’en suis venue à accepter que cette illusion a une raison d’être car si je n’étais pas soucieuse de protéger mes personnages et de leur faire honneur, je suis certaine que je ne pourrais tout simplement pas écrire de romans. Ivan et Margaret sont vraiment les deux premiers personnages auxquels j’ai pensé lorsque je me suis mise à écrire ce qui deviendrait Intermezzo. J’ai d’abord écrit uniquement du point de vue de Margaret, y compris de nombreux passages qui sont aujourd’hui dans le roman. Mais j’ai fini par avoir un blocage et n’arrivais plus à avancer dans l’écriture. Je me suis alors dit qu’Ivan pouvait tout à fait avoir un grand frère – et Peter, Sylvia et Naomi me sont tout de suite apparus très clairement, pratiquement à ce même instant.
Dans Intermezzo, Ivan est féru d’échecs. Pourquoi ce jeu-ci ? Que permet, en termes romanesque, le jeu d’échecs ? Est-ce un jeu qui vous est familier ?
S. R. En réalité, je ne joue pas aux échecs ! Donc j’ai dû faire beaucoup de recherches pour ces parties du livre. Je voulais composer avec Ivan le portrait le plus crédible possible d’un joueur d’échecs très investi, à l’esprit de compétition. Je ne saurais dire exactement pourquoi j’ai « choisi » les échecs – dès qu’Ivan m’est apparu, c’était déjà un joueur d’échecs. La première image du roman qui m’est venue est celle d’Ivan en train de jouer une partie simultanée en démonstration, avec Margaret dans le public. J’imagine que les échecs m’intéressent. Je les trouve même assez glamour. J’ai commencé à me pencher sur la culture et l’histoire des échecs pendant la pandémie, donc ça s’est probablement logé dans mon cerveau à ce moment-là. Et je suis souvent très attirée par l’écriture de personnages qui ont de grandes passions dans la vie, peut-être parce que ma relation à mon travail est elle-même assez intense. Plus j’écrivais à propos d’Ivan, plus je voyais des similitudes entre sa relation aux échecs et ma relation à l’écriture. Alors peut-être que cela m’a permis de trouver une approche différente à certaines questions de créativité ou d’art. D’un point de vue culturel, je pense qu’on ne perçoit pas de la même manière la figure du joueur d’échecs obsessionnel et celle de l’artiste obsessionnel. Mais les points communs sont très nombreux. C’est mon avis en tout cas.
Vous avez un style reconnaissable entre mille, une utilisation du style indirect notamment qui contribue à la musique de votre langue. Comment le travaillez-vous ?
S. R. Merci pour ces mots gentils. Je ne me suis jamais vue comme une styliste – je suis toujours, en premier lieu, très attachée aux dynamiques internes d’une scène ou d’une situation, et la langue peut m’apparaître plutôt comme secondaire. Mais petit à petit, je me rends compte que ceci est une autre de mes illusions. Après tout, comment « la langue » peut-elle être secondaire dans un roman – une forme dans laquelle le langage est littéralement tout ce qu’il y a ? En réalité, je suis obsédée par le rythme et la musicalité. J’ai parfois vu mes propres phrases légèrement mal citées – avec une simple virgule au mauvais endroit ou une seule syllabe changée – et une alarme s’est immédiatement déclenchée dans ma tête, non pas parce que le sens est erroné, mais parce que la musicalité a été détruite (à mon oreille). Bien sûr, les goûts sont subjectifs et je suis certaine que de nombreux lecteurs trouvent que ma prose manque de qualité mélodique. Mais pour moi, le rythme d’une phrase est absolument essentiel et on ne peut pas y toucher. Je souhaiterais de tout mon cœur pouvoir lire plus de traductions de mes ouvrages car j’adorerais savoir comment mes traducteurs, qui travaillent avec différentes ressources linguistiques, gèrent les aspects rythmiques de la prose. Quand j’ai lu la merveilleuse traduction d’Intermezzo de Laetitia Devaux, j’ai été stupéfaite de la manière dont elle avait magnifiquement saisi ce que je considère être les qualités mélodiques et les variations tonales du roman. Je m’estime très chanceuse que les traducteurs qui travaillent sur mes romans soient si doués.
Vous explorez dans Intermezzo des sujets qui vous sont chers, l’amour, l’amitié, les différences de classe, en y ajoutant ici les relations fraternelles. J’admire cette façon que vous avez d’écrire, à la façon d’un Modiano, toujours le même livre mais différemment. Est-ce une volonté forte de votre part ou le jeu de l’inconscient ?
S. R. Je crois que j’ai toujours la même intention quand j’écris un roman, celle de faire honneur aux personnages et à leurs situations. Bien sûr, les personnages sont à chaque fois différents – je n’avais jamais écrit sur Ivan, Peter, ou aucun des autres auparavant. Donc le roman se distinguait suffisamment de mes autres livres pour que je m’y intéresse, et pour que je sois excitée à l’idée de l’écrire.
La seule nouveauté dont j’ai vraiment besoin dans mon travail, c’est de parvenir à créer de nouveaux personnages et de nouvelles relations. Tant que je pourrai faire cela, j’écrirai des romans. Que les gens en aient un jour assez de les lire, je l’ignore ! Mais je continuerai probablement à les écrire. Je crois qu’il est vrai que les thèmes que vous mentionnez sont ceux qui me sont les plus chers. Une autre de mes ressources narratives qui persiste, et que j’ai remarquée récemment, c’est la crainte du ridicule. Presque tous mes personnages craignent de se ridiculiser. Et pourtant, les choses qui comptent le plus dans leur vie impliquent souvent au moins le risque de l’humiliation. Si mes personnages avaient moins peur de se sentir embarrassés, la plupart de mes romans seraient des nouvelles, ou n’existeraient pas du tout. (Je ne sais pas ce que ça révèle de moi.)
Est-ce que d’après vous, le roman peut changer le monde ?
S. R. Je ne crois pas avoir de théorie très convaincante à propos du rôle de l’art dans des périodes de grands bouleversements historiques. Ce qui est sûr, c’est que je refuse de tourner le dos aux réalités politiques dans mon travail. Mes personnages habitent un monde social et économique défini et subissent les pressions idéologiques propres à leur époque. En revanche, je n’écris pas mes romans pour essayer de persuader les gens d’adhérer à mon propre point de vue (socialiste). Bien que mes personnages se disputent souvent, y compris à propos de politique, les romans eux-mêmes ne sont pas structurés comme des raisonnements politiques. Pour moi, les œuvres d’art font partie des consolations qui donnent à la vie sa raison d’être. La vie est souvent difficile et douloureuse. Et je pense qu’un certain type d’expériences peut offrir comme un contrepoids à cette douleur – marcher dans la nature, partager des repas entre amis, écouter de la musique, ou lire. Dans ma vie, les romans ont été une source indispensable de consolation. Et si mes propres romans ont le pouvoir de consoler leurs lecteurs de temps en temps, cela peut sûrement me suffire.
À la mort de leur père, les relations entre Ivan et Peter prennent une nouvelle tournure. Un grand écart d'âge, des professions et modes de vie différents, leurs rapports à la famille les séparaient déjà. Ce décès et leurs relations amoureuses respectives vont creuser plus encore ce fossé déjà grand. Tout le talent de Sally Rooney réside dans sa façon de creuser inlassablement le sillon des relations humaines. Elle revient certes sur des thèmes qui lui sont chers, l'amour, l'amitié, la famille choisie, les différences de classe, en y ajoutant ici l'exploration des relations fraternelles, mais d'une façon toujours renouvelée. Ce faisant, elle démontre avec brio que décidément, le roman offre au lecteur un immense pouvoir de consolation dans un monde en plein bouleversement.