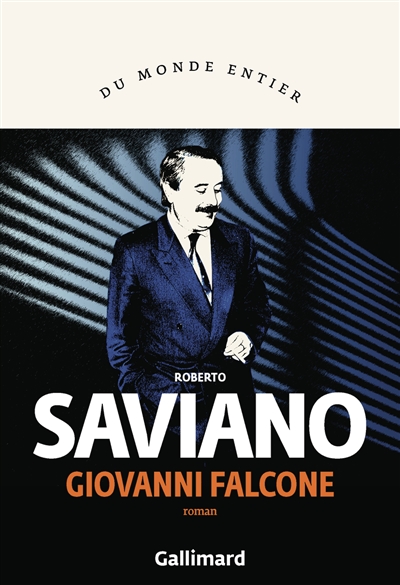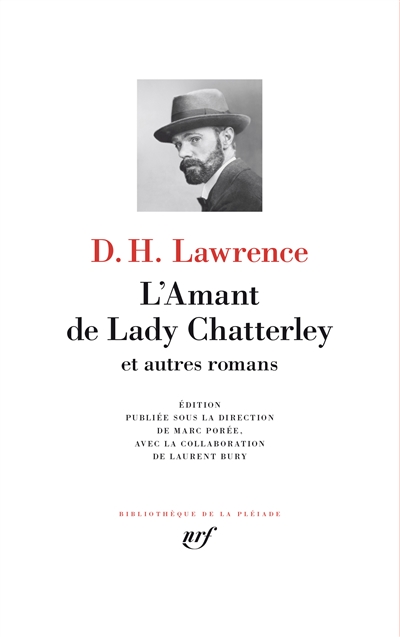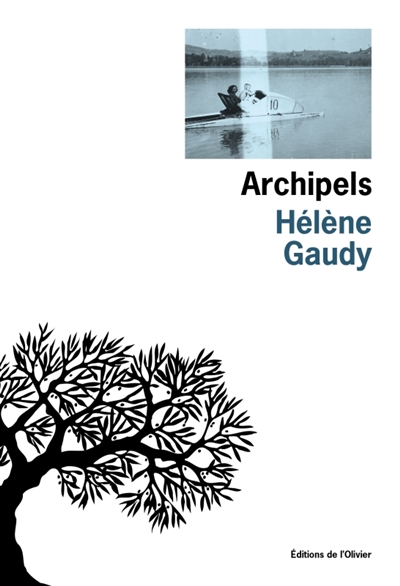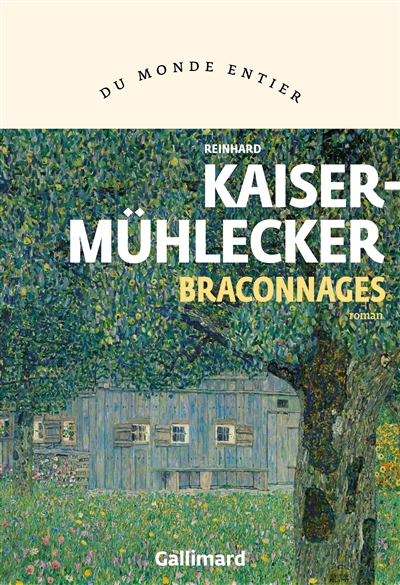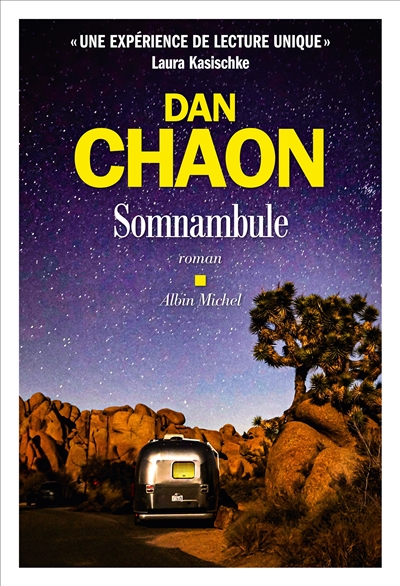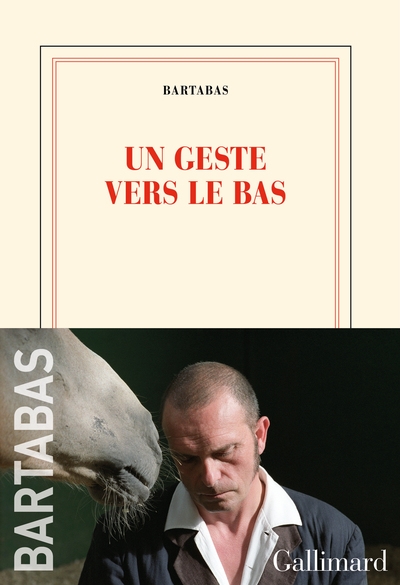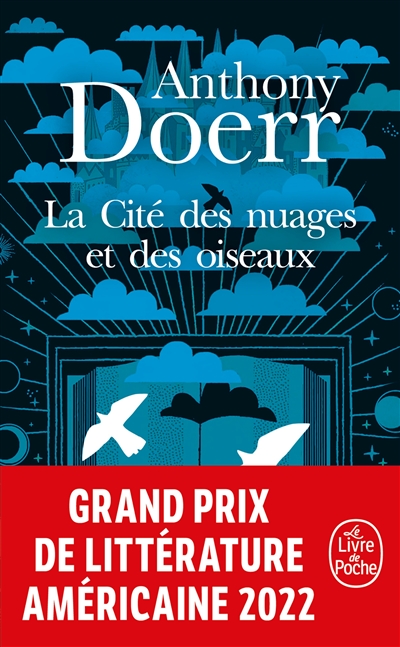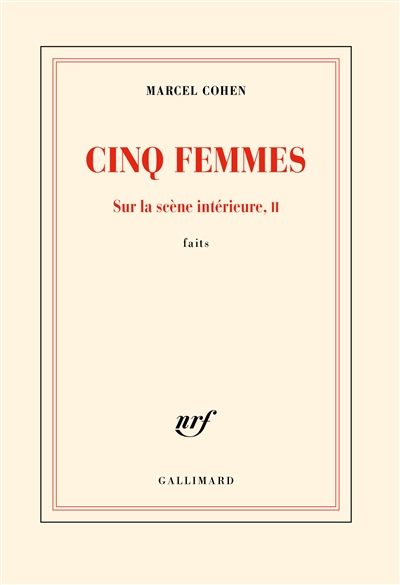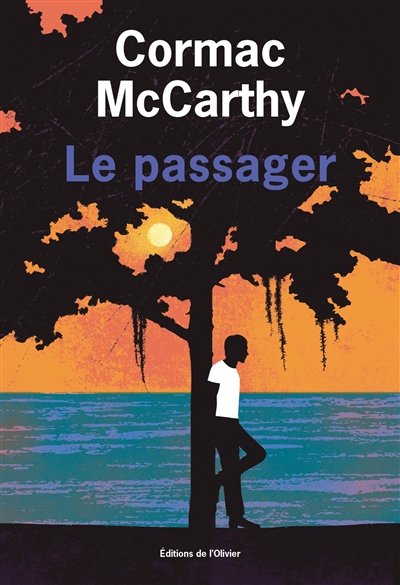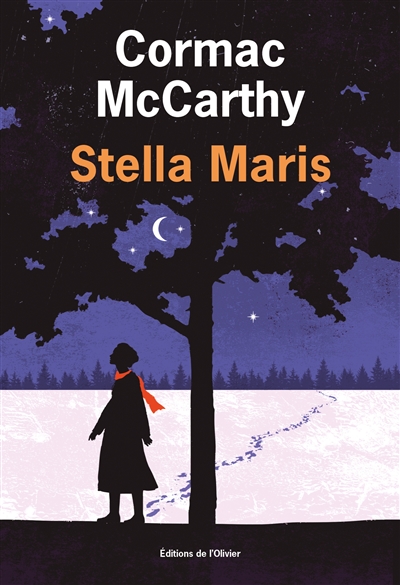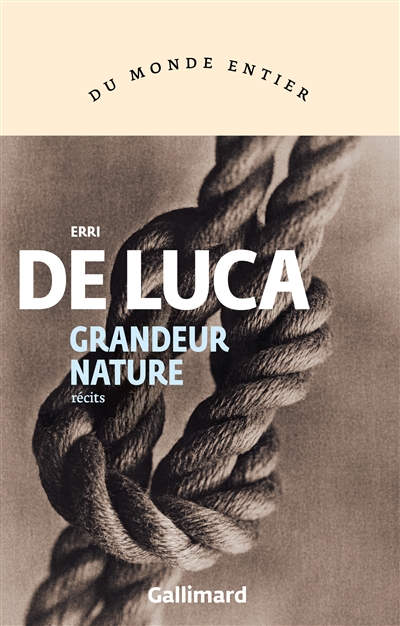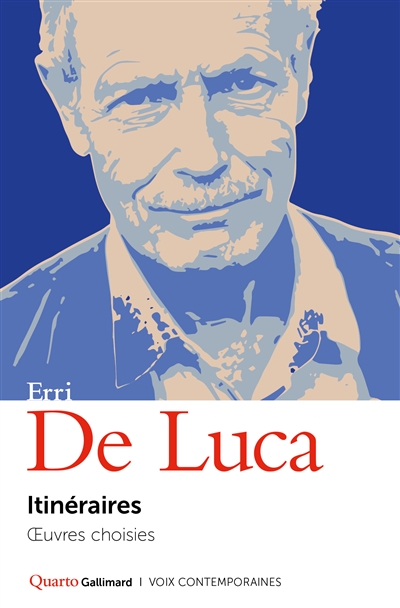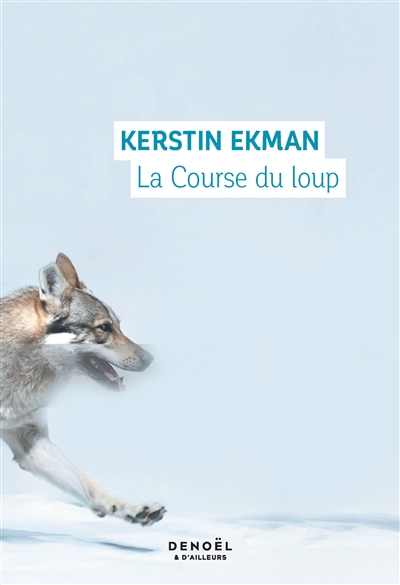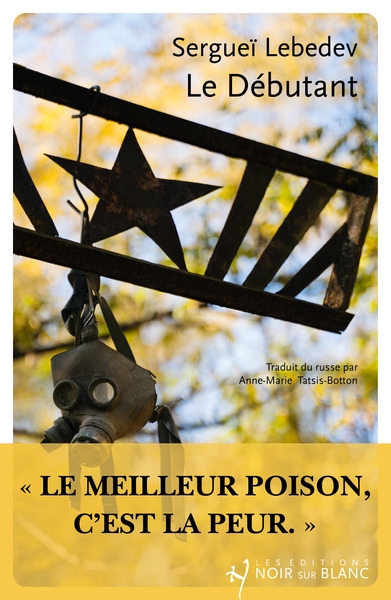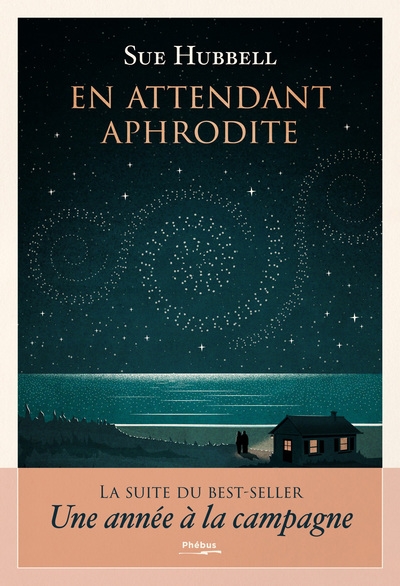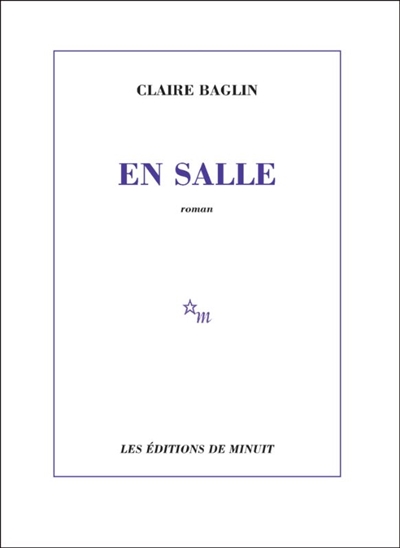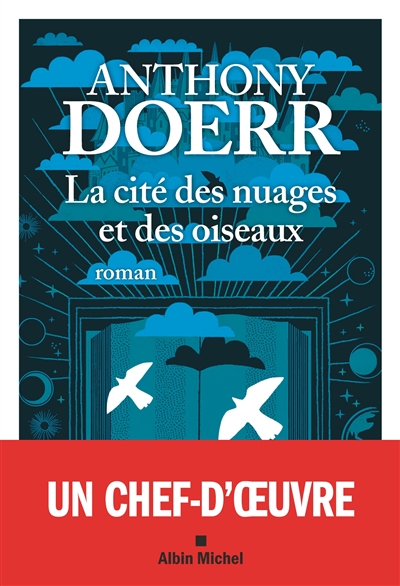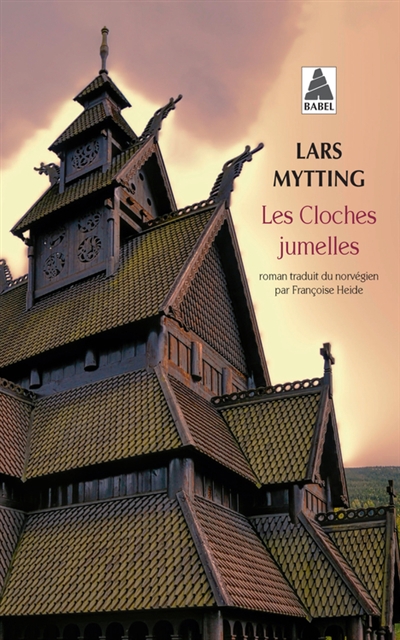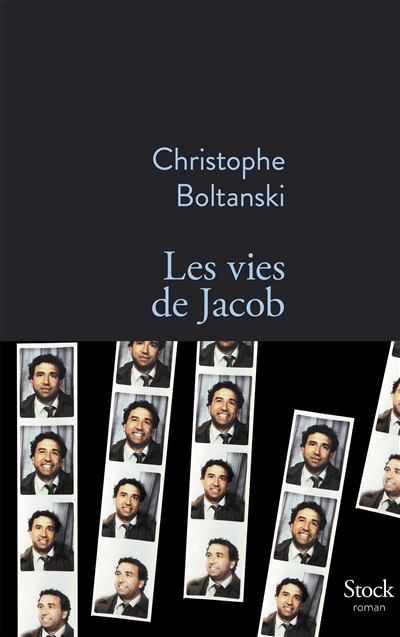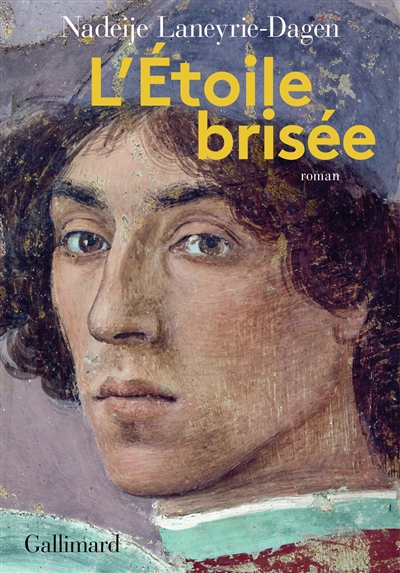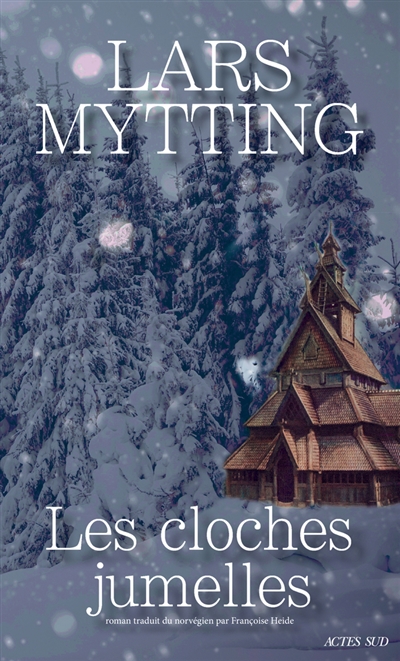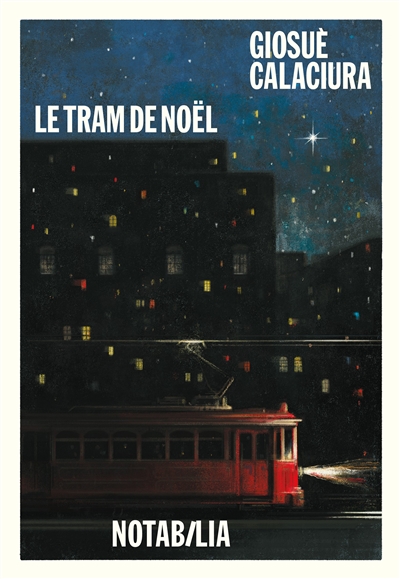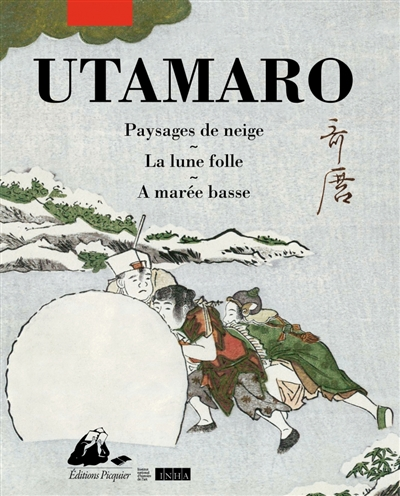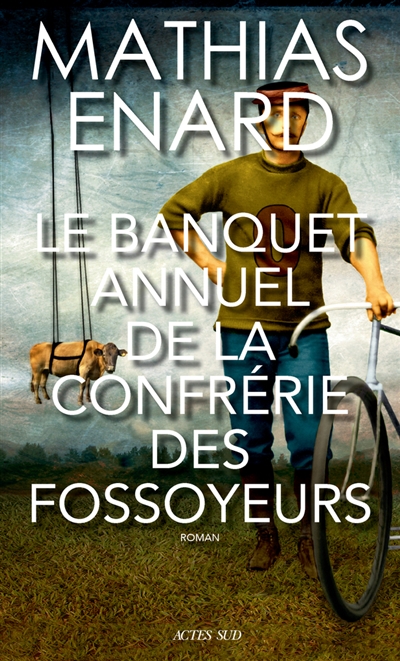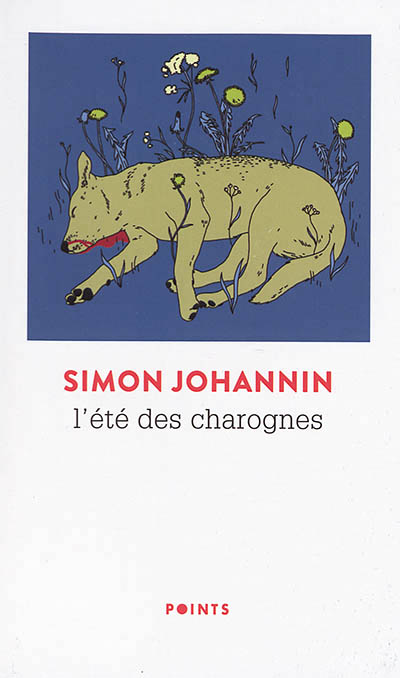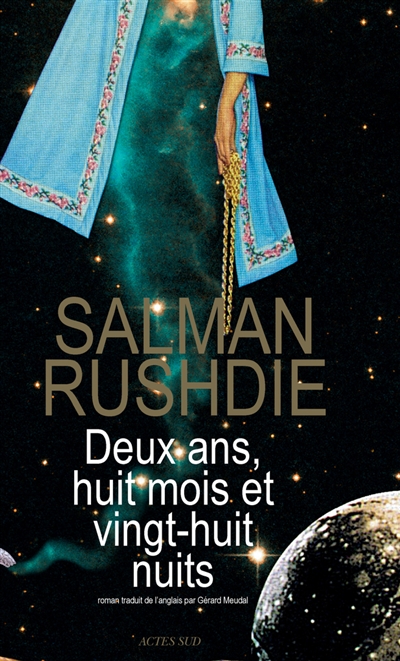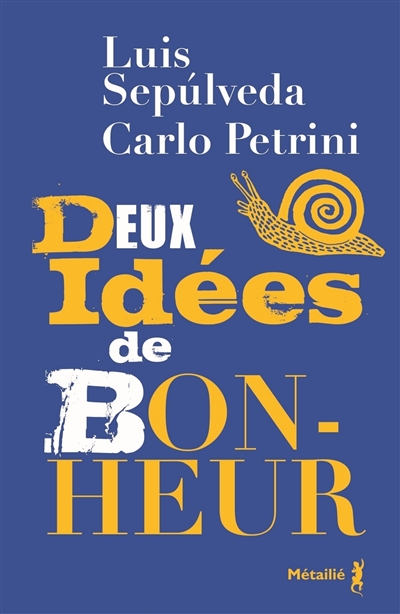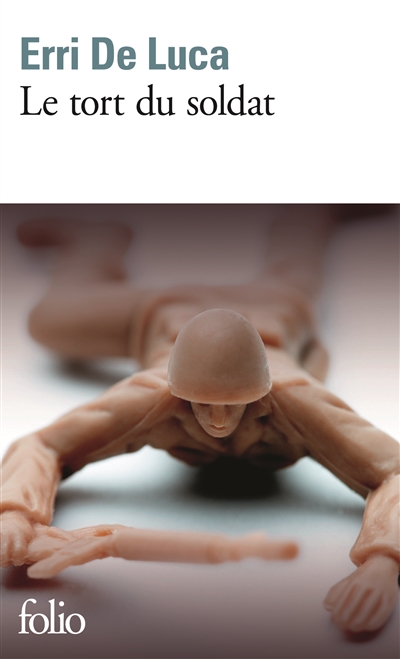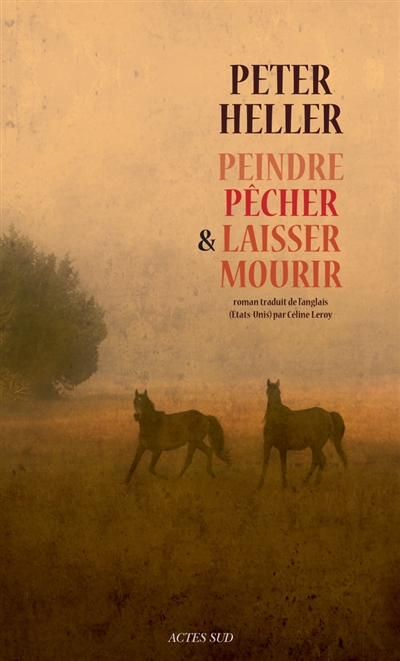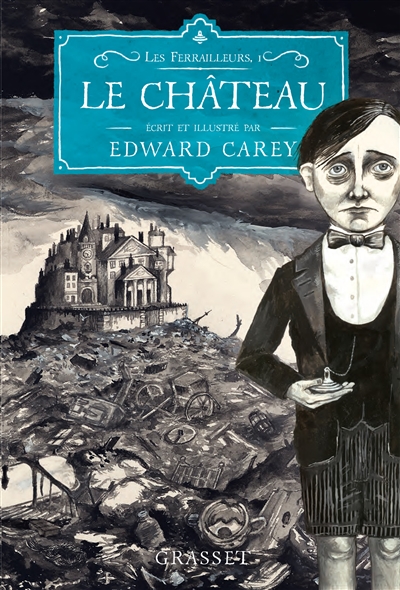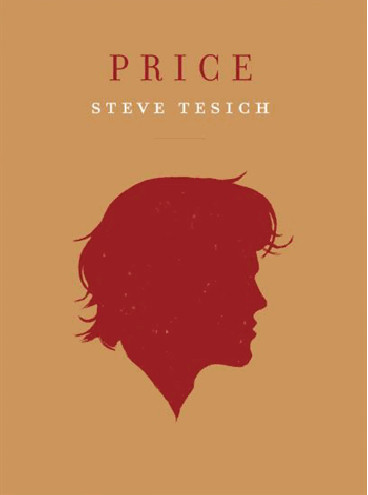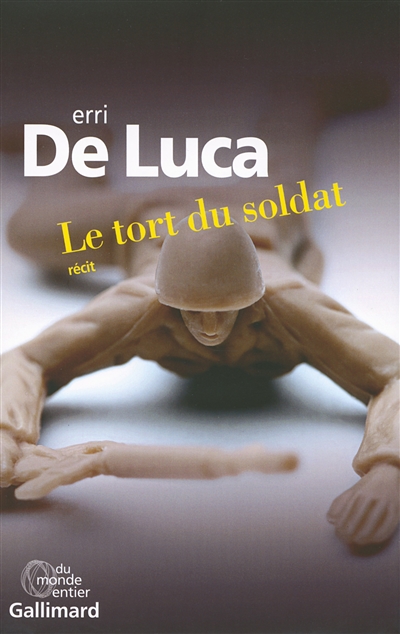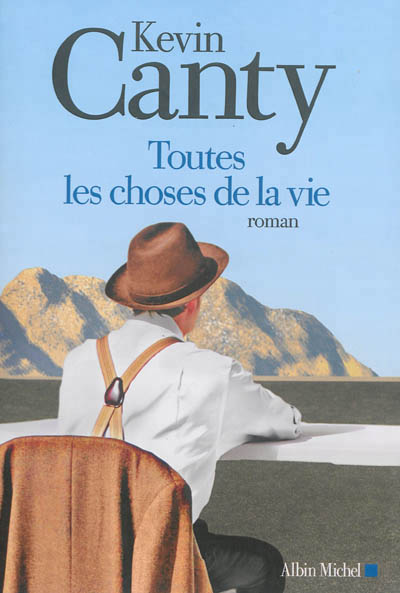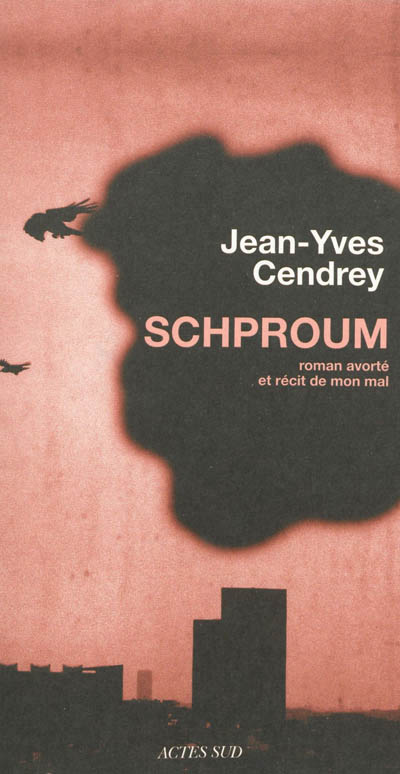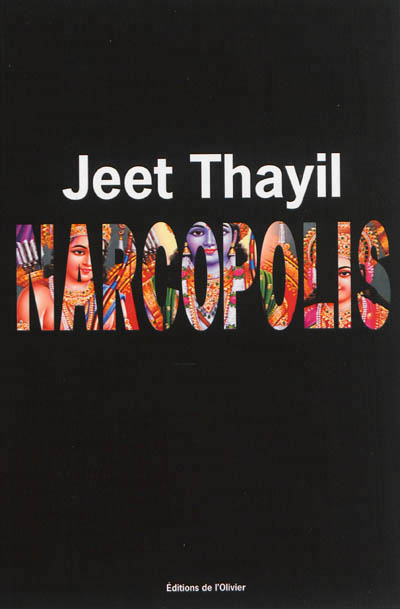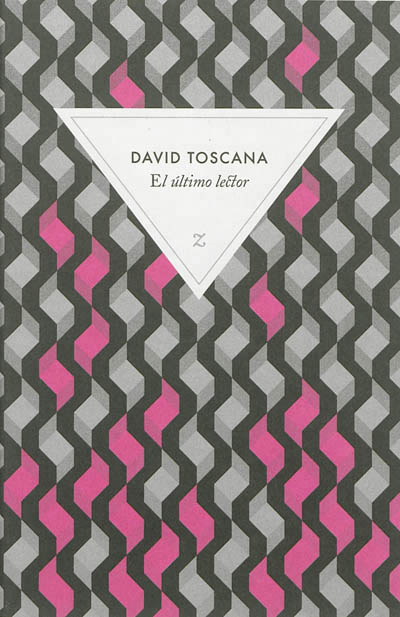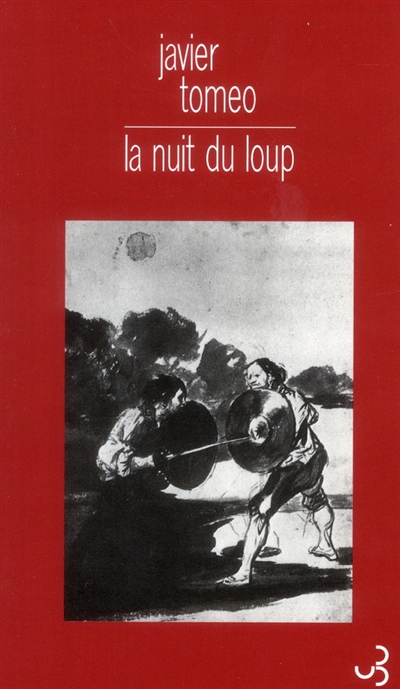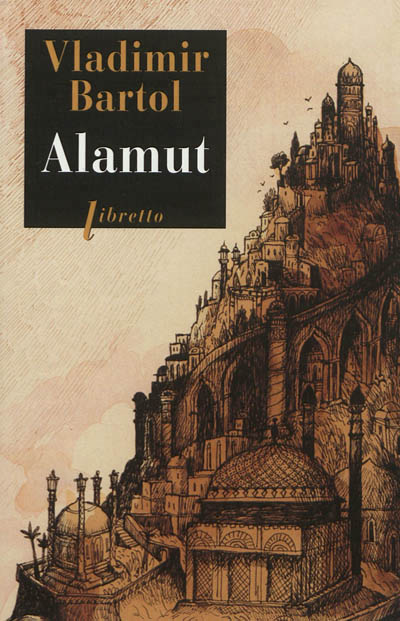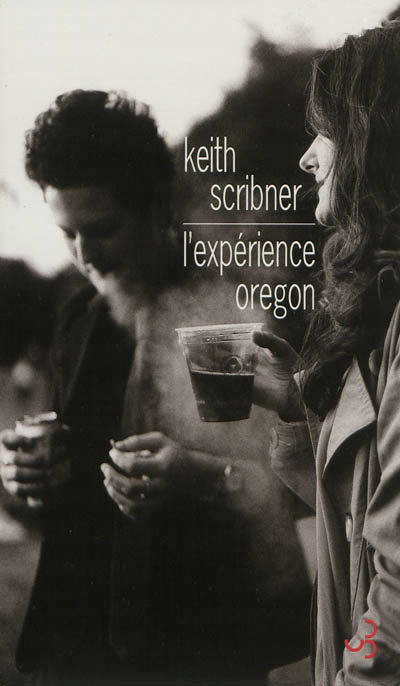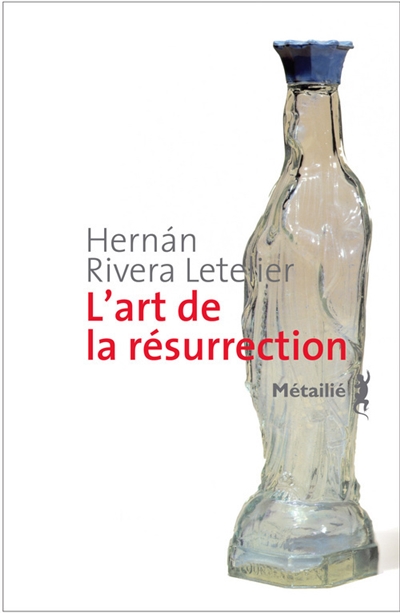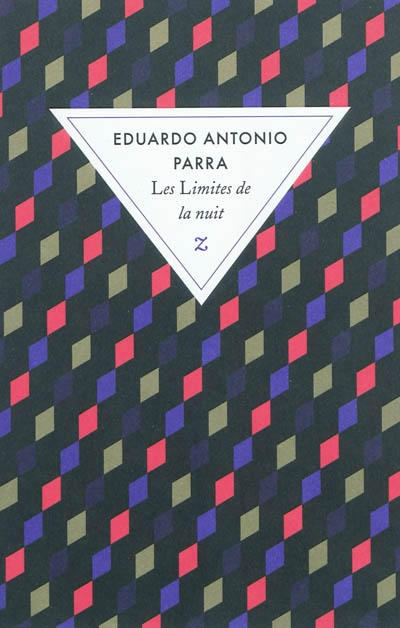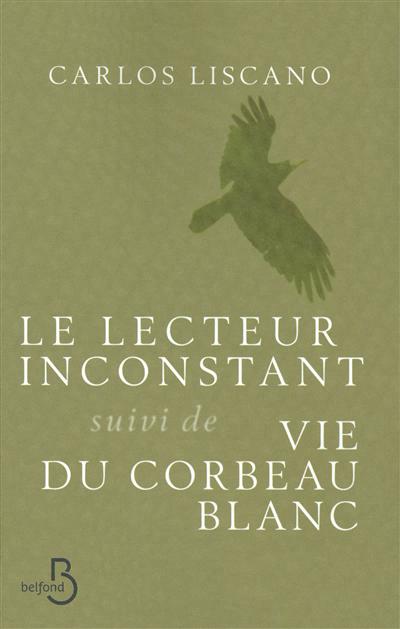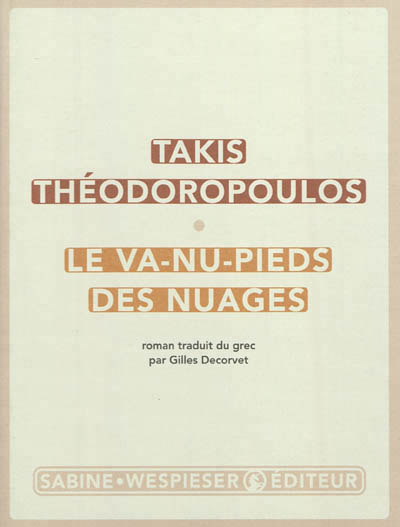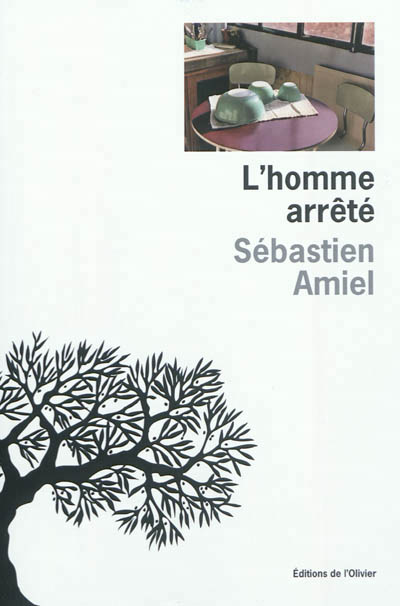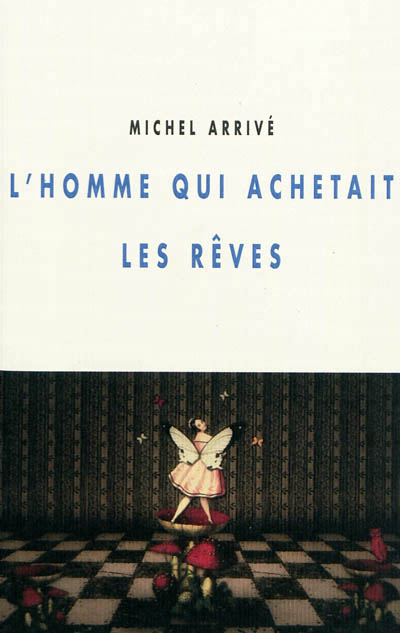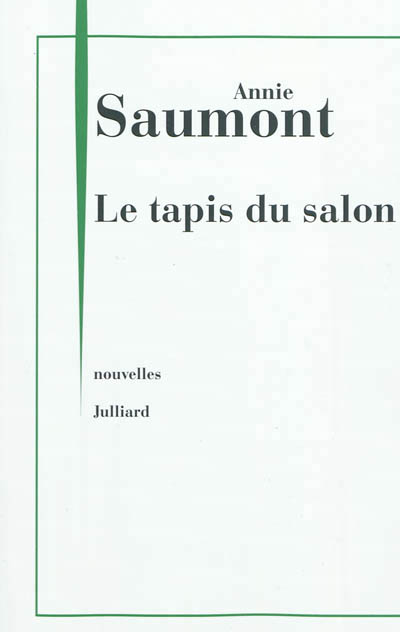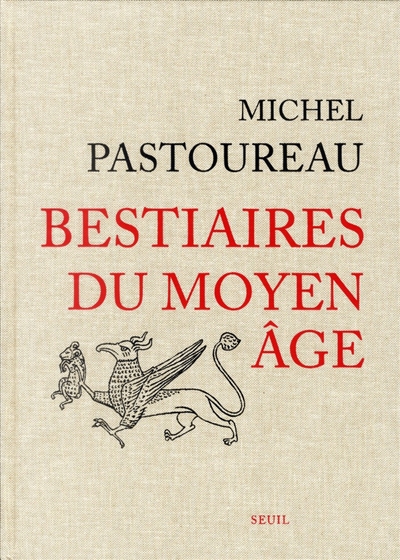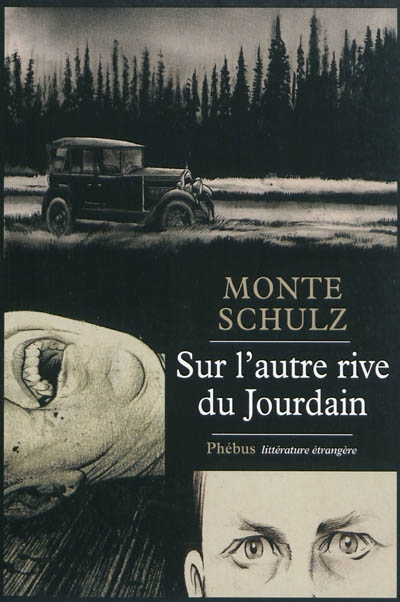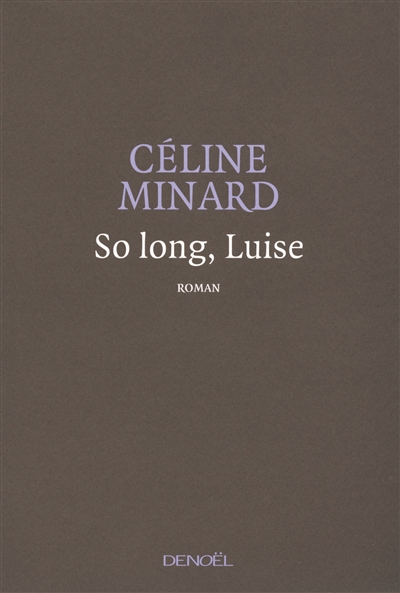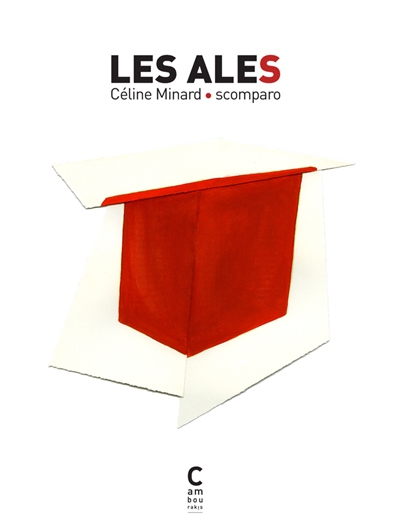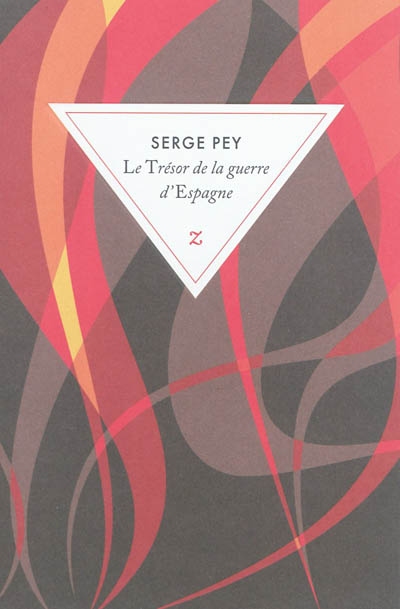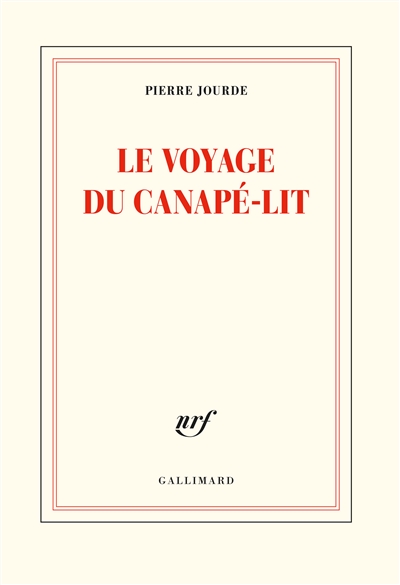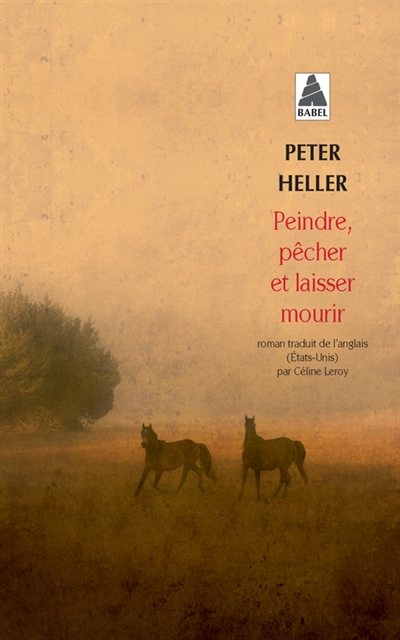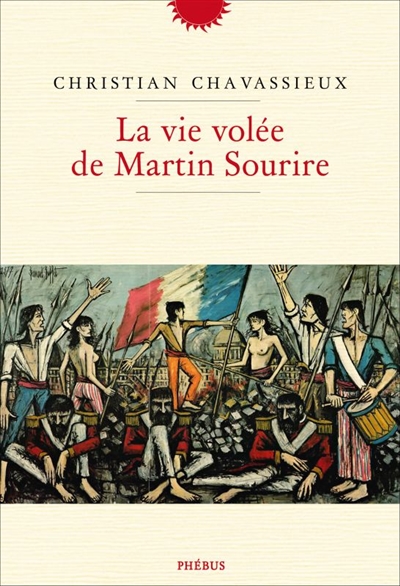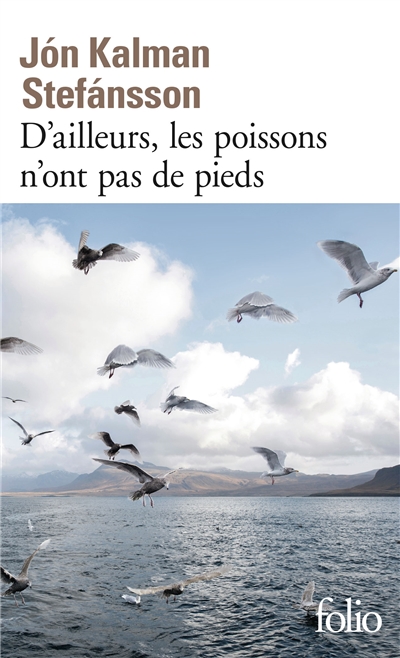Littérature étrangère
Edward Carey
L'Observatoire
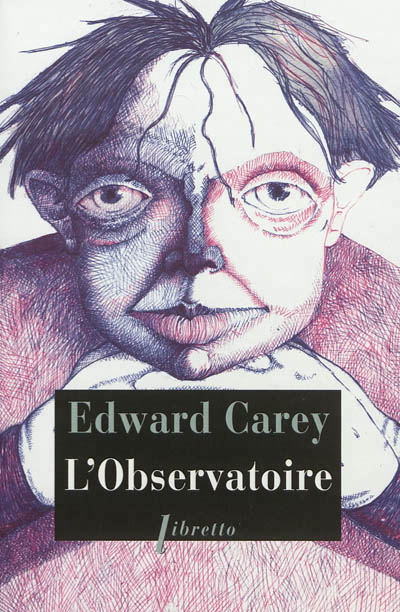
-
Edward Carey
L'Observatoire
Traduit de l'anglais par Muriel Goldrajch
Libretto
01/01/2005
400 pages, 10,80 €
-
Chronique de
Michel Edo
Librairie Lucioles (Vienne) -
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Daniel Berland
- Corinne Lucas de Litote en tête (Paris)

✒ Michel Edo
(Librairie Lucioles, Vienne)
Il en est de certains romans comme de ces fleurs du désert qui n’éclosent qu’une fois tous les dix ans, la nuit et pour une heure seulement. Les voir une fois suffit par leur rareté à en conserver pour toujours le souvenir vivant dans notre mémoire.
L ’Observatoire d’Edward Carey est de ces livres-là. Publié pour la première fois en 2002 chez Phébus, il semblait surgi de nulle part. On l’a légitimement comparé à Mervin Peake, associé son univers à celui de Carroll ou de Calvino, mais L’Observatoire n’appartient finalement qu’à lui-même... Ce que l’on nomme l’Observatoire est une énorme bâtisse retranchée derrière un mur d’enceinte, dernier vestige d’un immense et florissant domaine agricole dévoré par l’urbanisation. Si la vie a été riante un jour au domaine de l’Observatoire, si la richesse en débordait sur la campagne environnante, il n’en reste plus rien aujourd’hui. La maison semble un navire en ruine voué à la destruction, humide et sordide, tandis que la vie et le progrès s’écoulent autour d’elle, la rongeant peu à peu. Les gens qui vivent là sont des parias, des inadaptés à la modernité. Francis Orme, le narrateur, est un homme de 39 ans, maladivement solitaire et secret, aux mains éternellement prises dans des gants de coton blanc qu’il change à la moindre souillure. Sa vie est réglée jusque dans les moindres détails, régie par des lois drastiques et immuables qui le protègent lui et sa collection (996 pièces exactement, liste exhaustive en appendice) méthodiquement acquise en dérobant les objets les plus précieux à leurs propriétaires. Les autres habitants, en premier lieu son père et sa mère, sont tous également profondément obsessionnels et psychotiques, barricadés derrière leurs portes et leurs fantasmes d’une vie plus rutilante, manière de se protéger d’un présent qui les dépasse où d’un passé qui les terrifie. Mais l’équilibre précaire du domaine va être chamboulé par l’arrivée d’une nouvelle locataire, mademoiselle Tapp, jeune femme frêle, éternelle cigarette entre les lèvres, affable, curieuse et dont l’intervention provoquera une anamnèse collective. Les souvenirs révélés par ses nouveaux voisins déferont inéluctablement les liens malsains qui unissaient les personnages. La femme-chien retrouve la parole et la mémoire, Peter Bugg, le suant et cruel précepteur se libère d’un crime terrible... Autour de Francis Orme, dont le traumatisme est sans doute le plus ancien et le plus abominable, tout se délite, le laissant plus désemparé que jamais face aux vivants. Par un subtil jeu de révélations et d’allers-retours entre le présent et le passé du manoir, Edward Carey crée une atmosphère angoissante, fantasmagorique sans jamais user ni du surnaturel ni du suspense. Il imagine un monde où la folie et la normalité ne sont guère éloignées, où l’absurdité et le cynisme ne sont que ceux du quotidien. Francis Orme et son exposition d’amours ; sa mère et sa chambre aux souvenirs ; Claire Higg et ses séries télé dégoulinantes de sentiments sont des manifestations de l’égoïsme et de l’insatisfaction, exacerbées par la laideur du monde.