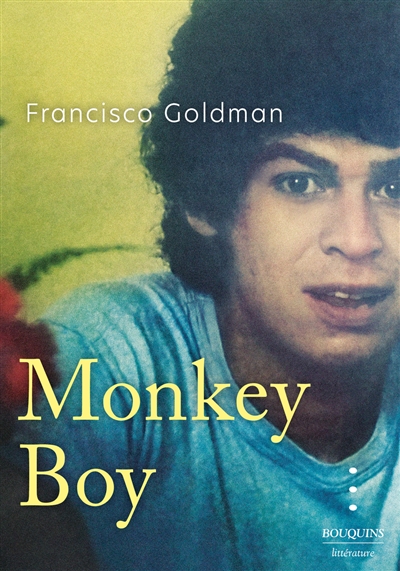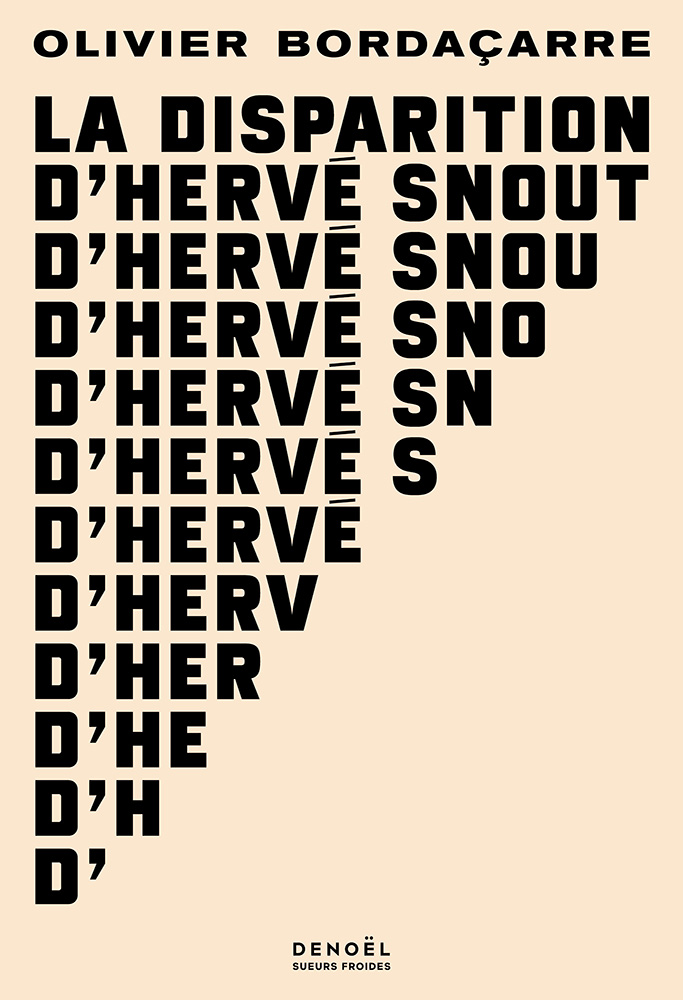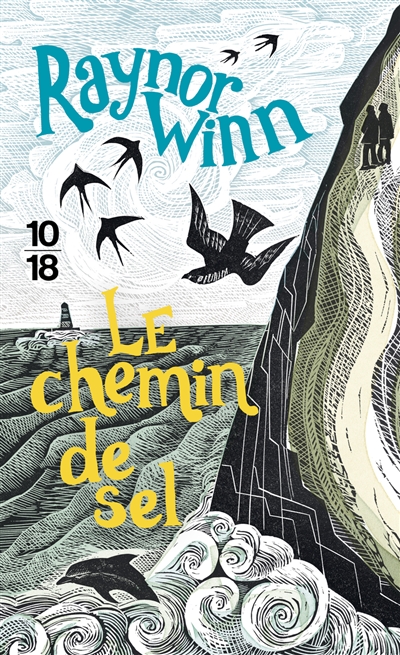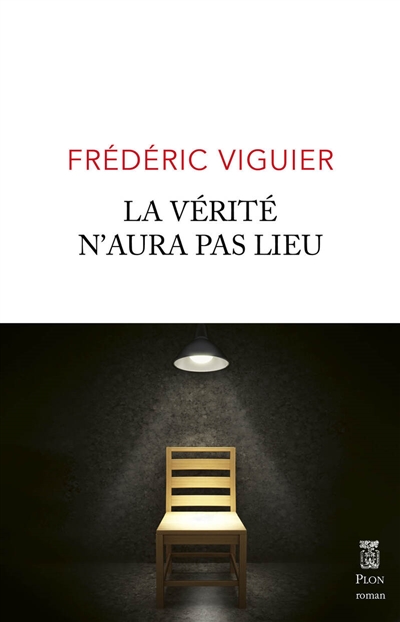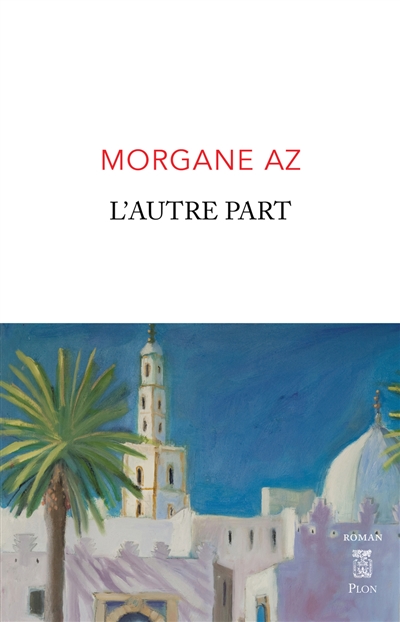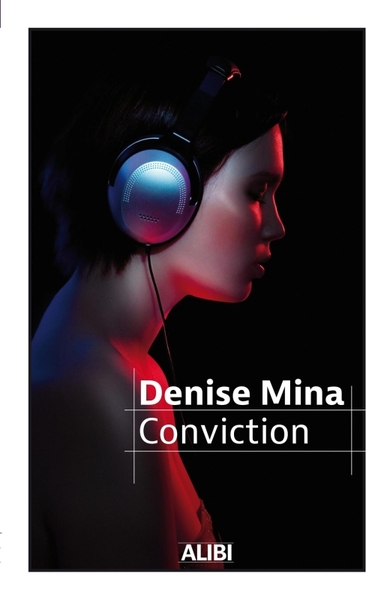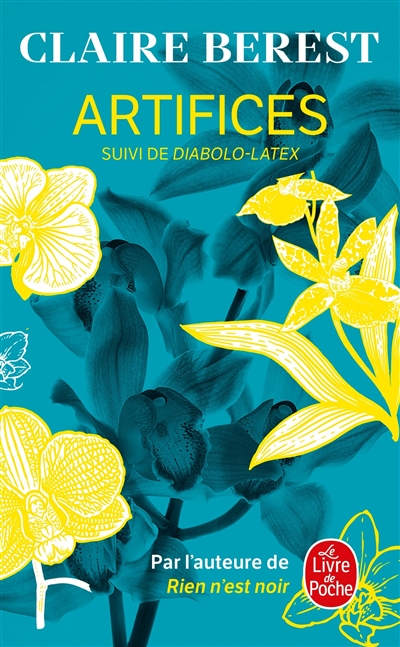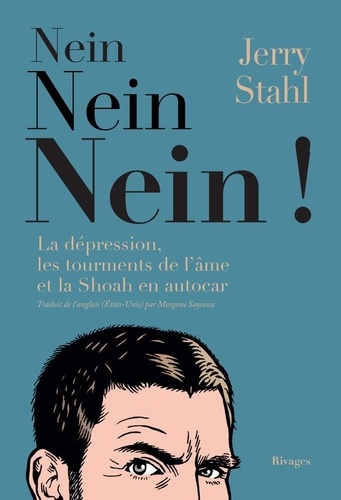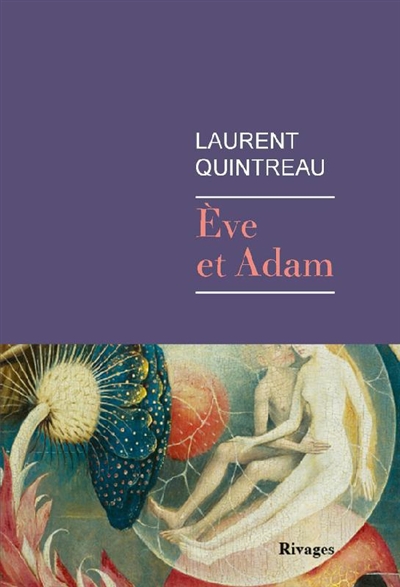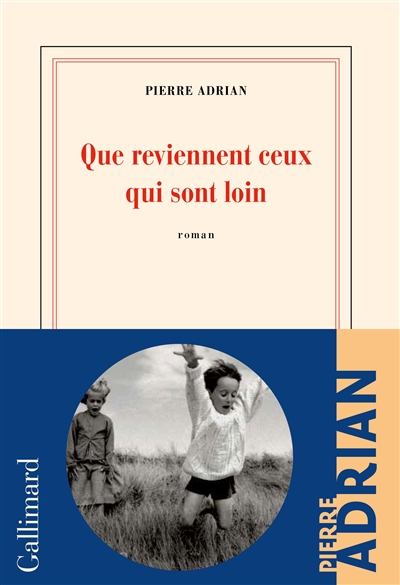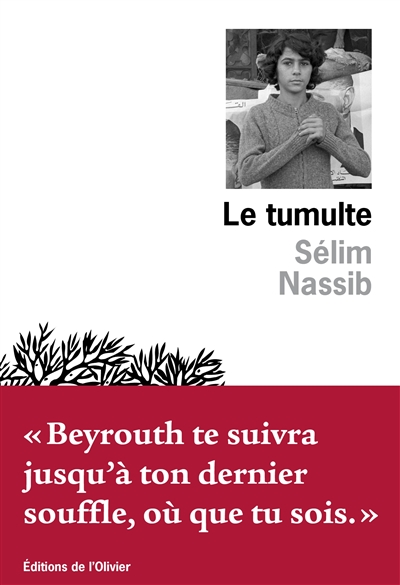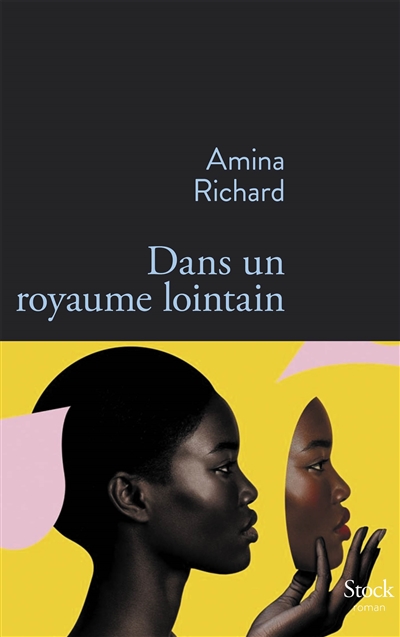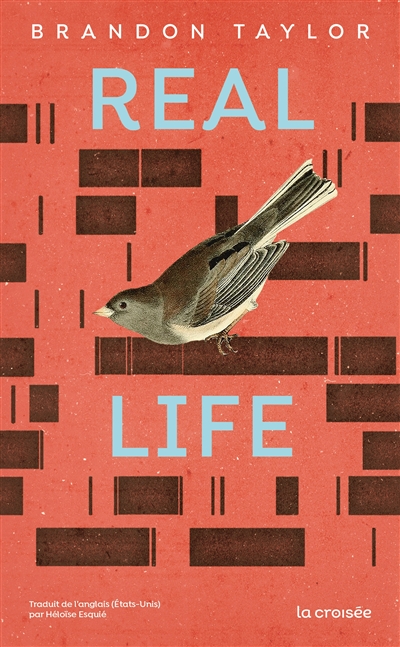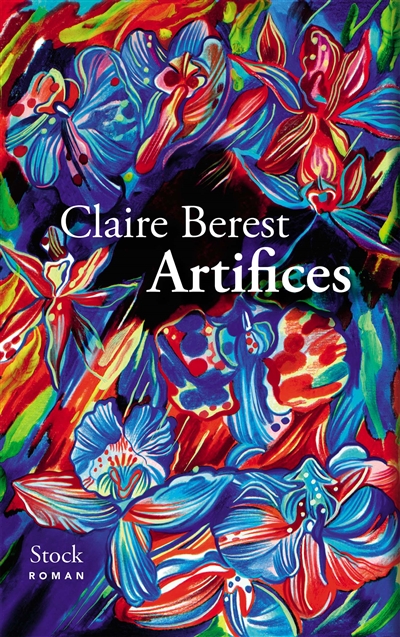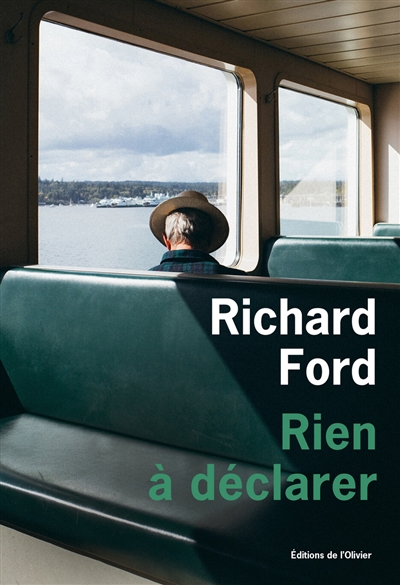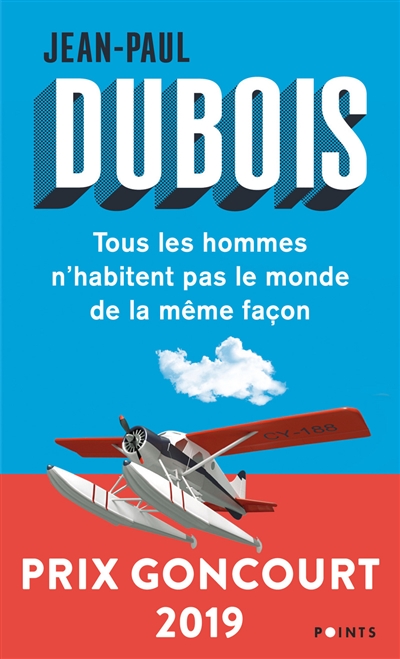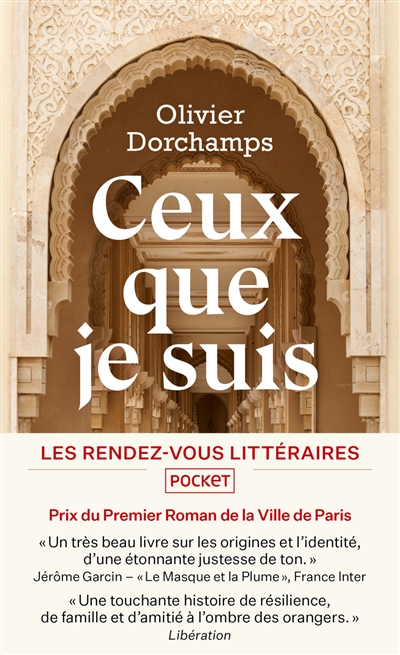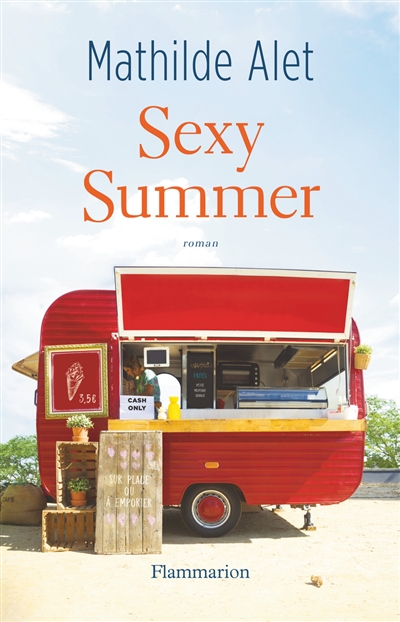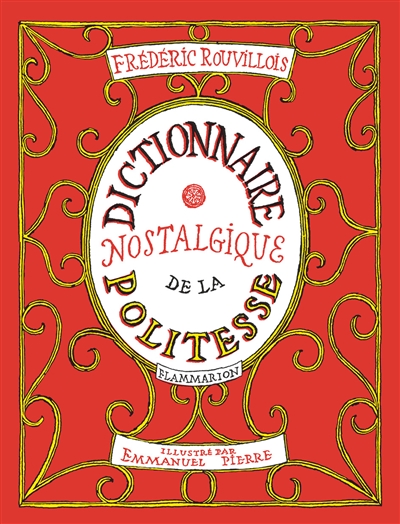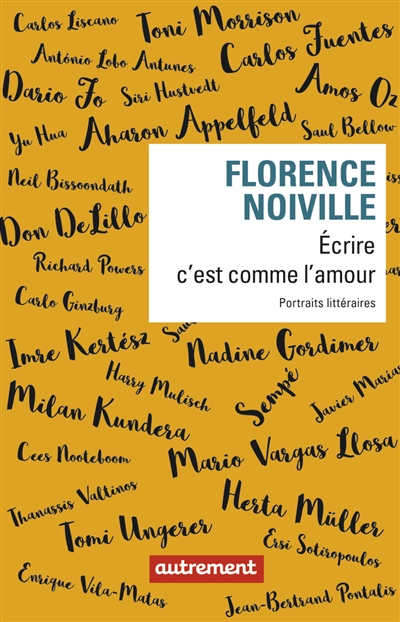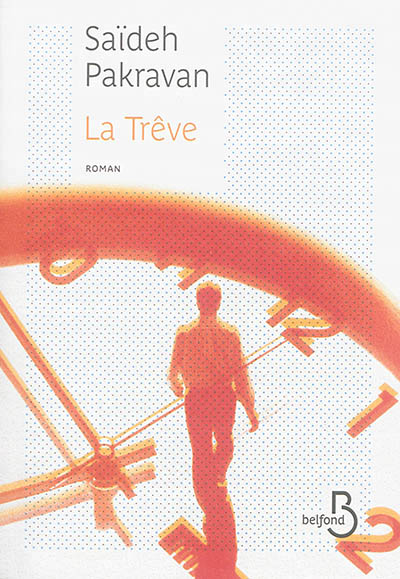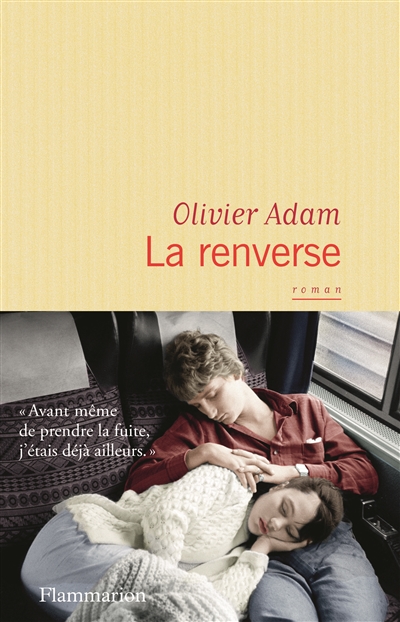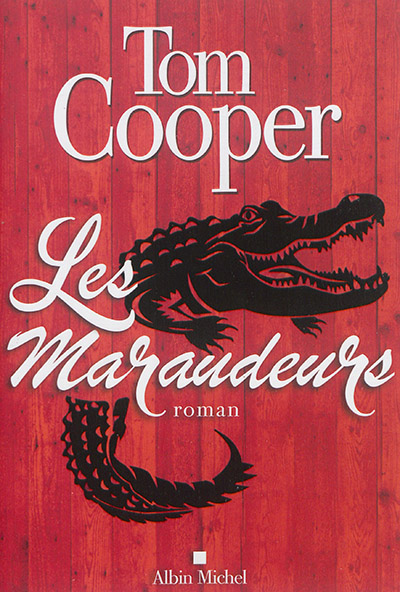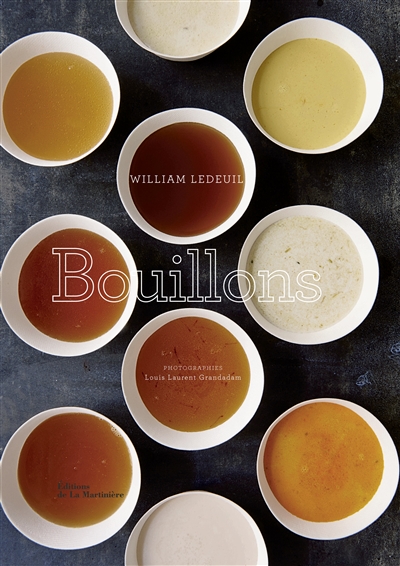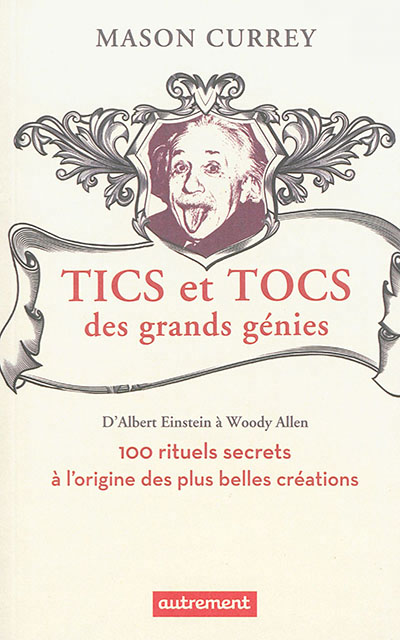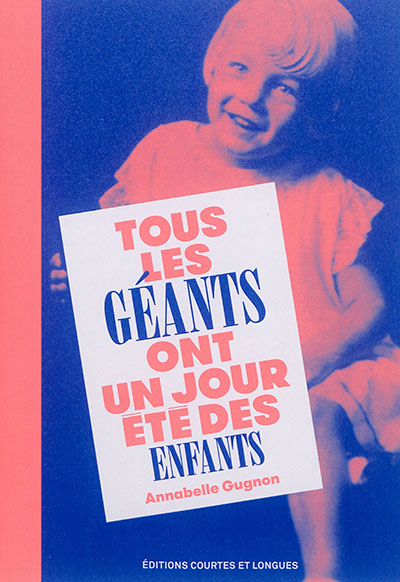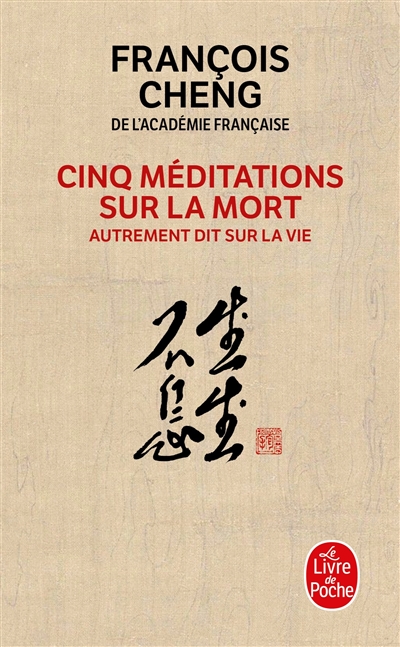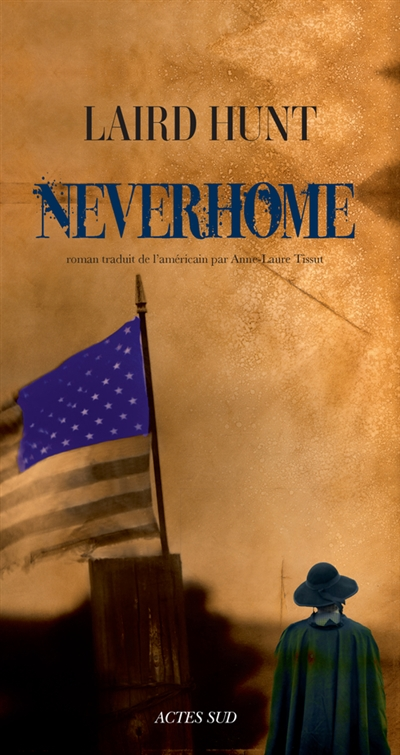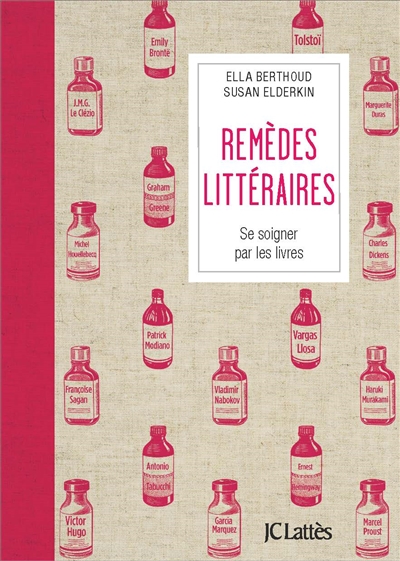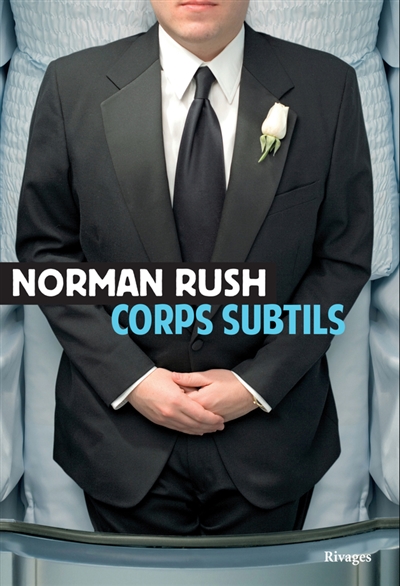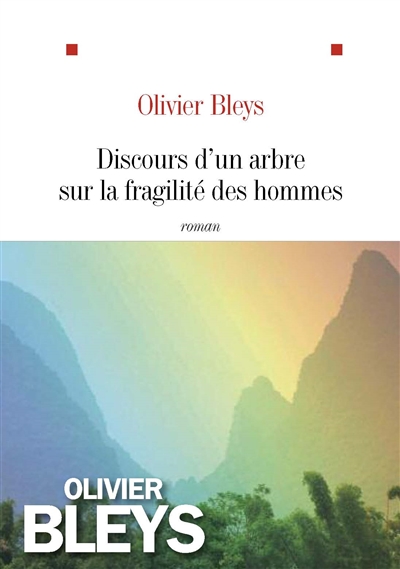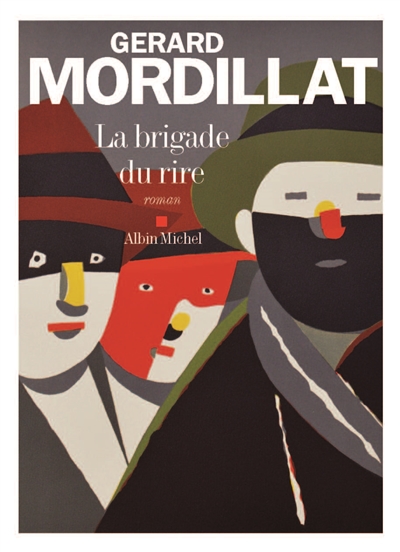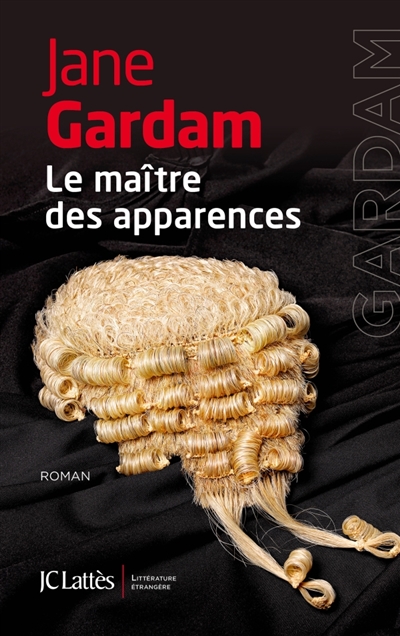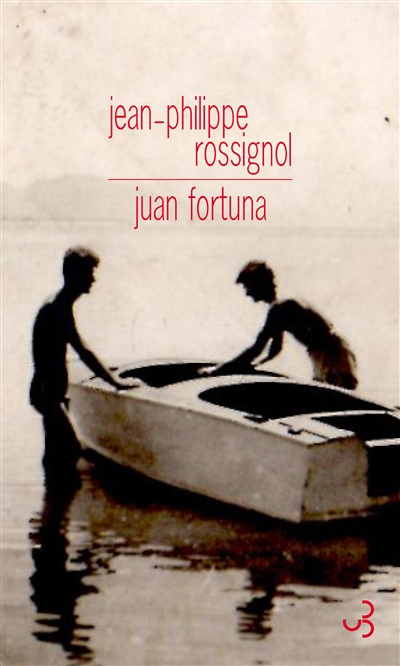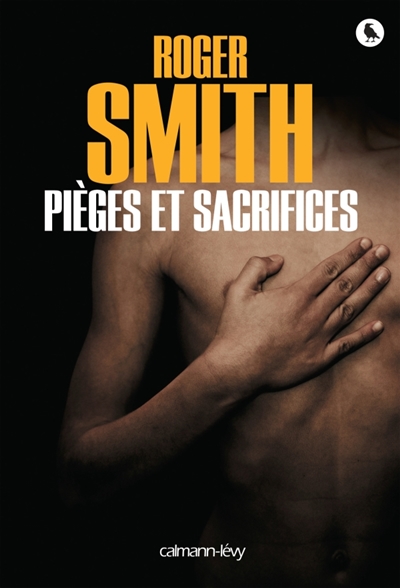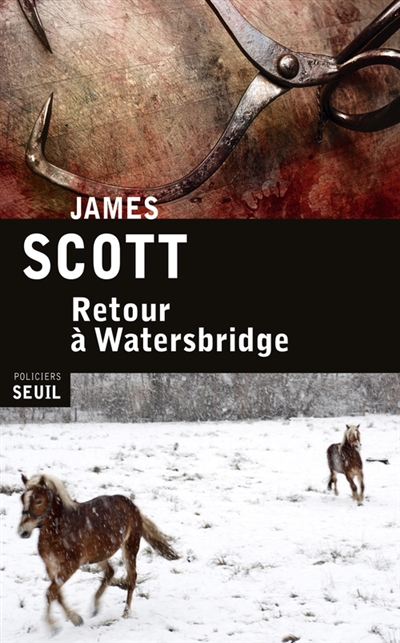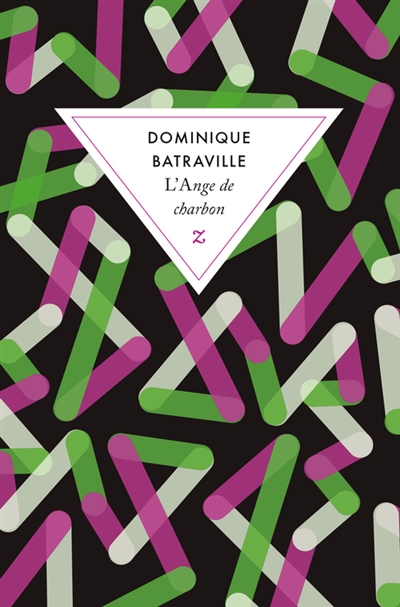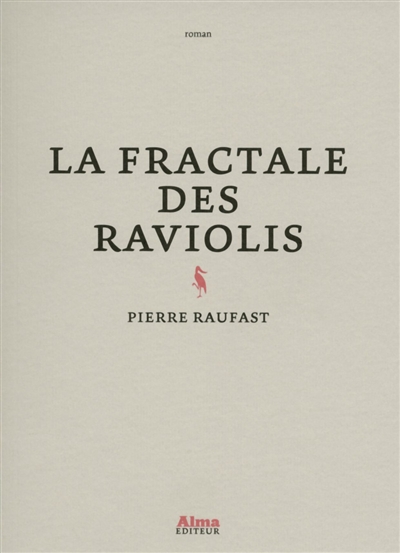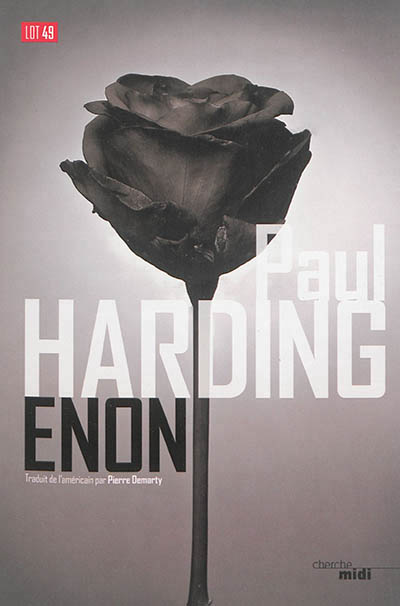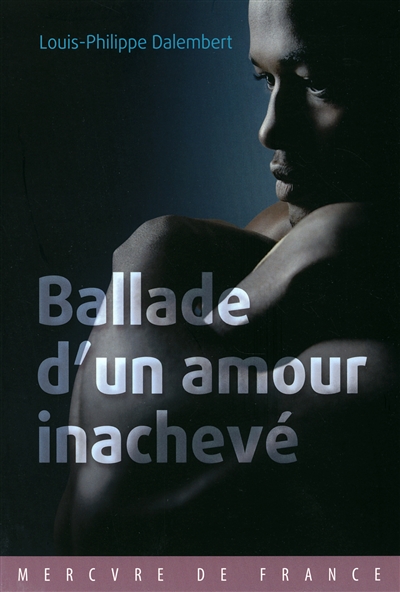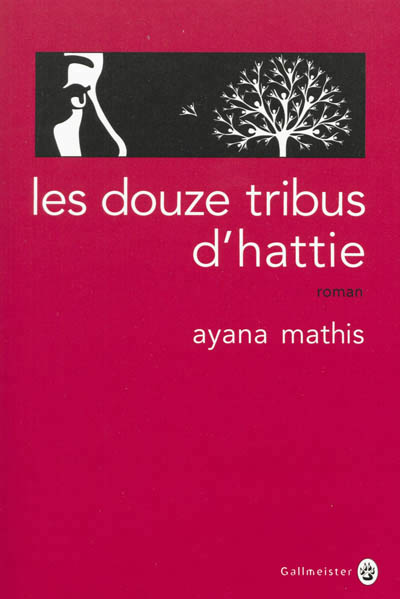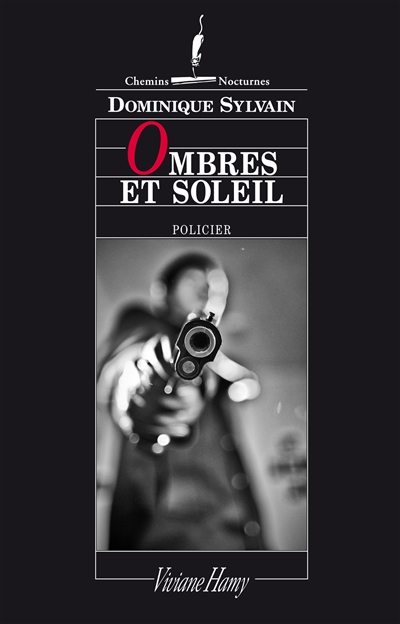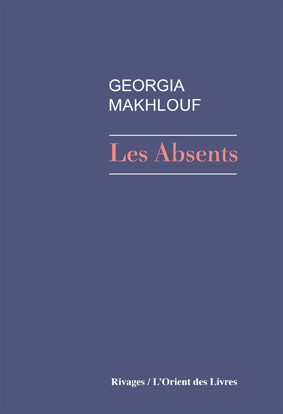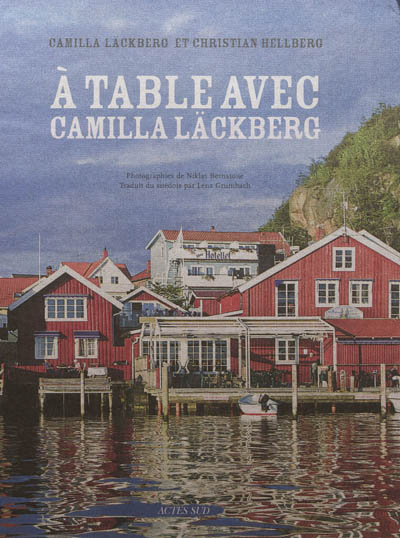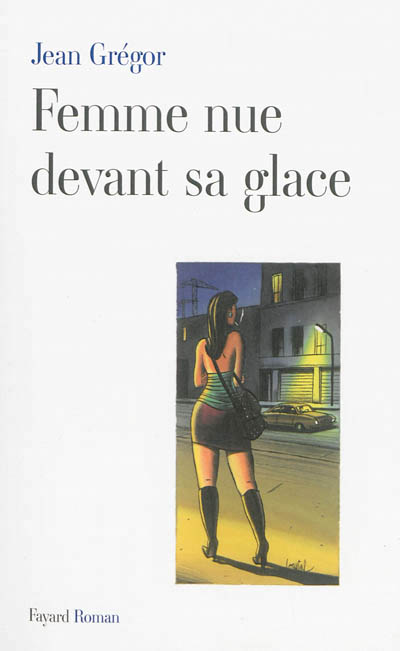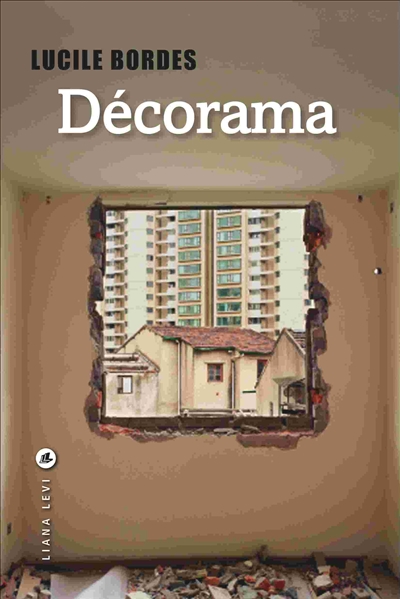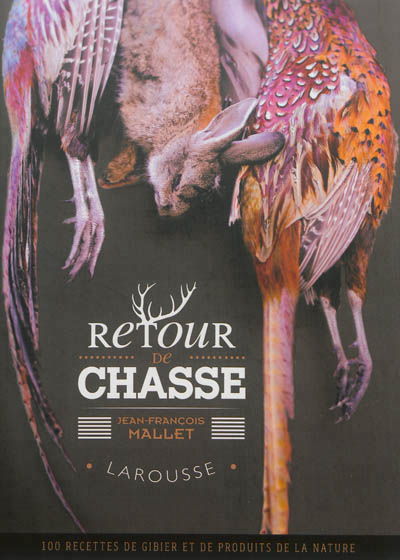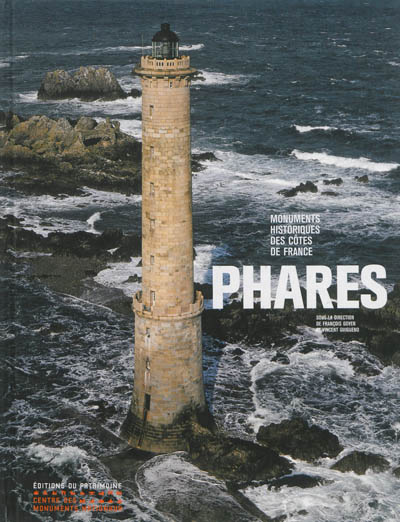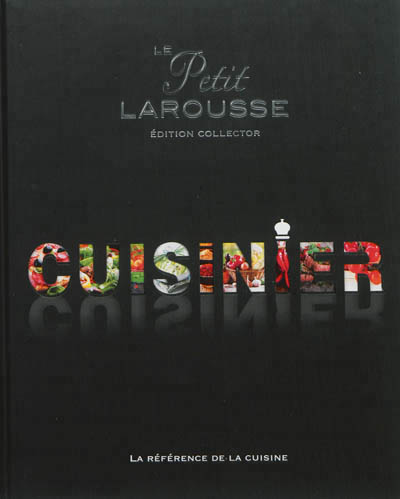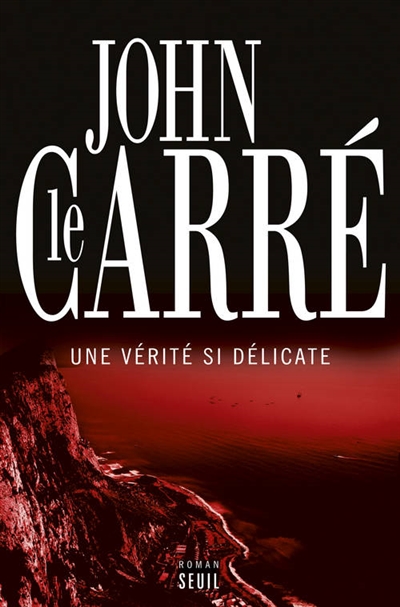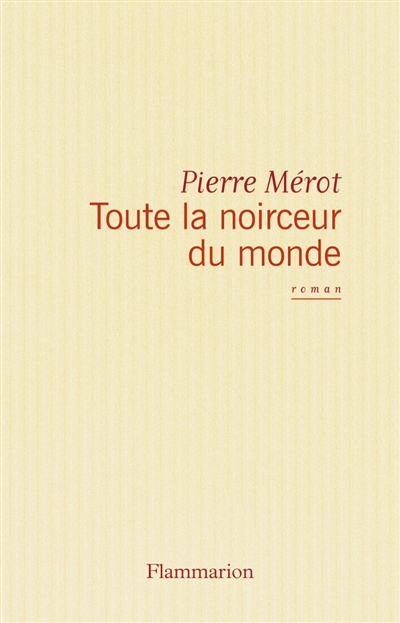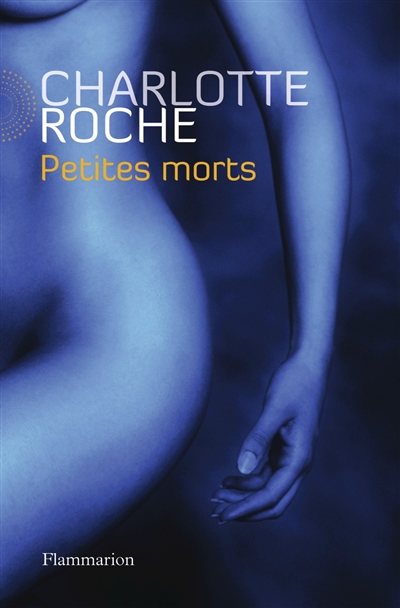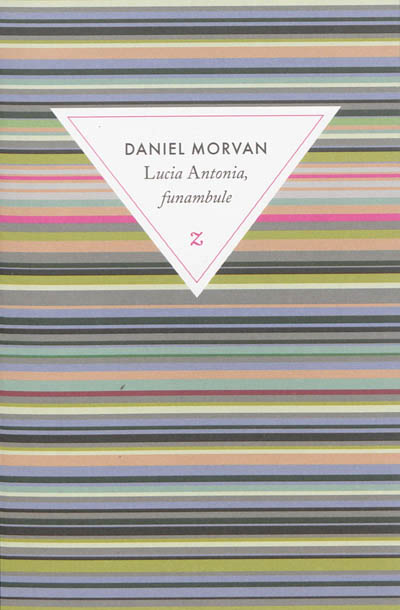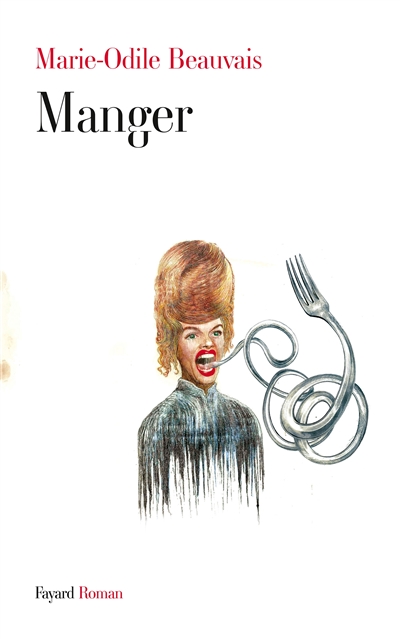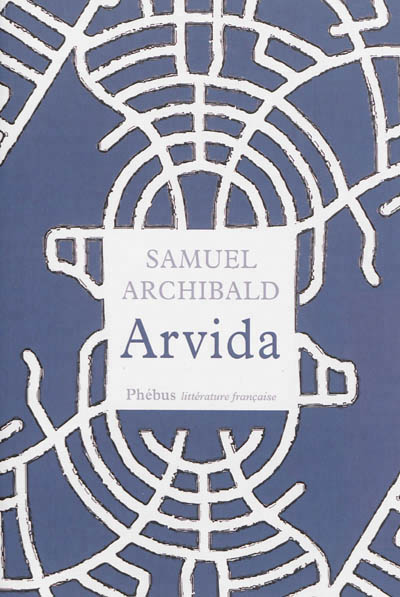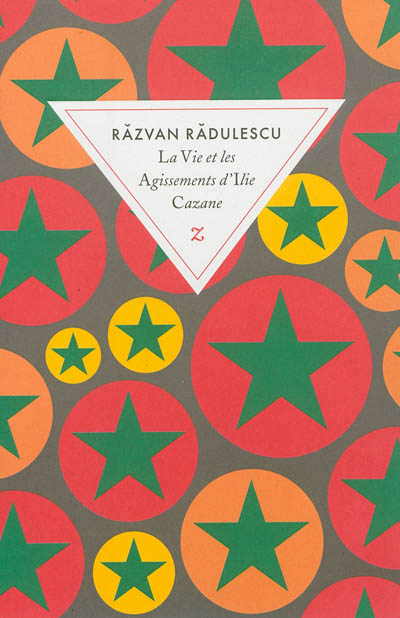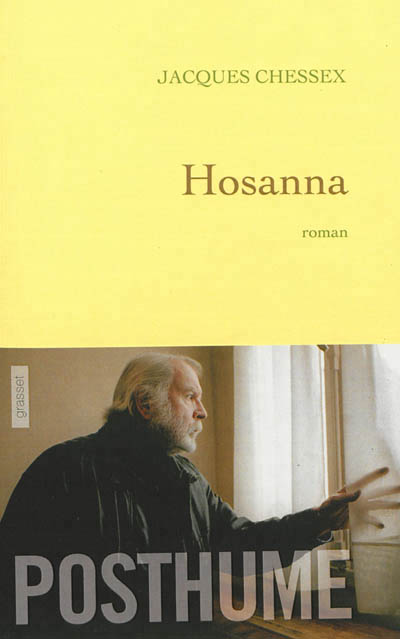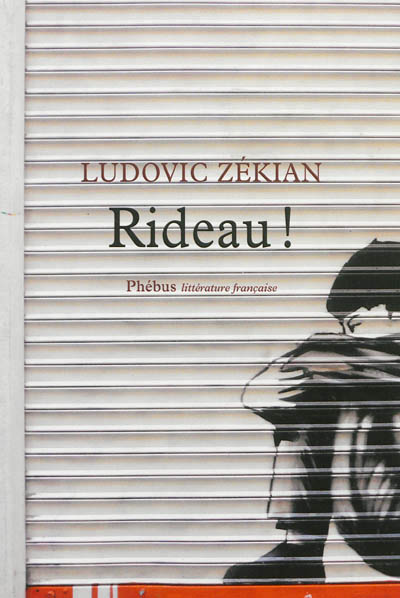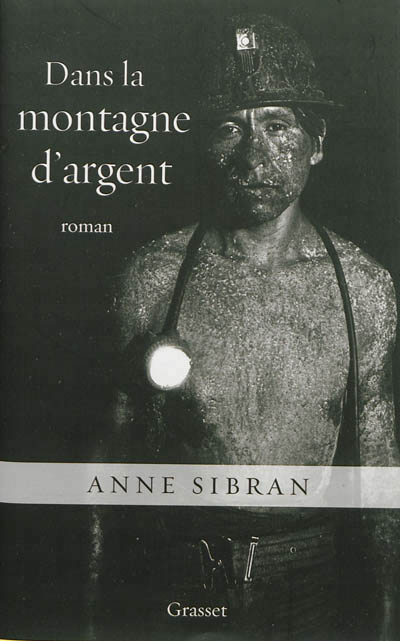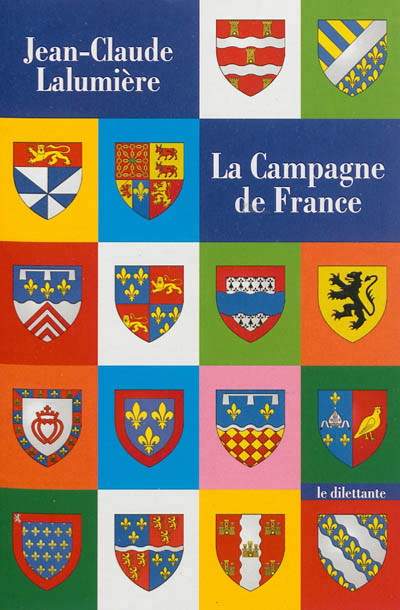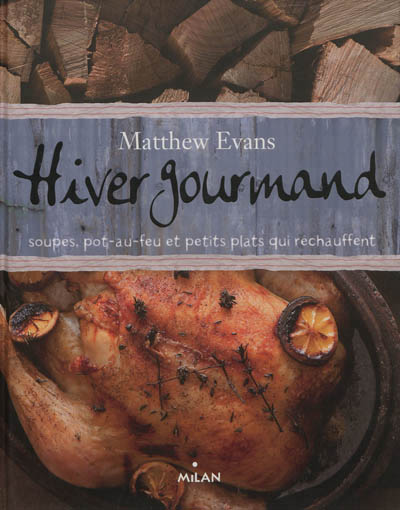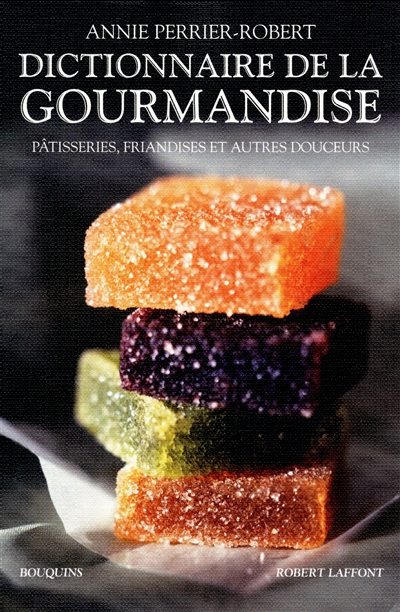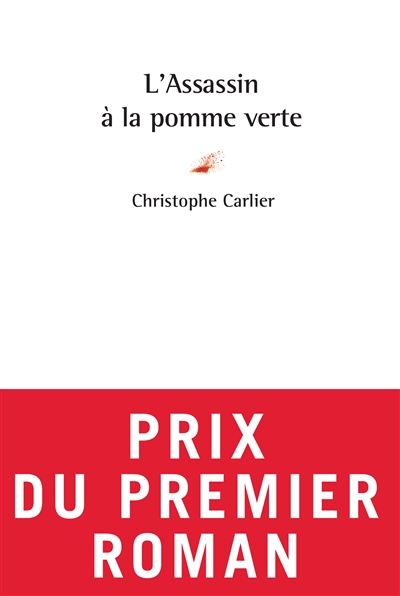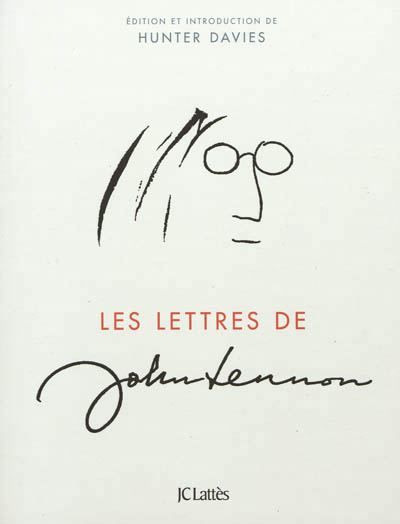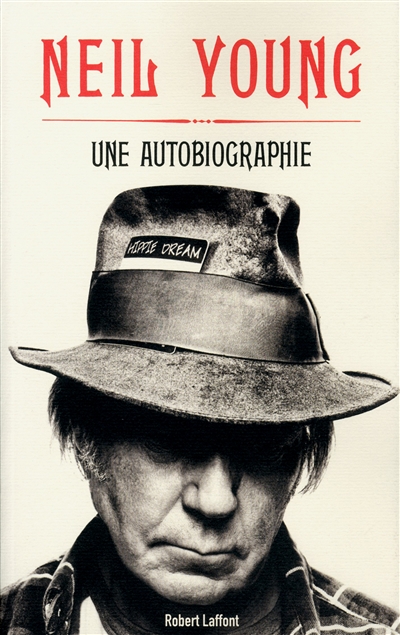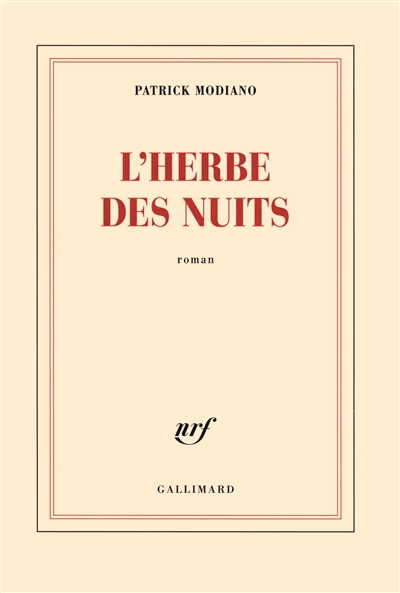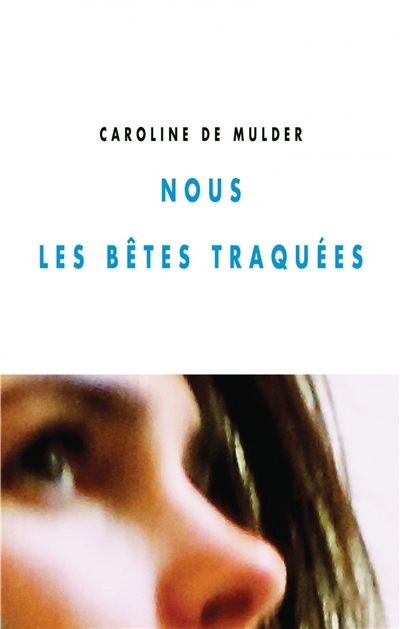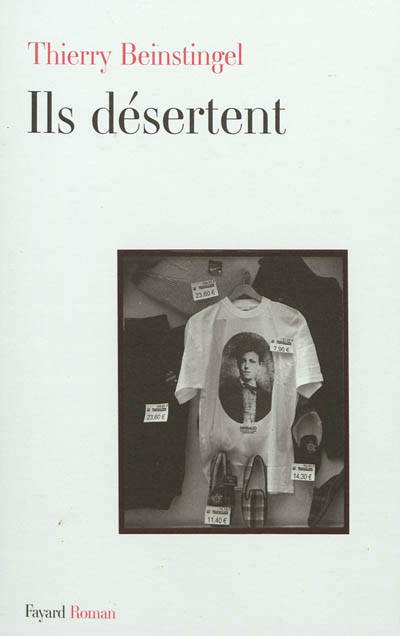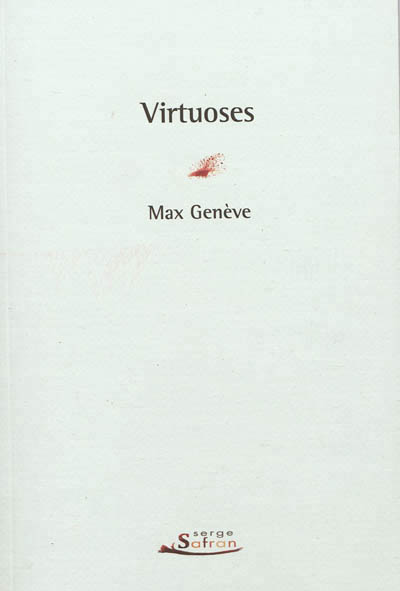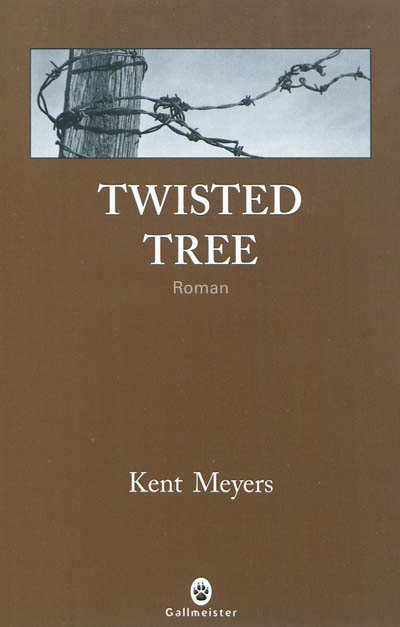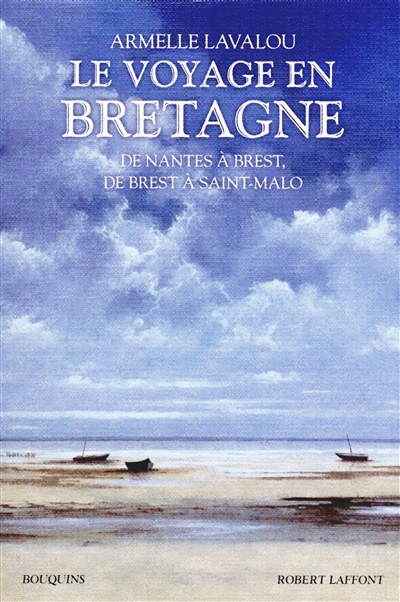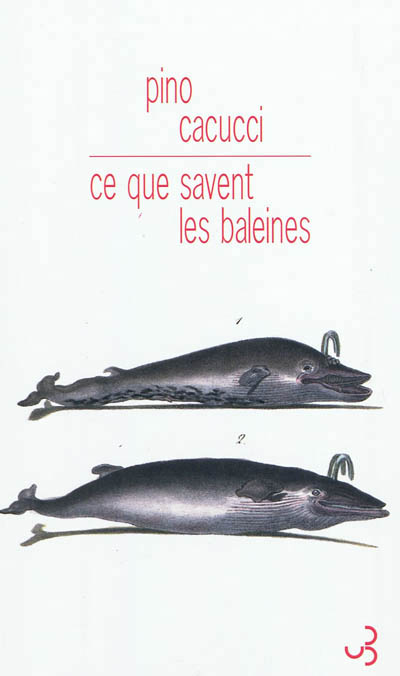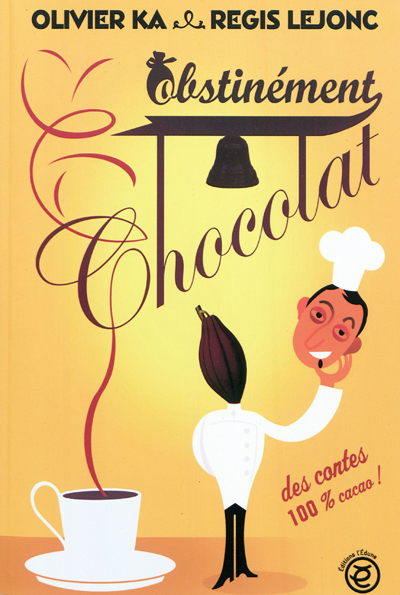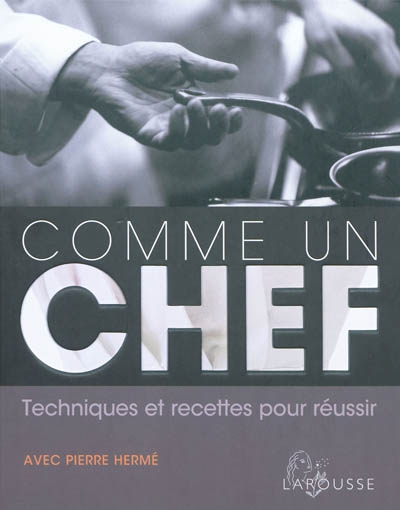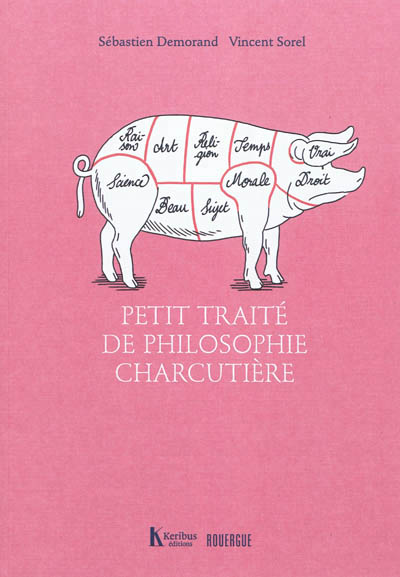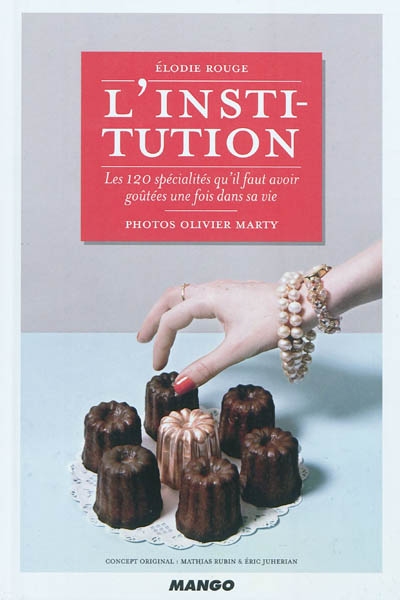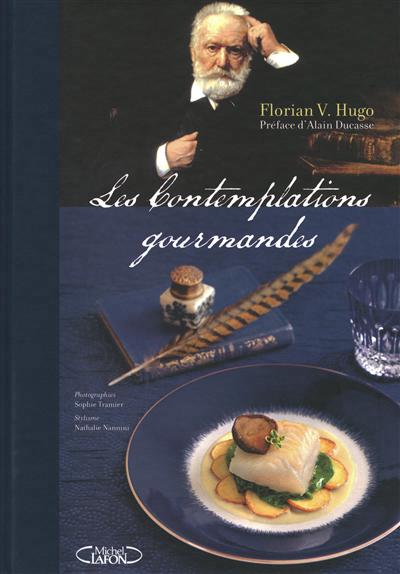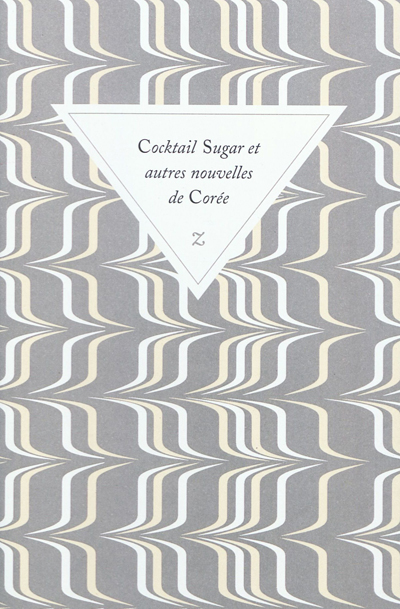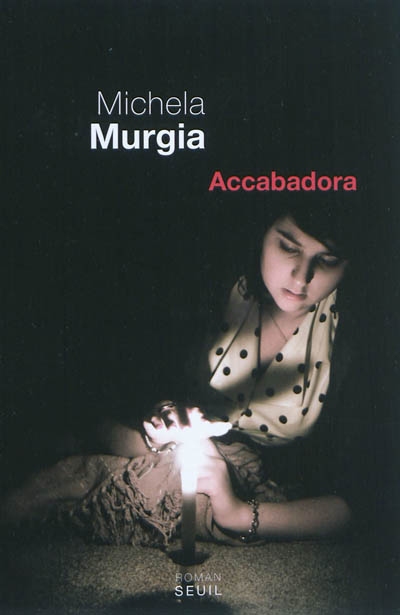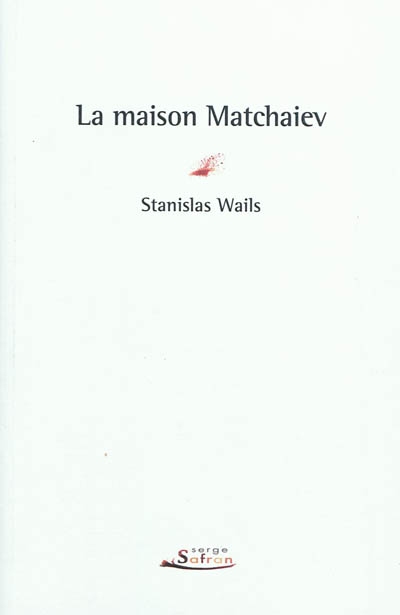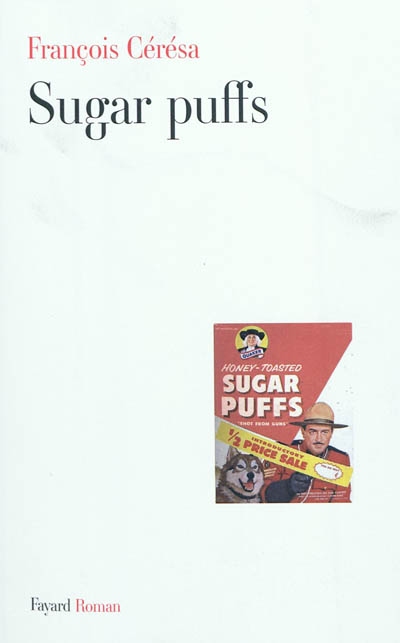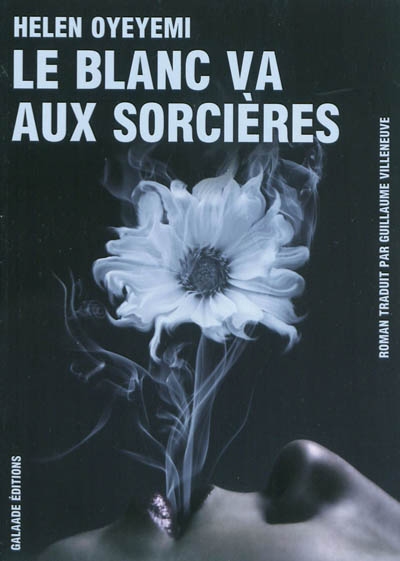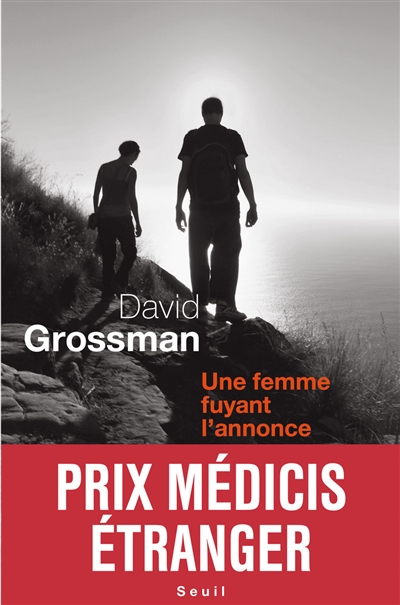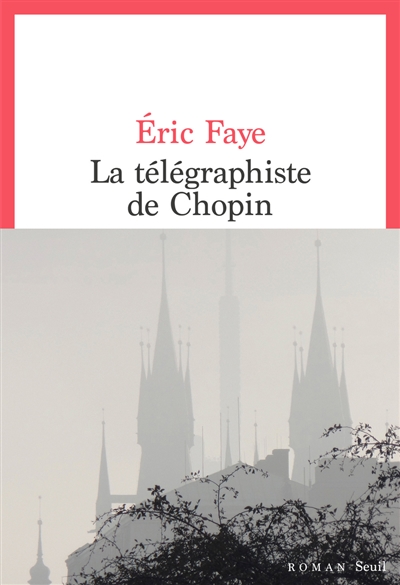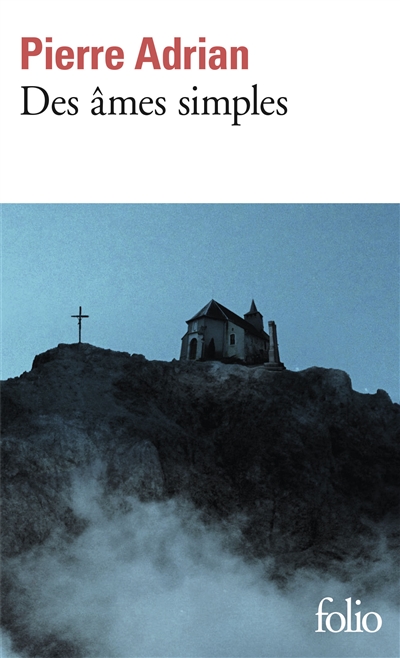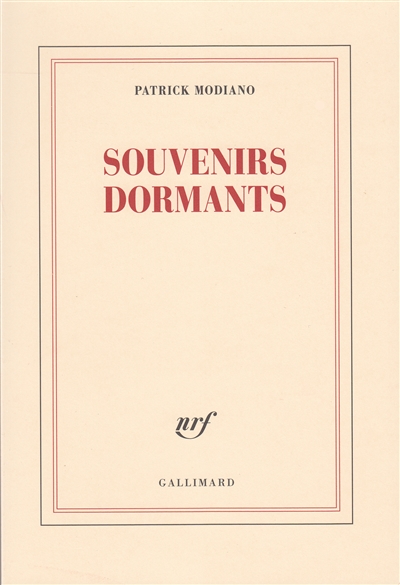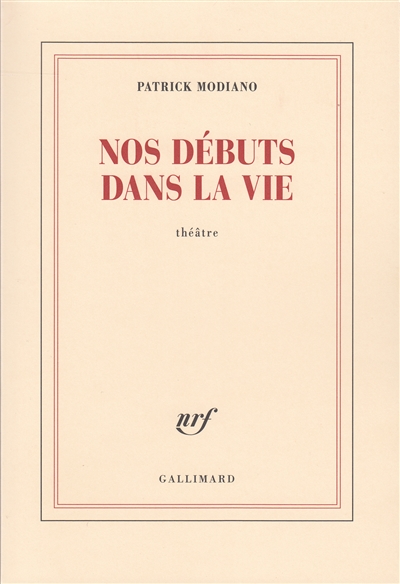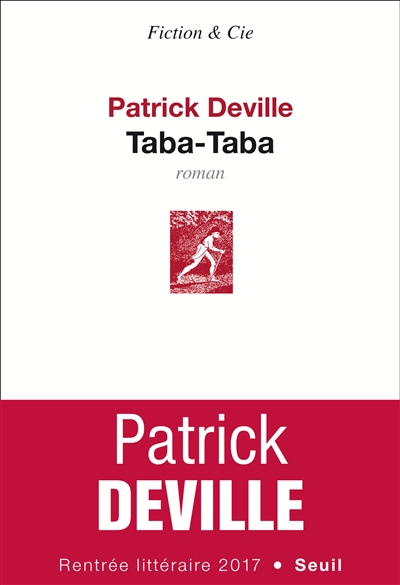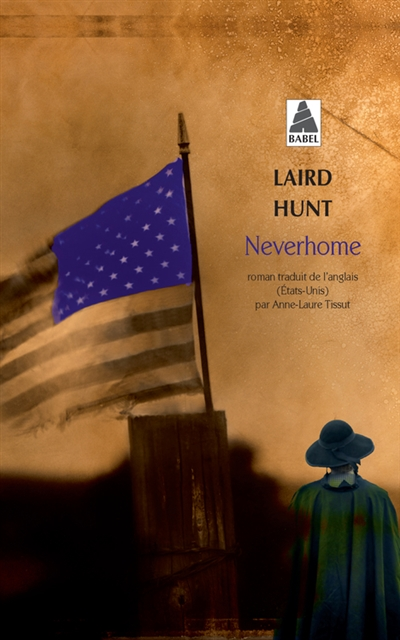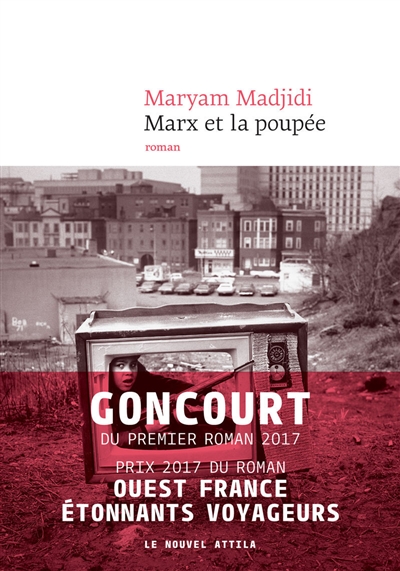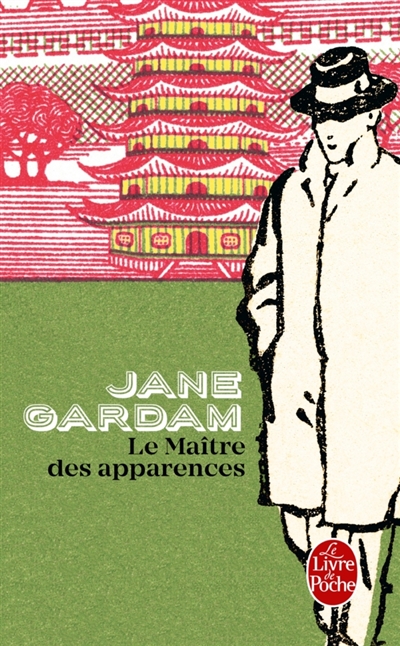Littérature étrangère
Jenni Fagan
Les Buveurs de lumière

Partager la chronique
-
Jenni Fagan
Traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwaller
Métailié
24/08/2017
304 p., 20 €
-
Chronique de
Jean-François Delapré
Librairie Saint-Christophe (Lesneven) -
Lu & conseillé par
26 libraire(s)


Chronique de Jean-François Delapré
Librairie Saint-Christophe (Lesneven)
Dans cette petite ville de Clachan Fells, au Nord de l’Écosse, alors que le monde entre dans une étrange glaciation, une petite communauté survit dans un parking de caravanes. Dylan, grand type bourru, débarque ici avec une idée en tête. Mais le froid gagne, autant les hommes que les cerveaux. Le froid gagne-t-il à tous les coups ?
Nous sommes dans un monde qui se meurt, où la glace implacable recouvre peu à peu tout ce qui reste de vivant. Dans cette petite ville où arrive Dylan, on s’organise pour survivre, retarder l’échéance de ce thermomètre qui, inexorablement, descend vers l’insoupçonné. De Constance qui bricole un poêle à bois avec des bouts de tuyaux à Stella, sa fille née garçon, du taxidermiste fou furieux à la star du porno, on traficote du gin, on monte vers les étoiles, on enterre des secrets de famille, on laisse le froid entourer la vie, la ville, les caravanes. Chacun sait que la lutte est inégale, on ne défie pas la nature impunément depuis des siècles pour qu’elle ne finisse pas par vouloir se venger. Dans ce roman, vertigineusement poétique, Jenni Fagan nous ensorcelle avec cette parabole éblouissante où on mesure avec effroi les limites absolues de notre humanité vacillante, avec cette certitude que si la glaciation arrive bientôt, j’irai rejoindre Jenni sur le toit de sa caravane.
PAGE — Comment est né ce livre et dans quelle zone de votre cerveau avez-vous été cherché ces personnages ?
Jenni Fagan — Le roman est né avec l’idée de lumière. Je voulais réfléchir à ce que représente la lumière pour les humains, sous toutes ses formes. Je passe une grande partie de mon temps à marcher dans la nature et je voulais avoir l’opportunité de dépeindre cela en mots, mais en l’amenant plus loin, je voulais montrer comment les gens réagissent face aux éléments, dangereux et inhérents à la vie sur une planète où l’on ignore systématiquement le climat. La vie moderne est forgée sur la désinfection et l’ignorance du fait que nous vivons justement sur une planète. Nous racontons des histoires de dieux ou d’au-delà qui nous apporteront la grâce, mais je suis convaincue que tout ce que nous avons, c’est le présent. Quant aux personnages, Stella a tout simplement fait irruption dans mon cerveau avec ses ongles de gothique et son drapeau de pirate attaché à son vélo. Les autres ont fait de même. Depuis là où ils se trouvent, je les laisse venir à moi, sans trop les forcer, car ils n’aiment pas ça. Bien sûr, je les ai tous recherchés et certaines de mes propres idées concernant l’amour, le sexe et le genre s’y expriment naturellement. Je voulais créer un personnage féminin qui a plusieurs amants mais aucune envie de vivre avec aucun d’entre eux. Constance, la mère, a une façon très scientifique d’appréhender la vie et n’est absolument pas tourmentée par le besoin d’être aimée. J’ai apprécié passer du temps avec elle et me rendre compte que trop de femmes sont élevées dans l’idée que la plus grande qualité féminine est d’être aimée ou de ne pas être une menace. On me dit souvent que j’écris comme un homme ou que je pense comme un homme. Je n’ai pas de mal à imaginer l’idée d’être né dans le mauvais corps et d’avoir à se battre pour son identité, c’est ce qui m’a d’ailleurs attirée chez Stella. Dylan est un homme qui a été élevé par des femmes très peu conventionnelles, un géant qui fait le deuil de ces femmes et doit réévaluer ce que cela implique d’être amoureux d’une femme qui n’a pas besoin de lui. En un sens, j’ai créé une famille et un monde dont j’avais envie de faire partie, malgré l’imminente ère glaciaire.
P. — Le livre est une invitation à la recherche. Dylan arrive dans cette communauté à la recherche de quelqu’un. Stella se demande qui elle est. Constance s’est perdue et tente de se reconstruire. Il y a cette idée de quête dans un monde qui se meurt.
J. F. — Nous menons tous une sorte de quête dans un monde qui se meurt. Notre planète va mourir et nous ne savons juste pas quand, bien que de nombreux pays aient l’air de tout faire pour accélérer le processus. Bien des gens n’ont pas conscience de leur mortalité mais nous vivons tous à crédit et le temps qu’on nous donne est la quête la plus importante que nous ne mènerons jamais. Je suis très intéressée par la façon dont les vérités des individus existent à l’intérieur des plus grandes vérités (ou des mensonges) des nations. Qu’arrive-t-il quand les humains vivent une période de changement aussi extraordinaire ? Qu’arrive-t-il quand la nature reprend ses droits sur la planète ? J’avais tout cela à l’esprit pendant l’écriture de ce roman.
P. — Plus le froid envahit le roman, plus tout ce petit monde se resserre sur ses propres certitudes. C’est ce que vous vouliez montrer ?
J. F. — Je n’aime pas penser à ce que j’essaye de montrer. Je n’aime pas trop interférer avec le processus d’écriture. J’écris d’une façon très spécifique qui laisse carte blanche à une partie spécifique de mon cerveau. Certaines personnes disent qu’il n’y a rien de mieux que la mort imminente pour se sentir vivant. La nature est mortelle mais elle est aussi un des plus beaux éléments de notre planète. Quand les humains comprennent que leur temps est incroyablement compté, cela change-t-il la valeur qu’ils donnent à la planète et aux autres ? Parfois, oui.
P. — Vous êtes poète et cela se sent évidemment dans tout le roman. Je me suis d’ailleurs dit que si la fin du monde devait ressembler à quelque chose, je choisirais la vôtre. Vous le pensez aussi ?
J. F. — Oui, je pense. Je ferai toujours le choix de la beauté, de l’amour, de la vitalité et du danger. L’humanité et la curiosité, voilà ce que je choisirais. Bien sûr il y aurait aussi du gin, une grande conscience de la fragilité de l’existence et le désir de vivre tant qu’on le peut. Et si l’ère glaciaire arrive plus tôt que prévu, je vous invite à venir nous chercher sur le toit de la caravane. La poésie est mon plus vieil amour. C’est la seule chose qui a été une constante dans ma vie.