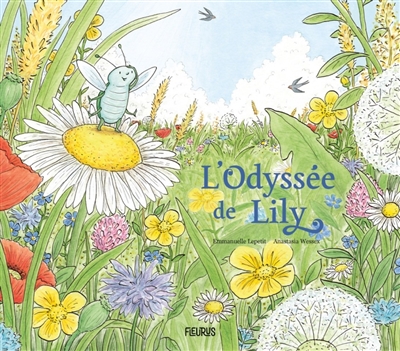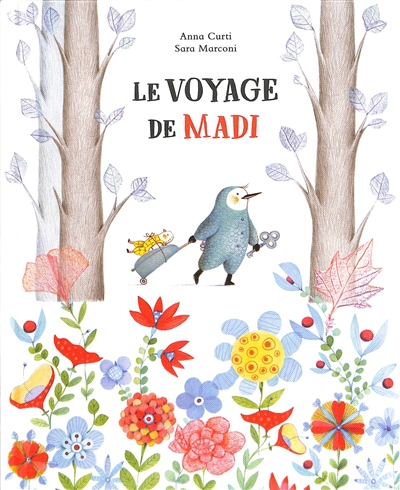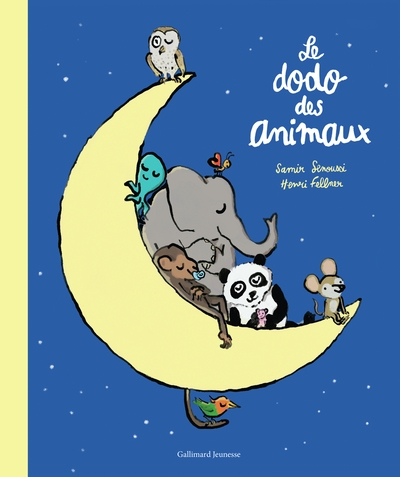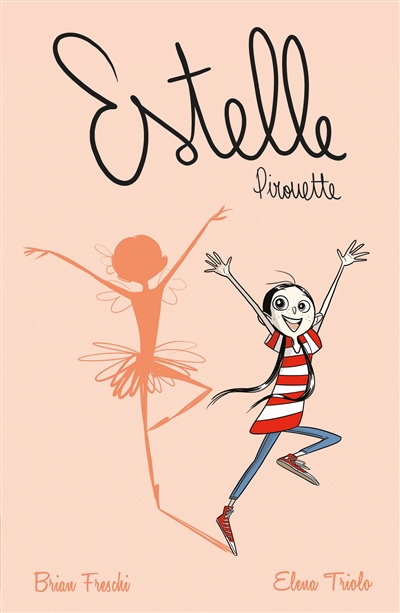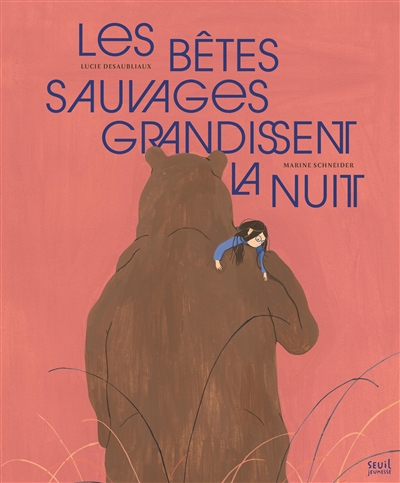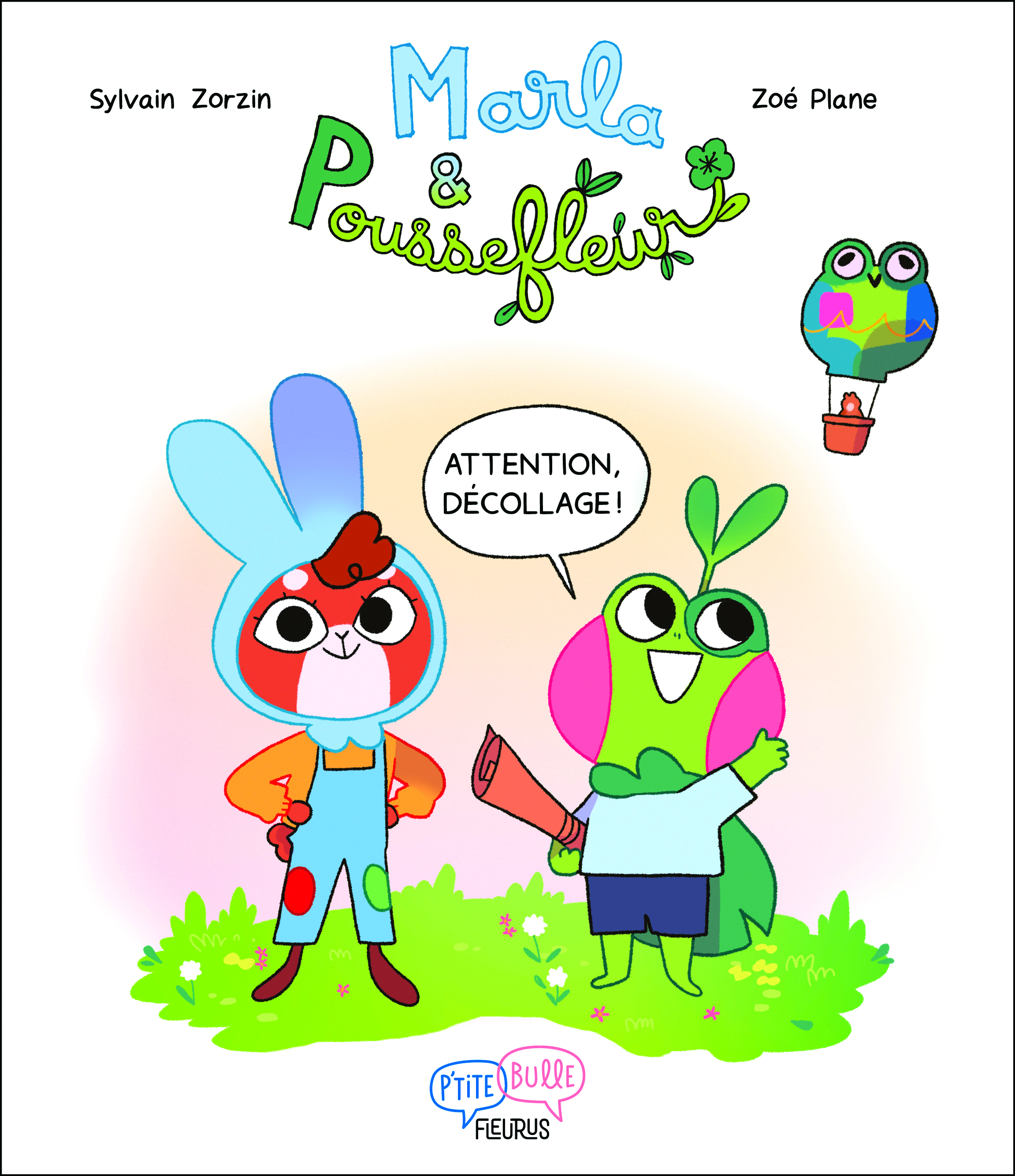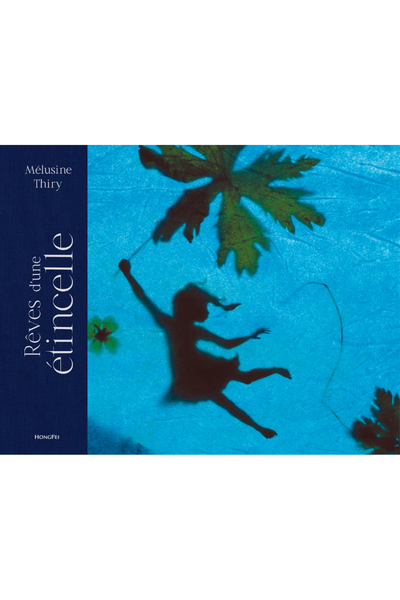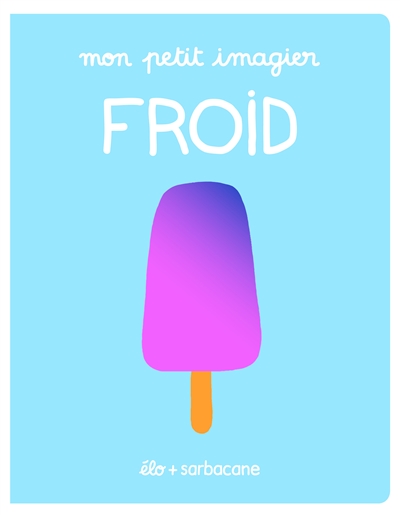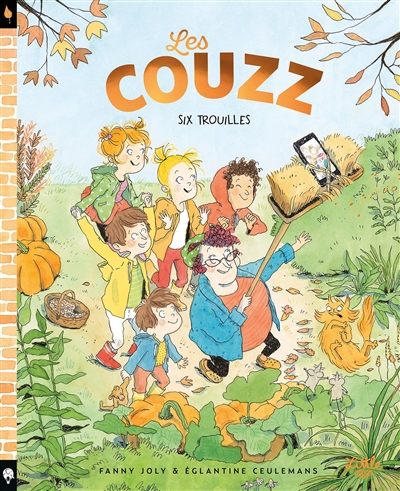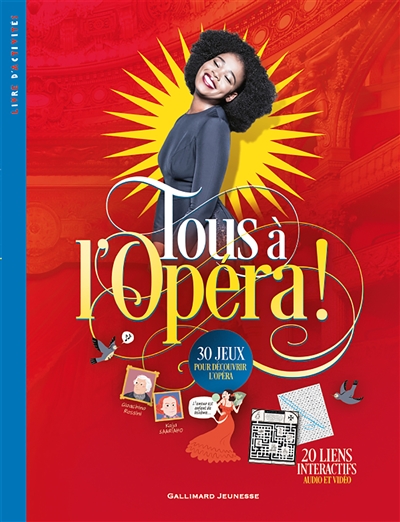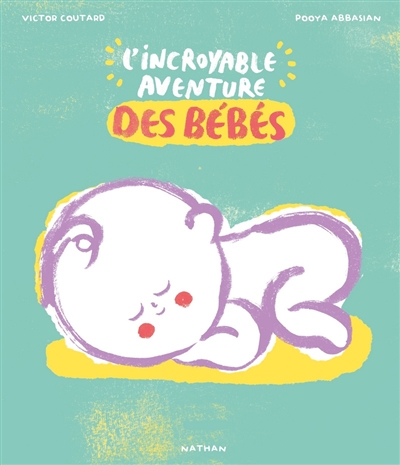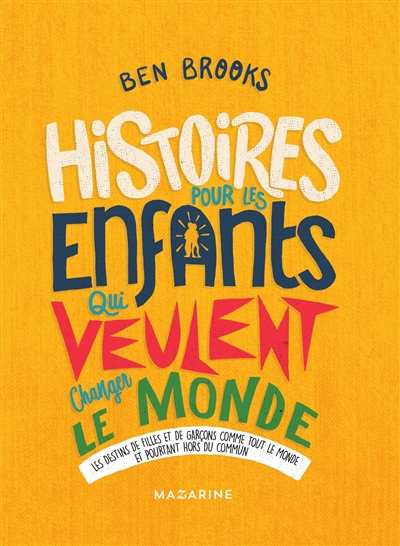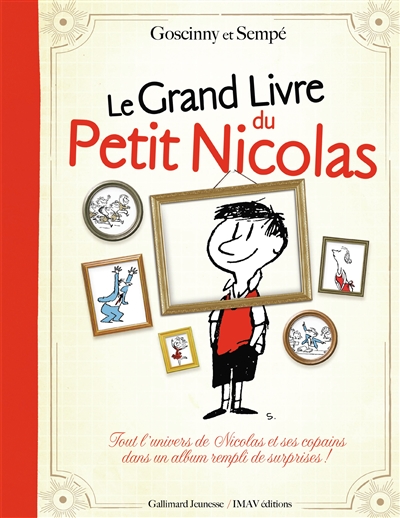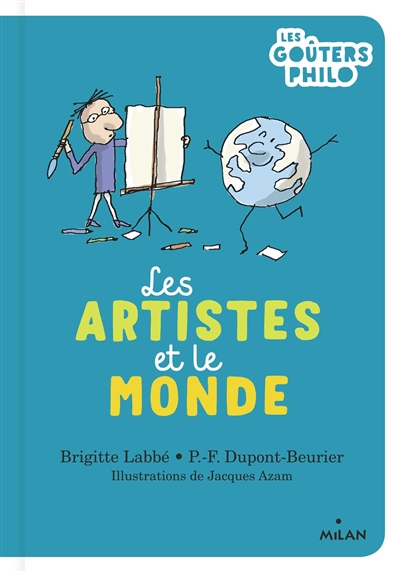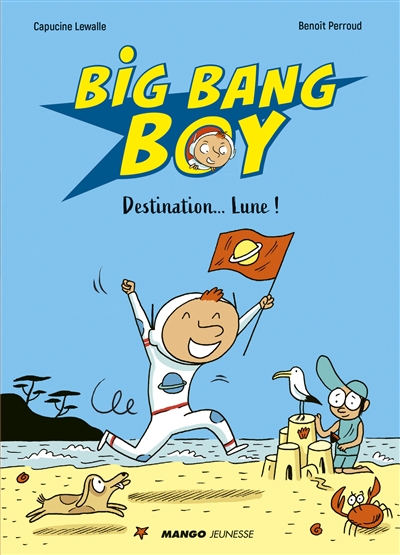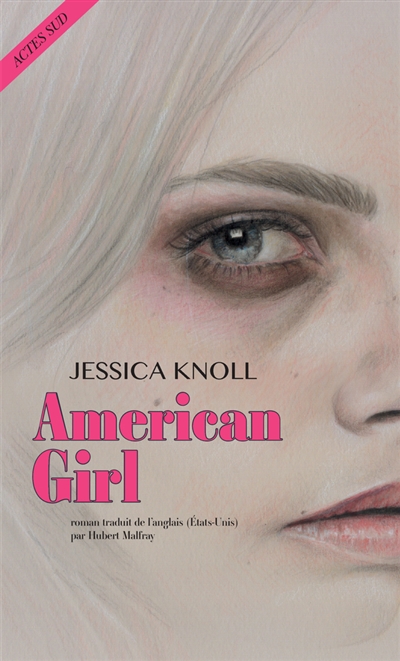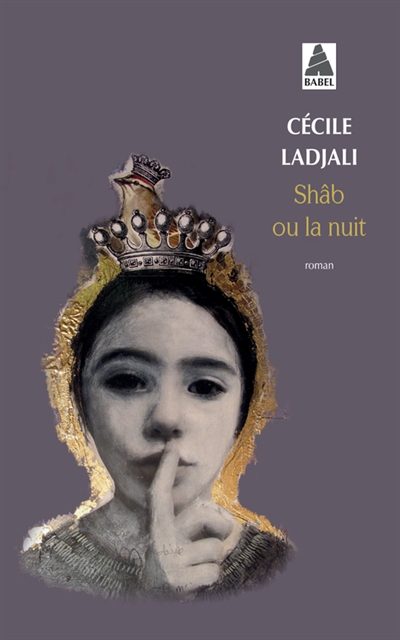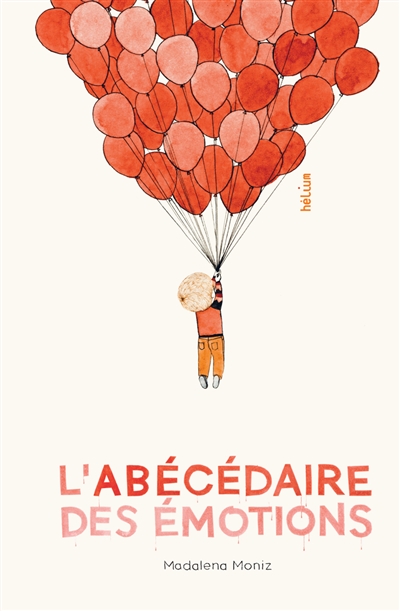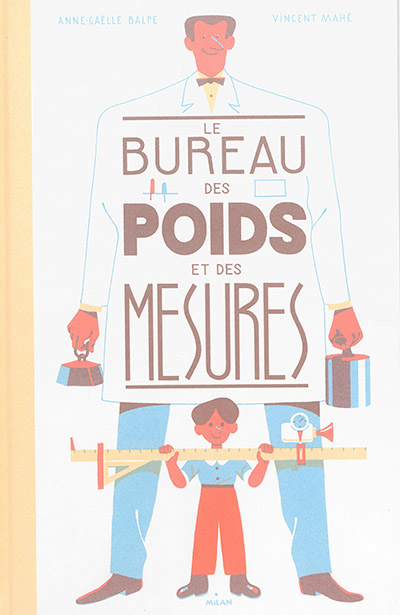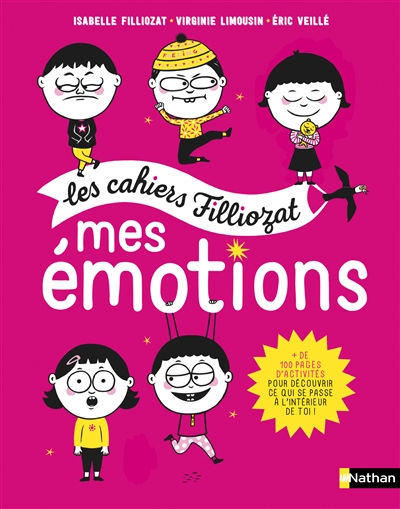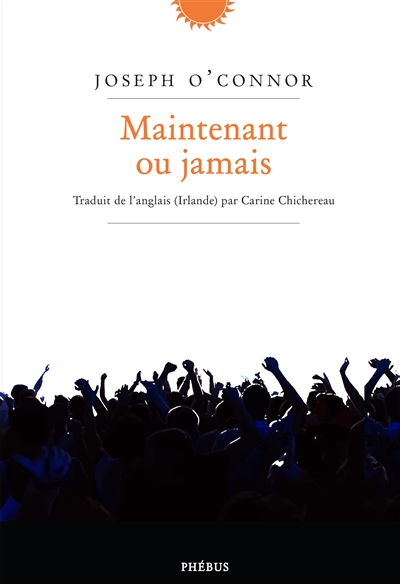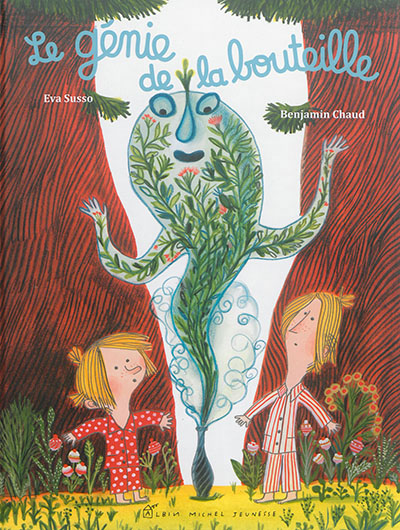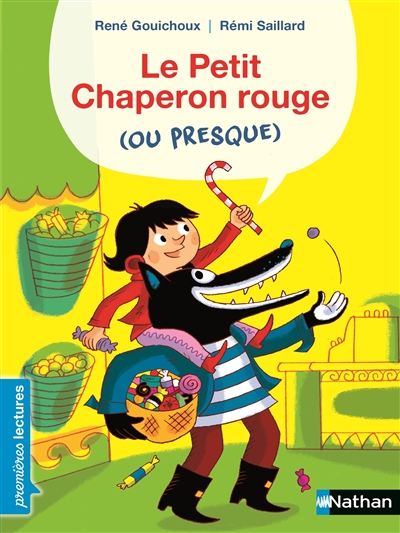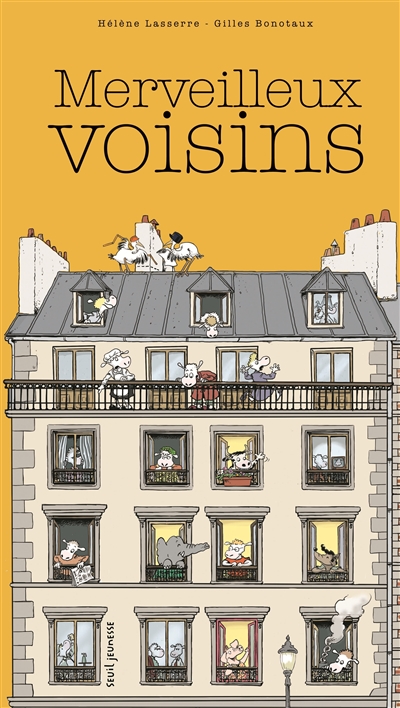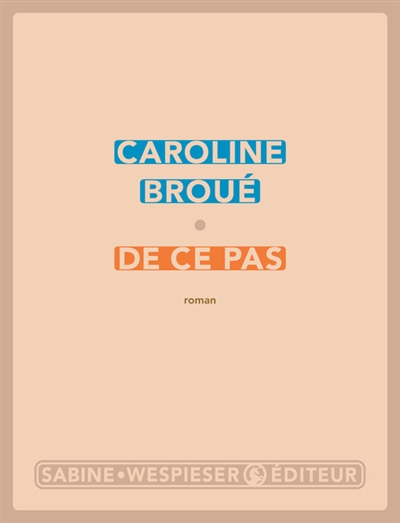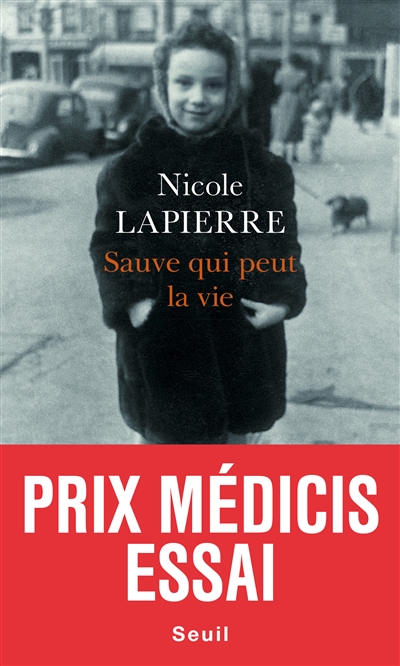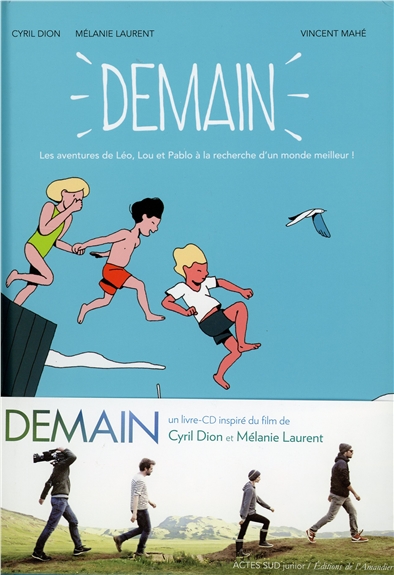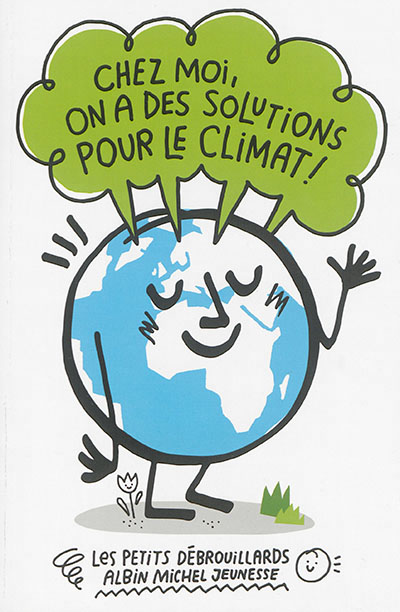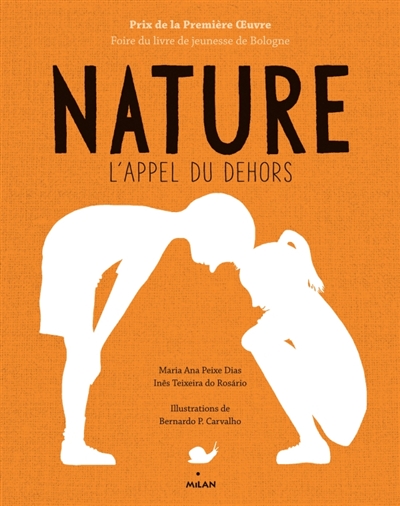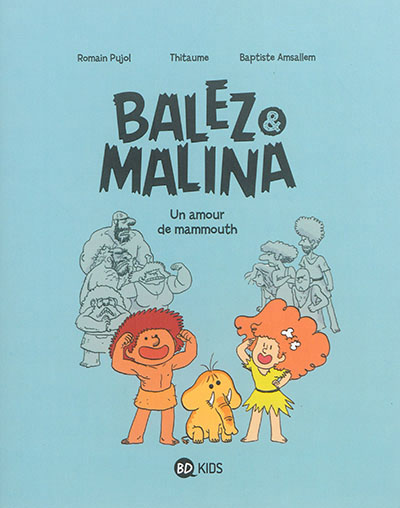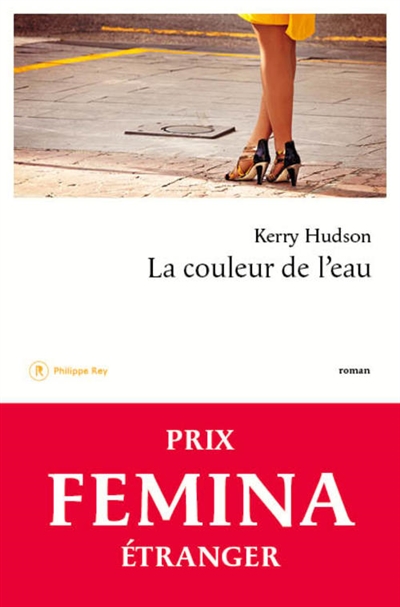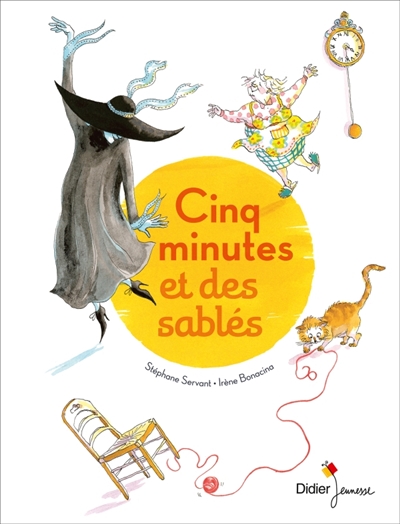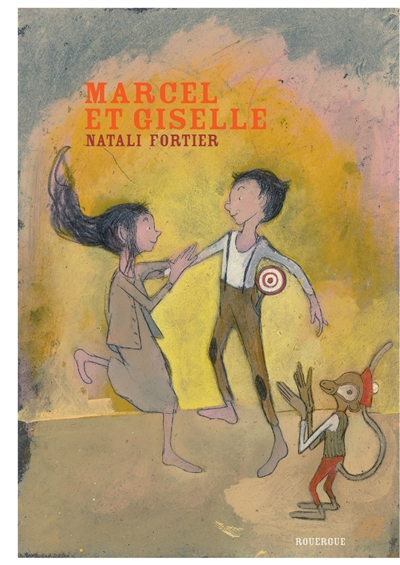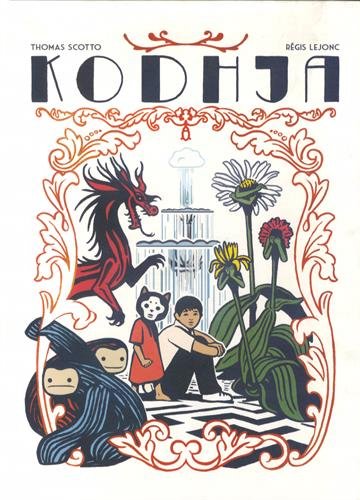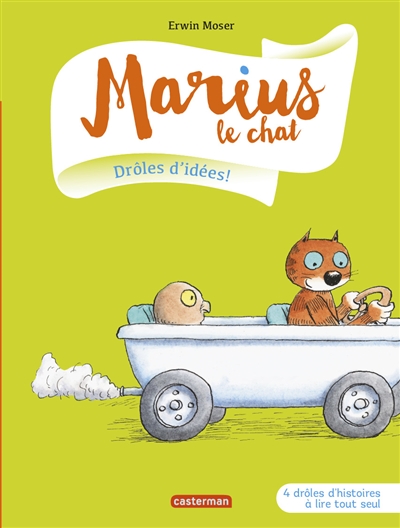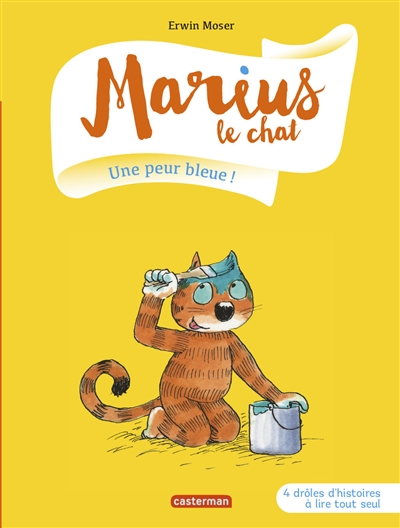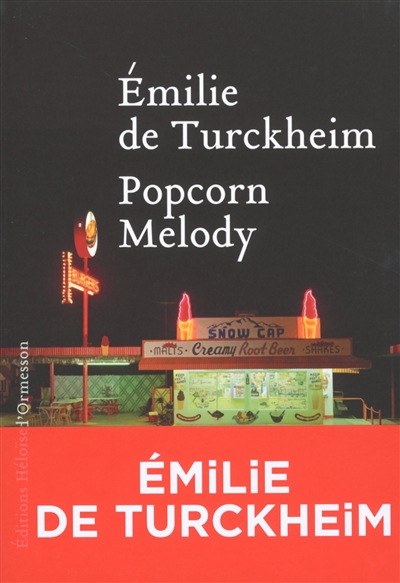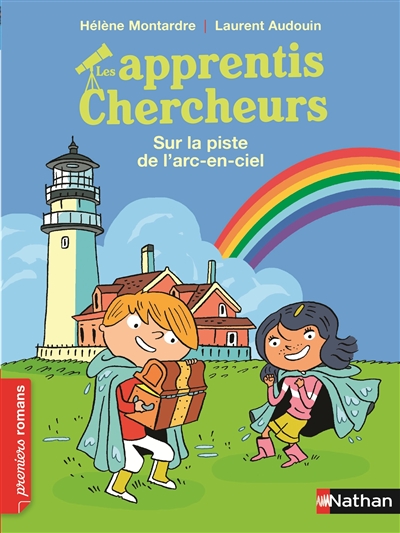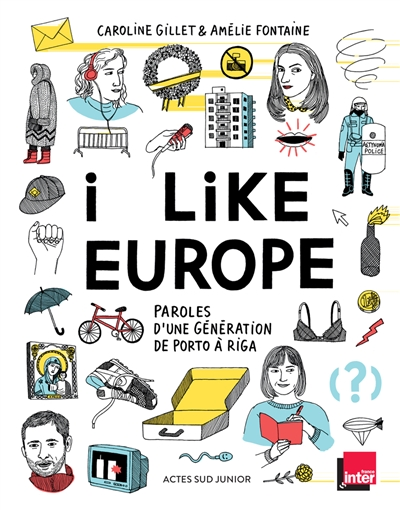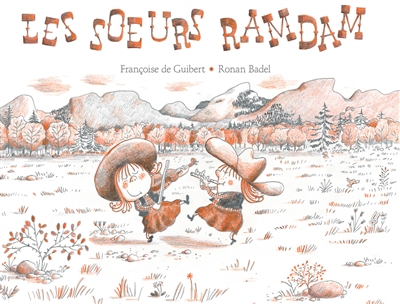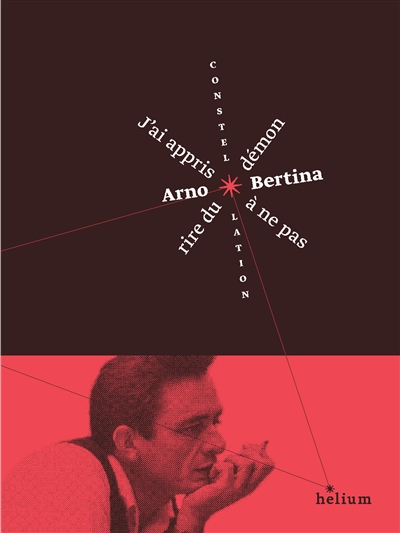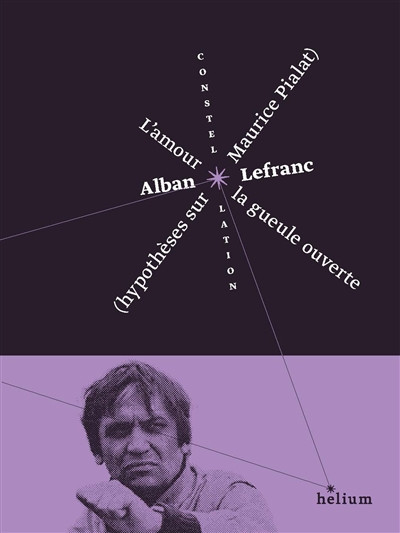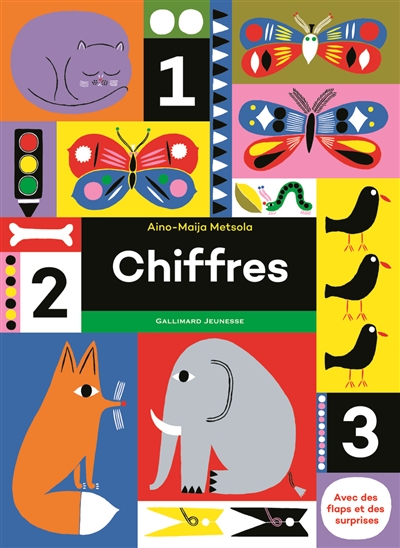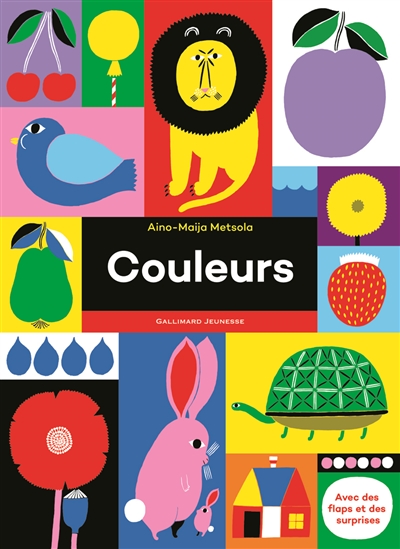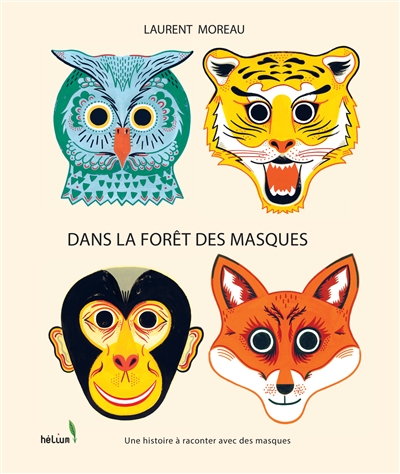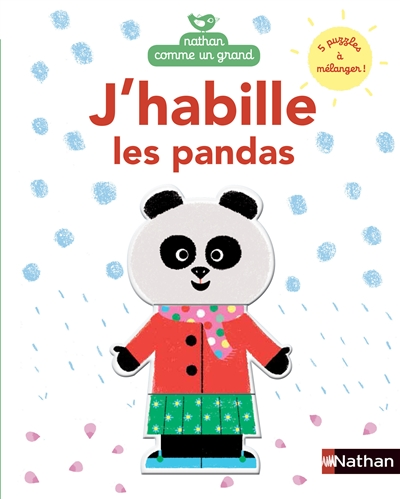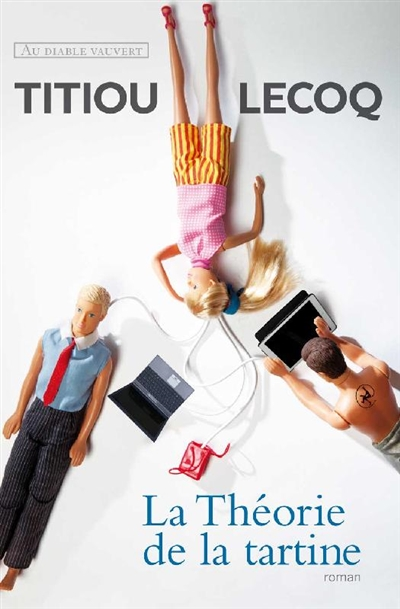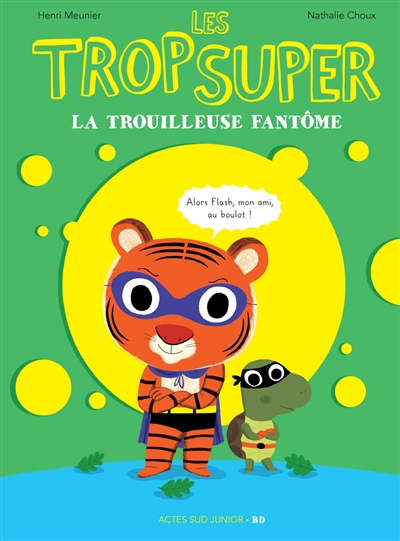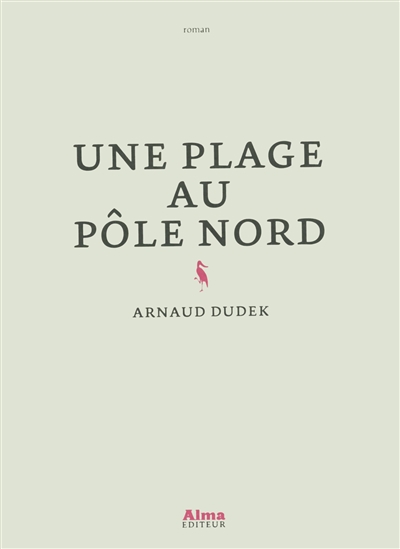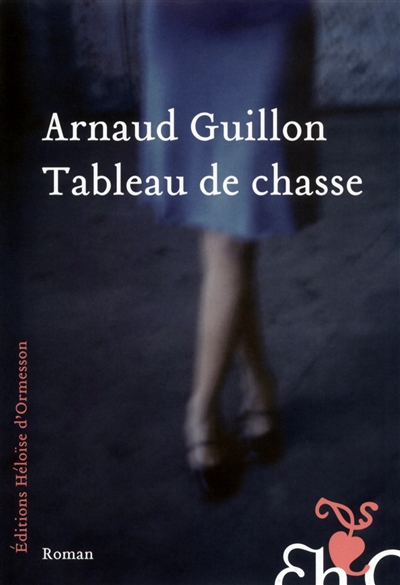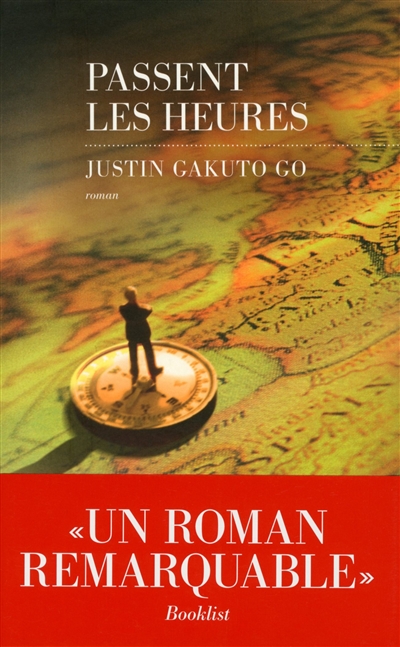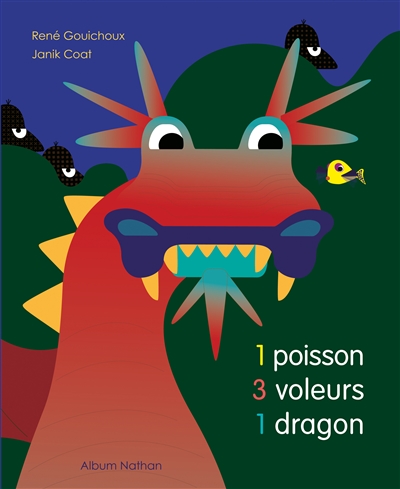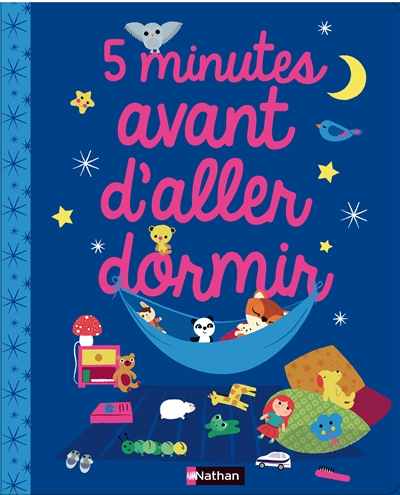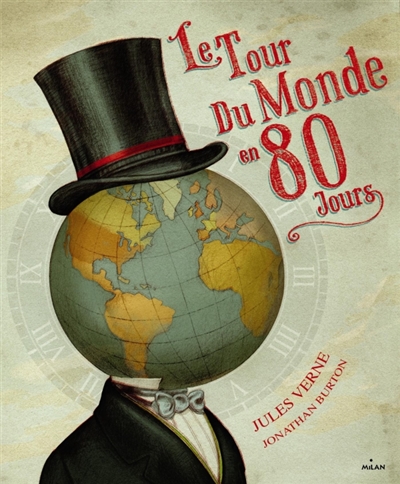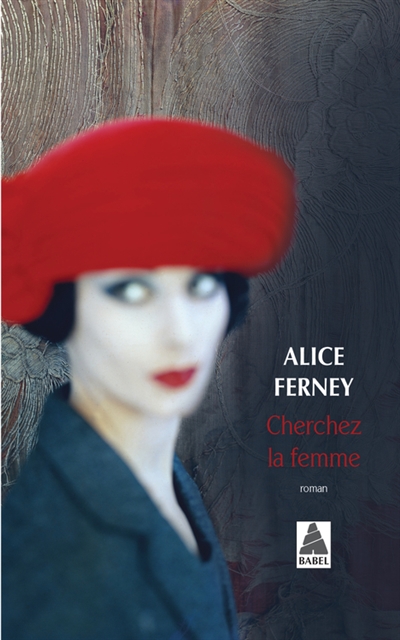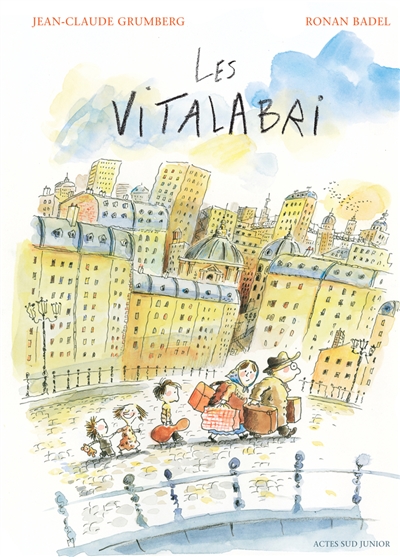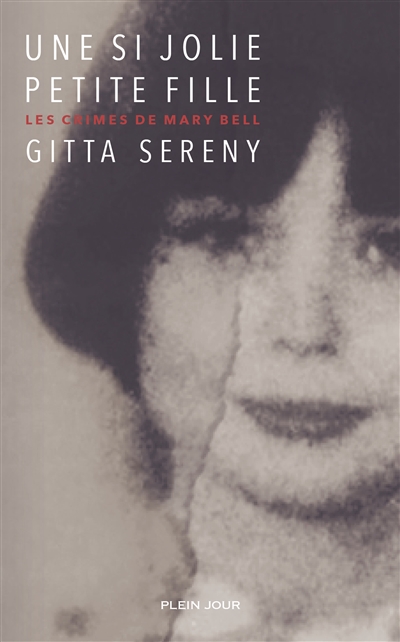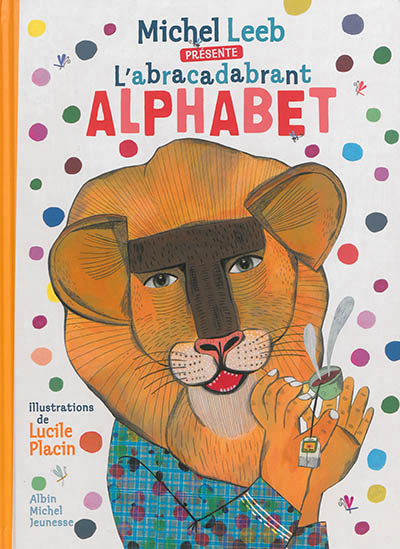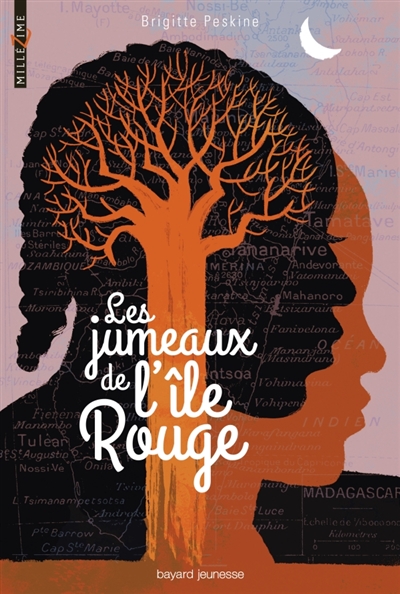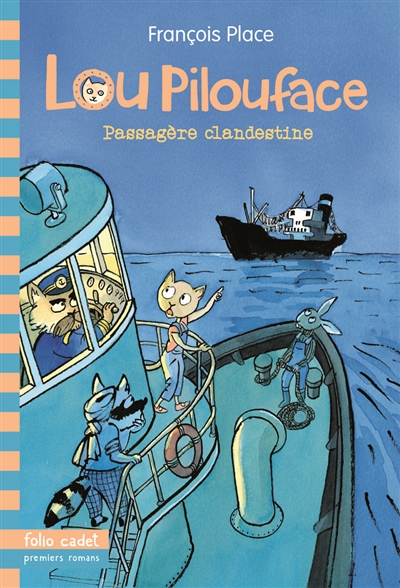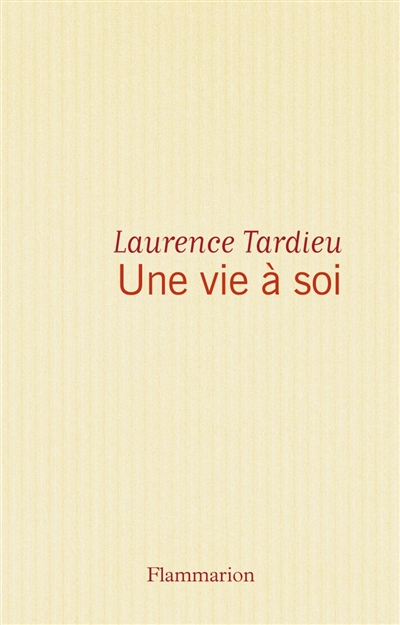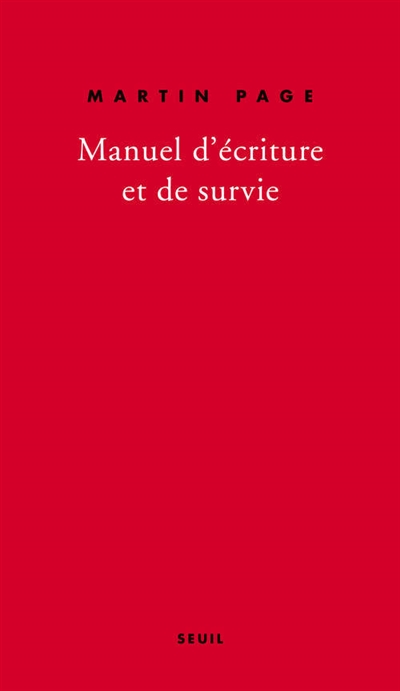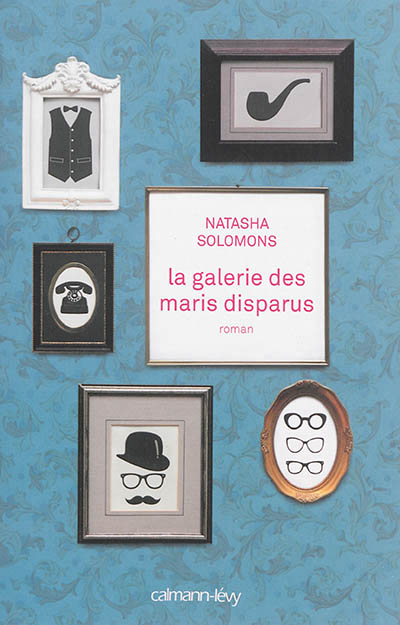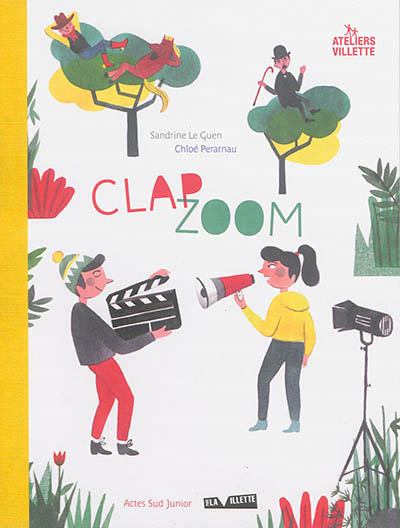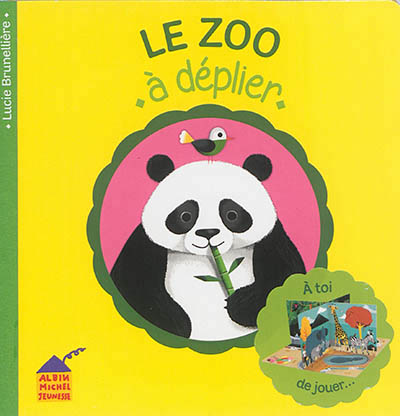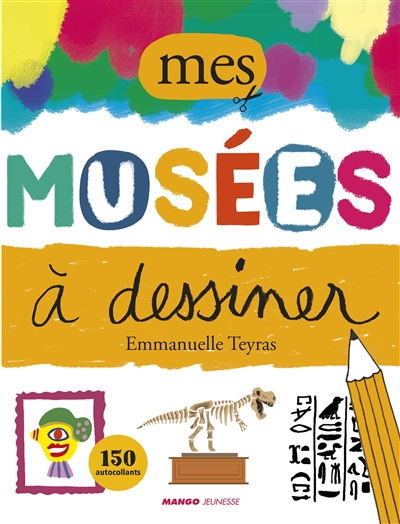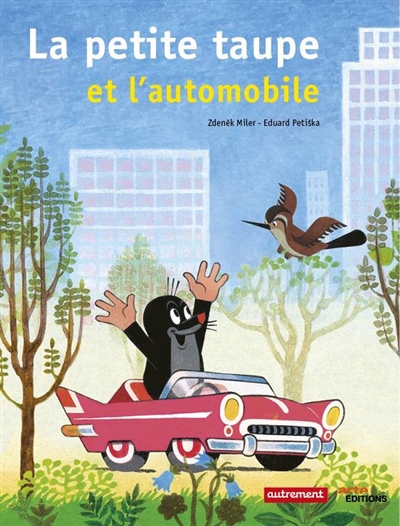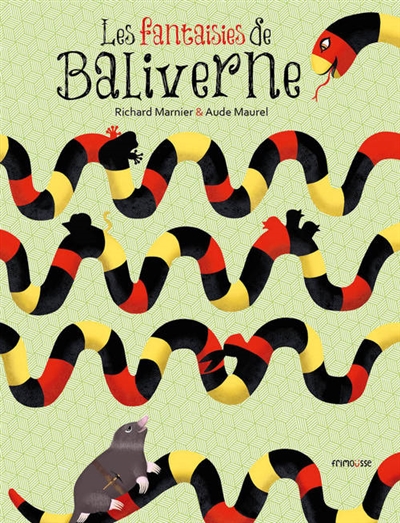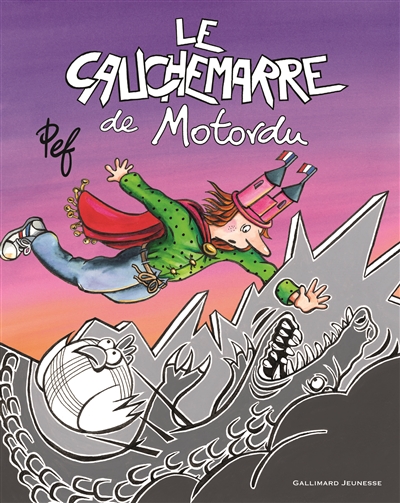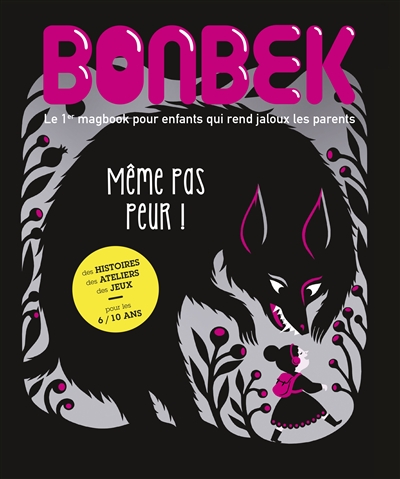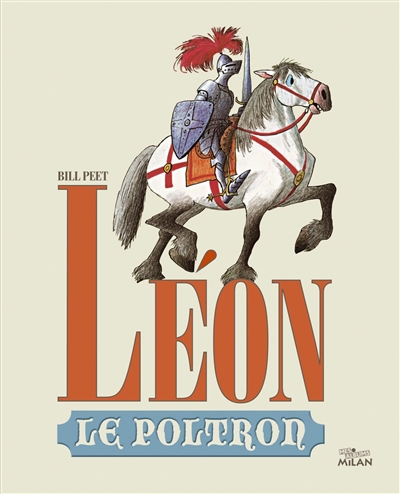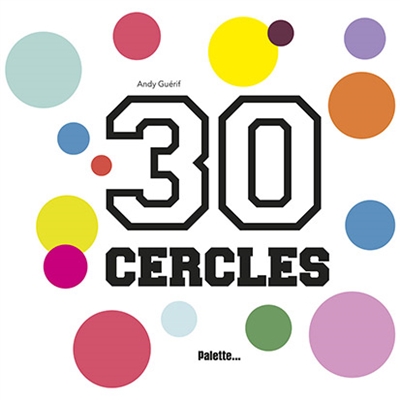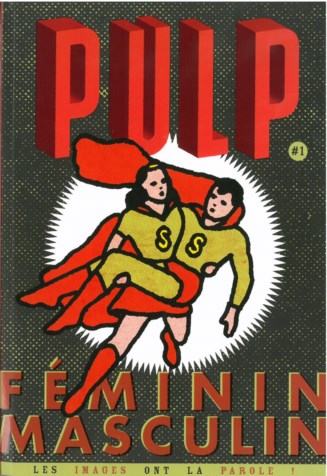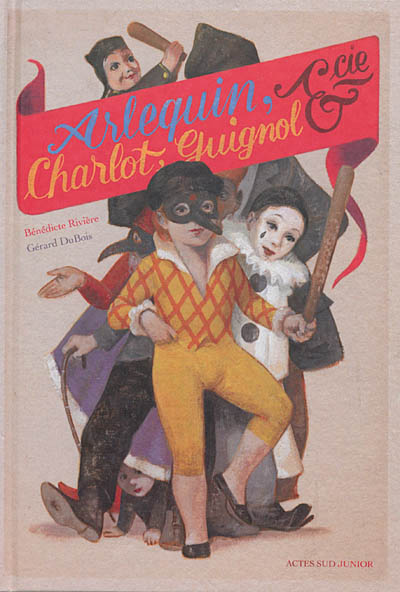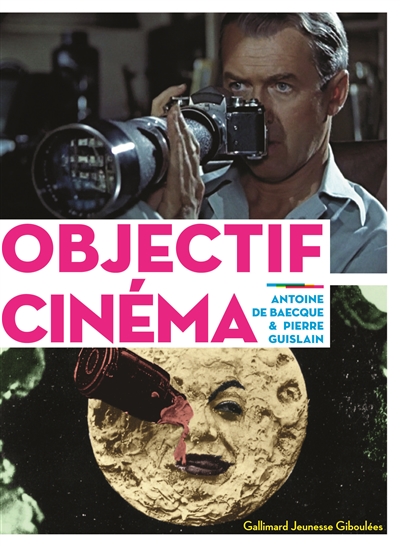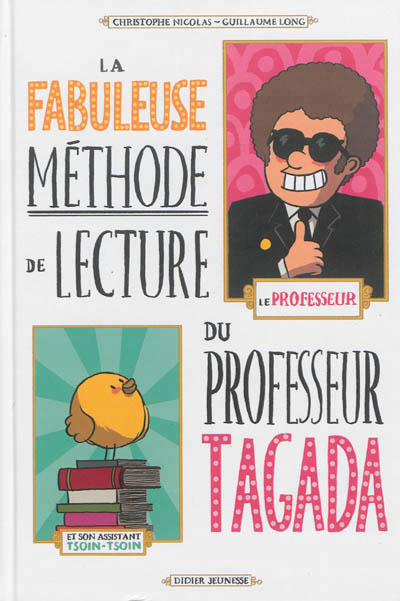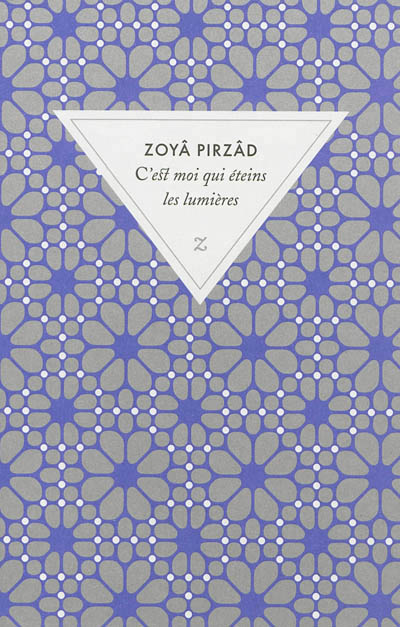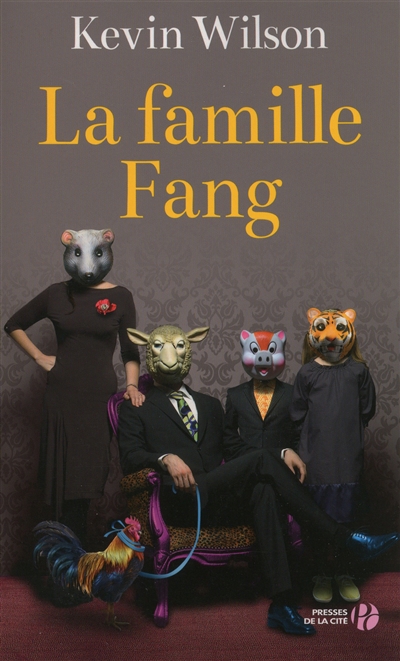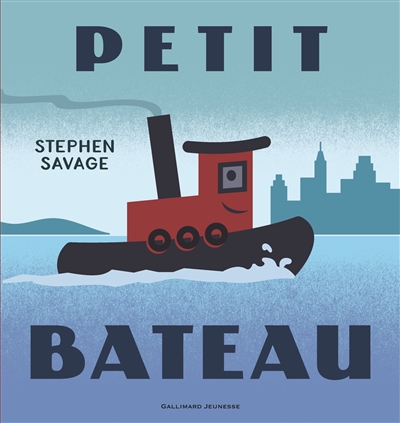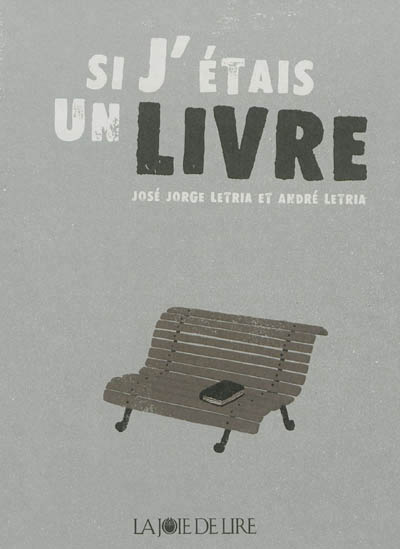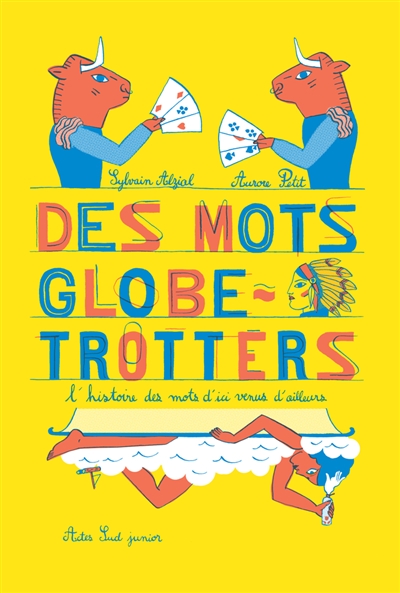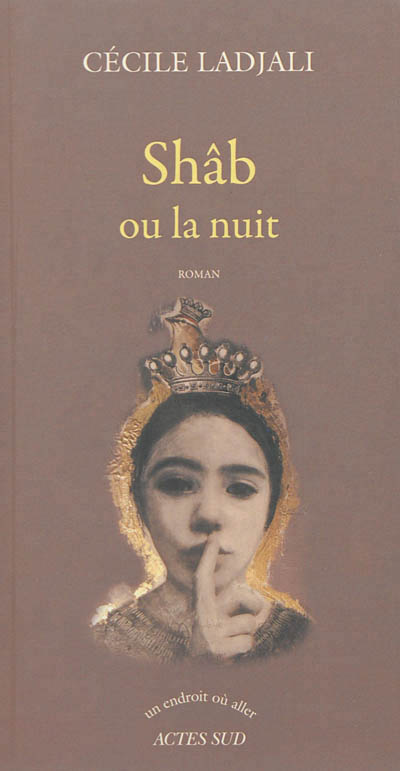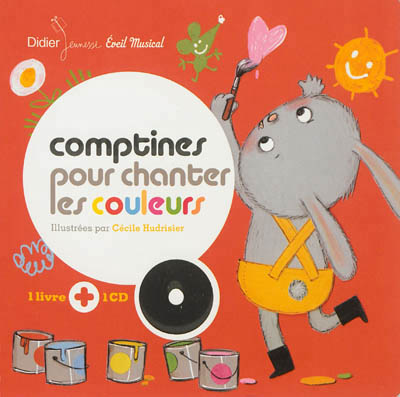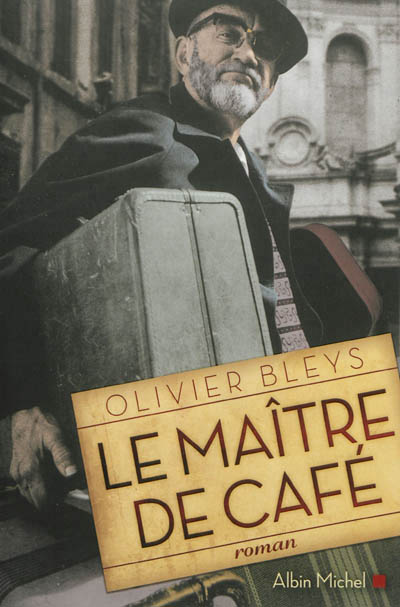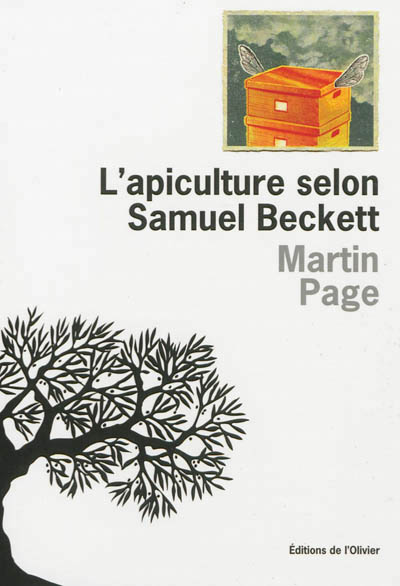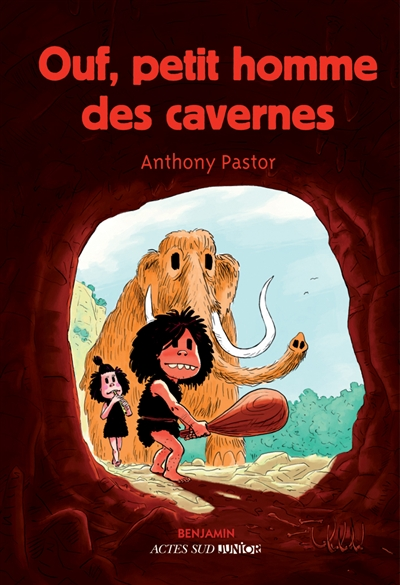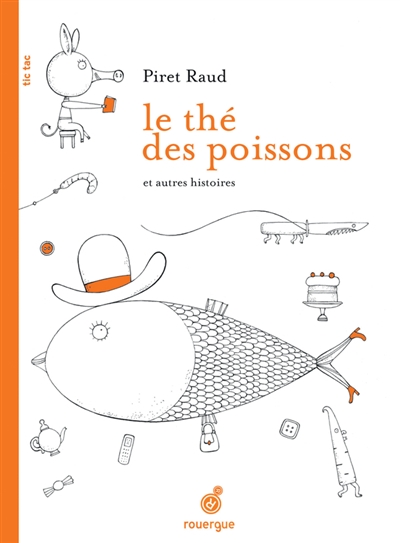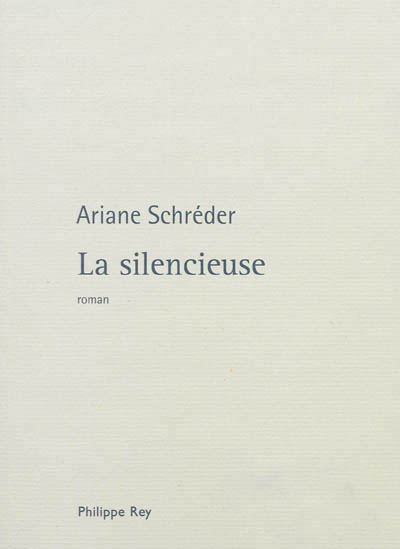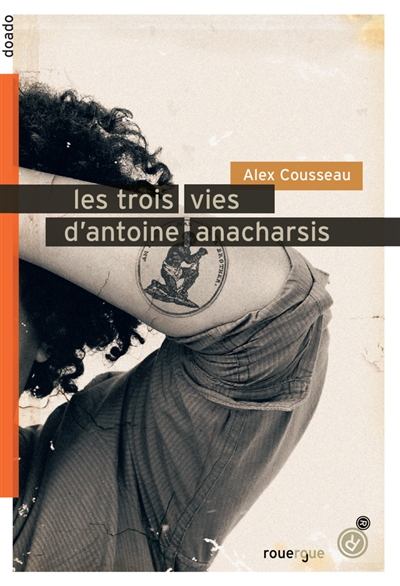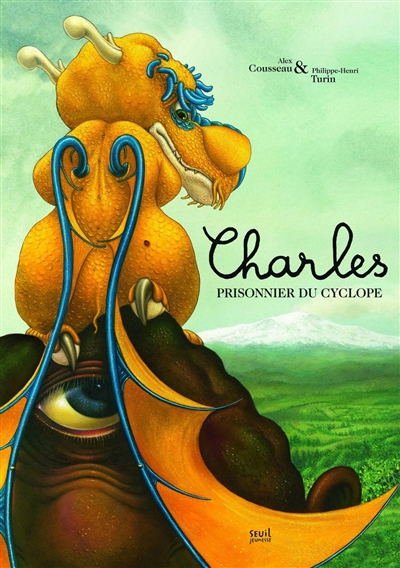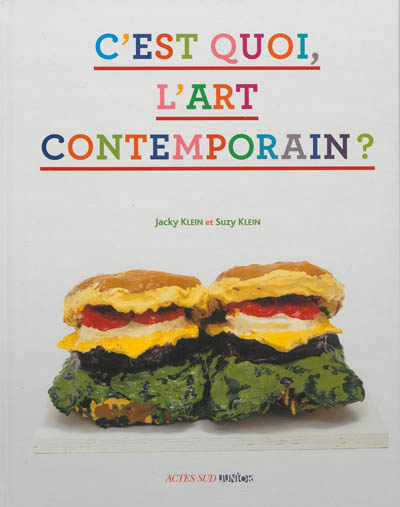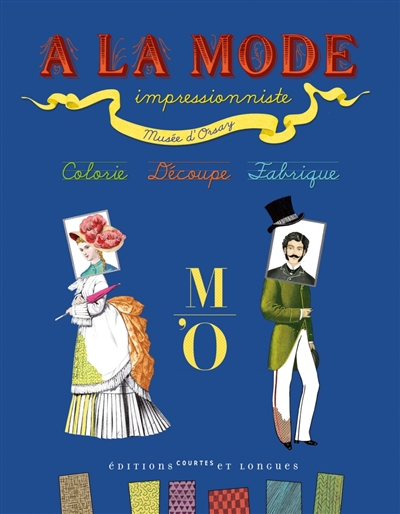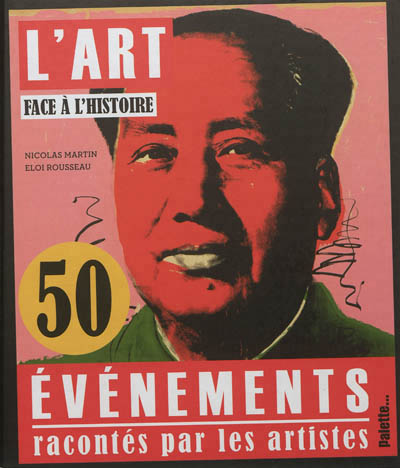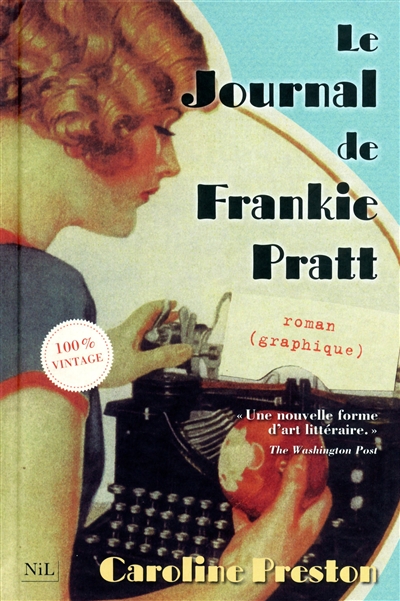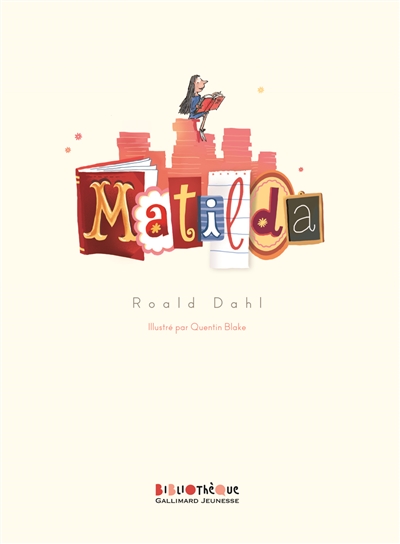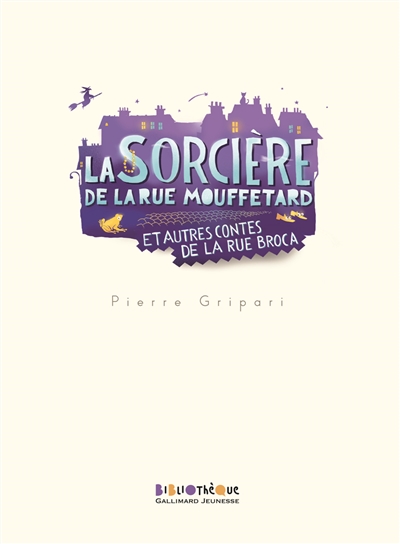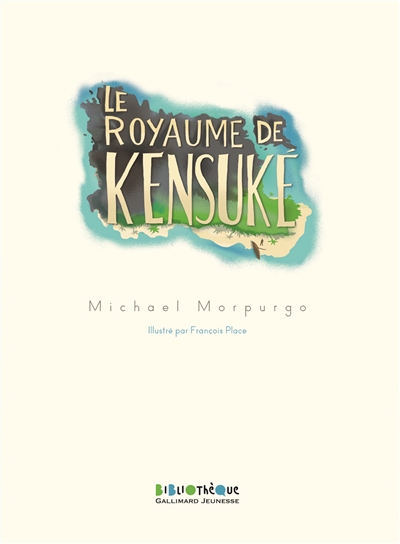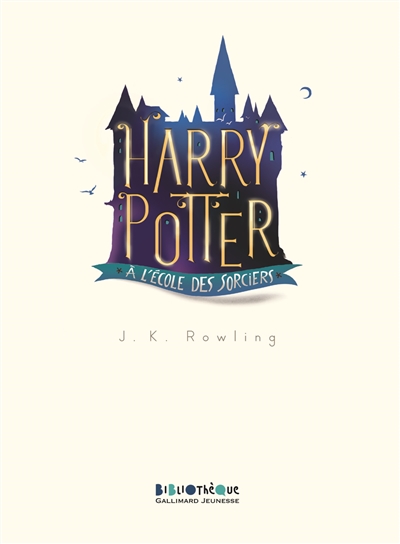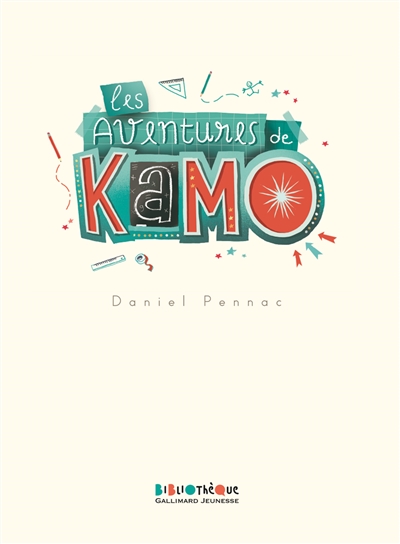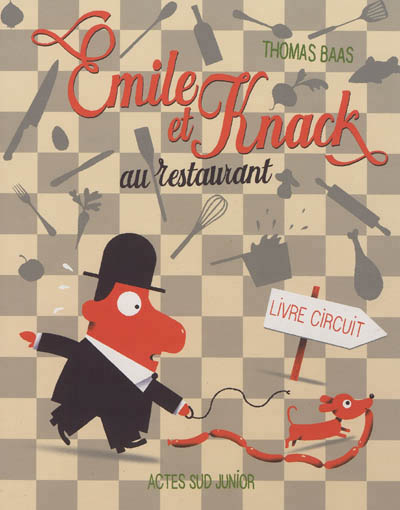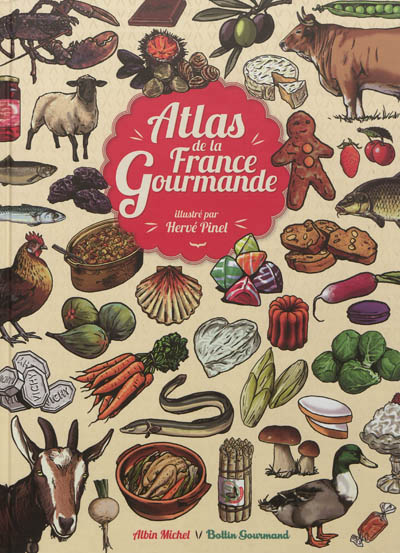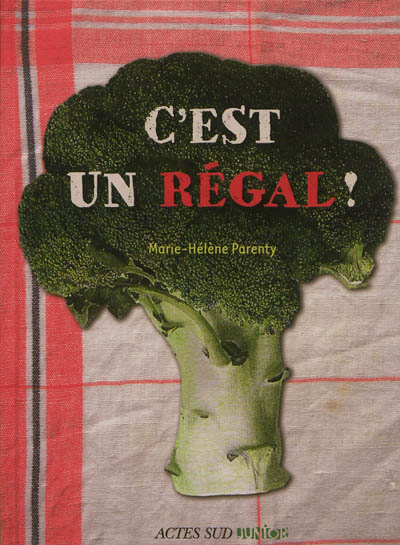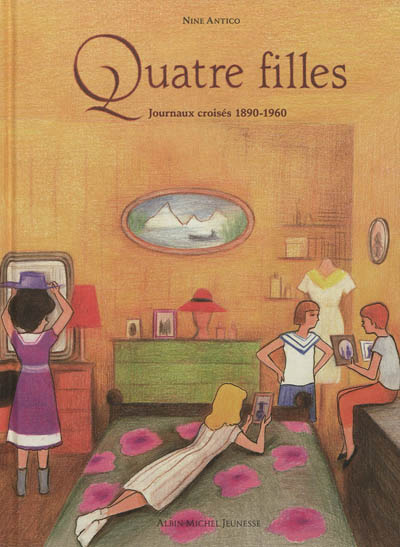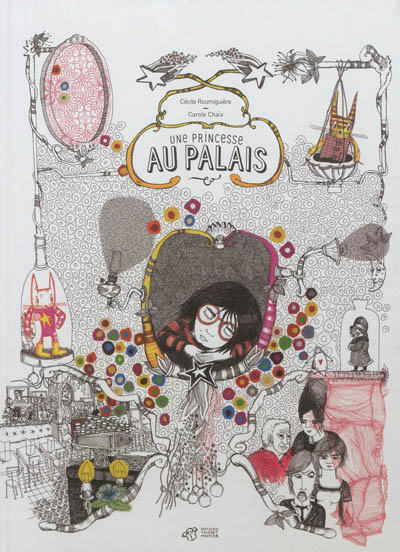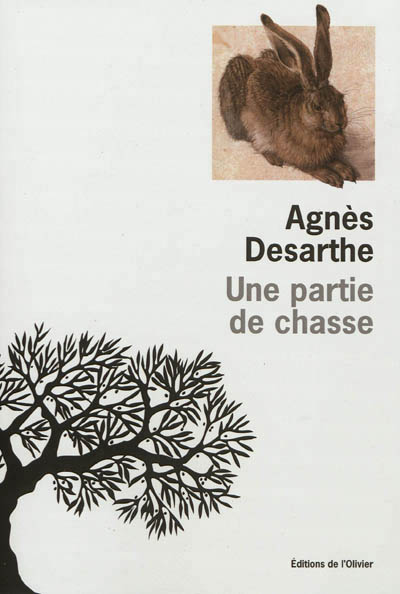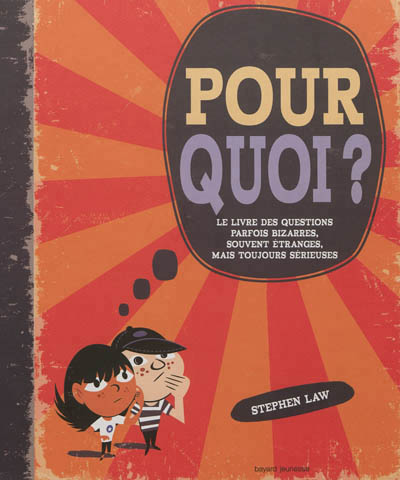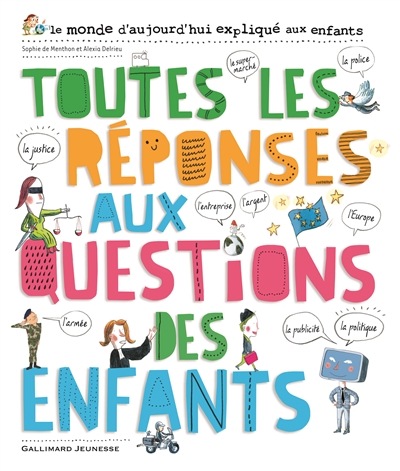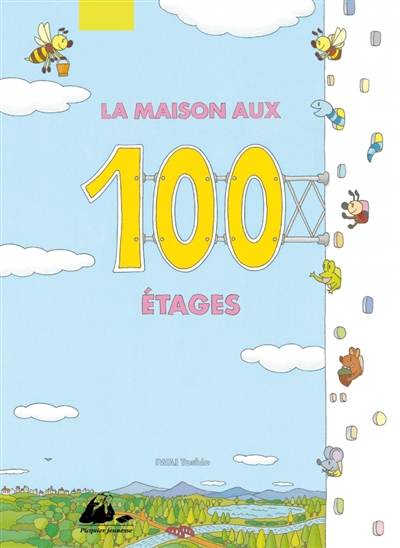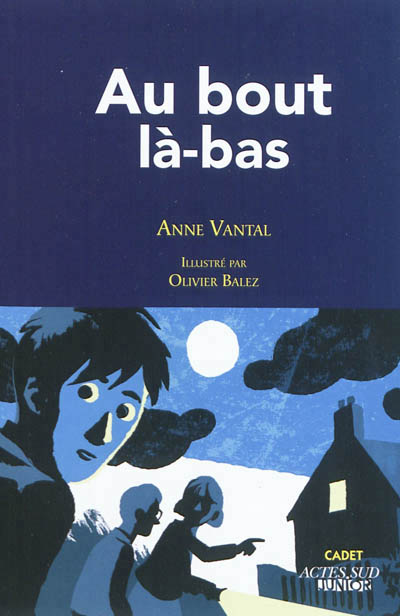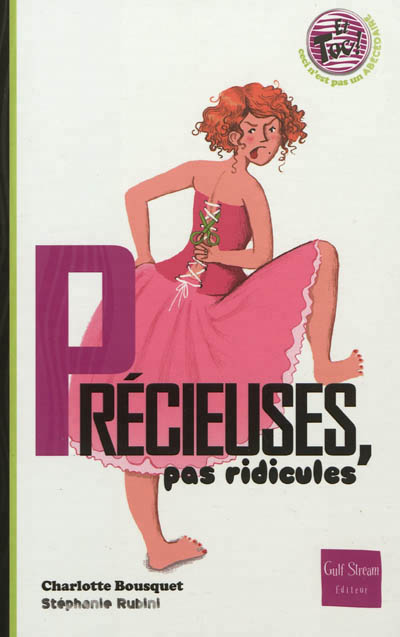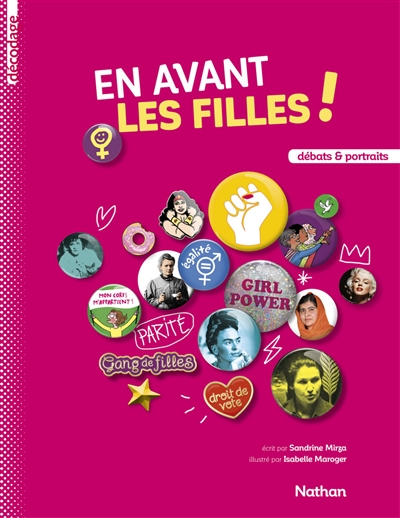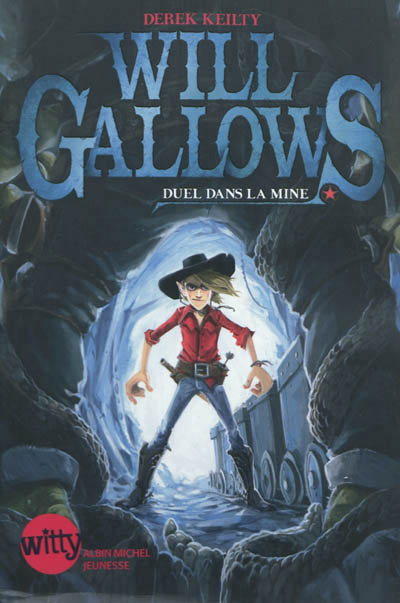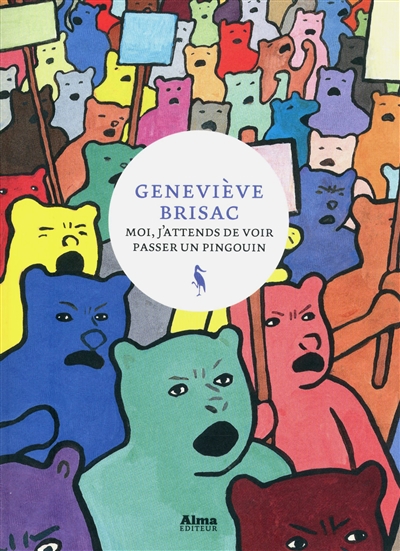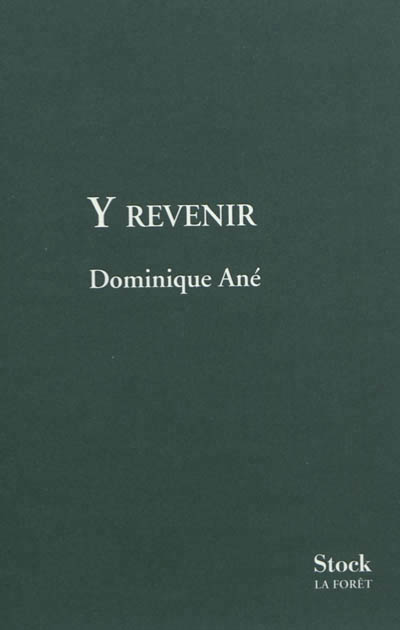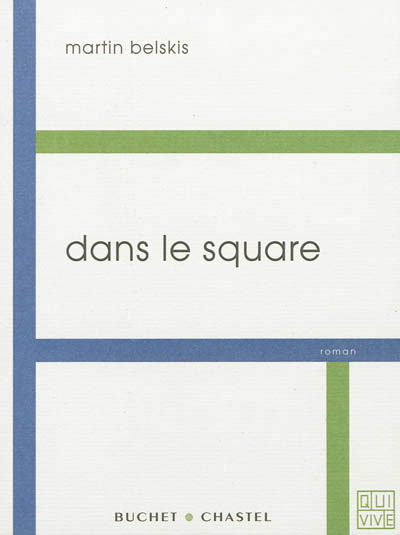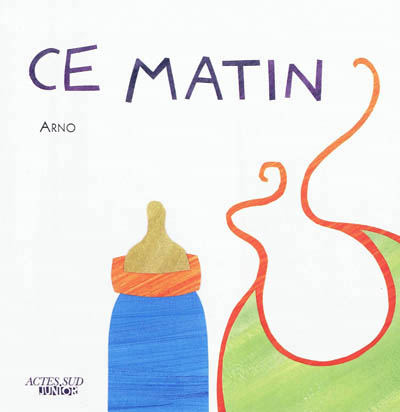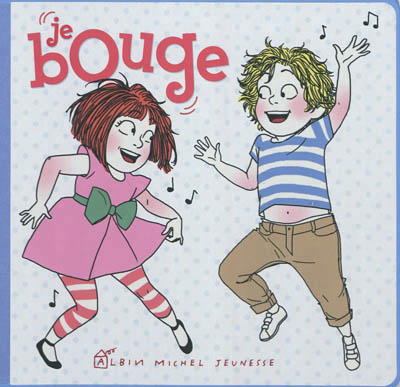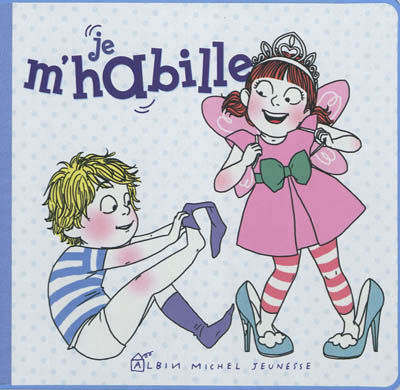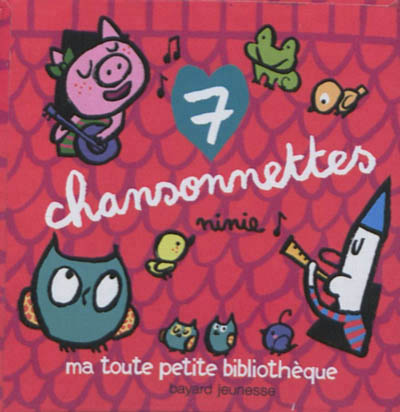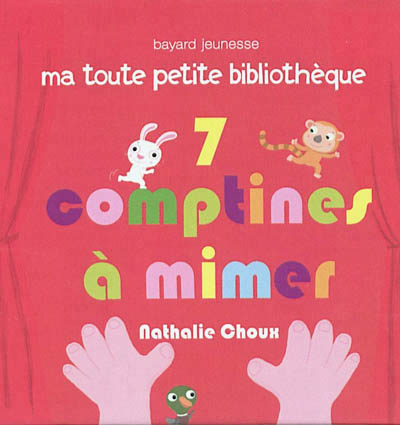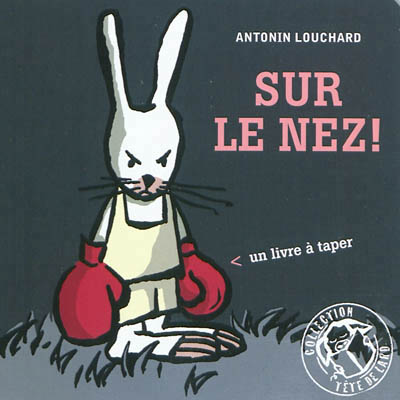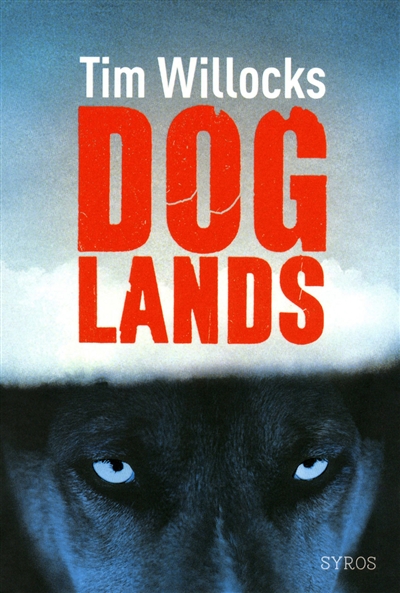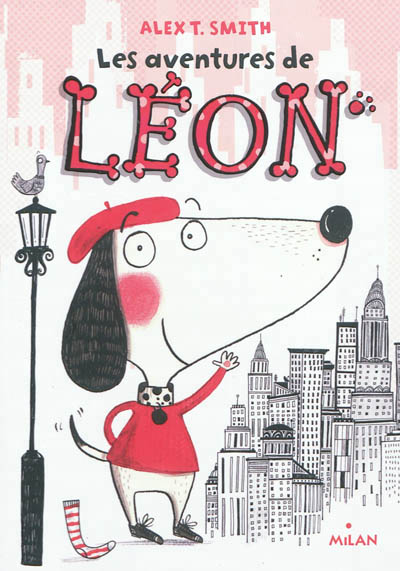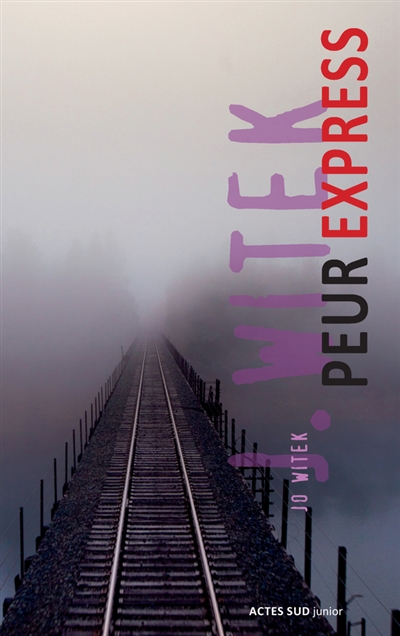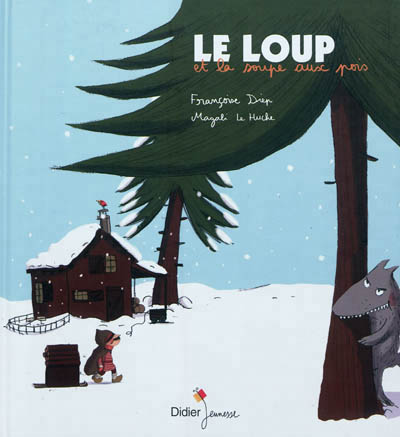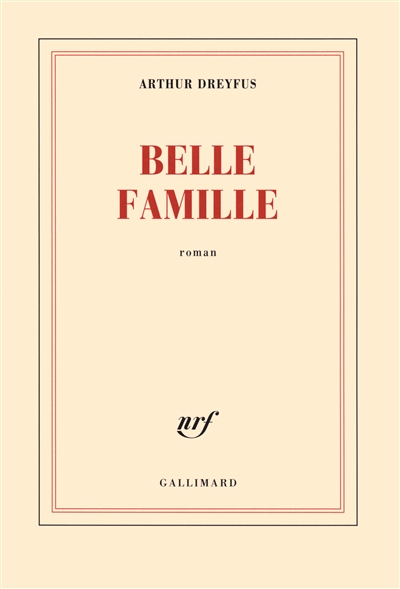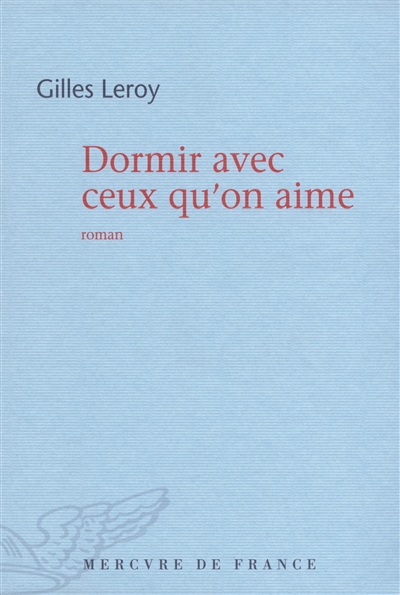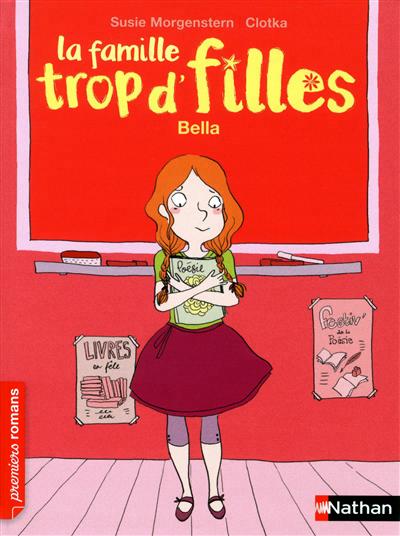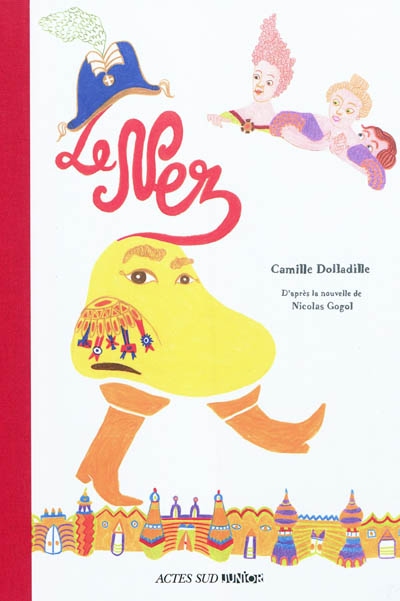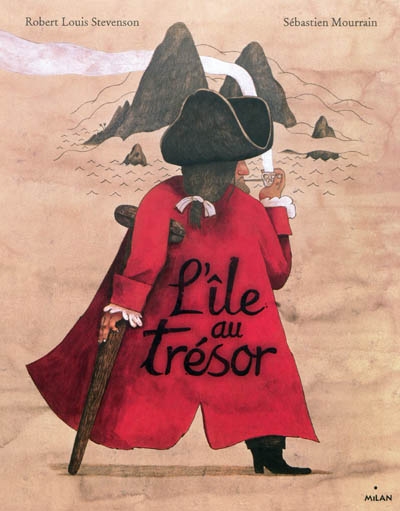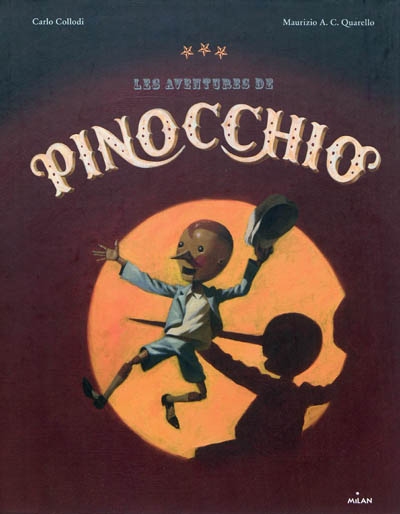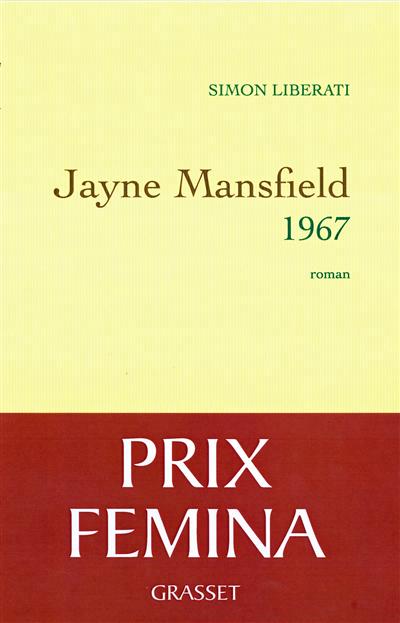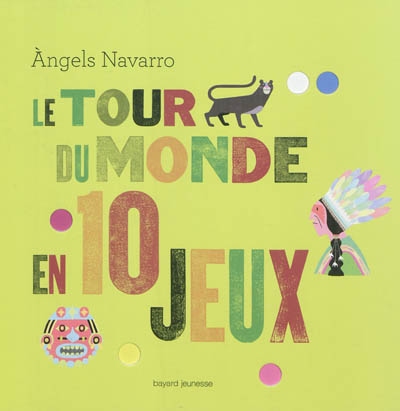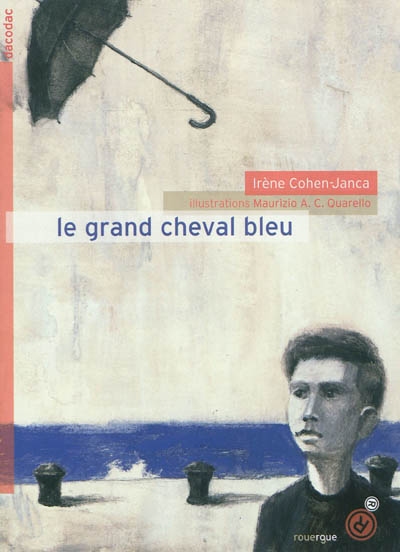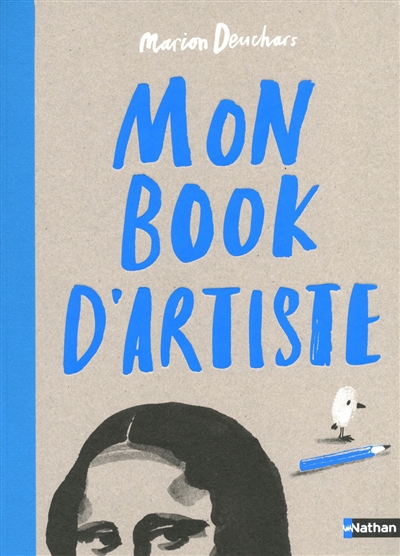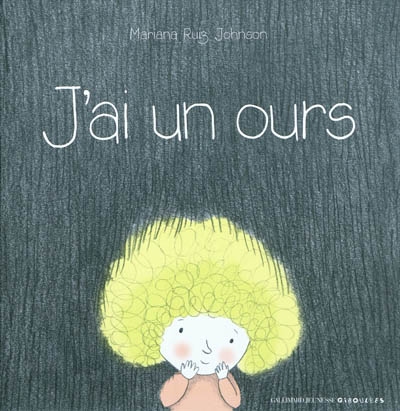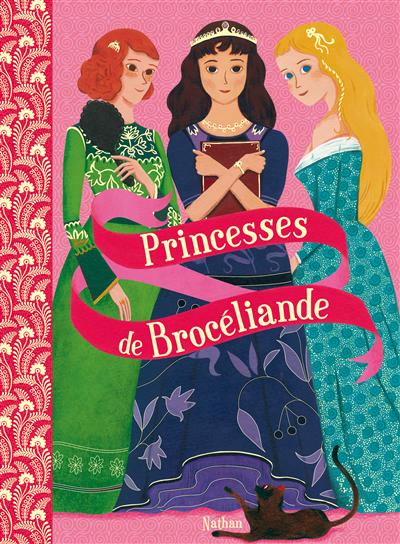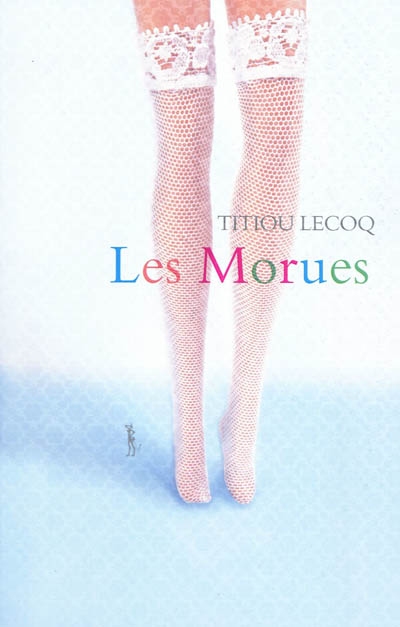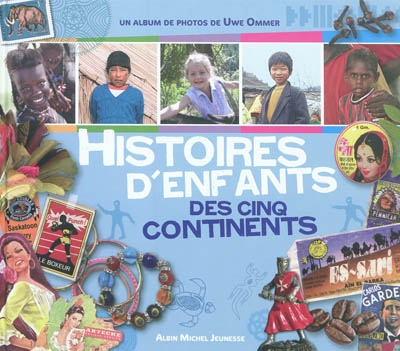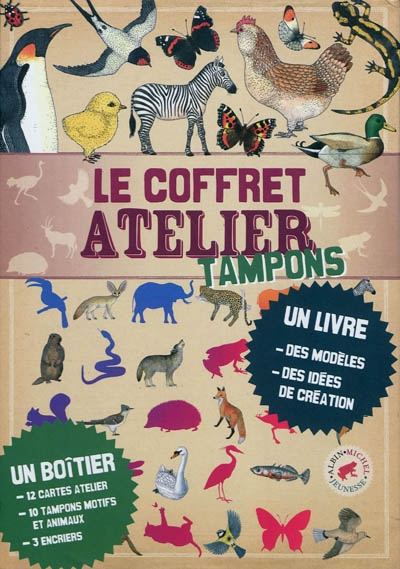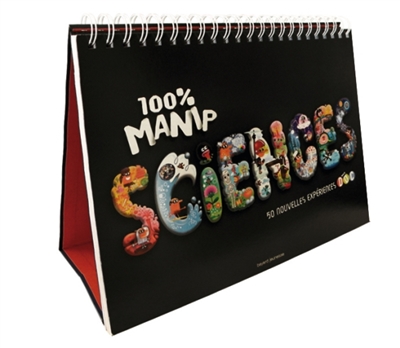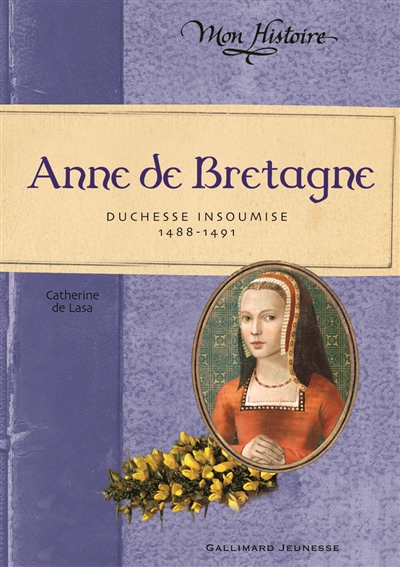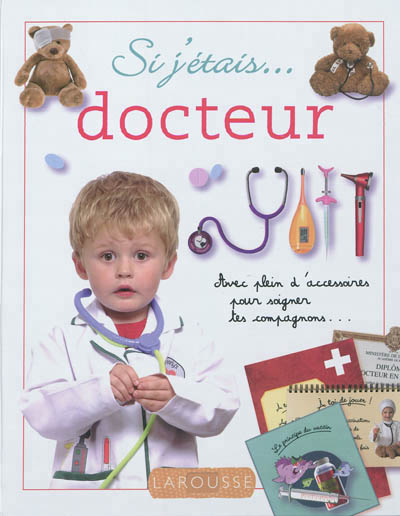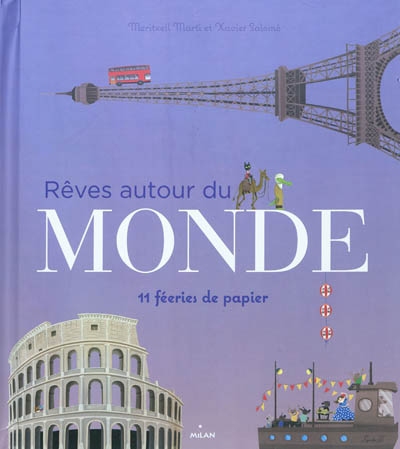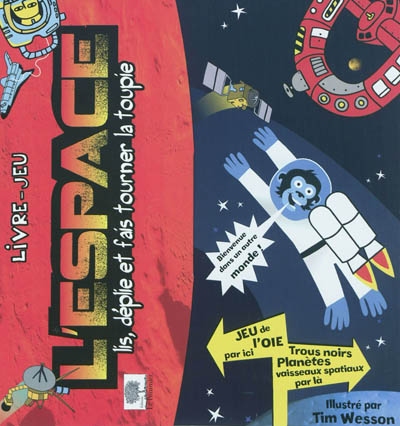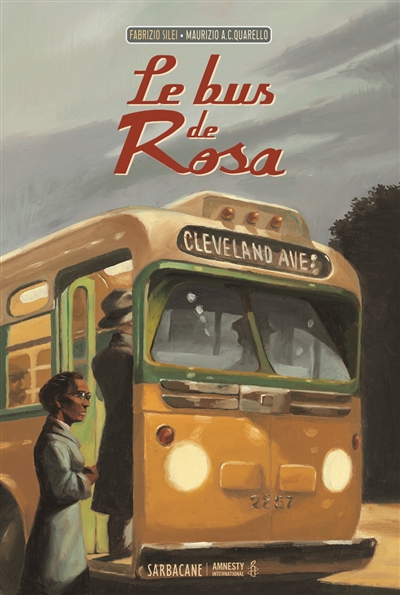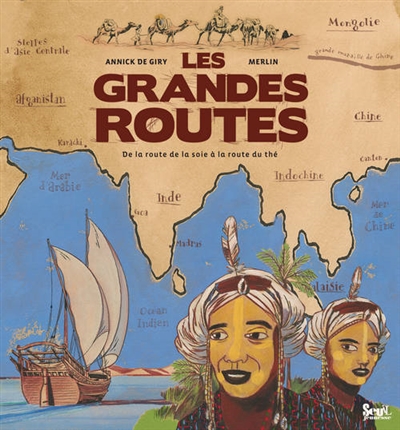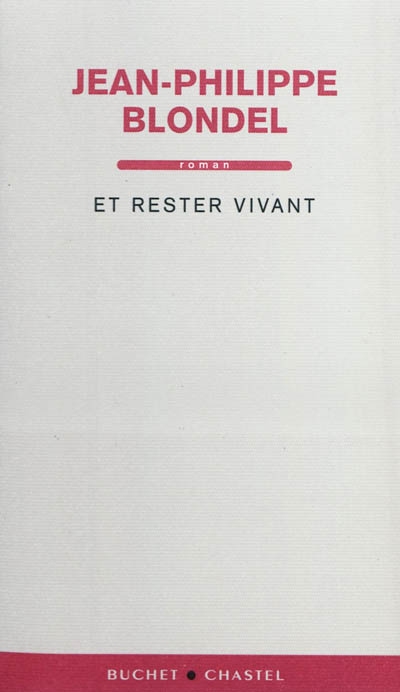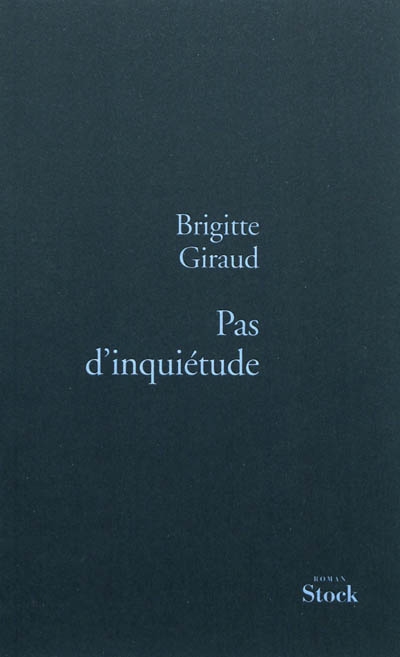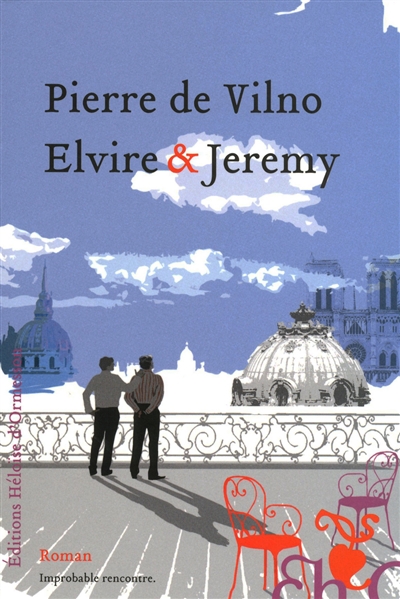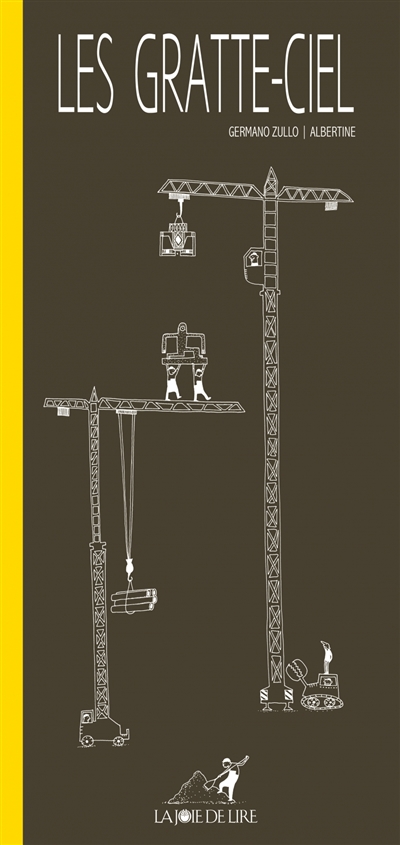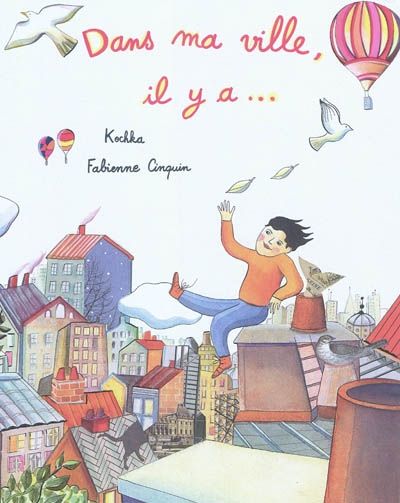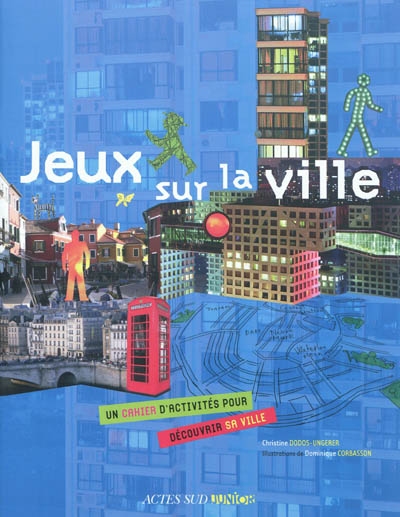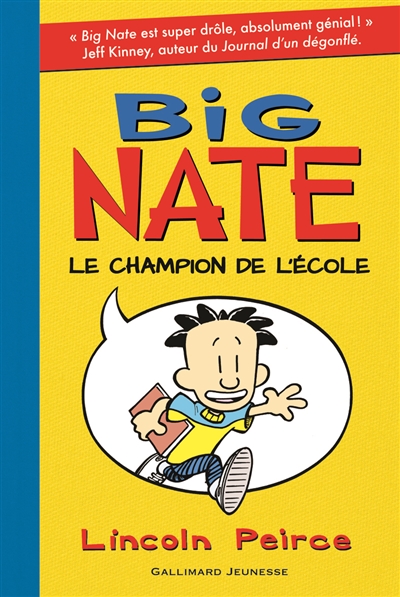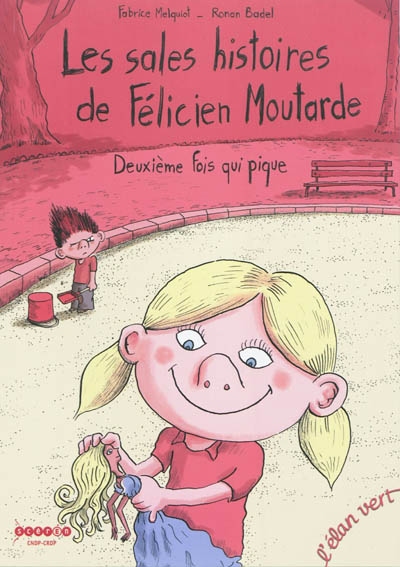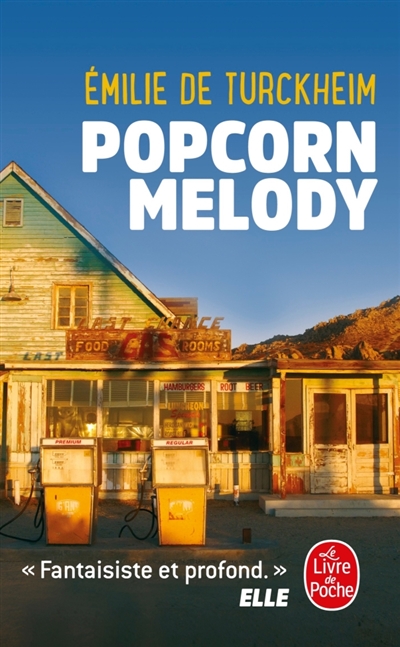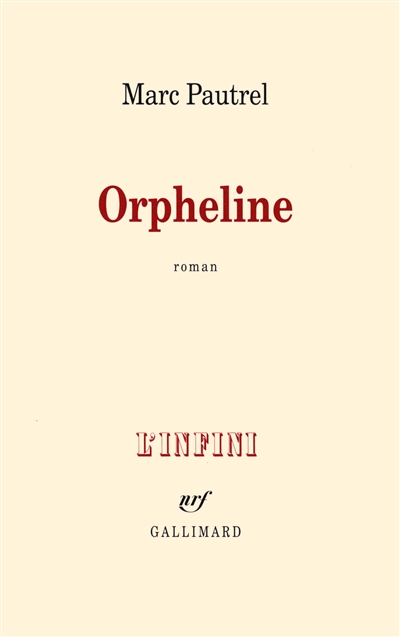Littérature française
Agnès Desarthe
Comment j’ai appris à lire
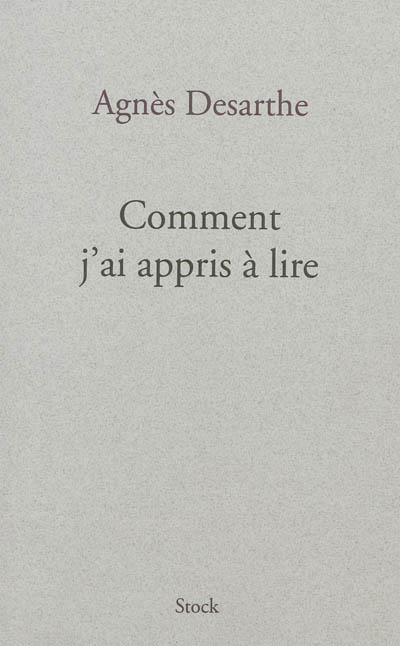
-
Agnès Desarthe
Comment j’ai appris à lire
Stock
02/05/2013
180 pages, 17 €
-
Chronique de
Aurélia Magalhaes
Bibliothèque/Médiathèque Hélène Oudoux (Massy) -
❤ Lu et conseillé par
7 libraire(s)
- Jean-Pierre Agasse de Actes Sud (Arles)
- Julie Uthurriborde de Montmartre (Paris)
- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)
- Aurélia Magalhaes de Hélène Oudoux (Massy)
- Pauline Fouillet de Livres et vous (Ruffec)
- Julia Lahoz de Nemo (Montpellier)
- Marie-Jo Sotto de Goulard (Aix-en-Provence)
✒ Aurélia Magalhaes
(Bibliothèque/Médiathèque Hélène Oudoux, Massy)
Il est difficile de savoir ce que sont un « bon » et un « mauvais » lecteurs tant ce qui se passe lors de la lecture d’un livre est mystérieux et intime. Ce qui est sûr, c’est que l’on n’accède pas au plaisir de lire dans la contrainte, mais lorsque l’on prend conscience de ce que l’on fait en ouvrant un livre.
Page — On entend souvent déplorer que leurs enfants n’aiment pas lire. Vous-même revendiquez ne pas avoir aimé lire et être devenue finalement une grande lectrice. Pensez-vous qu’il y ait une fatalité lorsqu’un enfant refuse de lire ?
Agnès Desarthe — Je suis un bon exemple pour répondre non à cette question. Ce que j’ai découvert en écrivant le livre c’est que tout en disant que je n’aimais pas lire, je me souviens pourtant avoir lu des livres avec plaisir. La lecture devient un problème si l’on fait reposer sur elle un enjeu : social, scolaire… Maintenant on a vite fait d’étiqueter les gens, et c’est aussi l'un des effets pervers des nouvelles façons d’enseigner, qui consiste à établir des dossiers scolaires dès la maternelle et à classer les élèves en bon ou mauvais lecteur. Classification absurde. Car qu’est-ce qu’un mauvais lecteur ? Il y a quelque chose de très privé dans la lecture. Ce que j’ai envie d’interroger c’est ce que l’on fait quand on lit. Je ne crois pas qu’il y ait de cas désespérés à condition de ne pas placer un enjeu trop fort autour de la lecture et d’avoir la patience d’attendre que le déclic se fasse dans la tête des lecteurs. J’ai eu la chance de ne pas recevoir trop de pression. Mes parents m’encourageaient à lire sans me faire sentir que j’étais une idiote parce que je ne lisais pas. J'ai parfois vu de drôles de choses dans les salons du livre, comme ces enfants en âge de lire des ouvrages sans illustration qui se ruent systématiquement vers les albums illustrés, mais sont rabroués par leurs parents.
Page — Peut-on accéder à l’amour des livres par des chemins de traverse ? Apprendre à lire n’a-t-il pas à voir avec les rencontres (avec des écritures ou des formes), une sorte d’apprivoisement ?
A. D. — C’est en tout cas mon expérience. Je ne lisais pas, mais j’ai lu certains livres un nombre incalculable de fois parce qu’ils me convenaient parfaitement à ce moment-là. La question de la confiance est très importante parce qu’il y a quelque chose de très intime et de profond dans le rapport au livre. Une lecture réussie ne suffit pas nécessairement à déclencher l’amour de la lecture, mais on avance plus serein. Quand on a apprécié un auteur, il est évidemment tentant de privilégier la lecture de ses autres livres. C'est une façon de gagner en confiance dans son rapport à la lecture. Il arrive parfois aussi que l'on reste bloqué sur un livre, ou que l'on rechigne, une fois terminé un roman qui nous a particulièrement marqués, à le remplacer par un autre. On est alors persuadé que jamais aucun autre livre ne sera en mesure de procurer l'intensité de ce qu'on a ressenti à la lecture de celui-là.
La rencontre peut aussi avoir lieu par le biais de personnes physiques qui font office de passeurs dans la vie d’un lecteur. Dans tous les cas, le plaisir de lire ne s’apprend pas dans la contrainte ni dans l’opposition d’un médium avec un autre. On prétend que les enfants sont davantage attirés par les images animées au détriment des livres. C’est quelque chose que l’on entend sans arrêt. Les images de toutes sortes envahissent toujours davantage le quotidien des enfants, ce qui aurait des conséquences dramatiques sur la lecture. Opposer image (au sens large : les films, les vidéos, les consoles de jeux, toutes les petites choses que manipulent les enfants avec des images animées…) et texte est, à mon avis, un combat perdu. Accuser un médium pour en favoriser un autre ne fera pas avancer le débat. En quoi l'un est-il meilleur que l'autre ? J’ai l’impression pour ma part, que, au contraire, les deux se complètent et s'enrichissent mutuellement. Mais les deux modes d’expression jouent un rôle dans le développement de l’imaginaire. Le rapport qui s’établit avec le livre est une autre étape qui se fait avec le temps, à condition de ne pas stigmatiser le lecteur en fonction de sa manière de pratiquer la lecture.
Page — On entend souvent dire que lire est une pratique solitaire, voire isolante, pourtant dans votre livre vous dites que vous êtes devenue lectrice en devenant « sujet » du verbe lire. Apprendre à lire serait donc tout sauf passif ?
A. D. — C’est la découverte que le livre n’était pas un objet mort mais le lieu de dépôt d’une parole toujours vivante qui a été décisive. Le livre devenait le contraire de la solitude, c’est-à-dire la possibilité inouïe d’entrer en contact avec des centaines de personnes à travers les siècles ou le monde. Cette dimension-là m'a longtemps échappé. Plus jeune, je ne la recherchais pas. Peut-être parce que je n’en avais pas besoin ou parce que j’en avais peur. Mais la découverte qu'en lisant, on entre aussi en contact avec une personne, parfois lointaine, parfois même morte, m’a paru une occasion inouïe, une chance prodigieuse. J'ai vécu cette découverte comme une révélation fantastique. De plus, si lire se pratique seul, je n’ai pas du tout l’impression que ce soit une activité isolante : il arrive souvent que des amitiés réelles se fondent sur le partage d’une amitié commune avec un livre ou un auteur. Enfin, il existe une lecture en partage lorsqu’on lit à haute voix, pas seulement dans le cadre familial ou lors de rencontres dans des médiathèques, mais aussi entre amis. Cette pratique pas du tout solitaire peut être un moment très intense.
Page — Votre livre s’organise un peu comme une enquête, comme si en remontant à votre apprentissage de la lecture, vous aviez appris à vous connaître. La pratique de la lecture est-elle un moyen de mieux se connaître ?
A. D. — J’ai vécu l’écriture de ce livre comme une enquête au premier degré. J’avais une piste, « quand j’étais enfant, je n’aimais pas lire », et il m’a fallu rechercher dans mes souvenirs, vérifier les sources. Il fallait savoir à quoi cette phrase faisait écran et pourquoi. Mais je n’avais pas la réponse à ces questions avant de commencer le livre. Et en m’asseyant chaque jour à ma table de travail, je n’avais absolument aucune idée de ce que j’allais faire. J’avais un plan assez vague et je ne savais pas sur quoi j’allais tomber.
Quant à la connaissance de soi-même que la lecture permettrait, je ne suis pas sûre qu’il faille rechercher une forme d’identification dans les livres. On parle beaucoup d’identification dans le processus de la lecture, comme si le livre devait forcément être un miroir. Il y a toutefois un piège dans cette idée de miroir. On risque, en voulant correspondre à une image idéale de soi, de passer à côté de ce que l’on est vraiment. Pour que la vraie rencontre avec le texte se produise, il faut accepter la très légère prise de risque qu’il y a à se laisser porter par le livre. C’est dans le cadre de ce détour que l’élaboration se produit, que l’on peut prendre du recul avec ce que l’on est et que l’on découvre des choses sur soi. Cette connaissance ne se trouve que si on ne la cherche pas.
Page — En créant un espace particulier, en dehors de toute frontière et de tout jugement, la pratique de la lecture n’est-elle pas un moyen unique pour aller à la rencontre de l’autre ? Plus que le moyen d’être instruit, celui d’acquérir une véritable intelligence ?
A. D. — Je ne pense pas que l’on puisse penser la lecture en terme de but. C’est vraiment un domaine où doit s’exercer la plus grande liberté. La littérature, les arts en général, sont au-delà du rationnel. Certaines formes de pensée ne peuvent être ébranlées que par une expérience artistique ; c’est le seul moyen de défaire des nœuds affectifs qui se sont solidifiés dans une expérience de la vie. On ne naît pas intolérant. Tout cela parce que l’art fonctionne sur l’affectif et l’intuition. Il travaille à des endroits auxquels on n’a que peu accès. C’est pour cela que j’élargirais à tous les enseignements artistiques qui devraient, idéalement, être au même degré. Il n’y a pas de raison rationnelle d’expliquer à quelqu’un pourquoi il devrait lire. Ce qui compte, c’est de donner le plus possible accès à la lecture. Aurais-je lu Phèdre spontanément à 13 ans, sans y être incitée ou contrainte par les programmes scolaires et le travail en classe ? Je ne crois pas. Il me paraît absurde de considérer que la contrainte serait de nature à inhiber et à susciter chez les élèves le rejet du livre. Pour autant, il me semble également essentiel que le professeur qui propose un texte à ses élèves soit lui-même enthousiaste, passionné, convaincu de la qualité et de l’intérêt de ce qu’il encourage à découvrir. Il faut qu’il soit capable de faire partager le plaisir qu’il a ressenti à son auditoire. Après tout, c’est une partie de son rôle. Une journaliste m’a un jour demandé comment faire pour donner envie de lire à ses enfants. Je pense que le meilleur moyen est de lire devant eux : s’ils se rendent compte que la pratique à laquelle vous vous livrez sous leurs yeux est une expérience pleine de saveur, alors c’est gagné. On partage ce que l’on aime. La différence entre la littérature et les autres arts, pour lesquels on accepte que leur connaissance procède d’un apprentissage, c’est qu’elle est faite avec la langue que l’on parle. On suppose alors qu’en déchiffrant, on sait lire. Tout l’enjeu de mon livre est de montrer qu’on apprend à lire en comprenant ce qu’est la littérature, car c’est à ce moment-là que tout se passe. Cela peut venir, pour le coup très tard… mais il n’est jamais trop tard.