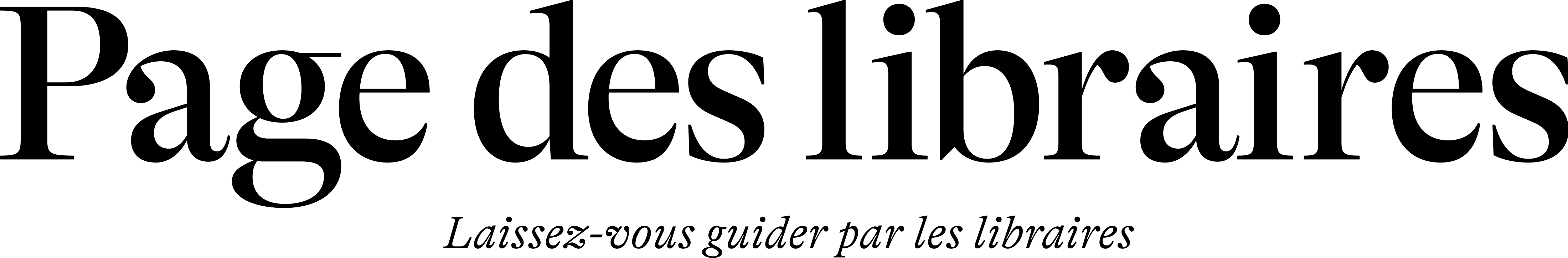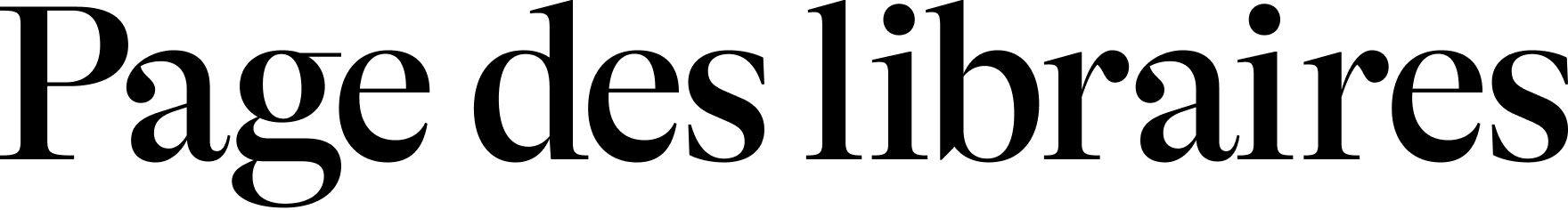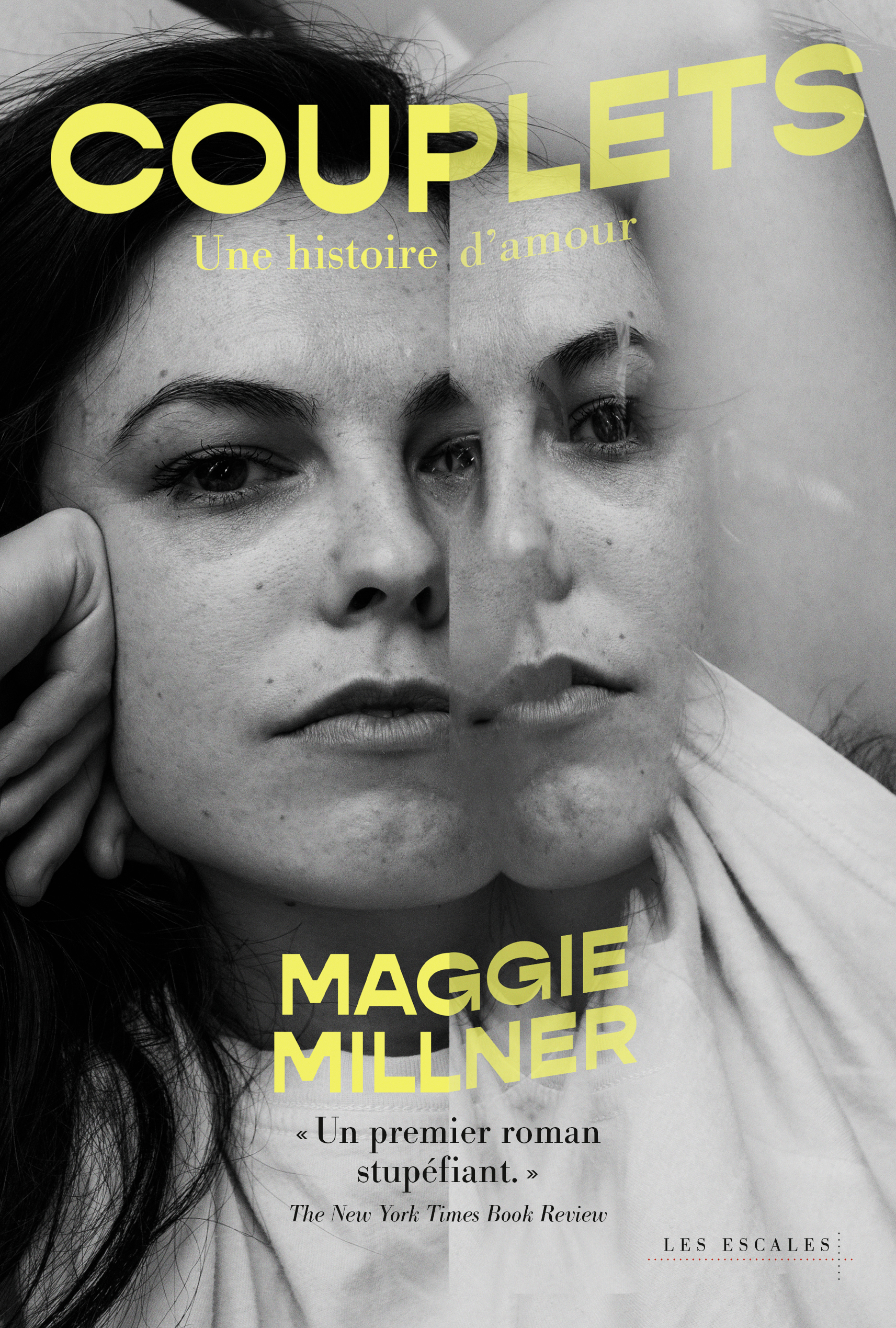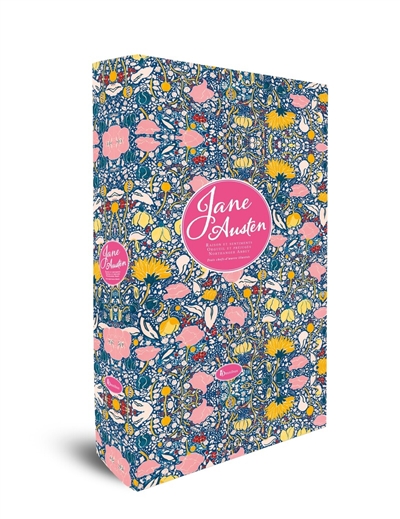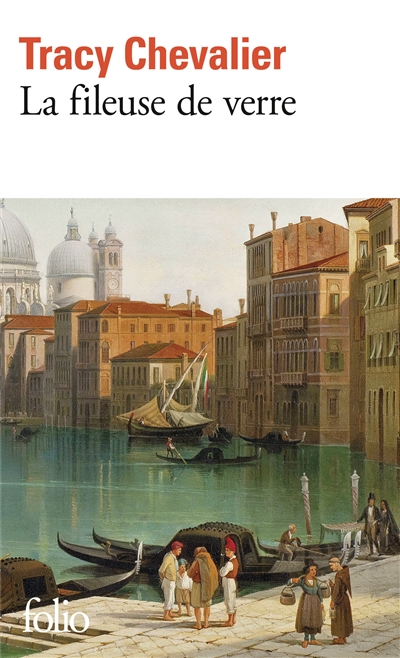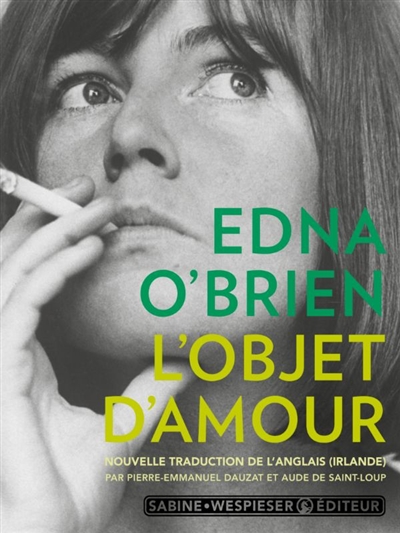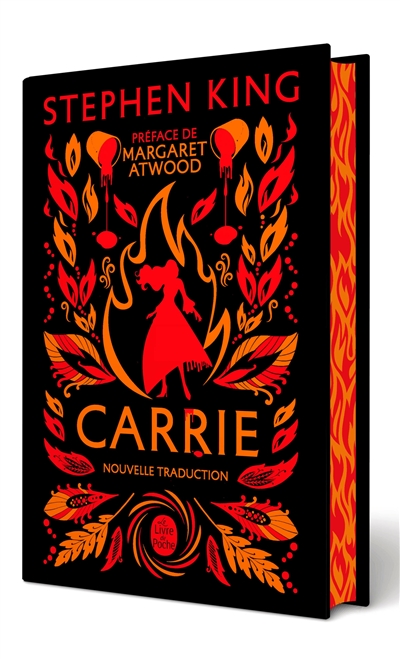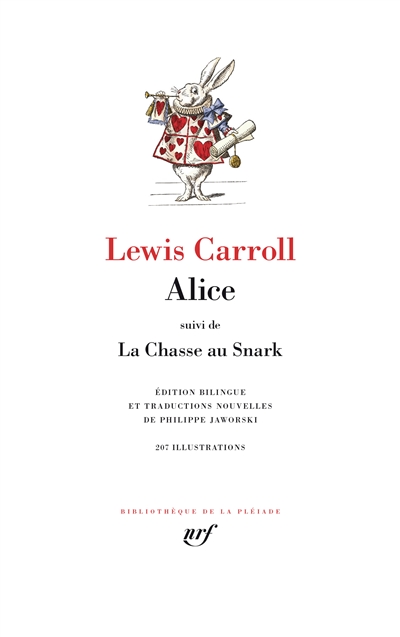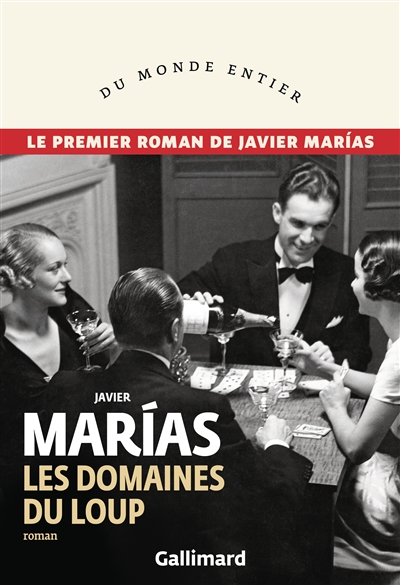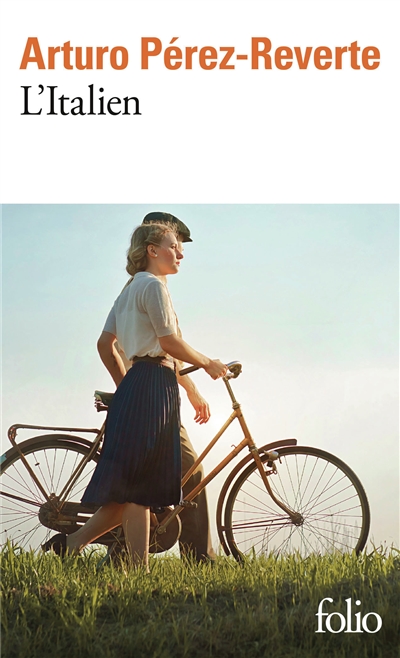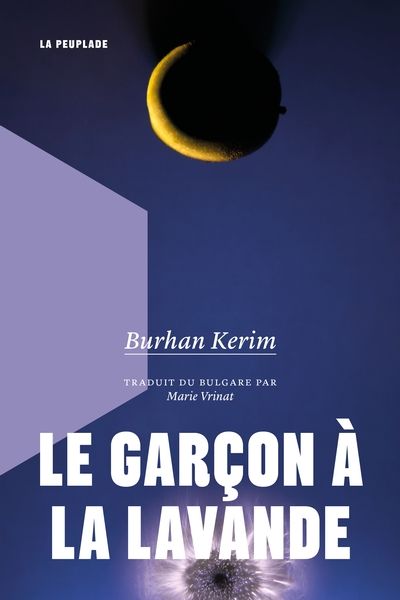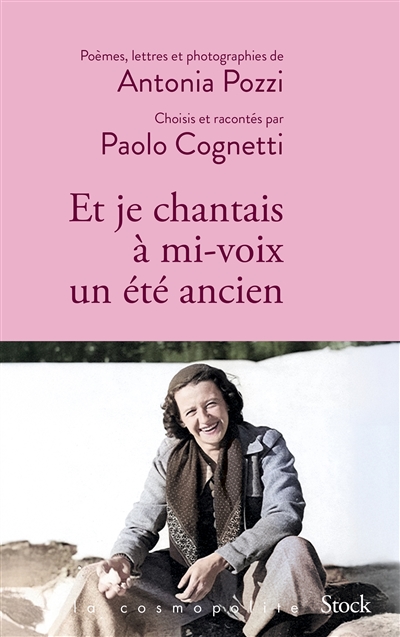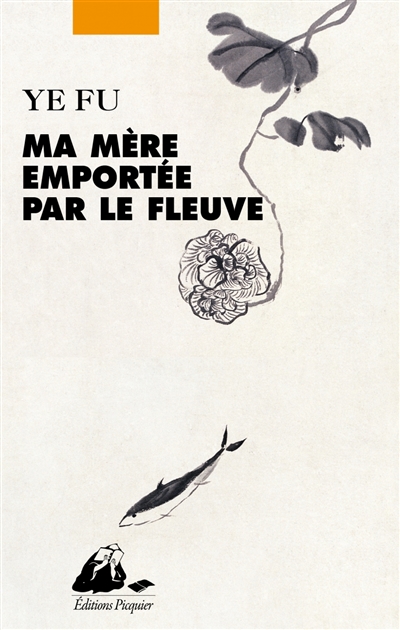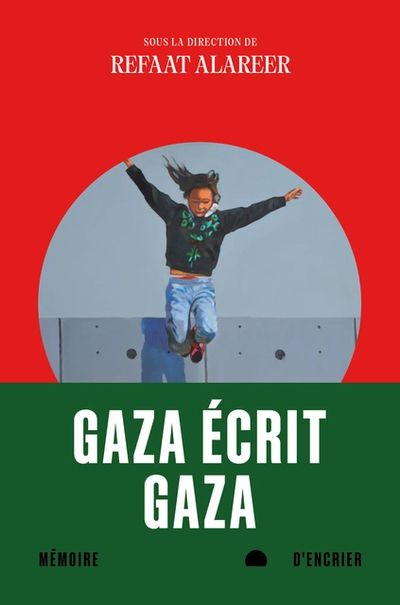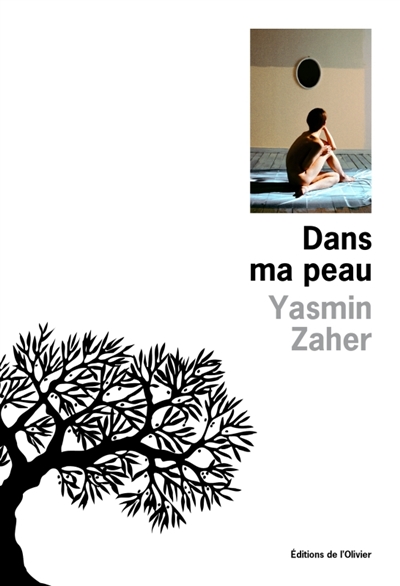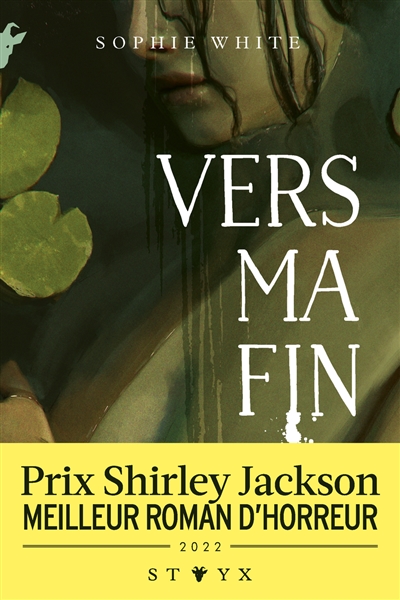Votre livre commence ainsi : « Je suis devenue moi. Non, j’avais toujours été moi. » Pourriez-vous vous présenter au lectorat français ?
Maggie Millner Je m’identifie comme queer. Je me suis toujours sentie outsider dans divers domaines de ma vie. C’est pour cela que je suis devenue écrivaine, attirée vers la poésie, forme la plus marginale. La facilité aurait été de se couler dans la norme mais je n'ai jamais pu me forcer à prétendre être autre chose que ce que je suis. Ça n'a pas été simple socialement. J'ai grandi dans une toute petite ville très conservatrice. J'ai fréquenté la même école rurale publique de la maternelle à la fin du secondaire. Jusqu'à l'université, j'ai connu peu de gens comme moi, désireux de tester cet échantillon de possibles.
Vous aviez déjà publié beaucoup de poésie. Comment en êtes-vous arrivé à mélanger poésie et prose pour aboutir à ce roman hybride ?
M. M. J'ai commencé par écrire des poèmes. Ce n’est qu'à la moitié du livre que la forme romanesque s’est imposée, avec le même arc narratif, le même suspense et développement des personnages que pour un roman noir. Ce livre parle de trouver une forme de vie, d'essayer différentes identités, une vie hétérosexuelle, une vie queer polyamoureuse ou monogame, une vie plus indépendante et solitaire, où la relation de couple principal se situe entre soi et l'écriture. J’ai dû expérimenter pour trouver la forme la plus juste. J'ai commencé avec le couplet héroïque, forme traditionnelle anglaise pour traduire les épopées grecques et romaines. Cela semblait en total décalage avec le sujet mais cette friction a été enrichissante. À nouveau cette incapacité à me conformer. Je me suis dit : « Je vais faire quelque chose de pas cool. Garder cette forme que tout le monde me déconseille. » Je l'ai pris comme un défi, pour me réapproprier cette forme associée aux effets de la civilisation occidentale et à la domination masculine.
Il y a aussi un aller-retour entre le « tu » et le « je », un ton tourné vers la légèreté.
M. M. Il n'y a pas qu'un seul soi en nous. Il existe de nombreuses façons de se considérer, de faire le point sur soi-même, d'où les changements de pronoms. Il s'agit de sortir de la vision étroite du « je ». La diversité des formes et le refus de se cantonner à un genre sont essentiels pour un tel projet. L'humour est très important pour moi, lié à l'apprentissage de la fiction. Maintenir une distance ironique par rapport à votre propre vie est la clé pour trouver la fantaisie et l’esthétique. Un des messages serait de garder le sens de l'humour malgré la peine et qu'il n'est jamais trop tard pour se transformer, malgré le sentiment d’être si confinés dans nos choix.
Avez-vous échangé avec Julia Kerninon qui a réalisé la si belle traduction française ?
M. M. Juste quelques emails car je crois à l'autonomie du traducteur et à sa force créative. Ce fut un choix brillant : elle est elle-même écrivaine et d'une grande sensibilité poétique et féministe.
Y-a-t-il un message générationnel ?
M. M. Nous sommes à un moment clé, je suis une millenniale. Ma génération vit à une époque où les structures qui ont façonné nos vies privées et publiques sont devenues facultatives. Nous devons à nos aînées féministes une grande partie de cette liberté actuelle, fruit de tant de luttes. On peut aujourd’hui vivre cette liberté mais cela peut être aussi effrayant. Lorsqu’on supprime les structures familières, presque tout devient accessible. Comment extraire ce que je désire de mon contexte culturel ? Est-ce que je déteste ou aime quelqu'un sui generis ? Probablement pas. On ne peut séparer la sexualité du contexte socio-culturel dans lequel on est ancré. C'est pourquoi tant d'écrivains de ma génération se demandent comment identifier notre désir. C'est une question récurrente qui n'a pas forcément de réponse mais il est utile d'y réfléchir. C’est dans ce contexte que le mot « queer » se comprend : une catégorie liminale qui se définit par son absence de définition et son refus d'être lisible au sein d’une culture hétérosexuelle dominante.
Une jeune femme qui vit en couple avec son petit ami et son chat depuis des années va vivre un coup de foudre pour une femme qu’un ami lui suggère de rencontrer. Elle quitte tout pour vivre cette histoire possédante. Naît une passion consumante et sauvage qui l’amène à découvrir son désir et se redéfinir elle-même. À travers l'amour, l'obsession, le manque, la jalousie, ce roman explore avec concision et finesse les errances du désir, la construction du moi par couches successives de rencontres qui nous constituent, le lien à l’écriture. Malgré les affres de cette relation dévorante, elle parvient avec subtilité, poésie, intelligence et humour à révéler son expérience pour nourrir la nôtre.