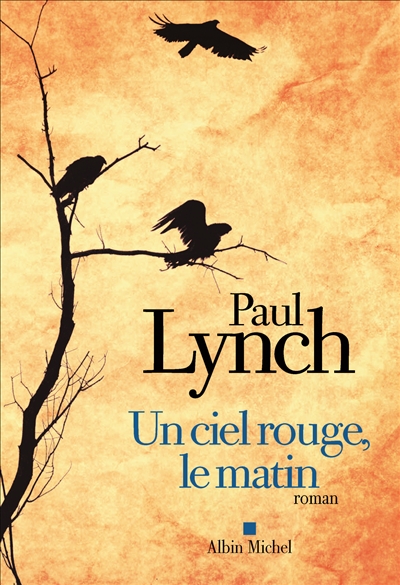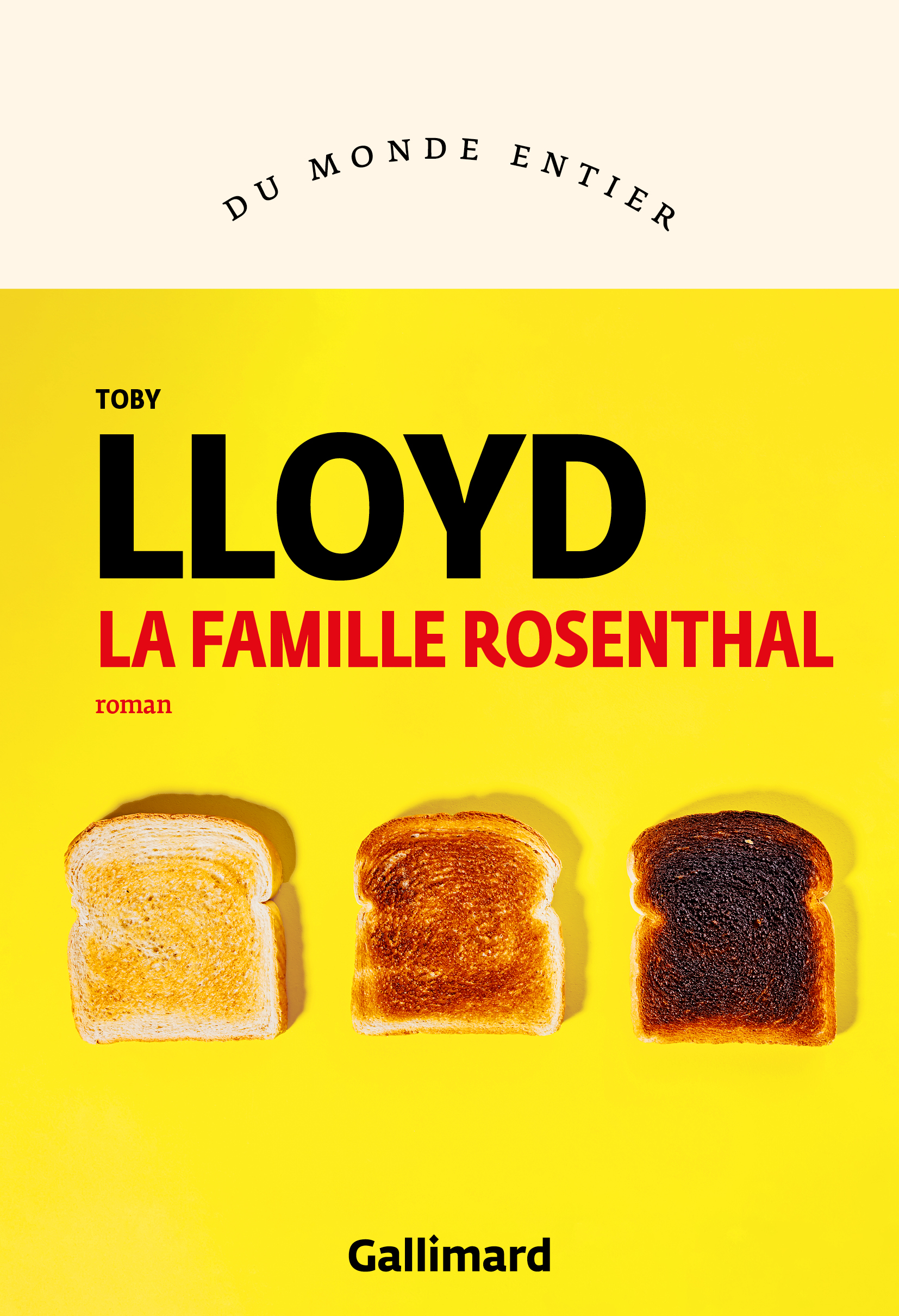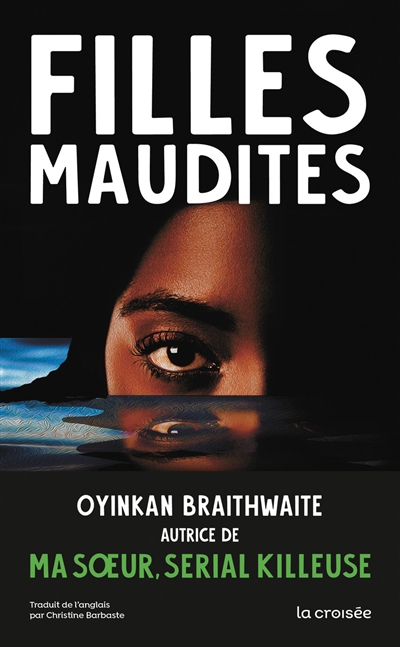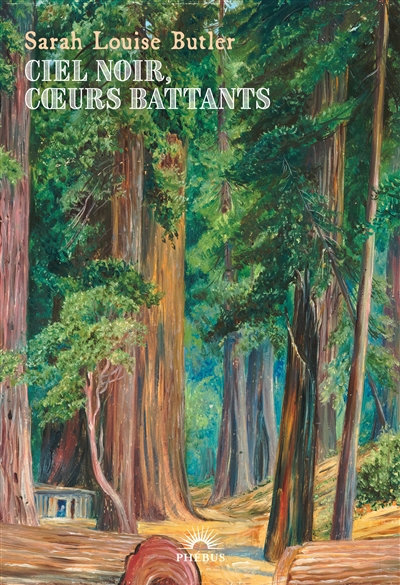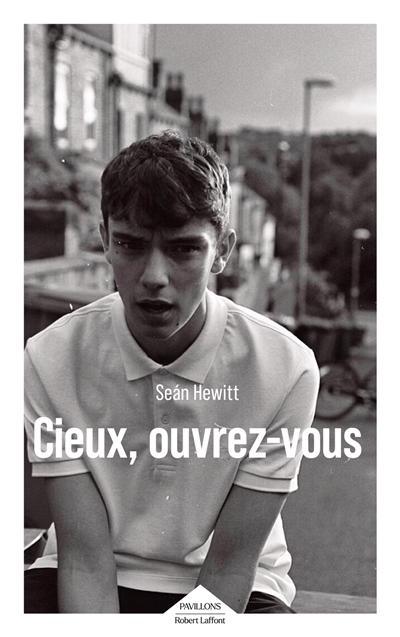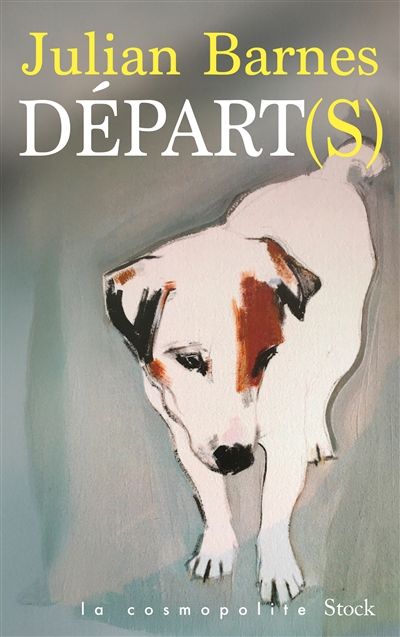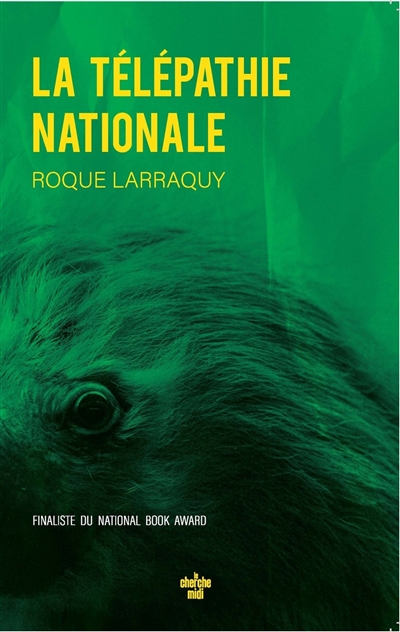Coll Coyle, un jeune métayer irlandais, est menacé d’expulsion par le fils du propriétaire terrien pour lequel il travaille, Hamilton. Il part donc à la rencontre du jeune homme afin de contester cette décision lourde de conséquences pour lui et sa famille, mais la discussion va dégénérer et Hamilton n’y survivra pas. Coll doit s’enfuir, laissant derrière lui sa femme enceinte et sa petite fille, pour échapper à la terrible vengeance de Faller, le contremaître du domaine. Commence alors une véritable chasse à l’homme qui nous entraîne des tourbières du Donegal aux chantiers de chemin de fer de la Pennsylvanie du XIXe siècle, en passant par le port animé de Derry d’où partent de nombreux migrants irlandais désireux de rejoindre les États-Unis. Paul Lynch nous offre de superbes descriptions de la spectaculaire péninsule d’Inishowen, où il situe le début de son roman, ainsi qu’un aperçu saisissant du sort qui attendait les immigrés irlandais partis dans l’espoir de trouver une vie meilleure.
Page — La nature est omniprésente dans votre roman. En fait, sa présence est si forte qu’elle semble être un personnage, au même titre que les hommes. Les paysages d’Inishowen (la région d’où vous venez et où débute le roman) ont-ils été l’une de vos principales sources d’inspiration pour ce premier roman ?
Paul Lynch — Je ne me doutais absolument pas que le paysage prendrait une telle importance avant de commencer à le décrire. Enfant, je trouvais que le Donegal était un endroit très banal. Mais avec le temps et l’éloignement, et d’un point de vue de romancier, j’ai commencé à le voir différemment, comme quelque chose de vaste et d’impartial, comme la représentation d’une échelle de temps qui dépasse l’homme, un aspect central de mon écriture. Pour moi, le paysage peut servir à la fois à positionner le lecteur et à le transporter. Il est ce soupçon essentiel de réalisme qui donne vie à l’histoire et sert à refléter la psychologie d’un personnage. Cependant, il peut aussi être utilisé pour exprimer l’absence de psychologie ou l’immensité objective du monde, cet étrange et vaste théâtre où se produit la vie humaine. Je pense que mon roman fait se confronter une vision post-humaniste du monde qui ne place pas l’être humain au centre de l’univers, et un point de vue humaniste qui aspire à trouver un sens à nos vies.
Page — L’émigration en Amérique est un thème récurrent de la littérature irlandaise. Bien que vous traitiez ce thème de façon plutôt inhabituelle en décrivant une chasse à l’homme qui se poursuit de l’autre côté de l’Atlantique au XIXe siècle, aviez-vous l’impression de vous inscrire dans une certaine tradition en abordant ce sujet ?
P. L. — J’ai toujours été révolté par le côté sentimental et romantique de la littérature irlandaise, cette façon qu’elle a de se victimiser, surtout à travers le cliché anti-anglais, datant du XIXe siècle, du paysan irlandais qui se fait expulser de ses terres par le méchant propriétaire. Pourtant, je me suis retrouvé à écrire là-dessus. Je me suis rendu compte que j’essayais de réécrire l’Histoire, de la décontaminer au profit d’une nouvelle génération. Car ces vieux mythes n’ont plus aucun sens pour nous. Pour ce faire, je devais débarrasser Un ciel rouge, le matin de tout sentimentalisme, de tout aspect nationaliste, religieux ou impérialiste : tout ramener au plus vaste domaine de l’évolution.
Il était très important pour moi que les lecteurs se sentent absorbés par chaque instant, à l’unisson des personnages du livre. Les gens vivent leur vie au quotidien. Ils ne se voient pas comme faisant partie de l’Histoire. Ce sont les historiens qui attachent de l’importance à ces vies. Si l’historien écrit en regardant vers le passé, le romancier doit écrire en regardant vers l’avenir. Chaque instant doit être d’un réalisme saisissant. Si l’on peut surprendre le caractère historique d’un simple instant, on peut capturer l’Histoire avant qu’elle ne devienne mythe. On peut rendre l’Histoire réelle.
Page — Lorsque le lecteur est en passe de se sentir submergé par la spirale de violence que Coll a déclenchée accidentellement, les passages racontés du point de vue de Sarah, la femme de Coll, procurent une sorte d’apaisement. Sa voix semble être celle de la raison au milieu de toute cette folie, mais aussi celle de l’impuissance et de la résignation. Que représente cette voix pour vous ?
P. L. — Sarah est le cœur qui bat de ce roman. Elle en est le chœur grec, un chant de la perte. Elle pose les mêmes questions que nous nous posons sur nos vies. Elle parle pour exprimer sa douleur. Elle cherche du sens là où on ne peut en trouver aucun. Elle est cette voix qui se retrouve condamnée à contempler l’abîme que sont le temps et la mémoire. Elle finit par comprendre que la vie entière est perte, car dans la vie, nous finissons par tout perdre.
Page — Faller, l’homme qui pourchasse Coll, a de toute évidence une vision fataliste de l’existence. Partagez-vous son point de vue lorsqu’il dit que nous aurons beau essayer, nous ne pourrons jamais avoir un contrôle total sur notre propre vie ?
P. L. — Dans ce roman, le sort de chacun des personnages est fait d’événements sur lesquels ils n’ont aucun contrôle. Ils sont tous ballottés par la tempête du destin. Faller le comprend. Il comprend la nature du pouvoir, et que tout pouvoir se retrouve un jour usurpé par un pouvoir plus grand. Il finit même par en faire lui-même l’expérience. Faller est un tueur né. Mais même Faller commet des erreurs. Et lorsqu’il en commet, il y a de meilleurs tueurs que lui, là-dehors. Il s’agit d’une perspective évolutionniste. Dans ce livre, chaque lot se fait supplanter par un autre : même le lot de l’histoire irlandaise, qui laisse place à une histoire américaine.
Page — La noirceur de votre roman est contrebalancée par la beauté du langage que vous utilisez. Alors, selon vous, la poésie existe-t-elle pour nous consoler du monde cruel dans lequel nous vivons ?
P. L. — Une belle écriture est une forme de séduction : suivez-moi, mon beau lecteur, et je vous montrerai le reflet de la Méduse ! La beauté permet de dévoiler la cruauté du monde sans nous effrayer. Elle nous permet de regarder en face les choses que nous ne voulons pas voir. Pour moi, plus votre vision philosophique du monde est dure, plus votre écriture doit être belle. Seule la beauté autorise à se tenir au bord du précipice afin d’y plonger notre regard, sans ressentir le désespoir qui nous ferait basculer. En même temps, je pense que la beauté est la seule forme d’amnésie capable de nous faire oublier l’abîme. La beauté soulage notre éternelle blessure.