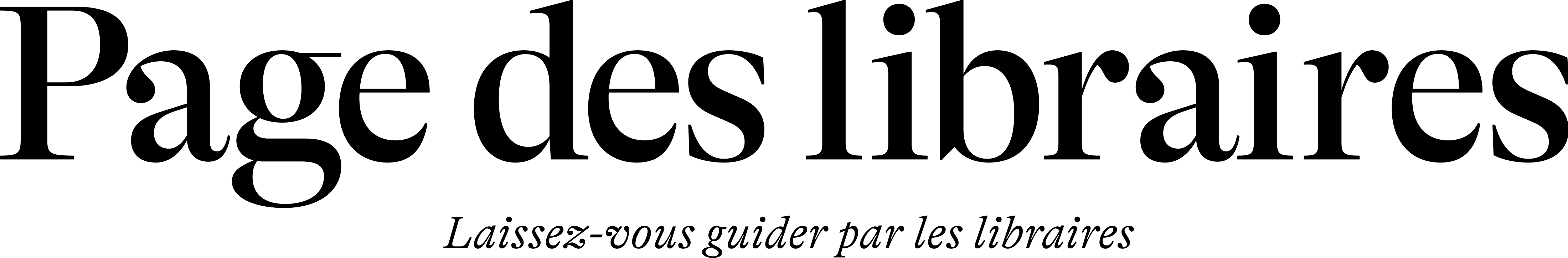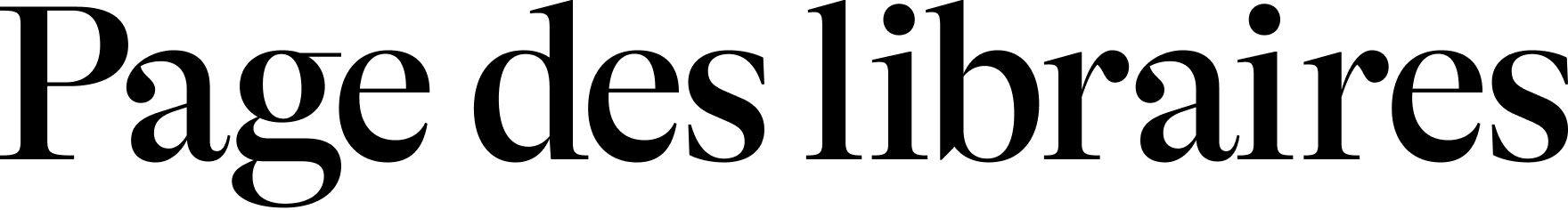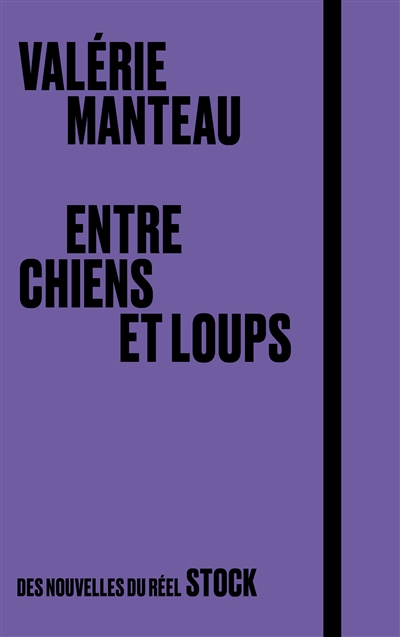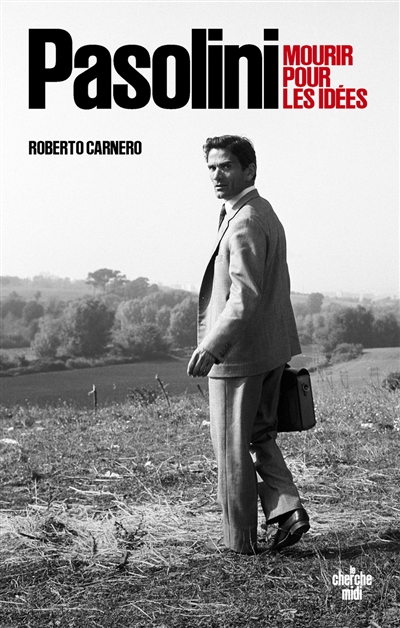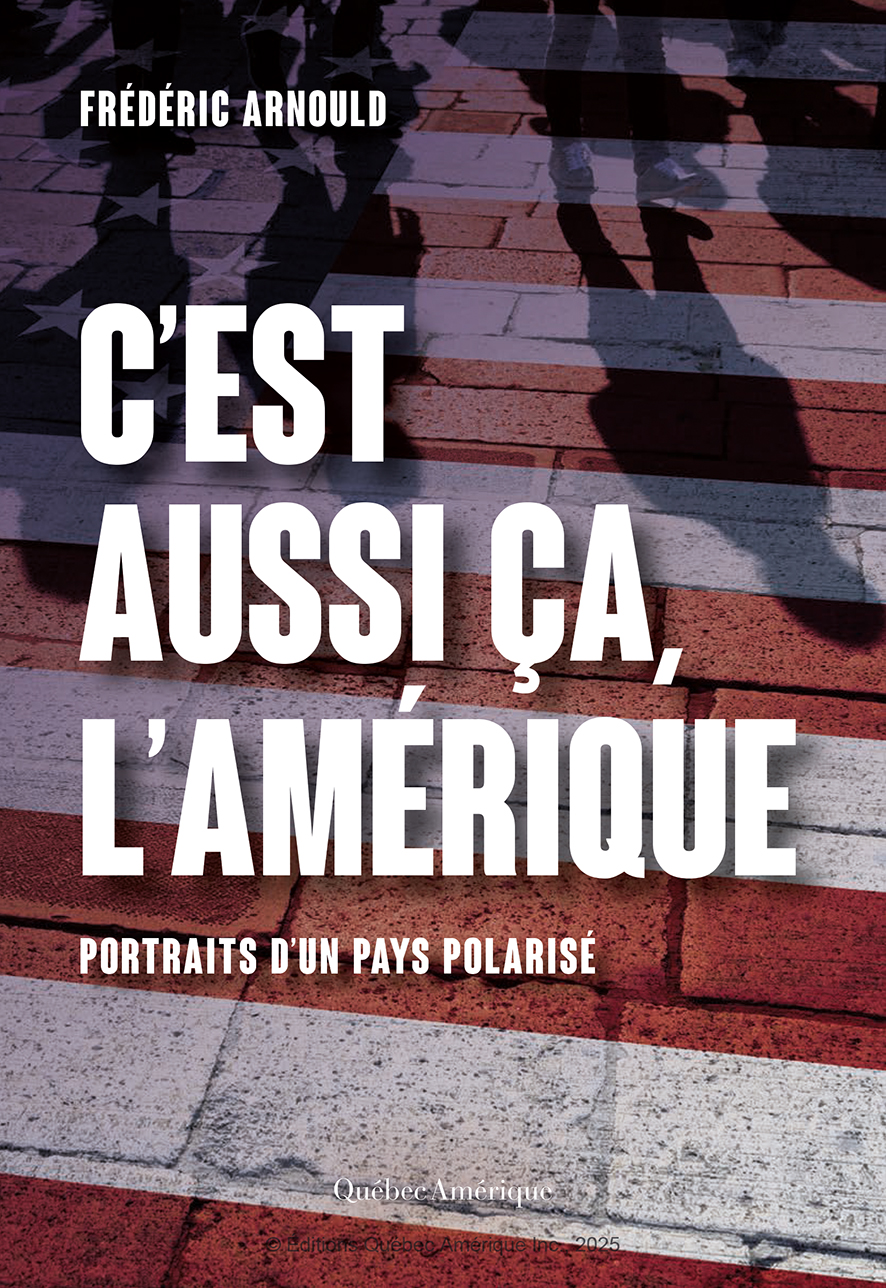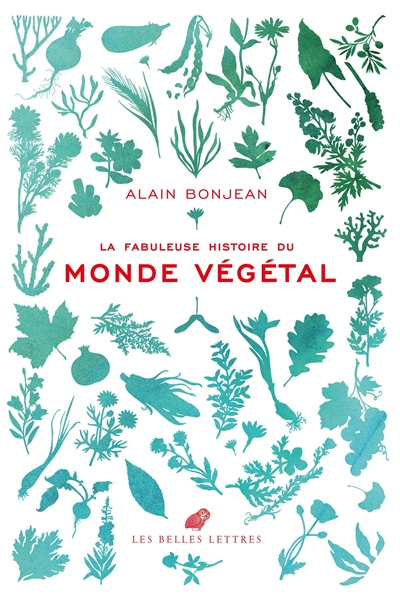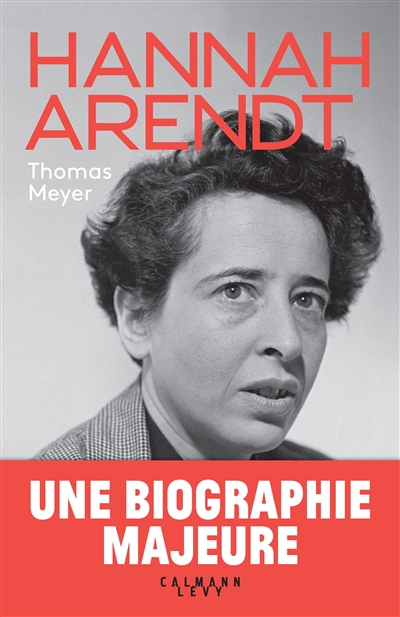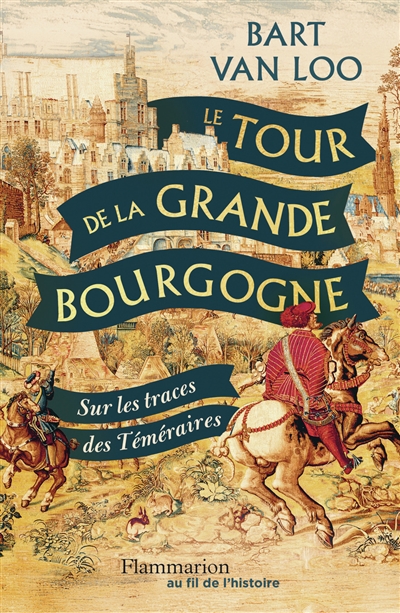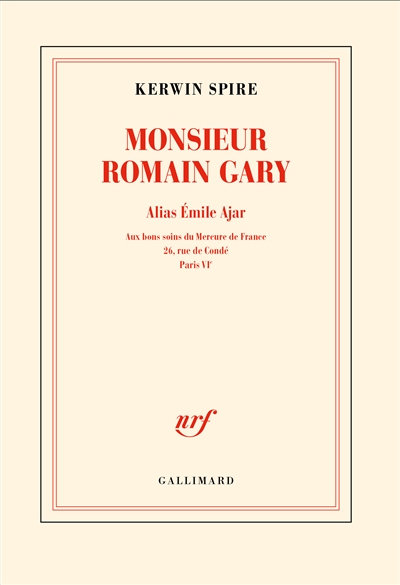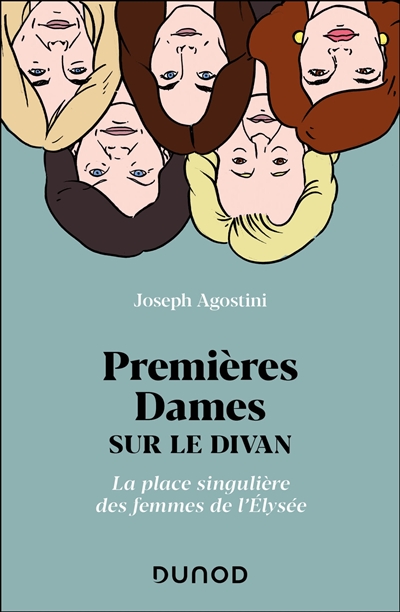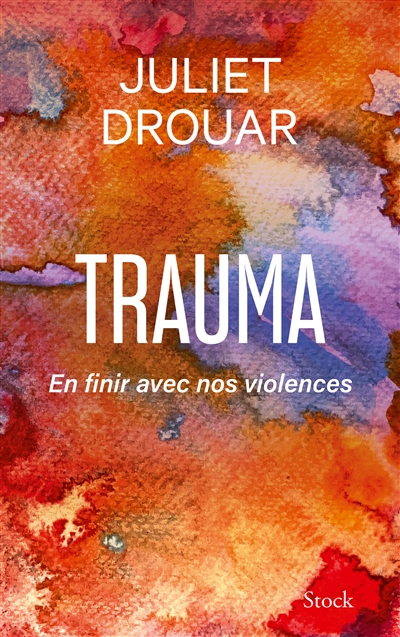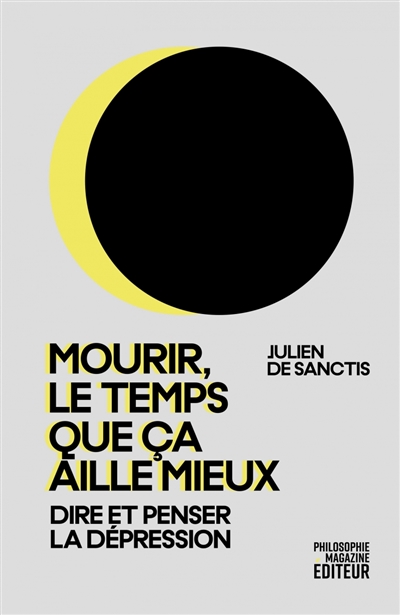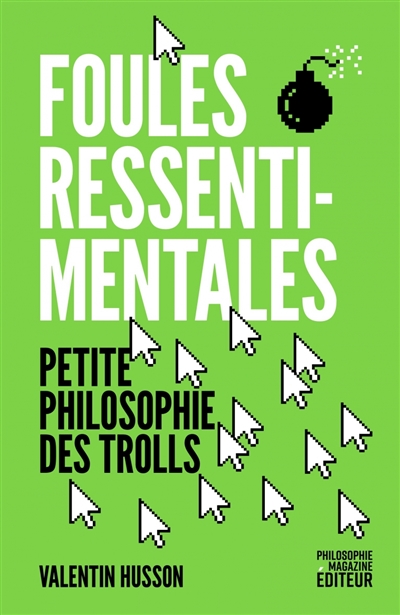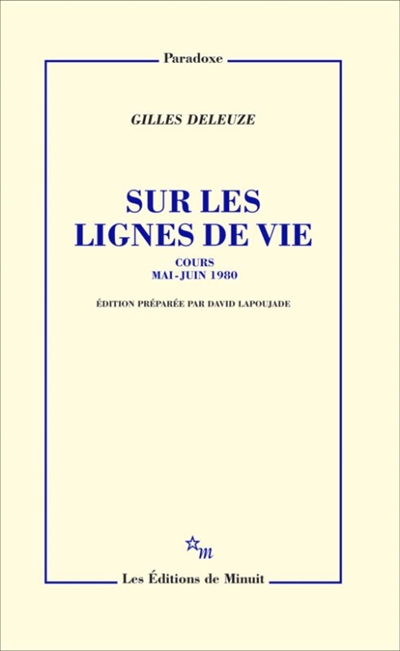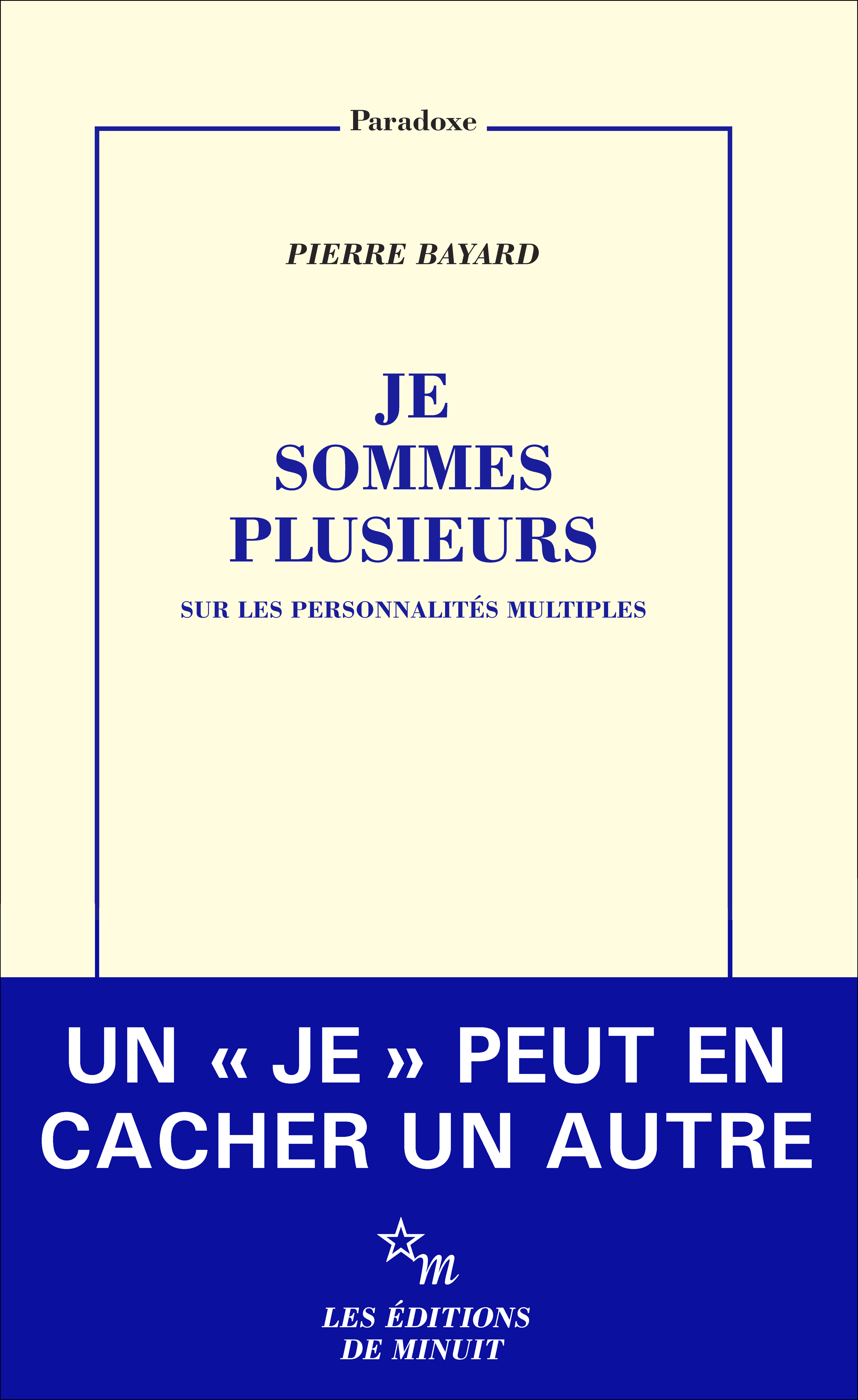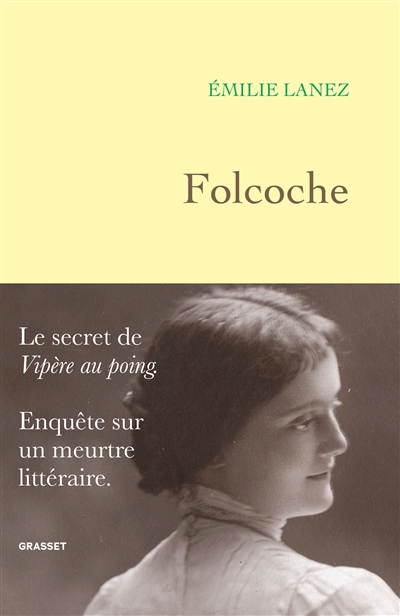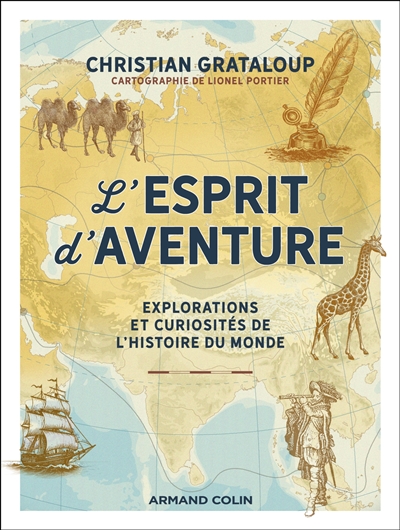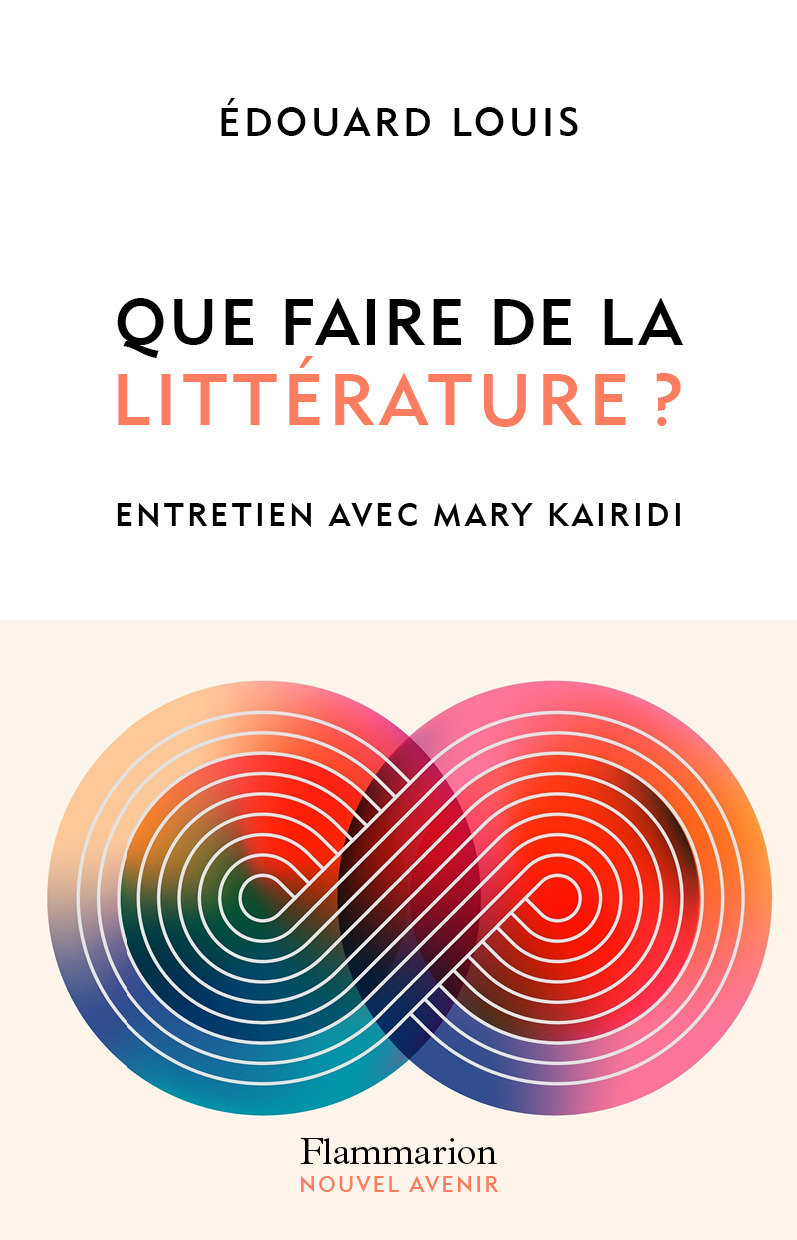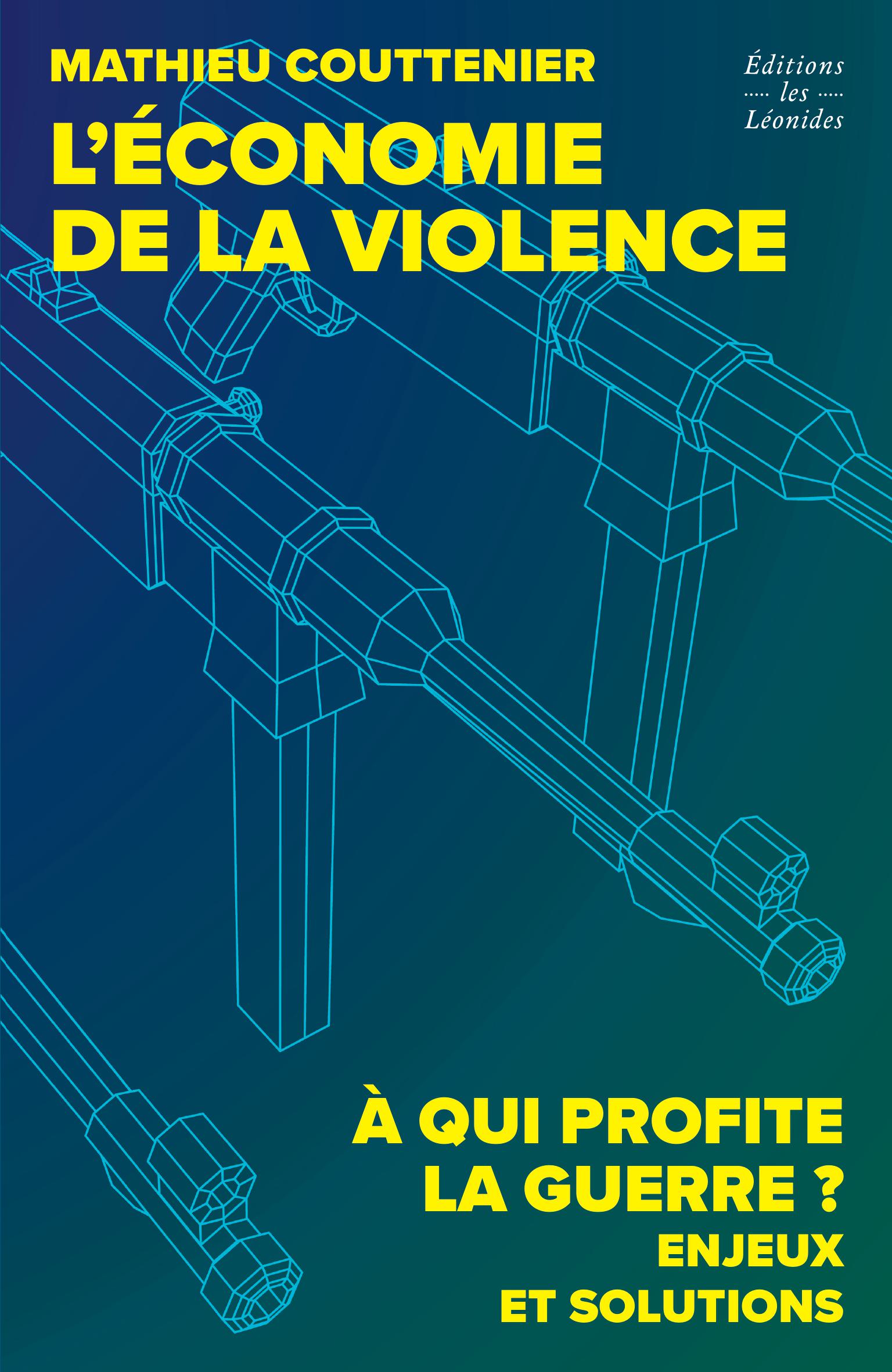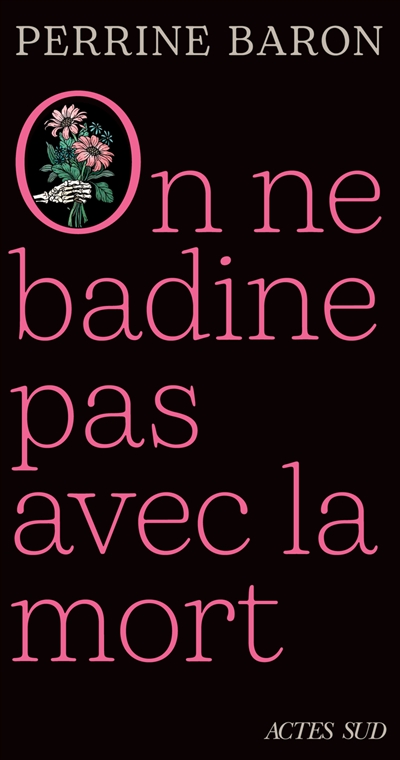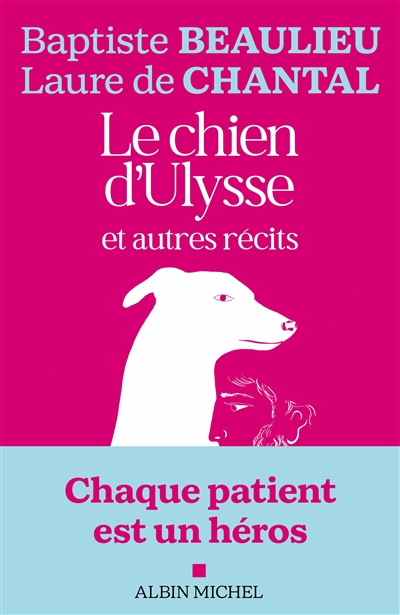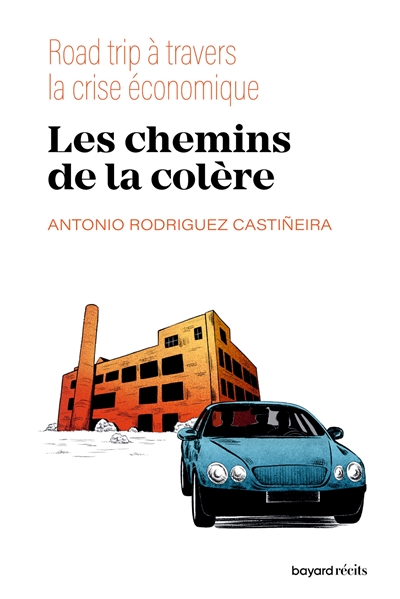Quelles réflexions ont transformé votre première « impulsion » d’assister au procès de Gisèle Pelicot en livre ?
Valérie Manteau Cette affaire découverte dans la presse un an avant le procès a tout de suite donné lieu à des discussions intimes, nouvelles, passionnantes avec mes amis, mes amies surtout, ma famille, mon compagnon. Le nombre et la banalité des agresseurs, ainsi que le profil de bon mari de Dominique Pelicot, nous renvoyaient un miroir implacable. Cela faisait écho à ce que les féministes disent et écrivent depuis longtemps : on connaissait la banale monstruosité du viol mais cette affaire en était comme une mise en scène, incarnée par cinquante et un personnages dont on allait décortiquer les parcours, la psychologie, les motivations. Pour qui s’intéresse à la comédie humaine, c’était un théâtre cathartique. C’est pourquoi, quand je suis allée à Avignon le 5 septembre pour soutenir Gisèle Pelicot, je suis restée. Il y avait tant à comprendre. Et pour moi, la meilleure manière de réfléchir, c’est encore de faire un livre.
On sent au fil des pages, et vous l'exposez avec sincérité, comment une affaire comme celle-ci pèse de toute sa noirceur sur celles et ceux qui suivent le procès. Comment se passe l'écriture d'un livre comme celui-ci ? Comment avez-vous trouvé le ton juste pour donner toute sa place à la victime sans rien omettre non plus du parcours et des profils de ses agresseurs ?
V. M. Je n’ai pas fini de ressentir l’onde de choc car je n’y étais pas préparée. Je n’avais jamais suivi de procès pour viol et c’est d’une brutalité qu’on a du mal à imaginer. On parle de tout ce qui hante la vie des femmes depuis l’enfance, notre condition de proie. Heureusement, on faisait corps avec les journalistes qui couvraient l’audience, dans cette ville étrange qu’est Avignon en automne. Nous étions comme dans une bulle, nous nous serions les coudes. J’ai noirci des carnets et des carnets de notes au fil des jours, à mi-chemin entre journal de bord intime et comptes rendus des audiences. Je n’ai pas une approche journalistique : je pars de ce que je ressens, de ce que mon corps communique, comme craquage, comme inquiétude, comme fascination aussi, celle qui vous fait lever le matin pour aller écouter ces gens. J’ai commencé le travail d’écriture à proprement parler après la fin du procès, dès janvier et jusque fin juin, enfermée chez moi, en pyjama, avec mon chat. Entourée de mes livres et de mes notes, j’ai à nouveau parcouru cette montagne d’informations. Je voulais répondre à cette question simple, en apparence : qui sont-ils ? J’ai travaillé en apnée, si bien que je me suis autorisée à garder des traces de l’humour noir qui fut mon fil d’Ariane pour sortir la tête du labyrinthe. L’humour permet de s’extraire, parfois, sans battre en retraite. D’ailleurs, je raconte que nous, public, et même Gisèle Pelicot, avons eu des fous rires, parfois en pleine audience.
Vous mobilisez de nombreuses références à propos des violences sexuelles et plus largement du féminisme, faisant du livre non seulement un récit du procès mais aussi une porte d'entrée utile sur le versant théorique de ces questions. Comment avez-vous intégré toute cette documentation, qui nourrit vos pages, à votre travail ?
V. M. Très naturellement : je n’ai pas séparé cette affaire de mes propres réflexions, mon histoire, les discussions de comptoir et les lectures théoriques qui ont structuré ma pensée depuis vingt ans. Tout marche ensemble, se confronte, dialogue.
La médiatisation hors normes de ce procès et en parallèle l'élan de solidarité et de sororité envers Gisèle Pelicot, ainsi que les réseaux de soutien qui se sont développés, sont au cœur de votre livre. Un an après, quel bilan en tirez-vous ? Quel est leur poids face à une culture du viol encore si présente ?
V. M. L’une des avocates de la défense a lâché un jour entre deux plaidoiries que les quarante avocats qui s’opposaient à l’accusation formaient une « mêlée de rugby ». Je viens d’une famille où l’on joue au rugby : j’ai trouvé que cette métaphore illustrait bien les rapports de force de cet univers baigné de culture machiste. Avec Lola Lafon, nous pensons devoir en faire un « boucan d’enfer ». C’est notre manière de résister à la poussée masculiniste qui nous déborde de tous côtés. Même s’il y a peu de raisons d’être optimiste par les temps qui courent, notre message a le mérite d’être fort, d’être puissant et surtout d’être beau. Ce n’est pas rien d’être du côté de la beauté, face à toute cette brutalité.
C'est un procès monstre, pour une affaire dont la mémoire collective se souviendra probablement longtemps. Aux côtés de Dominique Pelicot sur le banc des accusés, quarante-neuf autres hommes, accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot avec la complicité de son mari qui l’anesthésiait avant de la leur livrer. En refusant le huis clos, en incarnant son combat et en se confrontant en pleine lumière à l'horreur de ce qu'elle a subi, Gisèle Pelicot a, à sa façon, incarné un tournant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est ce combat que raconte Valérie Manteau, avec sa plume caractéristique : les longues journées au tribunal, l'attitude des accusés, les stratégies des avocats... Elle y mêle des remarques plus personnelles et incarnées, des éclairages théoriques rappelant la longue histoire des luttes féministes et le travail, malheureusement trop souvent dans l'ombre, de toutes celles et ceux qui documentent les rapports de genre, leurs inégalités et leur violence.