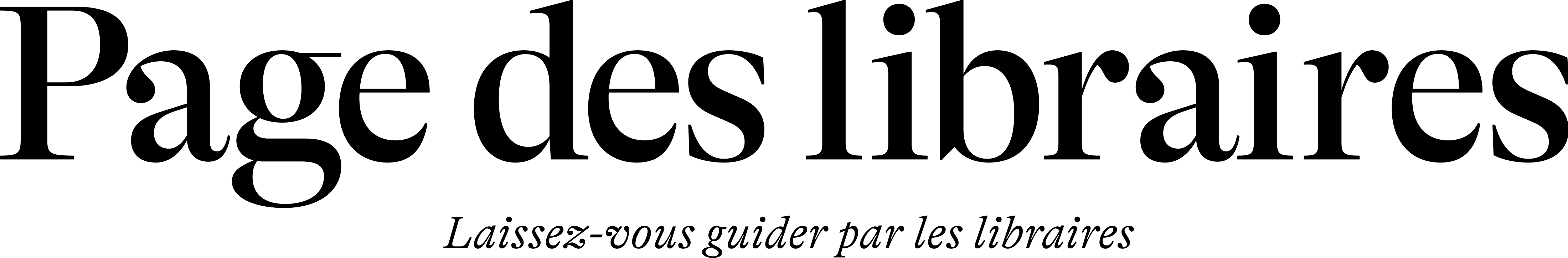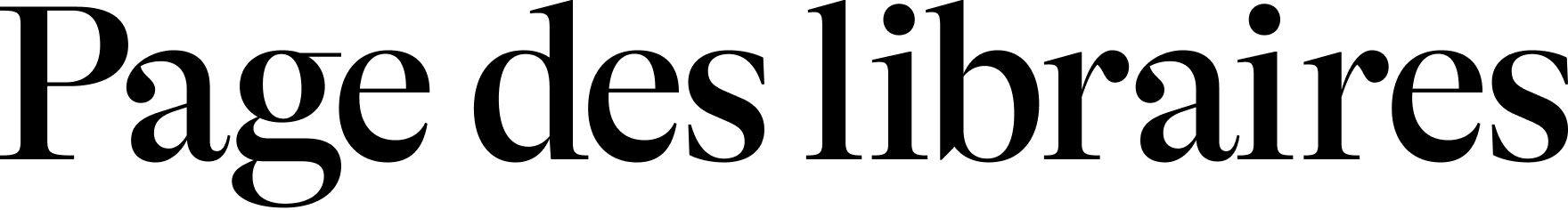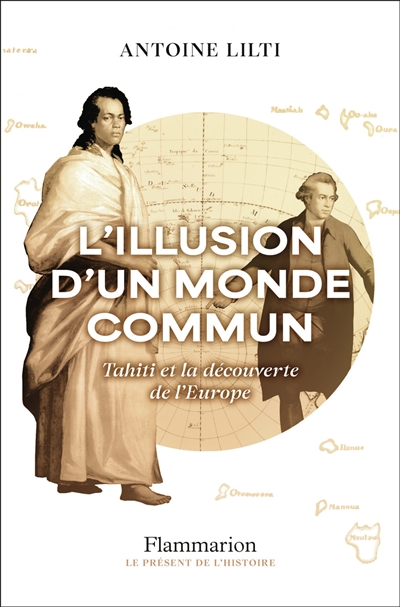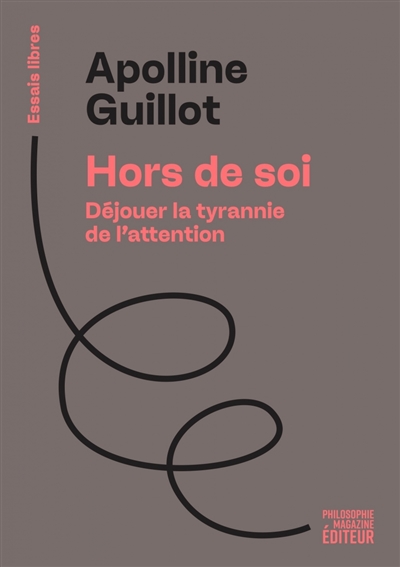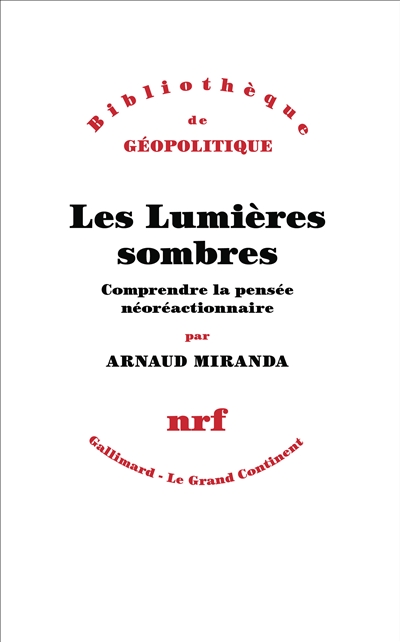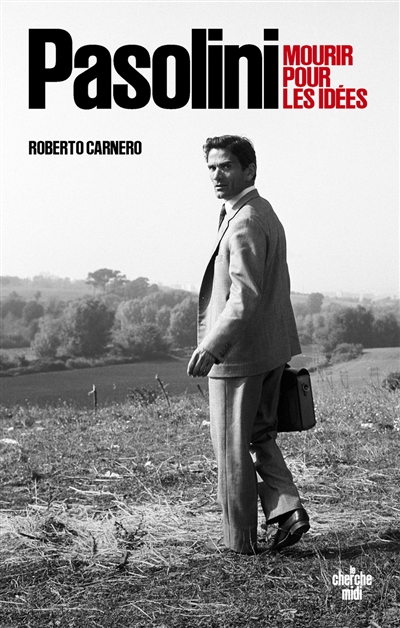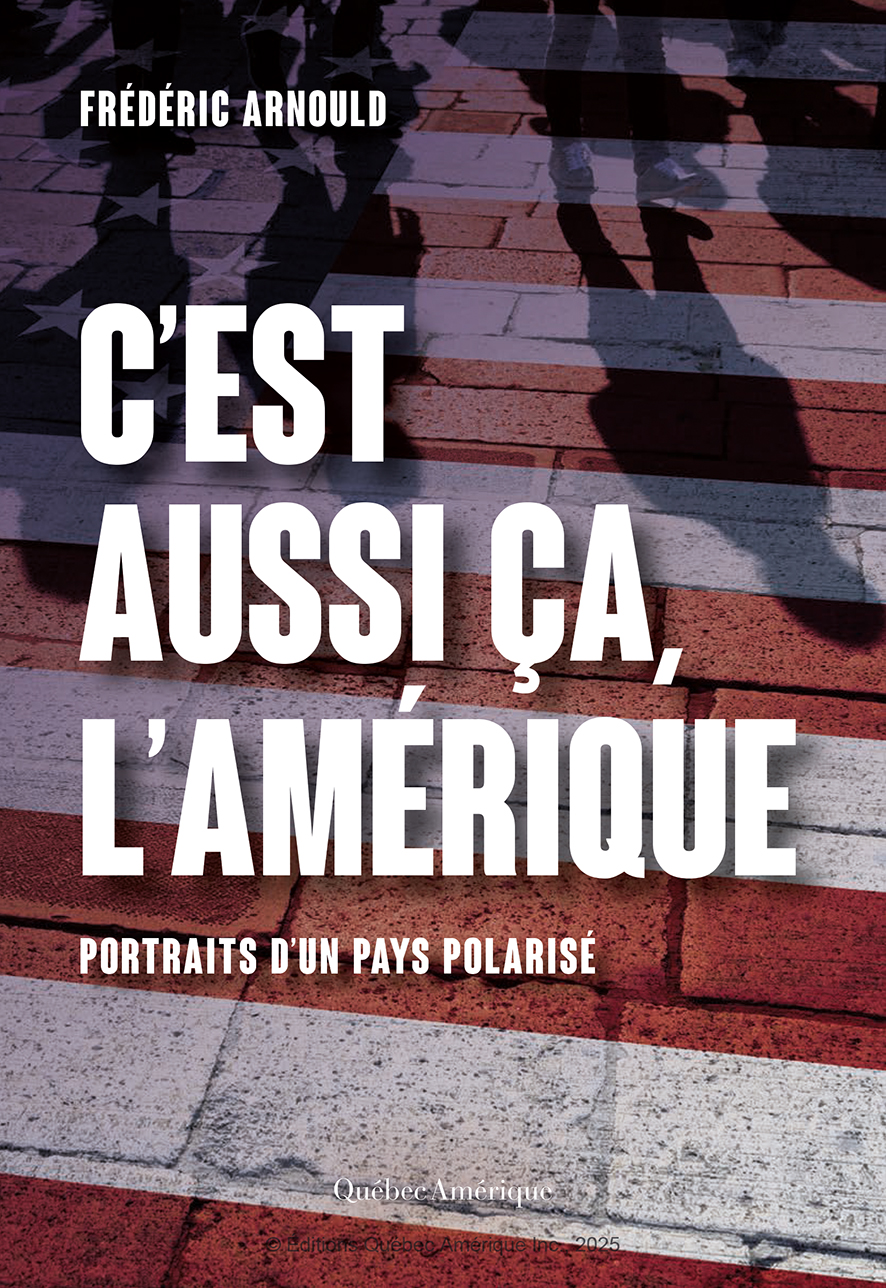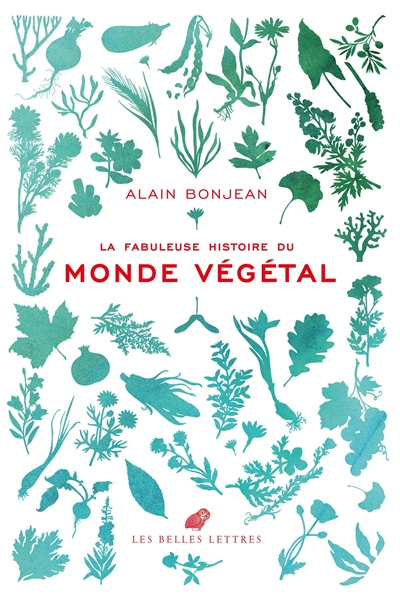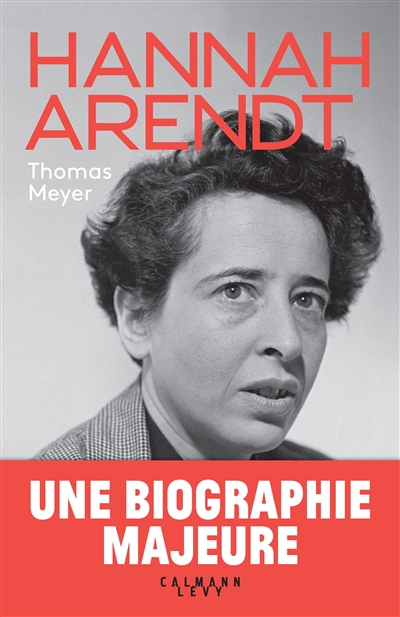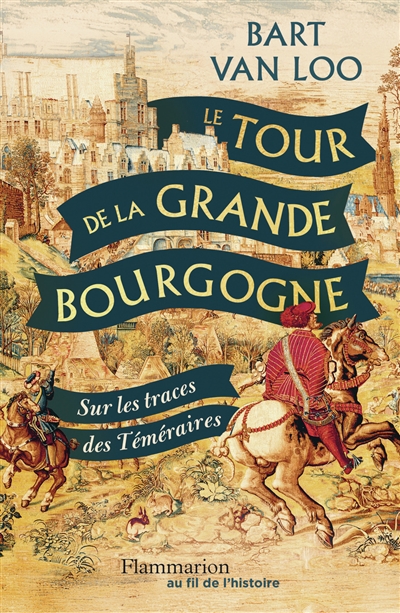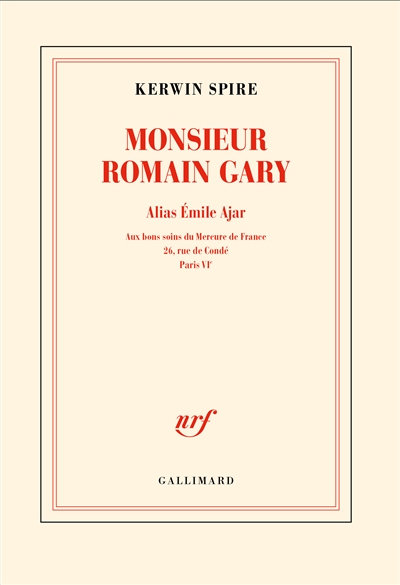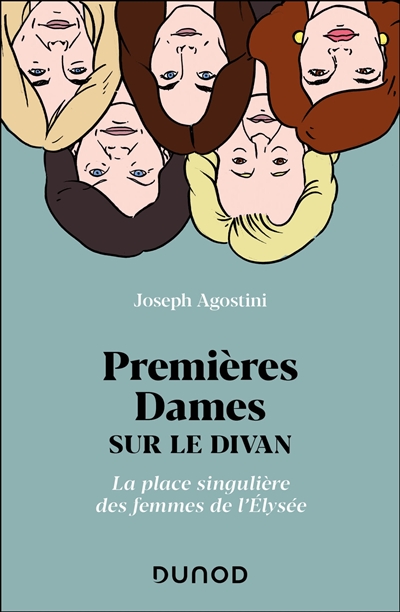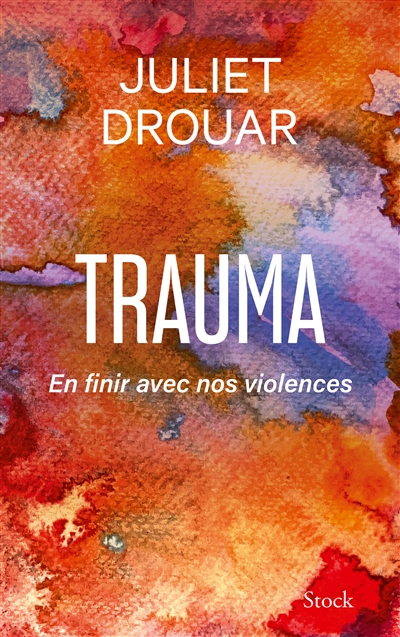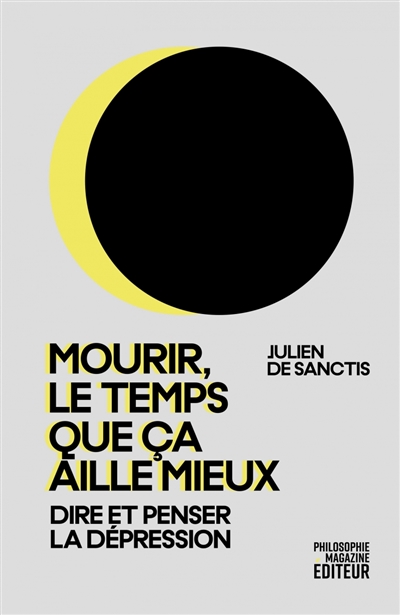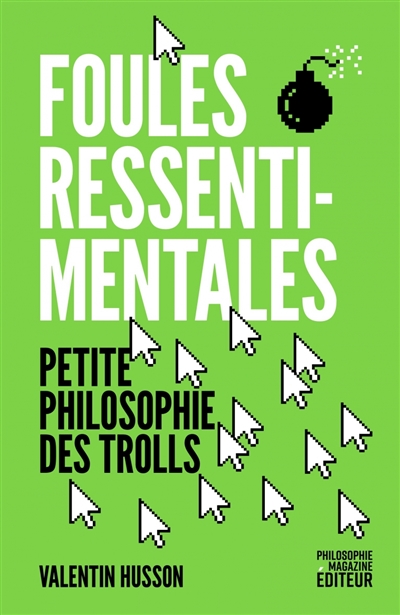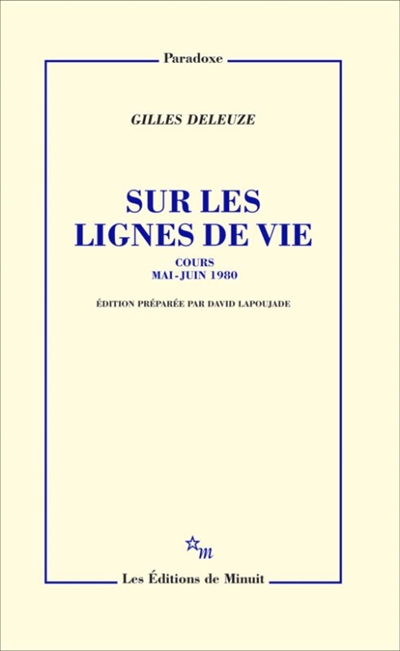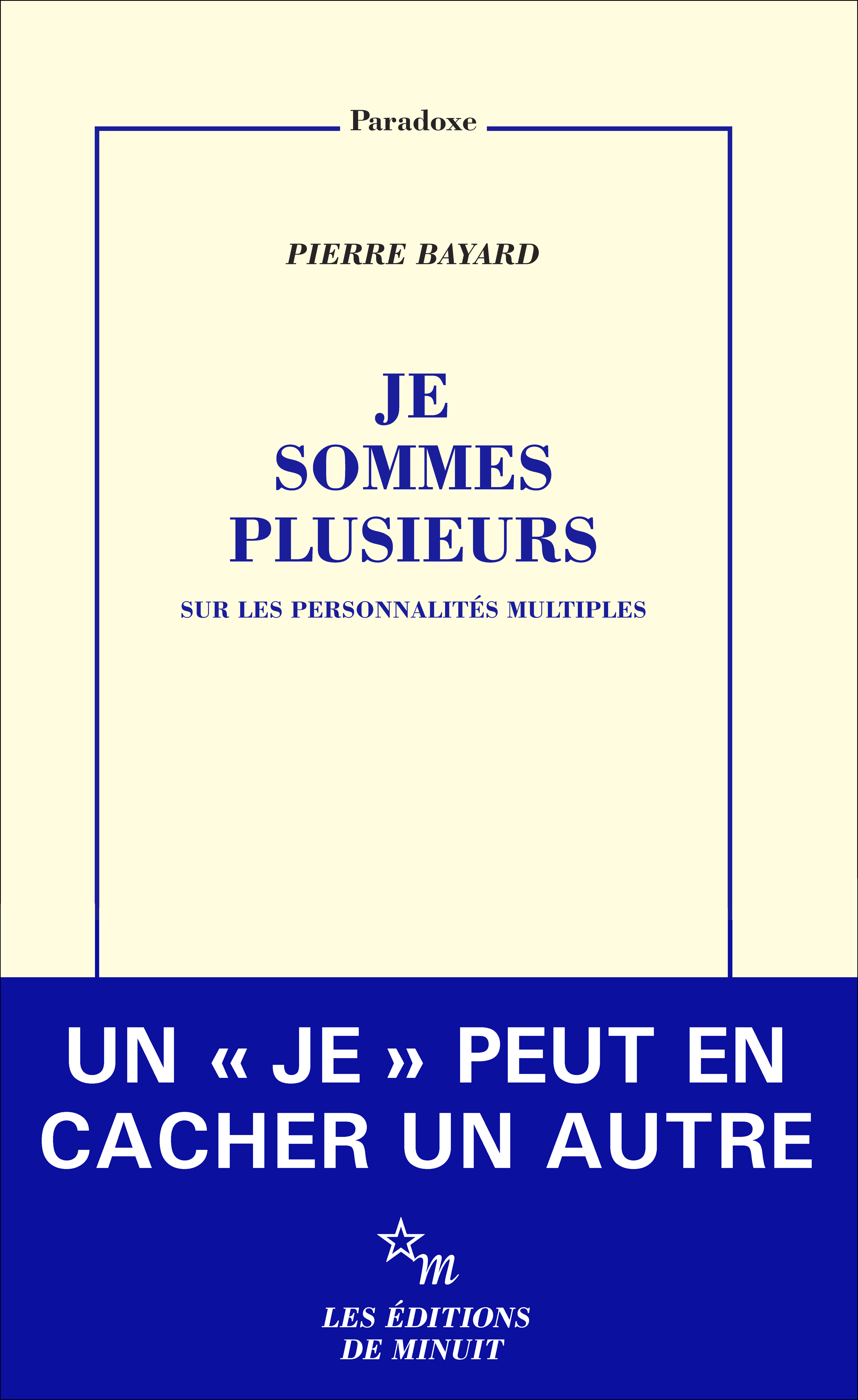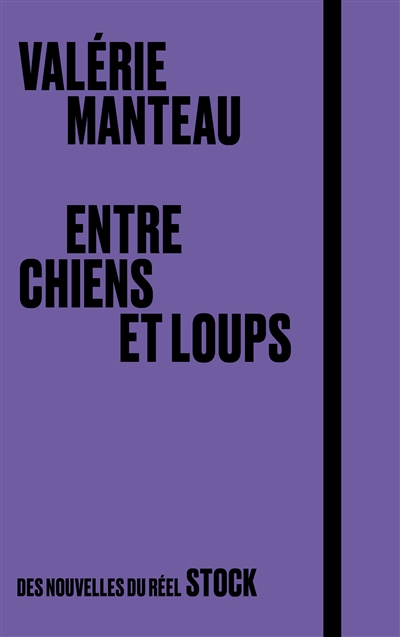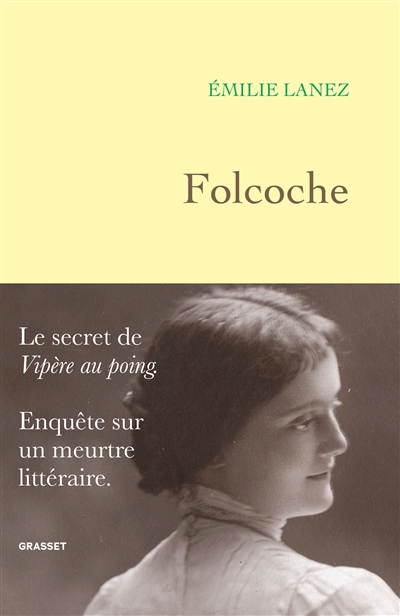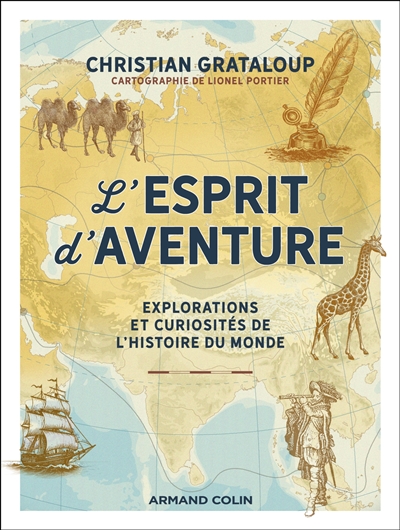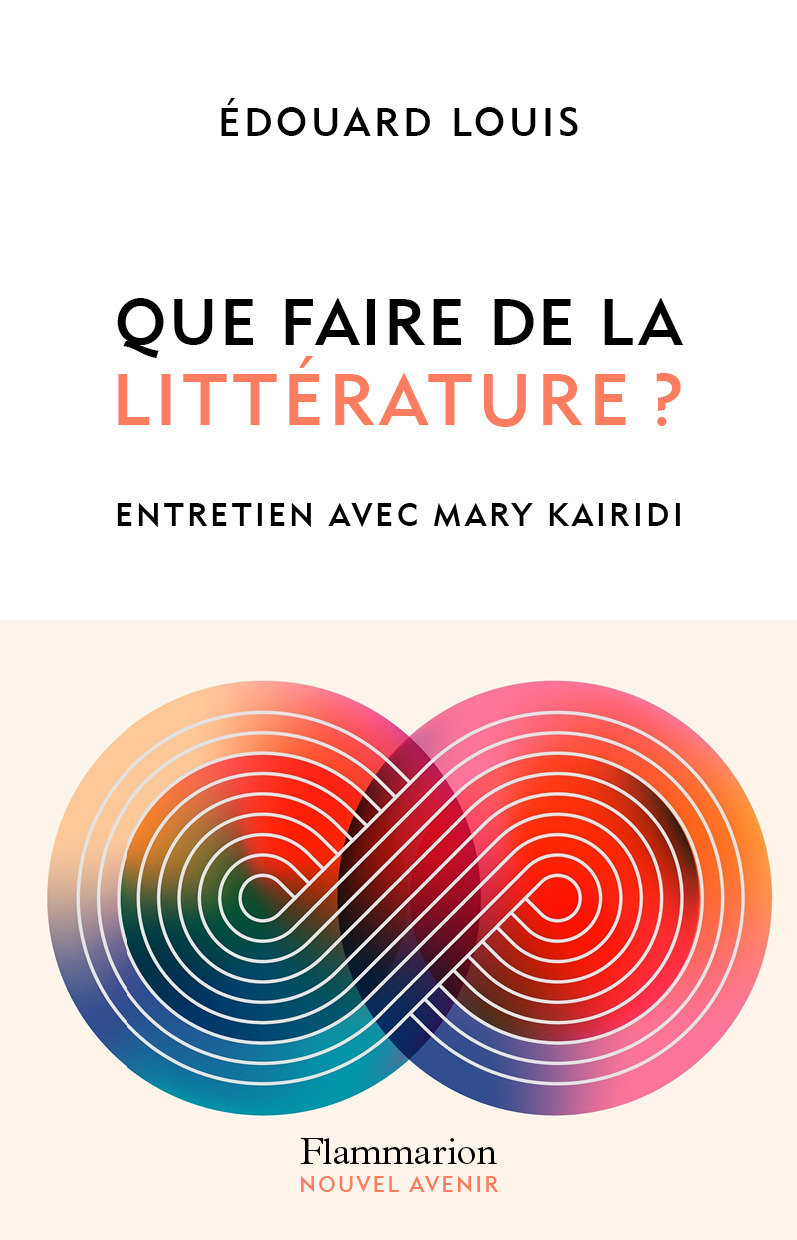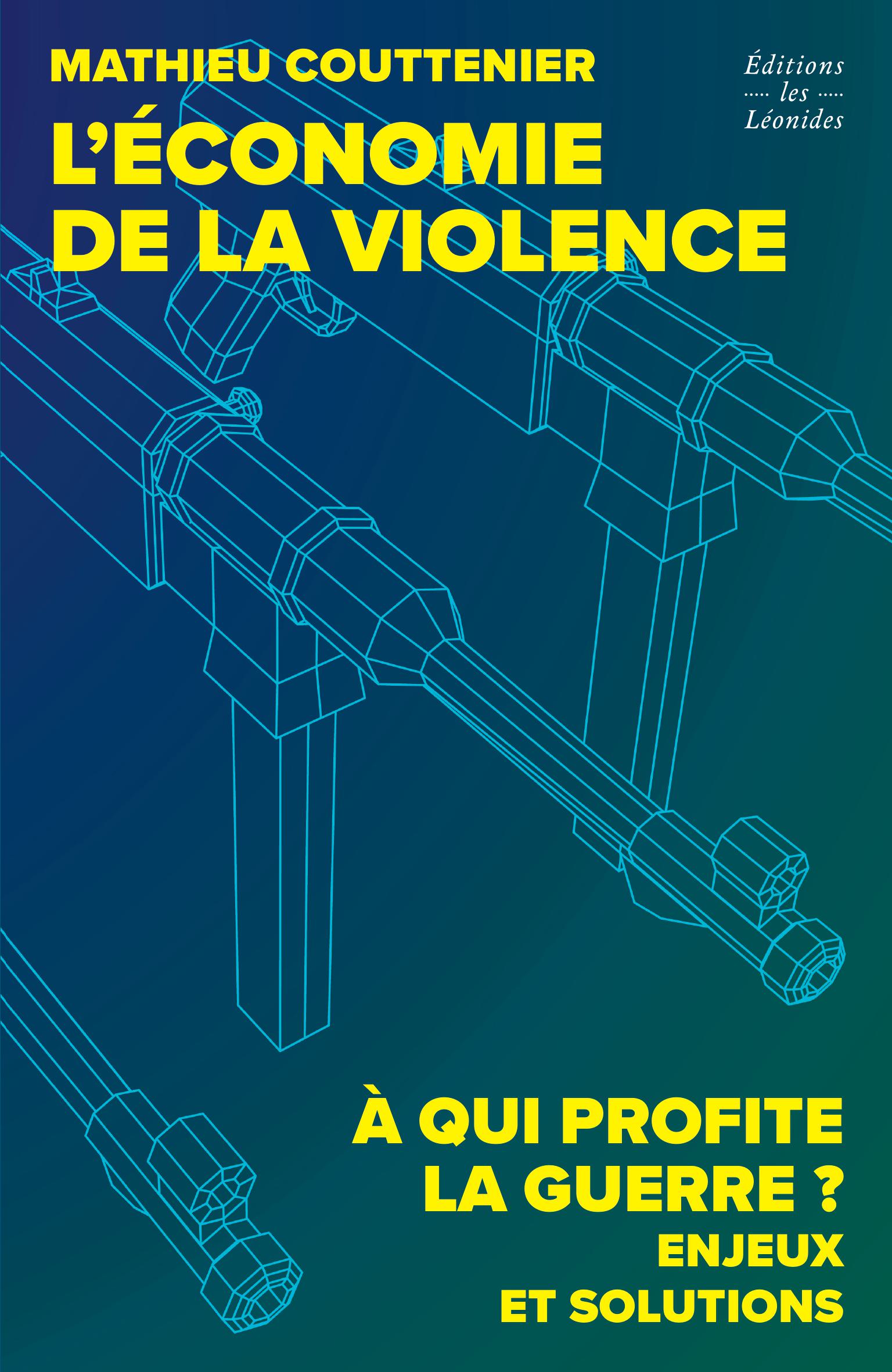L’audace marque votre livre : serait-elle un point commun entre ceux qui pensent sur le fil de leurs ambiguïtés et ceux qui choisissent de monter à bord de vaisseaux étrangers pour des destinations inconnues ?
Antoine Lilti – J’aimerais beaucoup pouvoir dire cela car j’ai une profonde admiration pour le courage et l’audace de ces voyageurs tahitiens qui ont décidé de quitter leur île pour s’embarquer avec des Européens. D’ailleurs, cela reste l’énigme du livre. Pourquoi sont-ils partis ? Où pensaient-ils aller ? Comment comprendre la confiance qu’ils faisaient à ces étonnants voyageurs venus à bord de leurs énormes vaisseaux, ces « pirogues sans balancier » qui leur apparaissaient comme de véritables îles flottantes ? Mais l’honnêteté m’oblige à plus de modestie : mon voyage intellectuel comportait bien moins de dangers que le leur. Il m’a fallu plus de persévérance que d’audace et le risque de la page blanche n’est rien à côté du scorbut, de la malaria et de la variole dont ils ont été victimes. N’oublions pas que certains ne sont jamais revenus.
La prudence aussi est au cœur de votre travail : analyser la « fable de Tahiti » n’est-il pas un exercice aussi délicat que sonder en mer les bas-fonds et les courants ?
A. L. – Cette comparaison me convient mieux car le travail d’historien s’apparente un peu à de la navigation au milieu de récifs. Pour filer à mon tour la métaphore, on avance lentement, avec prudence : il faut sonder les fonds (c’est la recherche des sources et leur lecture critique), vérifier les cartes des voyageurs qui nous ont précédés, quand il y en a (c’est la connaissance de l’historiographique mais aussi des travaux anthropologiques ou archéologiques) et se méfier des bourrasques (les interprétations trop rapides). C’est pourquoi j’ai mis dix ans à écrire ce livre, en avançant très progressivement, en révisant mes hypothèses à la découverte de nouvelles sources, en cherchant aussi la meilleure façon de raconter cette histoire. Mon but était d’entremêler deux récits : celui des voyageurs tahitiens venus en Europe et celui des Lumières confrontées à la rencontre de l’altérité.
Pourquoi le rêve d’une Polynésie sans tabou sexuel, une nouvelle Cythère, est-il tenace et partant si riche à analyser ?
A. L. – Sans doute parce qu’il se présentait sous un double aspect. On pouvait y voir un modèle de liberté, affranchi des contraintes et de l’hypocrisie de la morale chrétienne, mais aussi une société primitive, un état définitivement perdu des sociétés humaines, peut-être même une anomalie. Si bien que cette « fable de Tahiti », dont je rappelle qu’elle repose sur un malentendu, a pu prendre plusieurs formes. Pour le public curieux, c’était un sujet divertissant, entre étonnement et incrédulité. Pour les philosophes des Lumières, elle offrait un point de départ à l’imagination utopique et à la critique des faux-semblants de la civilisation. Plus tard, elle a joué d’autres rôles, apparaissant aux artistes et aux écrivains comme une échappatoire à la morale et à la société bourgeoise du XIXe siècle. Puis, ce mythe tahitien s’est abîmé par la suite, se transformant en imagerie touristique et coloniale. Le point commun de toutes ces versions, c’est le fantasme masculin d’une disponibilité sexuelle des femmes tahitiennes, offertes au désir des hommes, alors que la réalité était bien plus sinistre. Il revient à une femme, Mme de Montbart, d’avoir, dès le XVIIIe siècle, perçu le mensonge derrière cette fable et dénoncé les violences exercées sur les femmes tahitiennes.
Illusoire, ce « monde commun » n’est-il pas pourtant très fécond en librairie comme sur scène depuis son invention ?
A. L. – Absolument. C’est la raison pour laquelle je parle d’une « illusion », non pas au sens d’un mensonge mais au sens d’une fiction, d’une fable, au sens de « l’illusion théâtrale ». Dès la fin du XVIIIe siècle, le désir des Lumières de constituer un monde commun, englobant les nouvelles sociétés et cultures découvertes dans le Pacifique, a suscité un grand nombre d’ouvrages : des dialogues, des contes, de longs romans. J’en étudie plusieurs dans le livre et je m’arrête tout particulièrement sur une pièce de théâtre, Omai, grand succès londonien en 1784, qui imaginait le voyage de ce jeune Tahitien à travers le monde et s’achevait par l’apothéose du capitaine Cook, considéré comme le « César de la Grande-Bretagne ». On voit bien alors que le monde commun est une fiction philosophique et une illusion théâtrale, celle d’un monde ordonné par l’Empire britannique. En France, les fictions tahitiennes jouent un rôle un peu différent, plus critique à l’égard de la civilisation européenne, mais véhiculent, là encore, de nombreux fantasmes. Un siècle plus tard, cette illusion sera toujours féconde, comme en témoigne le succès des romans de Pierre Loti.
Il en va sans doute de la vie des idées comme de la navigation en haute mer : le pire est moins la tempête ou la controverse que la crispation idéologique, autrement dit, l’encalminage. Alliant rigueur scientifique et érudition joyeuse, Antoine Lilti nous dévoile tous les ressorts d’une histoire pleine d’équivoques et toujours ouverte, où la rencontre de l’autre, bien plus qu’une astuce rhétorique ou un bel échantillon pour enrichir les collections, met en exergue toutes les contradictions des Lumières, tiraillée entre conquête et découverte. Car dans ces pages, l’historien se situe et surtout nous raconte « le passé de quelqu’un », ces Polynésiens, Pautu, Mai, Tupaia, Hitihiti ou Ahutoru, qui embarquèrent un jour vers l’Europe.