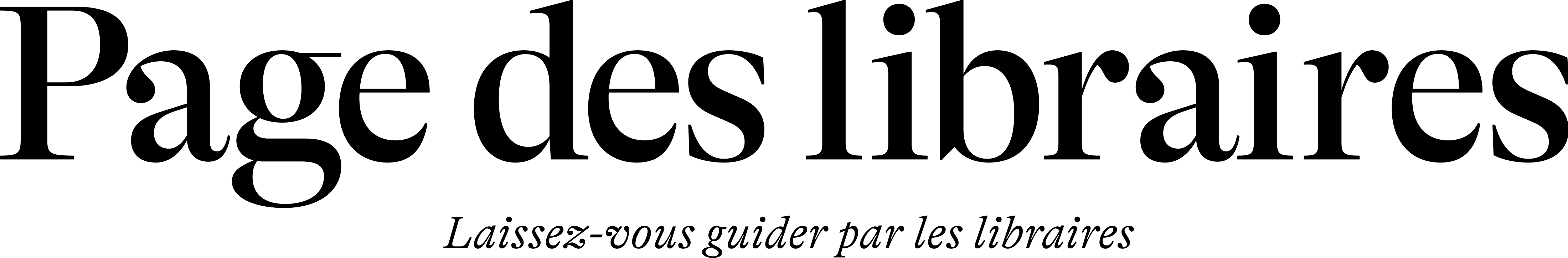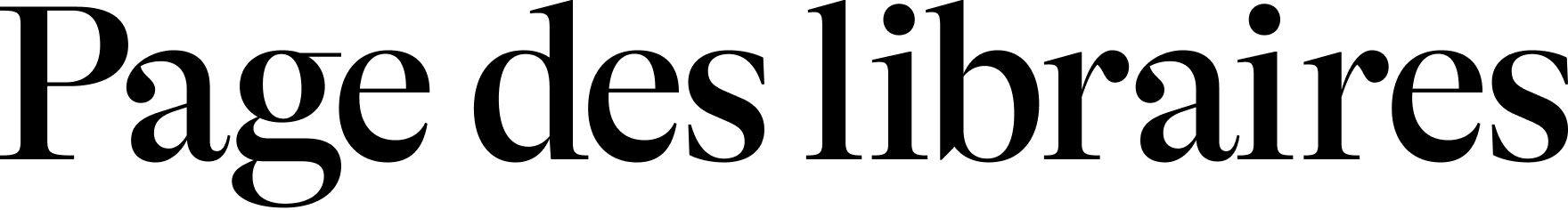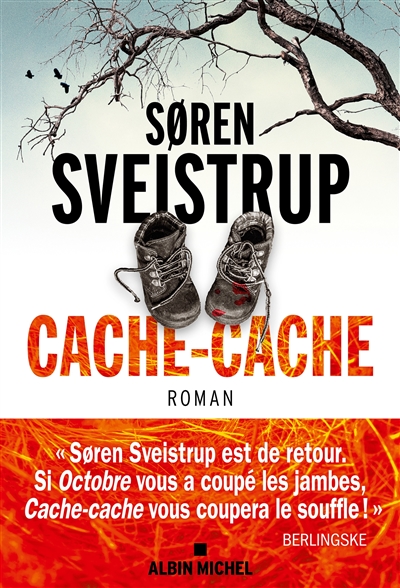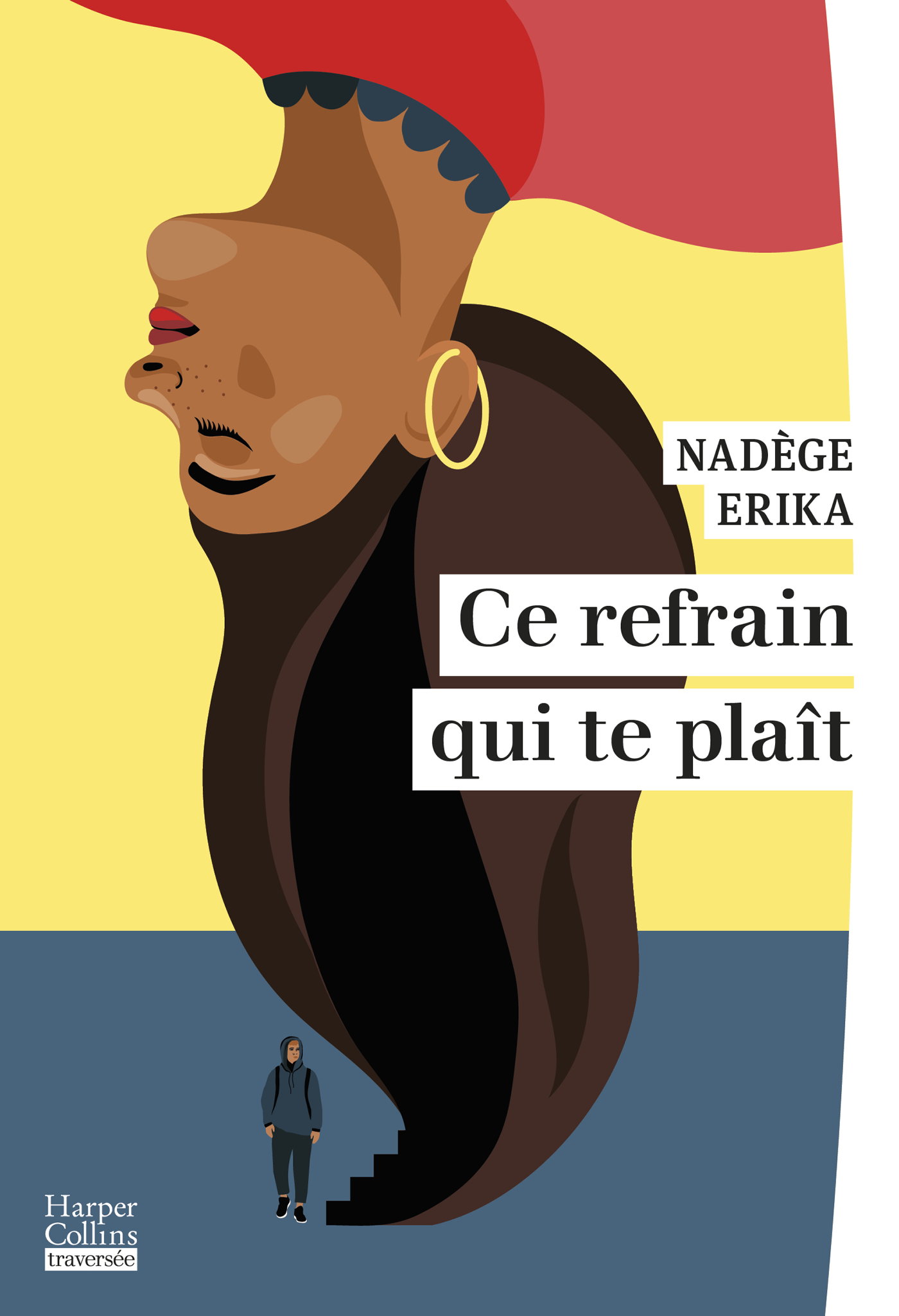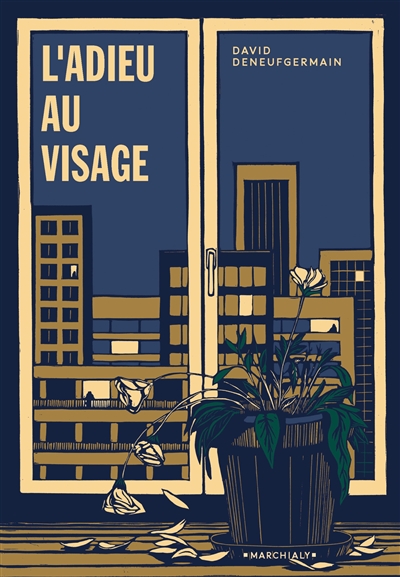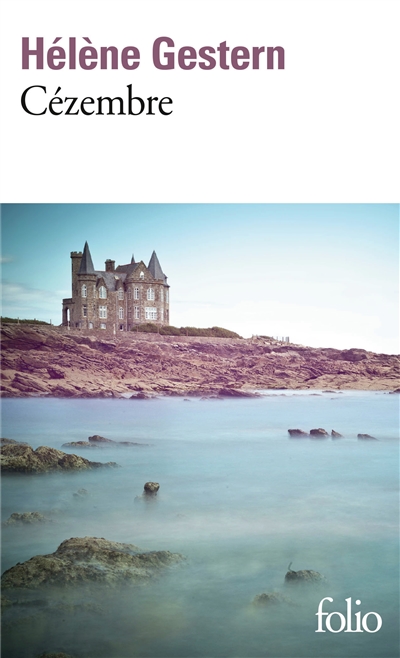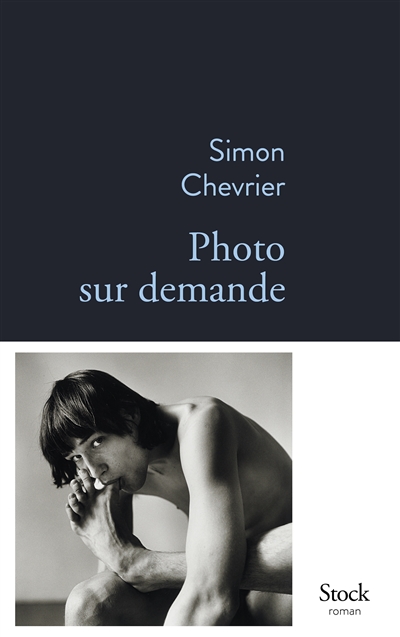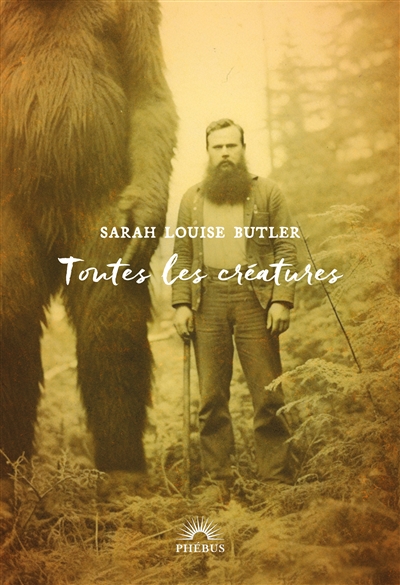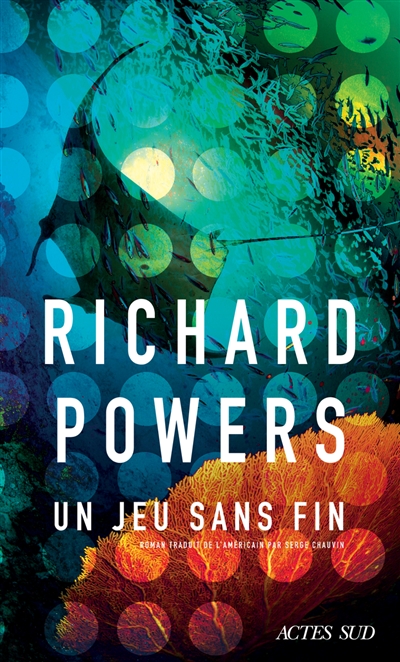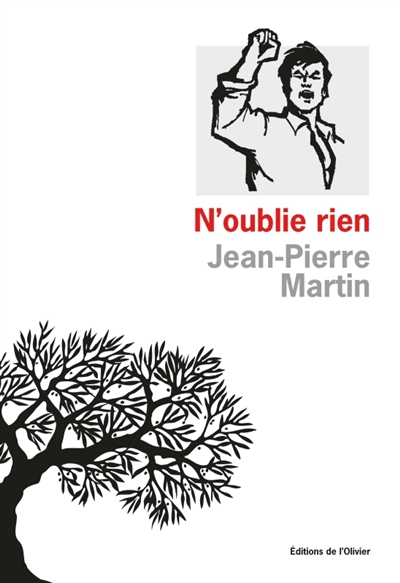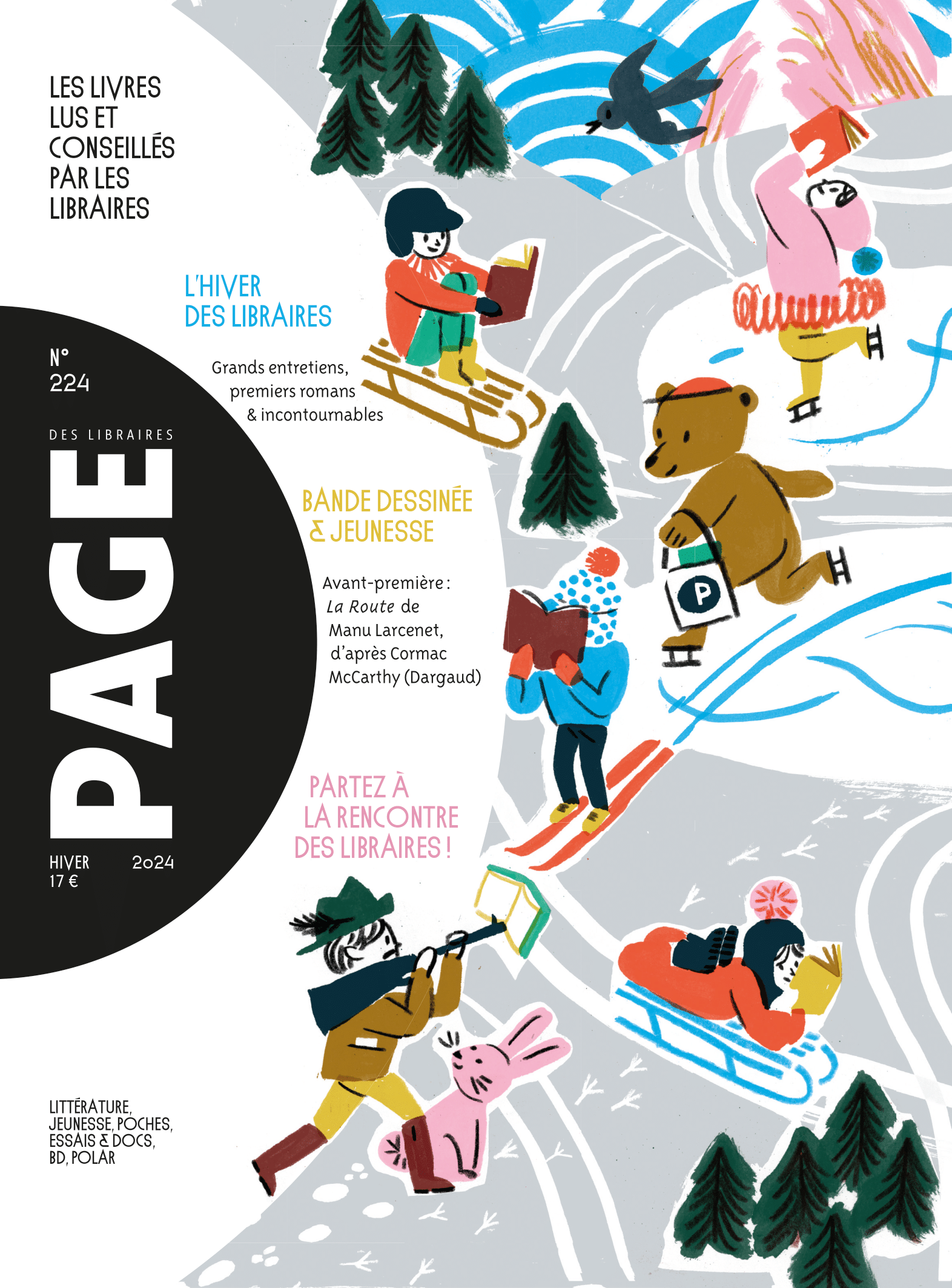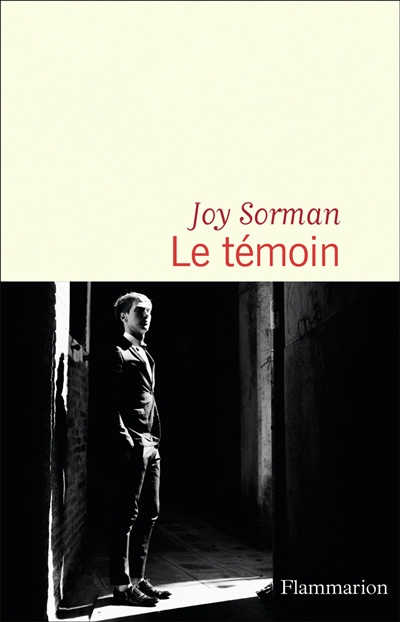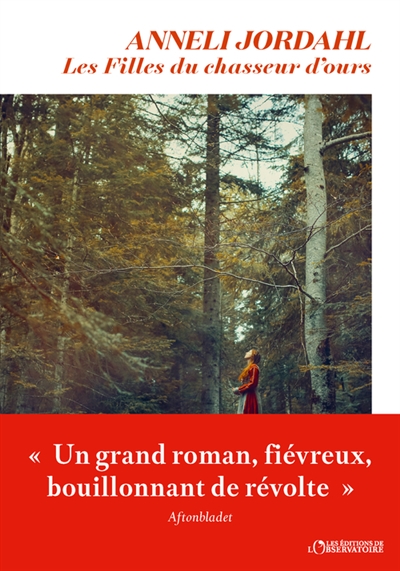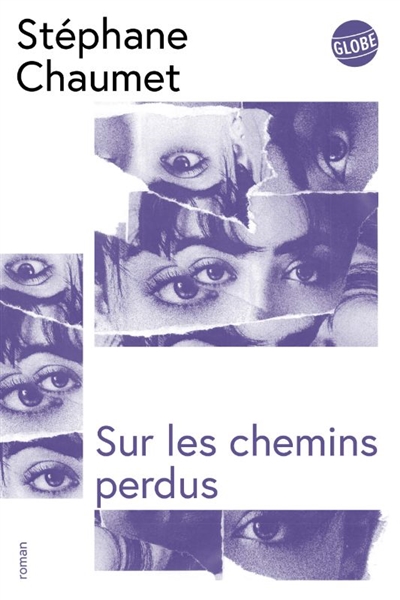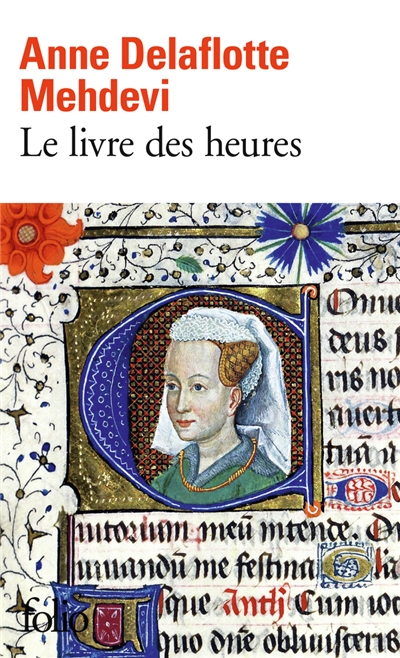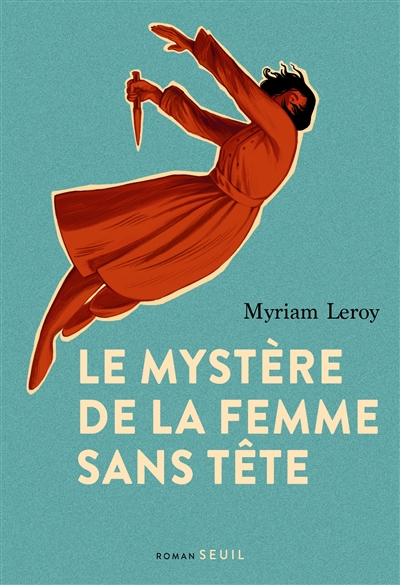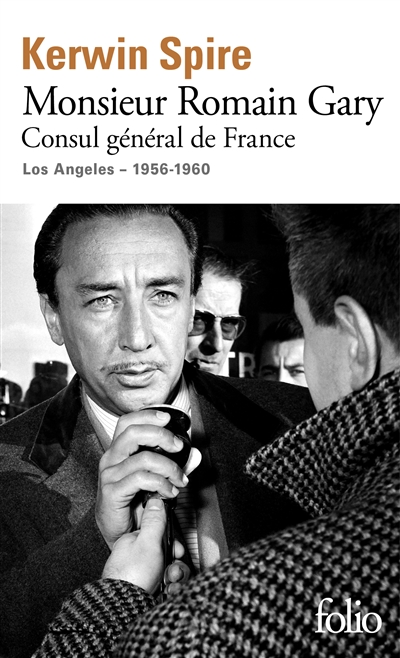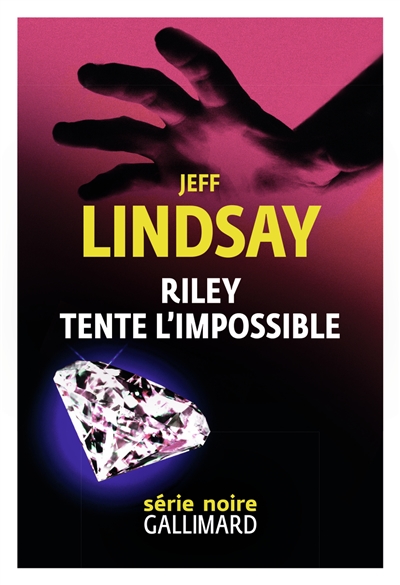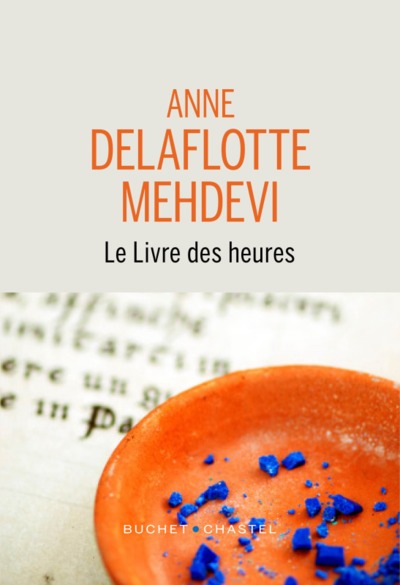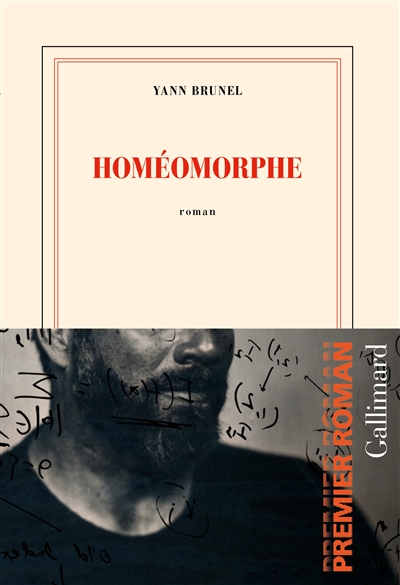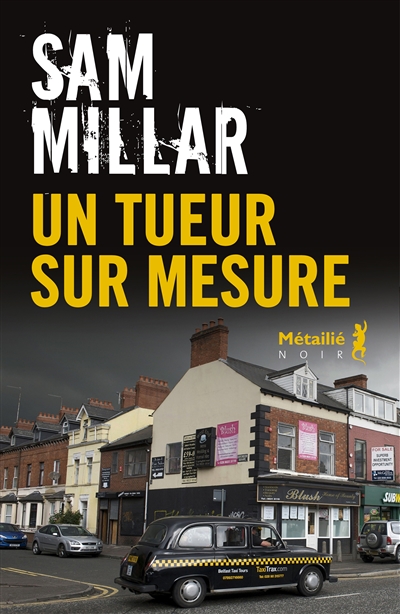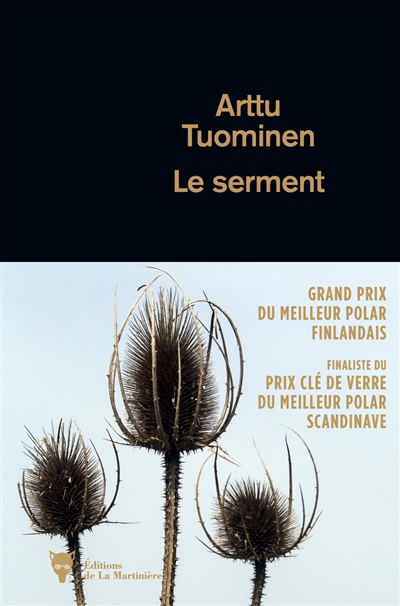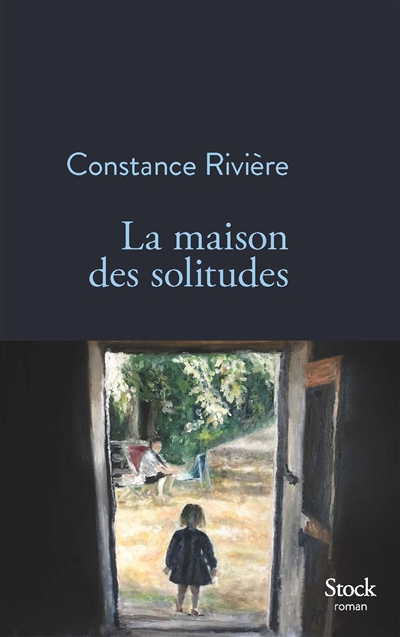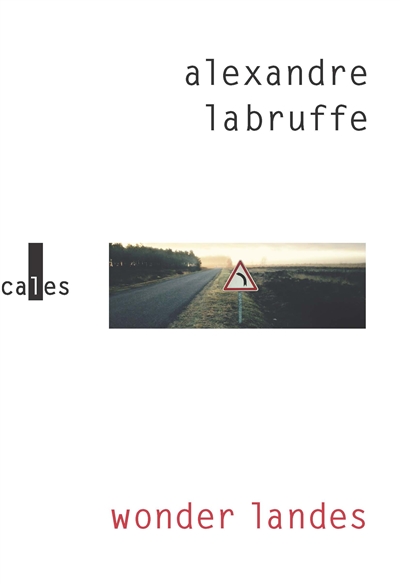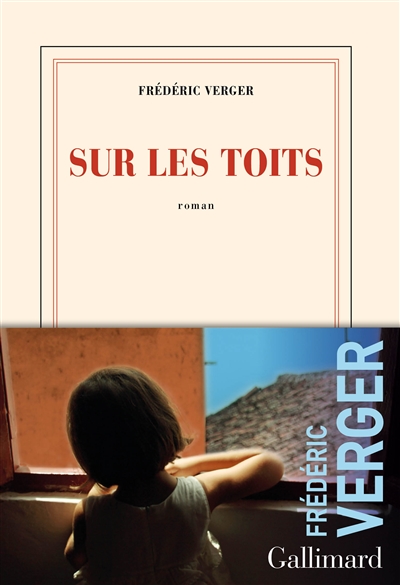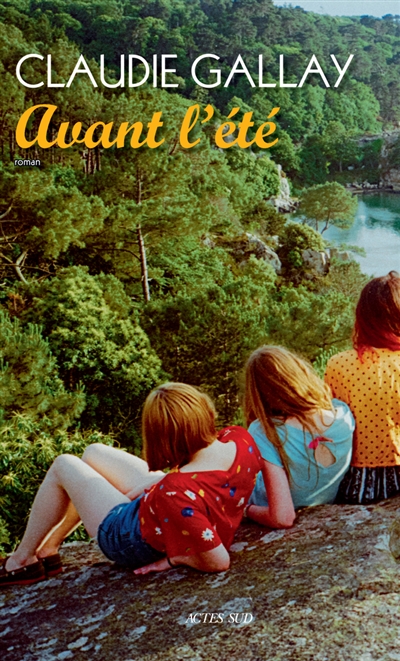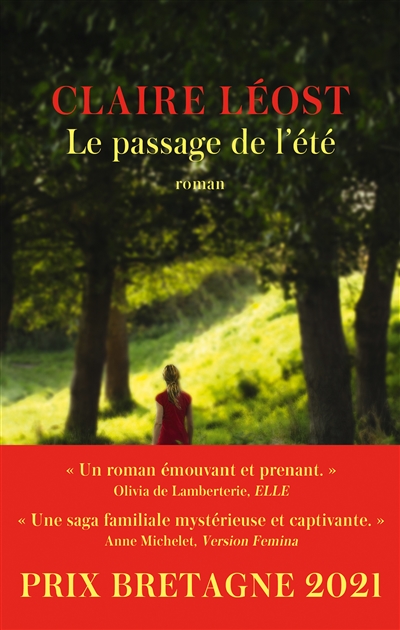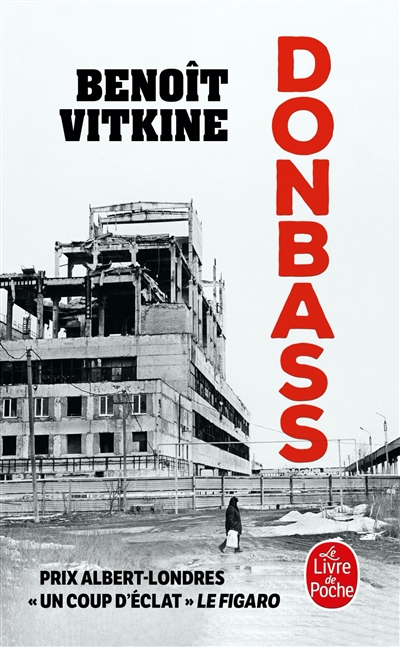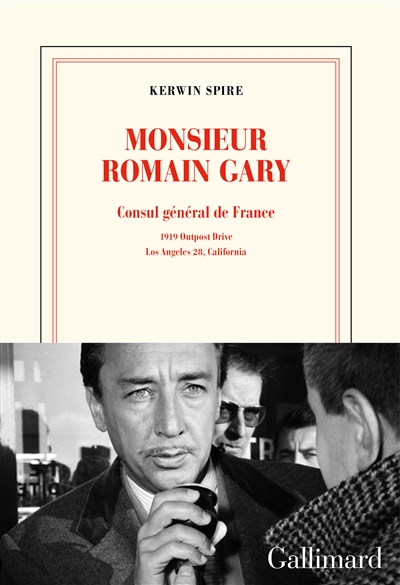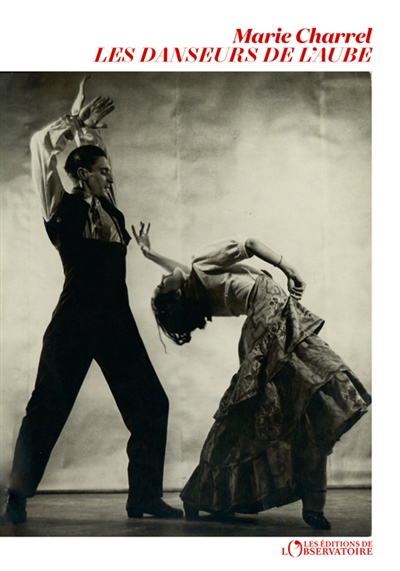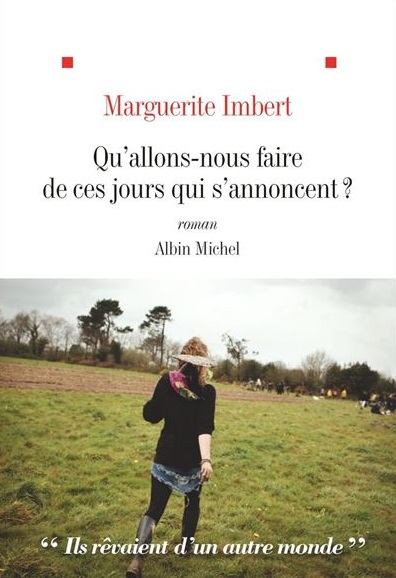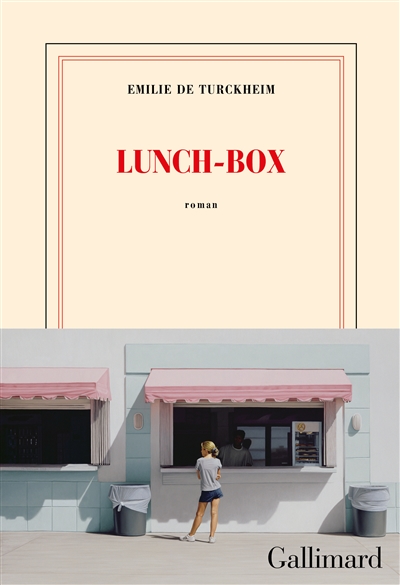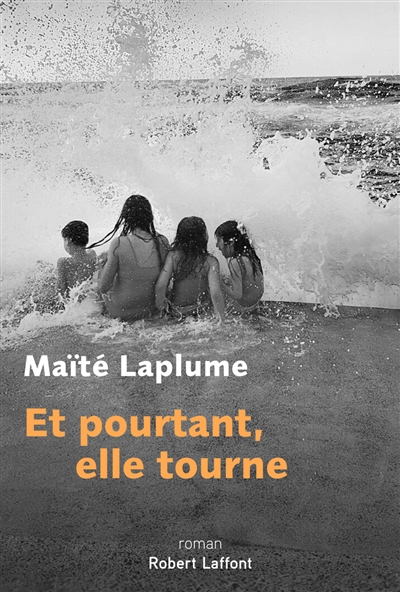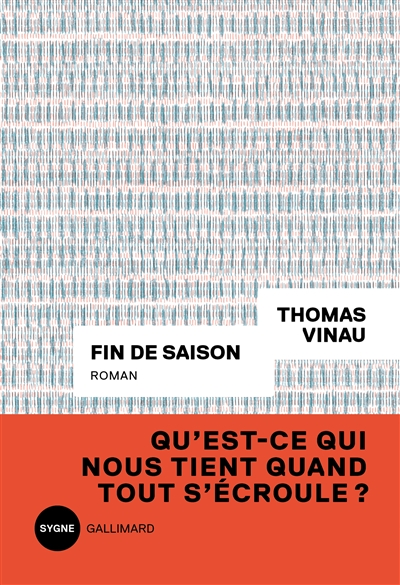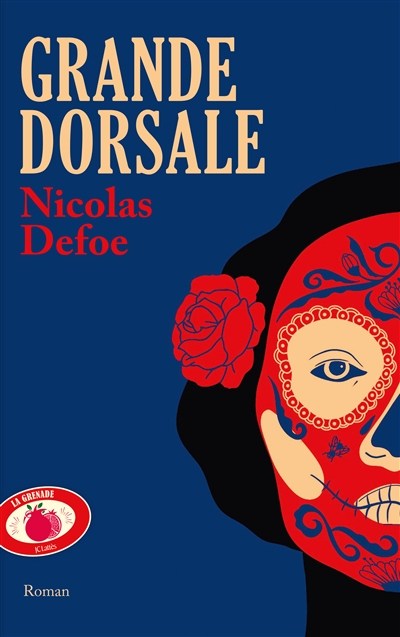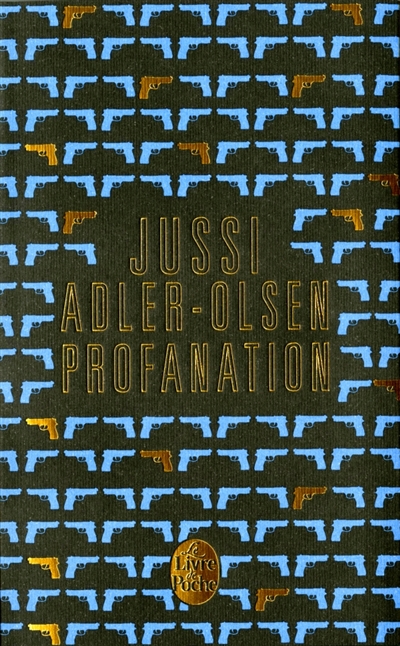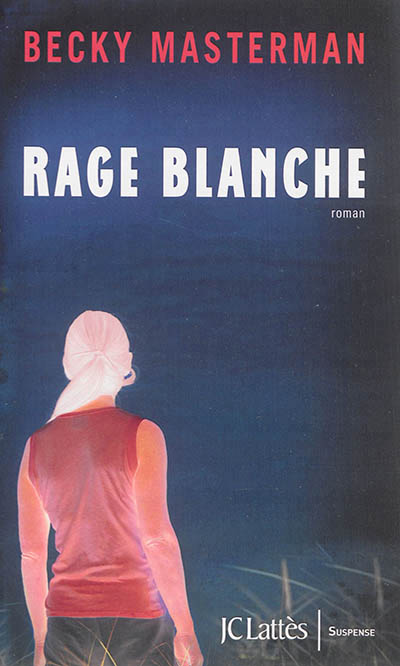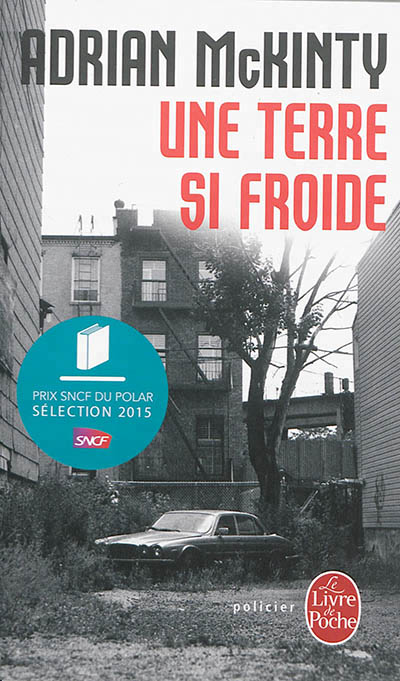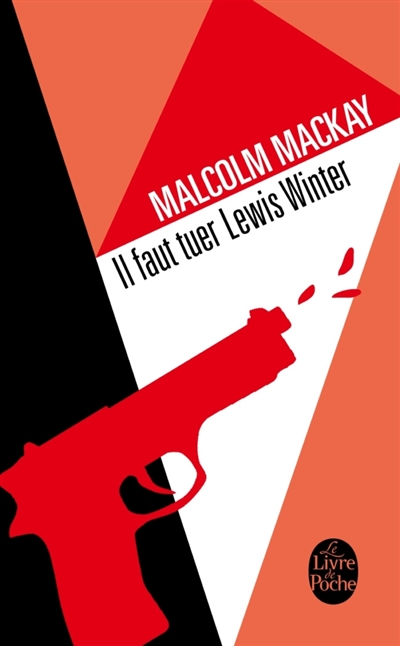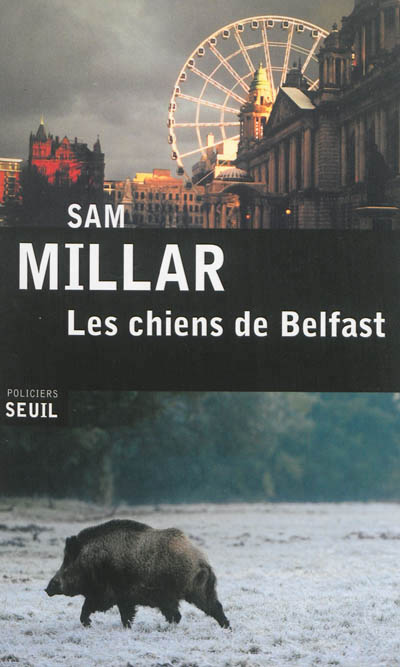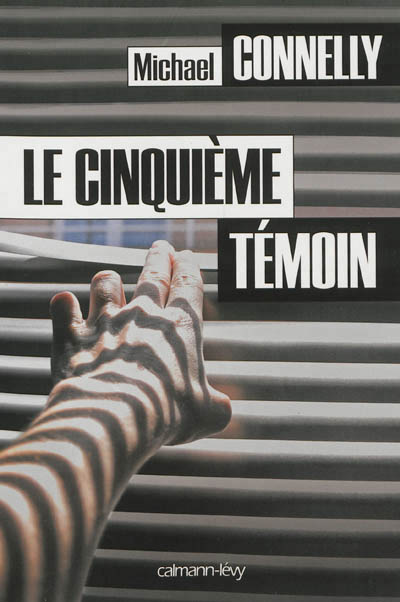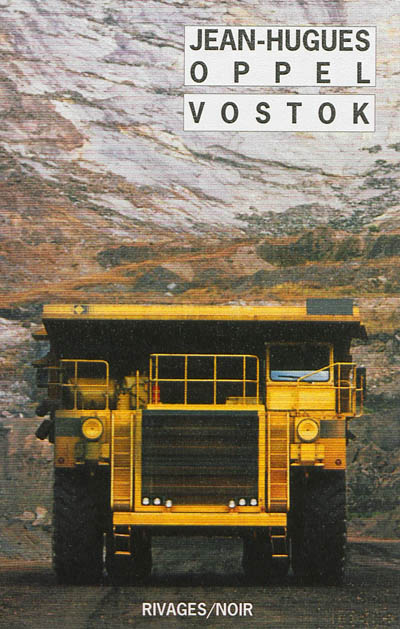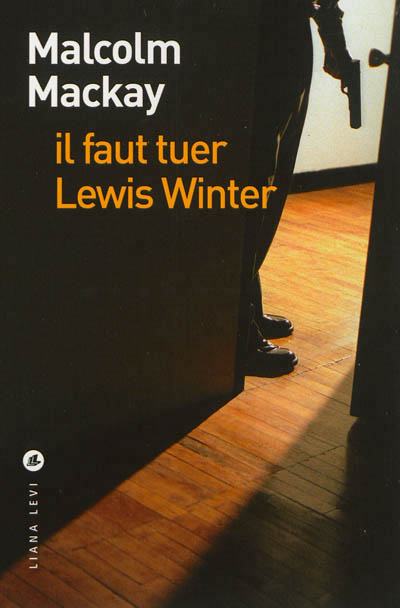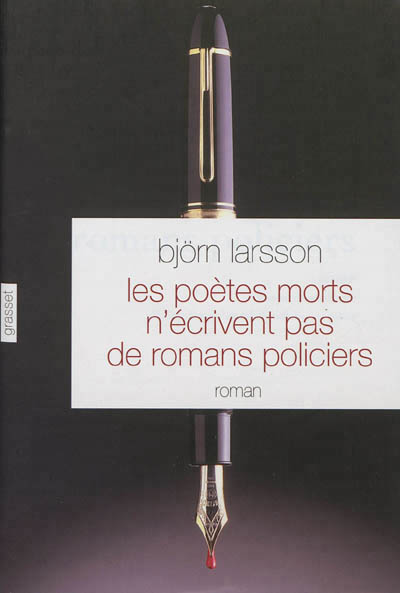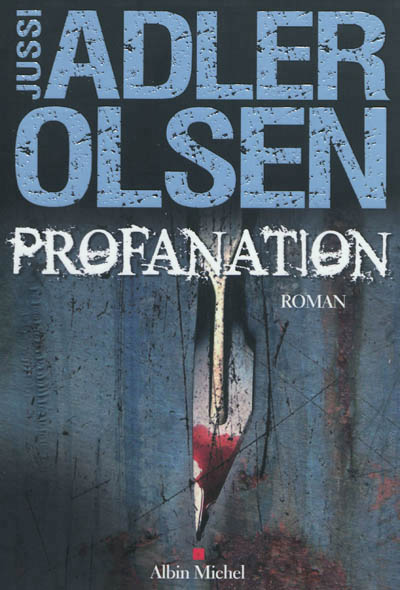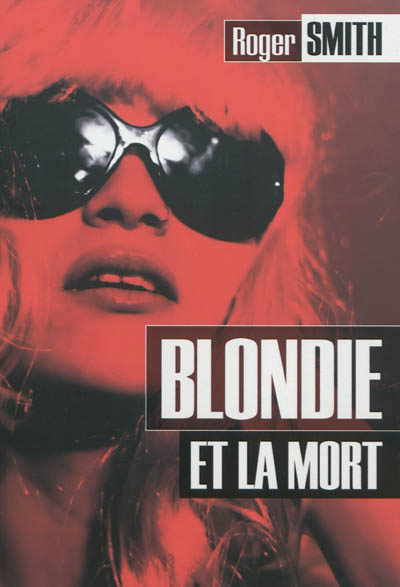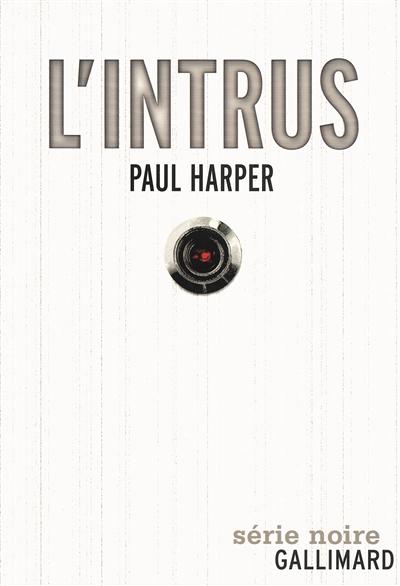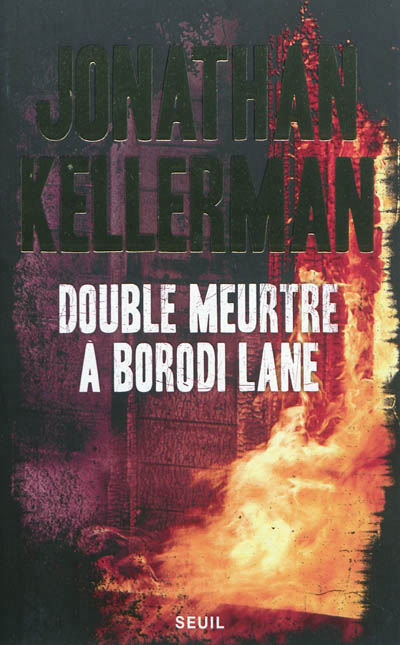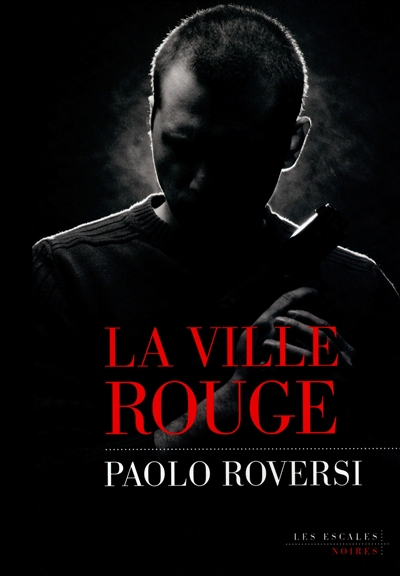Littérature française
Cloé Korman
Mettre au monde
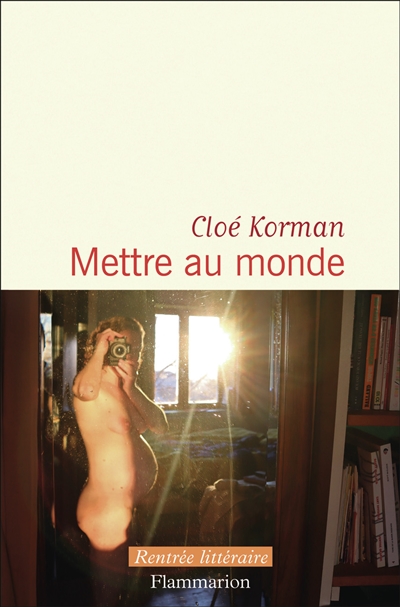
-
Cloé Korman
Mettre au monde
Flammarion
20/08/2025
288 pages, 21 €
-
Chronique de
Katia Leduc
Librairie L'Embarcadère (Saint-Nazaire) -
❤ Lu et conseillé par
9 libraire(s)
- Sophie Todescato de Les Temps modernes (Orléans)
- Delphine Bouillo de M'Lire (Laval)
- Linda Pommereul de Le Failler (Rennes)
- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)
- Tracy Pradalier de Bibliothèque Germaine Tillion (Paris)
- Coralie Brunel de Forum (Saint-Étienne)
- Margot Bonvallet de Passages (Lyon)
- Mélanie Dallara de Goulard (Aix-en-Provence)
- Nathalie Barqueiro de L'Îlot pages (Malakoff)

✒ Katia Leduc
(Librairie L'Embarcadère, Saint-Nazaire)
Cloé Korman s’empare de l’histoire des femmes dans un roman des corps et des désirs, de leur appartenance au monde, qui questionne non seulement la maternité mais également la société actuelle. Un ouvrage convaincant où l’intensité des personnages s’accompagne d’une langue charnelle et poétique.
Quelle fut la genèse de ce roman, Mettre au monde ?
Cloé Korman L’origine est très précise : elle se rapporte au souvenir presque inatteignable de la naissance de mon premier enfant en juillet 2018. J’ai eu la sensation de quelque chose d’intense et d’invisible. Presque comme si c’était ma propre naissance, avec l’envie de capturer cette émotion, ces sensations physiques, la signification que cet événement revêtait dans ma vie. Il me fallait ainsi accéder à un certain savoir, une technique, en restant bien entendu dans l’humain. Deux personnages sont ainsi nés, deux femmes un peu issues de moi : Marguerite, une historienne, et Jill, une sage-femme. Cette écriture m’a permis de remonter le fil de cette expérience en me laissant guider par le savoir de Jill, par ses gestes, sa relation avec ses collègues. Marguerite fut une sorte de double, quant à sa manière de regarder sa grossesse et d’y réfléchir.
L’histoire des femmes est le fil rouge de votre roman avec le personnage de Marguerite. On assiste à ses recherches, son entretien haut en couleur avec la première femme gynécologue, ses visionnages de films militants... Quel est votre regard sur ces années de combat ?
C. K. Comme le dit Marguerite, elle a l’impression que sa naissance doit autant à la biologie qu’à la possibilité d’avorter. C’est le thème de ses recherches : elle se pose la question de garder son enfant tout en étant une chercheuse spécialiste de la légalisation de l’avortement. J’avais donc en permanence besoin de mettre en scène cette tension, ce moment d’émancipation des femmes que fut le tournant des années 1970. Plus je cherchais, plus la densité d’événements était vertigineuse : l’accès légal à l’avortement puis à l’échographie de grossesse, la péridurale… Ces années-là ont donc été un véritable choc. La relation de Jill avec sa mère, infirmière, m’a permis de partir à la rencontre des professionnelles qui travaillaient dans les maternités ou les hôpitaux, là où les femmes ont récemment pris l’habitude de mettre au monde, avant et après ce basculement.
Ce roman est éminemment politique, avec une volonté de démontrer le contournement préoccupant par une partie de la sphère politique de la loi Veil, avec une stigmatisation d’une catégorie de la population. Qu’est-ce que cela dit de notre société ?
C. K. C’est un roman que j’ai écrit intensément au présent, presque en temps réel. Plus le temps passait et plus les neuf mois de la grossesse de Marguerite coïncidait exactement avec le temps de l’écriture, un temps que j’ai vécu dans une angoisse de l’actualité très aiguë, où le théâtre politique révélait quelque chose de profondément injuste dans notre rapport à l’immigration, avec notamment le procès Pelicot. Il y avait une dimension grimaçante, beaucoup de cynisme dans l’exploitation politique des événements, favorisant l’excès des discours. Je me suis demandé quelle serait une politique xénophobe sur le plan de la santé publique du point de vue du ministère de l’Intérieur, de l’éducation ou de la santé. Comme souvent la réalité dépasse un peu la fiction, je ne m’attendais pas à entendre l’expression de « réarmement démographique » pour encourager le natalisme, ni à ce qu’il y ait un reflux de l’aide gratuite qui mette profondément en danger les femmes immigrées dans leur rapport à la contraception et dans leur possibilité d’accéder à l’IVG.
Dans votre roman, on trouve une forme de satire assez salvatrice avec une ministre du droit des femmes et une directrice de colloque qui n’hésitent pas à recourir au buzz ou à des approximations assez consternantes ! Que vous permettent-elles de dire ?
C. K. J’ai aussi éprouvé le besoin de rire de cette actualité et de ce personnel politique souvent grotesque ; notamment de me moquer de la commémoration de la loi Veil qui fut l’occasion de nombreux outrages à l’Histoire. Cette commedia dell’arte politique a quelque chose d’indécent dans sa manière de s’approprier opportunément les tragédies du quotidien. La mettre en exergue m’a permis de l’opposer aux combats réels de ceux impliqués sur le terrain et à toutes les formes de résistance.
Jill est sage-femme, elle jongle entre ses gardes et ses deux enfants qu’elle élève seule, aidée en cela par sa mère Jeanne, ancienne infirmière avec qui sa relation est complexe, faite de nombreux non-dits. Marguerite, chercheuse à l’université sur l’histoire des avortements illégaux, mène une vie plutôt libre et sans attaches. Alors qu’elle prépare un colloque sur les 50 ans de la loi Veil, elle se découvre enceinte. Reflet d’un monde en mutation, celui des années 1970, cette fresque intimiste recense les droits des femmes si chèrement acquis. C’est aussi la satire de l’arène politique et ses dangereuses compromissions. Un roman juste, troublant et salutaire !