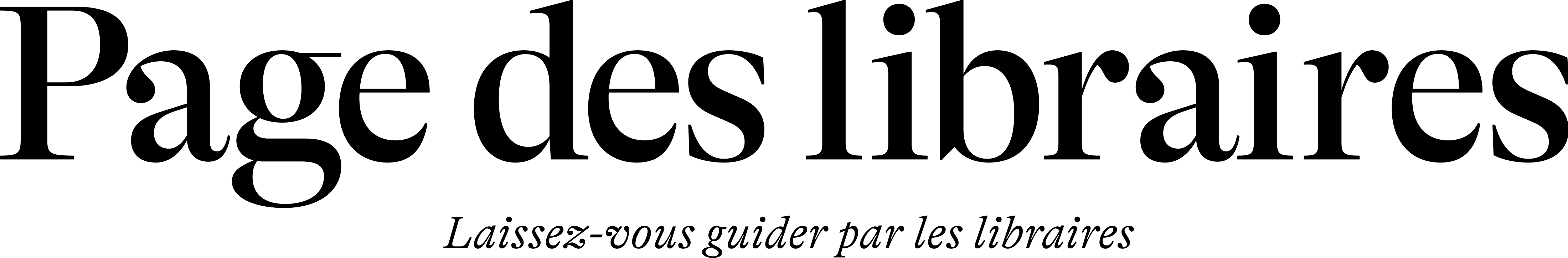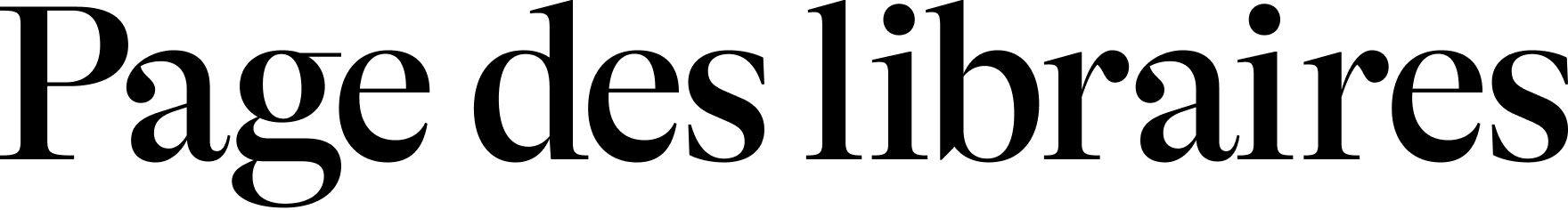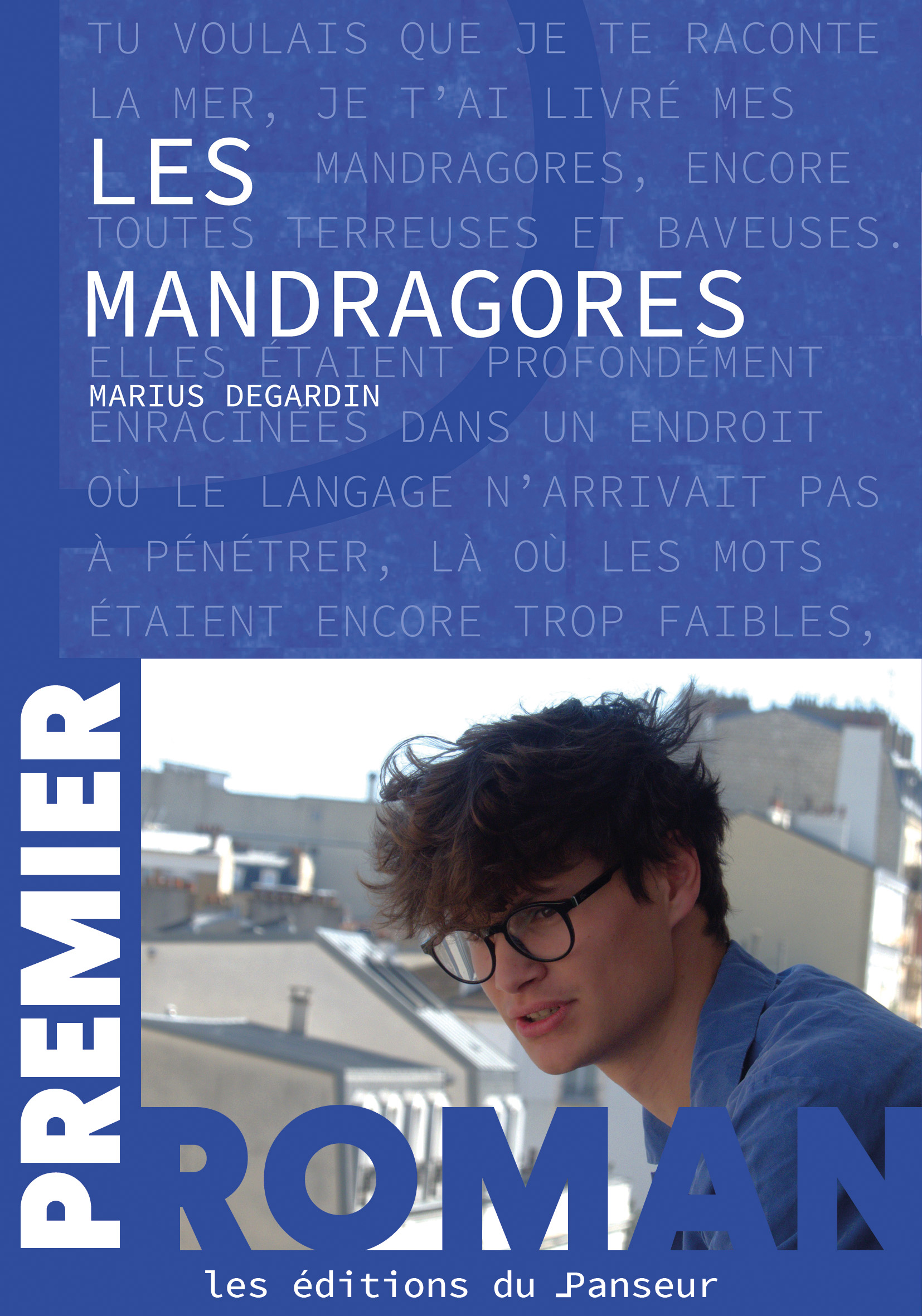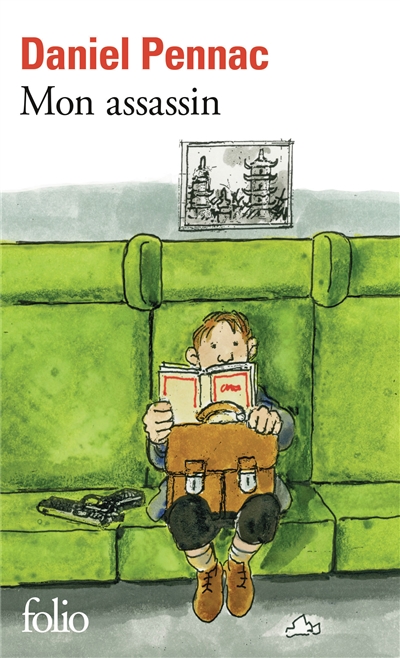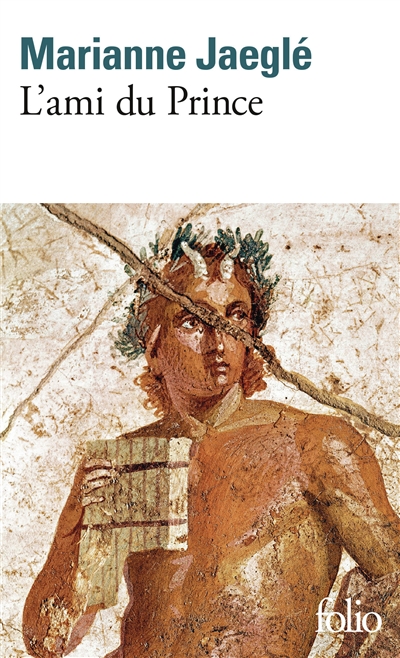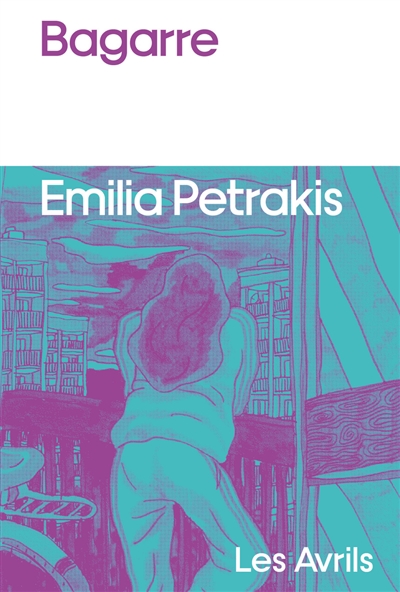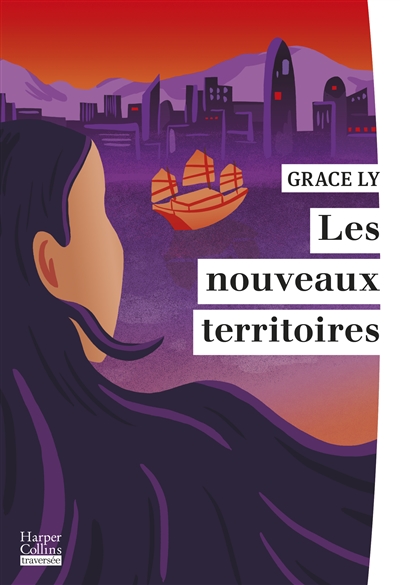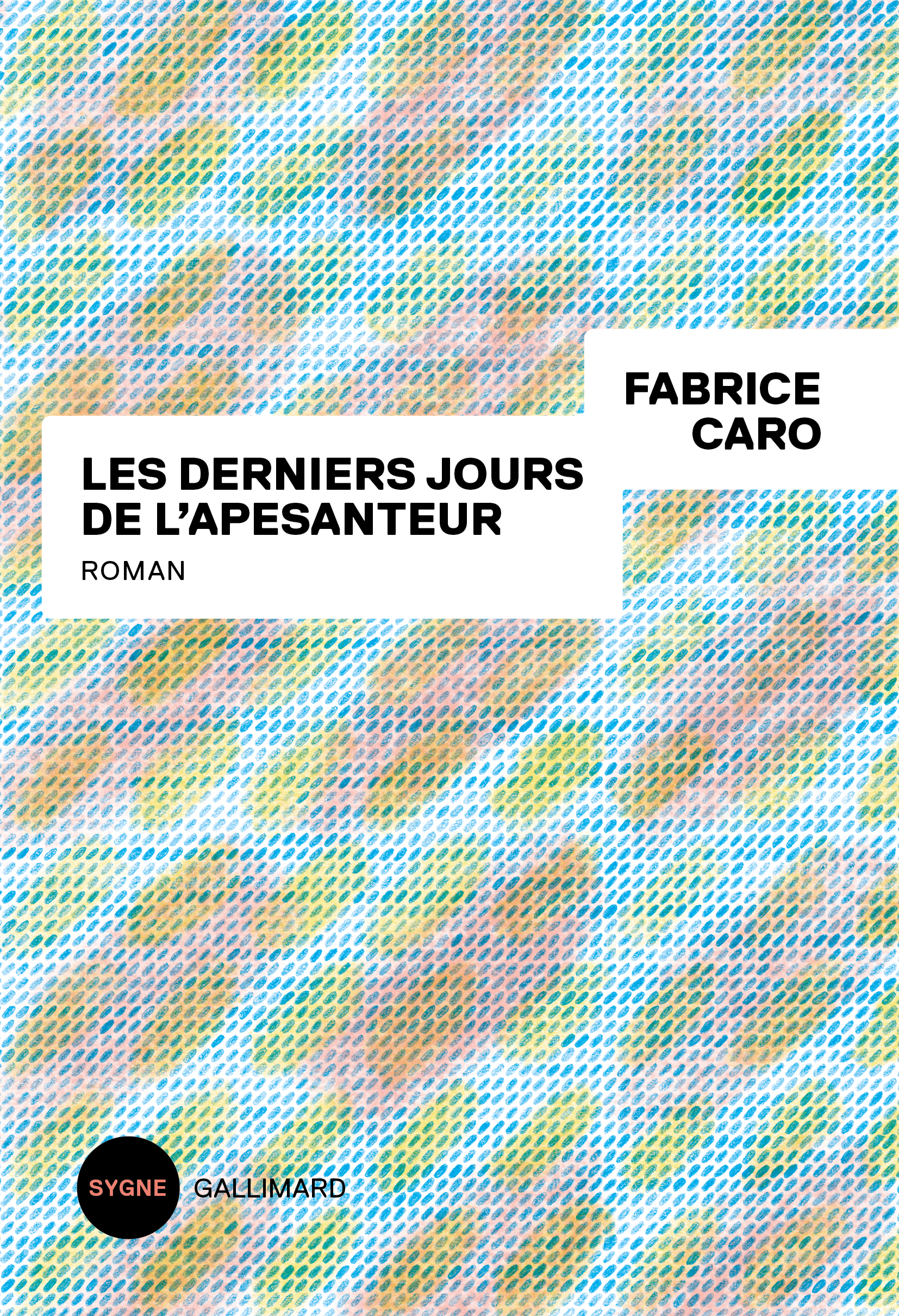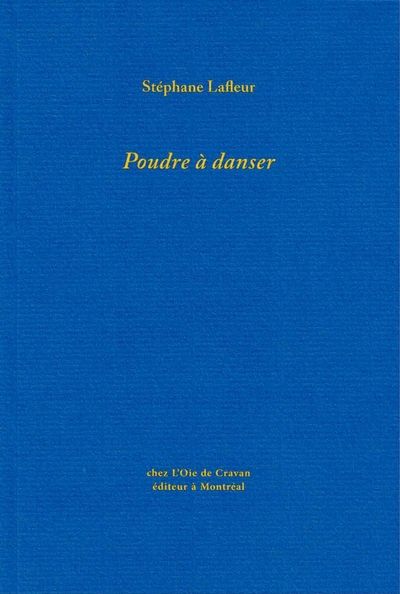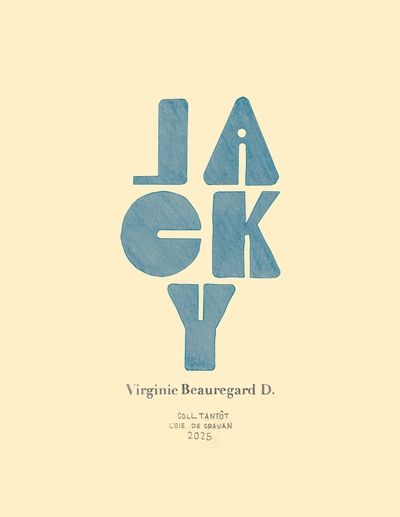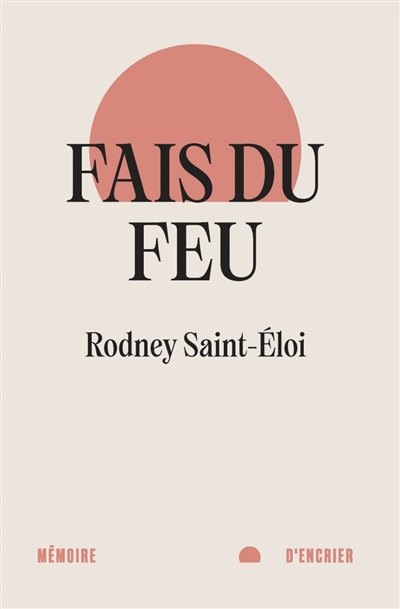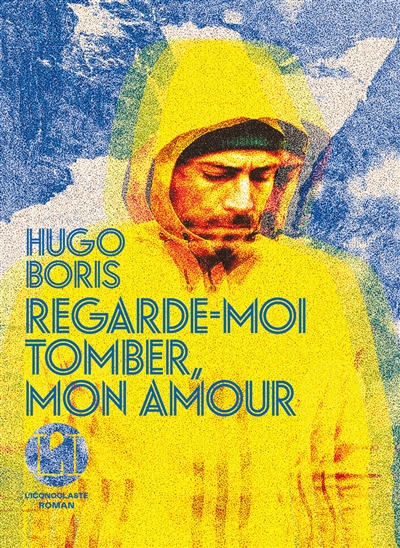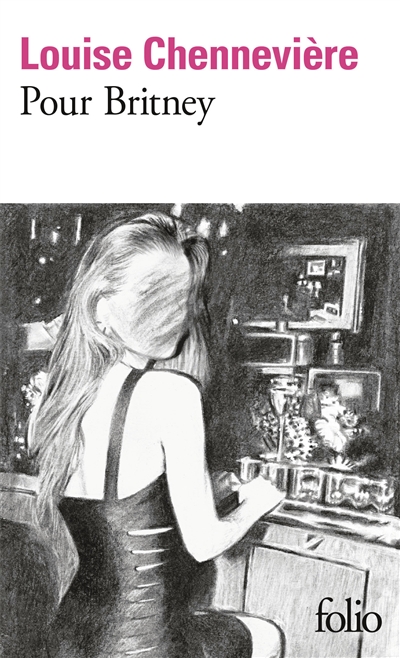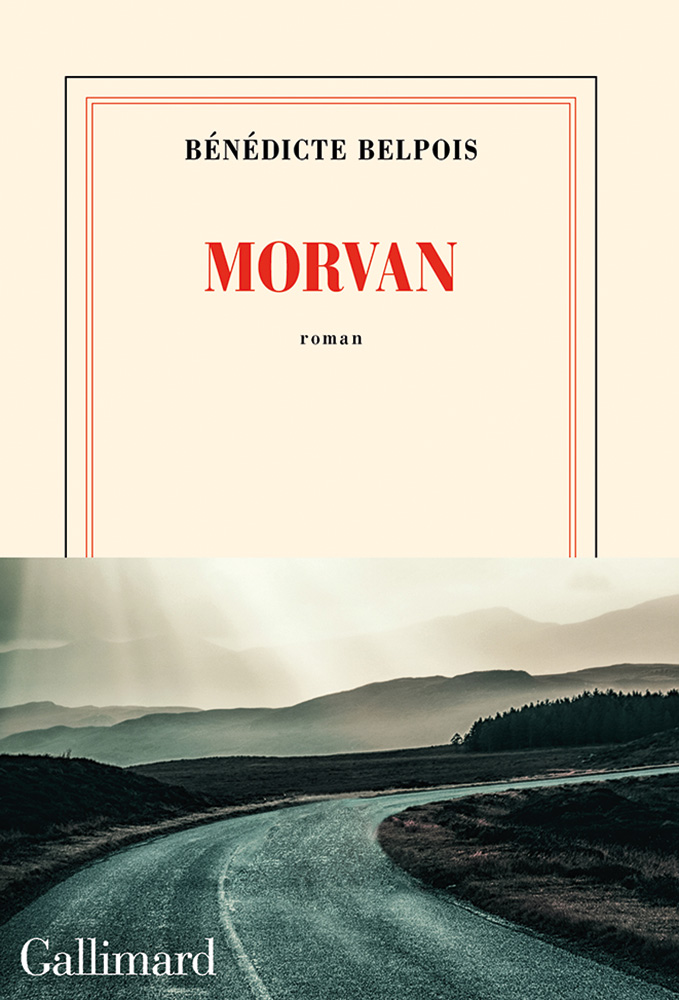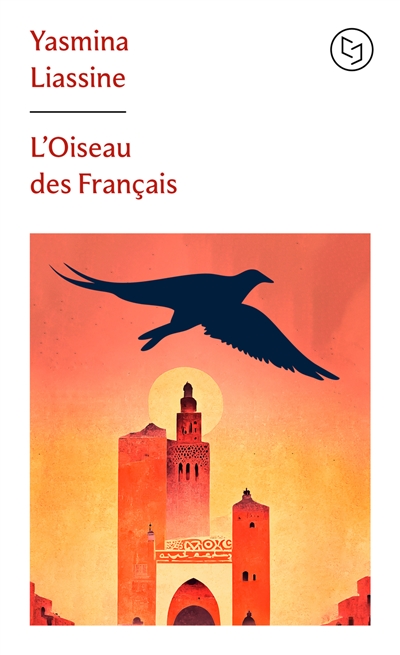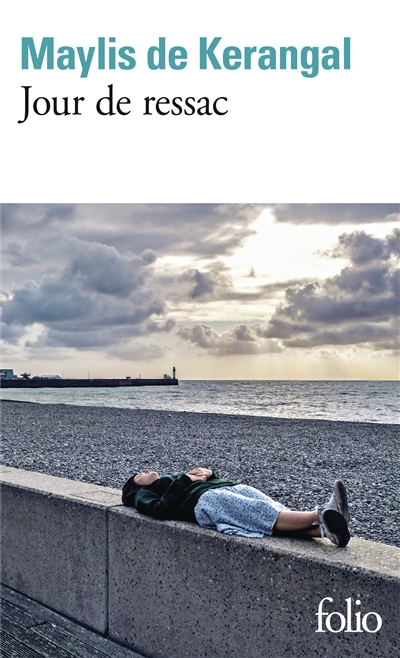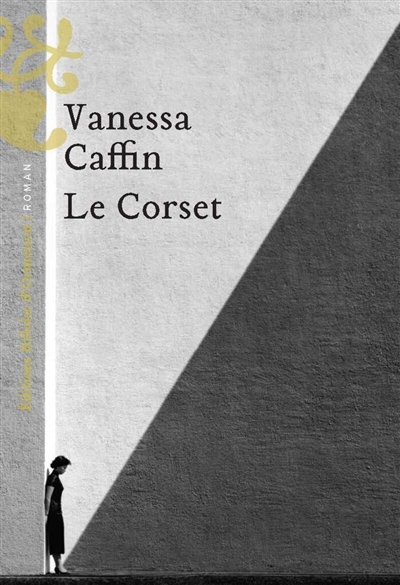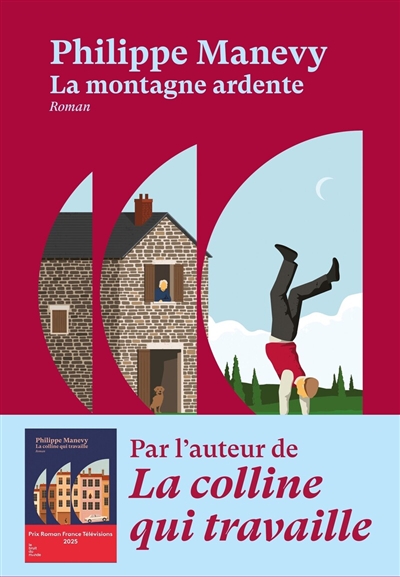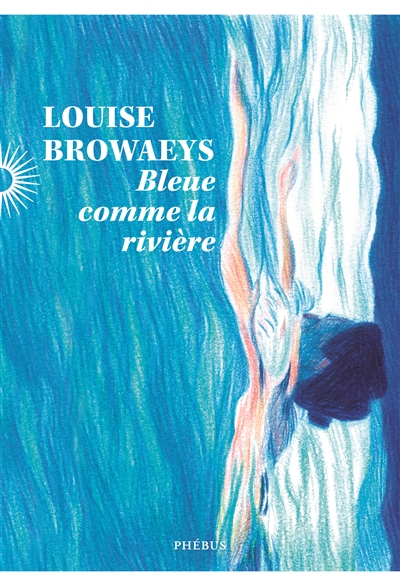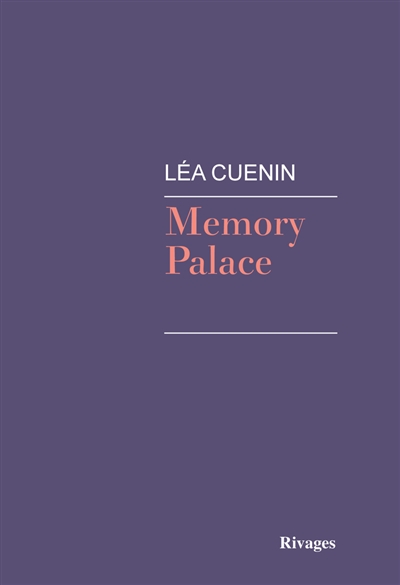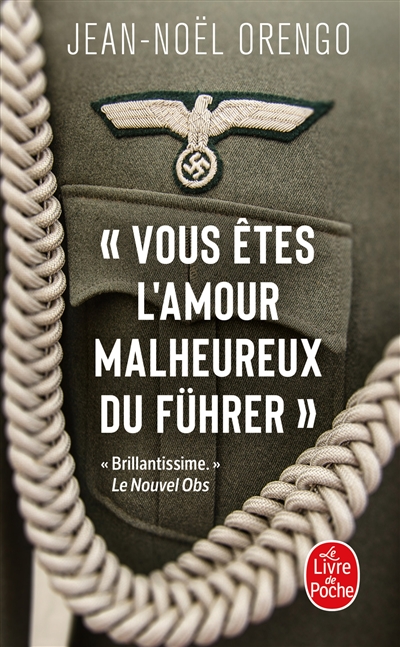Les Mandragores, c'est l'histoire d'une fratrie, de quatre jeunes adultes sacrément cabossés par la vie et par leur famille. Pouvez-vous nous les présenter ?
Marius Degardin Le chef de la famille, celui qui a pris la place des parents qui sont partis, c'est Primo. C'est un musicien classique, un violoniste. Sa réponse à l'absence des parents, c'est une forme d'animosité. Le deuxième, Piero, est pianiste de jazz. Il est aveugle. C'est celui qui « tient la baraque » à l'intérieur de la famille, qui essaie de colmater l'absence de sentiments de l'aîné. La troisième, Chiara, est une révolutionnaire dans l'âme. Elle est sage-femme et elle incarne une forme d'espoir parce qu'en faisant accoucher, elle prépare le monde de demain, même si elle est très abîmée par le monde d'avant. Et le dernier, c'est Benito, dont le prénom a été choisi par son père en référence à Mussolini. Il est l’héritier de tout ça mais ne s’y reconnaît absolument pas.
Justement, c'est à Benito que vous avez choisi de donner la parole dans ce livre. Pourquoi ?
M. D. Comme lui, je suis le dernier de ma fratrie. Dans cette position où l’on est un peu à la lisière d’un passé qui nous rejette et d’un avenir qui nous fait peur, avec cette sensation d’être coincé dans le présent. Benito n'arrive pas à s'y accrocher, ça le fait souffrir. Je trouvais intéressante cette position où on arrive après le drame et où il faut colmater. Où il faut des histoires. Et, généralement, les petits derniers sont connus pour raconter les histoires des adultes.
Mais celui qui détient les clés de l'histoire familiale, c'est Primo.
M. D. Primo n'habite pas avec ses frères et sœur alors il les invite tous les mois pour leur donner de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Au cours de ces dîners, l'aîné va, comme un fossoyeur, ressortir des souvenirs, des reliques, une photo du père, une photo de la mère, des lettres, un carnet… Je trouvais intéressant de voir à quel point un personnage peut imposer une version de l'histoire et comment les autres récupèrent cette histoire en tentant de mettre un peu de lumière là où ils pensent qu'il pourrait y en avoir.
Comment réussissez-vous à tenir cet équilibre subtil entre les choses terribles qui leur arrivent et des éclats de lumière ?
M. D. En fait, je suis arrivé avec pas mal de situations sombres parce que je ne les avais pas trouvées dans mes lectures. Mais, en les écrivant, je me disais : « Il ne faut pas que ce soit une finalité, il faut que ce soit un passage. » Vous parlez d’« éclats » et moi j'aime bien l’expression « éclat de rire ». J'ai essayé de faire en sorte que cette histoire soit drôle. Les éclats de rire, ça met vraiment des pointes de lumière et, au bout d'un moment, si on suit nos éclats de rire, on arrive à quelque chose de beaucoup plus lumineux.
Parmi les nombreux personnages secondaires, il y a Roman, le meilleur ami de Benito qu’il décrit comme un « danseur du précipice ». Comment avez-vous imaginé ce personnage ?
M. D. Roman, c'est un peu le fruit de mes lectures de Nietzsche. Mais c'est aussi un hommage à mes amis qui m’ont énormément aidé. Au début du livre, le personnage de Roman est comme une version aboutie de Benito : il lui parle de l'éternel retour et lui explique comment fonctionne la vie. Et, en l’écoutant, Benito se fait une promesse, celle de vivre ces choses pour les comprendre. Roman, c'est l'horizon d'un avenir, d'une santé possible. Il le fait voyager jusqu'à la mer, il le sort de l'amertume et du caractère obscur de la capitale.
Le titre, Les Mandragores, a un lien avec Albert, un autre personnage formidable que Benito rencontre à Saint-Anne. Albert y a un jardin. Or un jardin, c'est planter pour préparer l’avenir. Est-ce aussi ce que raconte votre roman ?
M. D. J’ai été très marqué par Les Misérables de Victor Hugo qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise graine, qu’il n'y a que de mauvais cultivateurs. Quand j’étais au lycée, j’ai commencé à entretenir mon balcon où j'avais des plantes. On change de temporalité, ça donne un rapport direct au monde. Le personnage d'Albert se raccroche à une temporalité qui est loin des souffrances humaines. Quand le présent est trop lourd, inscrire le cours des événements dans le temps long, avec des végétaux qui poussent par exemple, apporte de l’apaisement.
Dans la famille Cipriani, il y avait les parents venus d’Italie, disparus l’un après l’autre. Les quatre enfants ont alors dû se débrouiller seuls, pour survivre et pour inventer l’avenir, à défaut de comprendre le passé. Cabossés par la vie, tous le sont. Mais Benito, le petit dernier, s’en trouve bouleversé au point de ne pas vouloir affronter la suite. Au fil des rencontres – avec Iris, une jeune prostituée, Albert, un interné de Saint-Anne, Roman, son meilleur ami – et des mots d’un « herbier des beaux jours », Benito s’invente une voix et une voie pour naviguer vers l’avenir. Marius Degardin signe un premier roman éblouissant par son style, sa construction et la puissance de ses émotions.