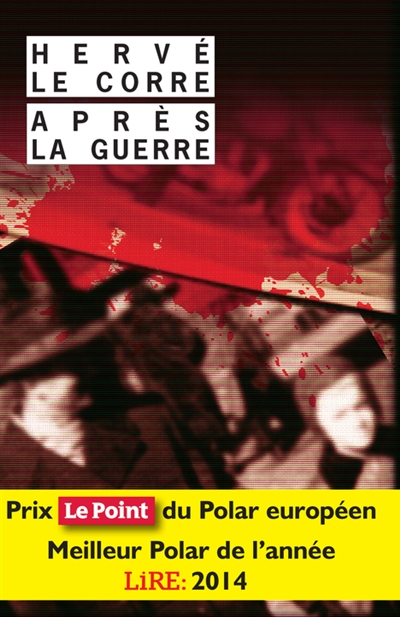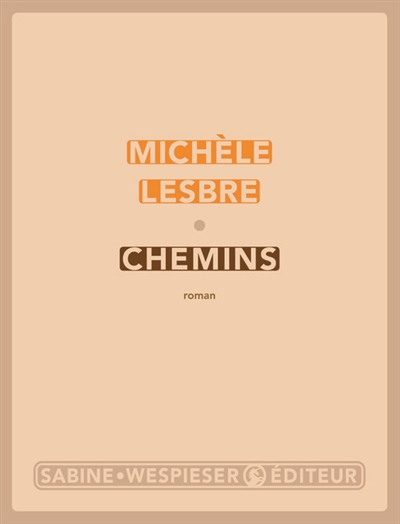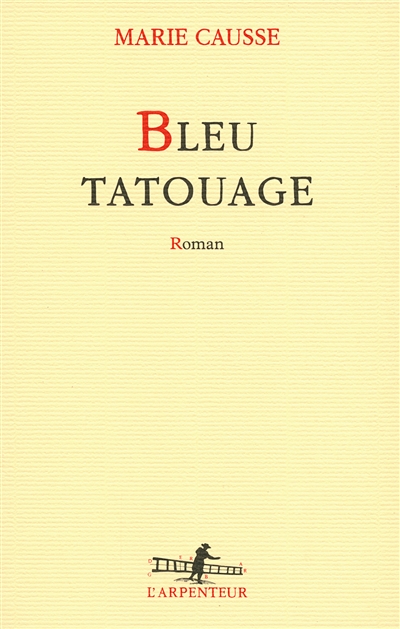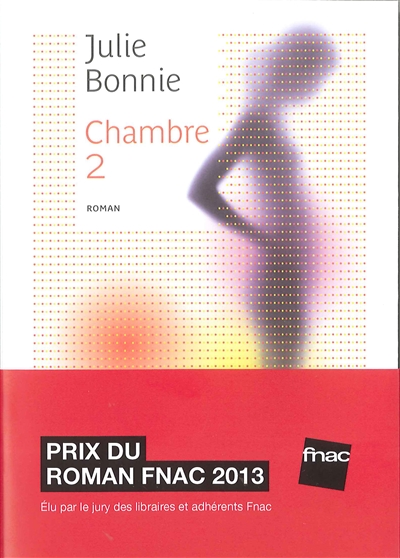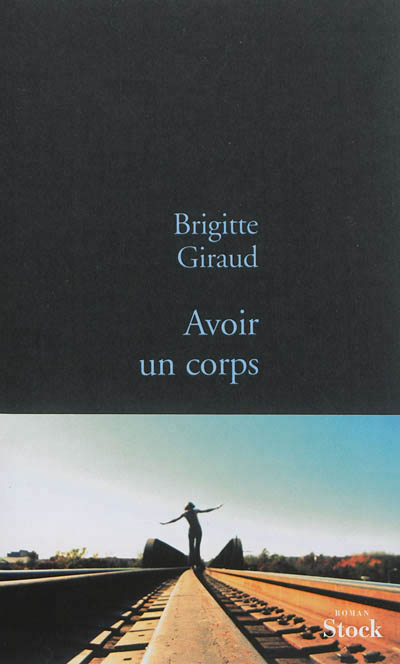Polar
Emmanuel Grand
Terminus Belz
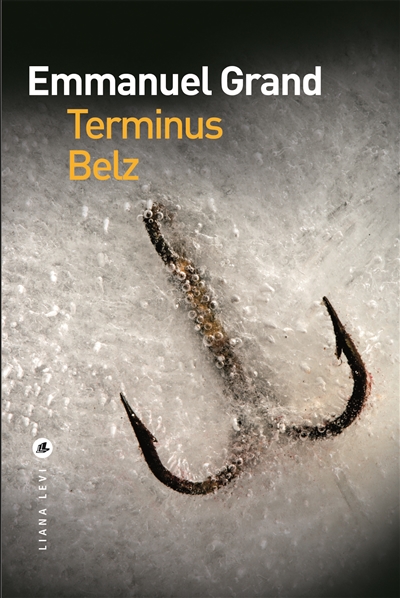
-
Emmanuel Grand
Terminus Belz
Liana Levi
09/01/2014
365 pages, 19 €
-
Chronique de
Virginie Vigouroux
Librairie Vivement dimanche - La Benjamine (Lyon) - ❤ Lu et conseillé par 33 libraire(s)
✒ Virginie Vigouroux
(Librairie Vivement dimanche - La Benjamine, Lyon)
À quoi reconnaît-on un bon polar ? Au fait qu’on ne peut pas le lâcher de la première à la dernière page. Eh bien, Terminus Belz est de cette trempe-là ! Avec une scène d’ouverture qui vous met immédiatement dans l’ambiance, ce roman, le premier signé par Emmanuel Grand, tient toutes ses promesses.
Le lecteur découvre Marko, jeune Ukrainien clandestin en cavale. Il est seul en France, pays qu’il ne connaît pas, il a la mafia à ses trousses et la vue du moindre policier lui donne des sueurs froides. Il décide alors de se réfugier où personne, pense-t-il, ne viendra le chercher, loin de tout : sur une île. Et c’est là le génie d’Emmanuel Grand. Car au fur et à mesure que le tueur à gages engagé pour liquider Marko progresse, celui-ci se heurte non seulement aux limites géographiques de l’île, mais aussi aux avaries qui empêchent toute fuite. La tension monte inexorablement. Mais le suspense ne s’arrête pas là puisque Marko a fort à faire lorsqu’il arrive sur Belz, petite île de pêcheurs où tout le monde se connaît et où le travail se fait rare. La venue d’un étranger ne peut évidemment pas passer inaperçue et cet événement va cristalliser les tensions et donner lieu à quelques altercations musclées. Je n’en révèle pas plus sur l’intrigue, si ce n’est qu’elle est menée tambour battant. En ce début d’année le polar français a le vent en poupe !
Page — Avec Terminus Belz, vous faites une entrée réussie sur la scène du polar. Etait-ce une évidence pour vous que votre premier roman serait un policier ?
Emmanuel Grand — Depuis tout petit je suis fasciné par la construction. Adulte, je suis resté assez habile de mes mains et surtout habité par cette passion de construire. Quand j’ai décidé d’écrire ce roman, je voulais une histoire qui fonctionne un peu comme un mécanisme d’horlogerie. J’étais fasciné par les thrillers américains d’Ellroy, Lehane ou King car ils ont cette intelligence de l’intrigue. C’est le fameux « page turner » anglo-saxon, et le genre le plus adapté à ce type de construction avec ses intrigues, ses sous-intrigues, ses mystères et ses résolutions, ses pistes, vraies ou fausses, c’était le polar, sans aucun doute. De ce fait, que mon premier roman soit un polar s’est imposé comme une évidence.
Page — Était-il important pour vous de traiter certains sujets de nos sociétés actuelles comme les réseaux d’immigration clandestine et la peur de l’autre ?
E. G. — C’est une autre caractéristique du polar : c’est un genre (mais pas le seul) qui permet de parler du réel, voire qui se donne le réel pour objet. Plus on est proche du réel, plus on implique le lecteur dans l’histoire. Ce peut donc être vu dans un premier temps comme un ressort narratif. Mais c’est aussi important sur le fond car l’objectif que je me suis fixé avec ce texte ne concerne pas seulement sa construction, mais aussi sa capacité à atteindre l’humanité des personnages. Je ne traite pas de l’immigration clandestine ou de la peur de l’autre, car ce n’est pas une thèse, mais je plonge des personnages d’aujourd’hui dans des situations de notre temps ; et la façon qu’ils ont de se comporter dans ces situations nous en dit un peu plus sur eux, et sur nous. Car bien entendu, je ne peux le cacher, il y a une vision du monde embusquée derrière l’histoire de Marko et Caradec, et qui transparaît, par capillarité. Elle concerne en effet l’immigration clandestine, la peur de l’autre, mais aussi la dureté du travail de ces pêcheurs, l’étau économique dans lequel ils se trouvent et un peu de scepticisme à l’égard de certains aspects de notre monde moderne.
Page — Dès le début nous sommes enchaînés au destin de Marko, nous avons peur pour lui, nous ne pouvons plus lâcher le livre. Comment avez-vous travaillé pour installer cette tension ?
E. G. — J’ai travaillé de manière très empirique. Je n’ai jamais fait d’études de lettres et n’ai pas pu mobiliser tout l’arsenal d’outils que l’on enseigne dans les ateliers d’écriture. J’ai un peu étudié le piano jazz ; et dans le jazz, la meilleure manière d’apprendre l’improvisation, c’est de répéter les solos des grands jazzmen. L’apprentissage par cœur… c’est ce que j’ai fait. J’ai pris des bouquins de grands auteurs et j’ai essayé de comprendre. Et j’ai compris un certain nombre de choses… Pas tout. Il me reste beaucoup à apprendre. On touche ici au secret de fabrique… Je ne vais vous révéler qu’une chose, qui d’ailleurs fait étrangement écho au jazz : le rythme est la clé. Le rythme ne doit jamais abandonner l’histoire. Comme il n’abandonne jamais Miles Davis, même quand il joue peu. Le rythme de l’ensemble. Le rythme des parties. Le rythme des chapitres. Le rythme dans chaque page.
Page — Votre histoire est vraiment ancrée dans le réel tout au long de cette course-poursuite, jusqu’à ce que le surnaturel cueille le lecteur par le biais de légendes bretonnes. Ainsi l’Ankou, l’ange de la mort, devient un vrai ressort de l’intrigue. Connaissiez-vous ces croyances avant de débuter votre roman ?
E. G. — Oui. Enfin, je n’étais pas un expert, mais à vrai dire, tout est parti de là. L’origine de ce roman remonte à une lecture d’un recueil d’Anatole le Braz paru dans la collection « Bouquins » en 1996 et intitulé Magies de la Bretagne. Et puis, au cours d’un voyage à Etel, près de Belz, j’ai assisté à une cérémonie du pardon breton. Je me suis dit que ce pays était décidément resté très attaché à ses traditions et j’ai voulu en savoir plus. Dans ce bouquin très épais, que j’ai lu avec gourmandise, j’ai trouvé quatre lignes qui retraçaient une petite histoire et je me suis dit qu’il y avait matière à roman. Ces quatre lignes sont reproduites dans le livre et elles ont une importance toute particulière dans l’histoire.
Page — Vos personnages sont bien croqués et beaucoup sont très attachants. Il y a notamment Claude Venel, libraire haut en couleur, qui aide Marko dans ses investigations. Alors, clin d’œil à notre profession ?
E. G. — Claude Venel, le libraire, est un personnage que j’aime beaucoup et pas seulement parce que je me suis inspiré, pour une bonne part, d’un de mes grands cousins, littéraire, enflammé et expert dans une variété impressionnante d’alcools de plus de 40°. Venel est attachant car il est à lui seul une avalanche de contradictions. À la fois tonitruant et fragile comme une coquille d’escargot, à la fois éperdu d’admiration devant quelques lignes prises au hasard dans L’Odyssée et désespéré de donner une telle place dans sa librairie à des livres médiocres parce qu’il faut bien vivre. C’est un défenseur de la différence bretonne et un vrai citoyen du monde levant son verre à la Grèce antique et à la Chine, berceaux de notre civilisation. Enfin, c’est un amoureux de l’écrit. En écrivant ces pages, je n’avais pas rencontré de libraires comme j’ai eu l’occasion de le faire depuis quelques semaines. J’ai découvert des gens épatants et passionnés. Et je ne cesse de dire autour de moi d’acheter les livres dans les librairies et nulle part ailleurs… Pour ce qui est du penchant pour la bouteille, je vous propose que nous convenions conjointement qu’il s’agit d’un attribut plus directement emprunté à la corporation des antiquaires.