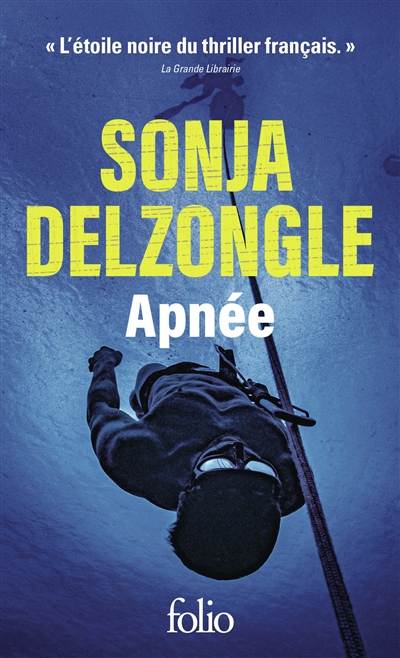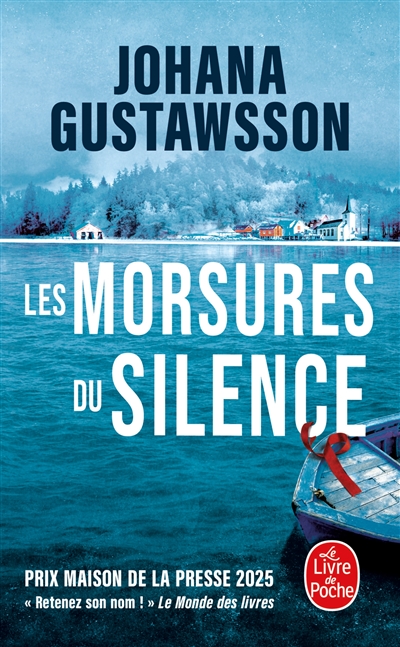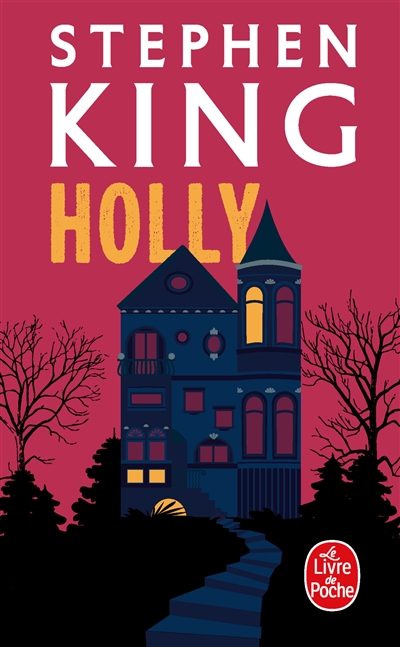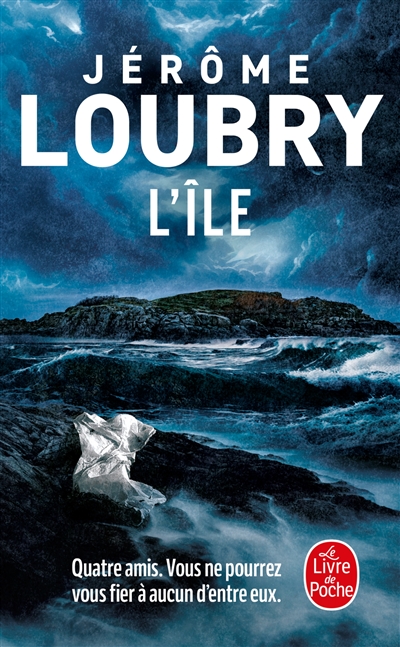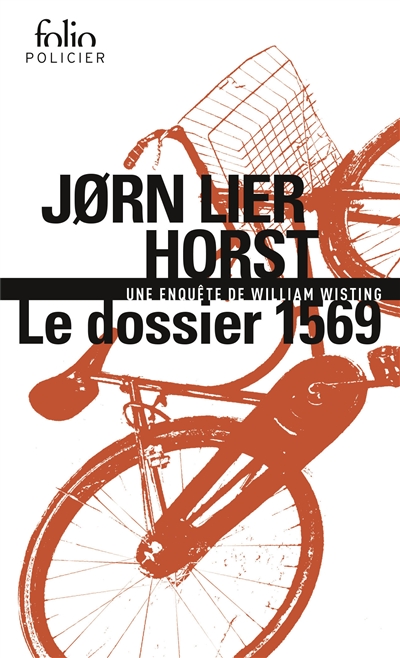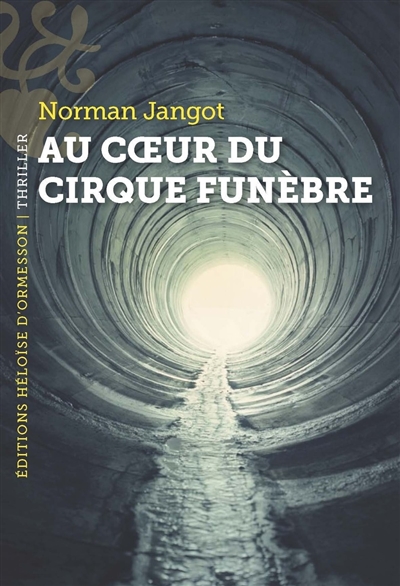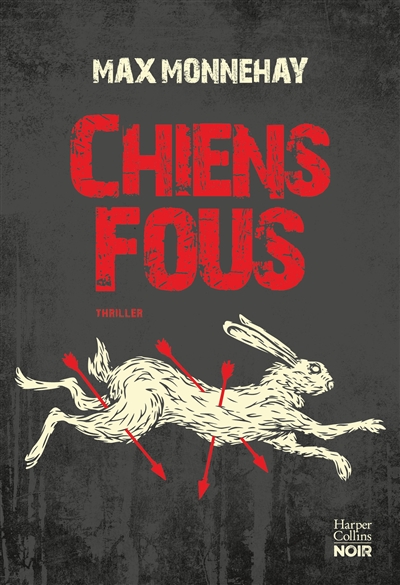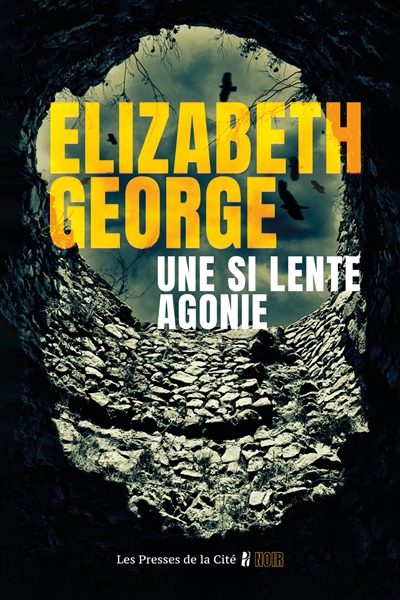Le père d’Helena était franquiste et amoureux d’un soldat marocain avec qui il a fui, abandonnant son épouse anglaise à Tanger. Le père de Miguel était républicain. Il est mort en détention après la guerre civile, laissant sa femme folle de désespoir. Entre Helena et Miguel, deux personnalités totalement antinomiques résidant désormais dans une maison de retraite, se noue une étrange relation qui va les mener à parcourir ensemble les routes d’Espagne, à la recherche d’une paix peut-être encore possible pour eux-mêmes et pour leurs enfants. En Suède, Fatima est contrainte à séduire le chef de la police de Malmö pour le compte d’un truand local, parce que son grand-père l’a vendue pour régler une mystérieuse dette des années auparavant. Pour Helena, Miguel, Fatima et tous les autres personnages de ce vaste roman polyphonique où tout est tragiquement lié, il est question de démêler les fils de son héritage et de découvrir, enfin, un espace de liberté où exister et construire son propre destin.
PAGE — Par-delà la pluie est un roman qui déborde largement de l’univers du polar auquel on a l’habitude de vous associer. Cela vous semble-t-il important de vous affranchir des contraintes liées à ce genre littéraire ?
Víctor del Árbol — Cela me paraît anecdotique. En tant qu’écrivain, mon engagement porte sur la littérature (les mots) et non sur le genre (l’étiquette). Je suis un conteur qui essaie de solliciter cette partie de notre intelligence liée aux émotions les plus profondes. Choisir la douleur comme point de départ implique une perception de l’existence plus proche du « noir ». Quand une histoire est bonne, elle s’affranchit du genre, voire de l’intention de l’écrivain.
P. — Il s’agit d’un livre à la construction complexe et très aboutie. Pourquoi avez-vous choisi une architecture aussi travaillée ?
V. D. A. — Je ne peux pas aborder de façon superficielle des thèmes aussi essentiels que la liberté individuelle, la signification de l’identité collective ou la valeur de la mémoire. Il m’est important de confronter les voix et les opinions, de fournir au lecteur, en même temps que le contexte, les différentes visions qui lui permettent de choisir ses propres réponses et qui ne sont pas obligatoirement les miennes. De plus, je travaille avec des êtres faits de mots et non avec des clichés. Et il n’est rien de plus complexe qu’un être humain.
P. — Si dans ce roman on s’intéresse beaucoup aux personnages, on s’intéresse surtout aux liens qui les unissent.
V. D. A. — Même les personnages qui choisissent la solitude, à l’instar d’Helena, finissent par se rendre compte que seul l’« autre » peut expliquer ce qu’ils sont. Même quand nous ne les connaissons pas, les autres sont des miroirs qui nous révèlent qui nous sommes. Et nous sommes de vrais hérissons. Il nous faut nous regrouper pour survivre, mais gare aux blessures provoquées par les épines. Un simple frôlement, un échange ou un regard peuvent changer un destin. Même si nous ne formons qu’un agrégat de solitudes.
P. — Pourquoi le thème de la transmission qui s’opère de génération en génération (et pas toujours pour le meilleur) vous est-il particulièrement cher ?
V. D. A. — Nous ne sommes que la séquence d’une histoire qui a commencé avant notre naissance et qui nous survivra. C’est pourquoi il est aussi important de connaître le passé que de garder espoir dans le futur. Si nous n’étions que présent, nous serions des îles à la dérive. Je ne crois ni au déterminisme ni à la providence mais au libre-arbitre et à la responsabilité de chacun dans ses actes. Pour être réellement libre, il faut être conscient de la raison pour laquelle nous faisons (répétons ?) les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. C’est la seule façon de rompre la chaîne de la fatalité.
P. — Vous cultivez dans vos romans l’art de saisir différents lieux et différents moments de l’Histoire européenne. Est-ce aussi le rôle de l’écrivain d’apporter un éclairage différent sur le monde qui nous entoure ?
V. D. A. — Ce qui me plaît dans la littérature classique, c’est qu’elle continue d’entrer en résonance avec nos préoccupations. C’est pourquoi j’aspire à écrire pour mes contemporains, depuis mon quotidien et dans des circonstances données, mais le regard rivé sur le futur. Je pense que mon devoir d’écrivain est d’évoquer des sujets que personne ne veut aborder en proposant une véritable analyse. Si j’ai traité dans mon roman les thèmes de la vieillesse, la maladie, l’oubli, le racisme, les mauvais traitements, la déception concernant l’idée de l’Europe, c’est qu’ils constituent les problèmes auxquels les citoyens du XXIe siècle sont confrontés. Mais dans 100 ans, les questions seront les mêmes. Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que l’amitié ? Peut-être alors ce livre pourra-t-il aider les lecteurs qui viendront. Et moi, depuis l’oubli, je serais heureux qu’il en soit ainsi.