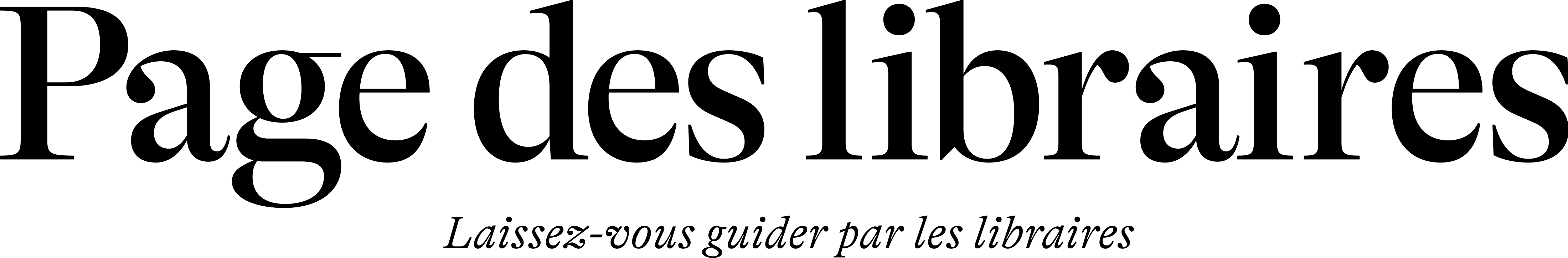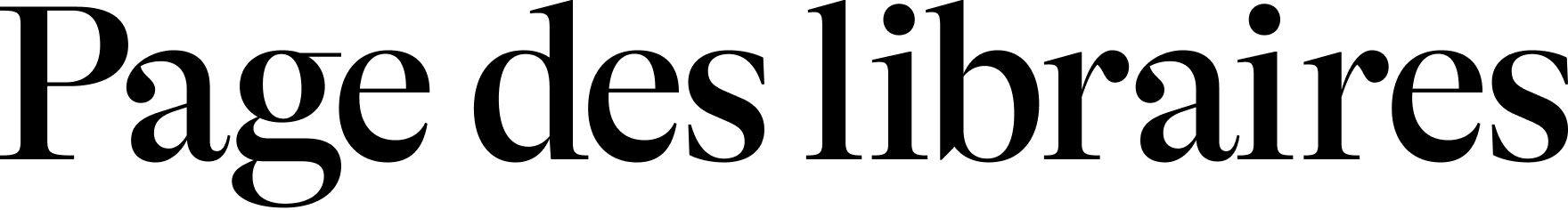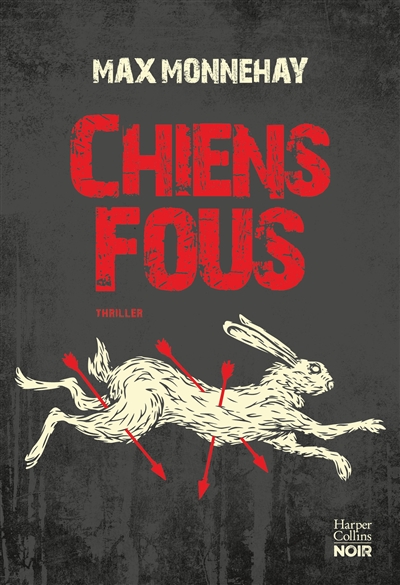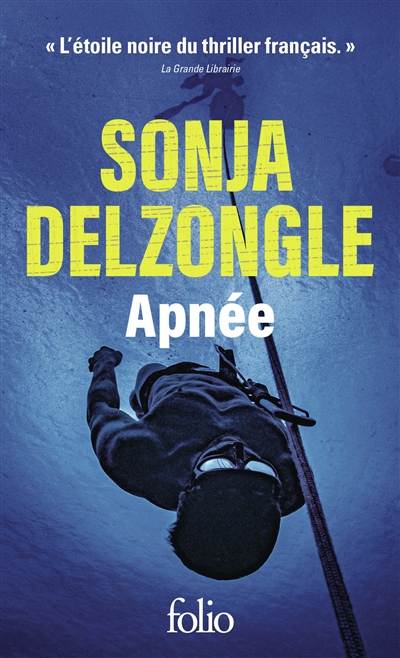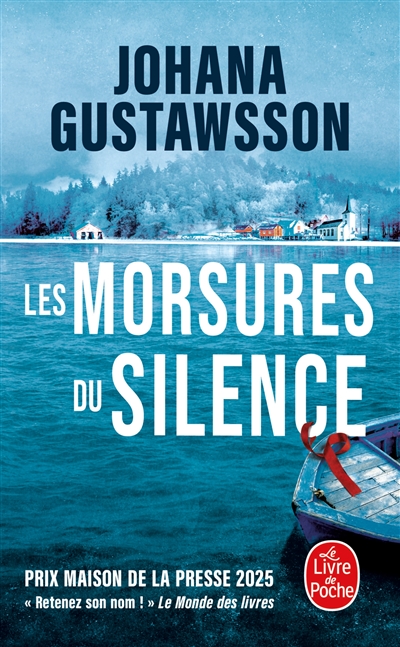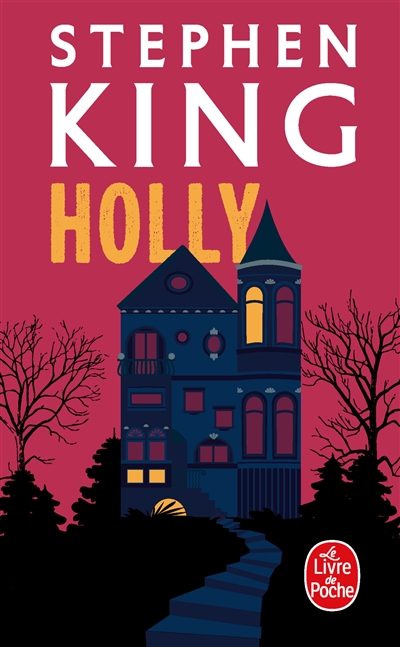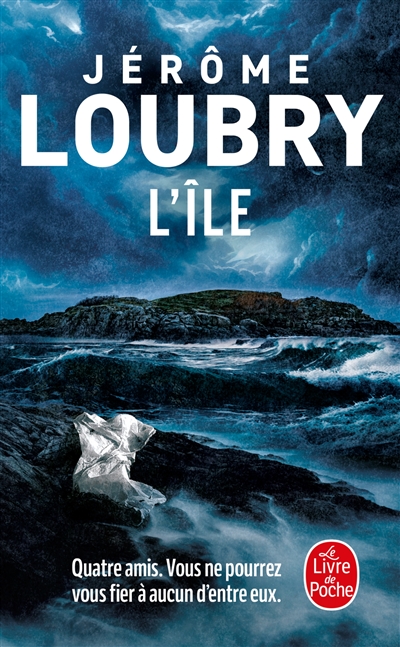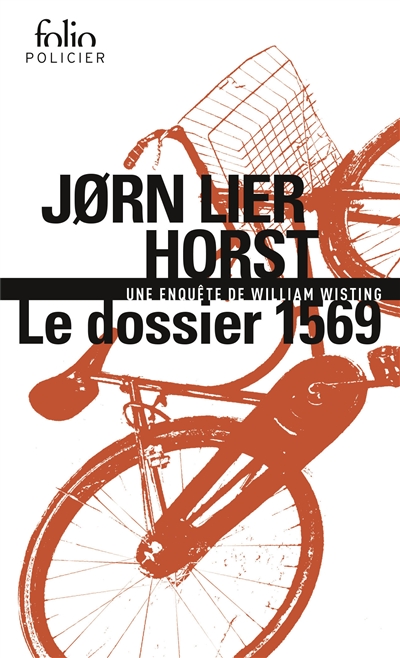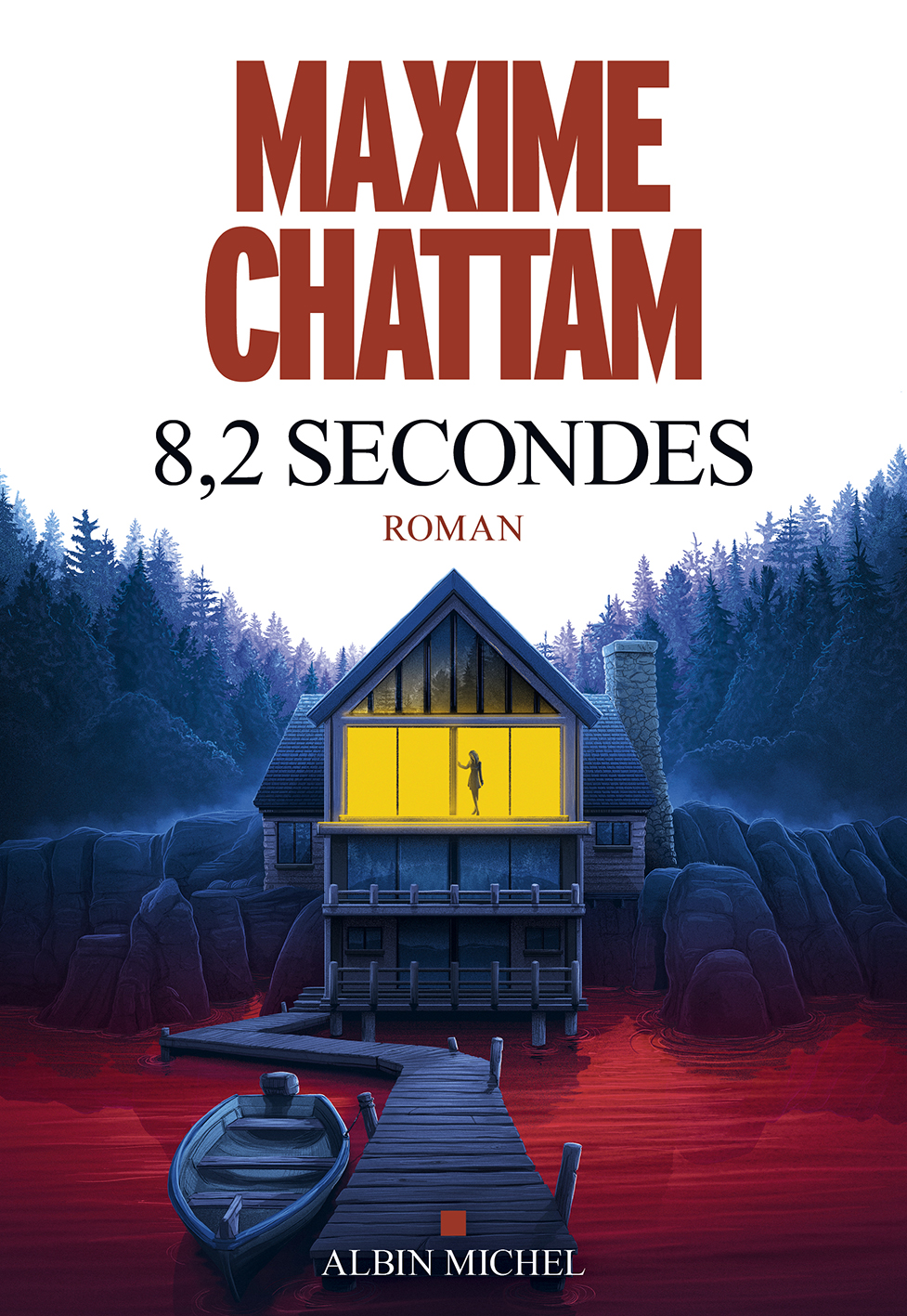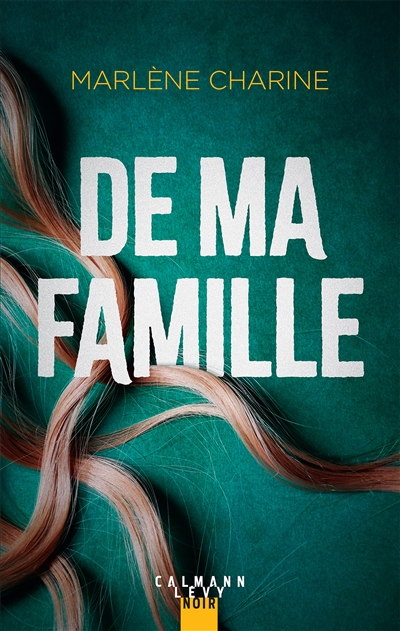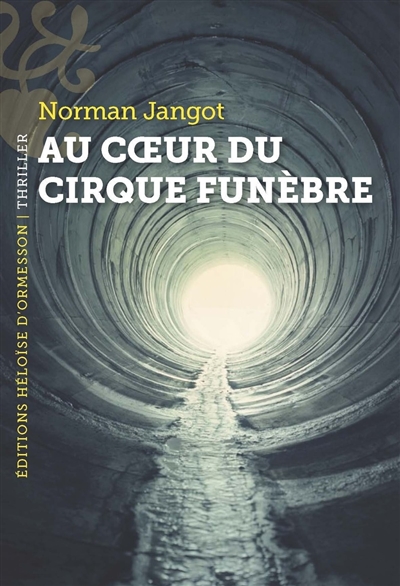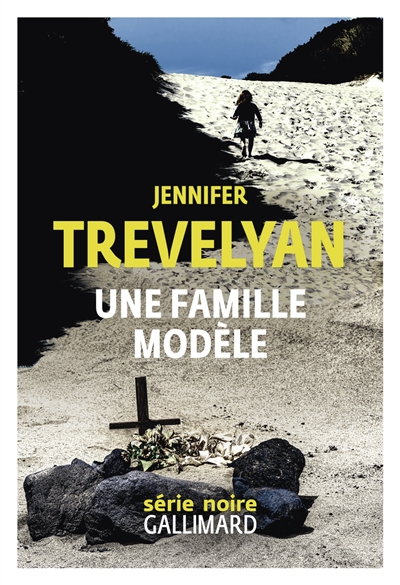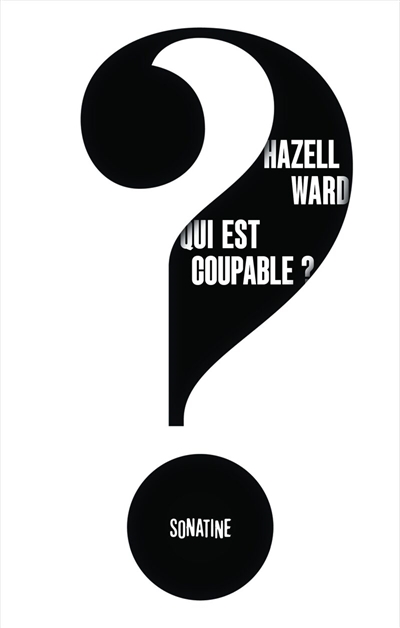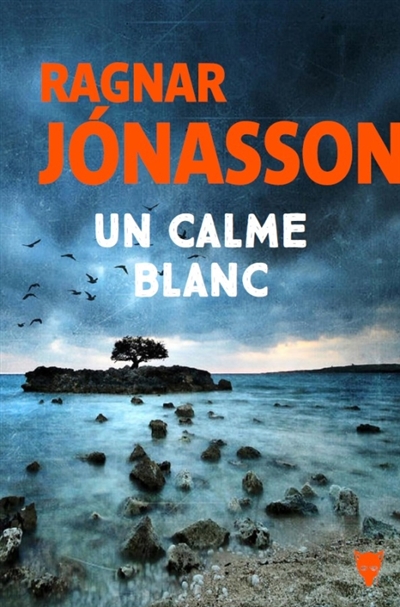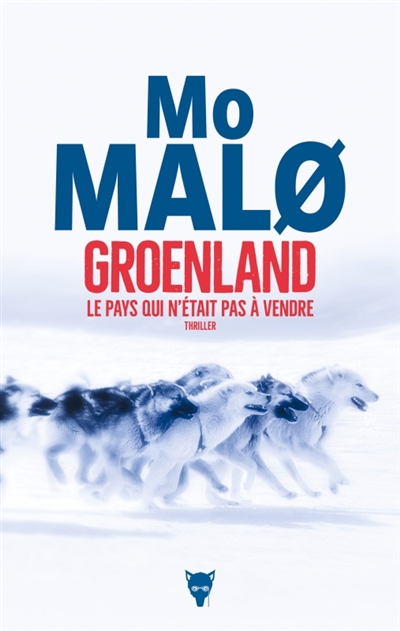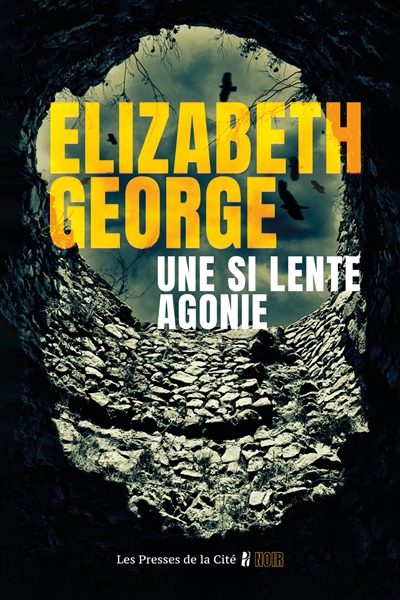Chiens fous est assez différent de vos précédents polars. Aviez-vous besoin de ce changement de décor, de thématique, de personnages ?
Max Monnehay – Après plus de cinq ans passés à La Rochelle avec Victor Caranne, j’avais envie et besoin, oui, de travailler sur autre chose. Et tant qu’à faire, sur du très différent. Alors on est toujours dans le noir, voire le très noir ici, parce que c’est le genre dans lequel je m’épanouis. Mais je savais que mon nouveau personnage serait très loin de mon psychologue maladivement empathique.
L’aspect juridique est très présent et documenté dans votre roman : était-ce complexe d’évoquer le déroulement d’un procès pour meurtre et la défense des avocats ?
M. M. – Quand on se lance dans un thriller judiciaire, il me semble que le réalisme n’est pas une option. Sinon on tombe très vite dans la caricature ou le ridicule. Sans parler de la passionnante plongée dans les arcanes de la justice pénale dont je me serais privée ! C’est à un juge d’instruction d’Avignon et à un flic corse que je dois toutes mes connaissances sur le sujet. La justice française est complexe et ce à bien des égards. C’est sur cette complexité, sur ces ambiguïtés que j’ai construit le procès se déroulant dans Chiens fous.
Votre roman se déroule entre Bordeaux et l'Andalousie : ces lieux revêtent-ils une signification particulière à vos yeux ?
M. M. – Je connais un peu Bordeaux et le lieu convenait parfaitement au besoin obsessionnel de revanche sociale de mon avocat : le vin, la qualité de vie, la culture, le patrimoine et surtout, dans l’imaginaire collectif, une ville bourgeoise. Concernant l’Andalousie, je n’ai pas eu la chance de m’y rendre, mes recherches se sont faites à distance. Mais cette région-là, je ne l’ai pas choisie. C’est plutôt l’inverse : c’est l’un des sujets du livre qui m’a conduite à elle. J’espère évidemment avoir l’occasion de la découvrir, sous un angle différent de celui abordé dans Chiens fous. Je sais qu’elle peut être magique.
Si ce n'est pas le sujet principal, la maltraitance animale, notamment envers les chiens de chasse, est une des thématiques du roman. Ce sujet vous tenait-il à cœur ?
M. M. – Quand, il y a trois ans, on m’a parlé des Galgos espagnols et de ce que les chasseurs leur font subir, j’ai évidemment eu du mal à y croire. Un petit tour sur le Net et quelques haut-le-cœur plus tard, il était clair que j’allais me pencher sérieusement sur leur martyre et les hommes qui le leur infligent. C’est assez fou que le sujet ne soit jamais traité chez nous, alors que cela concerne 50 000 animaux par an chez l’un de nos voisins européens. On parle quand même de chiens qu’on balance dans des puits, qu’on pend, qu’on abandonne, pattes brisées, dans la campagne, parce qu’ils n’ont pas su honorer leur maître en attrapant un lièvre.
Au fil de la lecture, on ressent des sentiments ambivalents pour Alano. Est-ce compliqué de camper un héros tout en ombre et lumière ?
M. M. – C’est un exercice jouissif. Un héros aimable n’est pas forcément plus simple à créer, parce qu’il s’agit de lui offrir des aspérités, une profondeur qui l’extraient du cliché et du risque inhérent d’ennui. Mais un héros inamical, voire antipathique, là on est sur une corde, sur un fil permanent : parce qu’il faut parvenir à ce que le lecteur s’identifie malgré tout. C’est franchement grisant. Et ça permet aussi une vraie transformation du personnage. On part d’un type plutôt infect et ce qu’il va vivre va avoir un impact réel sur sa vision du monde et de lui-même. Les héros positifs sont moins propices à ce genre de chambardement intime.
Dans votre polar, il est question de scènes de viol et de tortures particulièrement atroces. Comment appréhendez-vous l'écriture de ces scènes ?
M. M. – Ici, les faits sont rapportés à la barre par l’une des victimes. Le processus d’écriture ne relève donc pas vraiment de la mise en scène d’un viol en tant que tel. Après, c’est toujours un peu la même chose avec la littérature noire : si on en écrit, c’est qu’on a une certaine fascination pour la violence, pour ce qu’elle dit de l’homme et de son environnement, pour ce qu’elle provoque de frissons et d’émotions. Ce n’est pas facile parce qu’il faut imaginer le pire. Mais cet exercice se révèle souvent assez cathartique et s’avère un entraînement plutôt efficace pour tolérer notre monde. Parce qu’en termes de cruauté, le réel battra toujours la fiction à plate couture.
Êtes-vous pleinement réconciliée avec votre désir d'écrire des romans policiers ?
M. M. – Plus que réconciliée : j’ai trouvé ma maison. Le noir, j’en écrivais déjà mais il me manquait un cadre, une structure. Des murs, en fait. À briser, si besoin. Le polar m’a offert ça.
Alano vit avec sa femme et leur fille dans leur maison familiale en Andalousie, à côté d'une forêt dans un petit village calme, seulement troublé par ses voisins chasseurs et leurs chiens maltraités. Son quotidien est aux antipodes de ce qu'il vivait quand il était grand avocat dans la région bordelaise. Se définissant volontiers lui-même comme ambitieux et égoïste, très différent de son épouse, il ne défendait que des clients riches lui permettant un train de vie des plus luxueux. Jusqu'au jour où il s'est intéressé au cas Vincent Sauriol accusé de viols et d'agressions abominables sur plusieurs victimes. Ce procès a tout changé. Alternant passé et présent, Chiens fous est un roman sans concessions, rythmé, surprenant et diablement bien pensé. Impossible de ne pas le dévorer !