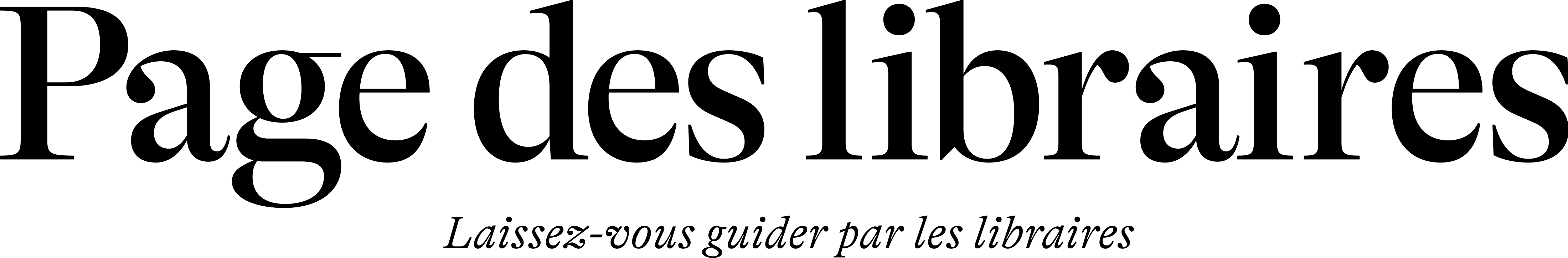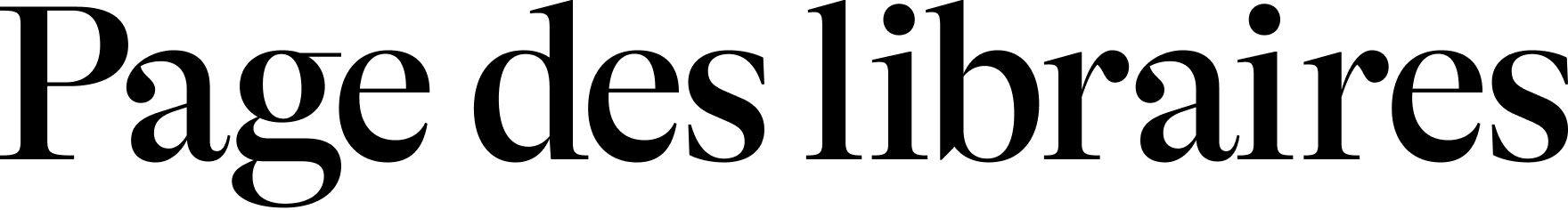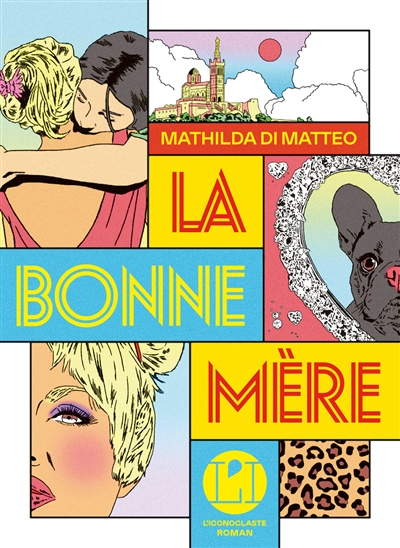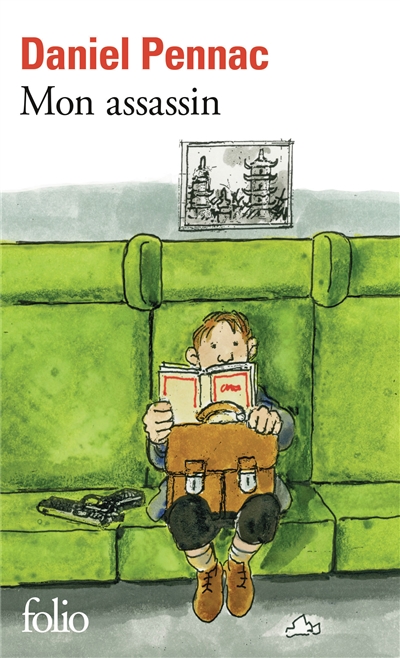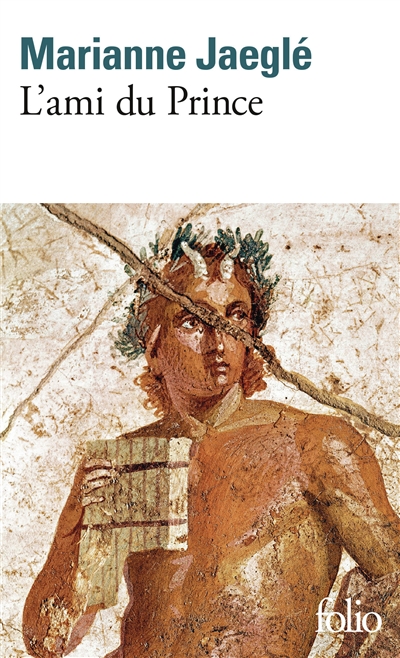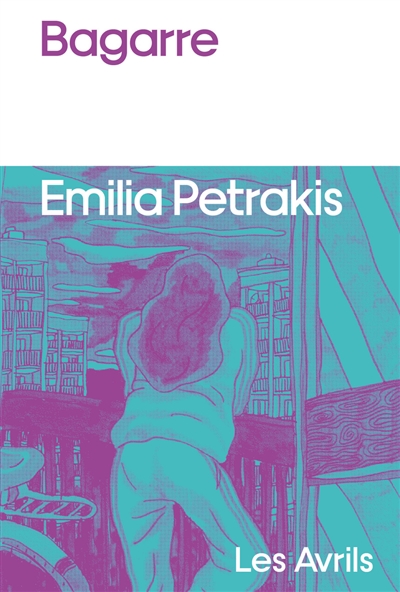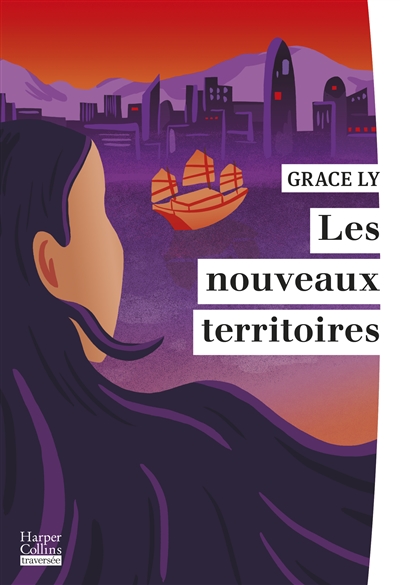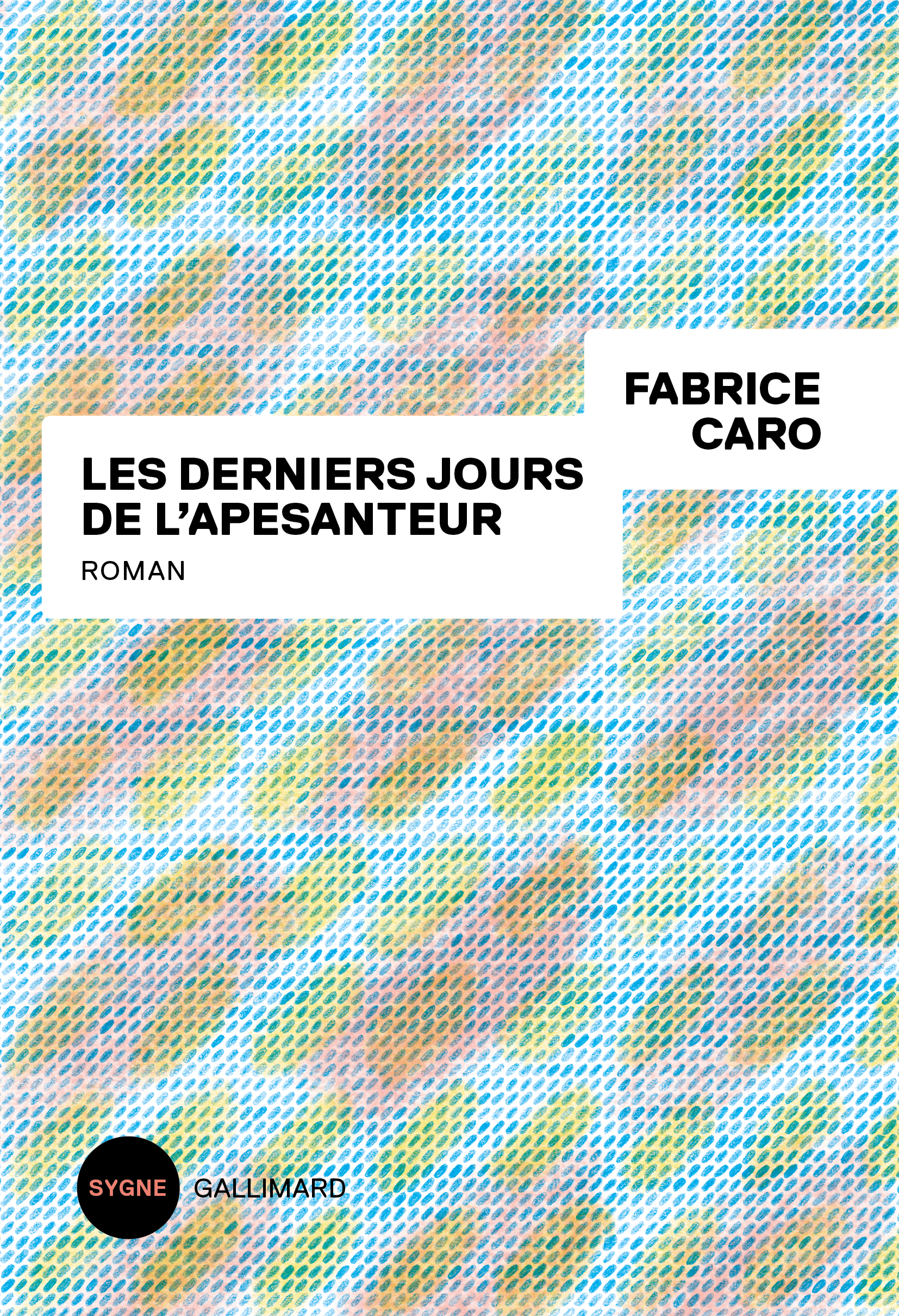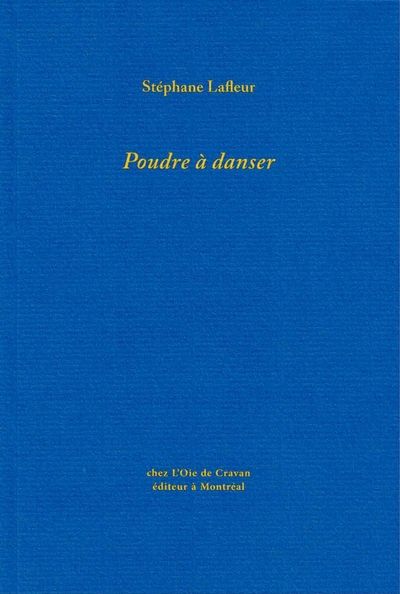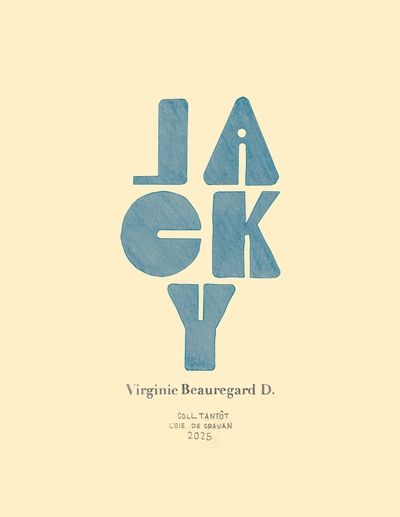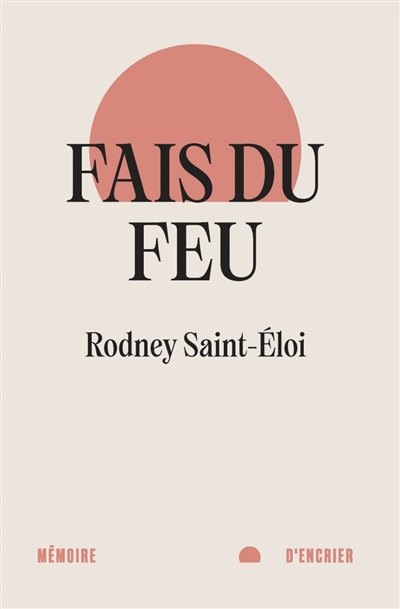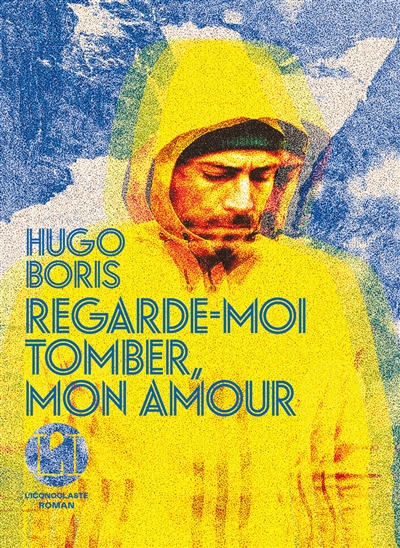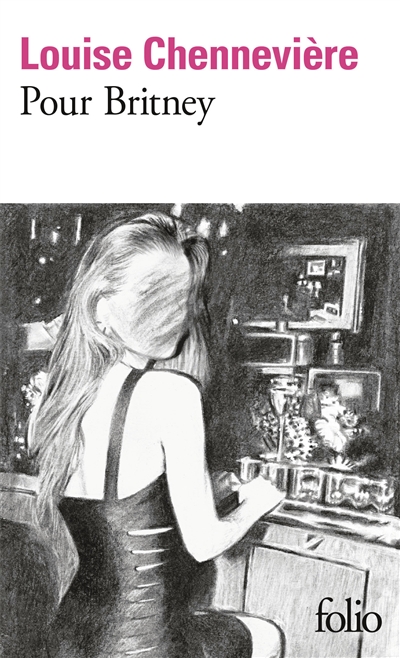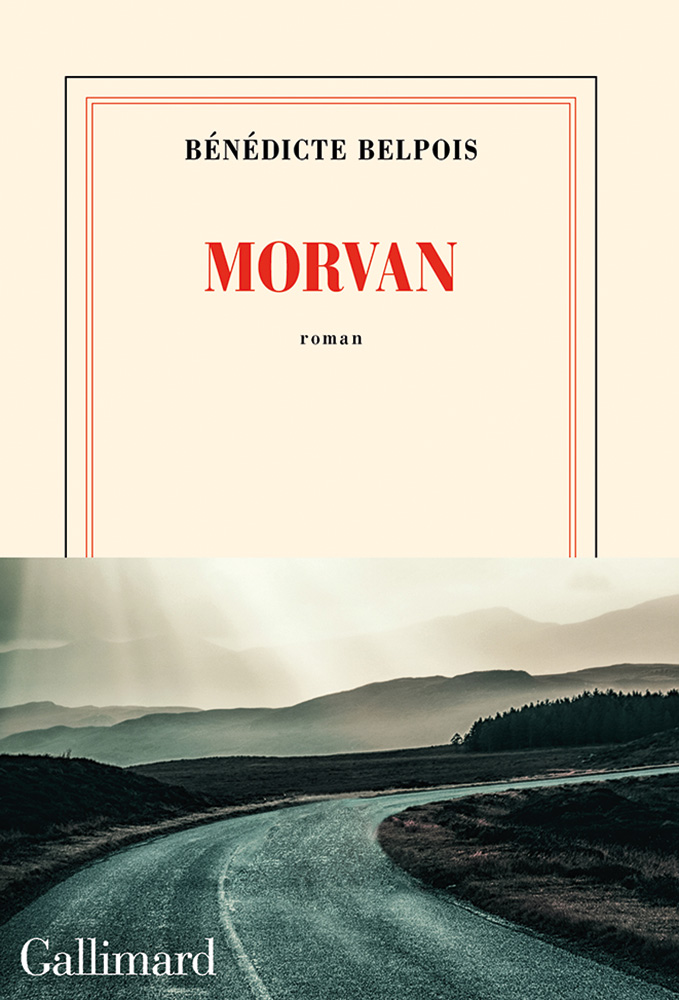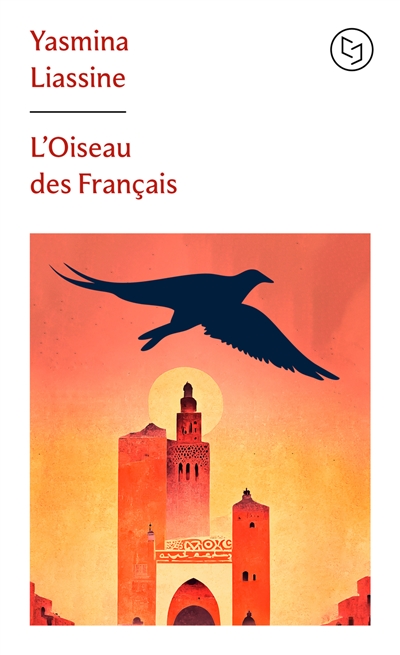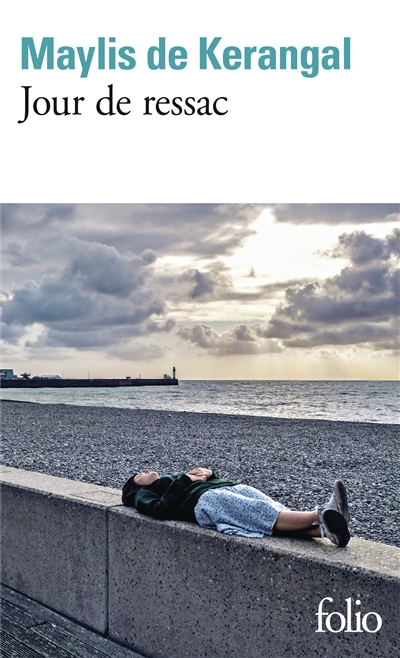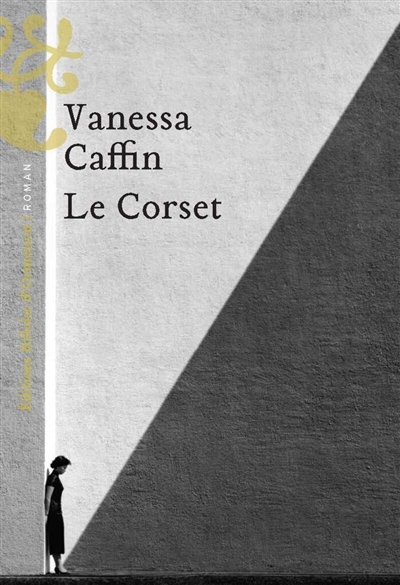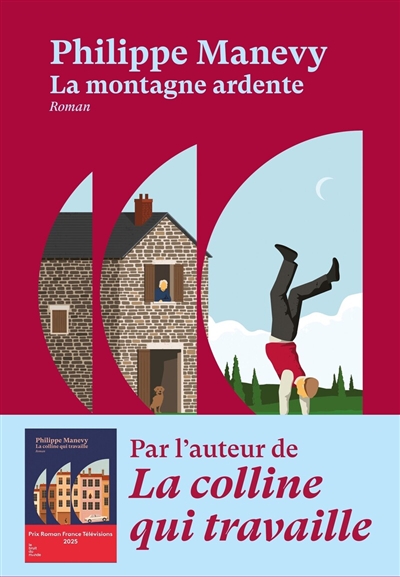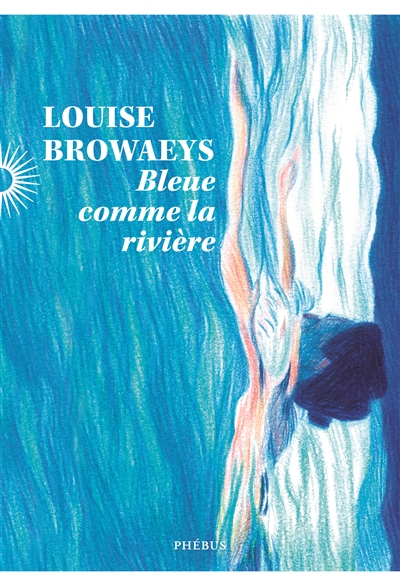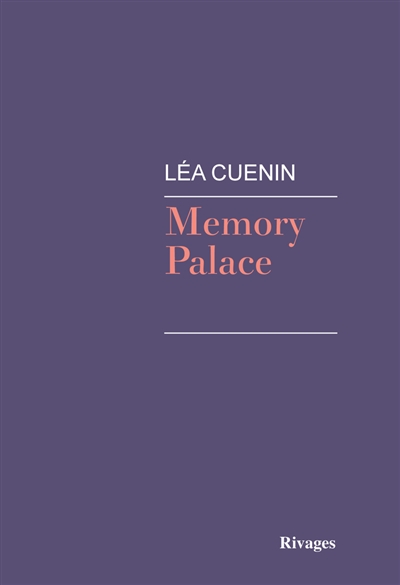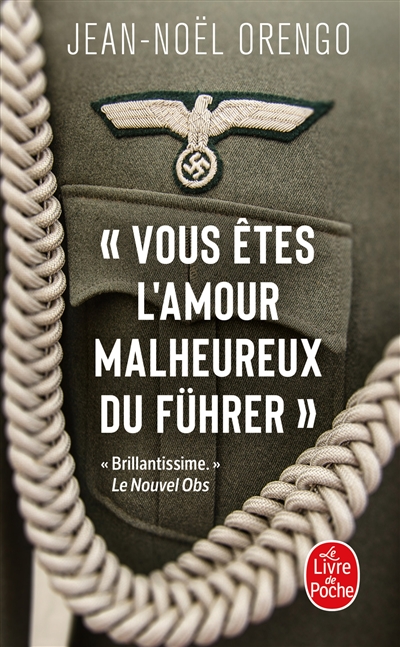En 2021, vous remportez un concours de nouvelles. Cette récompense vous a-t-elle encouragée à entreprendre l’écriture d’un roman ?
Mathilda di Matteo Oui, complètement. J’ai écrit mon premier roman à 14 ans mais je l’ai perdu à cause d’un virus informatique. Et puis, pendant mes études, j’ai commencé beaucoup de textes que je n’arrivais pas à achever par manque de discipline. Cependant, je continuais à lire, beaucoup. Remporter ce concours m’a permis d’obtenir une sorte de validation de l’extérieur et d’ainsi trouver la motivation pour faire tous les sacrifices que demandait l’écriture d’un roman, en parallèle d’un travail à plein temps.
On entre dans le roman avec la voix de Véro. On est tout de suite emporté par son énergie, sa féminité, son exubérance. Pouvez-vous nous présenter ce personnage à la fois puissant et fragile ?
M. di M. À l’origine, je pensais que la voix de Clara, la fille de Véro, était la seule voix nécessaire pour raconter l’histoire d’une jeune femme qui découvre Paris, qui peine à trouver sa place et croit avoir réussi à fuir ses démons, pour finalement se rendre compte qu’elle reproduit un schéma familial. Mais ça sonnait faux, il manquait quelque chose. Et un jour, j’ai entendu Véro. Vraiment. J’ai entendu sa voix et c’était celle d’une cagole géniale que j’avais commencée à esquisser dans des nouvelles. Elle se présentait de nouveau à moi pour combler les manques de mon texte. À Marseille, la cagole est une sorte de mascotte qui se fond presque dans le paysage : c’est la féminité exacerbée, avec ses motifs léopard et ses talons aiguilles. Pendant mon enfance, quand on disait d’une femme que c’était une cagole, c’était une insulte. C’est plus tard, grâce à des lectures féministes et parce que Marseille me manquait, que j’ai commencé à sincèrement admirer ces femmes et leur féminité envahissante et transgressive. C’est une féminité populaire. Pourtant, en lisant à leur sujet, je me suis rendu compte que la cagole semblait ne jamais exister pour elle : c’était comme une icône sans intériorité. Alors j’ai eu envie de leur donner une voix et les traits d’une femme ayant enfanté dans les années 1990, comme ma mère, et ainsi leur faire une toute petite place en littérature.
Le roman est construit avec des chapitres qui alternent les voix de Véro et Clara. Sans que cela soit précisé, on reconnaît immédiatement quel personnage s’adresse à nous. Comment avez-vous travaillé ces deux langues très différentes ?
M. di M. Véro me parlait à l’oreille, c’est donc une langue très orale. Ensuite, je me suis beaucoup relue à voix haute. Clara, elle, m’est venue plus naturellement. C’est ma façon d’écrire. Ces deux langues et ces deux femmes diamétralement opposées m’ont permis de me demander de quelle façon on peut s’aimer quand on ne parle absolument pas la même langue. Elles m’ont permis aussi de trouver une forme d’équilibre pour traiter différents sujets dont certains sont graves. Elles n’ont pas la même féminité. L’une est une cagole à la fois forte et vulnérable, l’autre est doctorante en sociologie, une sorte d’intello torturée qui a réussi à se cuirasser et qui connaît les codes de la féminité acceptable. Cela ne les empêchera pas de tomber toutes les deux dans un piège.
Vous citez à plusieurs reprises Vivian Gornick et Attachement féroce, un roman qui met en scène une relation mère-fille basée sur la fusion et le rejet. Cette relation mère-fille est très importante dans votre livre, que vous permet-elle ?
M. di M. Effectivement ce roman de Vivian Gornick est vraiment incroyable. J’aime reprendre ce terme pour dire qu’elles s’aiment d’un amour féroce mais aussi extrêmement tendre. Finalement leurs joutes verbales permettent de donner du rythme au texte. Sans en dire trop, je voulais parler des violences qui arrivent dans tous les milieux et de la généalogie de cette violence. Ce sont des sujets graves. Pourtant cette relation mère-fille n’était pas forcément une intention de départ, tout comme la voix de Véro n’était pas prévue. Mais c’est finalement grâce à elle que le roman déroule beaucoup de joie, de tendresse, de rires, d’amour et d’amitié. Et j’en suis très heureuse.
Peut-être pouvons-nous conclure sur le choix du titre : La Bonne Mère.
M. di M. C’est vraiment le premier titre qui m’est venu en tête avec la voix de Véro. C’est un vrai sujet pour elle : est-ce que suis une bonne mère ? Comment être une bonne mère alors que je ne comprends pas cette enfant qui est pourtant la mienne et qui s’acharne à me fuir ? C’est une obsession pour elle. Et puis évidemment, c’est Marseille, c’est la Bonne Mère qui veille et qui sauve aussi.
Clara est née et a grandi à Marseille. Elle est la fille unique de Véro, assistante médicale et femme-léopard au décolleté plongeant et pailleté, et du « Napolitain », macho italien qui adore sa fille. Clara est une jeune femme brillante, partie étudier à Paris où elle a rencontré Raphaël, surnommé « Le girafon » par Véro. Mère et fille s’aiment d’un amour féroce. Véro sent que sa fille s’est éloignée et Clara trouve difficilement l’équilibre entre son amour, sa nouvelle vie et sa mère envahissante qui a tout de « la cagole grande gueule ». Les voix des deux femmes se succèdent dans un tourbillon qui interroge l’héritage de la violence de manière drôle et tragique à la fois. Tout sonne juste, c’est cinglant, pétillant et moderne.