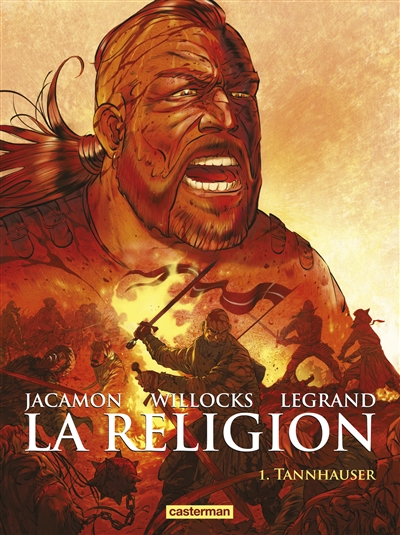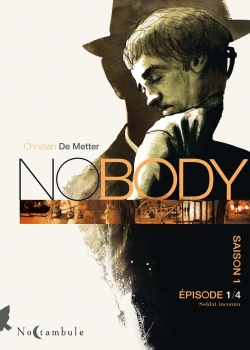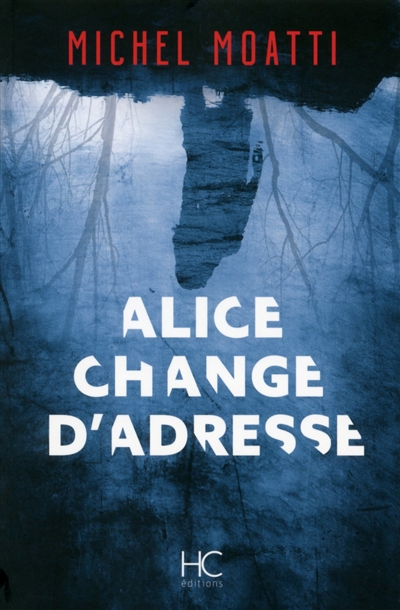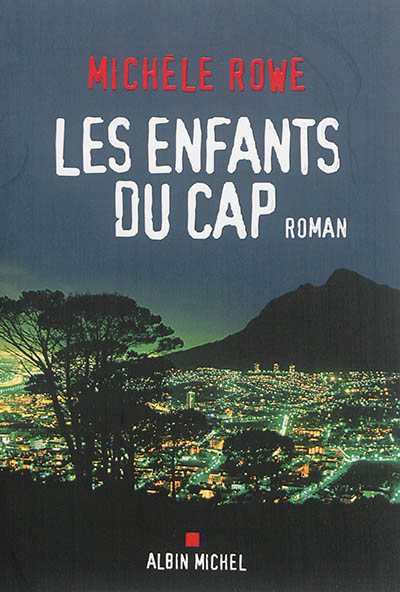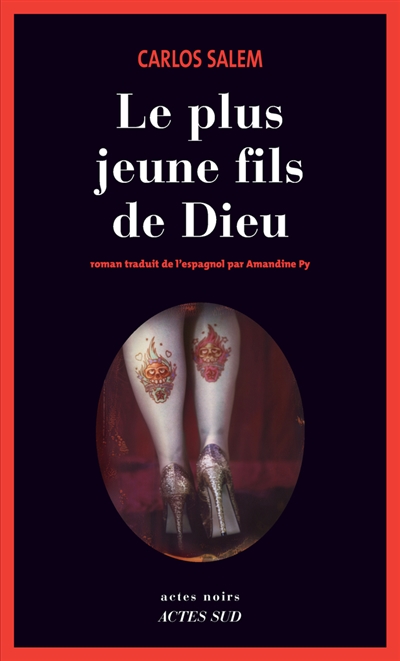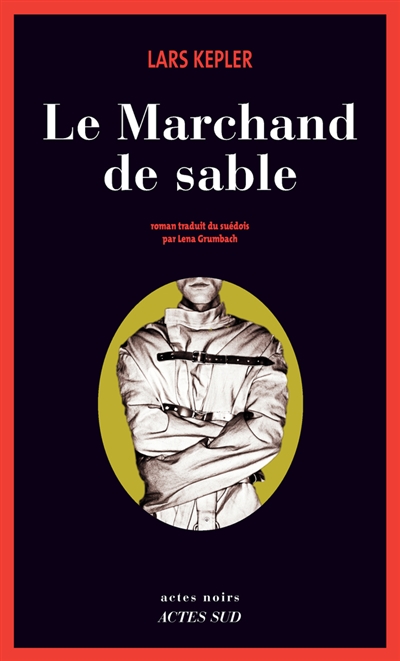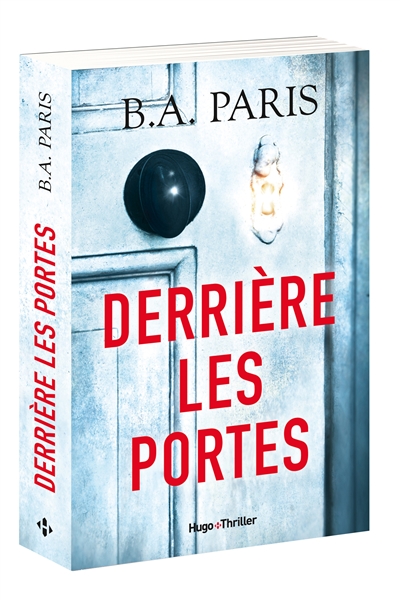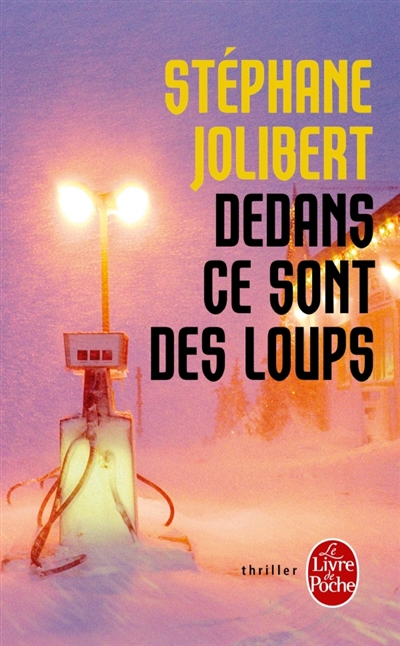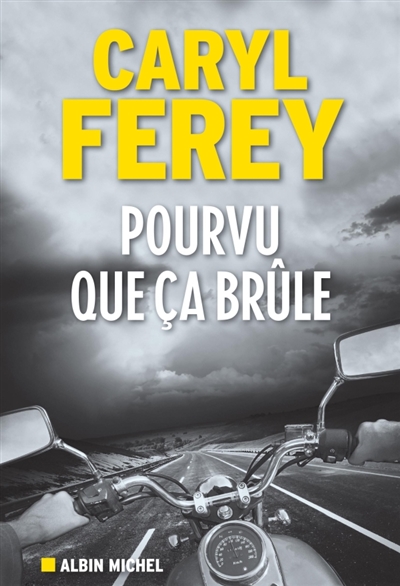Polar
Stéphane Jolibert
Dedans ce sont des loups
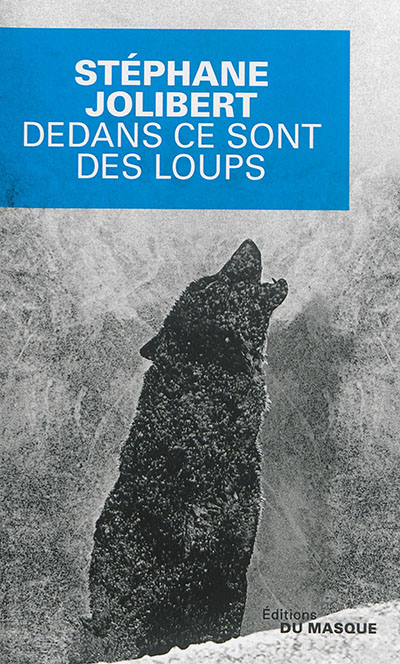
-
Stéphane Jolibert
Dedans ce sont des loups
Le Masque
06/01/2016
279 pages, 19 €
-
Chronique de
Carine David-Imbert
Librairie Majolire (L'Isle d’Abeau) - ❤ Lu et conseillé par 12 libraire(s)
✒ Carine David-Imbert
(Librairie Majolire, L'Isle d’Abeau)
Le Terminus est une bourgade aux faux airs de Deadwood, dernière frontière entre la vie civilisée et la nature à l’état sauvage du Grand Nord. Si ce n’est qu’y sont regroupés tous les rebuts de la société. Nats évolue parmi eux, hanté par une vengeance qui attend son heure depuis bien longtemps…
Dans ce premier roman, le talentueux Stéphane Jolibert nous entraîne aux confins du Grand Nord. Au Terminus (comprendre : le bout du monde !), dernier bastion de civilisation avant les grandes étendues sauvages, nulle autre loi n’a cours que celle du patron. Puisque personne ne l’a jamais aperçu, Nats est chargé de la faire respecter en son nom pour maintenir l’ordre dans le bar et le bordel locaux. Ce qui n’est pas chose aisée, car ladite « civilisation » accueille tous les repris de justice et autres truands venus ici se faire oublier. Lorsque Nats décide de prendre le large, son successeur se présente et réveille en lui de douloureux souvenirs… et une colère enfouie depuis (trop) longtemps. Si seulement il pouvait être sûr d’avoir reconnu le bon coupable. L’heure de la vengeance pourrait bien avoir sonné, et les plus bas instincts remonter à la surface. Violent, noir à souhait : avec ce polar 100 % plein air, la maxime « L’homme est un loup pour l’homme » prend tout son sens. Un grand vent de fraîcheur à ne pas manquer.
Page — Dedans ce sont des loups, votre premier roman, nous emmène aux confins du Grand Nord. Seriez-vous d’un esprit aventureux ?
Stéphane Jolibert — Si par aventureux on entend bourlingueur, oui. J’ai pas mal voyagé, vécu ailleurs longtemps, loin, très loin de la France, mais toujours côté sud. Pour être franc, ma connaissance du Nord s’arrête à Bruges. Je redoute le froid et la neige m’indispose, au point d’éviter de marcher dedans, c’est dire…
P — Quelle est la genèse de ce roman, vos inspirations ? Aviez-vous en tête l’idée d’un western moderne ?
S. J. — Ce roman est né d’une simple phrase : « Et l’horizon, comme si la chose était possible, se blanchit davantage. » Je me trouvais à Liège, une pluie verglaçante s’abattait sur la ville, les trottoirs s’étaient transformés en patinoire. J’ai donc patiné jusqu’à un bistrot, presque à l’aveugle parce que le brouillard était de la partie. Là, j’ai ouvert un Moleskine pour y inscrire ces quelques mots. Puis, regardant dehors, observant les voitures en travers de la route, les piétons s’accrochant tant bien que mal au mobilier urbain ou tombant, j’ai dû me dire un truc du genre : « La météo est un personnage comme un autre. Et l’est d’autant plus lorsqu’elle devient hostile. » Le reste s’est imposé dès lors que je me suis mis à y travailler tous les jours, jusqu’à ce que le mot « fin » apparaisse. L’inspiration naît du plaisir d’écrire et je n’écris pas seulement lorsque je m’installe derrière un clavier, non, je fais ça aussi en buvant un café, en faisant les courses… et quelquefois en dialoguant, ce qui peut être extrêmement agaçant pour l’autre, j’en conviens. J’avoue n’avoir jamais pensé au qualificatif western. Cependant je le trouve adéquat, tous les ingrédients s’y trouvent et mes influences littéraires et cinématographiques sont en grande partie américaines.
P — Dedans ce sont des loups s’invite au ballet de la rentrée littéraire de janvier. Il semble que l’histoire de sa publication soit pour le moins inattendue. Pouvez-vous nous en dire plus ?
S. J. — Ce n’est pas moi qui ai envoyé le tapuscrit, mais ma femme – à mon insu, lasse de me voir travailler dessus dès que j’avais un moment de libre. Nous quittions Paris, ce qui fait que la réponse expédiée par La Poste s’est perdue. Une année plus tard, je recevais un mail de Claire Silve, éditrice chez JC Lattès, me faisant part de son incompréhension. Elle disait qu’il était rare qu’elle encourage un auteur à poursuivre, qui plus est inconnu, mais qu’elle croyait à ce texte si je remaniais certains passages. En bref, elle ne comprenait pas que je ne l’aie pas encore contactée. Ce que j’ai fait. Par la suite, j’ai retravaillé lesdits passages. Elle l’a présenté, mais n’a pas reçu le soutien escompté. Elle l’a alors confié à Laurent Laffont qui l’a aimé et qui, à son tour, l’a confié à Alice Monéger – du Masque. Alice m’a appelé dès la dernière page tournée pour me proposer de l’éditer. Cinq très longues années se sont donc écoulées entre l’envoi du tapuscrit et sa publication !