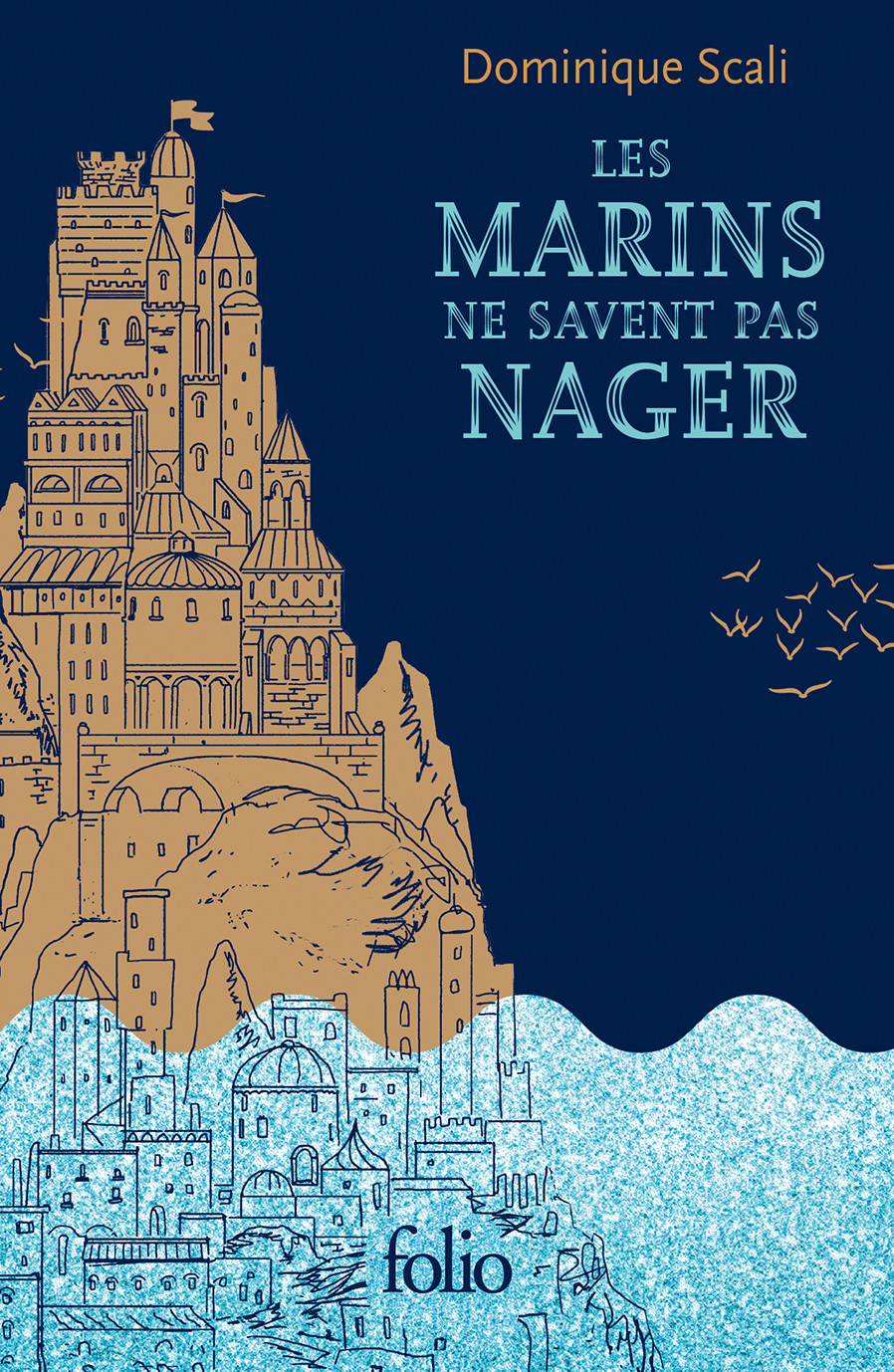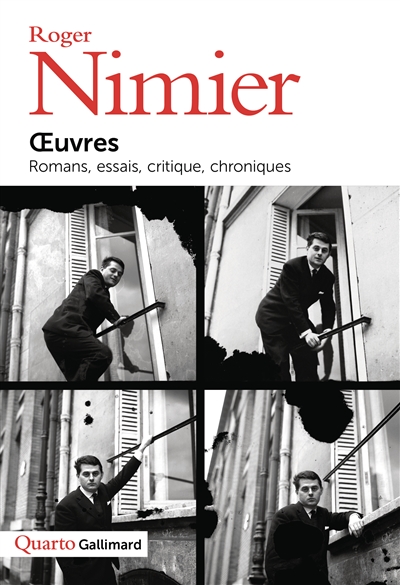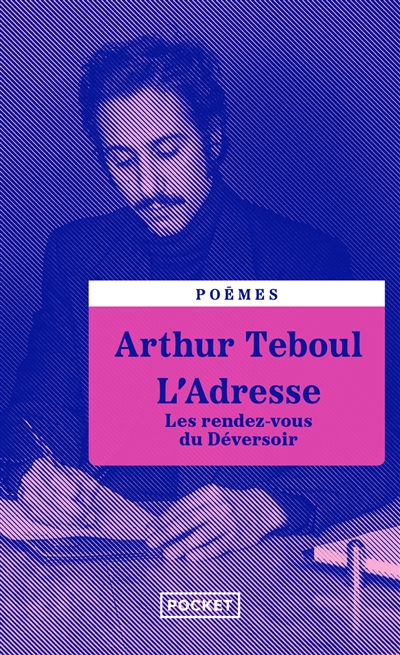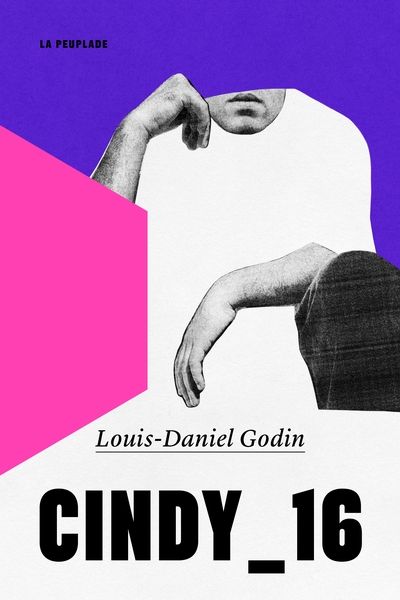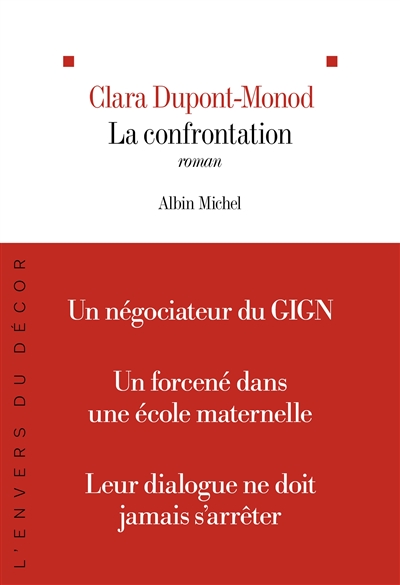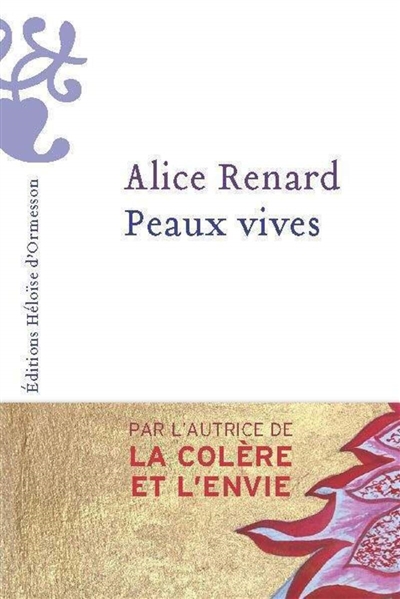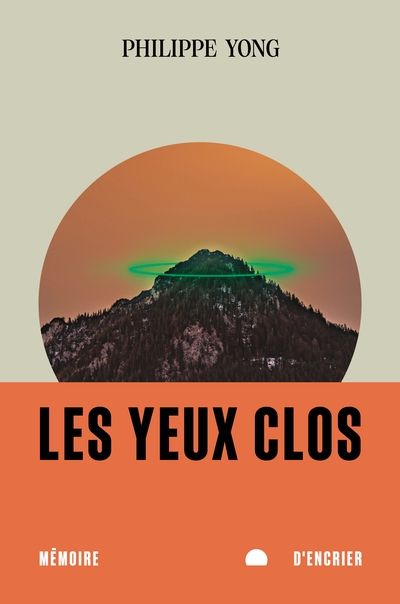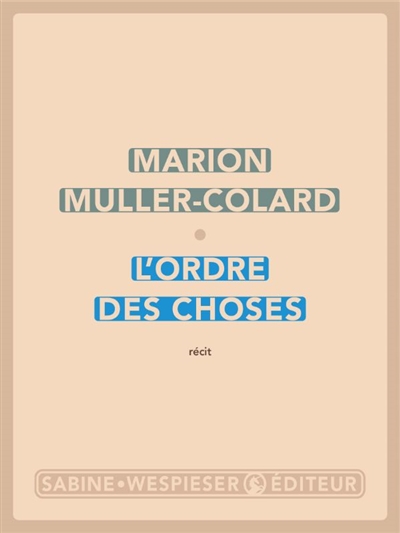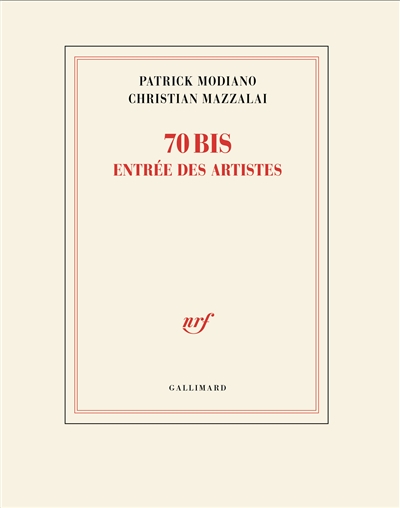« La neige règne sans partage ». Avec cette (presque) première phrase, Christian Guay-Poliquin nous assujettit d’emblée à l’impérieuse emprise de cette neige omniprésente et au rythme quasi hypnotique de sa narration au style limpide et poétique. Le narrateur est immobilisé par un accident qui l’a laissé alité et souffrant, les deux jambes brisées. Mais l’hiver est venu et les conditions de survie difficiles rendent son évacuation vers un hôpital impossible. Aussi promet-on à Matthias, un vieil homme échoué là au hasard d’une panne, une place dans le prochain convoi pour la ville en contrepartie des soins prodigués au jeune homme. Ce huis clos oblige les deux hommes à se faire face mais aussi à se confronter à leur propre intériorité ainsi qu’à la puissance inéluctable de la nature. Le Poids de la neige est un roman d’une beauté, d’une force et d’une profondeur incroyables qui ne nous laisse pas indemnes et l’œuvre d’un jeune écrivain de très grand talent.
PAGE — Comment vous est venue l’idée de ce face-à-face imposé entre Matthias et le narrateur ? Au final, peu en importent les causes (qui demeurent assez mystérieuses), c’est véritablement la rencontre entre ces deux hommes, leurs épreuves intimes croisées, leurs manières de survivre qui semblent vous avoir intéressé.
Christian Guay-Poliquin — J’ai d’abord voulu raconter une histoire d’aidant naturel, mais en inversant les rôles. Dans mon roman, le vieillard n’est pas mourant, bien au contraire, c’est lui qui prodigue les soins au jeune blessé et qui prend en charge toutes les tâches du quotidien. Toutefois, au-delà de cette situation, il faut rappeler que ces deux personnages sont contraints à ce tête-à-tête. Car ils ont été littéralement pris en otage par une panne d’électricité généralisée et un hiver interminable. Dans ce huis clos, chaque geste, chaque parole, chaque silence peut ainsi prendre une ampleur considérable, voire disproportionnée. Si une certaine complicité point par moment, tout est néanmoins là pour rappeler le fragile équilibre sur lequel reposent les relations humaines. Dans la fiction comme dans la réalité, on ne revient jamais indemne du « territoire de l’autre ».
PAGE — Le Poids de la neige est, d’une certaine façon, assez contemplatif. En effet, l’impossibilité de quitter le village, les difficultés à faire face à la neige et aux conditions de survie difficiles, cela ramène les personnages à la nature, son observation et la conscience que si elle est à la fois prodigue et rude, elle est surtout toute-puissante. Pourquoi avoir choisi de mettre l’accent sur cette dimension plutôt que sur l’action pure ?
C. G.-P. — Il n’y a jamais d’action pure. Chaque action s’inscrit dans un contexte qui la dépasse, qui l’englobe et qui, aussi, la définit. Ainsi, l’errance du regard accompagne chaque geste et détourne imperceptiblement notre attention. À la manière des plans d’insert, au cinéma, le général donne le ton au particulier. Le café que l’on verse est accompagné d’un coup d’œil vers l’horloge. On lave la vaisselle en regardant par la fenêtre au-dessus de l’évier. On conduit la voiture en étirant immanquablement le cou pour observer la forme des nuages. La dimension poétique du monde est là. Dans le détail superflu qui transforme l’action pure du récit en action humaine. Et, bien sûr, dans la nature qui berce avec une magnifique indifférence tout ce que nous pensons être.
PAGE — Le temps semble déréglé – au début, on pense que c’est l’effet de l’état du narrateur mais cela perdure bien après son rétablissement. Ainsi les chapitres portent des numéros croissants puis décroissants, discontinus… En quoi cela contribue-t-il à construire l’atmosphère si particulière du roman ?
C. G.-P. — Je me plais à dire que j’écris des histoires où il ne se passe rien. Parce que c’est précisément lorsque rien ne se passe que tout peut arriver ! Blague à part, si l’essentiel d’une péripétie se résume à son déploiement dans le temps, c’est donc que chaque détail compte. Le rythme, dit-on en musique, passe par la maîtrise du silence. C’est pareil en littérature. Que les chapitres correspondent à l’accumulation des centimètres de neige est donc une ruse – assez simple somme toute – qui me permet de jouer avec le temps du récit et, ainsi, de mettre l’emphase sur quelques éléments bien choisis. Le Poids de la neige est en ce sens un roman de l’attente. Attente de la guérison, attente de la prochaine cargaison de vivres, attente du printemps… Et si cette attente a une signification différente pour chacun des personnages, ce n’est qu’une formule littéraire pour affirmer la dimension humaine de la relativité du temps.
PAGE — Le roman foisonne de références mythologiques, bibliques et littéraires : vous semblez vous y être amusé et en même temps, comme on le sait, les « amusements » d’un auteur sont rarement gratuits. Qu’avez-vous cherché à questionner de manière sous-jacente par ce réseau de références ?
C. G.-P. — Un texte existe grâce à ceux qui le précèdent et à ceux qui lui suivront. Ainsi la littérature. C’est pourquoi, comme bien d’autres avant moi, j’ai pris plaisir à dissimuler d’autres textes à l’intérieur de mon travail. Certes, ce procédé sert à étoffer le réseau de sens du récit mais, plus encore, à mettre en abyme la littérature sans avoir à faire intervenir – encore – le cliché du personnage-écrivain. La référence mythologique, quant à elle, est beaucoup plus explicite. À l’instar de mon roman précédent, Le Fil des kilomètres, l’histoire du Poids de la neige est entrecoupée par quelques passages en italique. Ce récit en parallèle reprend ici le mythe de Dédale et Icare mais en intervertissant sa proposition finale. Ainsi, alors qu’Icare vole au-dessus de la mer en suivant scrupuleusement les indications de son père, ce dernier se laisse progressivement griser par l’altitude et, assoiffé de lumière et d’horizon, se rapproche dangereusement du soleil. Enfin, il s’agit surtout de jouer avec les références comme on joue avec les métaphores et peut-être ainsi éveiller les « regards familiers » enfouis au cœur des « forêts de symboles » dont nous parlait Baudelaire il y a déjà longtemps.