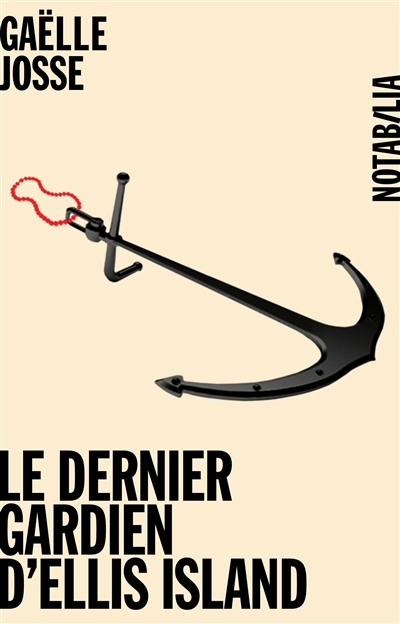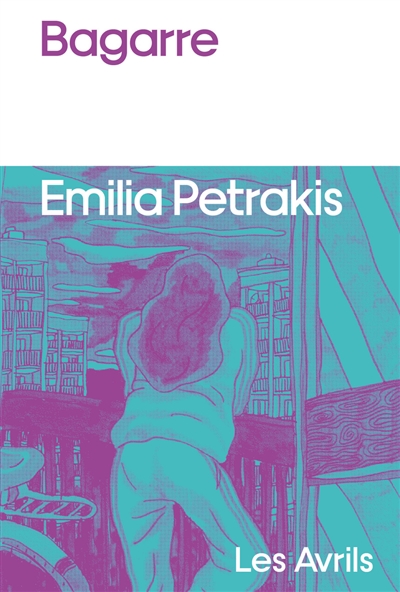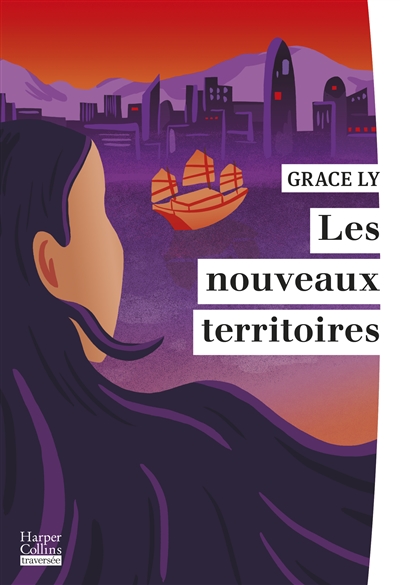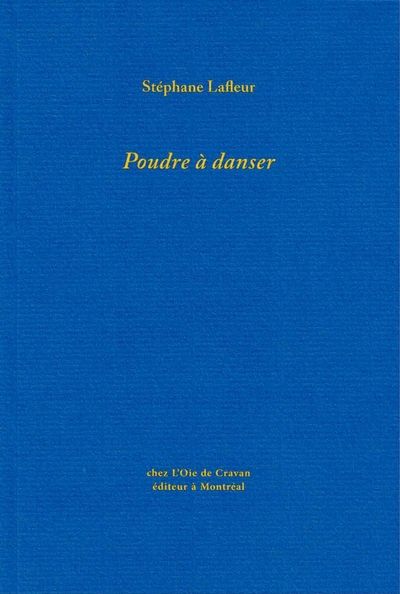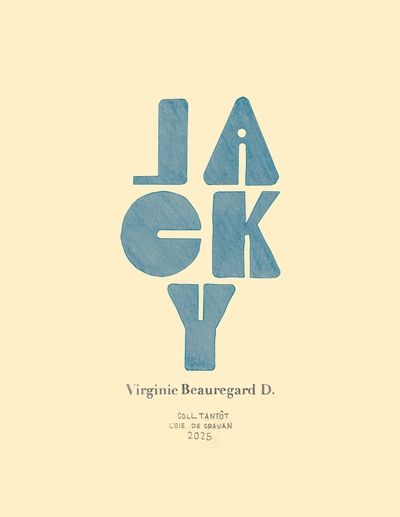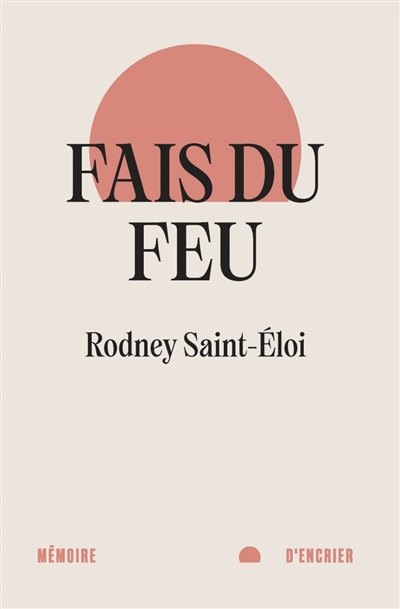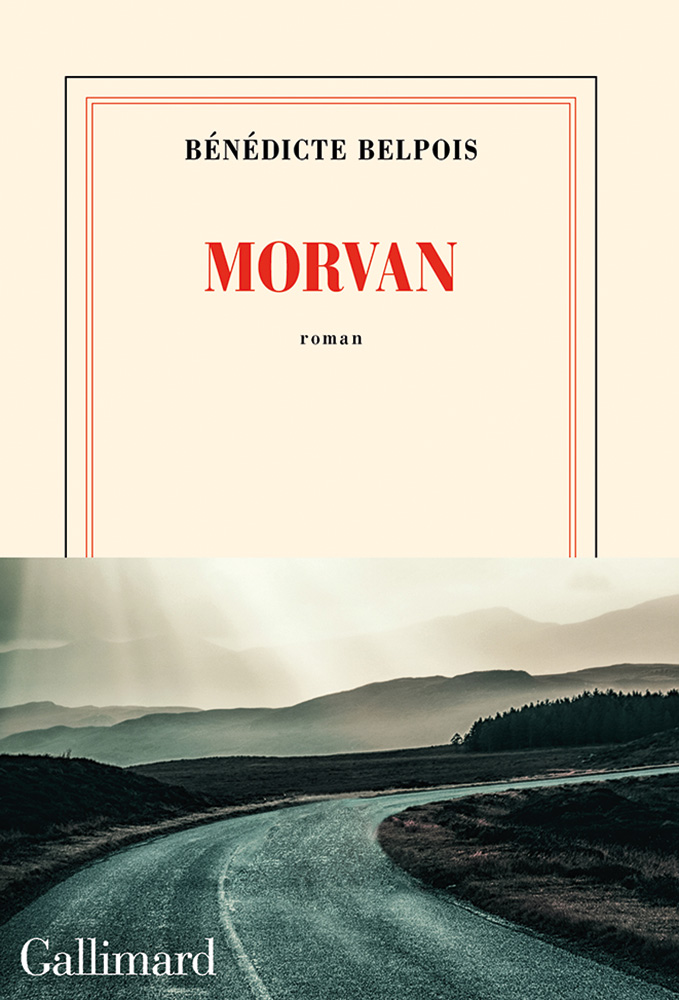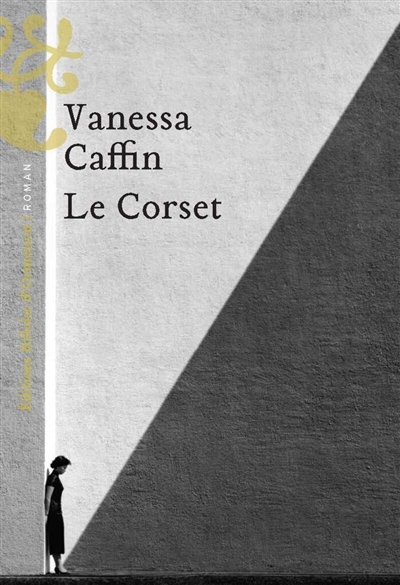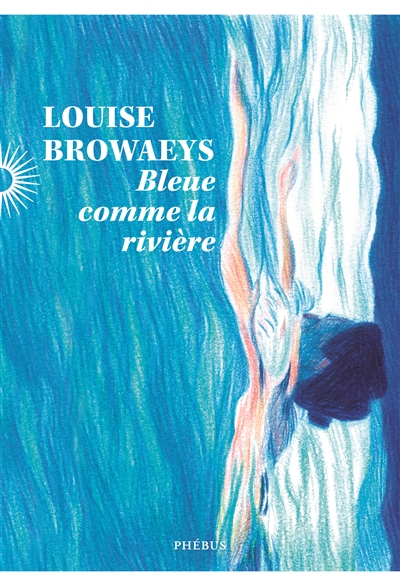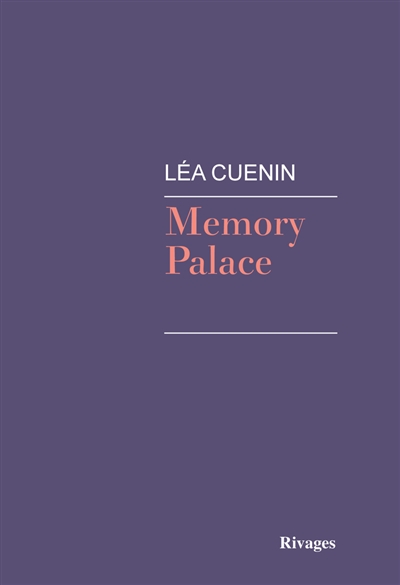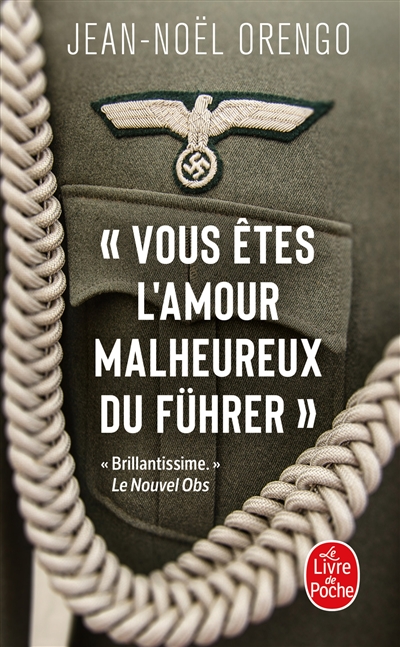Quelques jours avant la fermeture d’Ellis Island, son directeur écrit ses souvenirs. Dans un huis clos solitaire, un monde s’écroule. Celui où les immigrants venaient nourrir le creuset de l’Amérique. Acceptés ou refusés sur le sol américain, leur destin dépendait de leurs réponses à un questionnaire, de la décision d’un fonctionnaire. Après des années de bons et loyaux services, c’est le monde intérieur de John Mitchell qui s’effondre. Le fonctionnaire zélé a failli, a transgressé le règlement et, plus profondément, les lois de l’humanité. Il a abusé de son pouvoir. Regrets, sentiment de perte, tous les exilés défilent une dernière fois. Avec une écriture juste et acérée, Gaëlle Josse donne à voir, à sentir une tranche de l’histoire américaine à travers les mouvements d’une âme en proie à ses démons. La grande Histoire se fond dans le destin de l’individu et des anonymes déclassés qui prennent chair et âme. Amour, passion, la narration est tendue dans une grande plongée au fond des méandres d’une âme prisonnière de sa solitude et de l’île. Magistral et urgent !
Page — Comment avez-vous « accosté » à Ellis Island, monument de l’Histoire américaine ?
Gaëlle Josse — Mon livre prend pour cadre cet îlot qui, à partir de 1892 et jusqu’en 1954, a été le point de passage obligatoire de tous les immigrants venus d’Europe et désireux d’entrer sur le territoire américain. Ellis Island a été surnommé « l’Île des peurs » et « l’Île des larmes ». Ce rocher représentait la possibilité d’être accepté par la grande Amérique et transformé en citoyen, ou d’en être chassé. C’est un endroit d’une très haute valeur symbolique, l’athanor, le creuset de l’Amérique. Le livre est né d’une collision frontale avec ce lieu que j’ai visité il y a un peu moins de deux ans. Ellis Island m’a immédiatement happée, m’a profondément bouleversée. Je m’y suis rendue très tôt le matin afin d’éviter la foule des touristes et je me suis retrouvée presque seule à arpenter les couloirs, à gravir les escaliers, à passer devant des dizaines de portes ouvrant sur des pièces vides. Le site est labyrinthique, hanté par le souvenir de tous ces exils. J’y ai éprouvé des sensations étranges. On sent l’édifice traversé de vibrations. Ses murs résonnent de centaines d’histoires de vies. Je ne nourrissais aucun projet littéraire. Et puis, quelques semaines après mon retour, l’idée du livre m’est tombée dessus de manière extrêmement forte et impérieuse. Je me suis efforcée de l’accueillir de mon mieux.
Page — Pourquoi avoir choisi la forme du journal pour raconter la vie de John Mitchell ?
G. J. — Rien n’est plus propice à la confidence, à la confession, au récit personnel que le journal intime. C’est une forme que j’aime beaucoup manier, que j’ai pratiquée, à un degré ou à un autre, dans chacun de mes livres. Il est un formidable moyen d’accompagner un personnage au sein de son labyrinthe intérieur. Être pas à pas avec lui et découvrir, en même temps que lui, ses failles, ses contradictions, ses erreurs, suivre ses errances, assister à ses éblouissements… Ce journal, trouvé par l’un des personnages, renferme une histoire qui fera écho à sa propre histoire, qui sera comme le miroir de ses expériences à lui. En une dizaine de jours, John Mitchell, resté seul sur l’île peu à peu désertée et qui vit un peu le même genre d’expérience que le personnage du Désert des Tartares (Dino Buzzati, Pocket), remonte le fil de son existence afin de se délivrer d’un certain nombre de drames qui se sont déroulés derrière les murs d’Ellis Island, d’événements difficiles qui l’ont lié à certains de ces immigrants. Et notamment à une jeune Sarde dont la rencontre produit en lui un séisme amoureux, qui les conduira à toutes les transgressions et à tous les drames. Le thème de la transgression est au centre du livre. Je me suis demandée comment un homme censé être le garant, l’emblème, le gardien de l’ordre, de la règle, de la loi, se trouve conduit, par la passion, mais aussi par d’autres facteurs, à transgresser tout ce qu’il représente. Comment se produit ce glissement psychologique ? Pourquoi et avec quelles conséquences ? De nombreux visages défilent au long des pages. Lazarini, par exemple, est un anarchiste italien qui suscite un certain nombre d’événements complexes. Et puis il y a cet écrivain hongrois auquel Mitchell, ayant découvert ce qu’il a fait et qui l’a conduit à immigrer, finira par refuser l’entrée sur le territoire américain. On se construit dans la rencontre avec l’autre, dans le regard de l’autre. Progressivement, John Mitchell voit s’effondrer ses certitudes. La mission qui lui a été confiée, qui consistait à veiller sur son pays, à le protéger contre une hypothétique menace extérieure, ne lui semble plus si légitime. Il prend conscience que le cœur de l’humanité ne réside pas uniquement dans l’organisation minutieuse du fonctionnement d’Ellis Island. Les failles qu’il perçoit, avec une acuité croissante, chez ces êtres en quête d’un salut nouveau, le révèlent à lui-même. C’est un peu ce que j’attends d’un livre. Une histoire tient à peu de choses. Il faut évidemment que le lecteur ait envie de tourner les pages et que l’intrigue se tienne un minimum. Mais l’essentiel pour moi est ailleurs. Un livre est comme un triangle. Un côté représenterait l’histoire, le second l’écriture et le troisième les personnages. Or, ce qui m’intéresse avant tout, ce sont les personnages. Ils ont des choses à nous apprendre, à nous transmettre. Ils sont les miroirs de notre propre humanité. La vie, l’amour, la mort, Dieu au milieu de tout ça, qu’avons-nous reçu et qu’avons-nous donné, qui avons-nous trahi, qu’est-ce que retiennent finalement nos mains ? Ce sont les seules interrogations qui vaillent. J’ai tendance à écrire pour explorer encore et encore ces questions. Un huis clos favorise l’exacerbation des sentiments, offre un espace d’affrontement psychologique à peu près sans limites. Par la grâce de l’imagination de l’auteur, c’est aussi un lieu dont on s’échappe, où peuvent s’enchâsser d’autres histoires, à la manière de poupées russes ou par effet de miroir.
Page — Pourquoi avoir conçu un blog prolongeant le livre ?
G. J. — J’ai créé ce petit objet numérique à partir de photos personnelles et d’images d’archives, de musiques qui m’ont accompagnée pendant l’écriture. Il ne s’agit en aucun cas d’un instrument de promotion. Plutôt une sorte d’après-lecture. En réunissant ces documents et en les comparant avec des photos récentes prises à Lampedusa qui montrent des bateaux chargés jusqu’à la gueule, prêts à sombrer sous le poids de leurs grappes humaines, j’ai été frappée de reconnaître les mêmes visages, chargés de la même détresse que ceux des hommes, femmes, enfants débarquant il y a un siècle à Ellis Island. Des êtres encombrés de sacs en plastique et de baluchons, qui laissent tout derrière eux, qui sont le dos au mur et tentent de trouver, à n’importe quel prix, une vie meilleure en rejoignant des lieux dont ils ne connaissent ni la langue, ni les mœurs, ni les codes. Expérience éternelle…