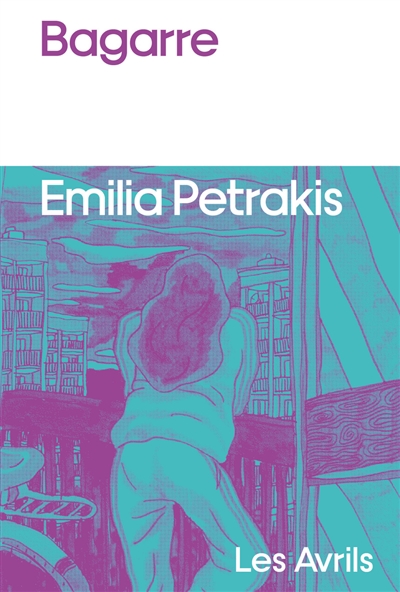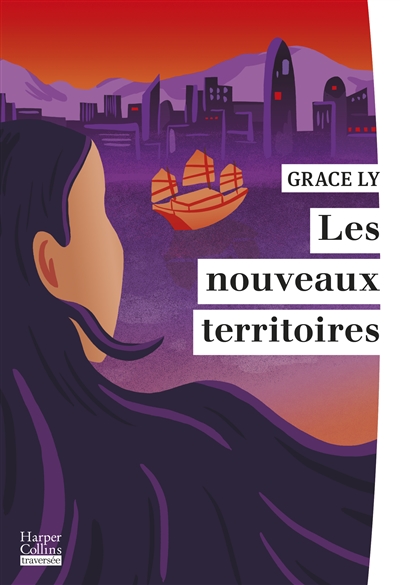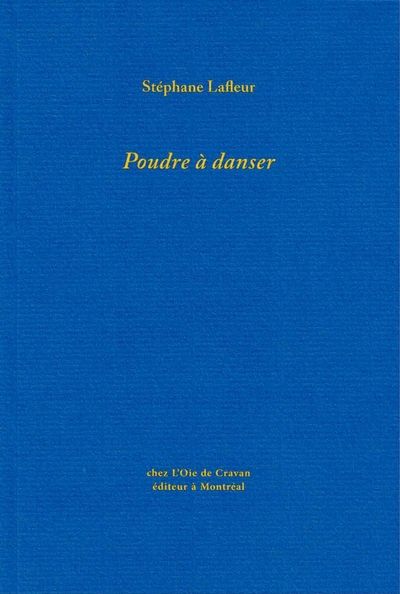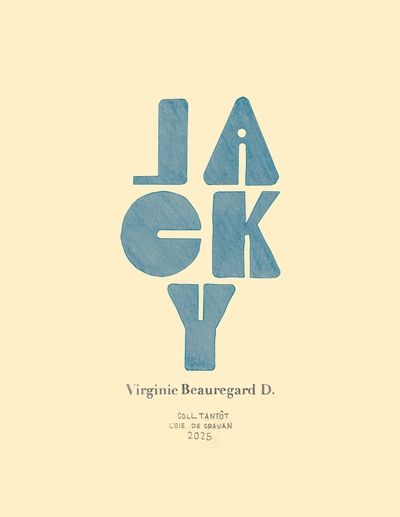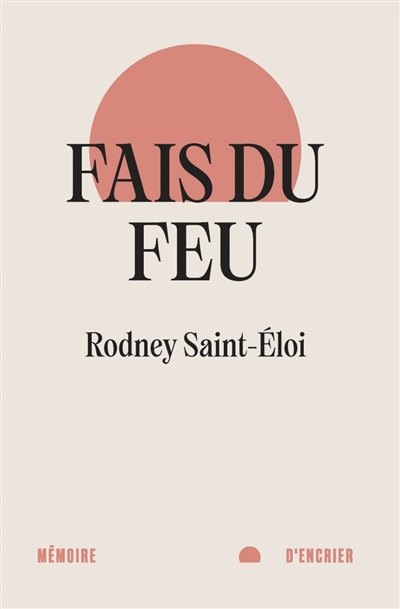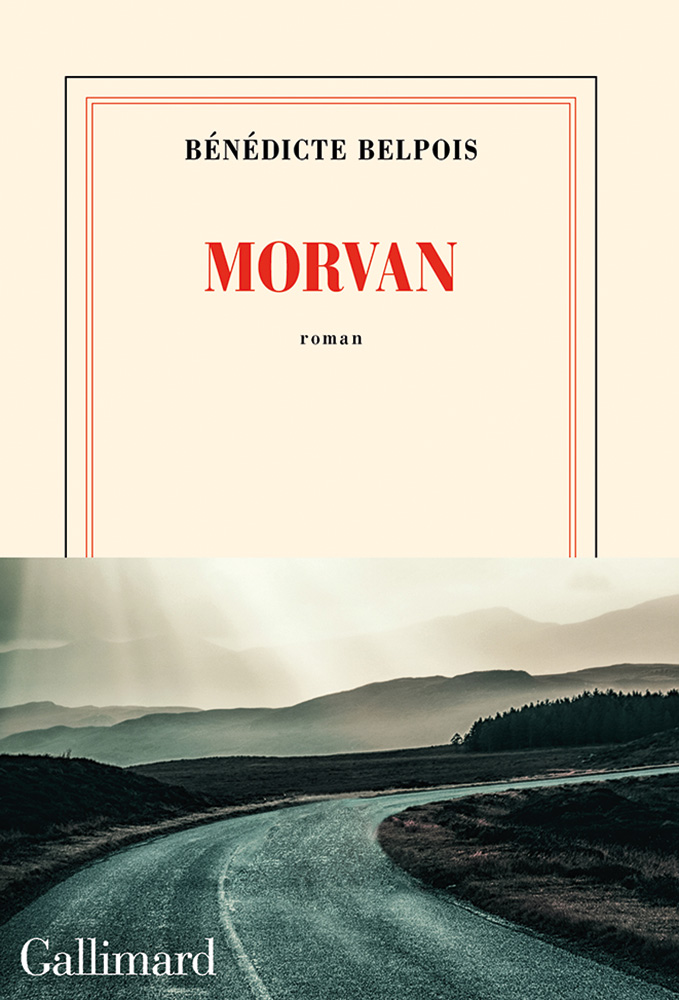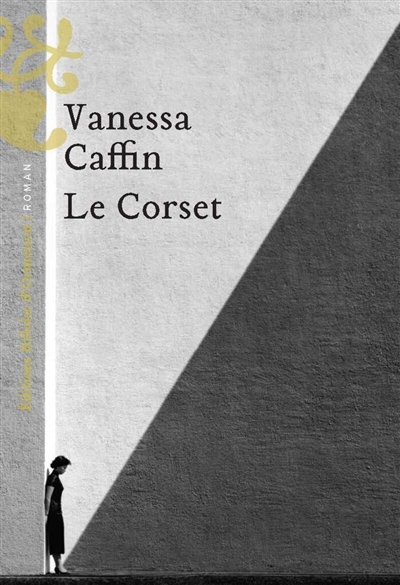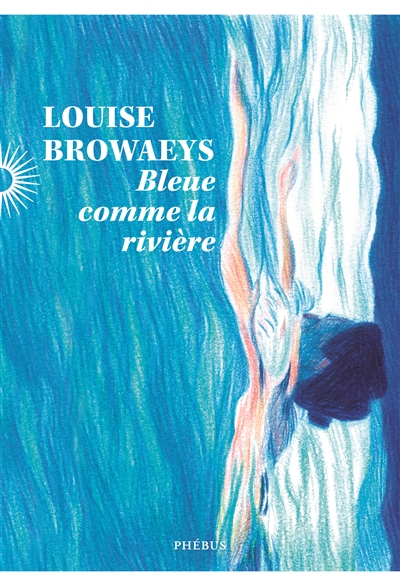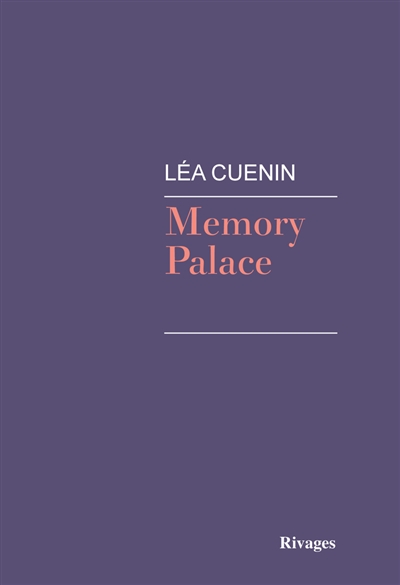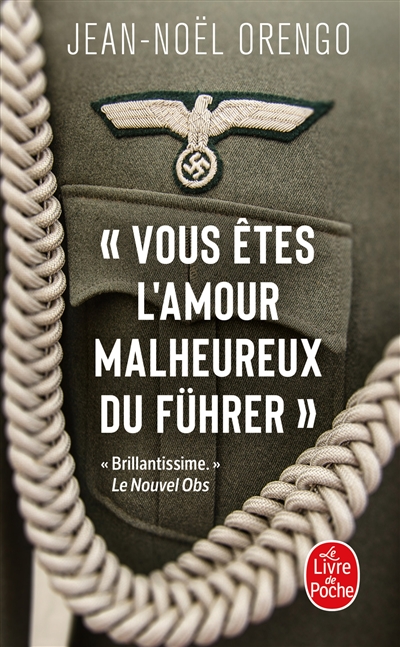Il y a presque dix ans paraissait Quatre soldats, un de vos romans les plus connus. Dans Un repas en hiver, vous nous faites partager un moment de la vie d’autres soldats, pris au piège d’une autre guerre, dans un autre camp et qui sont pourtant confrontés aux mêmes problèmes : le froid, la faim, la peur, un certain dégoût à l’égard des missions qui leur sont confiées. Il s’agit d’hommes ordinaires propulsés au cœur de l’horreur, une horreur dont ils sont les acteurs forcés… Pourquoi avoir placé vos personnages dans un contexte aussi terrible ?
Hubert Mingarelli — Ce qui me fascine – encore que ce ne soit pas le terme le plus approprié pour parler de la situation –, c’est qu’à l’issue d’un conflit, en fonction du côté de la frontière où l’on se trouve, selon qu’on est né dans un camp ou dans un autre, on appartient à la communauté des héros, des vainqueurs ou à celle des salauds. Vous parlez de Quatre soldats, ce roman déjà ancien, et c’est vrai que les trois soldats de Un repas en hiver ressemblent à ceux de ce précédent livre. Ils sont pratiquement semblables, sauf que le boulot de ceux qui peuplent ces pages consiste à exécuter des juifs par milliers. On appelle cet aspect de la Seconde Guerre mondiale la Shoah par balle. Au fur et à mesure de l’avancée de l’armée allemande, des unités de réservistes constituées de soldats qui n’étaient pas forcément des nazis, qui étaient des hommes ordinaires, avaient pour tâche de fusiller des gens par milliers, par centaines de milliers. Ce qui me bouleverse, c’est que ces hommes étaient des individus comme vous et moi. Comment une telle chose est-elle possible ? Comment vous et moi, qui ne ferions de mal à personne, dès lors que nous sommes plongés dans un univers de terreur, sommes potentiellement susceptibles d’obéir à des ordres atroces ? Contrairement aux personnages de Quatre soldats, avec lesquels je me sentais bien – tant qu’à passer des semaines, des mois avec des personnages, autant se sentir à l’aise en leur compagnie… –, je me demandais constamment ce qui m’avait pris de parler de ces types. Ils ont accompli des choses innommables. J’avais un problème avec eux. Et bizarrement, à mesure que je progressais dans l’écriture, j’éprouvais de moins en moins de problèmes à les fréquenter. Leur job n’avait pourtant pas changé. Il consistait toujours à éliminer le plus de juifs possible. Un repas en hiver parle de cette Shoah par balle. L’extermination des juifs à l’intérieur des camps de concentration n’impliquait pas des gens comme vous et moi. Ceux-ci n’étaient pas directement confrontés à la mort. À la limite, ils encadraient les futures victimes, les entassaient dans les trains chargés de les conduire à la mort. Mais en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, les soldats allemands et quelques-uns de leurs auxiliaires tuaient d’une balle dans la tête. Ils étaient concrètement associés au crime de masse. Comment est-ce possible ? Le fait est que ça l’est puisque c’est arrivé.
Le narrateur, Bauer et Emmerich (les trois soldats d’Un repas en hiver) partagent tout et, pourtant, ils demeurent intrinsèquement seuls. Jusqu’au bout. Entre cette fraternité et cette solitude, on a le sentiment que c’est la condition humaine que vous décrivez ?
H. M. — Je n’ai pas toutes les réponses. Est-ce qu’ils sont seuls du fait de ce travail ? Sont-ils – sommes-nous – de toute façon seuls ? Ces personnages appartiennent à ces gens ordinaires qui formaient le gros des unités de réserve de l’armée allemande qui tuaient les juifs par centaines de milliers. On leur a demandé préalablement s’ils acceptaient une telle mission, s’ils étaient d’accord pour accomplir cette tâche – je parle de la réalité, pas de mon roman. Ceux qui ne voulaient pas étaient tout à fait en droit de refuser. Ils ne recevaient nulle sanction. Mes trois personnages, mes trois soldats ont accepté de le faire. Ils portent ce poids parce qu’ils n’ont pas osé dire non. Un non qui n’aurait entraîné aucune sanction.
Pourtant, ce jour-là, celui qui est raconté dans le roman, ils disent non.
H. M. — Ils n’en peuvent plus. Pourquoi n’en peuvent-ils plus ? Je ne sais pas. Au bout d’un moment, je suppose, c’est pénible d’être éclaboussé de sang et de morceaux de cervelle chaque jour. Le roman ne parle pas de ces aspects de leur travail, il ne pose pas ces questions. Je me les pose maintenant devant vous…
Ainsi, pour une journée, ils sont affectés à une autre mission, à peine plus supportable que l’autre mais qui les en éloigne pour quelques heures. Une fois leur tâche accomplie – arrêter un juif –, ils trouvent refuge dans une maison abandonnée, y allument un feu et partagent leurs maigres provisions afin de confectionner un repas. En dehors des premières pages du roman, l’essentiel de l’histoire se situe à l’intérieur de cette maison, autour de ce repas. Ce précaire espace de chaleur représente-t-il la possibilité d’un havre, d’un petit espace de réconfort et de paix dans le cauchemar qu’est devenue leur vie ?
H. M. — Pour moi, oui. Ils ont froid, ils n’ont presque rien à manger, ils sont loin de chez eux… mais ils en font une telle chose, pas pour très longtemps, le temps d’une trêve au cours de laquelle ils sont ensemble. C’était une scène compliquée à écrire. Un repas a quelque chose d’un rituel, c’est un moment très symbolique – même si le roman se garde de toute symbolique. En racontant cet épisode, j’étais dans la mécanique qui porte mes personnages. Comme eux, j’avais faim, j’avais froid, je profitais de la chaleur du foyer. Je m’interrogeais, préoccupé par les mêmes questions qu’eux, sans doute. Que fait-on dans une maison gelée ? Que faire lorsqu’on n’a presque rien à manger ? Dans quelle casserole prépare-t-on la soupe, avec quels ingrédients, à l’aide de quels ustensiles… ? Et avec qui mange-t-on ? Car ils ne sont pas seuls, il y a avec eux un juif et un Polonais antisémite : c’est le cœur de l’histoire.
Emmerich a un fils, là-bas, dans cet ailleurs dont il ne vaut mieux pas parler si l’on veut tenir. Pourtant il l’évoque car il est confronté à un problème que les circonstances rendent presque dérisoire : son fils fume. À travers cet événement apparemment anecdotique, c’est une question essentielle qui se pose au père : que vais-je transmettre à mon fils ? Cette inquiétude, il la partage avec ses camarades à la faveur du repas. Qu’est-ce qui vous a donné envie de poser cette question de la transmission ?
H. M. — Je pense que ce père, le seul des trois soldats à avoir une famille en Allemagne et à être père, alors qu’il est à des milliers de kilomètres de chez lui, s’inquiète plus que jamais de ce qu’il est en mesure – ou, justement, de ce qu’il n’est plus en mesure –, de transmettre à son fils. Alors il s’interroge avec ses amis sur la meilleure façon d’empêcher son fils de fumer. Peut-être voit-il sa fin approcher ? Tout ça est tellement dérisoire : un gamin qui se met à fumer au milieu de ce contexte de mort, au milieu de ce désastre général… Et cependant, il faut bien que ce soldat se raccroche à quelque chose, peut-être pour ne pas basculer complètement dans la folie… Je dis cela, mais je n’en sais rien. C’est comme si je m’exprimais à sa place. Il a besoin de ce secours, de trouver un point d’appui, alors il pense à son fils. Il est un père désarmé devant ce minuscule problème d’un fils adolescent qui fume avec ses copains. Il en parle à ses frères d’arme qui tentent de l’aider, de lui prodiguer leurs petits conseils… « Frères d’arme », quelle étrange formule. Il y a quelque chose de positif, de bon dans cette expression. Ici, elle désigne trois tueurs, trois chasseurs de juifs. Pourquoi parler des bourreaux et pas des victimes ?
Parce que ce sont des hommes ?
H. M. — Exactement ! Tout le problème est là ! Ils étaient des hommes, ils étaient nous.
Littérature française
Hubert Mingarelli
Frères humains ?

-
Hubert Mingarelli
Un repas en hiver
Stock
22/08/2012
144 pages, 17 €
-
L'entretien par
Marie Michaud
Librairie Gibert Joseph (Poitiers) - ❤ Lu et conseillé par 24 libraire(s)

Entretien par Marie Michaud
(Librairie Gibert Joseph, Poitiers)
Marcher dans la neige. Parler, peu.
Se réchauffer autour d’un feu et d’un repas. Le lecteur accompagne au plus près les personnages d’Un repas en hiver et n’en sort pas indemne. Toujours avec pudeur, justesse et sensibilité, Hubert Mingarelli interroge simplement ce qui fait et défait notre humanité.