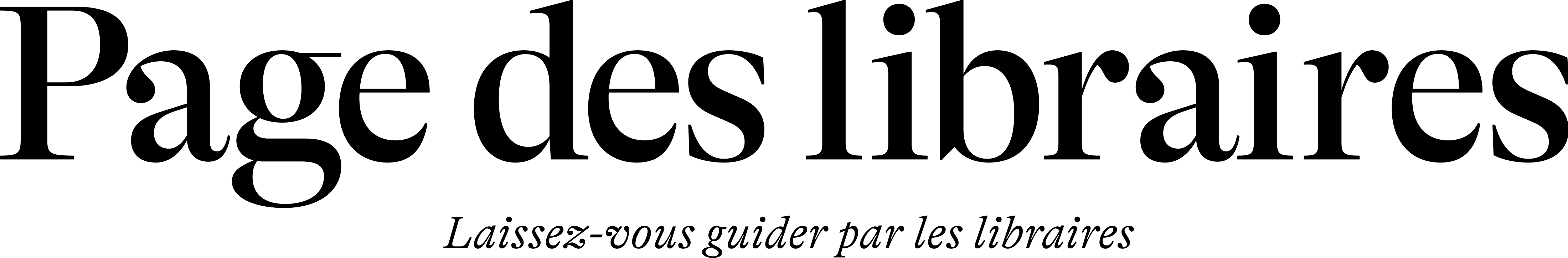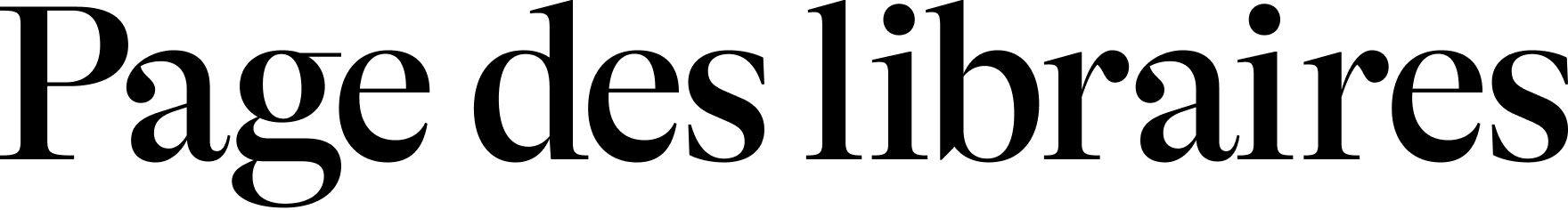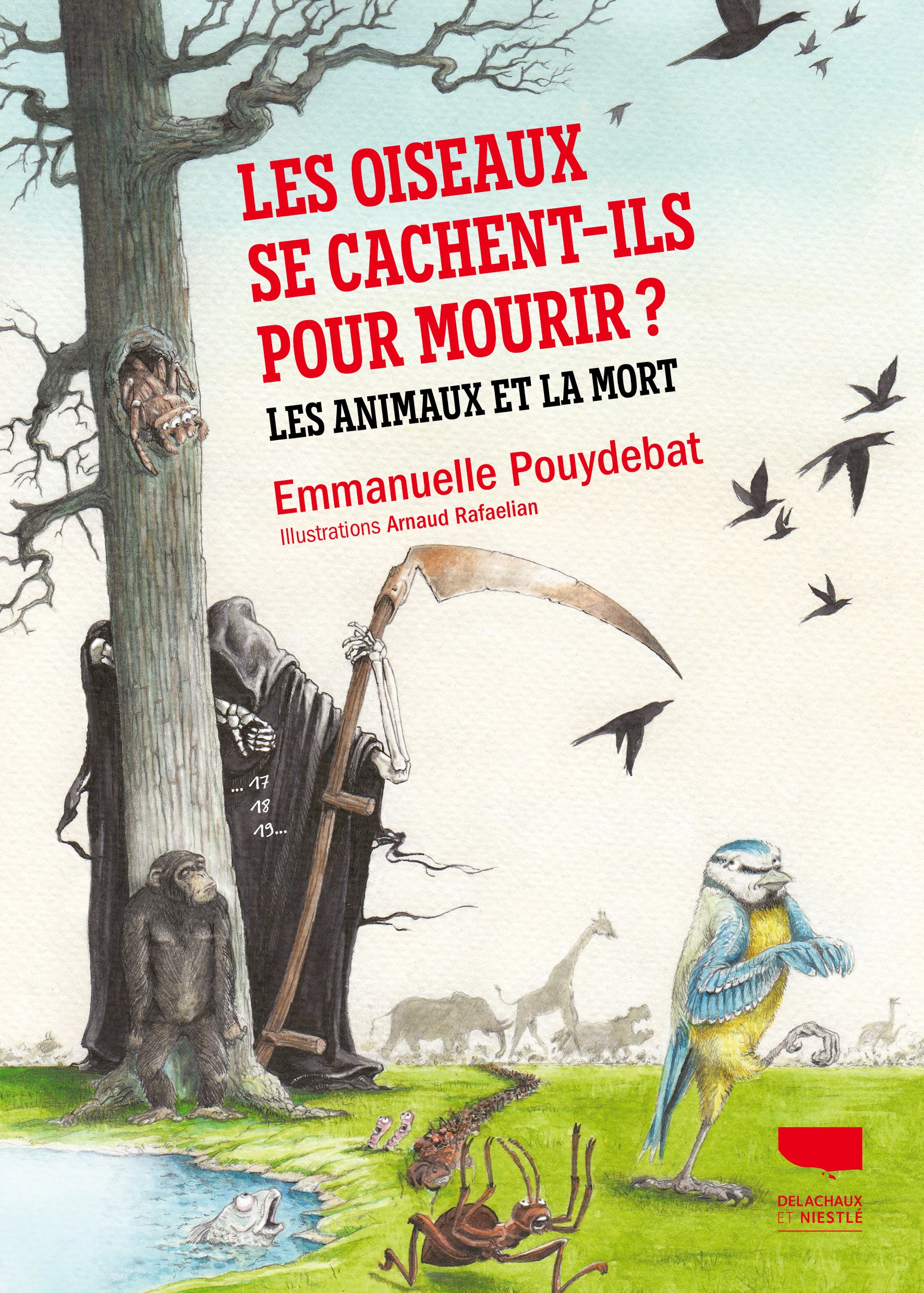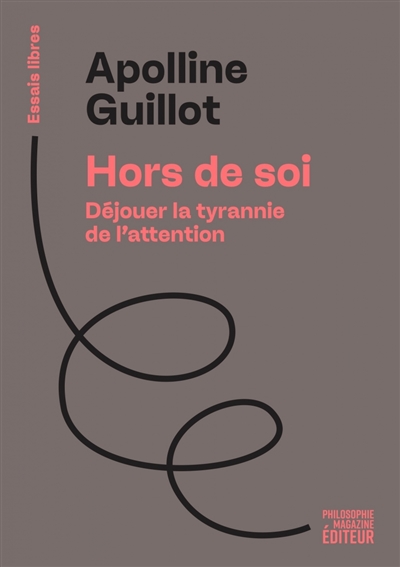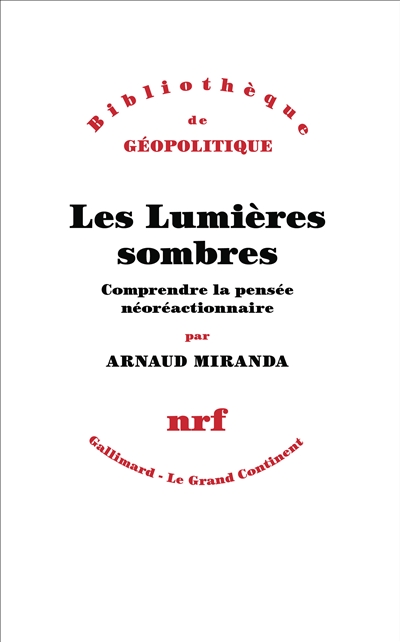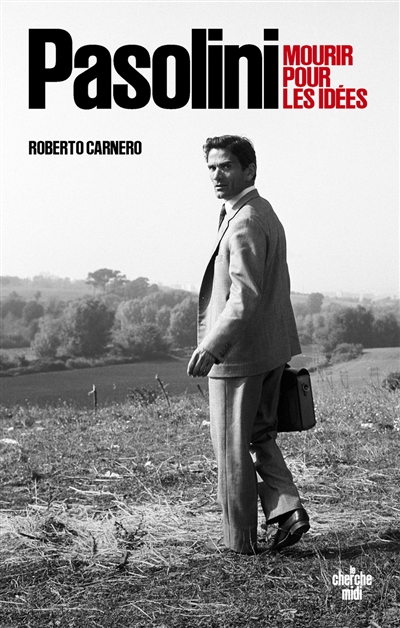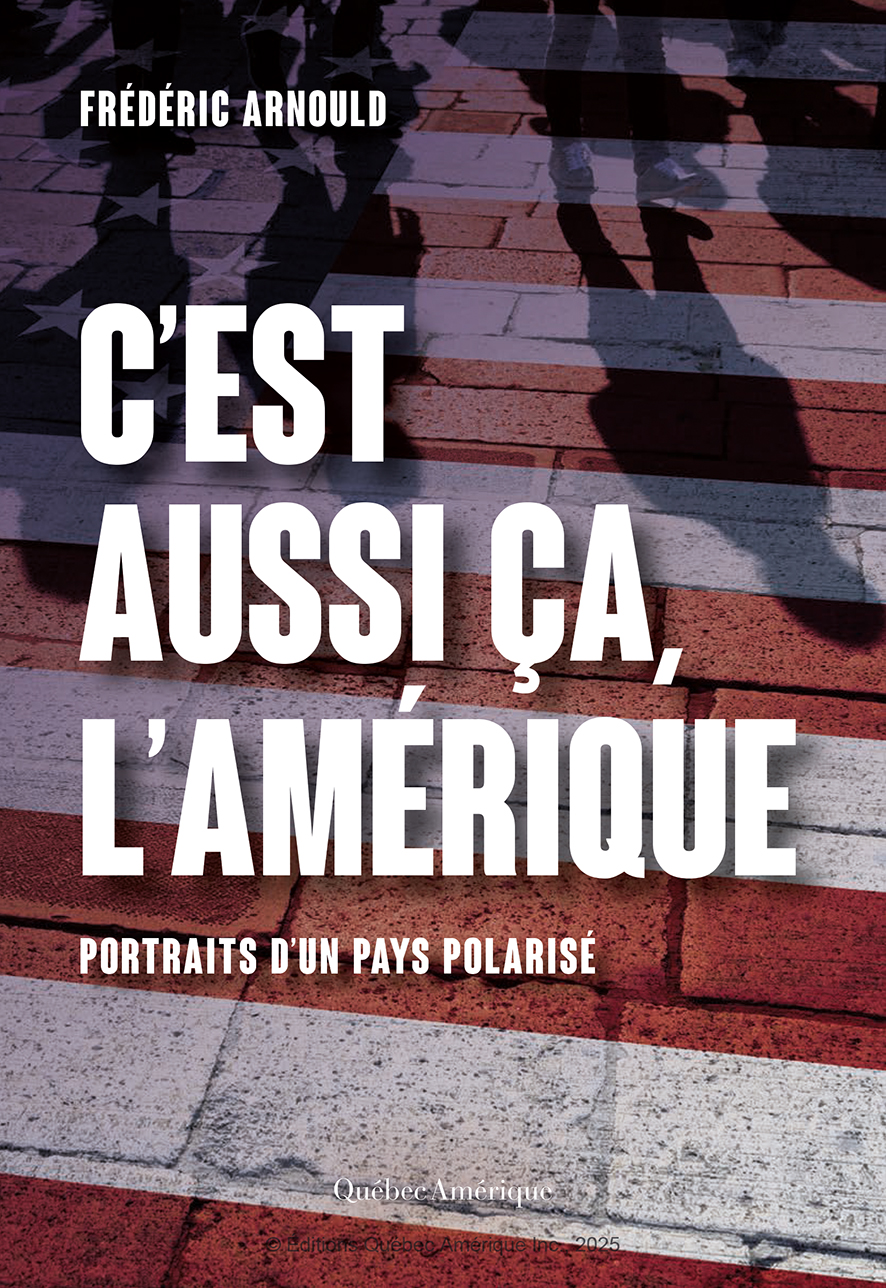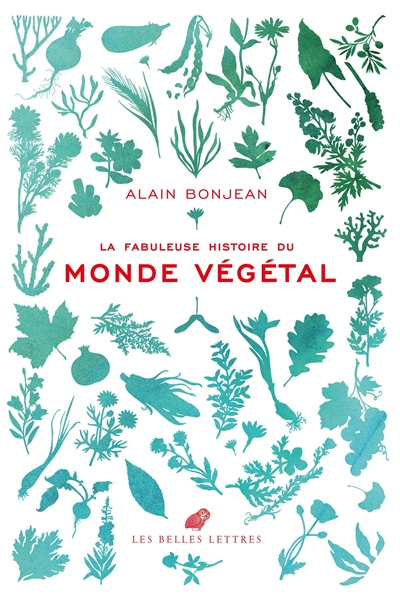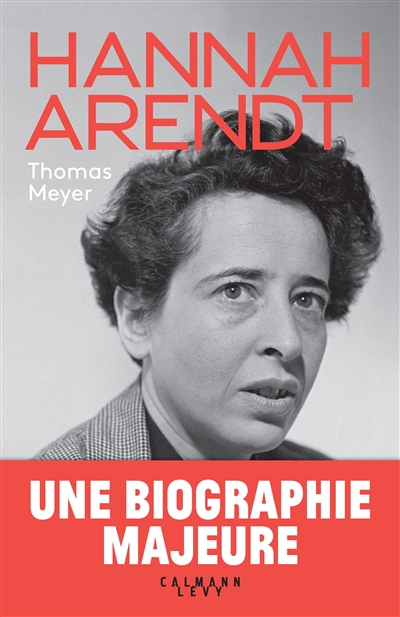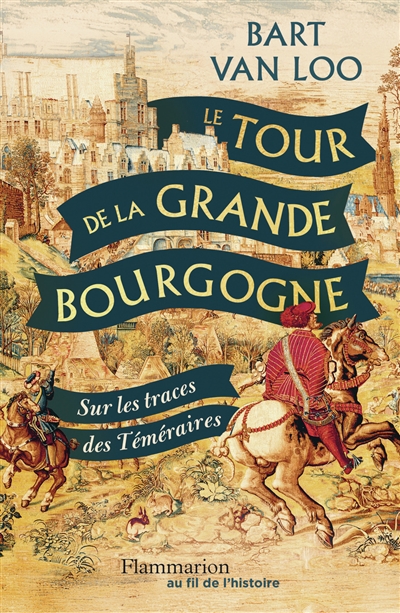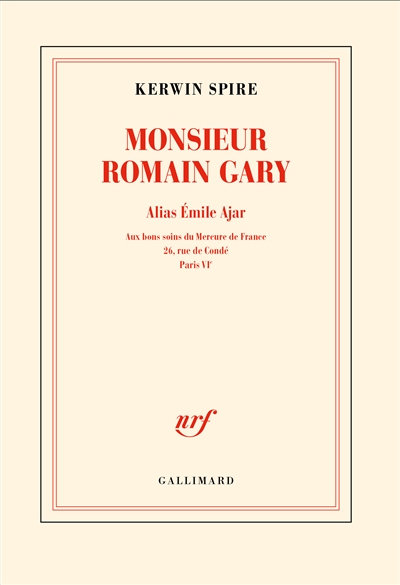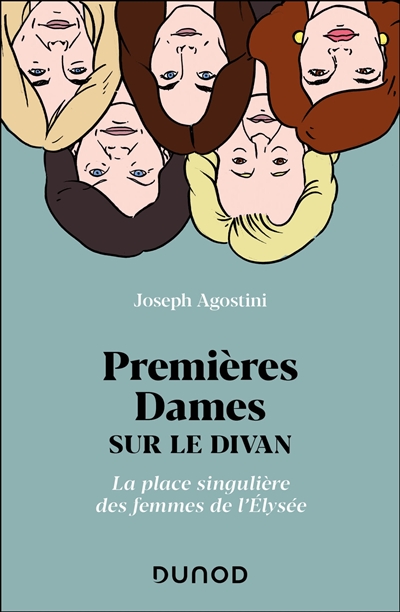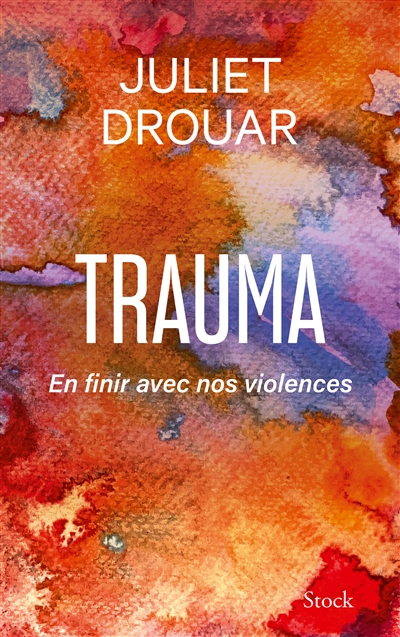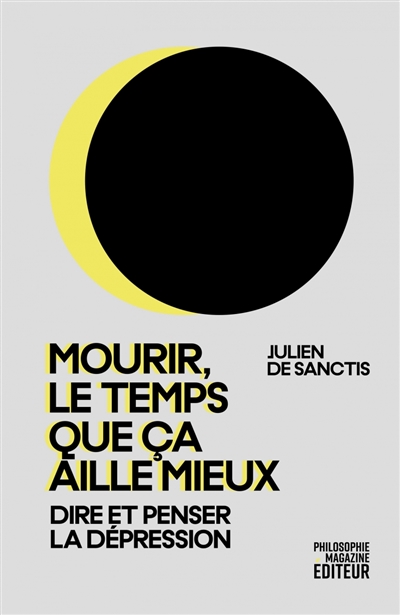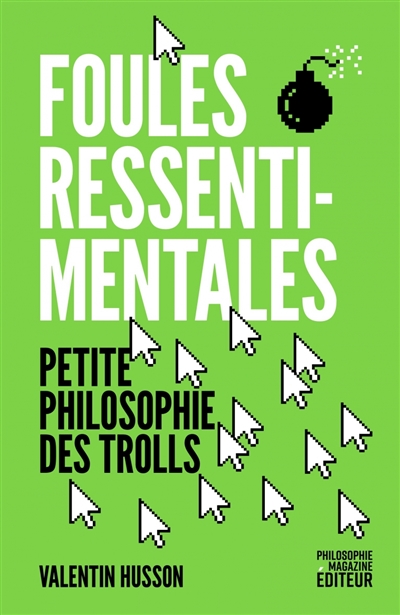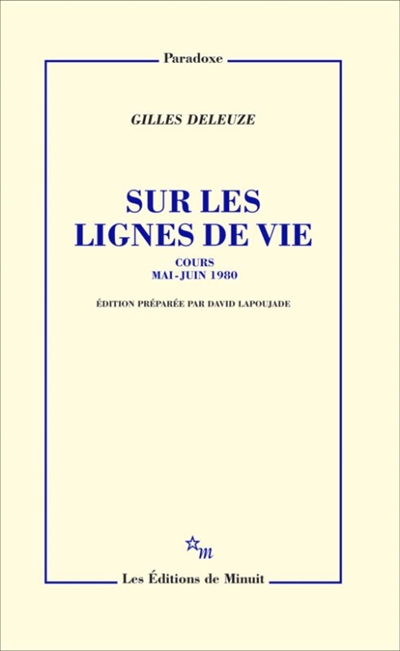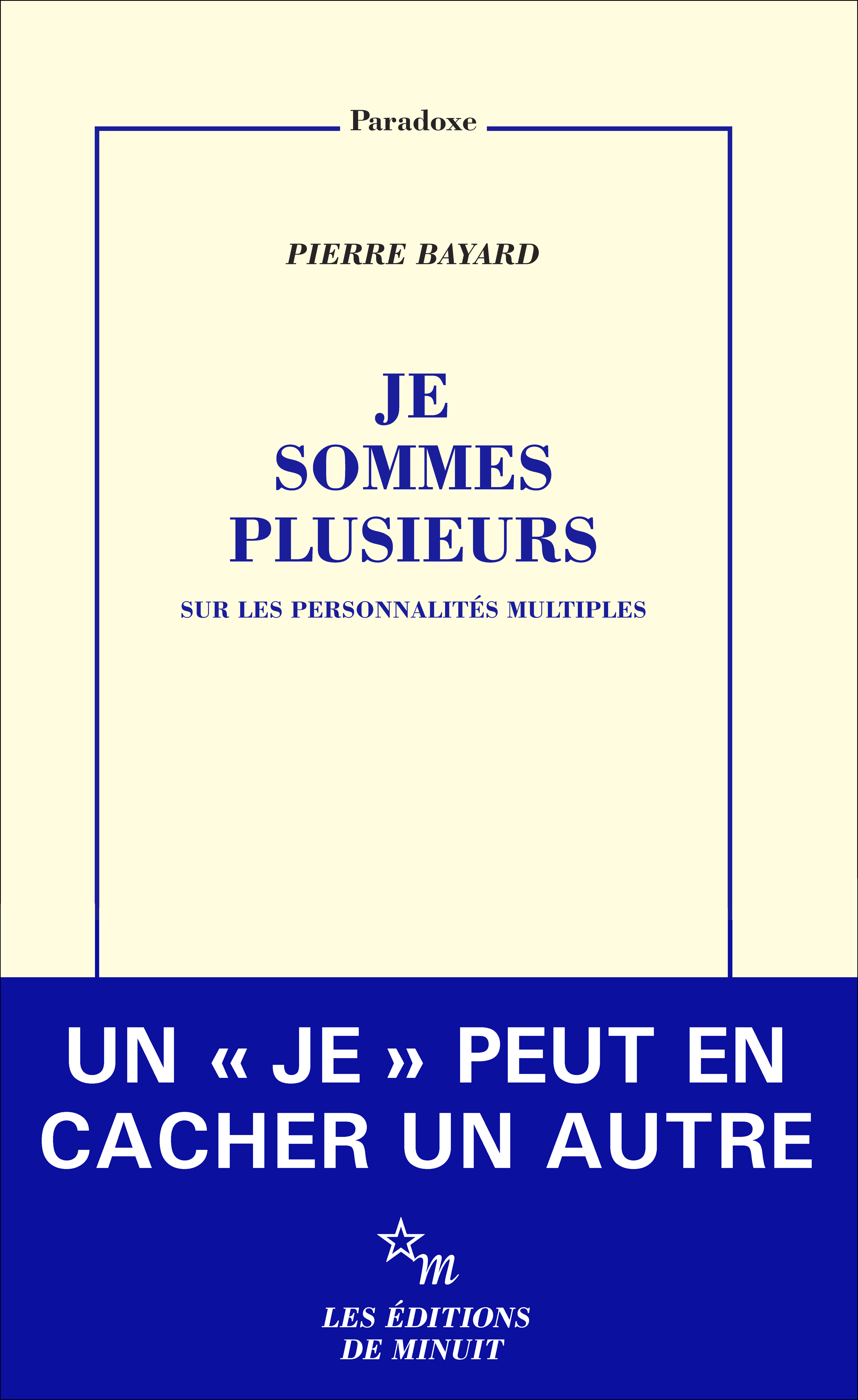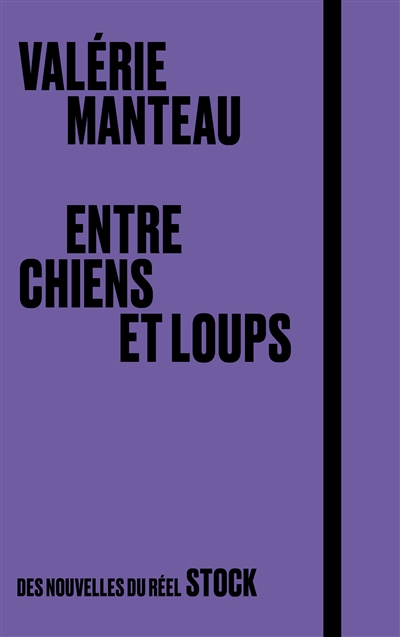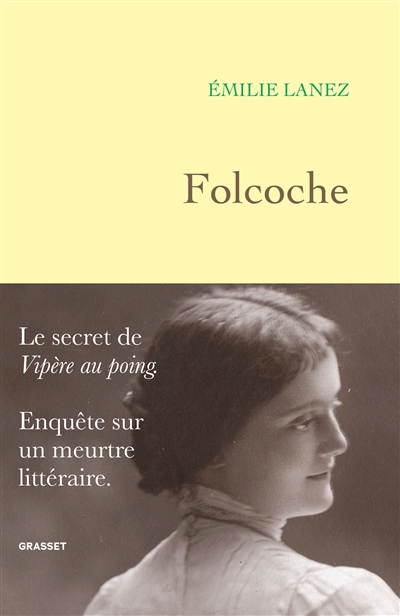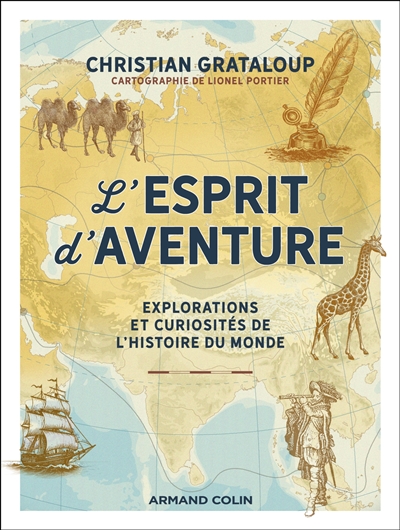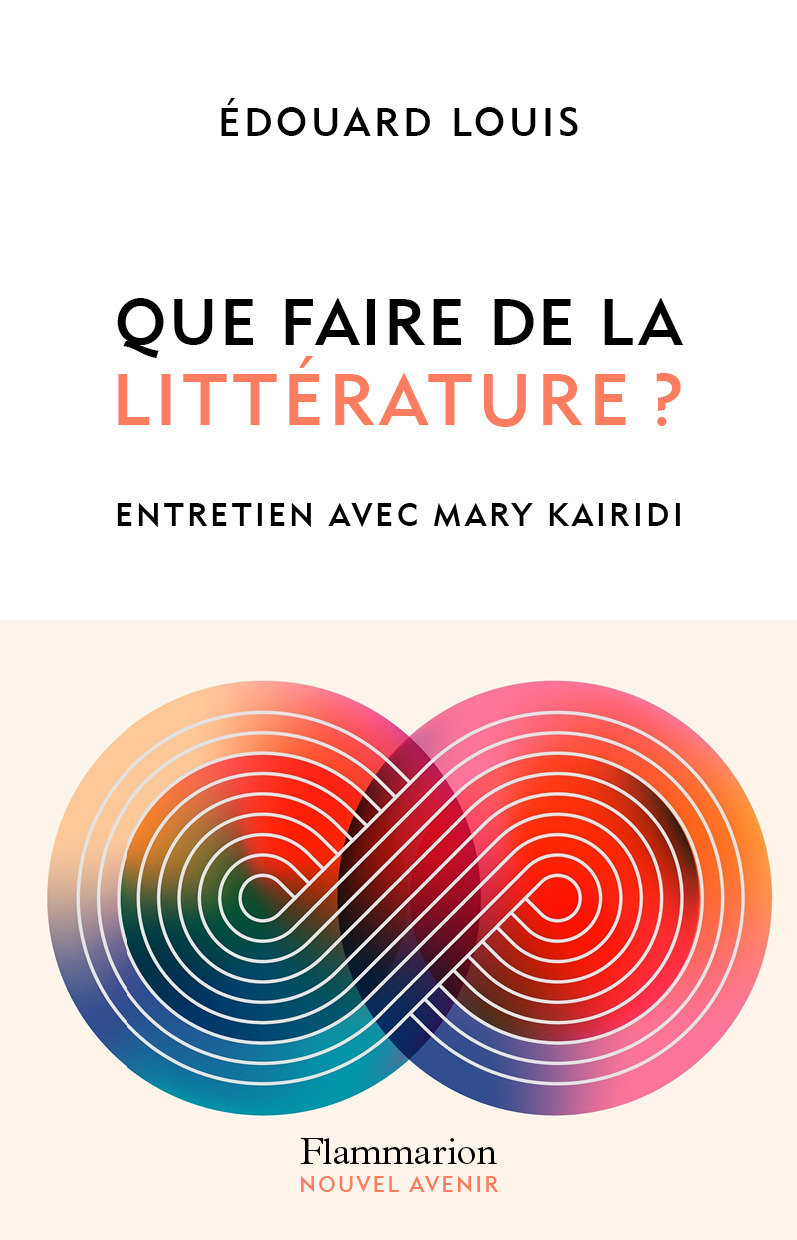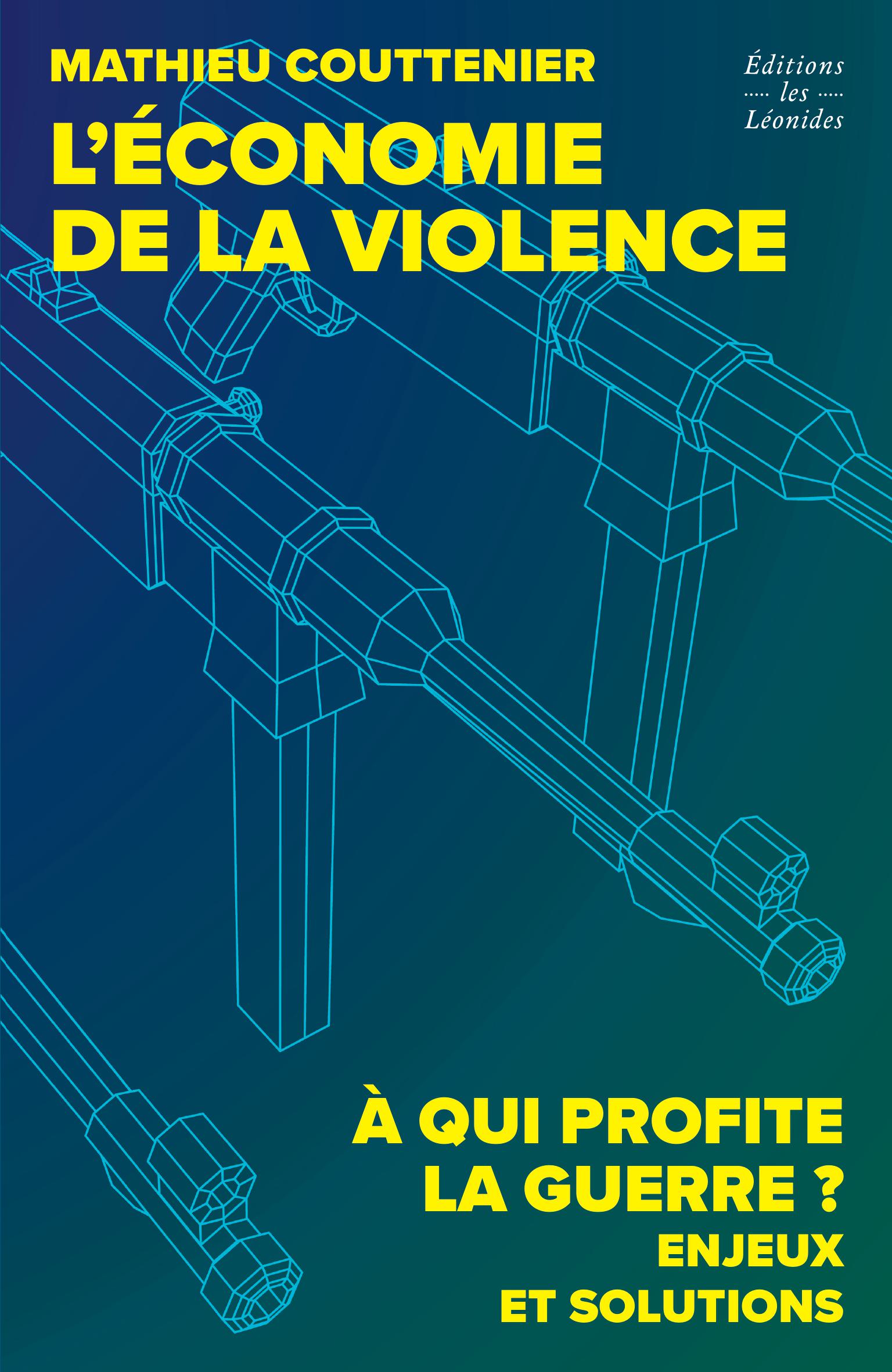Les animaux ont-ils conscience de la mort ? Une étude inattendue, passionnante et drôle aussi ! Un texte rigoureusement scientifique accompagné d'illustrations qui déroulent une pensée novatrice, sérieuse mais avec humour. Ce sujet sensible et touchant n'en devient que plus enthousiasmant !
Qu'est-ce que la thanatose ?
Emmanuelle Pouydebat – La thanatose, ou « faire le mort », est un comportement utilisé par de très nombreuses espèces, souvent pour tenter de survivre à un prédateur. Ce comportement consiste à s’immobiliser, parfois « simplement » sur le dos, parfois dans des positions extrêmes (contorsions, langue pendante, saignements, etc.). En prenant cette pause, la proie conduit le prédateur soit à se désintéresser d’elle (elle ne bouge plus), soit à croire qu’elle est non consommable car morte et donc potentiellement contagieuse !
Comment ce sujet est-il devenu un objet de recherche pour vous ?
E. P. – Je me suis rendue compte qu’il y avait de la plasticité comportementale derrière. Pour simplifier, la thanatose peut varier d’une espèce à l’autre, bien sûr, mais surtout d’un individu à l’autre au sein de la même espèce et pour un même individu selon le contexte. Par exemple, un hippocampe qui nage vite utilisera davantage la fuite. Un poisson pouvant bénéficier de cachettes dans son environnement se cachera. Une couleuvre qui est pleine, enceinte, utilisera la thanatose (elle est lente !) pendant qu’une jeune femelle fuira. En gros, ce qui me fascine, comme toujours, c’est la diversité ! Et les questions irrésolues derrière : y a-t-il des apprentissages qui se cachent derrière ces choix ?
Ce livre est écrit avec un dessinateur. Pourquoi ce choix et cette tonalité plutôt humoristique ?
E. P. – Écrire un livre sur la mort m’a au départ intuitivement repoussée. Je suis très sensible et j’avais peur que ce soit trop triste à écrire comme à lire. Mais c’est tellement passionnant ! Je me suis dit que ce serait dommage de ne pas l’écrire, que le sujet était fascinant. Il fallait cependant y mettre de la légèreté. J’ai donc essayé de laisser place à l’humour dans le texte et Arnaud Rafaelian a fait le reste, avec sa sensibilité et son sens du comique ! Le livre est sans doute parfois triste, mais il est profond et souvent très drôle. Un mélange d’émotions comme je les aime !
Une grande variété d'espèces sont convoquées : on comprend que chacune a ses pratiques. Comment éviter l'anthropomorphisme dans l'analyse ?
E. P. – On ne peut pas ! Je ne suis qu’une humaine malheureusement ! Comme Franz de Wall, je pense qu’il y a un anthropomorphisme acceptable et je préfère proposer des hypothèses positives plutôt que négatives comme « certaines espèces peuvent se laisser consciemment mourir » plutôt que « certaines espèces ne peuvent pas se laisser consciemment mourir ». La difficulté est de le prouver et avec quel protocole scientifique. Il faut être prudent quand on interprète les comportements mais aussi ouvrir le champ des possibles.
Pouvons-nous justement parler de pratiques culturelles ?
E. P. – Quelle question complexe ! Pour parler de pratiques culturelles, il faudrait que le comportement observé varie d’un groupe à l’autre pour la même espèce et qu’il se transmette socialement (apprentissage, observation, etc.) et de génération en génération. C’est donc très compliqué à démontrer. Chez les éléphants, par exemple, on sait que les comportements face aux cadavres varient selon les groupes et sont semble-t-il transmis. Certains s’approchent, d’autres touchent avec le pied, la trompe, d’autres restent immobiles des jours. Des collègues parlent de comportements ou de rituels proto-culturels.
La déontologie est au cœur de votre recherche. Comment peut-on faire pour observer le vivant sans trop le contraindre ?
E. P. – Vous touchez pour moi le problème essentiel, en particulier quand on s’intéresse aux comportements liés à la mort. À titre personnel, même si j’ai été scientifiquement fascinée par les comportements de certains insectes (papillons, fourmis, abeilles…), étudier expérimentalement la mort est très problématique puisque ça implique parfois de les mettre en situation de risque de mort. Reste la solution de les observer uniquement à distance dans leur milieu, en acceptant que la publication des données soit donc très longue. Car pour certains, voir une maman hippopotame, entre autres, remonter son bébé mort à la surface pendant des heures en espérant probablement qu’il respire de nouveau, est une anecdote non publiable. Pas simple.
Emmanuelle Pouydebat est de ces chercheuses consciencieuses et passionnées qui savent transmettre ! Ce livre est une pépite par l'originalité du sujet, ce qu'il nous apprend et l'éthique de sa démarche. Plus encore que découvrir si les animaux ont conscience ou non de la mort, il s'agit d'observer la science en train de progresser et cela est passionnant. Un texte qui doute, qui questionne, qui avance par hypothèses, loin des discours binaires et péremptoires qui obstruent plus la pensée qu'ils ne l'éclaircissent : ce travail est exemplaire. La déontologie n'enlève rien au plaisir de lecture car les auteurs ont su y mettre de l'humour, de l'intelligence avec un sens de la narration exquis !