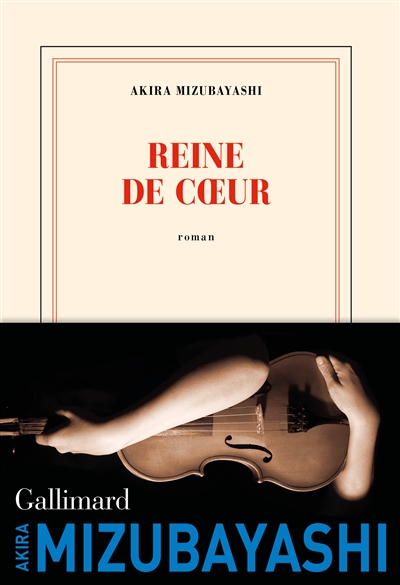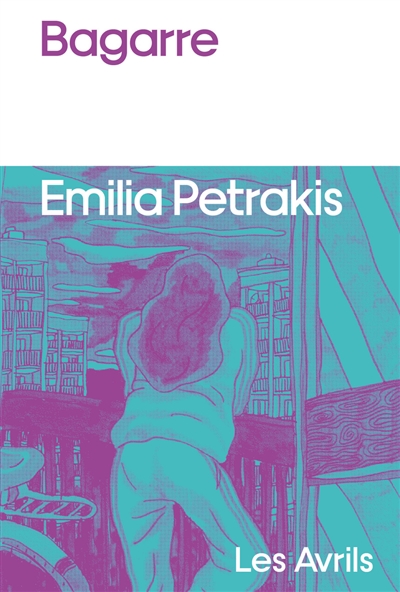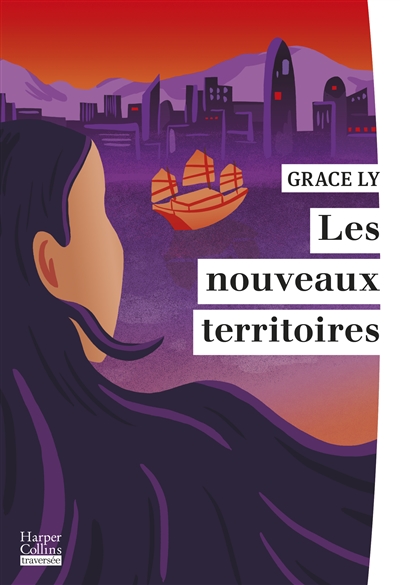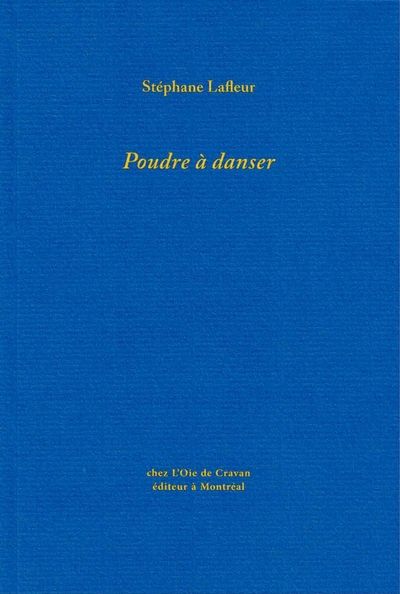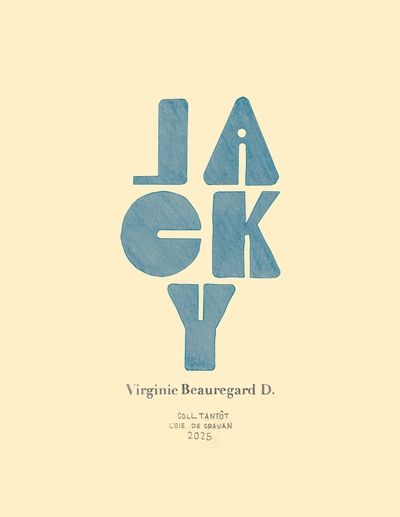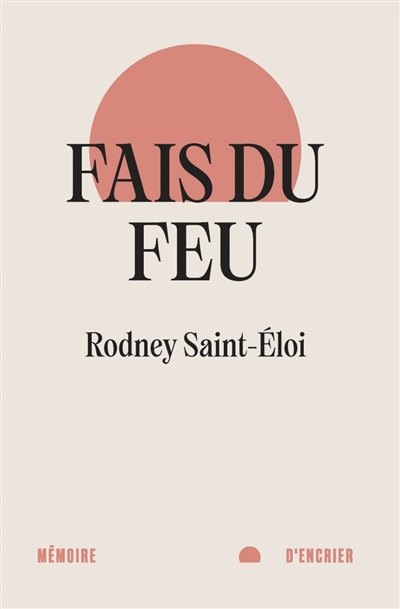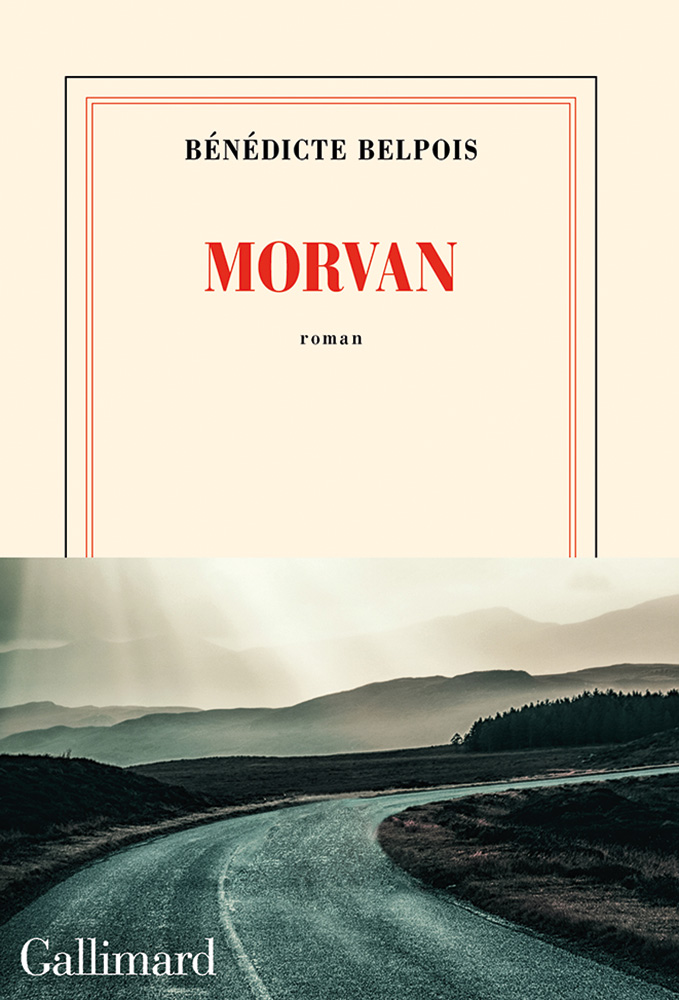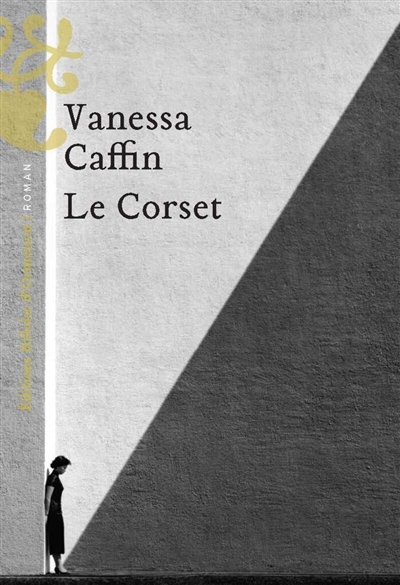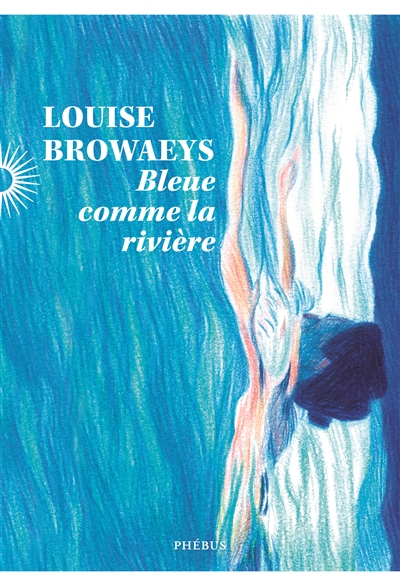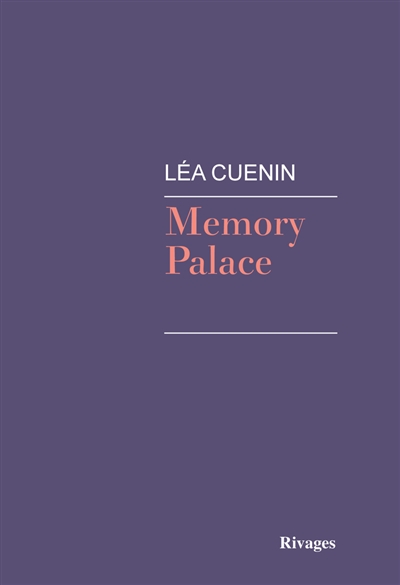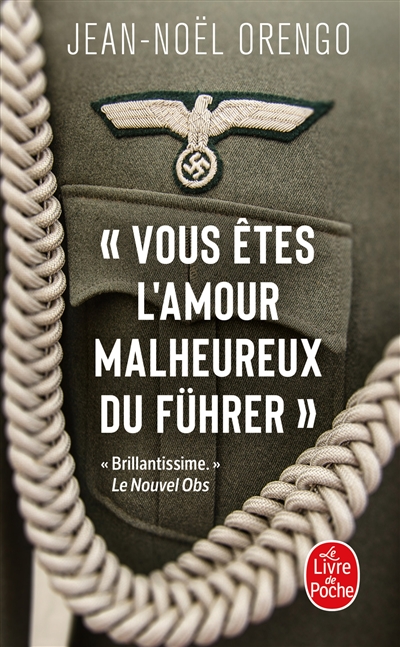Dans vos romans, les personnages se voient confisquer leurs vies par la folie belliciste de l’Histoire, surtout par la guerre de Quinze ans. En quoi cette guerre vous hante-t-elle tout particulièrement ?
Akira Mizubayashi - Né en 1951, je n’ai pas connu cette guerre. Mon père, oui. Né en 1913, il l’a vécue douloureusement parce qu’il a eu des expériences traumatisantes dans l’armée, comme Jun de Reine de cœur. J’ai forgé ce personnage en m’inspirant de l’image de Kaji, le héros de La Condition de l’homme de Masaki Kobayashi. Tourmenté à sa manière par la guerre, mon père s’identifiait à Kaji. On n’a pas obligé mon père à se livrer à des actes de violence aussi terrifiants que ceux qui conduisent Jun au suicide. Mais le trauma de la guerre fut suffisamment fort pour que mon père vive hanté par le souvenir torturant du fascisme militaire. La guerre de Quinze ans vit en moi ou je vis cette guerre par une sorte de procuration paternelle, d’autant plus que le Japon n’en a pas fini avec cette période désastreuse. Les révisionnistes, au pouvoir depuis longtemps, œuvrent désormais ostensiblement pour la mise à mort de la Constitution de 1947 afin de restaurer un régime politique centré sur l’institution impériale. Plus de 20 millions de morts en Asie, plus de 3 millions de Japonais tués dans une guerre menée au nom de l’empereur, ce n’est pas rien. Les bombardements massifs du 10 mars 1945 qui ont rasé Tokyo, les deux bombes atomiques qui ont anéanti dans l’instant d’innombrables vies... Je suis sûr que mon père n’a cessé de vivre jusqu’à la fin de ses jours avec tout un tas d’images qu’il a conservées de sa jeunesse meurtrie. Mon père nous a élevés, mon frère et moi, dans la détestation de cette guerre d’agression impériale. C’est cette éducation paternelle qui fait que cette guerre que je n’ai pas connue est perpétuellement présente dans mon esprit comme trace indélébile de la souffrance de mon père.
Pourquoi le choix du violon comme fil conducteur ?
A. M. - J’aime les instruments à cordes parce que ce sont les instruments du quatuor à cordes, genre que j’affectionne particulièrement. Les quatuors à cordes, de Haydn à Chostakovitch, sont incontestablement une des meilleures parts de la musique classique. Ce qui me plaît, c’est le fait que quatre musiciens constituent un ensemble dans lequel ils sont indissolublement liés. Chacun est à l’écoute des autres. Personne ne domine. Personne n'est soumis. Chacun assume pleinement sa part mais chacun n’existe que par rapport à l’ensemble. Ils sont égaux dans l’œuvre et devant l’œuvre. Je reprendrais volontiers l’expression de l’Abbé Sieyès à propos de la nation dans Qu’est-ce que le tiers état ? L’abbé révolutionnaire de 1789 dit que la nation est un corps d’associés. Je crois en effet que le quatuor à cordes est un corps d’associés. Et ce n’est pas un hasard, si le quatuor à cordes en tant que genre a pris naissance avec Haydn et a connu un essor remarquable à l’époque de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Au centre d’Âme brisée, il y a un violon. Un alto traverse Reine de cœur. J’aimerais bien raconter une histoire qui gravite autour d’un violoncelle !
Il y a dans vos écrits un échange constant entre les mots et la musique. Vous posez des mots sur elle mais elle accompagne aussi les moments forts de la narration. Est-ce une manière de s’ancrer dans l’émotion de l’instant ?
A. M. - Comme dans Âme brisée, j’ai souhaité que le concert final dans Reine de cœur soit le point de convergence des émotions. J’ai voulu mettre des mots sur cette musique extraordinaire qui dit la guerre. Mais, en arrivant à ce stade du récit, j’ai voulu aussi que la musique en tant qu’émotion pure remplace les mots. C’est ainsi que j’ai introduit le Salut d’amour d’Elgar comme réponse de Mizuné à la déclaration d’amour d’Otohiko. J’espère que les lecteurs se donneront la peine d’écouter sur YouTube cette admirable musique en même temps qu’Otohiko clique sur le fichier mp3 !
Les sentiments d’incertitude du présent et de solitude semblent habiter vos personnages.
A. M. - Comme le dit Kundera, le roman est une tentative d’exploration de l’existence. L’incertitude en est un élément important. Contrairement à ce qu’enseignent les religions, rien n’est sûr, rien n’est éternel. Notre existence est bâtie sur l’effritement constant du présent tendu vers la mort. La solitude est un autre élément essentiel de l’existence. Comme le dit Otohiko, chacun arrive au monde seul et s’en éloigne seul. D’où le désir de s’unir à autrui. D’où mon envie de raconter des histoires d’amour.
Croyez-vous comme dans vos romans à la capacité des nouvelles générations de réparer, recoller les morceaux du passé ?
A. M. - On n’y réussit pas toujours. C’est pourquoi il y a tant de fantômes dans le monde ! Mais l’Art est là. Pour moi, un des rôles essentiels de l’Art consiste à faire revenir les fantômes, comme le souligne Mizuné au sujet de la tentative littéraire d’Otohiko en invoquant la figure d’Orphée.
À propos du livre
Jun et Anna se sont rencontrés à Paris. Mais lorsque la guerre sino-japonaise se déclare en 1939, Jun est rappelé par l’armée et doit retourner au Japon. Ils ne se reverront pas. Ne restera qu’Agnès, fruit de leur amour. Les retrouvailles n'auront lieu que des décennies plus tard par le biais des générations suivantes : la fille d’Agnès reconnaîtra l’histoire de ses grands-parents dans le roman d’Otohiko, petit-fils de Jun issu de son mariage au Japon. Ensemble, ils vont parvenir peu à peu à recoller les morceaux éparpillés de leur vie et permettre ainsi à chaque voix de faire entendre sa mélodie, pour enfin pouvoir vibrer à l'unisson. Une narration d’une grande intensité lyrique.