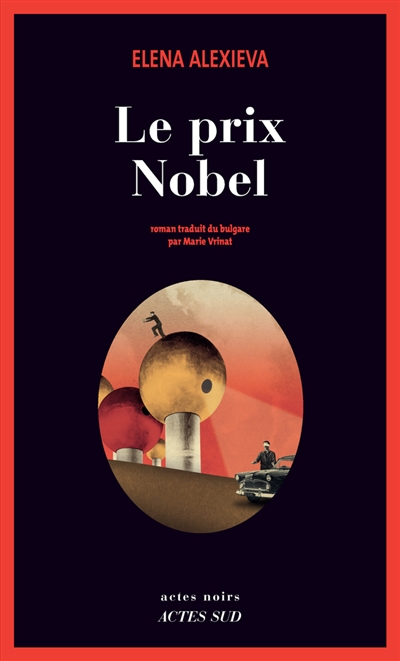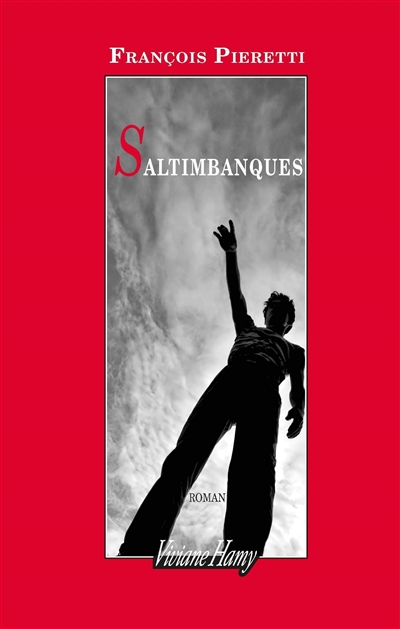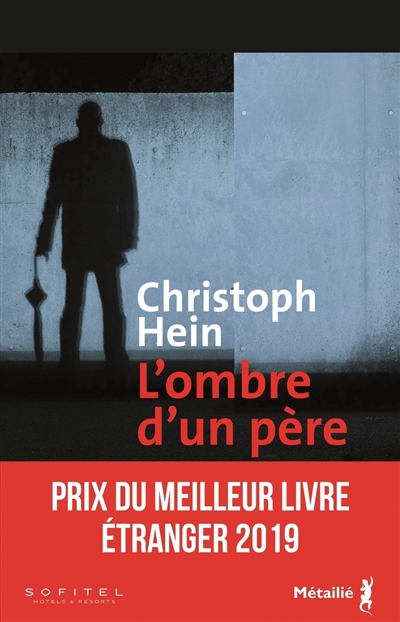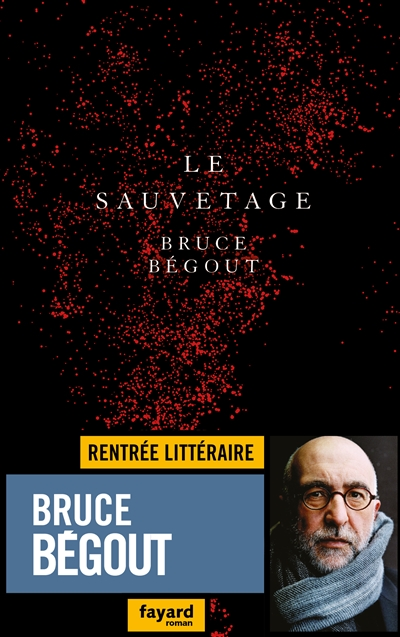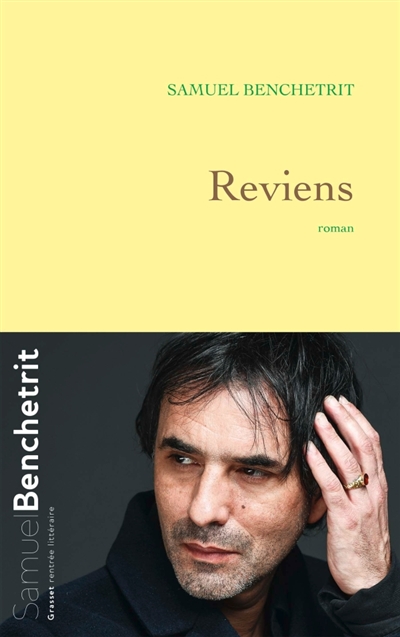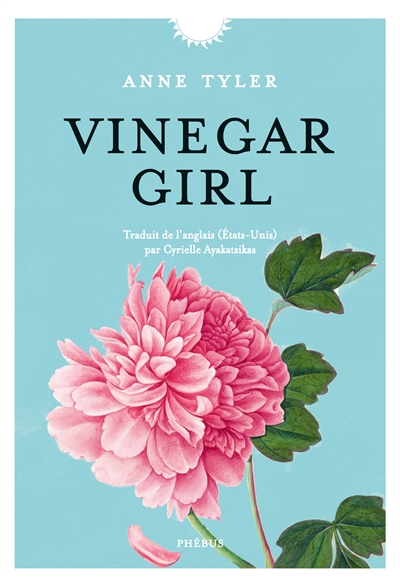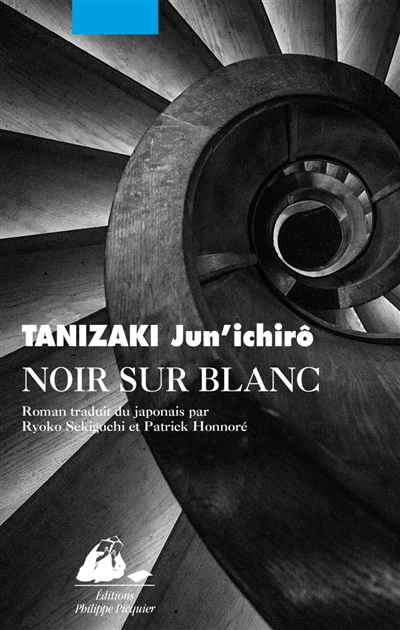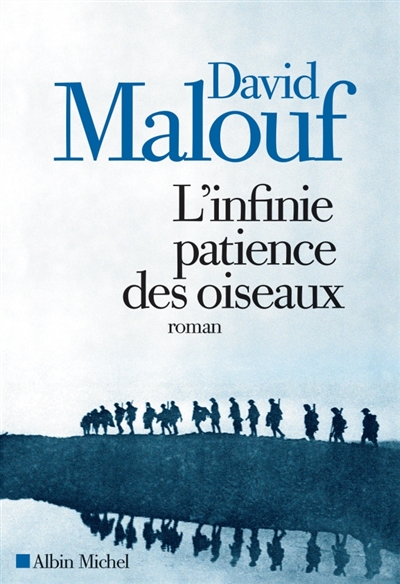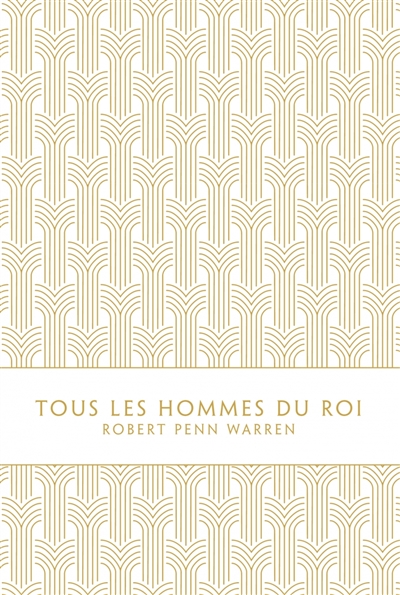Littérature étrangère
Sahar Delijani
Les Enfants du Jacaranda

-
Sahar Delijani
Les Enfants du Jacaranda
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pauline Miller-Fleuret
Le Livre de Poche
08/04/2015
360 pages, 7,10 €
-
Chronique de
Christophe Gilquin
Librairie L'Atelier (Paris)
✒ Christophe Gilquin
(Librairie L'Atelier, Paris)
Pour son premier roman, Sahar Delijani s’est inspirée de sa propre histoire. Les Enfants du jacaranda raconte, à travers différents destins, ces moments où le pouvoir iranien, de 1983 à 2009, montre un terrible visage, alors que des hommes et des femmes se battent pour la liberté.
Ils s’appellent Néda, Omid, Forugh, Sara, Sheida. Comme d’autres enfants de dissidents politiques nés au lendemain de la Révolution iranienne, ils ont vu leurs parents emprisonnés avant d’être élevés par des proches. Vingt ans plus tard, à la suite d’une élection présidentielle qu’elle juge frauduleuse, leur génération décide de se battre elle aussi contre la tyrannie, au risque de raviver d’anciennes blessures… À travers plusieurs voix, Les Enfants du jacaranda se déploie en une mosaïque d’émotions et révèle la cruauté d’un régime qui ne reculait devant rien pour briser ses opposants (les passages dans la prison d’Evin en sont les plus frappants). Et si Sahar Delijani rend compte de toute cette souffrance infligée, ce sont bel et bien les instants fulgurants où la joie, les rires et l’amour sont possibles, qui donnent toute sa force à ce livre poignant, véritable hymne à la jeunesse et à la liberté.
Page — L’Iran et votre histoire familiale sont les deux matrices de votre livre. Était-ce d’emblée une évidence d’écrire sur ces sujets ?
Sahar Delijani — Pas du tout. Quand j’ai décidé d’écrire, je travaillais sur beaucoup de thèmes, sauf sur mon histoire familiale. Celle-ci faisait si intimement partie de moi que je n’avais jamais pris le temps d’y réfléchir. Je n’avais donc jamais pensé à la raconter. Tout a commencé par hasard, lorsque j’ai retrouvé un petit bracelet de noyaux de dattes que mon père m’avait fabriqué en prison, après ma naissance. J’avais déjà vu ce bracelet plusieurs fois quand j’étais petite, mais je n’avais jamais pensé à l’histoire qui l’entourait. Cette fois, c’était comme si, tout à coup, quelque chose s’était réveillé en moi. J’ai demandé à mon père de me raconter quand et comment il avait fabriqué ce bracelet. J’ai su, alors, que je voulais non seulement raconter notre histoire familiale, mais surtout donner une voix à tous ces objets, toutes ces reliques de notre passé et du passé de mon pays.
Page — Il se dégage de votre roman un climat particulier, qui oscille entre « l’horreur et l’espoir », entre la peur (celle des arrestations, des bombardements), la souffrance et une furieuse envie d’être libre.
S. D. — Je voulais parler d’un pays aux prises avec l’horreur de la tyrannie, de la prison et de la guerre, mais je voulais également évoquer la façon dont les personnages tentent de garder leur dignité et leur humanité, y compris dans les moments les plus obscurs et les plus difficiles. Je souhaitais parler des répercussions de la dictature sur notre façon d’être, de vivre et de grandir, et surtout raconter comment on résiste à cette tyrannie et à cette horreur, jour après jour, comment la liberté et l’espoir demeurent vivants à l’intérieur de chacun.
Page — Vous accordez beaucoup de place aux femmes.
S. D. — J’ai toujours été entourée par des femmes : ma mère, ma grand-mère, mes tantes, les amies de prison de ma mère. D’aussi loin que je me souvienne, les femmes sont là, et plus particulièrement des femmes fortes et très déterminées, des femmes qui ont fait la révolution, qui ont été en prison, qui voulaient être heureuses. Cela ne me surprend pas, donc, qu’elles aient pris une place fondamentale, à la fois dans ma conscience et dans mon écriture.
Page — Cette période d’une rare violence semble avoir agi comme une onde de choc pour votre génération. Au point que, pour certains de vos personnages, ceux qui sont partis, il peut naître un sentiment de culpabilité, surtout au moment des manifestations de 2009.
S. D. — On ne peut jamais vraiment couper les liens avec son pays natal, ni tourner le dos au destin de son peuple, sans se sentir de quelque façon impliqué dans son Histoire. Le sentiment de culpabilité naît du fait d’être seulement un observateur passif, depuis son écran d’ordinateur ou de télévision, tandis que, par exemple, pendant les manifestations de 2009, des centaines de milliers de personnes descendaient dans la rue pour réclamer des droits et changer le cours de l’Histoire. On culpabilise en voyant ces manifestants frappés, battus, emprisonnés, parfois tués dans la rue par les balles des forces de sécurité, simplement parce qu’ils réclament des élections justes et libres, tandis que nous sommes là, derrière notre écran, à l’abri de nos appartements, dans un pays loin de toute cette violence. Quand on les regarde se faire frapper et traîner dans des fourgons de police, sans pouvoir leur fournir aucune aide, la culpabilité est forte. C’est ce double sentiment de passivité et d’inutilité face à l’Histoire qui explique, fondamentalement, pourquoi les personnages de ce roman se sentent coupables.
Page — Votre livre se découpe en épisodes, en tranches de vie. Pourquoi avoir choisi cette forme ?
S. D. — Tous les personnages sont liés par la même tragédie, celle de l’emprisonnement et des exécutions de masse des prisonniers politiques par le régime islamique dans les années 1980. Chaque fois qu’un nouveau personnage entre en scène, c’est comme si son histoire était dans la continuité de la vie du personnage qui le précède. Le parcours de chaque enfant est la continuation de celui de l’enfant d’avant. Je voulais ainsi donner un tableau plus complet de ce qui s’est passé en Iran pendant ces années-là, pas seulement pour une famille en particulier, mais pour une très grande partie de la société iranienne qui a souffert de la même violence et de la même persécution sans jamais pouvoir en parler.
Page — Il y a un élément récurrent dans le roman, c’est le jacaranda. Pourquoi cet arbre particulièrement ? Que symbolise-t-il ?
S. D. — Le jacaranda est une image utopique. C’est un arbre qui n’existe pas en Iran puisque c’est un arbre tropical. Il était pour moi le symbole de quelque chose de très beau, que tout le monde cherche à atteindre sans y parvenir. Cette idée m’est venue lorsque je pensais à la révolution iranienne et à ceux qui, comme mes parents, ont cru qu’elle allait les conduire à un monde plus beau, plus juste et plus libre. Ainsi les enfants du jacaranda sont les enfants de la révolution, et surtout les enfants des activistes qui ont cru dans le changement et y ont participé. L’arbre existe, cependant, car les idéaux aux noms desquels la révolution a été faite continuent d’exister. Ce sont peut-être les enfants qui poursuivront ce qui a été commencé par leurs parents.
Un livre d’auteur français contemporain
Je viens de lire le dernier roman de Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. De tous les romans que j’ai lus de Modiano, c’est celui qui m’a le plus touchée. On constate qu’encore aujourd’hui, à presque 70 ans, il est toujours hanté par ses souvenirs d’enfant, par le sentiment d’abandon et par la recherche de l’origine de son existence. Je trouve que Modiano traite de façon fascinante le sujet de la fugacité de la mémoire. Les personnages cherchent toujours quelque chose de leur passé dont ils semblent avoir conscience depuis toujours, mais qu’ils ne parviennent cependant pas à trouver, parce qu’il est déjà trop tard, et parce qu’on ne peut jamais vaincre la lutte contre le temps et l’oubli.