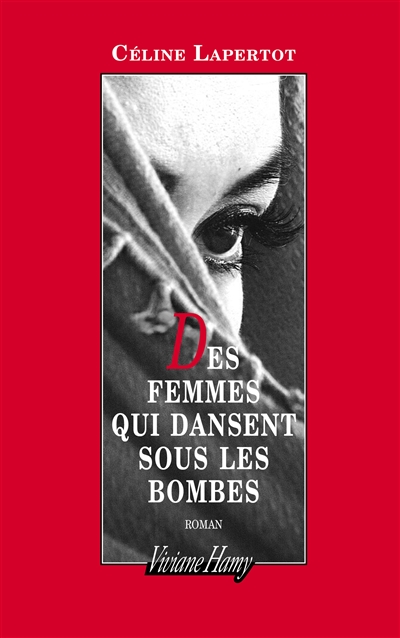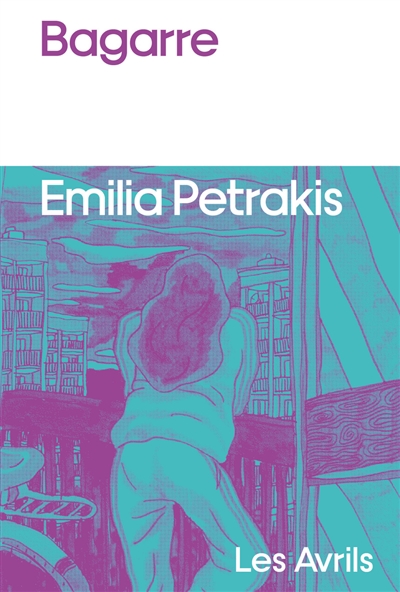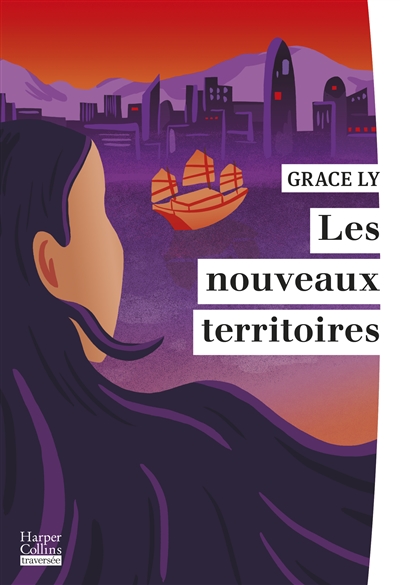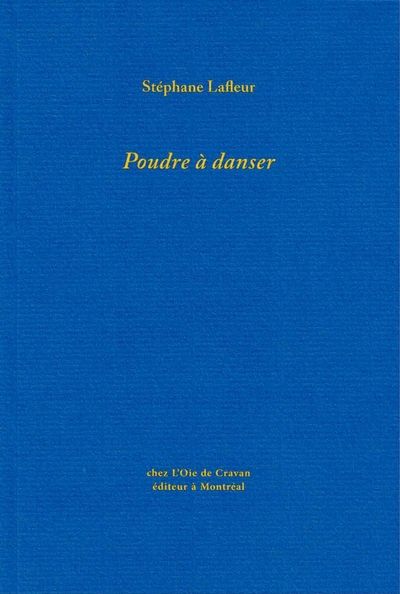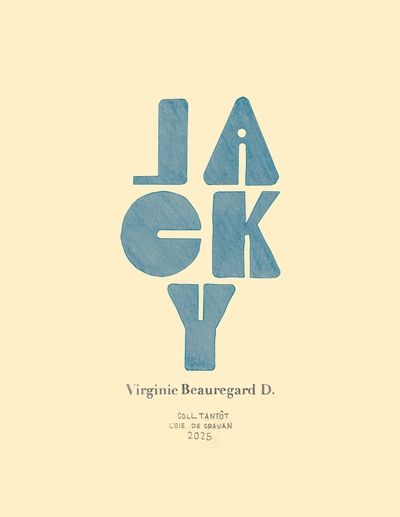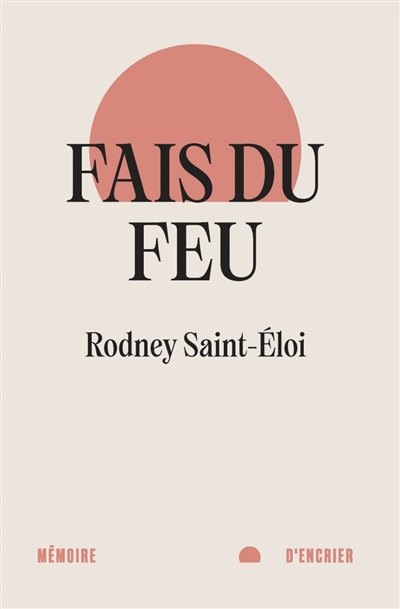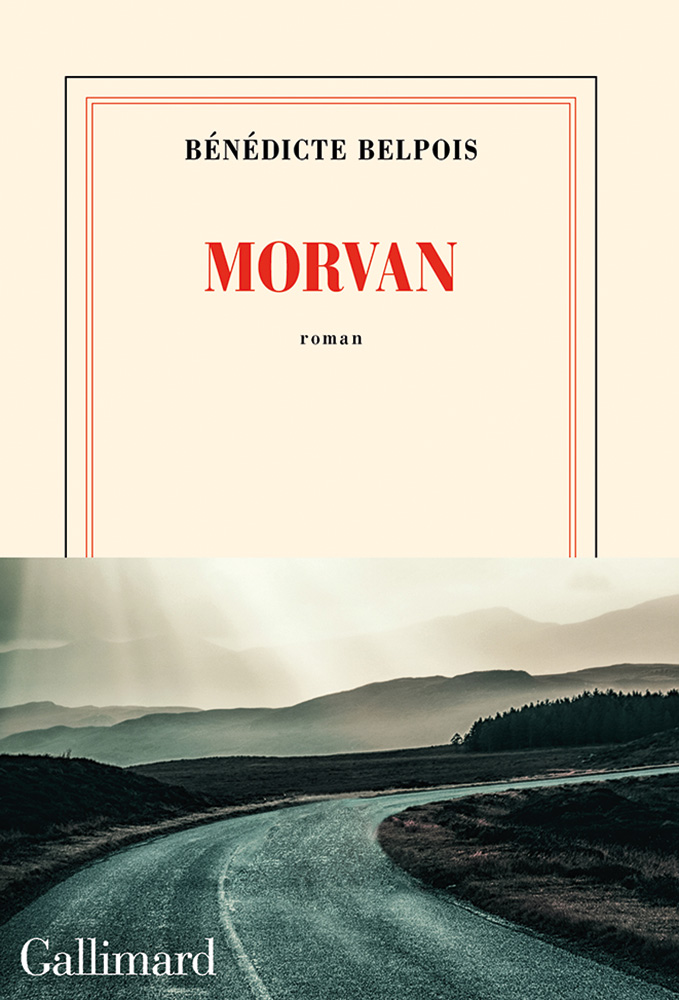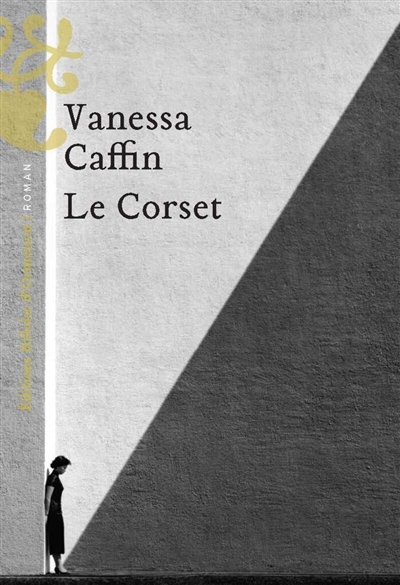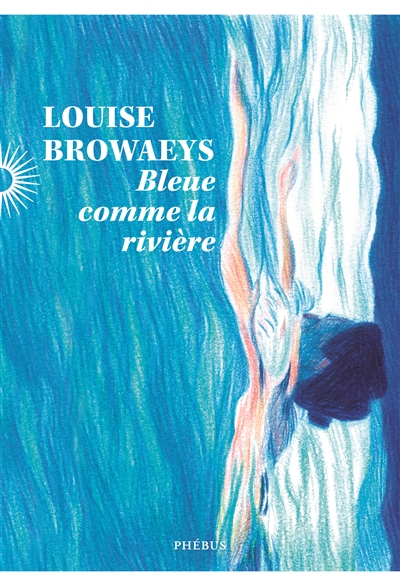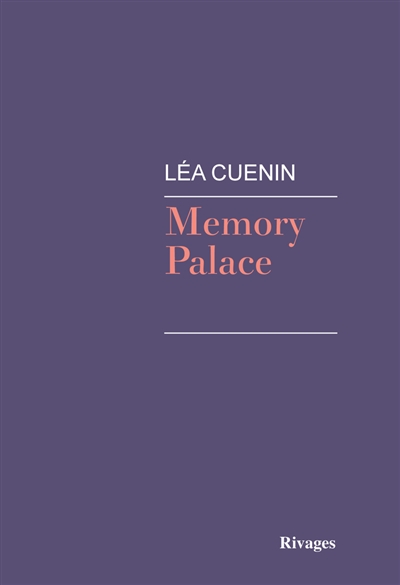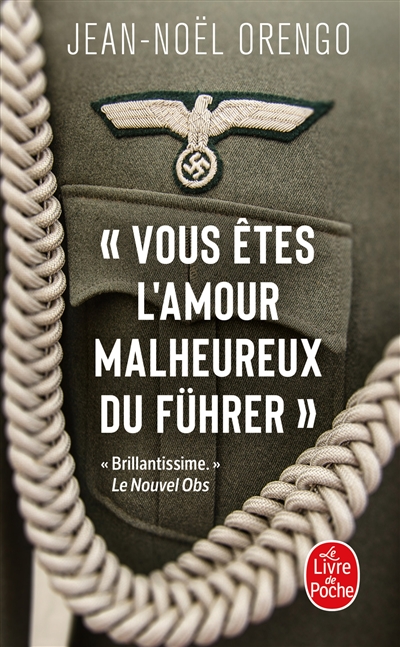« Quiconque tente d’éteindre ma lumière, je le tue. » « Quiconque brise une femme, je le tue. » Tels sont les mantras qui poussent chaque jour Séraphine à survivre et à résister, à se battre dans l’espoir de restaurer la paix et d’inventer un semblant d’avenir. Au fil des jours et des rencontres, la résistance se transmet d’une femme à l’autre comme autrefois les gestes simples d’un quotidien que l’horreur a balayé. Parce qu’elles découvrent que c’est possible : on peut refuser de vivre l’échine courbée, une terreur foudroyante rivée au cœur et au corps, on peut choisir de tout risquer si c’est pour ne plus être qu’une victime. Dès les premières pages de ce roman extraordinairement puissant, très minutieusement construit et magnifiquement écrit, vous marcherez dans la forêt avec Séraphine et ses sœurs de souffrance et de lutte, vous écouterez leurs voix dans la nuit du bivouac, vous étancherez les larmes qu’elles n’ont pas le temps de verser et vous ne les oublierez plus.
Page — Quand le lecteur ouvre Des femmes qui dansent sous les bombes, il est projeté quelque part en Afrique, dans un pays en proie à une guerre civile, aux côtés de Séraphine. Comment vous est venue l’envie, l’urgence de raconter cette histoire, de cheminer avec ces personnages ?
Céline Lapertot — Cette histoire est venue de la conjonction de deux choses essentielles : l’envie d’explorer encore une fois avec un regard un peu différent le thème de la violence faite aux femmes, dans un autre continent pour en définir les contours, mais aussi l’envie de prouver que je suis bien un auteur de fiction, puisque beaucoup de lecteurs avaient pensé que Charlotte (personnage de mon premier roman, Et je prendrai tout ce qu’il y a à prendre, Viviane Hamy), c’était moi. C’est une manière d’explorer un peu plus profondément mon fil rouge. J’ai effectué quelques recherches sur le statut des femmes en Afrique, notamment celui des femmes guerrières. Mais le plus gros du travail a été surtout de « devenir » Séraphine, Blandine, Mélusine, de m’incarner en elles et de faire mienne leur douleur. C’est un rôle de composition au même titre que celui des comédiens.
Page — Vous avez choisi un dispositif narratif assez singulier avec un personnage invisible, récepteur de différents témoignages. Pouvez-vous nous expliquer quel est l’enjeu d’un tel type de narration ?
C. L. — À mon sens, pour que la parole de ces femmes soit entendue de manière efficace, il fallait que le narrateur soit le plus en retrait possible. Je voulais une présence douce qui permettait le passage au « je » ; une sorte de plongée plus profonde encore dans l’intime de ces femmes. Mais pour ce faire, le narrateur devait être une ombre aussi discrète que possible, une sorte de médium qui n’est là que pour mettre l’autre en avant.
Page — Il y a plusieurs « je » qui se succèdent, s’entrecroisent, se répondent. En quoi était-ce si important pour vous que chaque personnage puisse dire sa vérité ?
C. L. — Il s’agissait avant tout de donner un peu de relief à mon narrateur qui est un journaliste, même si ce journaliste est dans l’ombre. La variation des points de vue pouvait donner l’effet d’une courte interview de chacun des protagonistes. C’est ce qui permettait aussi d’alterner le « elle » et le « je » pour varier les procédés d’écriture et rendre les interventions parfois plus poétiques.
Page — On l’a dit, les femmes sont le cœur battant du roman. On croise pourtant quelques personnages masculins (le docteur Basonga, ou Kadhi) qui, outre leur rôle dans l’histoire, ont une fonction symbolique. Comment avez-vous pensé puis incarné ces hommes ?
C. L. — À dire vrai, je n’ai pas cherché à les incarner. Ils sont venus à moi et je les ai suivis. La construction est de l’ordre de l’élaboration, mais dans l’écriture, l’instinct joue beaucoup. Pour faire « parler » ces hommes, j’ai surtout laissé parler mon instinct.
Page — Des femmes qui dansent sous les bombes est un roman sur la résistance, la résilience, la force des femmes. Diriez-vous que c’est un roman engagé, féministe ?
C. L. — Sans aucun doute. L’écriture est une forme d’engagement, tout romancier a à cœur de percuter, de laisser le lecteur dans un état de réflexion. Il est féministe dans le sens où j’aime écrire la femme confrontée à la violence et qui possède bon gré mal gré les clefs pour s’en sortir. Plus que jamais, partout dans le monde, les femmes ont besoin d’entendre qu’elles ne sont pas seules.