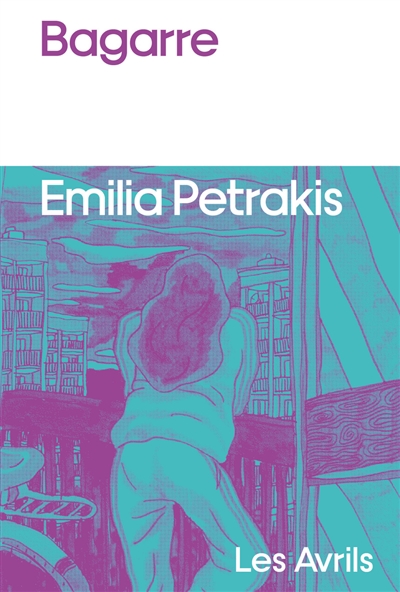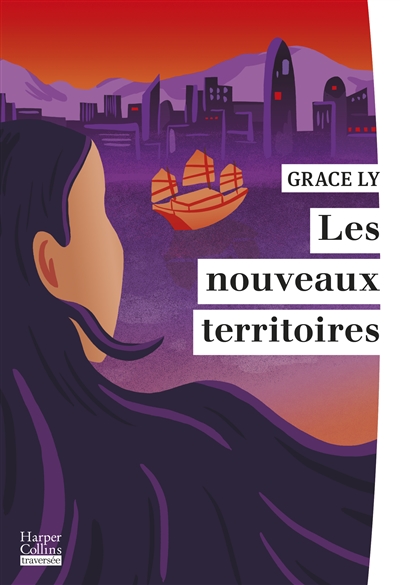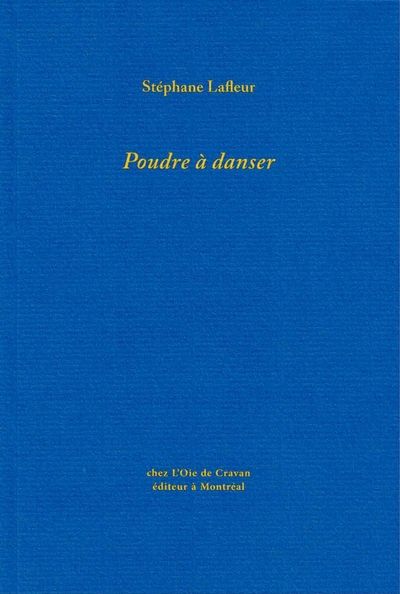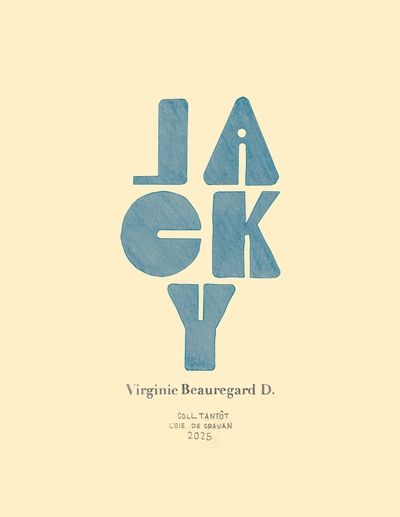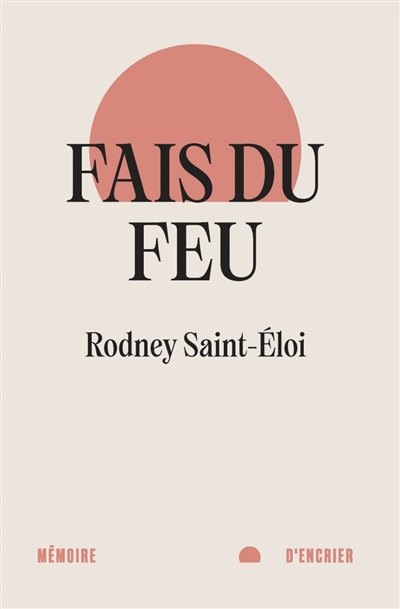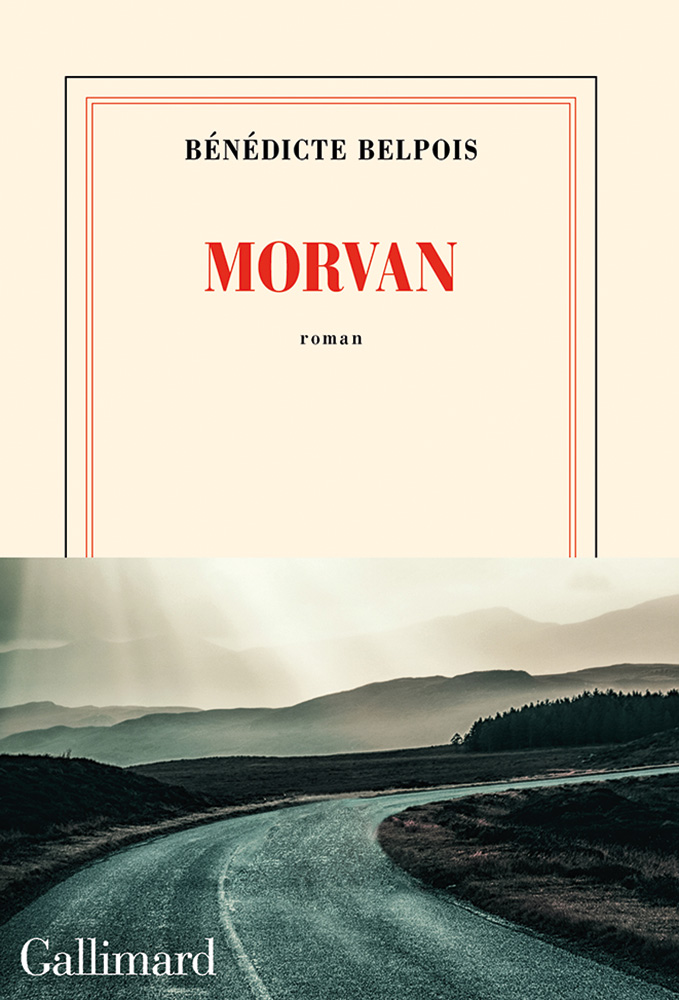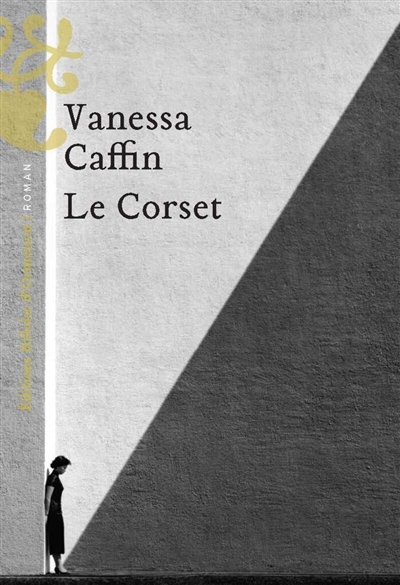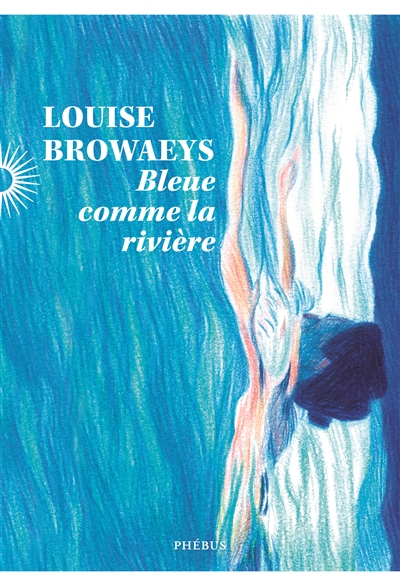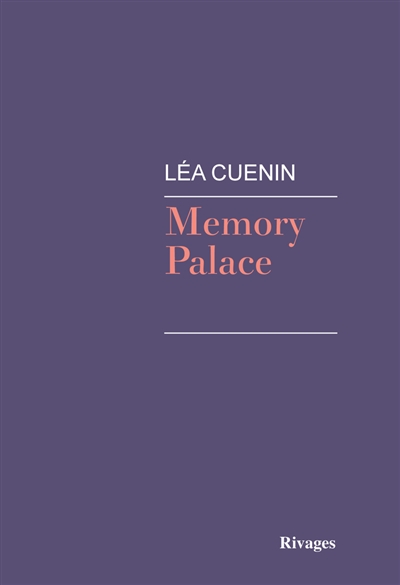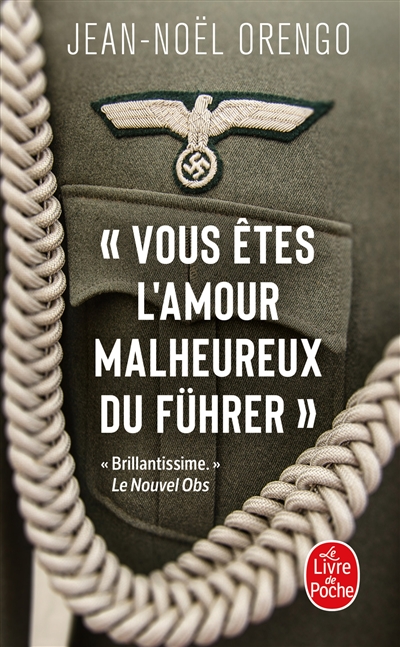Votre ouvrage est merveilleusement intitulé Les Désorientés. Un joli mot, un mot qui, spontanément, évoque un sentiment que tout le monde connaît et expérimente au cours de sa vie : la désorientation physique ou psychologique… En ouvrant le Littré, j’ai découvert que le premier sens du terme était « déconcerté ». Vos personnages sont en effet déconcertés, et sans doute aussi égarés dans un monde qu’ils n’avaient pas imaginé lorsqu’ils avaient 20 ans. C’est aussi un cri d’amour déchirant pour ce pays que vous continuez à ne pas nommer, du moins dans vos fictions. J’ai l’impression que vous avez écrit un roman qui venait de loin, que celui-ci était peut-être plus intime et plus ouvertement douloureux que les précédents. Qui sont ces désorientés et viennent-ils, comme j’en ai émis l’hypothèse, du plus profond de vous-même ?
Amin Maalouf — C’est vrai que ce roman vient de loin. Les Désorientés évoque ma jeunesse, une période de ma vie dont je n’avais jusqu’à maintenant jamais su parler, dont je m’étais toutefois souvent demandé comment l’aborder. J’ai une fois eu envie de lui consacrer un livre, mais j’ai renoncé, au dernier moment, happé par d’autres sujets. Je ne saurais dire exactement pourquoi j’ai décidé d’y venir aujourd’hui. Il semble que vient toujours un instant, dans le parcours d’un individu, où l’on éprouve le besoin de dresser le bilan de ses rêves de jeunesse. J’ai évidemment beaucoup de nostalgie pour le pays que j’ai quitté et pour cette époque de ma jeunesse. Il s’agit dans mon cas d’une double nostalgie, mais je suppose que chacun d’entre nous ressent quelque chose de singulier à l’égard de la période de ses 20 ans. Cependant, pour ceux qui viennent du Liban, le sentiment de perte est double : le pays que l’on a connu et celui que l’on a rêvé à 20 ans, tous deux ont disparu dans la guerre. J’ai voulu raconter cette période sans me mettre directement en scène. Mon esprit fourmille de personnages, mais aucun, dans le roman, ne correspond à une personne réelle. J’ai l’impression d’avoir recomposé mes personnages à partir d’une multitude d’éléments piochés parmi les gens que j’ai connus. Adam, le narrateur, n’est pas tout à fait moi, pas davantage que les personnages qu’il croise au cours du roman ne sont d’anciens camarades. Adam est un professeur d’Histoire qui a quitté le Liban pour la France vingt ans plus tôt. Il reçoit un jour un coup de téléphone d’un vieil ami avec lequel il s’était brouillé bien des années plus tôt. Sa voix est dramatiquement faible, il est sur le point de mourir et, avant d’expirer, il a souhaité renouer avec Adam. Ce dernier décide de partir le soir même et de prendre le premier avion pour ce pays que je ne nomme pas, vous avez raison, mais dont on devine assez vite qu’il est le Liban. Hélas, cet ami meurt au cours de la nuit, les retrouvailles ne peuvent avoir lieu. En revanche, elles ont lieu avec le pays délaissé deux décennies plus tôt. Adam replonge dans ce pays après une longue absence, il renoue avec les personnes qu’il a connues, espérant les voir, pour la dernière fois peut-être. Alors il découvre ce qu’ont été leur vie, les trajectoires qui, pour certains d’entre eux, les ont menés aux quatre coins de la planète, leurs itinéraires professionnels, politiques, amoureux… Il y a des personnages qui sont restés fidèles à eux-mêmes, d’autres qui ont abandonné leurs convictions. Voilà un peu ce que raconte Les Désorientés. Le titre s’est imposé à moi au cours de l’écriture. C’est vrai, il renvoie à quelqu’un de déboussolé, mais aussi à celui qui a perdu l’Orient.
L’écriture comme rempart à l’oubli ? Est-ce que vous êtes entré en écriture pour cette raison ?
A. M. — Je pense que l’on décide toujours d’écrire à la suite d’une blessure. Quitter un pays, c’est faire l’épreuve de la perte et de la douleur. L’essence de la littérature, c’est de restituer la mémoire, et il me semble que le titre du cycle proustien constitue un peu l’emblème de la littérature. On est toujours à la recherche du temps perdu, et c’est la fonction de la littérature de le reproduire, de lui offrir la possibilité de revivre, de lui rendre existence et dignité.
Votre livre est empreint de gravité, d’émotion, de réflexion, mais il est aussi émaillé de passages drôles et piquants. Je pense notamment à cet épisode qui raconte l’histoire d’amour, ou plutôt de tendresse amoureuse, entre Adam de retour au Liban et Sémiramis qui n’en est jamais partie.
A. M. — Dès qu’il repose le pied au Liban, Adam voit remonter en lui le souvenir d’une frustration amoureuse. Il avait 16 ou 17 ans et aimait en secret une jeune fille à laquelle il n’avait jamais osé avouer son amour. Le temps a passé et, pourtant, cette espèce de frustration a résisté au temps, de son côté comme de celui de Sémiramis. Cela donne lieu à un passage qui constitue probablement l’un des nœuds de ce roman. Sans vouloir débattre du problème de ce qui appartient au domaine du souvenir et de ce qui relève de la fiction, je dois dire que beaucoup d’éléments de cette histoire étaient éparpillés dans ma mémoire et constituent une part de mon expérience personnelle. Ces éléments, je les ai agencés autrement pour raconter une histoire.
Vous êtes reçu sous la Coupole, vous devenez immortel au fauteuil numéro 29, celui qu’occupait Claude Lévi-Strauss. Qu’aurait pensé le petit garçon, le jeune homme libanais qui parlait arabe à la maison et dans la rue si on lui avait annoncé qu’il aurait ce fabuleux destin intellectuel et littéraire ?
A. M. — Cette réception à l’Académie française est pour moi la perspective d’un immense moment d’émotion. Je ne sais pas comment je serai dans dix jours, mais j’ai toujours éprouvé une admiration considérable pour Claude Lévi-Strauss, non seulement en tant que lecteur, mais aussi parce que, quand j’étais étudiant en sociologie, sa pensée irriguait le milieu universitaire et influait sur nos lectures. Lui succéder sous la Coupole me procure une émotion supplémentaire. Rien dans mon parcours ne me prédestinait à me retrouver en France ou à écrire en français. Pour tout vous dire, avant de quitter le Liban en 1976, peut-être même deux semaines avant de boucler mes bagages, j’étais convaincu que je passerai ma vie dans ce pays. Puis la guerre a éclaté. J’ai compris qu’il n’y avait, au milieu de ce désastre, aucun avenir pour moi. Je venais d’une famille de langue arabe – bien sûr – et qui était plutôt de culture anglaise. Tout le monde au sein de ma famille avait étudié dans des écoles et des universités anglophones. Je me suis retrouvé en France parce que j’aime cette langue. Je l’aime de plus en plus au fur et à mesure que je la pratique. Les choses ont pris un tour que je n’avais pas prévu. C’est une sorte de divine surprise.
Littérature française
Amin Maalouf
« Le chant de la dernière fois »
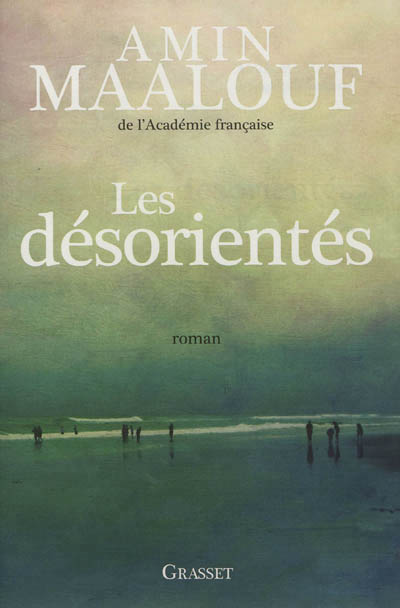
-
Amin Maalouf
Les Désorientés
Grasset
05/09/2012
544 pages, 21,90 €
-
L'entretien par
Véronique Marchand
Librairie Le Failler (Rennes) - ❤ Lu et conseillé par 17 libraire(s)
VM
Entretien par Véronique Marchand
(Librairie Le Failler, Rennes)
Trente-cinq ans après l’avoir quitté précipitamment, Amin Maalouf ne peut toujours pas se résoudre à écrire le nom de son pays natal. Il a en lui un amour intact pour le Liban, une souffrance toujours vive et une grande nostalgie pour sa jeunesse dont il n’avait peut-être jamais aussi bien parlé que dans ce roman.