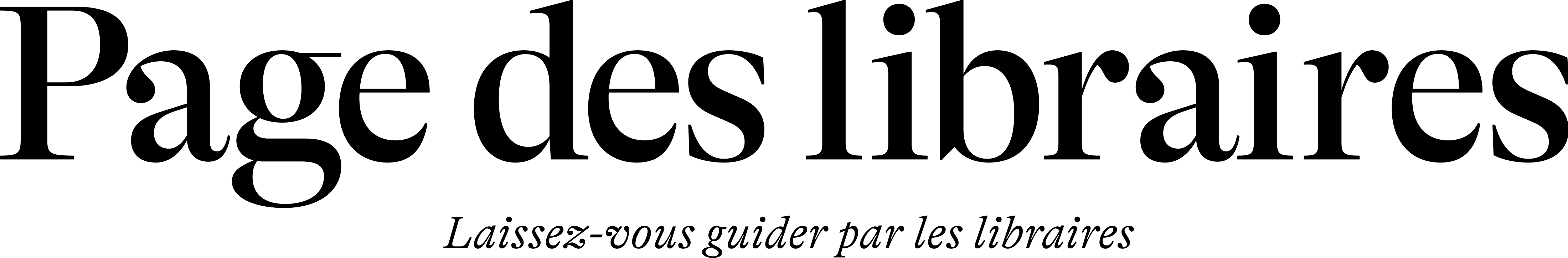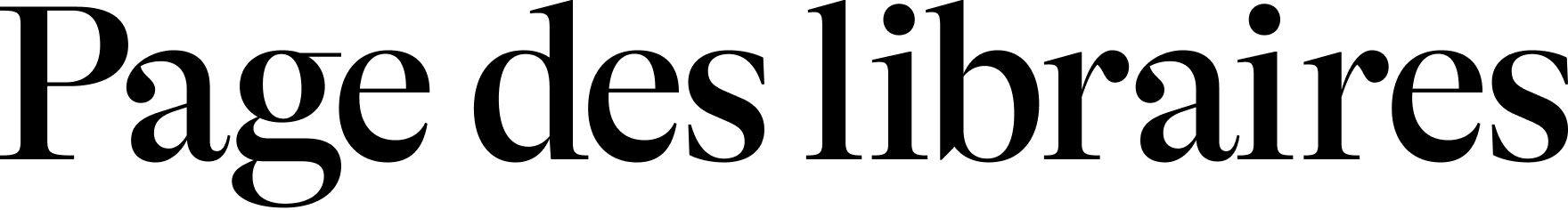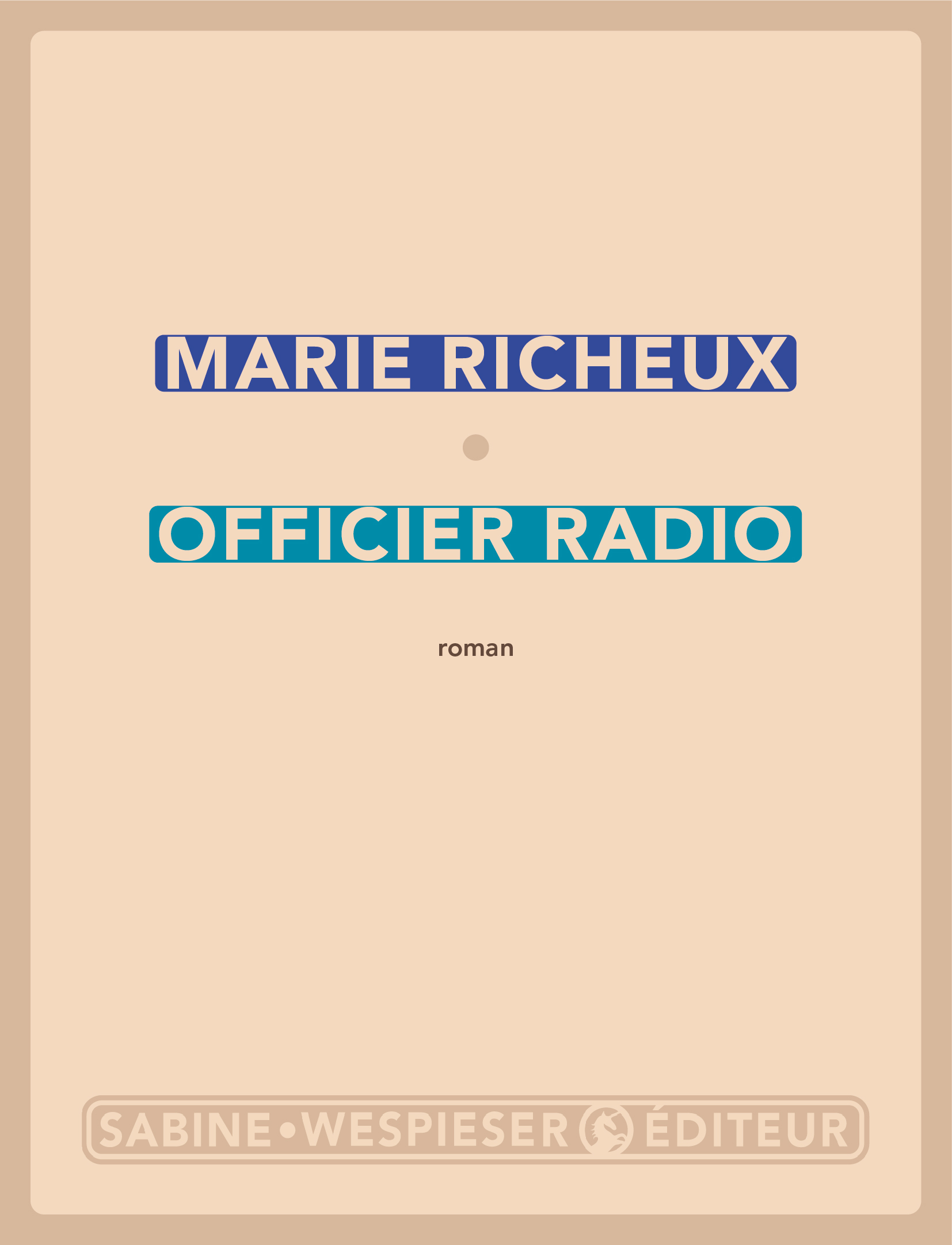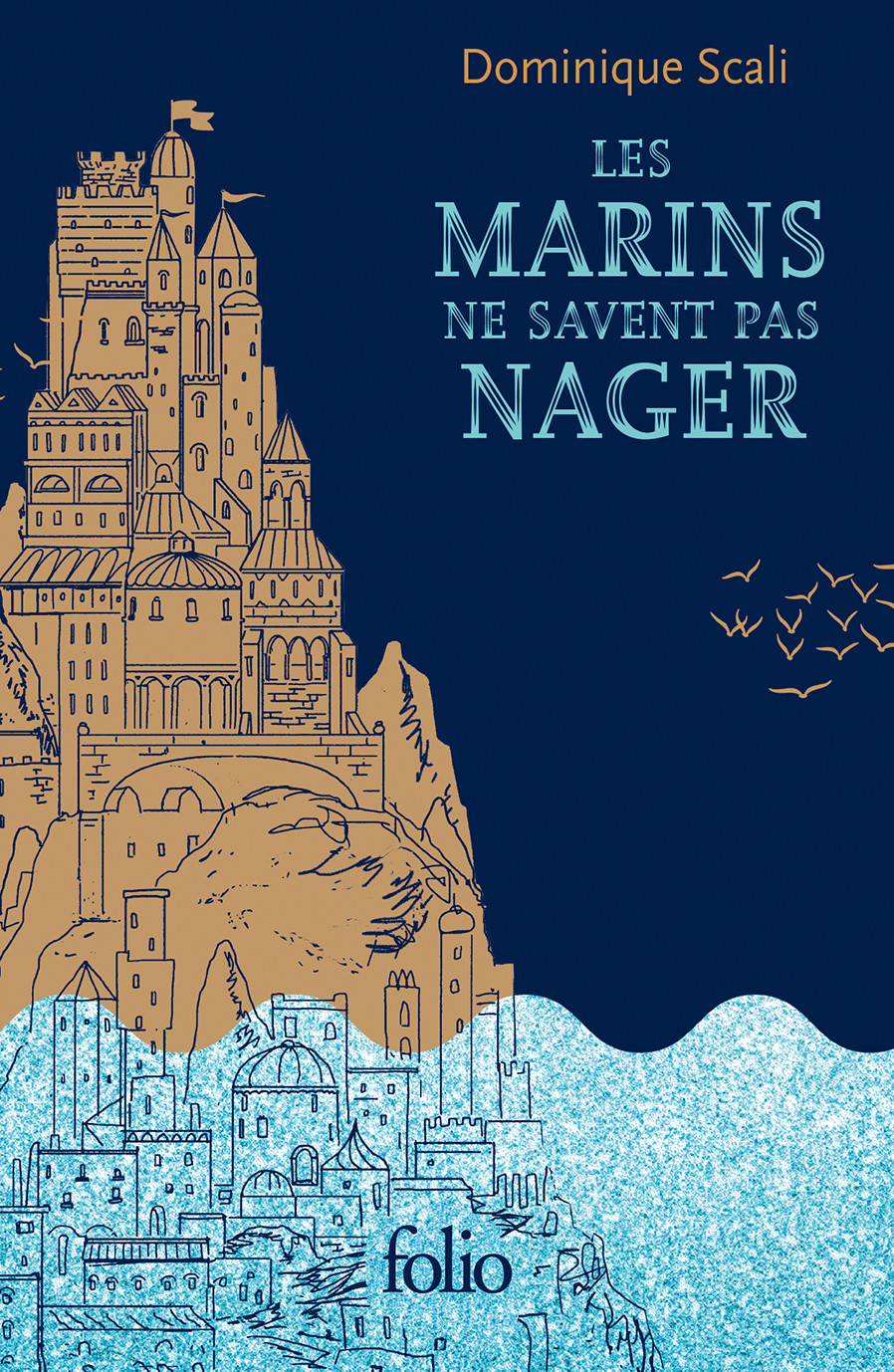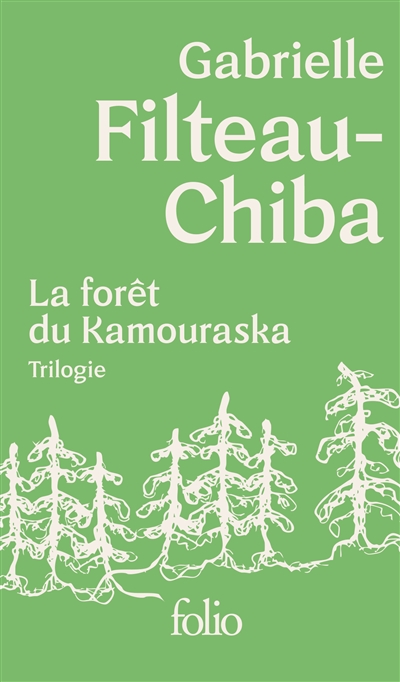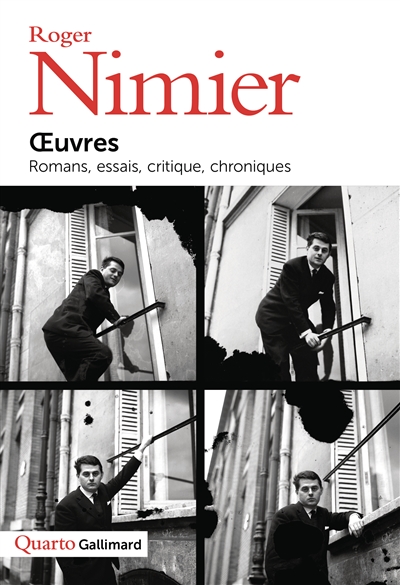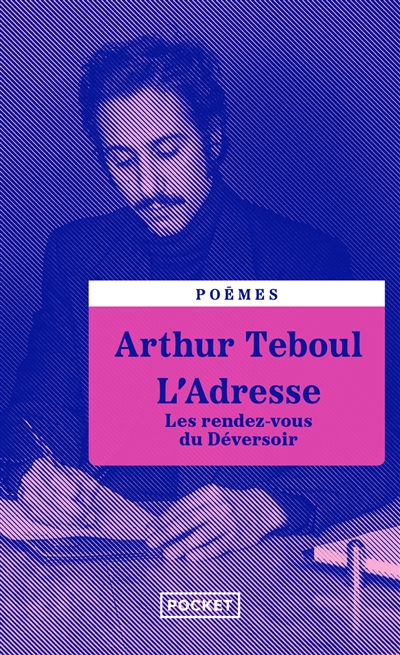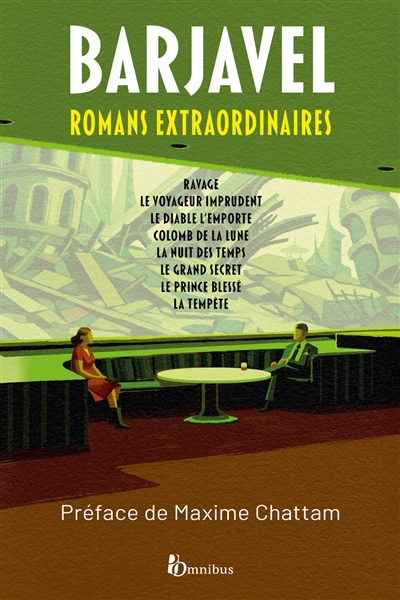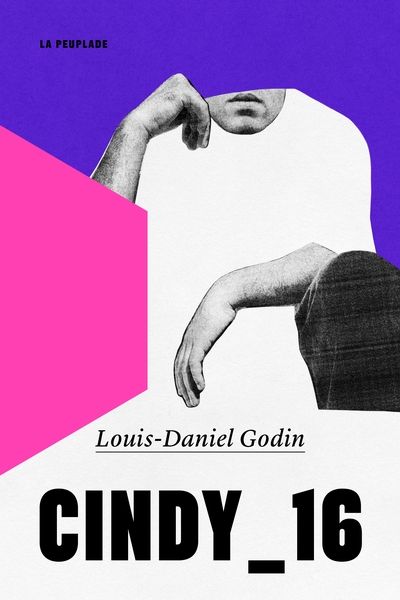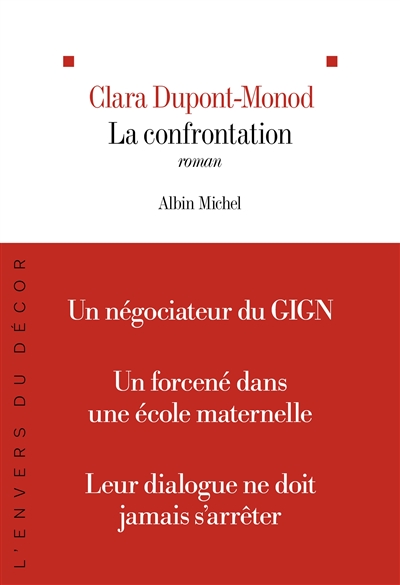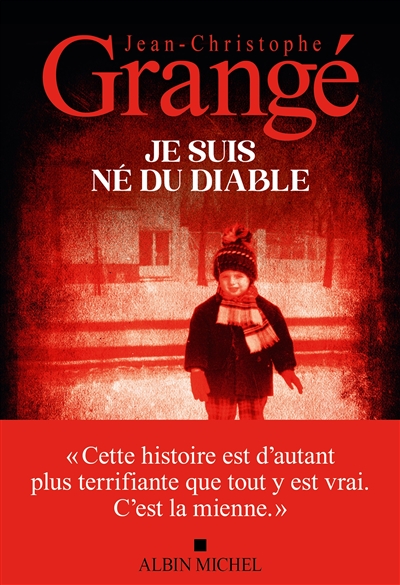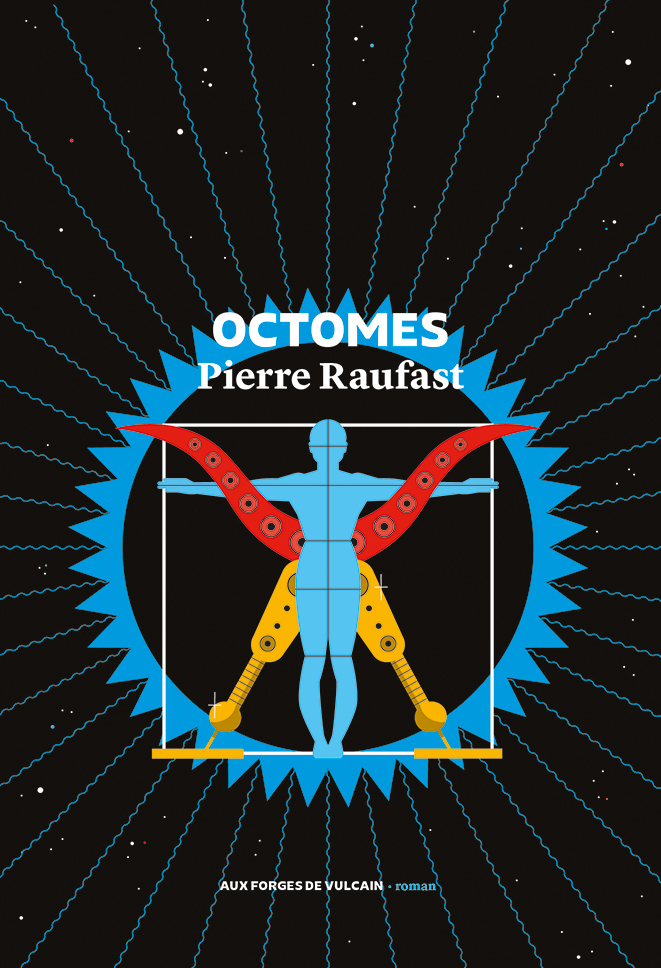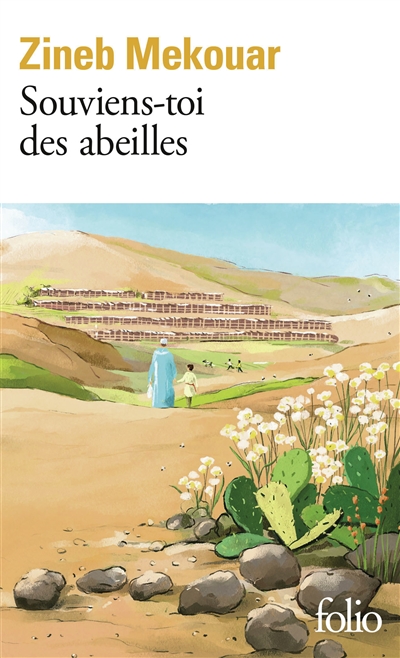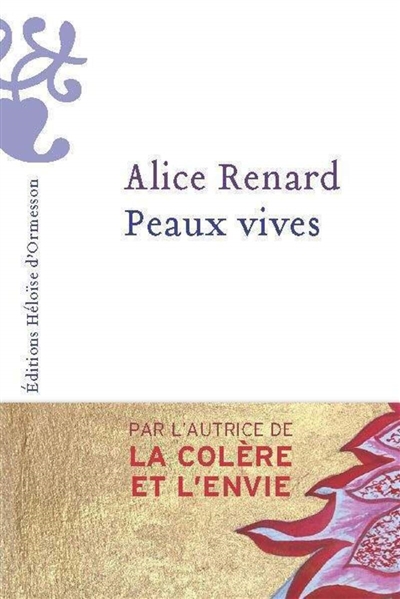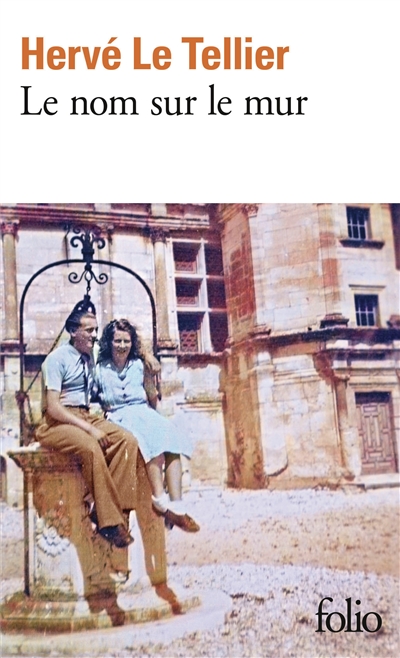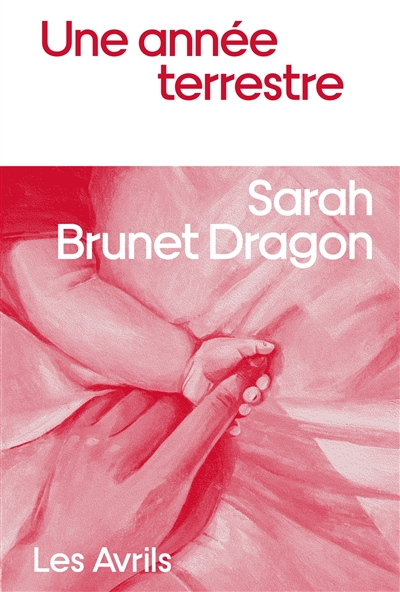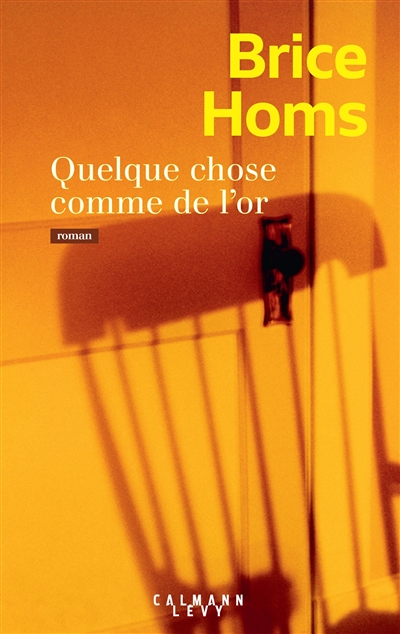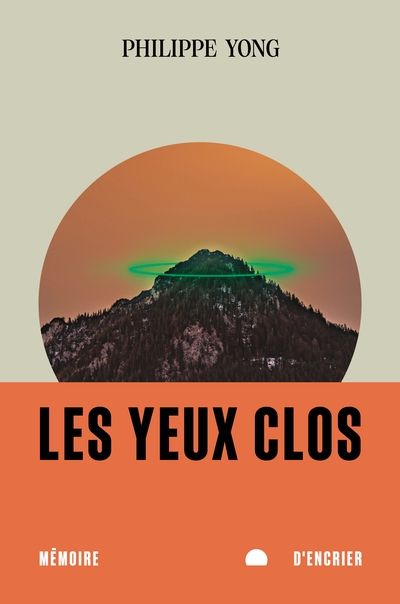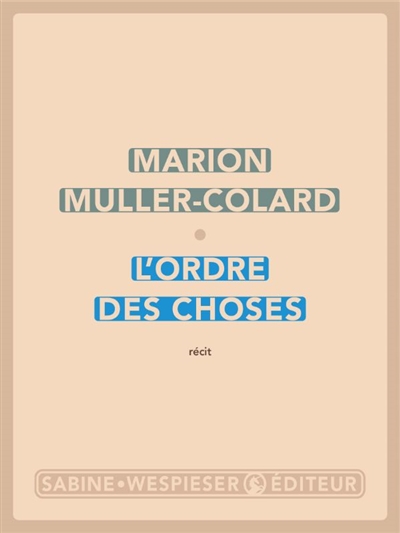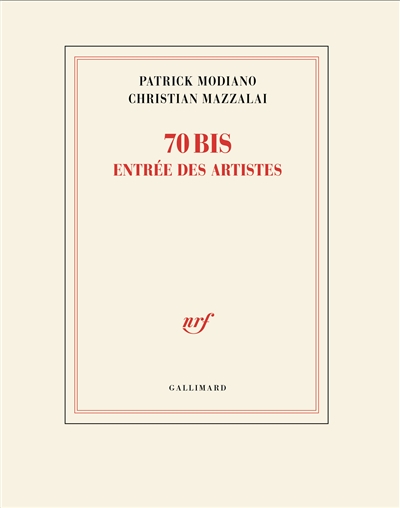L’événement au cœur du livre est le naufrage de deux navires le 26 juin 1979 : un de vos oncles était sur l’un d’eux et y a trouvé la mort. Vous avez toujours vécu avec ce drame. À partir de quand avez-vous considéré que cet accident, survenu il y a plus de quarante-cinq ans, pouvait faire l’objet d’un livre ?
Marie Richeux Il n’y a jamais eu de mystère autour de ce drame, il n’a jamais été caché. Je porte donc en moi ce livre depuis longtemps. Peut-être même, comme le dit mon double fictionnel, que je me suis mise à écrire pour écrire ce livre-là. Un des événements qui en marque le départ ‒ ou m’a donné l’autorisation pour l’écrire ‒, c’est la première scène du livre. On est dans un champ en Bretagne, un jour de mariage, la nuit est en train de tomber. Il y a une conversation entre le personnage de mon père et le personnage de mon cousin qui a perdu son père dans le naufrage. Celui-ci dit : « tu as été un père pour moi. » L’émotion puissante révélée par cette phrase m’a offert une scène d’ouverture. Cette déclaration d’amour m’a permis, comme le dit mon cousin, « d’aller là où lui n’a pu aller ».
La notion de « disparition » est un des axes majeurs du livre. C’est d’ailleurs un mot qui se retrouve dans des titres de livres qui vous accompagnent, que vous mentionnez au fil des pages.
M. R. C’est quelque chose que je n’ai pas anticipé quand j’ai démarré ce chantier d’écriture. Il se trouve que, dans ce drame, plusieurs marins furent portés disparus et certains corps restèrent non identifiés. Souvent on ne retrouve pas les corps et ça fait partie de la tragédie de ces accidents nautiques. Ce mot de « disparition » m’a poursuivie tout au long de l’écriture et j’en ai fait comme une forme de méditation en écrivant, convoquant tout ce que ce mot déroulait en moi, tous les souvenirs qui s’y attachaient. Ce qui renvoie bien sûr au métier que j’exerce, la radio, où l’on m’entend mais ne me voit pas. C’est en effet l’une des lignes force du texte.
Pour continuer sur le thème de la disparition, vous parlez de la Bretagne, des marins, d’un monde agricole englouti. Ce livre était-il aussi une sorte d’hommage ?
M. R. Absolument. L’autre motif de disparition, c’est un certain monde agricole breton qui n’est plus, qui était voué à disparaître et dont j’ai toujours entendu les histoires. Ce monde-là, celui des petites exploitations bretonnes, avait déjà en partie disparu quand on me le racontait, enfant. Je voulais raconter un peu de l’enfance, de l’adolescence de mon père et de ses frères, de ses parents. Inscrire des vies dans un livre leur permet de ne pas totalement disparaître.
Ce qui transparaît aussi dans votre livre, c’est la question. Vous en posez tout le temps, jusqu’à en avoir assez, dites-vous. Évidemment, on ne peut que faire le lien avec votre métier. Avez-vous intentionnellement construit ce livre en forme de questionnement ou est-ce venu spontanément ?
M. R. Je passe ma vie à faire de la radio, à poser des questions. Et je raconte dans ce livre comment mon rapport au monde est totalement construit autour de la question, de la recherche. Ce livre commence dans le brouillard et se termine dans le brouillard. Je m’y réconcilie avec la brume : il y a quelque chose de mon rapport à la question permanente qui s’apaise. C’est la trame d’autoportrait qui existe en sourdine dans ce texte.
Un livre est porté par ses mots et vous avez su trouver les plus justes pour écrire cette histoire, toujours à la frontière entre dévoilement et pudeur. Il y a aussi la structure avec ces petits chapitres aux titres sans capitales, des titres très signifiants. Comment avez-vous trouvé cette voie ?
M. R. Je l’ai beaucoup cherchée ! C’est le livre sur lequel j’ai le plus travaillé ; j’ai poli et repoli chaque phrase. Il y a des matériaux divers dans ce récit ; un matériau romanesque (une enquête qui fait avancer l’histoire) et la voix des autres. J’ai beaucoup retravaillé les entretiens, à partir de mes souvenirs, et essayé que chacun ait sa voix tout en s’inscrivant dans ma langue.
Le 26 juin 1979, deux navires, un italien et un français, font naufrage au large des côtes italiennes. Dans l’un d’entre eux se trouve Charles Richeux, un oncle paternel de l’autrice qui y trouvera la mort. Marie Richeux mène l’enquête, quarante-cinq ans plus tard, interrogeant sa famille, des témoins indirects, fouillant les archives. Fourmillant de questions, celles qu’elle pose et celles qu’elle se pose, elle fait ainsi revivre une partie de l’histoire familiale et celle d’une Bretagne rurale et maritime. Et, dans ce sillage, surgit un très beau portrait de père, le héros non nommé du livre.