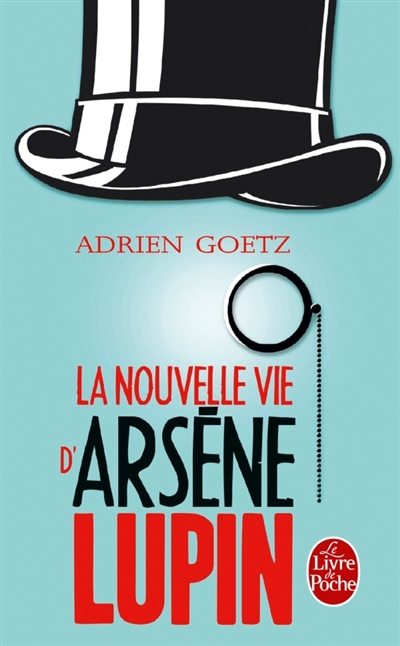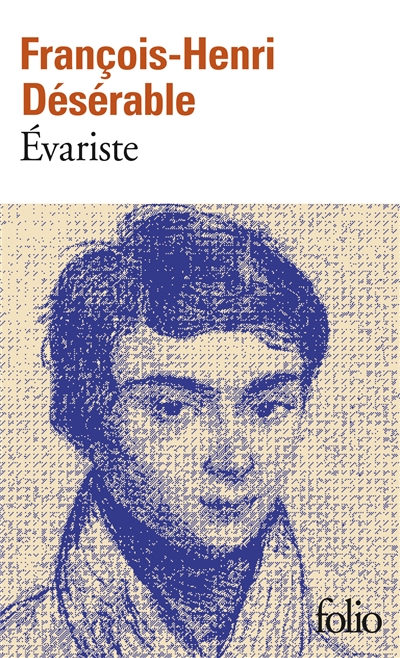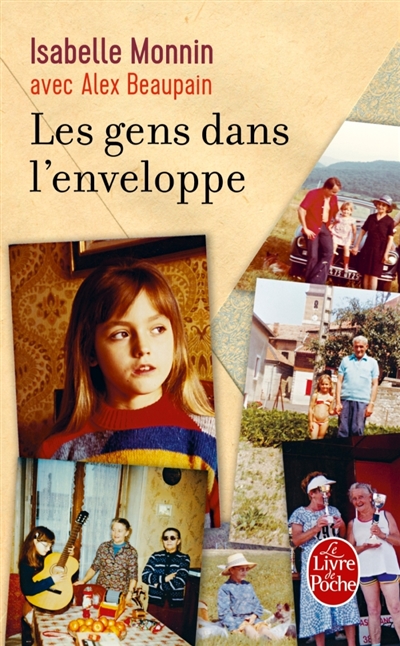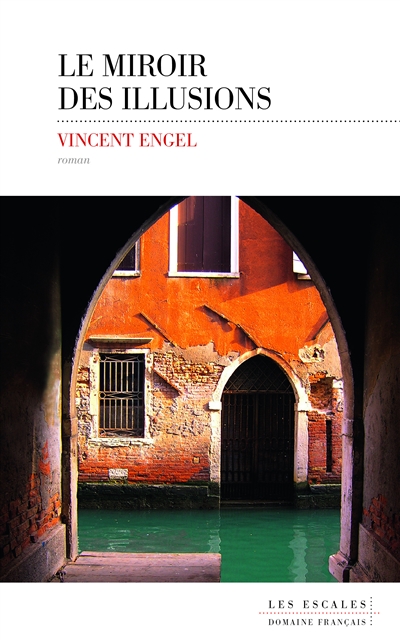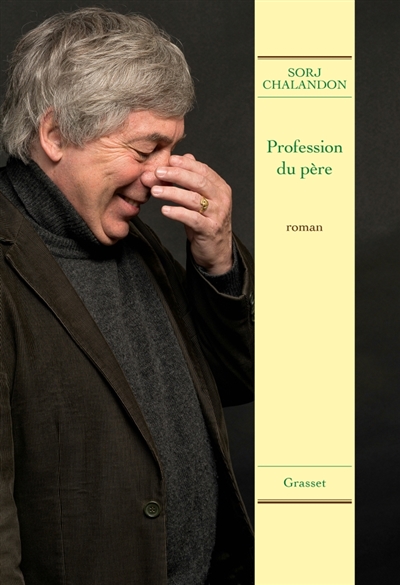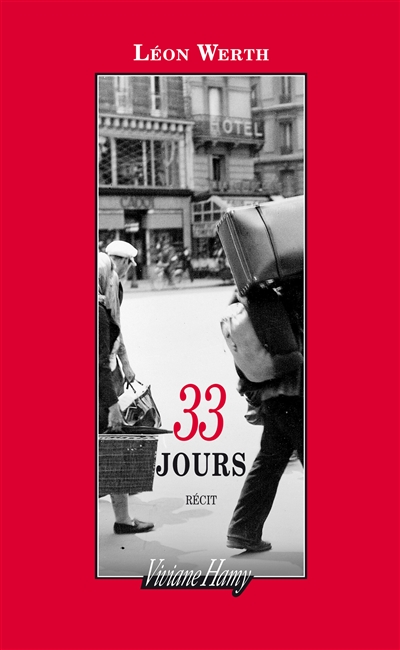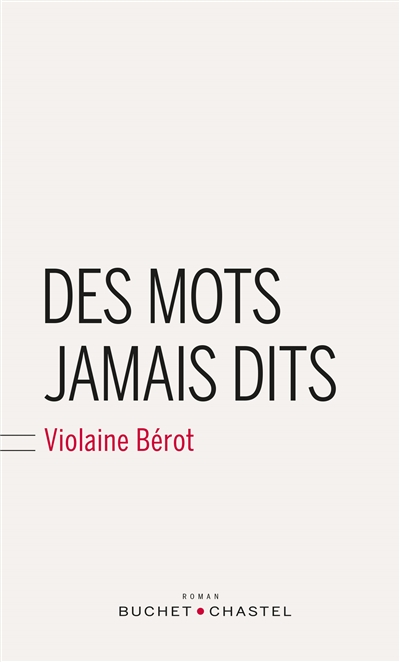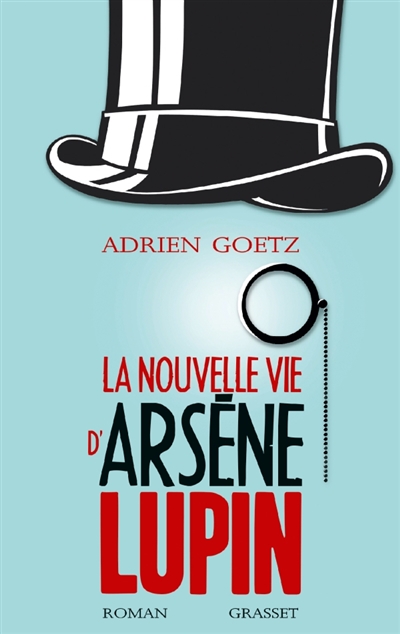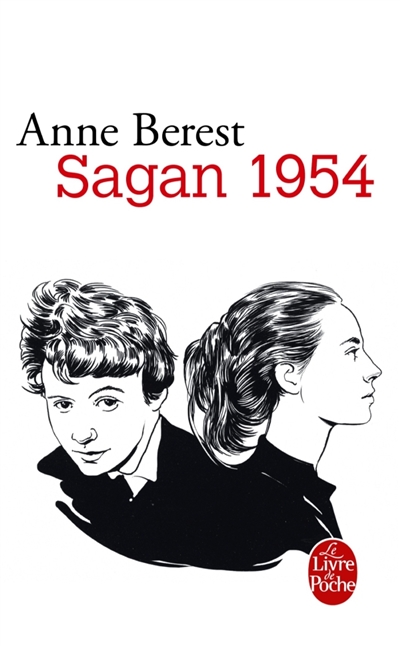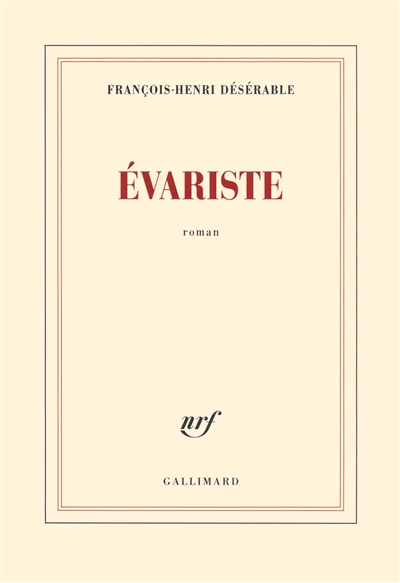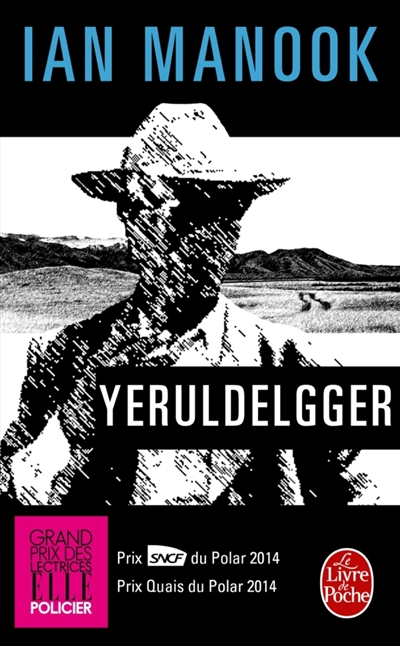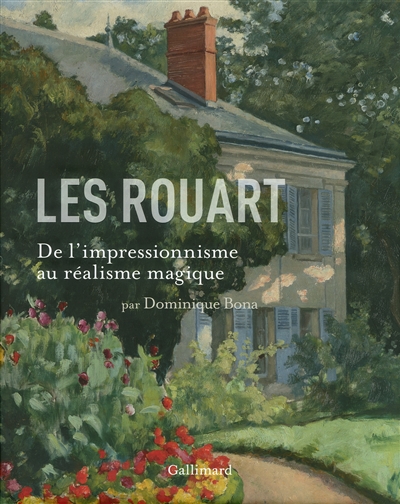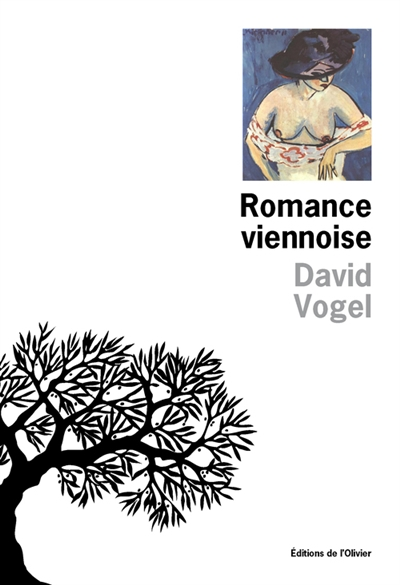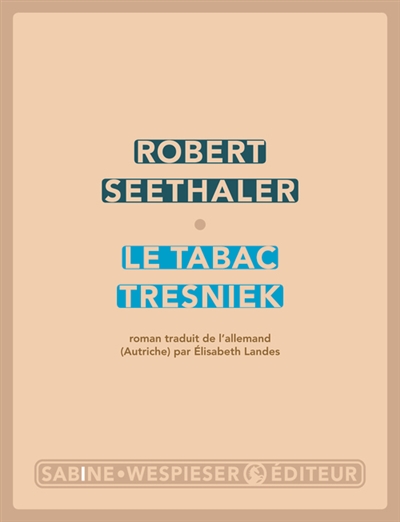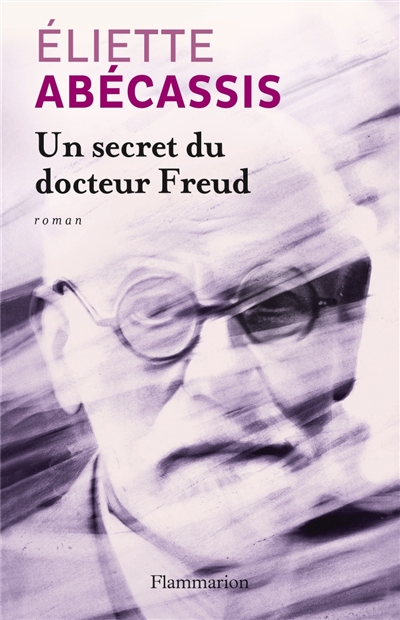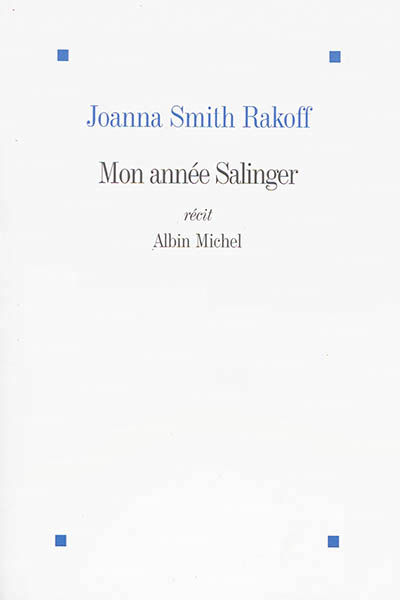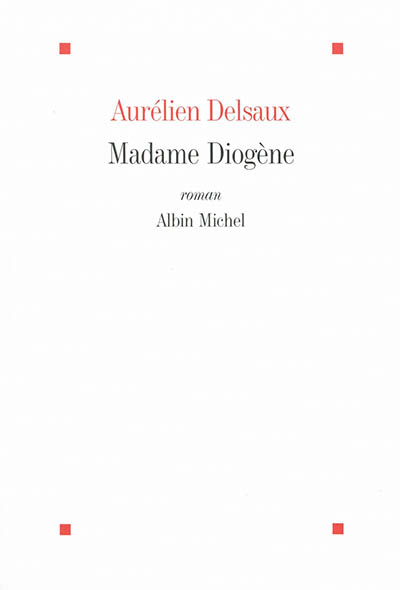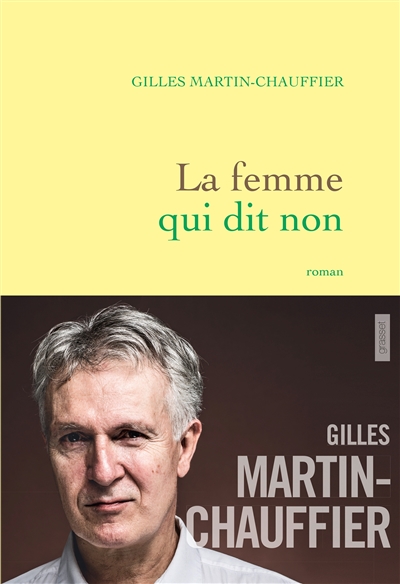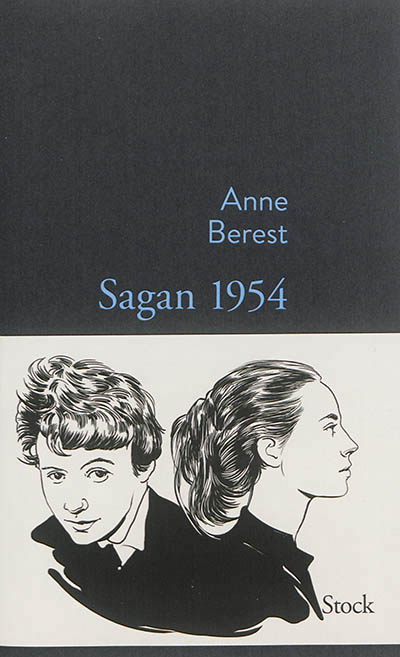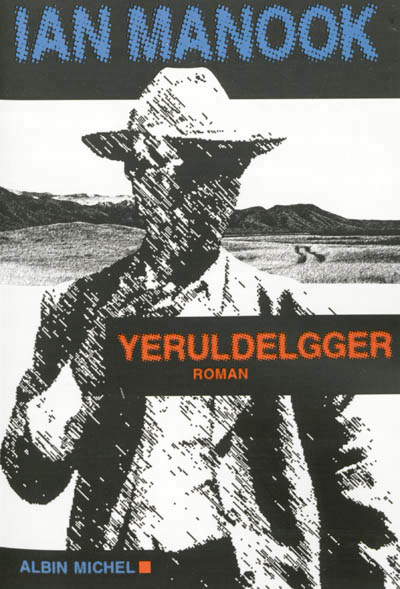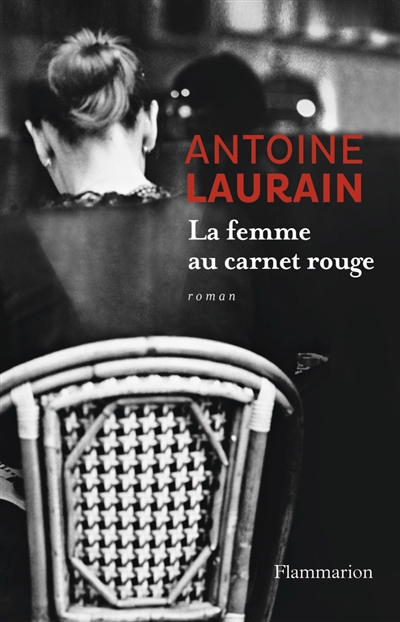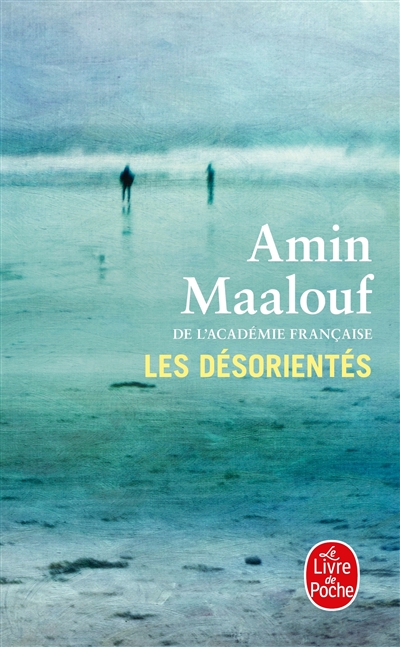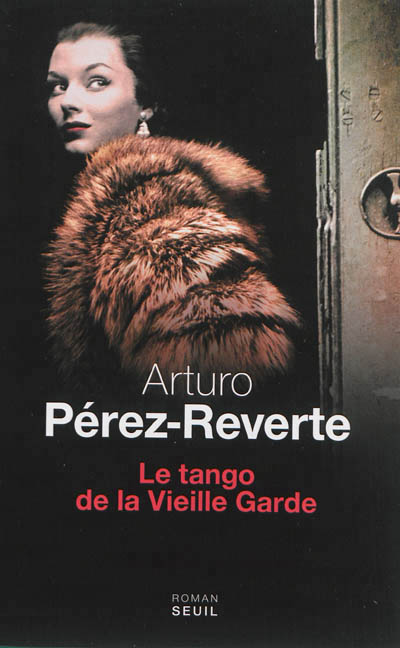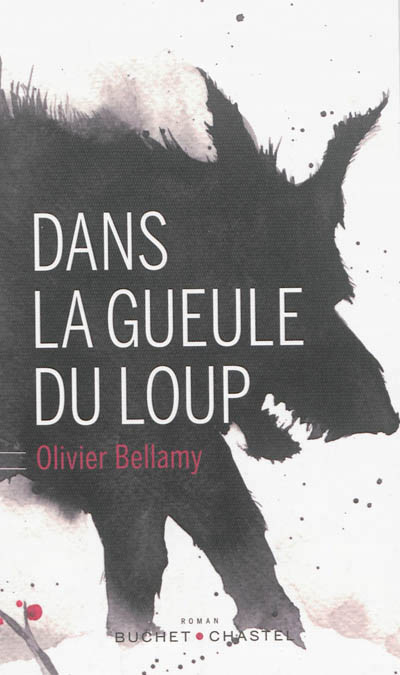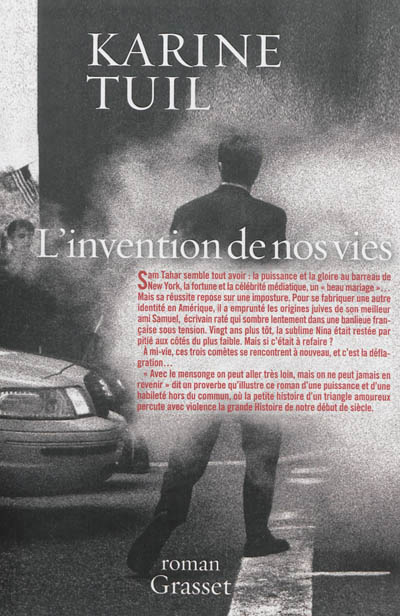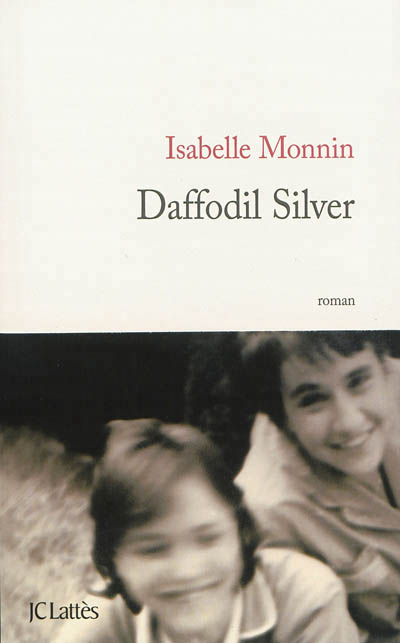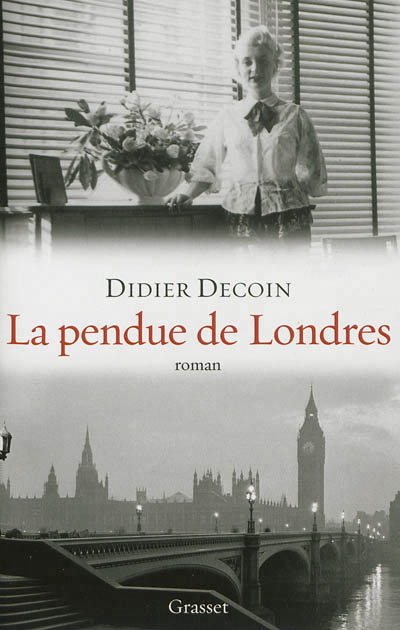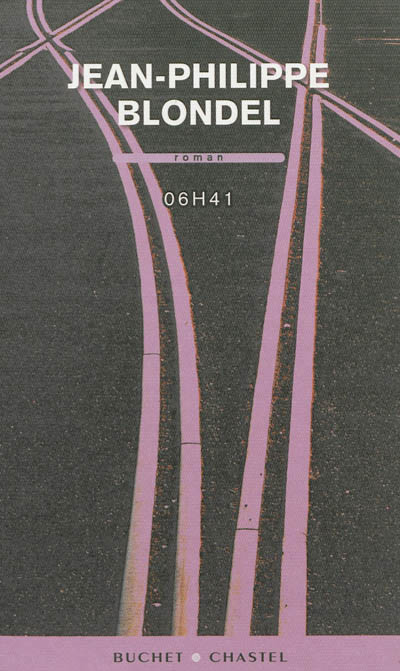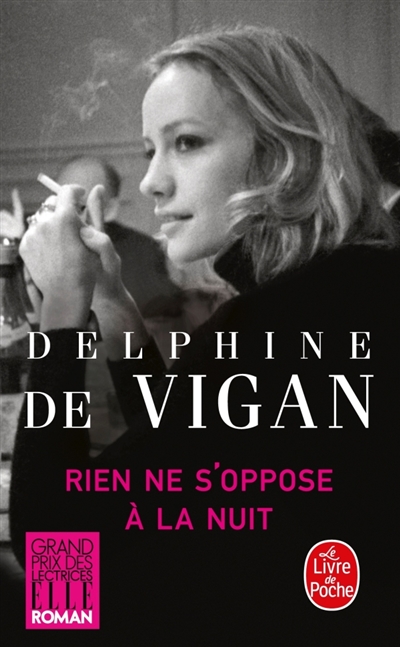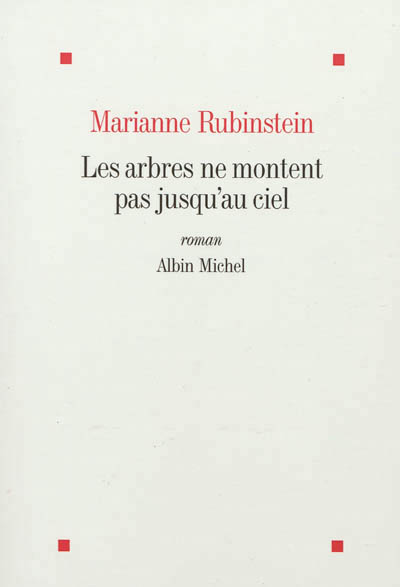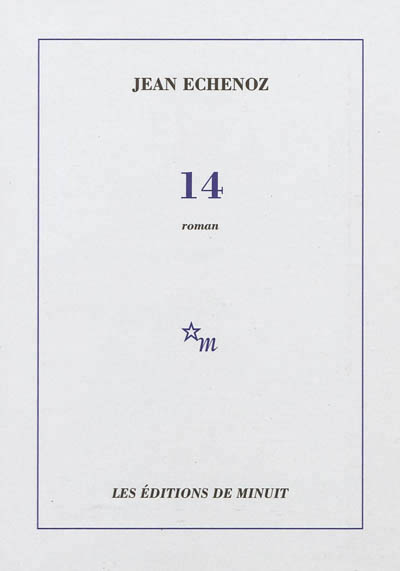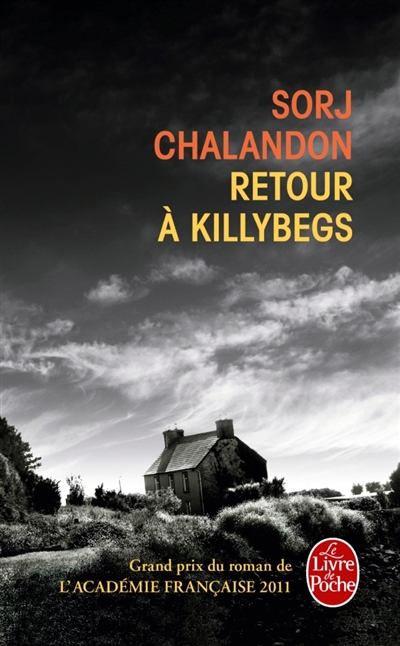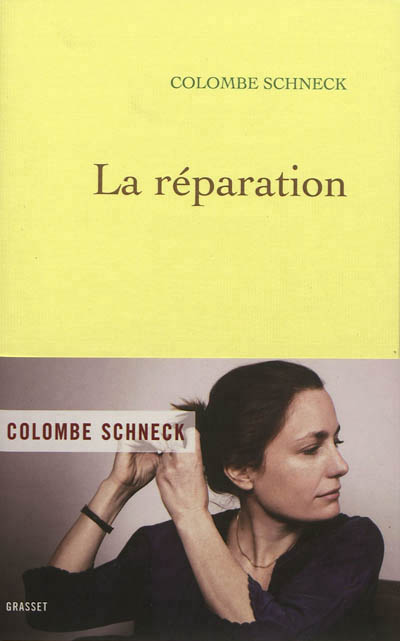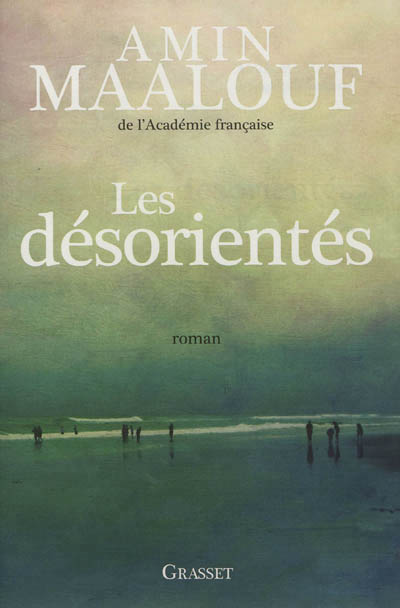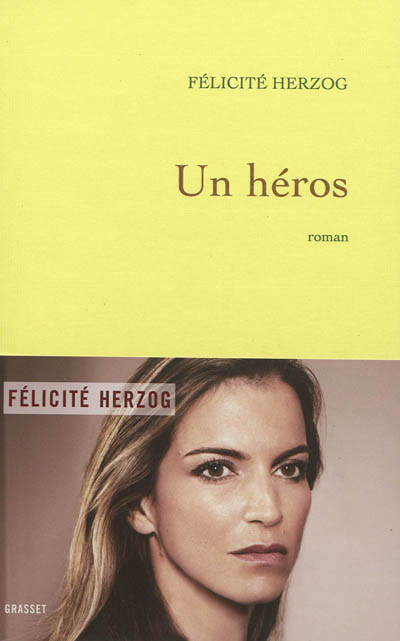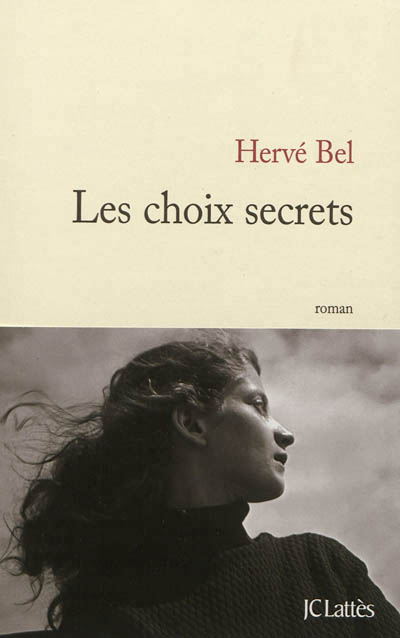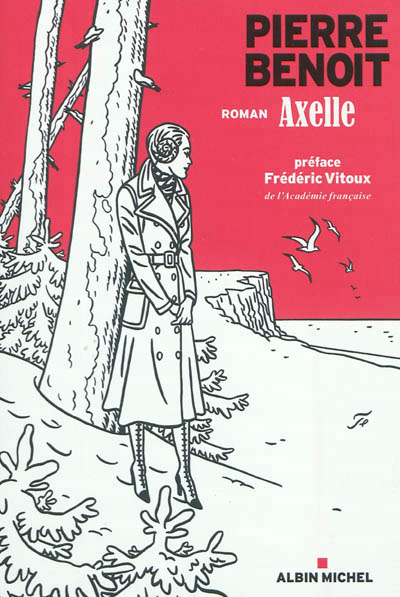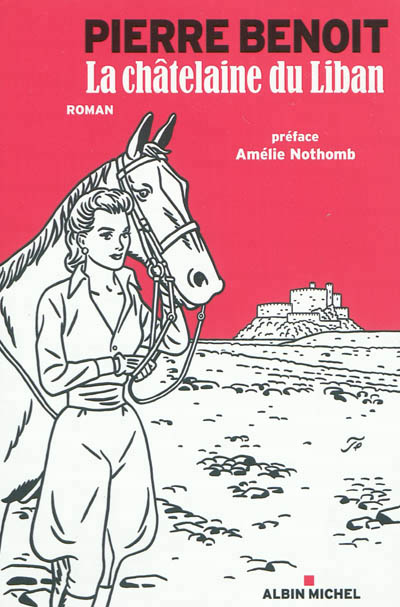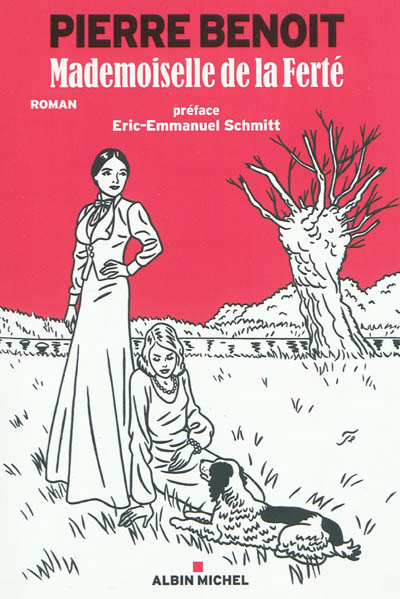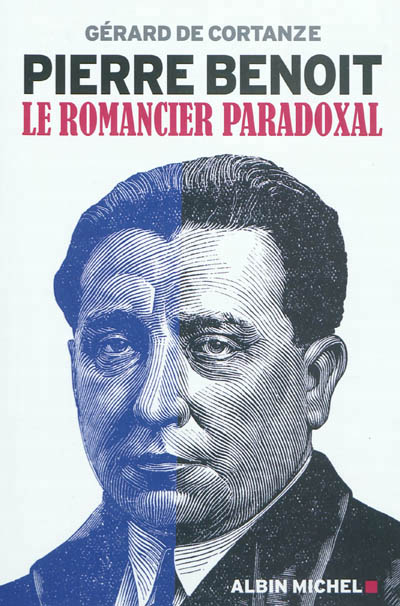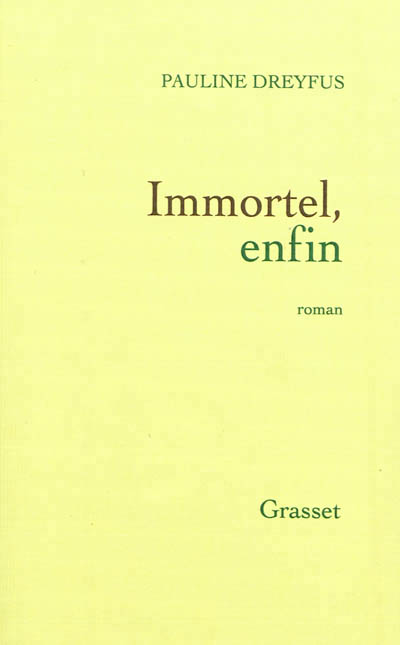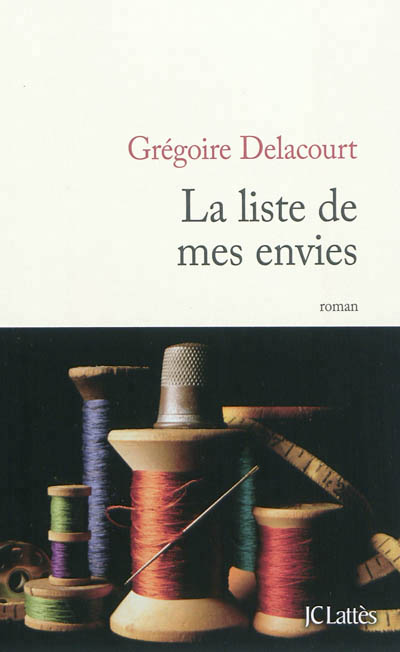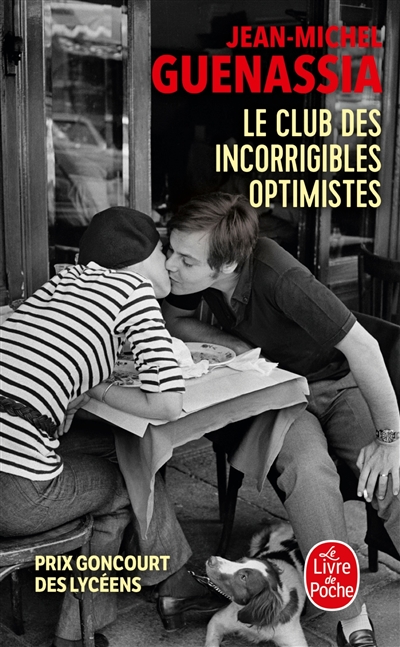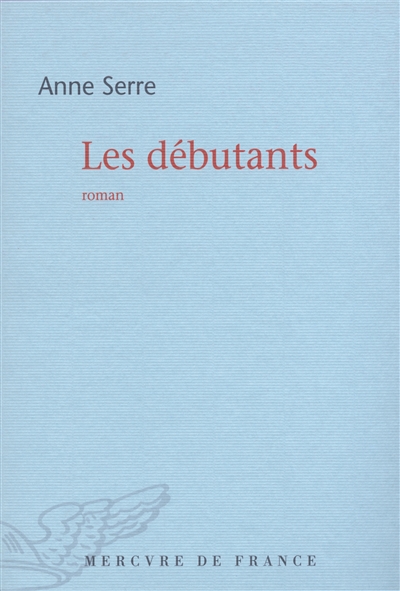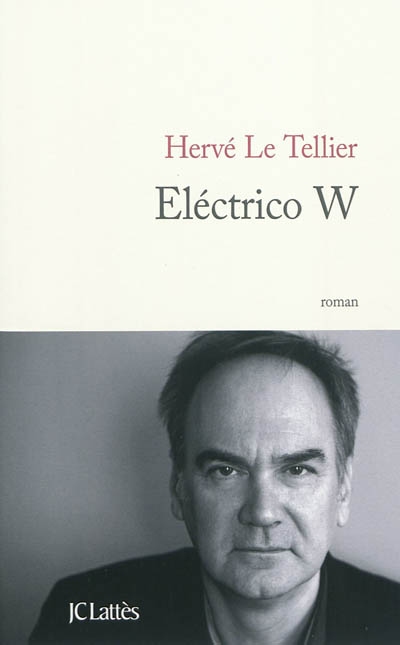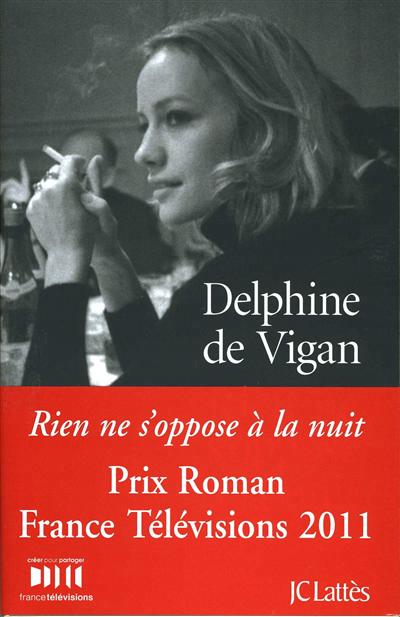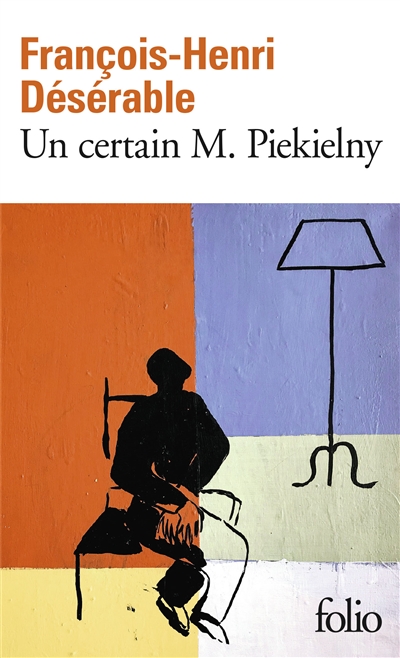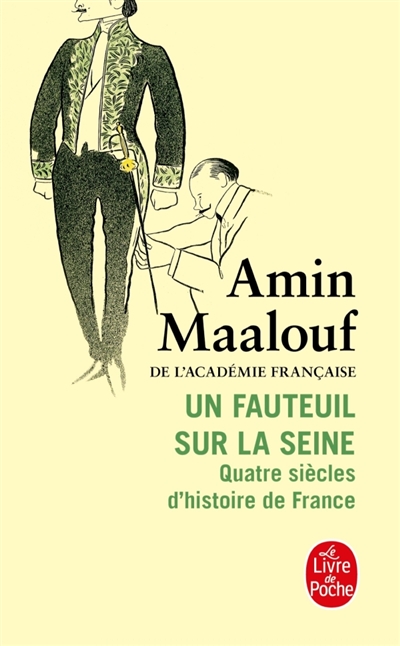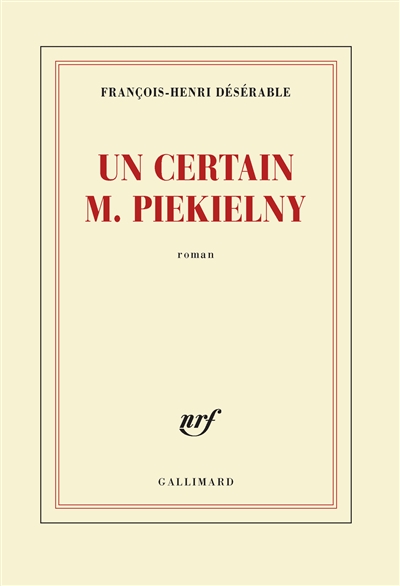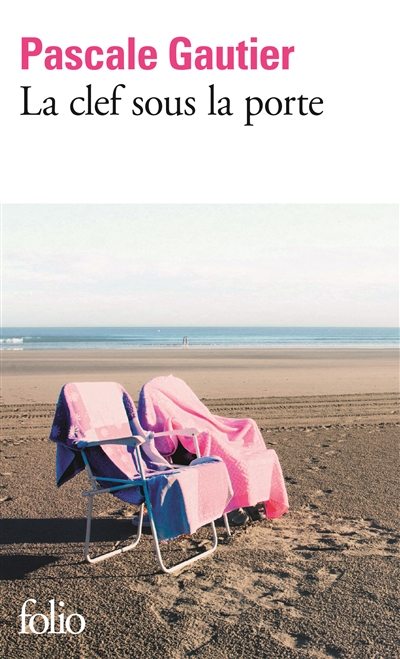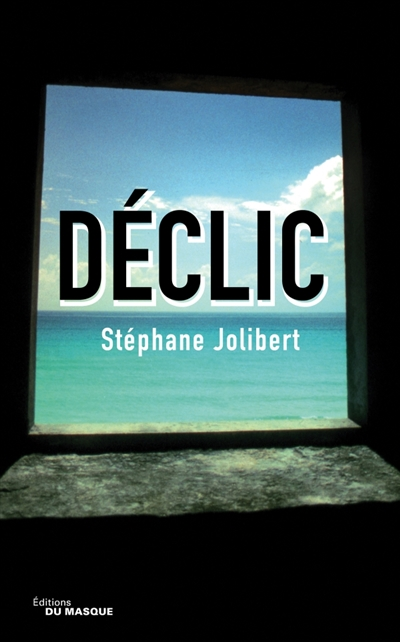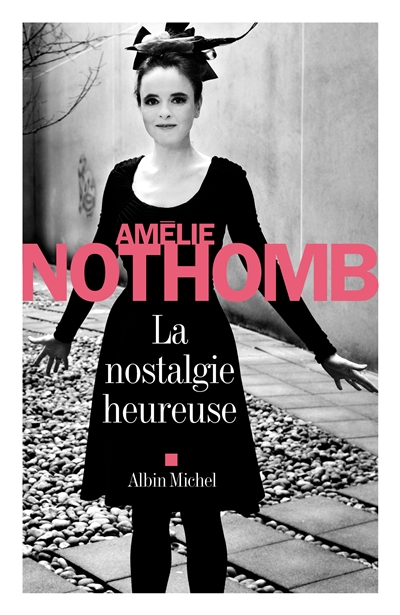Littérature française
Virginie Deloffre
Léna
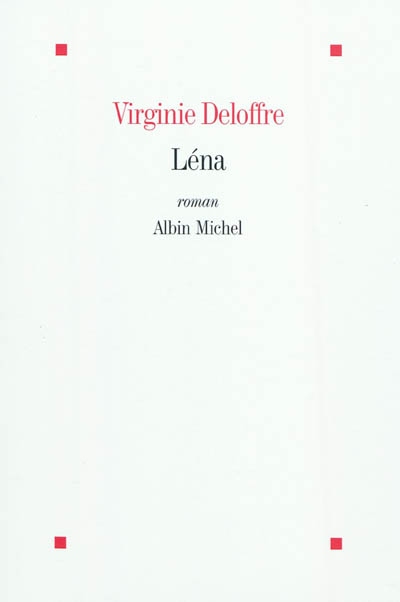
-
Virginie Deloffre
Léna
Albin Michel
17/08/2011
272 pages, 19 €
-
Chronique de
Véronique Marchand
Librairie Le Failler (Rennes) -
❤ Lu et conseillé par
4 libraire(s)
- Emmanuelle George de Gwalarn (Lannion)
- Bernadette Coudrin de Montaigne (Bergerac)
- Delphine Bouillo de M'Lire (Laval)
- Béatrice Putégnat
✒ Véronique Marchand
(Librairie Le Failler, Rennes)
Fin des années 1980 : le géant soviétique vacille, emportant dans sa chute les certitudes des uns et faisant renaître l’espoir des autres. Indifférente aux bouleversements du monde, Léna n’attend que le retour de l’Aimé. Un attachant premier roman empreint de cette fameuse âme russe qui n’en finit pas de nous faire rêver.
PAGE : Quand j’ai ouvert votre livre, les premiers détails qui me sont apparus, c’est un poème écrit en cyrillique et le titre du premier chapitre, « L’absence ». J’ai pensé : « je vais aimer ce roman ». Et en effet, je suis tombée sous le charme de Léna, et ce charme ne m’a plus quittée. Le livre, qui n’est pas un roman épistolaire, s’ouvre sur une lettre oscillant entre étrangeté, fatalisme et mélancolie, justement signée Léna. Qui est cette jeune femme ?
Virginie Deloffre : Léna est une femme dont on suit l’évolution intime et personnelle. Peu à peu, elle s’arrache à l’immobilité dans laquelle elle est plongée au début du roman. D’abord, elle est assise sur une chaise, près de la fenêtre, dans le voisinage d’un grand arbre qui pousse en contrebas. Elle vit là, à côté de cette fenêtre, peut-être pas par hasard… Dans un passage de sa lettre, elle raconte sa première vision d’un arbre. Léna est née dans un village du Grand Nord sibérien situé sur l’embouchure de l’Ob, au bord de la mer de Kara, à la hauteur de la toundra polaire. Elle est issue de ce paysage et le porte en elle. Le Nord est inscrit en moi, dit-elle, y compris ce paysage livide et figé de la toundra recouverte de neige, et la nuit polaire, cette nuit qui succède presque sans transition à la nuit. Vassia, son mari, est pilote dans l’armée de l’air soviétique et, avec la manie du secret propre à l’armée Rouge, ses permissions sont à la fois rares et totalement imprévisibles. Léna vit donc dans l’incertitude permanente de ses retours et de ses départs. Elle l’attend. À chacun de ses retours et à chacun de ses départs, elle écrit à deux être essentiels dans son existence, puisqu’ils sont ceux qui l’ont recueillie et élevée.
P. : Léna écrit à un homme et à une femme dont les vies sont très emblématiques de l’histoire soviétique.
V. D. : Léna écrit à Varia et Mitia − ce sont leurs diminutifs ; on recourt très peu au nom complet en Russie. Quand on appelle quelqu’un par son nom complet, c’est en général le signe que l’on est très fâché contre lui. Dans un échange normal ou une conversation affectueuse, on utilise les diminutifs. Varia et Mitia habitent en Sibérie polaire. Dimitri est un intellectuel moscovite, un géographe qui, après le XXe Congrès, a un peu trop déstalinisé sa grande bouche. Ça n’a pas plu, on l’a expédié en Sibérie pour lui mettre la tête au frais. Il est tombé sous le charme de cette région, il a été saisi par les paysages magnifiques et n’a jamais pu ni souhaité en repartir. On l’a installé chez Barbara, une solide Kolkhozienne fichée dans la terre, parce qu’on ne savait pas quoi faire de cet homme qui débarquait de Moscou encombré d’un lourd dossier émanant des organes de sécurité de l’État. Si elle est la sauveuse de Léna, elle est aussi la sauveuse du réprouvé Dimitri. Celui-ci aurait pu finir comme quantité d’intellectuels moscovites qui roulent dans les caniveaux parce qu’ils ne trouvent rien d’autre qu’une bouteille de vodka pour donner un sens à leur vie brisée. Lui est en quelque sorte sauvé par l’impitoyable beauté des paysages sibériens. Il y exerce son métier de géographe en arpentant à pied, à ski ou en traîneau, sur des kilomètres et parfois en compagnie de la petite Léna, ces espaces fabuleux. L’adulte qu’elle est devenue se souvient de ses équipées sur la toundra. Elle le mentionne dans ses lettres, et ses souvenirs lui permettent de survivre aux absences de Vassia. Elle parle aussi du retour du jour, qui est un phénomène extraordinaire du Grand Nord. Les retours impromptus de son mari évoquent à ses yeux le retour du jour continu caractéristique de l’été polaire.
P. : Léna est un personnage très mélancolique. Vous lui prêtez ces mots : « Moi, je suis faite de cette grisaille qui m’enveloppe tout entière. C’est la matière de la nostalgie. Quand Vassia s’en va, la brume se lève en moi et m’imprègne entièrement. Et je suis faite de cette étrange matière de pure nostalgie. » Vassia est pilote et va devenir astronaute. C’est un homme de l’avenir porté par une dynamique qui semble ne jamais devoir s’épuiser malgré la conscience aiguë qu’il a de voir son pays sombrer. Qu’est-ce qui unit cet étrange couple ?
V. D. : Ils sont effectivement très différents l’un de l’autre… du moins au début. Dans la première partie du livre, Vassia n’existe qu’au travers des lettres de sa femme. Il n’apparaît pas beaucoup au début, on comprend néanmoins qu’il est très différent de Léna, qu’il est tout en force et en volonté et que lui aussi est habité par un rêve, le rêve de l’ailleurs, le désir d’aller toujours plus loin. Alors qu’il vit la menace de l’effondrement de son pays, on lui offre la possibilité de partir dans le cosmos, de vivre ses rêves. C’est pour lui l’opportunité de s’échapper, de quitter la tourbe et la fange, la monotonie du quotidien, la médiocrité de ses semblables, d’y échapper juste un instant, mais un instant qui ressemble à l’éternité, un instant essentiel afin de pouvoir vivre en se nourrissant des images saisies au cours de cette échappée. Ce qui m’a inspiré le personnage de Vassia, c’est une minuscule carte postale qui représentait un lever de terre sur la lune. L’image était magnifique. Vassia veut voir ce que très peu d’hommes verront jamais, et dont Léna pense que c’est interdit, que cela revient à briser une sorte de tabou. Elle dit que l’on n’a pas le droit de quitter la Terre pour aller contempler sa beauté de tout là-bas. Mes deux personnages sont très différents, vous avez raison, mais ils sont en même temps, par certains aspects, très proches dans leur désir d’inaccessible et de merveilleux. D’ailleurs, tous mes personnages sont habités par le merveilleux − c’est un fil conducteur qui les unit. Le monde qu’ils ont contribué à bâtir, qu’ils ont connu, dans lequel ils ont grandi va s’écrouler du jour au lendemain, comme l’entrée dans la nuit polaire − c’est un phénomène qui se produit de manière incroyablement rapide. Et par rapport à ce désastre, ils s’accrochent à leurs rêves et vivent avec eux, les habitent, ne pouvant s’en passer, les investissant avec naturel et tranquillité. Malgré l’effondrement de leur univers, ils parviennent à survivre, à conserver un sens à leur existence. Il y a beaucoup d’espoir et de douceur dans la façon dont ils trouvent leur place, malgré tout.
P. : C’est vrai, c’est un livre infiniment doux. D’abord évanescente, Léna prend progressivement corps, sort de sa coquille, tandis que son mari s’absente six mois sur la station Mir. Elle sait qu’à son retour elle ne le retrouvera peut-être pas parce qu’il aura vu ce qu’il n’avait pas le droit de voir…
V. D. : Elle sait que tous les hommes ayant entrepris ce voyage rentrent avec des yeux vides, un corps mort, empoisonné par la nostalgie des couleurs qui n’existent que là-haut. Leonov, premier homme à avoir effectué une sortie hors d’un vaisseau, était peintre avant d’être aviateur. Après son voyage dans l’espace, il a tenté toute sa vie de retrouver sur la toile la crudité des couleurs aperçues dans l’espace. Léna sait à l’avance comment rentrera Vassia. Et de fait, il atterrit affecté par une double nostalgie : celle de son pays qui a fini de mourir pendant son absence, et celle du spectacle contemplé là-haut. Il traverse une période de désarroi intense. Paradoxalement, la douleur intense éprouvée par Léna quand elle comprend qu’elle risque de perdre son mari, contribue à l’extraire de sa léthargie, la contraint de se lever de sa chaise, pour vivre enfin.