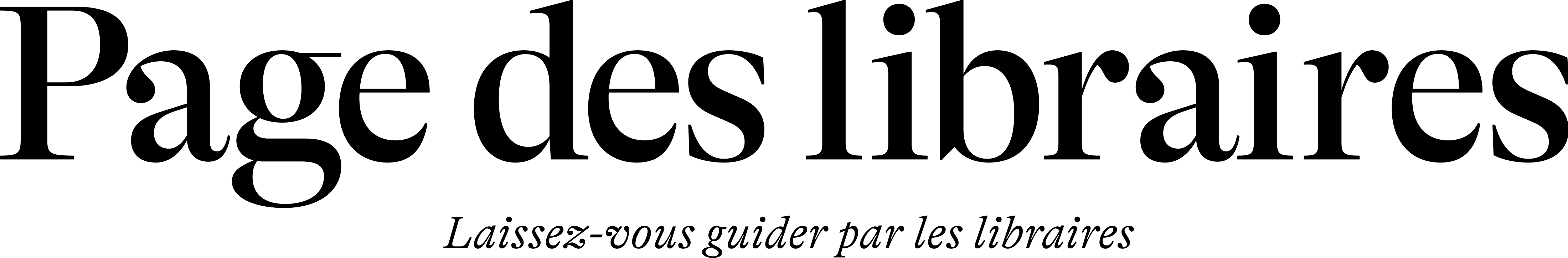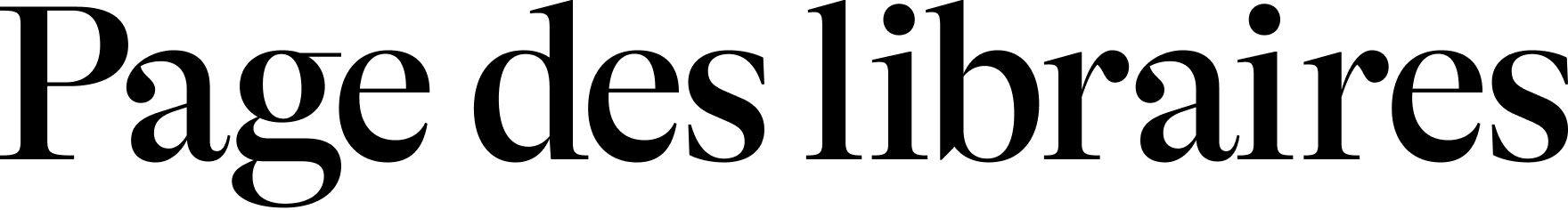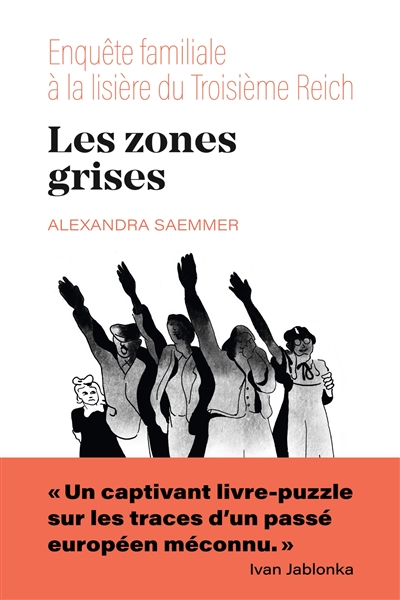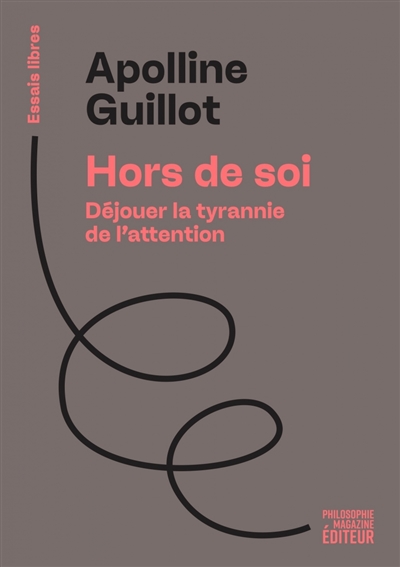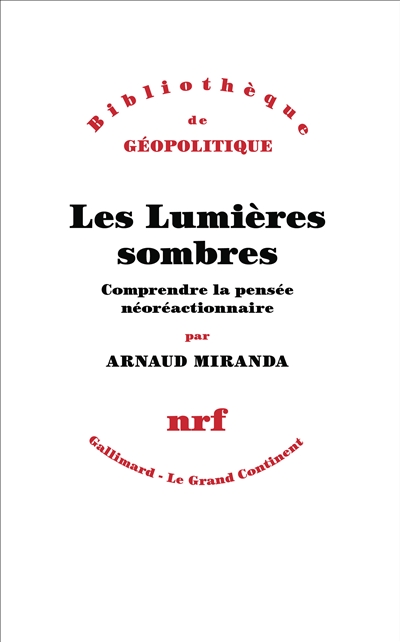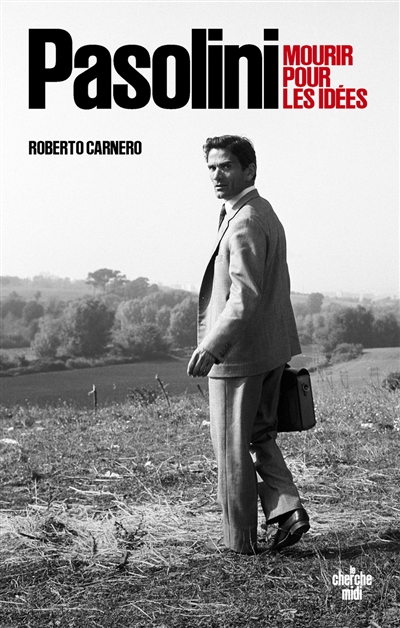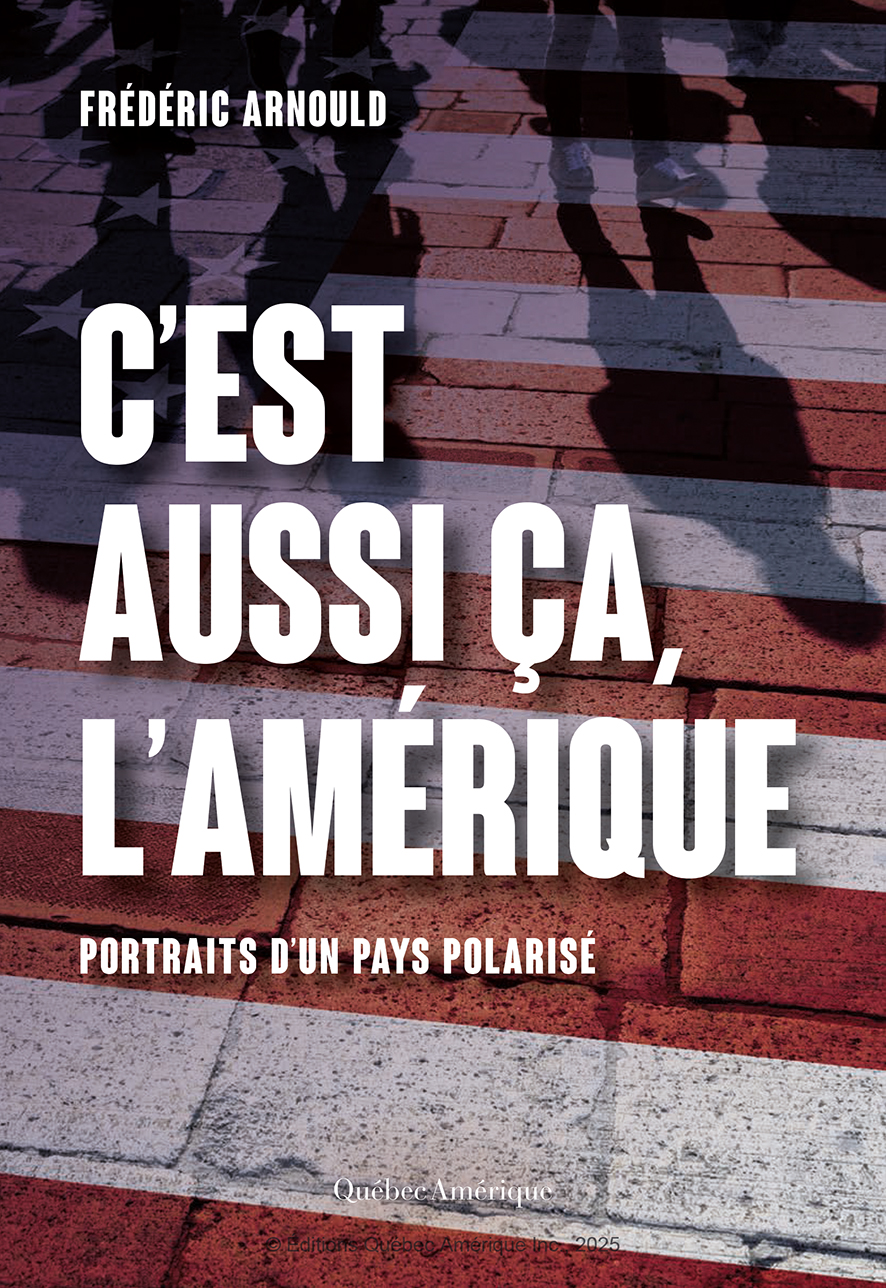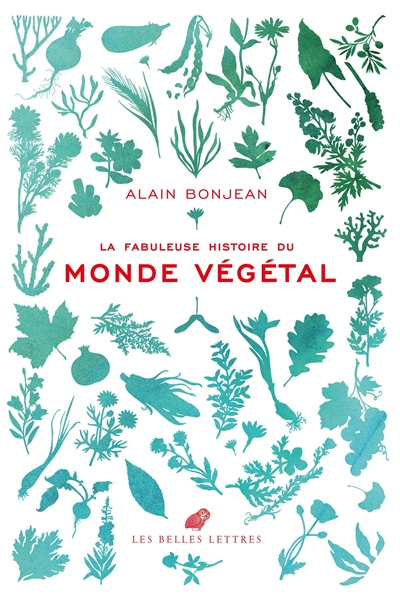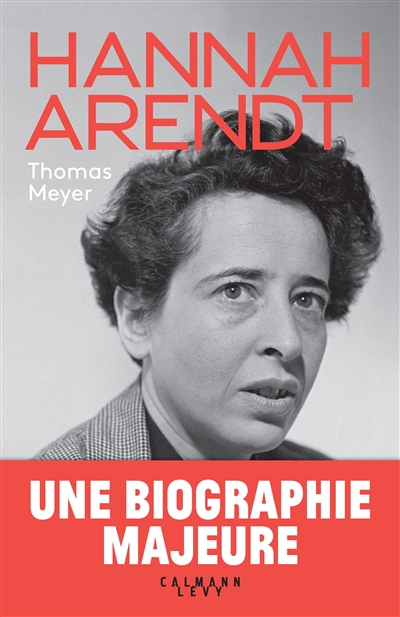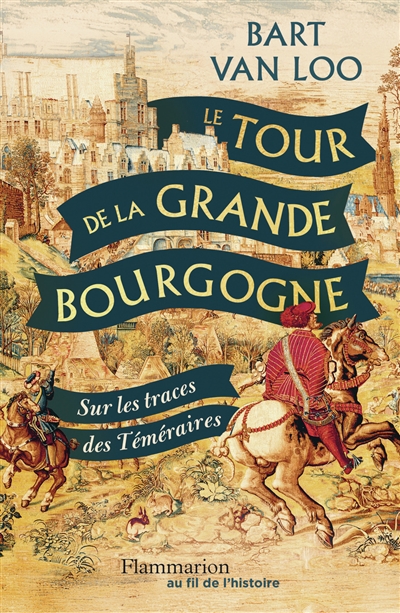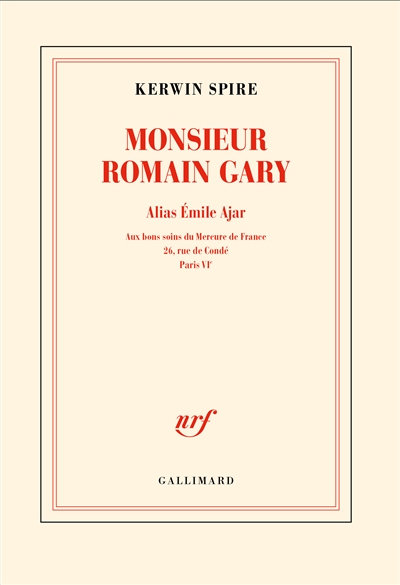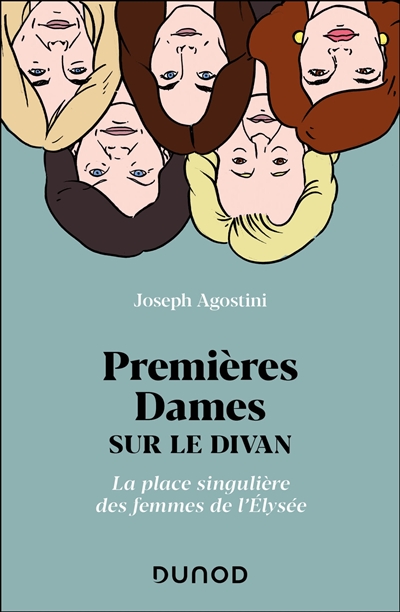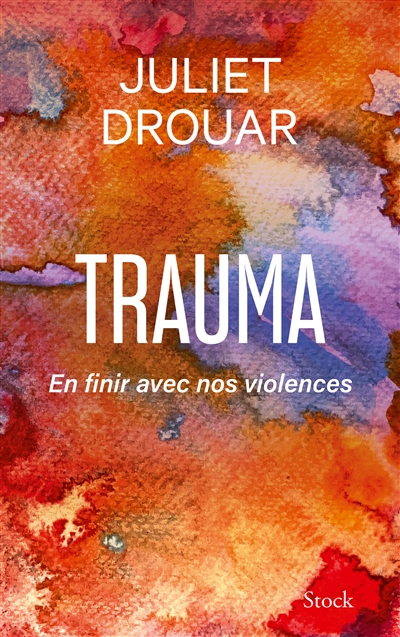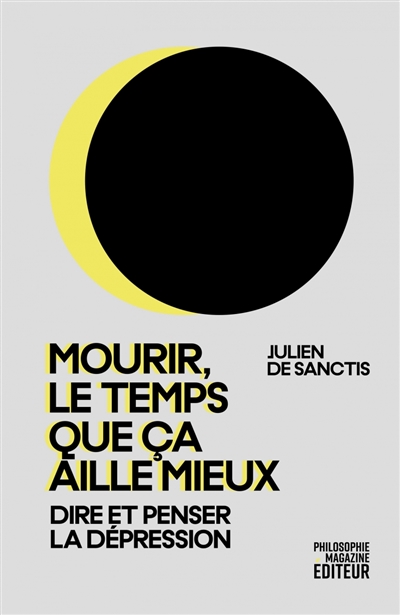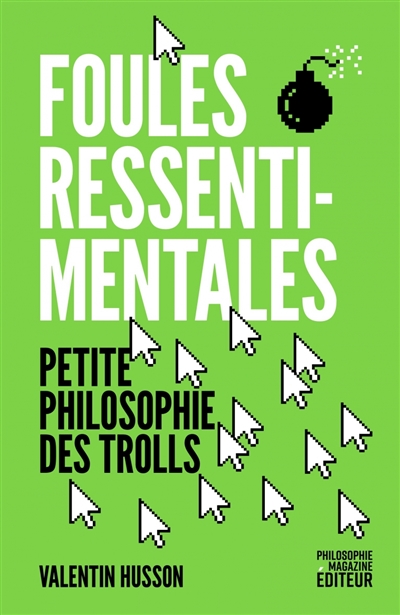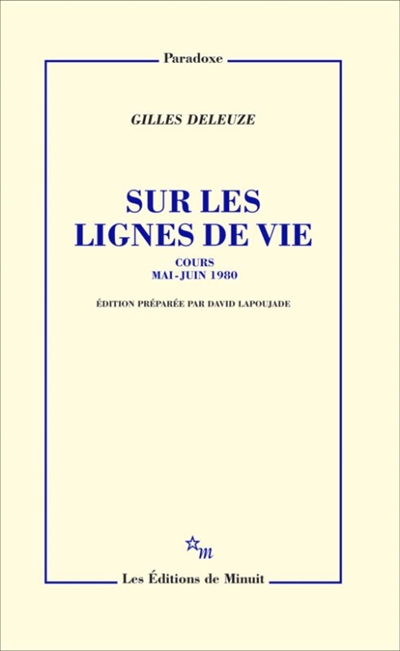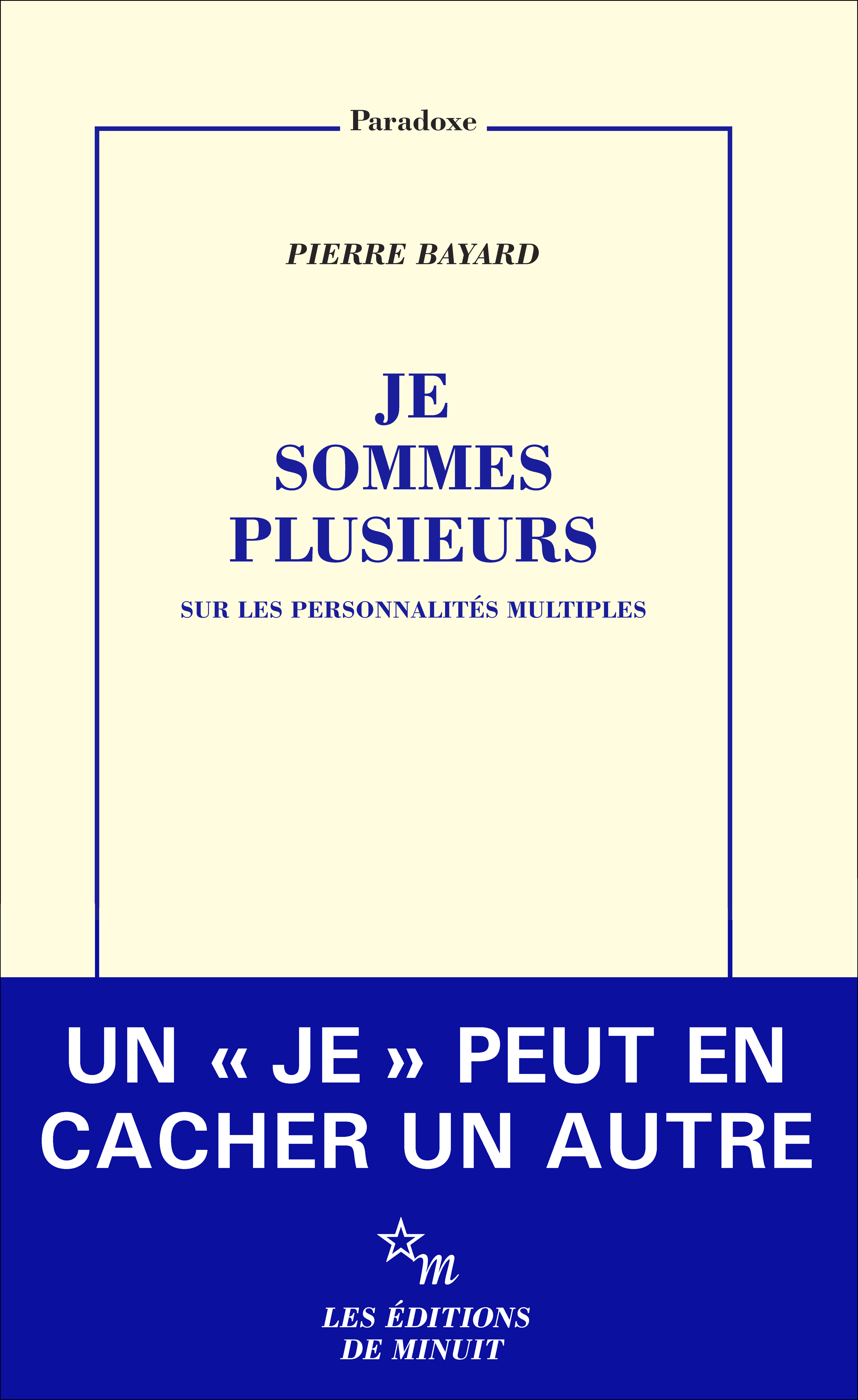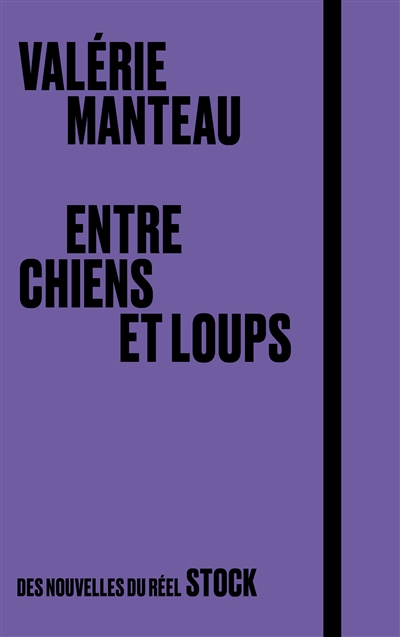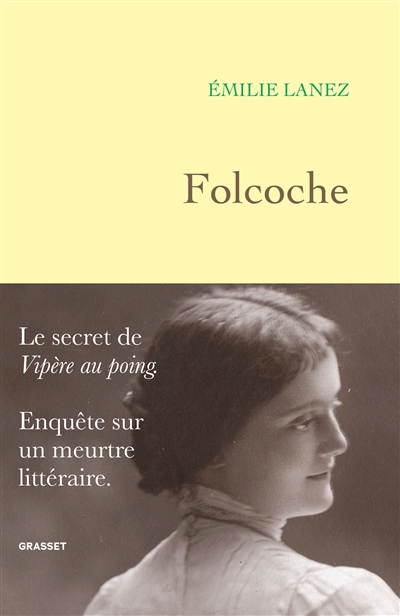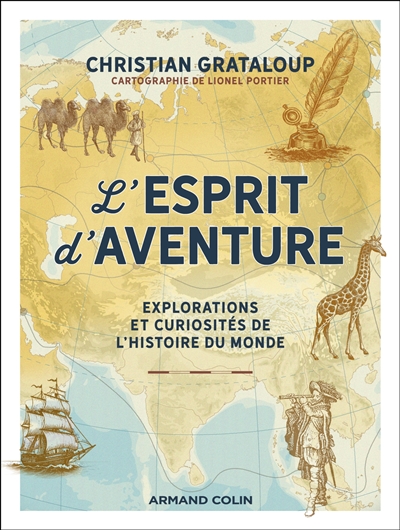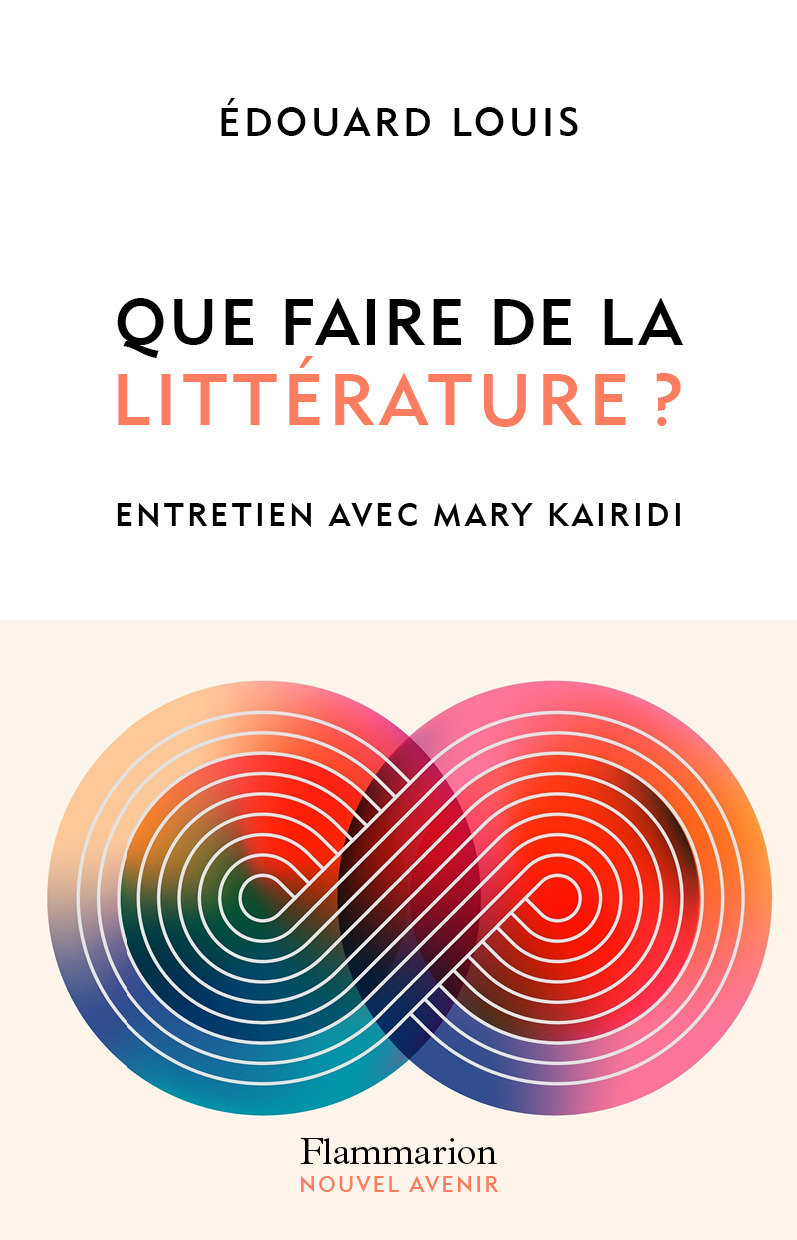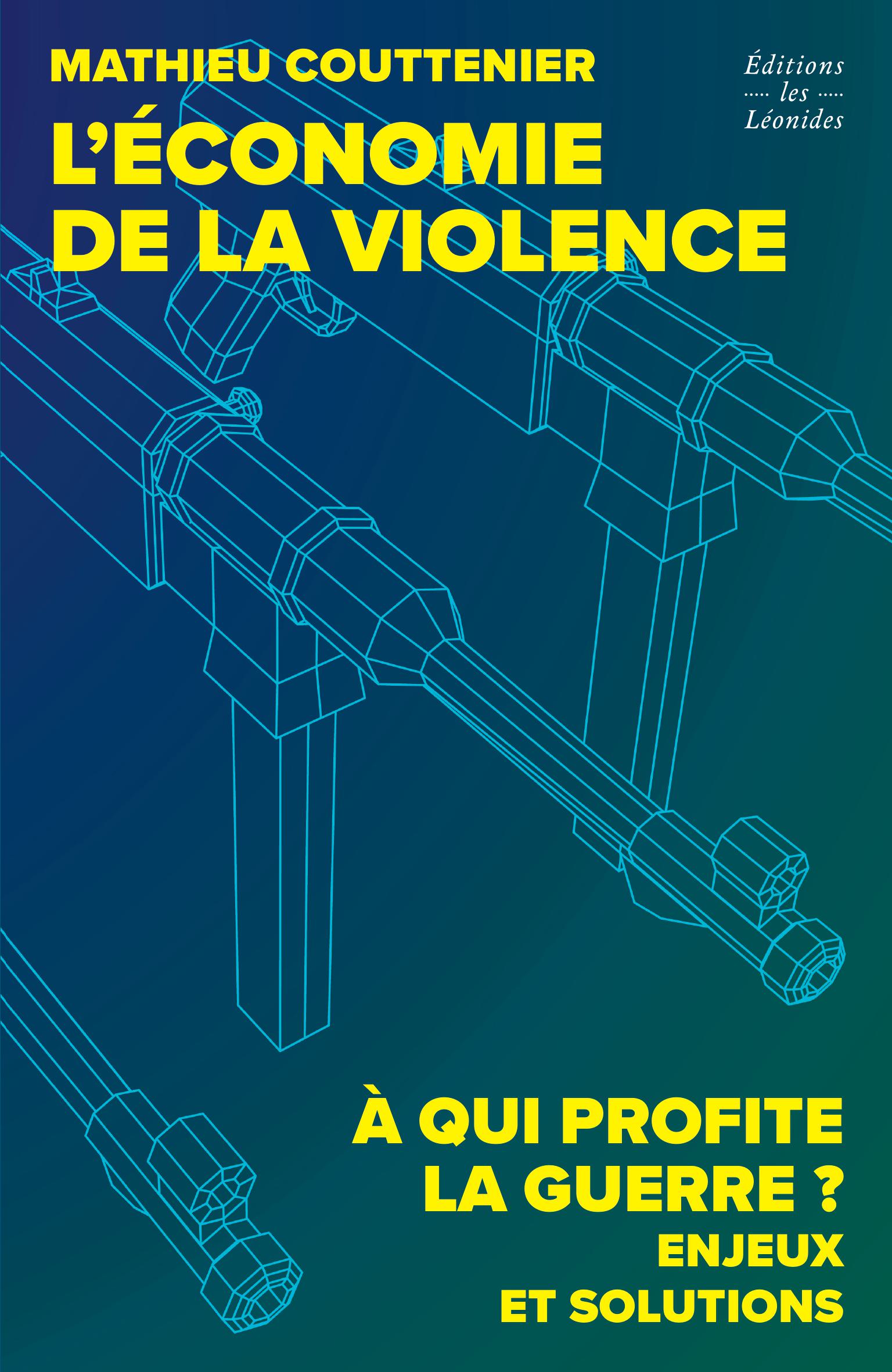Quel héritage peut bien laisser un peuple qui s’est tourné vers le pire régime de l’Histoire, en votant et s’offrant à l’Allemagne nazie ? En enquêtant sur l’histoire de sa famille, originaire des Sudètes, Alexandra Saemmer tente de répondre à cette question et poser un regard sur ce passé encore douloureux.
Votre livre-enquête, Les Zones grises, nous emmène dans une région liée aux heures les plus sombres de l’histoire européenne, les Sudètes. Qu’est-ce que les Sudètes ?
Alexandra Saemmer – Les Sudètes, à l’instar d’autres peuples frontaliers, ont vu leur identité nationale redéfinie à plusieurs reprises, étant considérés comme autrichiens, tchèques ou allemands, selon le contexte politique. Ma mère parlait du Sudetenland avec nostalgie. Or, l’histoire des Sudètes comporte des zones sombres. Cette minorité germanophone qui a colonisé les régions frontalières de la Tchécoslovaquie depuis le Moyen Âge, a été expropriée et expulsée à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir voté son annexion au Reich hitlérien en 1938.
Ce récit traduit-il le besoin de comprendre vos origines, d’éluder certains secrets familiaux ? N’avez-vous jamais eu de craintes quant à ce que vous pourriez découvrir ?
A. S. – Ce qui s’est passé lorsque les troupes soviétiques ont « libéré » les Sudètes en 1945 n’était pas un secret de famille : on disait ma mère issue de l’un des nombreux viols commis dans la région. Elle parlait également de son enfance dans un village bavarois où les habitants la traitaient de « slave » ‒ une insulte raciste à l’époque. Mais quand elle passait aux violences sexuelles subies par les enfants, je coupais court. Je considérais ma mère comme une « âme gelée » : c’est ainsi qu’on appelait les femmes traumatisées par la guerre et réduites au silence. Mais en vérité, c’était mon âme à moi qui était gelée par la peur. En 2021, quand le moment est venu d’affronter ces zones d’ombre, j’ai pu grâce à mon travail d’enquête confirmer le viol de ma grand-mère. Cependant, j’ai également dû me confronter aux témoignages de soldats soviétiques qui rappelaient que les maris des femmes allemandes s’étaient rendus coupables du même crime. J’ai découvert que mon grand-père sudète était brancardier sur le front et qu’il faisait preuve d’une grande empathie. Or, ses cartes postales du front se terminaient par Heil Hitler. Il a été forcé d’intégrer la Wehrmacht. Mais il a rejoint le parti national-socialiste de son plein gré. J’ai essayé dans mon livre de ne pas éluder ces contradictions, représentatives de la mémoire trouble des trois millions de Sudètes et de beaucoup d’Allemands.
Vous utilisez une méthode de travail fort intéressante. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
A. S. – Pour combler les trous dans le récit de vie de mes ancêtres, je ne voulais pas m’écarter des faits. Je me suis alors appuyée sur une méthode dont j’ai l’habitude : l’ethnographie des réseaux sociaux. Sur Facebook, les groupes sudètes sont nombreux. Pour les rejoindre, il fallait que je me déclare Sudète, que j’assume cette filiation. Les traces récoltées ne m’ont pas permis de retracer fidèlement ce que ma famille sudète a vécu. En revanche, elles m’ont fourni du matériel pour reconstruire, par association d’expériences, un vécu probable et le raconter comme un roman, mais sans fiction.
Depuis la parution du livre, avez-vous des retours de certains membre des groupes Facebook dédiés aux Sudètes ?
A. S. – Parmi les membres de la communauté sudète qui m’ont recontactée, beaucoup militent pour la réconciliation. Ils apprécient que mon livre n’essaie pas d’enfouir le passé mais l’expose dans son ambiguïté, faite de honte et de douleur. Se manifestent aussi des revanchistes qui me reprochent de ne pas suffisamment défendre la cause sudète. Le choix du français comme langue d’écriture serait un indice flagrant de cette trahison.
Votre démarche porte aussi l’espoir de « réparer les vivants ». Pensez-vous qu’à travers les lignes de votre récit, certains descendants du peuple des Sudètes sauront trouver les voies de la réconciliation avec leur douloureux passé ?
A. S. – J’ai ressenti par moments une forme de soulagement en écrivant ce récit ; soulagement lié au fait que la douleur-fantôme qu’éprouvent tant de Sudètes ne restait plus gelée en moi, mais se remettait en mouvement. Je ne veux pas me libérer de cette douleur car je ne veux pas m’arranger avec. J’ai essayé de la mettre à sa juste place, en faisant de mes grands-parents ni des bourreaux sanguinaires, ni des victimes ingénues.
Publié dans la collection « Bayard Récits », Les Zones grises d’Alexandra Saemmer entraîne le lecteur dans une palpitante enquête familiale au cœur du IIIe Reich. Originaire des Sudètes, l’autrice tente de comprendre à travers sa propre histoire les choix de ce peuple, leurs conséquences et le devoir de mémoire. Mêlant ses souvenirs à ses recherches personnelles et en s’appuyant sur des témoignages glanés sur certains groupes communautaires, Alexandra Saemmer nous offre un récit passionnant et sort de l’ombre l’histoire tragique et peu connue de ce peuple des Sudètes, brisé par ses liens avec le régime nazi et la Seconde Guerre mondiale.