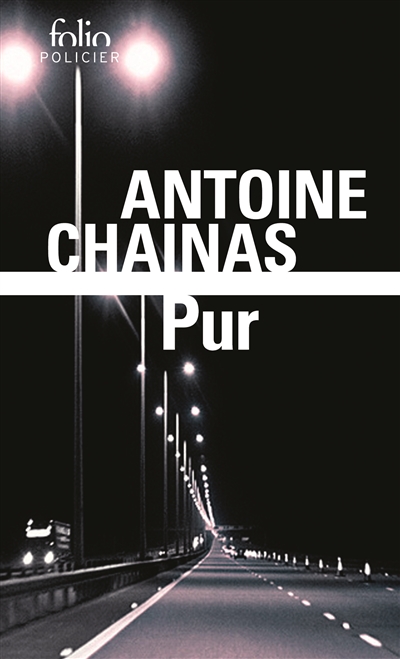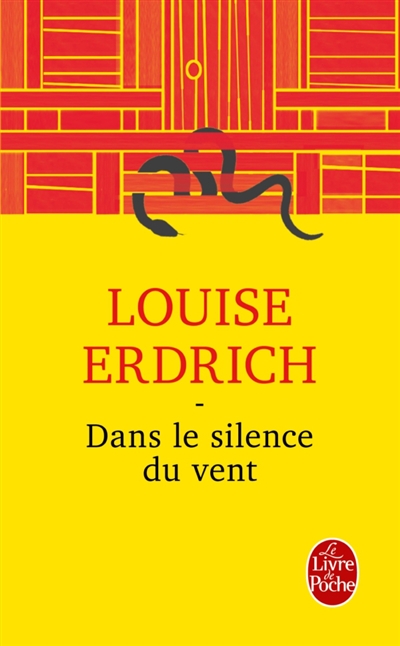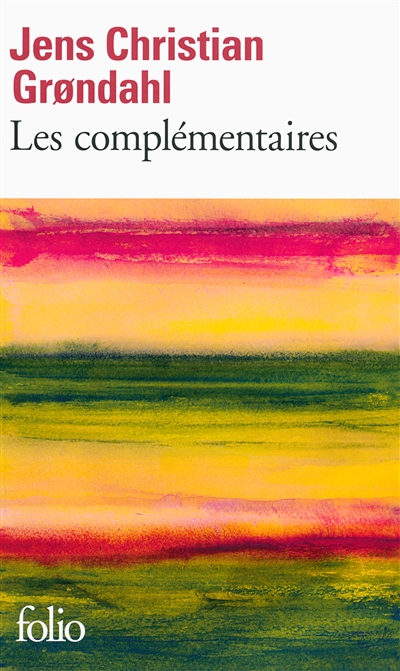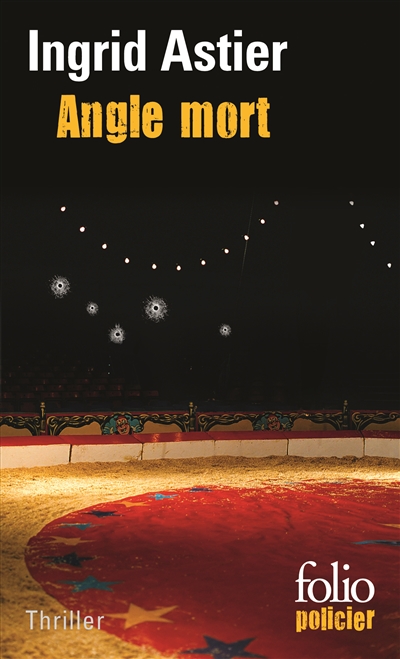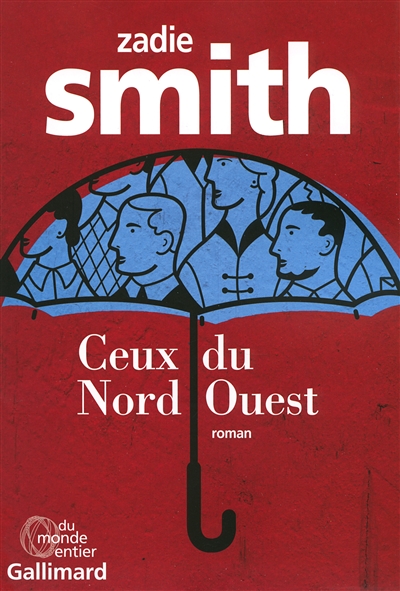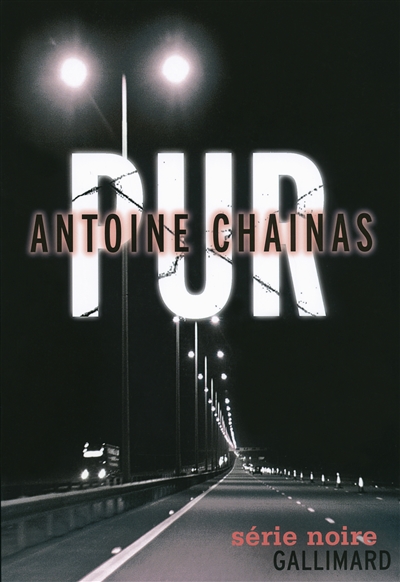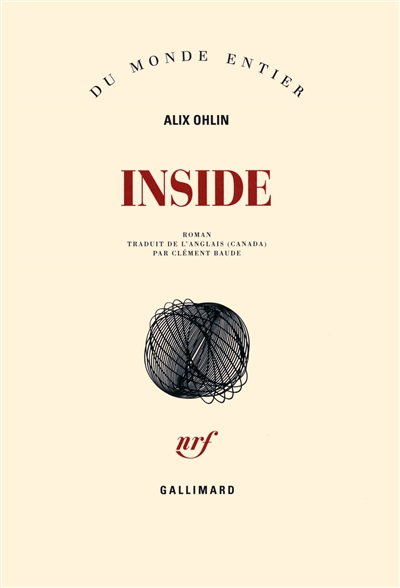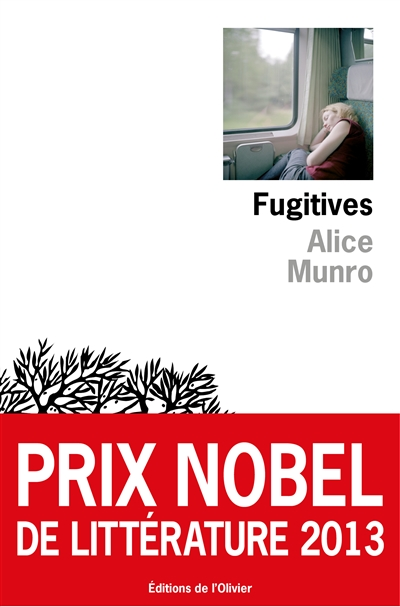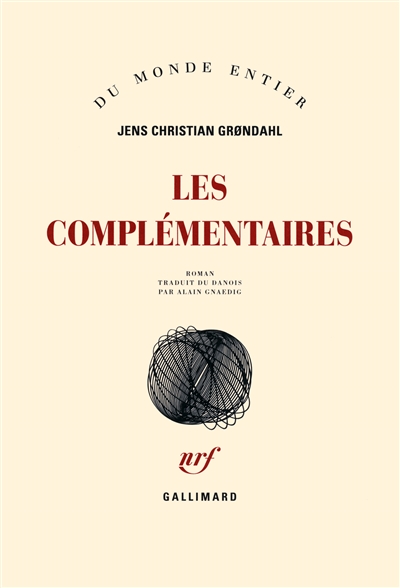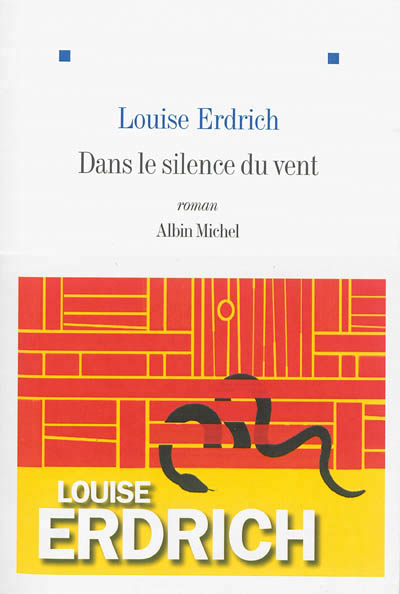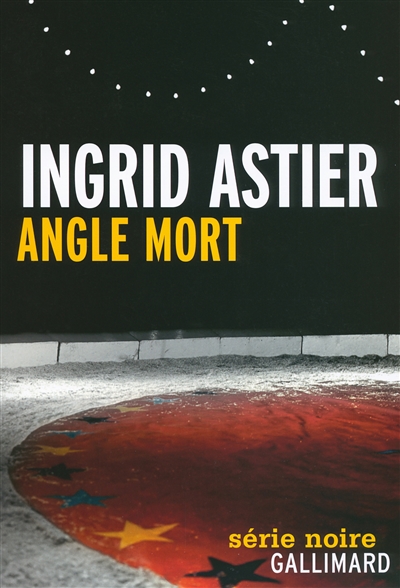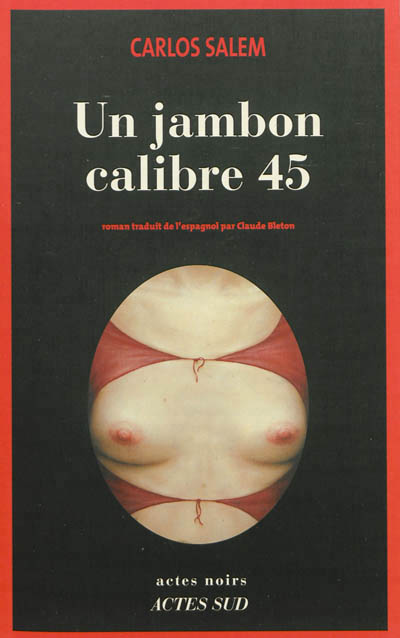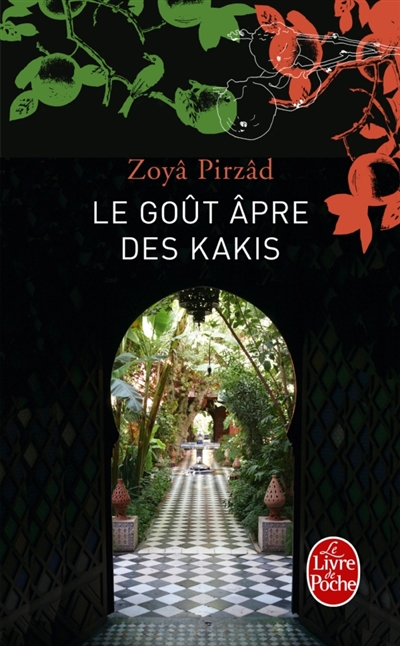Littérature étrangère
Alice Munro
Trop de bonheur
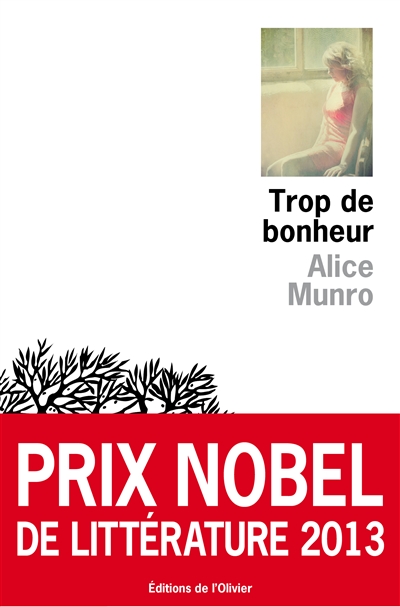
-
Alice Munro
Trop de bonheur
Traduit de l’anglais (Canada) par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso
L'Olivier
11/04/2013
320 pages, 24 €
-
Chronique de
Wilfrid Sejeau
- ❤ Lu et conseillé par 12 libraire(s)
✒ Wilfrid Sejeau
( , )
Cette année encore, le prix Nobel de littérature n’a pas dérogé à une sorte de règle tacite : surprendre. Les sages d’Oslo ont couronné un genre littéraire parfois négligé – en tout cas en France – et un auteur discret, préoccupé de création davantage que de promotion.
Le Nobel de littérature 2013, chacun s’y attendait un peu, serait décerné à un auteur d’Amérique du Nord, si possible citoyen des États-Unis, sans doute une romancière, de toute façon un écrivain dont l’œuvre est abondante, presque un graphomane, bref un (ou une) habitué des épais, denses, roboratifs romans… Finalement, la lauréate est canadienne. Elle n’écrit quasiment que des nouvelles, son œuvre est resserrée et tourne autour de quelques thèmes qui lui sont chers. Alice Munro est un peu plus connue en France que le lauréat 2011, le poète suédois Tomas Transtrômer, mais il est certain que nos librairies bruissent depuis quelques jours de commentaires interrogatifs du genre : « Tu l’as lue toi ? », ou : « Par quoi il faut commencer ? » Ou des regrettables : « Mais moi je ne lis pas de nouvelles ! »… Car Alice Munro a écrit quatorze recueils de nouvelles et un seul roman. Voilà le « problème » et l’originalité de cette distinction. Une première. Car c’est la première fois que le Nobel revient à une auteure dont l’œuvre se compose presque exclusivement de nouvelles. Alice Munro est, par ailleurs, une artiste discrète, peu versée dans le vedettariat. Elle écrit ses textes, puis laisse le lecteur se débrouiller avec… ce qui n’est pas toujours évident, tant elle dépeint avec finesse, parfois ambiguïté, souvent pas mal de perversité, des personnages livrés aux difficultés du réel, des protagonistes féminins en proie à des questionnements spécifiques, les affres d’une réalité triviale et truffée d’entraves, toutes choses qui constituent la matière de ses textes. Si elle fait preuve d’une très grande empathie pour ses personnages, elle adore aussi les placer dans des situations cruellement ironiques. Derrière son air de vieille dame très digne, elle n’a en réalité rien à envier aux facétieux jurés suédois. Dans Fugitives, une jeune femme décide subitement de quitter l’homme qui la maltraite et la vie minable qui s’effondre autour d’elle. Elle part avec la complicité d’une voisine qui nourrit des sentiments ambigus à son égard. Puis, finalement trop attachée, prisonnière du regard de l’homme qui « la fait exister » – même si c’est pour exister comme cela ! –, elle décide très vite de revenir. Chez Alice Munro les hommes sont souvent minables et violents, les femmes irrésolues et incapables de se libérer de leurs prisons. Les destins et les vies se jouent à peu de choses, de minuscules événements, souvent imprévisibles, font basculer irrémédiablement le cours des existences. Amateurs d’héroïsme et de romantisme édifiants, passez votre chemin, comme l’écrivait si justement, en 1995, la journaliste Martine Laval : « Chez Alice Munro, il faut se marier, coûte que coûte. Sans joie et sans amour. On concocte, on arrange. On simule, on trahit, en douce. […] Chez Alice Munro, s’il est question d’amour, c’est parce qu’il n’existe pas. On se cherche, on se loupe. Si l’on se croise, on ne s’embrasse pas. » Munro sait parler de la honte d’une fille pour sa mère, de l’amour aussi, de la culpabilité que l’on peut éprouver à aimer, du regard qui change et des illusions qui tombent sans faire de bruit. Il y a d’autres bonnes raisons de lire Alice Munro. Elle a été libraire. Munro’s Books, la librairie qu’elle a ouverte avec son mari à Victoria, au Canada, existe toujours. Contrairement à Joyce Carol Oates – que j’aime beaucoup – elle a décidé d’arrêter d’écrire, il sera donc nettement plus facile de suivre sa production.