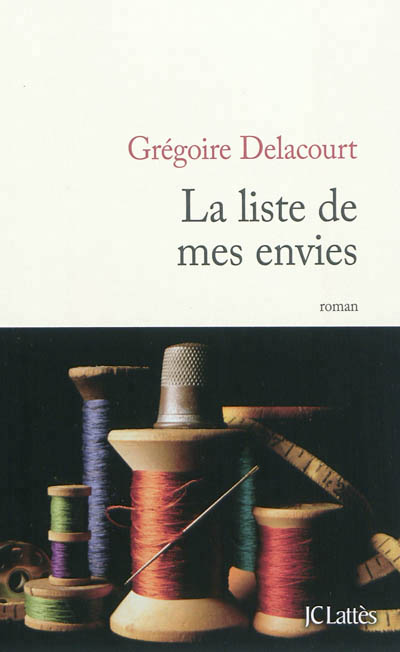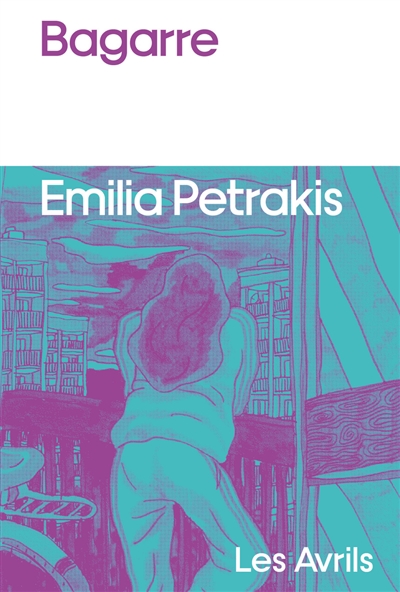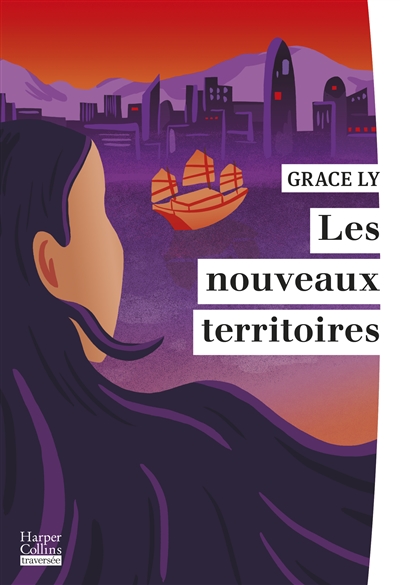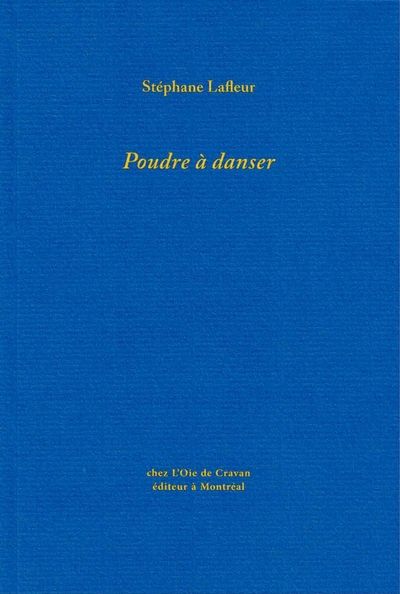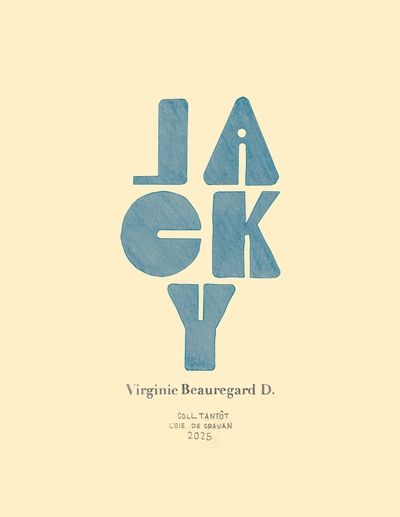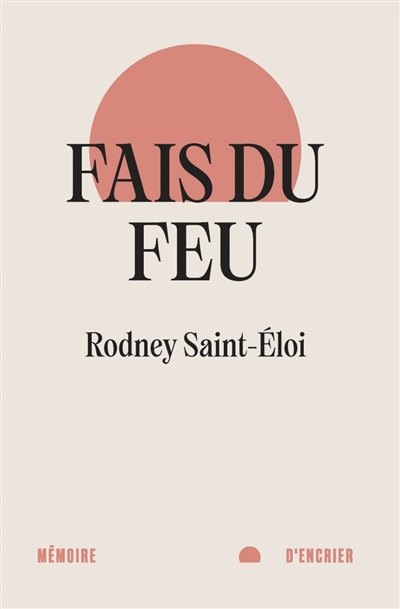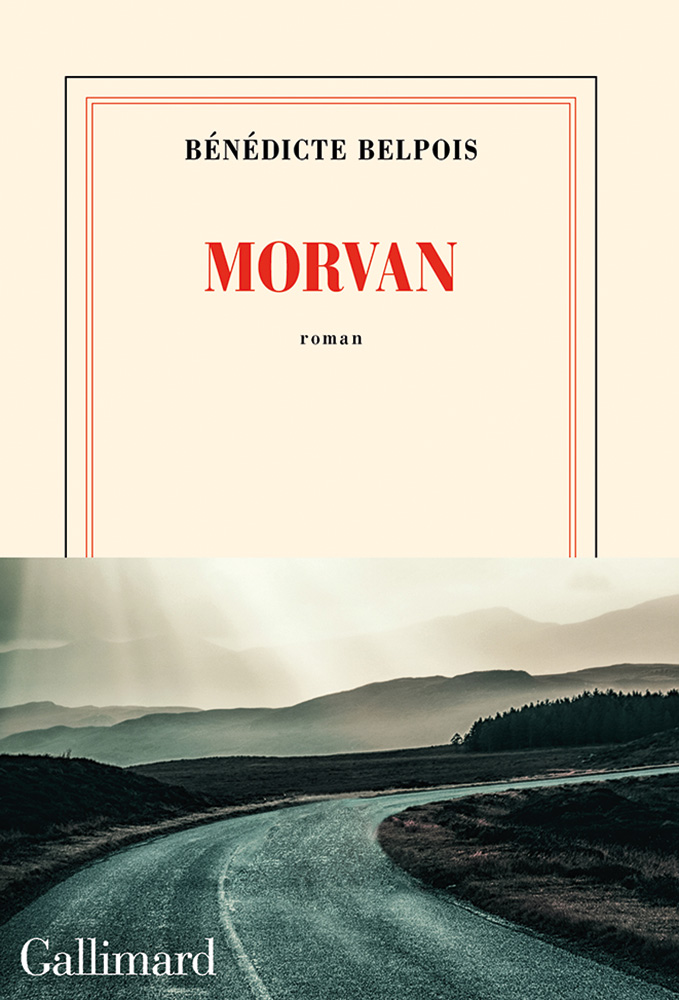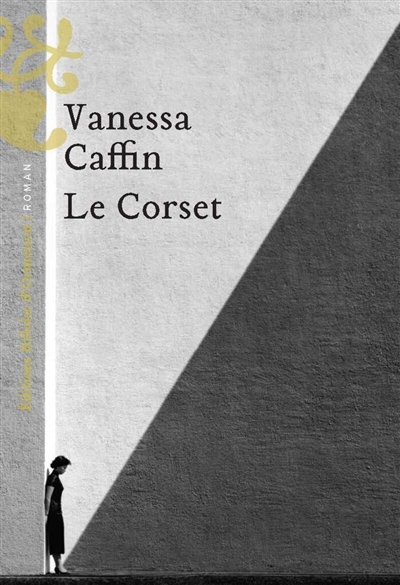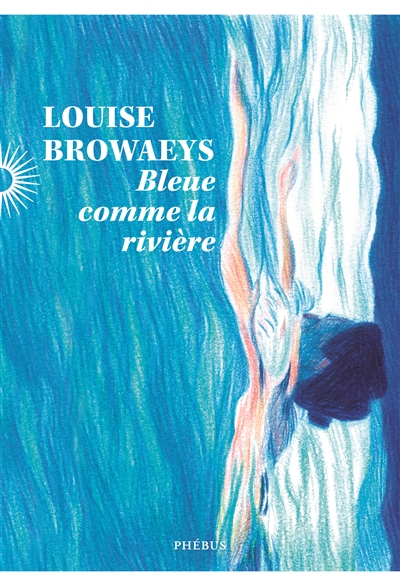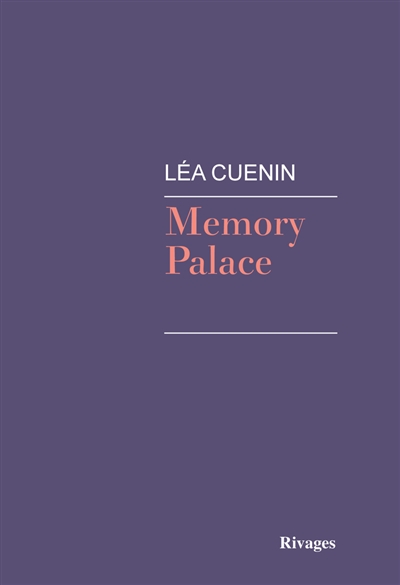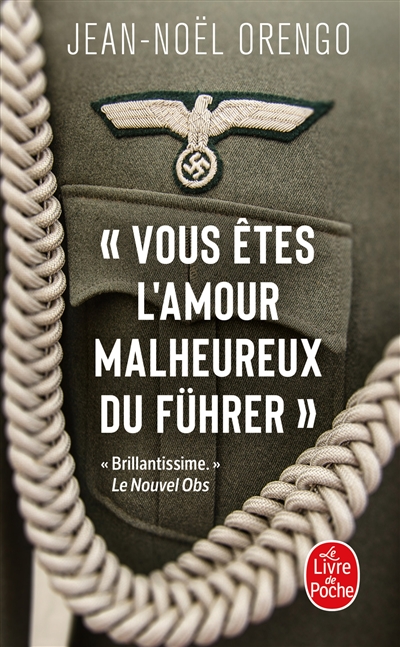PAGE : La narratrice de votre roman est une femme particulièrement attachante et émouvante mais j’aimerais que vous nous la présentiez vous-même.
Grégoire Delacourt : Tout d’abord, j’espère ne pas vous avoir déçue avec le titre ni avec le fait que j’aie cette fois pris la plume et le cœur d’une femme pour écrire. Cette femme, c’est Jocelyne Guerbette, 47 ans, mariée, trois enfants (un garçon, une fille et un cadavre). Elle rêvait d’être styliste à Paris, elle est mercière à Arras. Une jolie ville grise, une vie simple, honnête et au fond heureuse ; elle s’évade avec son blog dixdoigtsdor qui fait rêver des milliers de femmes, se grise des rêves légers de ses voisines Françoise et Danièle, et survit avec l’idée qu’elle se fait de l’amour : quelque chose de beau, de sérieux – qui pardonne beaucoup mais peut se dissoudre au contact de la trahison. À sa manière, elle est cousine des magnifiques Iseult, Mattie Silver (l’héroïne d’Ethan Frome de Wharton).
P. : Sur l’insistance de ses amies, elle joue au loto et gagne une somme considérable. L’attitude de Jo surprendra sans doute les lecteurs qui naturellement vont se projeter dans une situation similaire. On ne peut évidement pas dévoiler la suite, sinon qu’une de ses préoccupations est de rédiger la liste de ses envies mais pas celle de ses rêves...
G. D. : Les beaux rêves donnent envie de se réveiller, de marcher, de les poursuivre. Je ne suis pas sûr qu’ils soient faits pour être réalisés. Ils sont nos beaux combats quotidiens. Nos ailes. L’argent ne fait pas pousser les ailes. Elle l’écrit d’ailleurs : « L’argent ne fait pas l’amour ». Alors oui, lorsqu’il lui tombe dessus – et ce n’est pas tant l’argent que la possibilité qu’il représente de tout changer de sa vie – elle se demande ce qu’il y aurait à changer. Elle rédige des listes, la plus pragmatique (ses besoins), la liste de son cœur (ses envies), celle du frisson (ses folies). Elle va en réaliser certaines. Dans ses listes, il y a aussi les rêves des autres qu’elle pourrait concrétiser ; mais ce serait les amputer de leurs désirs, de l’attente qui est le sel de toute chose. « Après le désir toujours vient l’ennui », dit-elle aussi.
P. : Pourquoi est-elle si désabusée ?
G. D. : Être désabusé, c’est n’avoir plus d’illusions, et l’illusion est une perception faussée. Non. Elle n’est pas désabusée, juste réaliste, pragmatique ; elle sait où est le lieu de son bonheur, un petit territoire, près du cœur mais si loin, si difficile à atteindre. Sa petite fille mort-née, la férocité de son mari, la désinvolture de son fils l’ont endurcie ; la grande tendresse de sa fille, l’amitié des voisines, la grâce de ses lectrices l’ensoleillent. Elle a appris très tôt la douleur de la trahison, la violence de l’absence, la tragédie de la futilité des choses. En ce sens, elle est formidablement femme ; elle sait ce qu’elle peut perdre. Les hommes ne savent (et ne considèrent) que ce qu’ils peuvent gagner.
P. : Justement, parlez-nous des femmes. Dans vos romans ce sont des socles. Elles sont entreprenantes, courageuses, lucides. Les hommes semblent plus vacillants, fragiles voire fuyants.
G. D. : Ma mère était « une belle femme belle ». Une femme courageuse à l’époque où on demandait aux femmes d’être des bonniches disponibles. J’ai vu son combat, celui de ses amies, leurs pas, millimètre après millimètre, pour s’affranchir de l’arrogance des hommes. Leur force m’a bouleversé. Leur calme aussi, leur détermination. Les femmes sont heureuses parce qu’elles connaissent la vérité. Ou en tout cas la pressentent. Les hommes pas. J’ai eu la chance de grandir avec des femmes. Elles m’ont appris qu’il n’y a ni impudeur ni faiblesse à pleurer, à s’émerveiller, se laisser ravir.
P. : L’Écrivain de la famille a reçu pas moins de cinq prix littéraires. La Liste de mes envies a suscité un vif intérêt à la Foire du livre de Francfort et va être traduit dans de nombreuses langues. Que représente pour vous ce succès, en à peine deux livres ?
G. D. : C’est gentil, mais je crois qu’il est trop tôt pour parler de succès. Ce qui m’arrive est un formidable encouragement. Les très nombreuses lettres de lectrices notamment me bouleversent et me rassurent sur le fait que les livres ont encore un extraordinaire pouvoir. Participer à cette grâce est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. C’est une façon de remercier les livres qui m’ont fait grandir et aimer le monde.
P. : Certaines de vos phrases vous font paraître assez pessimiste. Cependant vous racontez de jolies histoires pleines de tendresse, de souffrances tues, de fragilités. Alors : écrire guérit-il ?
G. D. : Je ne sais pas si je suis pessimiste, mais je crois que l’amour et le couple sont des choses difficiles. Le désir est facile, mais après ? Ne sait-on qu’à la fin si on a vraiment aimé ? Qui aime-t-on en premier, l’autre ou soi ? Je ne sais pas. Tout cela est vertigineux. La famille aussi est un lieu difficile où sournoisement l’amour est obligatoire. Mais il y a toujours une « fille sur la voiture ». Il faut juste être prêt. Enfin, je ne sais pas si écrire guérit, mais ça apaise.
P. : Et lire a t-il les mêmes vertus ?
G. D. : Oh, oui ! Lire, c’est choisir d’être vivant. C’est se densifier. C’est rencontrer des personnes exceptionnelles. Quel bonheur quand un libraire me fait rencontrer la bonne personne. Grâce à eux, j’ai croisé Lily Bart (d’Edith Wharton), Leila Murray (de Laura Kasischke), Matt Scudder (de Lawrence Block), le petit Hercule (de Claude Ponti), Tralala (de Selby Jr.) et tant d’autres. Tant d’amis qui vous apprennent le monde.